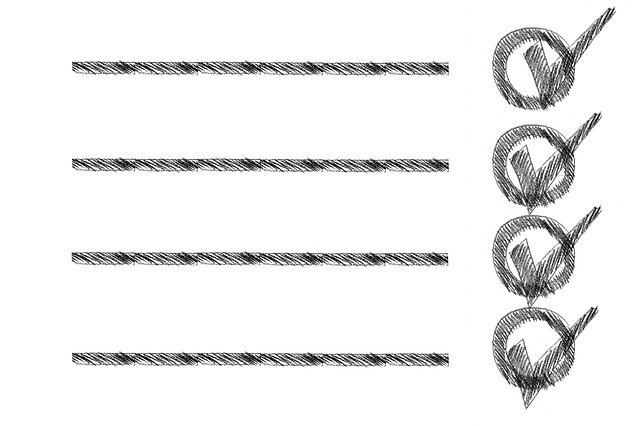Cinquième et dernière sanction susceptible d’être encourue par la partie qui a manqué à ses obligations contractuelles : la condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Cette sanction prévue par l’article 1217 du Code civil présente la particularité de pouvoir être cumulée avec les autres sanctions énoncées par le texte. Anciennement traitée aux articles 1146 à 1155 du Code civil, elle est désormais envisagée dans une sous-section 5 intitulée « la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat ».
Tel qu’indiqué par l’intitulé de cette sous-section 5, l’octroi des dommages et intérêts au créancier vise, à réparer les conséquences de l’inexécution contractuelle dont il est victime.
Si, à certains égards, le système ainsi institué se rapproche de l’exécution forcée par équivalent, en ce que les deux sanctions se traduisent par le paiement d’une somme d’argent, il s’en distingue fondamentalement, en ce que l’octroi de dommages et intérêts a pour finalité, non pas de garantir l’exécution du contrat, mais de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution du contrat. Les finalités recherchées sont donc différentes.
S’agissant de l’octroi de dommages et intérêts au créancier victime d’un dommage, le mécanisme institué aux articles 1231 et suivants du Code civil procède de la mise en œuvre d’une figure bien connue du droit des obligations, sinon centrale : la responsabilité contractuelle.
Classiquement, il est admis que cette forme de responsabilité se rapproche très étroitement de la responsabilité délictuelle.
Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que les deux régimes de responsabilité se confondent, bien que le maintien de leur distinction soit contesté par une partie de la doctrine.
?Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
- La responsabilité contractuelle désigne l’obligation de réparer les dommages résultant d’un défaut dans l’exécution d’un contrat : inexécution, mauvaise exécution ou encore exécution tardive.
- La responsabilité délictuelle, encore appelée extracontractuelle, sanctionne quant à elle les dommages causés à autrui en dehors de tout lien contractuel, l’obligation de réparation puisant alors à la seule source de la loi.
Deux thèses s’affrontent s’agissant du maintien de la dualité entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle :
- La thèse contre le maintien de la dualité
- Premier argument
- Le principe même de l’existence d’une responsabilité contractuelle est contesté.
- Pour les tenants de cette vision, la réparation des dommages causés par le défaut d’exécution d’un contrat relève du domaine de la responsabilité délictuelle ; en l’absence de dommage, seule l’exécution forcée du contrat peut être recherchée, le cas échéant sous la forme d’un équivalent pécuniaire à l’exécution en nature.
- Deuxième argument
- Les frontières entre le domaine de la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité délictuelle s’avèrent incertaines et mouvantes, l’évolution de la jurisprudence se caractérisant, pour l’essentiel, par un élargissement du domaine de la responsabilité contractuelle, un accroissement des obligations résultant du contrat et une extension des personnes liées par un contrat.
- Troisième argument
- La portée de la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle s’amenuise.
- Leurs régimes se ressemblent en effet sur bien des points – définition du préjudice réparable, établissement du lien de causalité, règles de prescription – et leurs résultats sont souvent semblables, de sorte qu’une erreur de qualification peut rester sans conséquence. Elle n’est pas sanctionnée par la Cour de cassation.
- La thèse pour le maintien de la dualité
- Premier argument
- La responsabilité contractuelle poursuit un objectif indemnitaire qui ne saurait se limiter à la seule fonction d’exécution forcée du contrat.
- En cas d’inexécution, le créancier insatisfait doit pouvoir non seulement exiger l’exécution du contrat ou sa résolution, mais aussi et cumulativement, le cas échéant, obtenir réparation.
- Or cette réparation, économiquement et juridiquement, ne se confond pas avec la prestation conventionnellement due.
- Deuxième argument
- Si les règles communes aux deux branches de la responsabilité l’emportent assez largement (…), il en subsiste d’autres qui, propres à la responsabilité contractuelle, font obstacle à une assimilation complète.
- Ainsi le principe selon lequel la réparation est à la mesure du dommage prévisible se justifie par le fait que l’économie du contrat consiste précisément à prévoir et à organiser, par anticipation, un rapport conventionnel.
- Les mêmes considérations conduisent à admettre plus largement le jeu de clauses exclusives ou limitatives de responsabilité en matière contractuelle.
La distinction entre les deux régimes de responsabilité a classiquement pour corollaire le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
?Principe de non-cumul
La jurisprudence a depuis longtemps posé un important principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle (V. en ce sens Cass. req. 21 janv. 1880).
Certains auteurs, minoritaires, étaient pourtant contre la reconnaissance de ce principe, au premier rang desquels figurait Planiol. Selon lui, partisan du cumul des responsabilités « la responsabilité délictuelle est préexistante à toute réglementation et se superpose seulement à la première à la manière d’un sédiment ».
La thèse avancée n’a cependant pas convaincu la Cour de cassation qui a toujours maintenu sa position.
Dans un arrêt du 11 janvier 1922 la haute juridiction a ainsi jugé que « les articles 1382 et suivants sont sans application lorsqu’il s’agit d’une faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un contrat » (Cass. civ. 11 janv. 1922).
Dans un arrêt du 11 janvier 1989, la Cour de cassation a encore considéré que « le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle » (Cass. 1ère civ. 11 janv. 1989, n°86-17.323).
Selon le principe du non-cumul encore qualifié de non-option, si un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, il n’est pas possible d’en demander la réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il n’est donc a fortiori pas possible de cumuler les deux voies et de demander réparation du même dommage sur deux fondements différents car il y aurait enrichissement sans cause de la victime à être indemnisée deux fois pour un seul dommage.
Les raisons de ce principe sont diverses. Il s’agit principalement d’éviter que le demandeur, en choisissant la voie de la responsabilité délictuelle, puisse échapper à des contraintes qu’il avait acceptées et qui rentraient dans les prévisions de son cocontractant, en particulier une clause limitative de responsabilité, ou encore se dispenser de la charge de la preuve, en invoquant la responsabilité de plein droit prévue par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil.
En faveur du cumul des responsabilités, on a surtout fait valoir que la responsabilité délictuelle serait une institution d’ordre public. Elle constituerait un minimum que le contrat pourrait augmenter mais non diminuer. Or les clauses limitatives de responsabilité sont admises.
Telles sont les raisons pour lesquelles, l’avant-projet de loi de réforme du droit de la responsabilité civile consacre ce principe de non-cumul sous réserve d’une exception très importante au profit des victimes de dommages corporels.
Celles-ci doivent pouvoir opter en faveur du régime qu’elles estiment leur être le plus favorable, à condition toutefois d’être en mesure d’apporter la preuve des conditions exigées pour justifier le type de responsabilité qu’elles invoquent.
?Un régime juridique provisoire
Ainsi qu’il l’est précisé dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, la réforme du droit des obligations n’opère aucun bouleversement radical en matière de responsabilité contractuelle.
En effet, la sous-section 5 consacrée à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est une reprise à droit constant de la section 4 du chapitre III de l’actuel titre III du code civil, avec quelques ajustements formels.
La raison en est, selon le rapport, que la responsabilité contractuelle ne peut être réformée isolément de la responsabilité extracontractuelle : il est généralement admis que, fondamentalement, ces deux formes de responsabilité sont des mécanismes de même nature, qui reposent sur l’existence d’un fait générateur, d’un dommage, et d’un lien de causalité entre les deux.
Seules des différences de régime les opposent, fondées essentiellement sur l’originalité du fait générateur en matière contractuelle, et que l’ordonnance du 10 février 2016 ne modifie pas.
Aussi, a-t-il été annoncé que le régime de la responsabilité contractuelle a vocation à être réformé dans le cadre du futur projet de réforme globale de la responsabilité civile, qui détaillera les dispositions communes aux responsabilités contractuelle et extracontractuelle, et les dispositions propres à chacun de ces deux régimes.
Pour l’heure, c’est seulement une modernisation du régime de la responsabilité contractuelle qui est intervenue, ce qui s’est traduit essentiellement par une codification des grands principes forgés par la jurisprudence antérieure.
Ces grands principes s’articulent autour de deux axes que sont :
- D’une part, les conditions de la responsabilité contractuelle
- D’autre part, l’aménagement de la responsabilité contractuelle
I) Les conditions de la responsabilité contractuelle
À l’instar de la responsabilité délictuelle la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
- L’inexécution d’une obligation contractuelle
- Un dommage
- Un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage
A) L’inexécution d’une obligation contractuelle
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il ressort de cette disposition que, pour être remplie, la condition tenant à l’exécution contractuelle, un manquement contractuel doit, d’une part, être caractérisé. D’autre part, ce manquement doit pouvoir être imputé au débiteur, faute de quoi sa responsabilité ne pourra pas être recherchée.
1. L’exigence d’un manquement contractuel
L’article 1231-1 du Code civil subordonne la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle à l’existence :
- Soit à l’inexécution de l’obligation
- Soit d’un retard dans l’exécution de l’obligation
Il ressort de cette disposition que l’inexécution contractuelle doit être entendue largement, celle-ci pouvant être totale ou partielle. Mais elle peut également consister en une exécution tardive ou défectueuse.
Plus généralement, l’inexécution visée par l’article 1231-1 du Code civil s’apparente en un manquement, par le débiteur, aux stipulations contractuelles.
La question qui alors se pose est de savoir en quoi ce manquement doit-il consister pour être générateur de responsabilité contractuelle ; d’où il s’ensuit la problématique de la preuve.
a. Le contenu du manquement
Très tôt la question s’est donc posée de savoir ce que l’on doit entendre par manquement contractuel, le Code civil étant silencieux sur ce point.
Plus précisément on s’est demandé si, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le manquement constaté devait être constitutif d’une faute ou si l’établissement d’une faute était indifférent.
a.1. Problématique de la faute
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil semblait apporter deux réponses contradictoires à cette interrogation.
- D’un côté, l’article 1137, al. 1er disposait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. »
- On en déduisait, que pour rechercher la responsabilité contractuelle du débiteur, il appartenait au créancier, non seulement de rapporter la preuve d’une inexécution, mais encore d’établir que le débiteur ne s’était pas comporté en bon père de famille.
- Classiquement, l’expression « bon père de famille » désigne la personne qui est avisée, soignée et diligente.
- Conformément à cette définition, le débiteur ne pourrait, dès lors, voir sa responsabilité contractuelle engagée que s’il peut lui être reproché des faits de négligence ou d’imprudence que le contractant, bon père de famille, placé dans les mêmes conditions, n’aurait pas commis.
- D’un autre côté, l’article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- À la différence de l’ancien article 1137 du Code civil cette disposition n’exigeait pas du créancier qu’il prouve que le débiteur ne s’est pas comporté en bon père de famille pour que sa responsabilité puisse être recherchée.
- Il s’évinçait donc de l’article 1147 que l’absence de faute du débiteur était sans incidence : seule importe l’existence d’une inexécution contractuelle.
Au bilan, tandis que l’ancien article 1137 du Code civil subordonnait la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle à l’établissement d’une faute, l’article 1147 ne l’exigeait pas, la seule inexécution contractuelle se suffisant à elle-même.
Pour sortir de l’impasse et résoudre cette contradiction, un auteur, René Demogue, suggéra de raisonner en opérant une distinction entre :
- D’une part, les obligations de moyens qui relèveraient de l’application de l’article 1137 du Code civil
- D’autre part, les obligations de résultat qui obéiraient, quant à elles, à la règle posée à l’article 1147
a.2. Obligations de moyens et obligations de résultat
?Exposé de la distinction
Demogue soutenait ainsi que la conciliation entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil tenait à la distinction entre les obligations de résultat et les obligations de moyens :
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur est contraint d’atteindre un résultat déterminé
- Exemple: Dans le cadre d’un contrat de vente, pèse sur le vendeur une obligation de résultat : celle livrer la chose promise. L’obligation est également de résultat pour l’acheteur qui s’engage à payer le prix convenu.
- Il suffira donc au créancier de démontrer que le résultat n’a pas été atteint pour établir un manquement contractuel, source de responsabilité pour le débiteur
- L’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie du résultat
- Exemple: le médecin a l’obligation de soigner son patient, mais n’a nullement l’obligation de le guérir.
- Dans cette configuration, le débiteur ne promet pas un résultat : il s’engage seulement à mettre en œuvre tous les moyens que mettrait en œuvre un bon père de famille pour atteindre le résultat
La distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat rappelle immédiatement la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 du Code civil.
- En matière d’obligation de moyens
- Pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis une faute, soit que, en raison de sa négligence ou de son imprudence, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat promis.
- Cette règle n’est autre que celle posée à l’ancien article 1137 du Code civil.
- En matière d’obligation de résultat
- Il est indifférent que le débiteur ait commis une faute, sa responsabilité pouvant être recherchée du seul fait de l’inexécution du contrat.
- On retrouve ici la règle édictée à l’ancien article 1147 du Code civil.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer si une obligation est de moyens ou de résultat.
?Critères de la distinction
En l’absence d’indications textuelles, il convient de se reporter à la jurisprudence qui se détermine au moyen d’un faisceau d’indices.
Plusieurs critères – non cumulatifs – sont, en effet, retenus par le juge pour déterminer si l’on est en présence d’une obligation de résultat ou de moyens :
- La volonté des parties
- La distinction entre obligation de résultat et de moyens repose sur l’intensité de l’engagement pris par le débiteur envers le créancier.
- La qualification de l’obligation doit donc être appréhendée à la lumière des clauses du contrat et, le cas échéant, des prescriptions de la loi.
- En cas de silence de contrat, le juge peut se reporter à la loi qui, parfois, détermine si l’obligation est de moyens ou de résultat.
- En matière de mandat, par exemple, l’article 1991 du Code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».
- C’est donc une obligation de résultat qui pèse sur le mandataire.
- Le contrôle de l’exécution
- L’obligation est de résultat lorsque le débiteur a la pleine maîtrise de l’exécution de la prestation due.
- Inversement, l’obligation est plutôt de moyens, lorsqu’il existe un aléa quant à l’obtention du résultat promis
- En pratique, les obligations qui impliquent une action matérielle sur une chose sont plutôt qualifiées de résultat.
- À l’inverse, le médecin, n’est pas tenu à une obligation de guérir (qui serait une obligation de résultat) mais de soigner (obligation de moyens).
- La raison en est que le médecin n’a pas l’entière maîtrise de la prestation éminemment complexe qu’il fournit.
- Rôle actif/passif du créancier
- L’obligation est de moyens lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution de l’obligation qui échoit au débiteur
- En revanche, l’obligation est plutôt de résultat, si le créancier n’intervient pas
?Mise en œuvre de la distinction
Le recours à la technique du faisceau d’indices a conduit la jurisprudence à ventiler les principales obligations selon qu’elles sont de moyens ou de résultat.
L’examen de la jurisprudence révèle néanmoins que cette dichotomie entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’est pas toujours aussi marquée.
Il est, en effet, certaines obligations qui peuvent être à cheval sur les deux catégories, la jurisprudence admettant, parfois, que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il n’a commis aucune faute.
Pour ces obligations on parle d’obligations de résultat atténué ou d’obligation de moyens renforcée : c’est selon. Trois variétés d’obligations doivent donc, en réalité, être distinguées.
- Les obligations de résultat
- Au nombre des obligations de résultat on compte notamment :
- L’obligation de payer un prix, laquelle se retrouve dans la plupart des contrats (vente, louage d’ouvrage, bail etc.)
- L’obligation de délivrer la chose en matière de contrat de vente
- L’obligation de fabriquer la chose convenue dans le contrat de louage d’ouvrage
- L’obligation de restituer la chose en matière de contrat de dépôt, de gage ou encore de prêt
- L’obligation de mettre à disposition la chose et d’en assurer la jouissance paisible en matière de contrat de bail
- L’obligation d’acheminer des marchandises ou des personnes en matière de contrat de transport
- L’obligation de sécurité lorsqu’elle est attachée au contrat de transport de personnes (V. en ce sens Cass. ch. mixte, 28 nov. 2008, n° 06-12.307).
- Les obligations de résultat atténuées ou de moyens renforcées
- Parfois la jurisprudence admet donc que le débiteur d’une obligation de résultat puisse s’exonérer de sa responsabilité.
- Pour ce faire, il devra renverser la présomption de responsabilité en démontrant qu’il a exécuté son obligation sans commettre de faute.
- Tel est le cas pour :
- L’obligation de conservation de la chose en matière de contrat de dépôt
- L’obligation qui pèse sur le preneur en matière de louage d’immeuble qui, en application de l’article 1732 du Code civil, « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute »
- L’obligation de réparation qui échoit au garagiste et plus généralement à tout professionnel qui fournit une prestation de réparation de biens (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 2 févr. 1994, n°91-18764).
- L’obligation qui échoit sur le transporteur, en matière de transport maritime, qui « est responsable de la mort ou des blessures des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable ni à sa faute ni à celle de ses préposés » (art. L. 5421-4 du code des transports)
- L’obligation de conseil que la jurisprudence appréhende parfois en matière de contrats informatiques comme une obligation de moyen renforcée.
- Les obligations de moyens
- À l’analyse les obligations de moyens sont surtout présentes, soit dans les contrats qui portent sur la fourniture de prestations intellectuelles, soit lorsque le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa
- Aussi, au nombre des obligations de moyens figurent :
- L’obligation qui pèse sur le médecin de soigner son patient, qui donc n’a nullement l’obligation de guérir (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 janv. 2005, n°03-13.579).
- Par exception, l’obligation qui échoit au médecin est de résultat lorsqu’il vend à son patient du matériel médical qui est légitimement en droit d’attendre que ce matériel fonctionne (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 23 nov. 2004, n°03-12.146).
- Il en va de même s’agissant de l’obligation d’information qui pèse sur le médecin, la preuve de l’exécution de cette obligation étant à sa charge et pouvant se faire par tous moyens.
- L’obligation qui pèse sur la partie qui fournit une prestation intellectuelle, tel que l’expert, l’avocat (réserve faite de la rédaction des actes), l’enseignant,
- L’obligation qui pèse sur le mandataire qui, en application de l’article 1992 du Code civil « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
- L’obligation de surveillance qui pèse sur les structures qui accueillent des enfants ou des majeurs protégés (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 11 mars 1997, n°95-12.891).
?Sort de la distinction après la réforme du droit des obligations
La lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 révèle que la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat n’a pas été reprise par le législateur, à tout le moins formellement.
Est-ce à dire que cette distinction a été abandonnée, de sorte qu’il n’a désormais plus lieu d’envisager la responsabilité du débiteur selon que le manquement contractuel porte sur une obligation de résultat ou de moyens ?
Pour la doctrine rien n’est joué. Il n’est, en effet, pas à exclure que la Cour de cassation maintienne la distinction en s’appuyant sur les nouveaux articles 1231-1 et 1197 du Code civil, lesquels reprennent respectivement les anciens articles 1147 et 1137.
Pour s’en convaincre il suffit de les comparer :
- S’agissant des articles 1231-1 et 1147
- L’ancien article 1147 prévoyait que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
- Le nouvel article 1231-1 prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
- S’agissant des articles 1197 et 1137
- L’ancien article 1137 prévoyait que « l’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables ».
- Le nouvel article 1197 prévoit que « l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
Une analyse rapide de ces dispositions révèle que, au fond, la contradiction qui existait entre les anciens articles 1137 et 1147 a survécu à la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi de ratification du 21 avril 2018, de sorte qu’il y a tout lieu de penser que la Cour de cassation ne manquera pas de se saisir de ce constat pour confirmer la jurisprudence antérieure.
b. La preuve du manquement
La mise en œuvre de la responsabilité du débiteur est subordonnée à la preuve d’un manquement contractuel.
Deux questions alors se posent :
- D’une part, sur qui pèse la charge de la preuve ?
- D’autre part, quel est l’objet de la preuve ?
Ces questions sont manifestement indissociables de la problématique consistant à se demander si, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le manquement constaté doit être constitutif d’une faute ou si l’établissement d’une faute est indifférent.
Le régime de la preuve en matière contractuelle est, en effet, radicalement différent selon que la mise en œuvre de la responsabilité du débiteur est ou non subordonnée à la caractérisation d’une faute.
On en revient alors à la distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat qui détermine le régime probatoire applicable.
- Lorsque l’obligation est de moyen, le créancier doit établir la faute du débiteur
- Autrement dit, il doit démontrer que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour atteindre le résultat convenu ainsi que l’aurait fait le bon père de famille.
- La gravité de la faute ici importe peu : la responsabilité du débiteur est engagée dès lors qu’il est établi qu’il a manqué à ses obligations contractuelles par négligence ou une imprudence.
- Cette gravité de la faute ne sera prise en compte que pour déterminer s’il y a lieu d’exclure les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité.
- Lorsque l’obligation est de résultat, il suffit au créancier de démontrer que le résultat promis n’a pas été atteint
- Dans cette configuration, la charge de la preuve est en quelque sorte inversée : ce n’est pas au créancier de démontrer que le débiteur a manqué à ses obligations, mais au débiteur de prouver que le résultat stipulé au contrat a bien été atteint.
- L’exécution, même partielle, des obligations du débiteur, ne lui permet pas de s’exonérer de sa responsabilité.
- Seul compte ici l’atteinte du résultat auquel s’est engagé le débiteur.
- Pour s’exonérer de sa responsabilité, ce dernier ne disposera que d’une seule option : établir la survenance d’une cause étrangère.
2. L’imputabilité du manquement
S’il est absolument nécessaire pour que le débiteur d’une obligation engage sa responsabilité qu’une inexécution du contrat, même partielle, puisse lui être reprochée, il est indifférent que cette inexécution ne résulte pas de son fait personnel.
Lorsque, en effet, l’inexécution contractuelle est imputable au fait d’autrui ou au fait d’une chose, le débiteur est également susceptible d’engager sa responsabilité.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir dans quelle mesure le débiteur répond-il du fait d’autrui et du fait d’une chose.
?L’inexécution contractuelle est imputable au fait d’autrui
Il est classiquement admis que le débiteur d’une obligation peut engager sa responsabilité contractuelle du fait d’autrui.
Tout d’abord, la loi prévoit de nombreux cas de responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Il en va ainsi en matière de :
- Contrat de bail, le preneur répondant des dégradations et des pertes qui arrivent par « le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires » (art. 1735 C.civ.)
- Contrat d’entreprise, le maître d’ouvrage répondant « du fait des personnes qu’il emploie » (art. 1797 C. civ.)
- Contrat d’hôtellerie, l’hôtelier étant responsable « du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel. » (art. 1953 C. civ.)
- Contrat de mandat, le mandataire répondant « de celui qui s’est substitué dans sa gestion (art. 1994 C. civ.)
- Contrat de transport, le commissionnaire de transport étant « garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » (art. L. 132-6 C. com.)
Ensuite, la jurisprudence reconnaît la responsabilité contractuelle du fait d’autrui lorsque le débiteur a volontairement introduit un tiers dans l’exécution de son obligation.
Il en va ainsi du préposé, du sous-traitant, du mandataire, des représentants du débiteur et plus généralement de tous ceux interviennent sur la demande du débiteur dans la relation contractuelle.
Il en résulte a contrario que lorsque l’intervention du tiers est spontanée, le débiteur n’engage pas sa responsabilité contractuelle en cas d’inexécution contractuelle du fait de ce tiers.
Dans un arrêt du 15 janvier 1993 la Cour d’appel de Grenoble a parfaitement résumé la règle en affirmant que « la responsabilité contractuelle du fait d’autrui couvre les fautes de toutes les personnes auxquelles le débiteur de l’obligation fait appel pour l’exécution du contrat » (CA Grenoble, 15 janv. 1993).
Reste que la responsabilité contractuelle du fait d’autrui ne va en général conduire à faire peser la charge de la dette de réparation sur la tête du cocontractant débiteur que de manière temporaire.
En effet, celui-ci sera fondé, dans le cadre de l’exercice d’une action récursoire, à obtenir le remboursement des sommes qu’il aura exposées auprès du tiers à l’origine du dommage.
?L’inexécution contractuelle est imputable au fait d’une chose
Bien que le Code civil soit silencieux sur la responsabilité contractuelle du fait des choses, elle a pourtant été conceptualisée par la doctrine qui distingue deux hypothèses :
- Première hypothèse : la chose est l’objet de l’obligation
- Cette hypothèse renvoie aux contrats qui ont pour objet le transfert de propriété de la chose ou sa mise à disposition.
- Tel est le cas des contrats de vente, d’entreprise ou encore de bail
- Pour ces contrats, le contractant qui transfère la propriété ou la jouissance de la chose est, la plupart du temps, tenu de garantir son cocontractant contre les vices cachés
- Aussi, lorsqu’un tel vice affecte l’usage de la chose, l’inexécution contractuelle a bien pour origine cette chose.
- Le débiteur de l’obligation de garantie engage donc bien sa responsabilité contractuelle du fait de la chose objet du contrat.
- Seconde hypothèse : la chose est un moyen d’exécuter l’obligation
- Cette hypothèse renvoie principalement aux contrats d’entreprise dont l’exécution suppose l’utilisation de choses par le maître d’œuvre tels que, par exemple, des outils ou des instruments.
- Aussi, le maître d’œuvre engage sa responsabilité lorsqu’un dommage est causé par l’une des choses qu’il avait sous sa garde et qu’il a utilisée pour fournir la prestation promise.
B) Le dommage
À titre de remarque liminaire, il peut être observé que l’utilisation du terme dommage ou de préjudice est indifférente. La plupart des auteurs les tiennent pour synonymes.
Pour certains, il convient néanmoins de les distinguer en ce que :
- Le dommage serait le fait brut originaire de la lésion affectant la victime
- Le préjudice constituerait, quant à lui, la conséquence de cette lésion
Toujours est-il que, à l’instar de la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle requiert la caractérisation d’un préjudice. La réparation due au créancier de l’obligation demeura néanmoins limitée au préjudice prévisible.
1. L’exigence d’un préjudice
Alors que la responsabilité délictuelle ne se conçoit pas en dehors de l’existence d’un dommage, la question s’est posée en matière de responsabilité contractuelle.
On s’est, en effet, demandé s’il était nécessaire de rapporter la preuve d’un dommage pour engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant.
Cette interrogation a suscité vif débat en doctrine, notamment en suite d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2002.
Dans cette décision, la troisième chambre civile avait, au visa de l’article 1147 du Code civil ensemble l’article 1731, affirmé que « l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est subordonnée ni à l’exécution de ces réparations ni à la justification d’un préjudice » (Cass. 3e civ. 30 janv. 2002, n°00-15.784).
Par cette décision, il était donc admis qu’en matière de bail le créancier n’avait pas à justifier d’un préjudice pour engager la responsabilité contractuelle du preneur.
Finalement, la Cour de cassation est revenue sur sa position dans un arrêt du 3 décembre 2003 aux termes duquel elle a jugé que « dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle » (Cass. 3e civ. 3 déc. 2003, n°02-18.033).
Cette position a manifestement été confirmée par le législateur à l’occasion de la réforme du droit des obligations, lequel n’a pas repris l’ancien article 1145 du Code civil, disposition sur laquelle s’appuyait la jurisprudence pour écarter l’exigence du préjudice en matière de responsabilité contractuelle.
À cet égard l’article 1145 disposait que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. »
Aussi, la Cour de cassation en déduisait que pour les obligations de ne pas faire, il n’y avait pas lieu pour le créancier de justifier d’un préjudice, ce qui était une lecture pour le moins erronée du texte, celui-ci le dispensant seulement de mettre en demeure son débiteur (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 10 mai 2005, n°02-15.910).
En tout état de cause, l’article 1145 du Code civil a été écarté par l’ordonnance du 10 février 2016 qui a, en revanche, repris l’ancien article 1149 devenu 1231-2.
Cette disposition prévoit, pour mémoire, que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
La lettre du texte ne laisse que peu de place au doute quant à l’exigence d’établir un préjudice pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur.
2. Les caractères du préjudice
Reprenant les termes de l’ancien article 1149 du Code civil, l’article 1231-2 issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
L’article 1231-3 ajoute que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Il ressort de la combinaison de ces deux dispositions que, pour être réparable, le préjudice qui résulte d’une inexécution contractuelle doit
- D’une part, être certain.
- D’autre part, être prévisible
a. Un préjudice certain
Si l’on se reporte à la définition du dictionnaire, est certain ce qui ne fait pas de doute, ce qui est conforme aux critères de la vérité.
Ainsi, le dommage est certain lorsqu’il est établi et avéré.
Le dommage certain s’oppose, en ce sens, au préjudice éventuel, soit le préjudice dont on ne sait pas s’il se produira.
Pratiquement, par certitude du dommage, il faut entendre, au sens de l’article 1231-2 du Code civil, que le dommage s’est réalisé :
- Soit parce que la victime a éprouvé une perte (1)
- Soit parce que la victime a manqué un gain (2)
a.1 La victime a éprouvé une perte
La perte éprouvée par la victime peut être :
- Soit actuelle
- Soit future
i. Le préjudice actuel
Le dommage actuel est celui qui s’est déjà réalisé. À la vérité, lorsque le dommage est déjà survenu, cette situation ne soulève guère de difficulté s’agissant de l’indemnisation de la victime.
Mais quid lorsque le dommage ne s’est pas encore réalisé ? Peut-on réparer un préjudice futur ?
ii. Le préjudice futur
?Préjudice futur et préjudice actuel
Contrairement à une idée reçue, le préjudice futur ne s’oppose pas au préjudice actuel en ce qu’il ne serait pas réparable.
Ces deux sortes de préjudice s’opposent uniquement en raison de leur date de survenance.
Au vrai, dès lors que le préjudice futur et le préjudice actuel présentent un caractère certain, tous deux sont réparables.
?Préjudice futur et préjudice éventuel
En matière de responsabilité, le préjudice futur s’oppose, en réalité, au préjudice éventuel dont la réalisation n’est pas certaine.
Dès lors que l’éventualité du préjudice « ne s’est pas transformée en certitude », pour reprendre une expression de François Terré, le préjudice n’est pas réparable, contrairement au préjudice futur dont la réalisation est certaine.
?Le préjudice futur certain
Ce qui importe c’est donc que le préjudice futur soit certain pour être réparable.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer ce principe en jugeant, dès 1932 que « s’il n’est pas possible d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate » (Cass. crim., 1er juin 1932).
Surtout, le projet de réforme de la responsabilité civile envisage l’introduction d’un article 1236 dans le Code civil qui disposerait que « le préjudice futur est réparable lorsqu’il est la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel »
Exemples :
- Dans un arrêt du 13 mars 1967, la Cour de cassation a estimé que la victime d’un accident de la circulation était fondée à obtenir réparation du préjudice futur occasionné par l’ablation de la rate, laquelle est de nature à raccourcir son espérance de vie (Cass. 2e civ., 13 mars 1967).
- Dans un arrêt du 3 mars 1993, la Cour de cassation a jugé que « des propriétaires d’immeubles justifiaient d’un préjudice certain du fait de la présence d’une ancienne carrière de calcaire asphaltique et du classement, à la suite d’effondrements du sol, comme zone de risque d’une partie du territoire de la commune, dès lors qu’elle relève que les tassements de sol se poursuivront de façon lente et irrégulière, avec parfois une accélération brutale, imprévisible et dangereuse, et que le sous-sol étant “déconsolidé” d’une manière irréversible, les immeubles seront soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres voire à un effondrement qui les rendra inhabitables » (Cass. 2e civ., 3 mars 1993, n°91-17.199).
a.2 La victime a manqué un gain
Le dommage réparable ne consiste pas toujours en une perte pour la victime ; il peut également s’agir d’un manque à gagner.
La Cour de cassation qualifie ce manque à gagner, lorsqu’il est réparable, de perte d’une chance.
?Reconnaissance de la perte d’une chance comme préjudice réparable
Dans un arrêt fondateur du 17 juillet 1889 la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, le caractère réparable de la perte de chance.
En l’espèce, le client d’un huissier de justice est privé de la possibilité de faire appel d’un jugement et, par voie de conséquence, de gagner son procès en raison de la faute commise par l’officier ministériel, laquelle faute a entraîné la nullité de l’acte portant déclaration d’appel.
La Cour de cassation reconnaît au client de l’étude un droit à réparation, sur le fondement de la perte de chance (Cass. req., 17 juill. 1889)
Depuis lors, la Cour de cassation reconnaît de façon constante à la perte de chance le caractère de préjudice réparable (V. en ce sens Cass. 1re civ., 27 janv. 1970, n°68-12.782 ; Cass. 2e civ., 7 févr. 1996, n°94-12.965 ; Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n°12-14.439)
?Définition
La Cour de cassation définit la perte de chance comme « la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que ; par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 18 mars 1975, n°74-92.118).
Dans un arrêt du 4 décembre 1996, la Cour de cassation a sensiblement rectifié sa définition de la perte de chance en jugeant que « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de l’infraction, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 4 déc. 1996, n°96-81.163).
?Conditions
Il ressort des définitions retenues par la Cour de cassation de la perte de chance que pour être réparable, elle doit satisfaire à plusieurs conditions :
- L’éventualité favorable doit exister
- Autrement dit, la victime doit avoir été en position de chance, position dont elle a été privée en raison de la production du fait dommageable.
- Exemple : la Cour de cassation a-t-elle refusé d’indemniser un ouvrier boulanger, victime d’un accident le privant de la possibilité d’ouvrir sa propre boulangerie, dans la mesure où il n’avait effectué aucune démarche en ce sens (Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n°96-11.816).
- Le critère utilisé par la Cour de cassation afin de déterminer si l’éventualité existe est, le plus souvent, le bref délai.
- Moins l’éventualité favorable espérée par la victime se réalisera à brève échéance et plus le juge sera réticent à reconnaître la perte de chance.
- La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle
- Autrement dit, la perte de chance ne doit pas être hypothétique.
- La disparition de l’événement favorable doit être acquise, certaine.
- En somme, la condition qui tient au caractère réel de la perte de chance n’est autre que la traduction de l’exigence d’un préjudice certain.
- La victime ne doit pas avoir la possibilité de voir se représenter l’éventualité favorable espérée.
- En somme, la disparition de cette éventualité doit être irréversible.
- Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que le candidat qui a perdu la chance de se présenter à un concours ne peut obtenir réparation de son préjudice, dès lors qu’il a la possibilité de s’inscrire une nouvelle fois audit concours (Cass. 2e civ., 24 juin 1999, n°97-13.408).
- La chance perdue doit être sérieuse
- Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise (V. en ce sens Cass. 1er civ. 4 avr. 2001, n°98-23.157).
- On peut ainsi douter du caractère sérieux de la chance d’un étudiant de réussir un concours, s’il n’a pas été assidu en cours et s’il ne s’est livré à aucune révision.
- On peut également douter du sérieux de la chance d’un justiciable de gagner un procès, dans l’hypothèse où il ne dispose d’aucune preuve de ce qu’il avance.
?Présomption du préjudice
Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de cassation a posé une présomption de certitude de la perte de chance, « chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable » (Cass. 1ère civ. 14 oct. 2010, n°09-69.195).
Autrement dit, la haute juridiction estime que le préjudice est certain, et donc réparable, dès lors qu’est établie la disparition du gain espéré par la victime.
Il s’agit d’une présomption simple, qui donc supporte la preuve du contraire.
?Réparation de la perte d’une chance
Dans la mesure où la réalisation de l’événement favorable n’est, par définition, pas certaine, l’indemnité allouée à la victime ne saurait égaler le gain espéré.
Ainsi, le montant de la réparation du préjudice sera-t-il toujours proportionnel à la probabilité que l’événement se réalise (Cass. 1ère civ., 27 mars 1973, n°71-14.587).
Le juge devra donc toujours prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice.
?Contrôle exercé par la Cour de cassation
L’évaluation de la perte de chance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour de cassation ne contrôlera que la prise en compte de l’aléa dans l’indemnisation.
Elle rappelle en ce sens régulièrement que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1er civ., 9 avr. 2002, n°00-13.314).
b. Un préjudice prévisible
L’article 1231-3 du Code civil prévoit que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
Pour être réparable, le préjudice qui résulte d’une inexécution contractuelle doit ainsi être prévisible, soit avoir été envisagé contractuellement par les parties.
Lorsque, toutefois, une faute lourde ou dolosive est susceptible d’être reprochée au débiteur, le son cocontractant sera fondé à réclamer une réparation intégrale de son préjudice, soit au-delà de ce qui avait été prévu au contrat.
?Principe
C’est là une différence fondamentale avec la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle ne donne pas lieu à application du principe de réparation intégrale du dommage.
En effet, l’article 1231-3 du Code civil dispose que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat […] ».
Cette règle procède de l’idée, comme rappelé dans le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 que le contrat est avant tout un instrument de prévisibilité.
Il est donc logique d’en limiter la réparation aux dommages qui ont été prévus ou qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat.
À cet égard, la prévisibilité porte tant sur la cause du dommage (sa nature) que sur sa quotité (son montant).
Aussi, en matière de contrat de transport par exemple, il ne suffit pas que le transporteur soit en mesure de prévoir les dommages susceptibles d’advenir aux marchandises pour que son cocontractant soit fondé à solliciter une complète indemnisation en cas de sinistre.
Il faut encore que les parties aient prévu la valeur des marchandises acheminées, en particulier si elle est élevée. À défaut, l’indemnisation sera limitée au remboursement du prix moyen des marchandises qu’il transporte habituellement.
Ainsi, l’exigence de prévisibilité du préjudice suppose que celui qui s’engage soit en mesure de savoir à quoi il s’expose dans l’hypothèse où l’inexécution de son obligation cause un dommage à son cocontractant.
Lorsque, dès lors, la prestation porte sur une chose, le débiteur doit en connaître la valeur, faute de quoi en cas de perte, de disparition ou de détérioration, les dommages et intérêts alloués au créancier de l’obligation inexécutée ne pourront pas correspondre à cette valeur.
?Exception
Par exception au principe de prévisibilité du préjudice, l’article 1231-3 du Code civil pose que, en cas de faute lourde ou dolosive, la réparation du préjudice causé au cocontractant est intégrale.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par faute dolosive et faute lourde.
Si les textes sont silencieux sur ce point, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l’imprudence délibérée dans ce cas confinant à l’intention. »
C’est donc vers la jurisprudence antérieure qu’il convient de se tourner pour déterminer ce que l’on doit entendre par faute lourde et par faute dolosive.
La différence entre les deux fautes tient, en substance, à l’intention de l’auteur de la faute :
- La faute lourde
- Elle est définie par la jurisprudence, selon la formule consacrée, comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté » (V. en ce sens Cass. Ch. Mixte 22 avr. 2005, n° 03-14.112).
- La faute lourde comprend donc deux éléments :
- Un élément subjectif : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
- Un élément objectif : l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.
- La faute dolosive
- Elle est définie quant à elle comme l’inexécution délibérée, et donc volontaire, des obligations contractuelles.
- À cet égard dans un arrêt du 27 juin 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le constructeur […] est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles » (Cass. 3e civ. 27 juin 2001, n°99-21.017).
- Il ressort de la jurisprudence que la faute dolosive suppose que le débiteur ait seulement voulu manquer à ses obligations contractuelles. Il est indifférent qu’il ait voulu causer un préjudice à son cocontractant.
Nonobstant la différence qui existe entre ces deux notions, la faute lourde est régulièrement assimilée à la faute dolosive par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation a ainsi rappelé que « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité » (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2014, n°13-21.980).
L’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive aurait, selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, été reconduite par le législateur, de sorte que les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure sont toujours valides.
En tout état de cause, lorsque la faute lourde ou la faute dolosive sont caractérisées, la limitation de l’indemnisation à concurrence du préjudice prévisible est écartée à la faveur du principe de réparation intégrale qui trouve alors à s’appliquer.
C) Le lien de causalité
À l’instar de la responsabilité délictuelle, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à l’établissement d’un lieu de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le préjudice causé au cocontractant.
Cette exigence est exprimée à l’article 1231-4 du Code civil qui dispose que « dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. »
Autrement dit, selon ce texte, qui est une reprise de l’ancien article 1151 du Code civil, y compris lorsque le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive, il n’engage sa responsabilité contractuelle qu’à la condition que soit établi un lien de causalité entre le préjudice et l’inexécution du contrat.
L’exigence d’un rapport de causalité entre le fait générateur et le dommage constitue ainsi le troisième terme de l’équation en matière de responsabilité contractuelle.

Il ne suffit pas, en effet, d’établir l’existence d’un fait générateur et d’un dommage pour que le cocontractant victime soit fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation.
Pour que naisse l’obligation de réparation, encore faut-il que soit établie l’existence d’une relation de cause à effet.
On ne saurait rechercher la responsabilité d’une personne si elle est étrangère à la réalisation du fait dommageable. Comme s’accordent à le dire les auteurs, il s’agit là d’une exigence de la raison !
Comme le souligne le doyen Carbonnier le rapport de causalité peut être envisagé de deux façons distinctes dans le procès en responsabilité :
- La victime du dommage tentera, de son côté, d’établir l’existence d’un lien de causalité afin d’être indemnisée de son préjudice. Pour ce faire, il lui appartiendra :
- D’une part, d’identifier la cause du dommage
- D’autre part, de prouver le lien de causalité
- L’auteur du dommage s’emploiera, quant à lui, à démontrer la rupture du lien de causalité afin de faire échec à l’action en responsabilité dirigée contre lui.
- Cela revient, pour ce dernier, à se prévaloir de causes d’exonération.
Ainsi, l’étude du lien de causalité suppose-t-elle d’envisager les deux facettes du lien de causalité
1. L’existence d’un lien de causalité
Bien que l’exigence d’un rapport de causalité ne soulève guère de difficulté dans son énoncé, sa mise en œuvre n’en est pas moins éminemment complexe.
La complexité du problème tient à la détermination du lien de causalité en elle-même.
Afin d’apprécier la responsabilité du défendeur, la question se posera, en effet, au juge de savoir quel fait retenir parmi toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.
Or elles sont potentiellement multiples, sinon infinies dans l’absolu.
?Illustration de la difficulté d’appréhender le rapport de causalité
- En glissant sur le sol encore humide d’un supermarché, un vendeur heurte un client qui, en tombant, se fracture le coccyx
- Ce dernier est immédiatement pris en charge par les pompiers qui décident de l’emmener à l’hôpital le plus proche.
- En chemin, l’ambulance a un accident causant, au patient qu’elle transportait, au traumatisme crânien.
- Par chance, l’hôpital n’étant plus très loin, la victime a été rapidement conduite au bloc opératoire.
- L’opération se déroule au mieux.
- Cependant, à la suite de l’intervention chirurgicale, elle contracte une infection nosocomiale, dont elle décédera quelques jours plus tard
?Quid juris : qui est responsable du décès de la victime?
Plusieurs responsables sont susceptibles d’être désignés en l’espèce :
- Est-ce l’hôpital qui a manqué aux règles d’asepsie qui doivent être observées dans un bloc opératoire ?
- Est-ce le conducteur du véhicule à l’origine de l’accident dont a été victime l’ambulance ?
- Est-ce le supermarché qui n’a pas mis en garde ses clients que le sol était encore glissant ?
- Est-ce le vendeur du magasin qui a heurté le client ?
À la vérité, si l’on raisonne par l’absurde, il est possible de remonter la chaîne de la causalité indéfiniment.
Il apparaît, dans ces conditions, que pour chaque dommage les causes sont multiples.
Une question alors se pose :
Faut-il retenir toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage ou doit-on seulement en retenir certaines ?
?Causes juridiques / causes scientifiques
Fort logiquement, le juge ne s’intéressera pas à toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage.
Ainsi, les causes scientifiques lui importeront peu, sauf à ce qu’elles conduisent à une personne dont la responsabilité est susceptible d’être engagée
Deux raisons l’expliquent :
- D’une part, le juge n’a pas vocation à recenser toutes les causes du dommage. Cette tâche revient à l’expert.
- D’autre part, sa mission se borne à déterminer si le défendeur doit ou non répondre du dommage.
Ainsi, le juge ne s’intéressera qu’aux causes du dommage que l’on pourrait qualifier de juridiques, soit aux seules causes génératrices de responsabilité.
Bien que cela exclut, de fait, un nombre important de causes – scientifiques – le problème du lien de causalité n’en est pas moins résolu pour autant.
En effet, faut-il retenir toutes les causes génératrices de responsabilité ou seulement certaines d’entre elles ?
?Les théories de la causalité
Afin d’appréhender le rapport de causalité dont l’appréhension est source de nombreuses difficultés, la doctrine a élaboré deux théories :
- La théorie de l’équivalence des conditions
- La théorie de la causalité adéquate
| La théorie de l’équivalence des conditions |
- Exposé de la théorie
- Selon la théorie de l’équivalence des conditions, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
- Cette théorie repose sur l’idée que si l’un des faits à l’origine de la lésion n’était pas survenu, le dommage ne se serait pas produit.
- Aussi, cela justifie-t-il que tous les faits qui ont été nécessaires à la production du dommage soient placés sur un pied d’égalité.
- Critique
- Avantages
- La théorie de l’équivalence des conditions est, incontestablement, extrêmement simple à mettre en œuvre, dans la mesure où il n’est point d’opérer de tri entre toutes les causes qui ont concouru à la production du dommage
- Tous les maillons de la chaîne de responsabilité sont mis sur le même plan.
- Inconvénients
- L’application de la théorie de l’équivalence des conditions est susceptible de conduire à retenir des causes très lointaines du dommage dès lors que, sans leur survenance, le dommage ne se serait pas produit, peu importe leur degré d’implication.
- Comme le relève Patrice Jourdain, il y a donc un risque, en retenant cette théorie de contraindre le juge à remonter la « causalité de l’Univers ».
| La théorie de la causalité adéquate |
- Exposé de la théorie
- Selon la théorie de la causalité adéquate, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ne sont pas des causes juridiques.
- Tous ne sont pas placés sur un pied d’égalité, dans la mesure où chacun possède un degré d’implication différent dans la survenance du dommage.
- Aussi, seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité.
- Il s’agit, en d’autres termes, pour le juge de sélectionner, parmi la multitude de causes qui se présentent à lui, celle qui a joué un rôle majeur dans la réalisation du préjudice.
- Critique
- Avantage
- En ne retenant comme fait générateur de responsabilité que la cause « adéquate », cela permet de dispenser le juge de remonter à l’infini la chaîne de la causalité
- Ainsi, seules les causes proches peuvent être génératrices de responsabilité
- Inconvénient
- La détermination de la « véritable cause du dommage », procède plus de l’arbitraire que de la raison.
- Sur quel critère objectif le juge doit-il s’appuyer pour déterminer quelle cause est adéquate parmi tous les faits qui ont concouru à la production du dommage ?
- La théorie est alors susceptible de conduire à une injustice :
- Tantôt en écartant la responsabilité d’un agent au seul motif qu’il n’a pas joué à un rôle prépondérant dans la réalisation du préjudice.
- Tantôt en retenant la responsabilité de ce même agent au motif qu’il se situe en amont de la chaîne de causalité.
?L’état du droit positif
Quelle théorie la jurisprudence a-t-elle retenu entre la thèse de l’équivalence des conditions et celle de la causalité adéquate ?
À la vérité, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme en matière de causalité, en ce sens que son choix se portera sur l’une ou l’autre théorie selon le résultat recherché :
- Lorsqu’elle souhaitera trouver un responsable à tout prix, il lui faudra retenir une conception large de la causalité, de sorte que cela la conduira à faire application de la théorie de l’équivalence des conditions
- Lorsque, en revanche, la Cour de cassation souhaitera écarter la responsabilité d’un agent, elle adoptera une conception plutôt restrictive de la causalité, ce qui la conduira à recourir à la théorie de la causalité adéquate
En matière de responsabilité contractuelle, afin de guider le juge dans sa recherche du lien de causalité, les parties n’hésiteront pas à établir, dans le contrat, une liste des préjudices qu’elles considèrent comme indirect et donc exclus du domaine du droit à indemnisation.
L’analyse de la jurisprudence révèle que le préjudice indirect est celui, soit qui n’est pas une conséquence immédiate de l’inexécution, soit qui résulte de la survenance d’une cause étrangère (fait de la nature, fait d’un tiers ou fait du créancier).
En tout état de cause, la Cour de cassation exerce un contrôle sur la caractérisation du lien de causalité par les juges du fond, de sorte que la preuve de la causalité ne saurait être négligée par les parties (V. en ce sens Com. 13 sept. 2011, n°10-15732).
2. La rupture du lien de causalité
a. Notion de cause étrangère
Il ne suffit pas qu’une inexécution contractuelle soit établie pour que naisse une obligation de réparation à la charge du débiteur de l’obligation violée.
Encore faut-il que ce dernier ne puisse pas s’exonérer de sa responsabilité.
Pour mémoire :

Dans la mesure où les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile sont cumulatives, le non-respect d’une d’entre elles suffit à faire obstacle à l’indemnisation de la victime.
Aussi, en simplifiant à l’extrême, le défendeur dispose-t-il de deux leviers pour faire échec à l’action en réparation :
- Soit, il démontre que le dommage subi par le demandeur ne constitue pas un préjudice réparable, en ce sens qu’il ne répond pas aux exigences requises (certain et prévisible).

- Soit, il démontre que le dommage ne se serait jamais produit si un événement étranger à son propre fait n’était pas survenu.
- Il doit, en d’autres termes, établir que, de par l’intervention de cet événement – que l’on qualifie de cause étrangère – le lien de causalité a été partiellement ou totalement rompu.

?Notion de cause étrangère
La notion de cause étrangère désigne, de façon générique tout événement, non imputable à l’auteur du dommage dont la survenance a pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal.
Autrement dit, si la cause étrangère au fait personnel, au fait de la chose ou au fait d’autrui ne s’était pas réalisée, le dommage ne se serait pas produit, à tout le moins pas dans les mêmes proportions.
C’est la raison pour laquelle, dès lors qu’elle est établie, la cause étrangère est susceptible de constituer une cause d’exonération totale ou partielle de responsabilité.
Si les textes relatifs à la responsabilité civile ne font nullement référence à la cause étrangère, tel n’est pas le cas en matière de responsabilité contractuelle.
L’article 1218 du Code civil dispose en ce sens que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
L’article 1351 prévoit encore que :
« L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure. »
?Manifestations de la cause étrangère
La cause étrangère est susceptible de se manifester sous trois formes différentes :
- Le fait d’un tiers
- Un tiers peut avoir concouru à la production du dommage, de sorte que s’il n’était pas intervenu aucun fait illicite n’aurait pu être imputé au défendeur.
- Le fait de la victime
- La victime peut avoir commis une faute qui a contribué à la production de son propre dommage.
- Le cas fortuit
- Il s’agit d’événements naturels (inondation, tornade, incendie) ou d’actions humaines collectives (grève, guerre, manifestation)
b. Cause étrangère et force majeure
Trop souvent la cause étrangère est confondue avec la force majeure alors qu’il s’agit là de deux notions bien distinctes :
- La cause étrangère consiste en un fait, un événement dont la survenance a pour effet de rompre le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage
- La force majeure consiste quant à elle, non pas en un fait, mais en plusieurs caractères que la cause étrangère est susceptible d’endosser.
Si sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 le cas de force majeur n’était défini par aucun texte, il était traditionnellement défini comme un événement présentant les trois caractères cumulatifs que sont l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
Les critères traditionnels que l’on prête à la force majeure ont-ils été repris par l’article 1218 du Code civil qui définit la force majeure comme ?
Cette disposition prévoit qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Selon le Rapport au président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 l’intention du législateur est claire : le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006, pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Si la volonté d’abandonner le critère d’extériorité est difficilement contestable, reste qu’une analyse de l’article 1218 interroge sur le succès de la manœuvre.
?: Sur le critère d’extériorité
?Notion
Dans la conception classique, l’événement constitutif de la force majeure doit être extérieur (ou résulter d’une cause étrangère), c’est-à-dire doit être indépendant de la volonté de l’agent, à tout le moins à son activité.
En matière contractuelle, la condition d’extériorité était évoquée à l’article 1147 du Code civil, qui faisait référence à la « cause étrangère » non imputable au débiteur.
L’extériorité s’entendait ici d’un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat et rendant impossible l’exécution du contrat.
À cet égard, il ne suffisait pas que l’exécution de l’obligation soit rendue plus difficile ou plus onéreuse par la survenance de l’événement extérieur (Cass., com., 12 novembre 1969), il fallait qu’elle soit effectivement impossible.
Si l’empêchement n’était que momentané, la jurisprudence considérait le débiteur n’était pas libéré et l’exécution de l’obligation était, dans ces conditions, seulement suspendue jusqu’au moment où l’événement extérieur venait à cesser (Cass., 1ère civ., 24 février 1981, n°79-12.710).
La condition d’extériorité de l’événement n’était pas, non plus, caractérisée si l’empêchement d’exécution du contrat résultait de l’attitude ou du comportement fautif du débiteur (Cass., 1ère civ., 21 mars 2000, n° 98-14.246).
Ainsi, le vendeur ne pouvait pas invoquer une force majeure extérieure pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de vice caché (Cass. 1ère civ., 29 octobre 1985, n°83-17.091), ni en principe le chef d’entreprise en cas de grève de son propre personnel (Cass., Com., 24 novembre 1953).
Reste que la Cour de cassation a finalement renoncé à l’exigence d’extériorité de l’événement pour retenir le cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
?Les fluctuations de la jurisprudence
À compter des années 1990, la Cour de cassation a commencé à admettre, dans plusieurs arrêts, que puissent exister des circonstances internes au débiteur, comme la maladie, la grève ou des circonstances économiques (le chômage ou l’absence de ressources, par exemple) susceptibles de constituer des cas de force majeure ;
- La grève a ainsi pu être considérée comme un événement extérieur (Cass., 1ère civ., 24 janvier 1995, n°92-18.227), sauf si elle résultait du fait ou d’une faute de l’employeur.
- La maladie a également été déclarée constitutive d’un cas de force majeure irrésistible, bien qu’elle n’ait pas été extérieure à la personne :
- Dans le cas d’un élève empêché, du fait de la maladie, de suivre l’enseignement dispensé par l’école contractante (Cass., 1ère civ. 10 février 1998, n°96-13.316)
- Dans le cas de l’annulation d’un voyage en Égypte, par une agence de voyages, en raison de la maladie de l’égyptologue qui devait accompagner les visiteurs (Cass., 1ère civ., 6 novembre 2002, n°99-21.203)
- Dans le cas du malaise brutal d’un conducteur d’automobile qui, ne pouvant plus maîtriser son véhicule, a causé un grave accident de la circulation (Cass. crim. 15 novembre 2005, n°04-87.813).
Afin de mettre un terme à l’incertitude qui régnait en jurisprudence, la Cour de cassation a voulu entériner l’abandon du critère de l’extériorité dans un arrêt d’assemblée plénière du 14 avril 2006 (Cass. ass. plén., 14 avr. 2006, n° 02-11.168).
Dans cette décision, après avoir rappelé « qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit » les juges ont affirmé « qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ».
|
Cass. ass. plé. 14 avr. 2006
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X… a commandé à M. Y… une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu’en raison de l’état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d’une nouvelle date de livraison qui n’a pas été respectée ; que les examens médicaux qu’il a subis ont révélé l’existence d’un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X… a fait assigner les consorts Y…, héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1) qu’en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z… avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu’elle serait constitutive d’un cas de force majeure, après avoir constaté qu’au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y… a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y… savait souffrir, depuis plusieurs mois, d’une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ;
2) qu’un événement n’est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n’a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l’événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu’en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y… le caractère d’un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d’informer son cocontractant qu’il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X… de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y… avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu’il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l’infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l’article 1148 du code civil ;
Mais attendu qu’il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu’il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ; qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y… était en mesure de réaliser la machine et qu’il s’en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d’une maladie irrésistible, la cour d’appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d’un cas de force majeure ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir omis, après avoir prononcé la résolution du contrat, de condamner in solidum les défenderesses à lui payer les intérêts au taux légal, à compter de la date de l’acte introductif d’instance et jusqu’à celle de son versement, sur la somme correspondant aux acomptes qu’il avait versés à son débiteur alors, selon le moyen, que les intérêts au taux légal sont dus du jour de la demande en justice équivalent à la sommation de payer jusqu’à la date de leur versement sur le prix qui doit être restitué à la suite de l’exécution d’un contrat ; qu’en omettant, après avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 11 juin 1997 entre M. Michel Y… et M. Philippe X…, de condamner in solidum Mme Micheline A…, Mme Delphine Y… et Mme Séverine Y… à payer à M. Philippe X… les intérêts au taux légal sur la somme correspondant au montant des acomptes initialement versés à M. Michel Y… par M. Philippe X…, à compter de la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance jusqu’à celle de son versement par Mme Micheline A…, Mme Delphine Y… et Mme Séverine Y… à ce dernier, la cour d’appel a violé l’article 1153 du code civil ;
Mais attendu que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X… aux dépens ;
|
Cette solution a, deux ans plus tard, été reprise par la première chambre civile qui, dans un arrêt du 30 octobre 2008, a considéré que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ». Elle ne fait ainsi plus de l’extériorité de l’événement une condition au caractère exonératoire de la force majeure (Cass. 1ère civ. 30 oct. 2008, n°07-17134).
Bien que l’on eût pu penser que la définition du cas de force majeure était désormais ancrée en jurisprudence, cela était sans compter sur la chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 16 mai 2012, a réintroduit l’exigence d’extériorité de l’événement, en affirmant que « la force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution » (Cass. soc. 16 mai 2012, n° 10-17.726)
Manifestement, cet arrêt n’est pas sans avoir jeté le trouble sur l’exigence d’extériorité dont la mention n’a pas manqué d’interroger les auteurs sur les intentions de la Cour de cassation.
Cette interrogation s’est d’autant plus renforcée par la suite que la troisième chambre civile s’est, à son tour, référée dans un arrêt du 15 octobre 2013 au critère de l’extériorité pour retenir un cas de force majeure (Cass. 3e civ. 15 oct. 2013, n°12-23.126).
Constatant que la jurisprudence ne parvenait pas à se fixer en arrêtant une définition de la force majeure, le législateur a profité de la réforme du droit des obligations pour mettre un terme, à tout le moins s’y essayer, à l’incertitude jurisprudentielle qui perdurait jusqu’alors, nonobstant l’intervention de l’assemblée plénière en 2006.
?La réforme du droit des obligations
Bien que le rapport au Président de la République signale que le législateur a, lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, entendu délaisser « le traditionnel critère d’extériorité », les termes de l’article 1218 du Code civil pris en son alinéa 1er interrogent sur l’effectivité de cette annonce.
Cette définition prévoit, en effet, que pour constituer un cas de force majeure l’événement invoqué doit avoir échappé au contrôle du débiteur.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir à quelles hypothèses correspond un événement qui échappe au contrôle du débiteur.
En première intention, on pourrait considérer qu’il s’agit d’un événement qui serait étranger à son activité, car ne relevant pas de son contrôle. Cette interprétation conduirait néanmoins à réintroduire le critère d’extériorité. Or cela serait contraire à la volonté du législateur.
Aussi, convient-il d’admettre que le nouveau critère posé par l’article 1218 couvre un spectre plus large de situations, lesquelles situations sont susceptibles de correspondre, tant à des événements externes qu’internes. Ce qui importe, pour constituer un cas de force majeure, c’est que le débiteur n’ait pas de prise sur l’événement invoqué.
Pris dans cette acception, le critère de « l’absence de contrôle » autorise à inclure, à l’instar de certaines décisions, dans le giron des cas de force majeure la maladie du débiteur ou encore la grève à la condition néanmoins que, dans ces deux cas, l’événement invoqué ne résulte pas de la conduite du débiteur.
En effet, la maladie qui serait causée par la conduite à risque du débiteur ne devrait, a priori, pas être constitutive d’un cas de force majeure. Il en va de même pour une grève qui prendrait sa source dans une décision de l’employeur.
?: Sur le critère d’imprévisibilité
Le deuxième élément de la définition de la force majeure posé par l’article 1218 du Code civil est l’imprévisibilité de l’événement.
Le texte prévoit en ce sens que la force majeure est constituée lorsque notamment l’événement invoqué « ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ».
La reprise du critère de l’imprévisibilité par le législateur appelle trois remarques :
En premier lieu, il peut être observé que l’imprévisibilité s’apprécie par référence à une personne ou un contractant prudent et diligent, et en tenant compte des circonstances de lieu, de temps, de saison. Il faut que le sujet n’ait pas pu prévoir la réalisation du dommage.
En deuxième lieu, l’imprévisibilité doit s’apprécier au jour de la formation ou de la conclusion du contrat, le débiteur ne s’étant engagé qu’en fonction de ce qui était prévisible à cette date (Cass. com., 3 octobre 1989, n°87-18.479).
Tout s’ordonne, dans le domaine contractuel, autour des prévisions des parties et des attentes légitimes du créancier : il faut que l’événement-obstacle crée une difficulté d’exécution dont le créancier ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur (20).
Dès lors, si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation.
En dernier lieu, l’emploi de la formule « raisonnablement prévu » suggère que l’imprévisibilité de l’événement puisse n’être que relative, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire que l’événement soit absolument imprévisible pour constituer un cas de force majeure.
Cette conception de l’imprévisibilité est conforme à la jurisprudence antérieure qui se contentait d’événements « normalement prévisibles » (Cass., 2e civ. 6 juillet 1960 ; Cass. 2e civ. 27 octobre 1965).
Il est, en effet, constant en jurisprudence que, l’événement est jugé imprévisible en fonction du temps et du lieu où il se produit et des circonstances qui l’accompagnent. Il s’apprécie par référence à un homme prudent, mais aussi par rapport à l’absence de faute de l’agent qui ne pouvait pas prévoir l’événement.
Pour que l’événement soit imprévisible, il faut, peut-on dire, qu’il provoque un “effet de surprise” au regard du lieu, du moment et des circonstances dans lesquels il se produit, de telle manière qu’il n’ait pu être prévu par un homme prudent et avisé.
Ce caractère relatif de l’imprévisibilité est admis par la jurisprudence même dans le cas d’événements naturels : ainsi, en fonction des circonstances de lieu, de date, de saison, peuvent ne peut pas être regardés comme des cas de force majeure, le verglas, la tempête, le vent, l’orage, les inondations, les chutes de neige, le brouillard, les glissements et effondrements de terrains, etc…
?: Sur le critère d’irrésistibilité
Troisième et dernier critère caractérisant la force majeure posée par l’article 1218, al. 1er du Code civil : l’irrésistibilité.
Le texte dispose que la force majeure est constituée lorsque les effets de l’événement « ne peuvent être évités par des mesures appropriées. »
Le rapport au Président de la république précise que l’irrésistibilité de l’événement doit l’être, tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).
L’irrésistibilité implique donc une appréciation du comportement de l’individu pendant toute la durée de réalisation de l’événement : de son fait générateur à ses conséquences.
Pour que l’événement soit irrésistible il faut que la personne concernée ait été dans l’impossibilité d’agir autrement qu’elle l’a fait.
À cet égard, la doctrine à la notion d’événement « inévitable » ou « insurmontable ». Aussi, dès lors que l’événement peut être surmonté, y compris dans des conditions plus difficiles par le débiteur, il n’est pas fondé à se prévaloir de la force majeure.
C’est donc à une appréciation “in concreto” de l’irrésistibilité que se livre la jurisprudence, en recherchant si l’événement a engendré ou non pour le sujet une impossibilité d’exécuter l’obligation ou d’éviter la réalisation du dommage et en vérifiant si un individu moyen, placé dans les mêmes circonstances, aurait pu résister et surmonter l’obstacle.
Il peut, en outre, être observé que la jurisprudence antérieure n’exigeait pas une impossibilité absolue de résister, pour le débiteur, à l’événement à l faveur d’une approche relative de l’irrésistibilité
En effet, cette dernière est appréciée par référence à un individu ordinaire, normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances de temps, de lieu, de conjoncture. De nombreux arrêts jugent fortuit, par exemple, l’événement “normalement irrésistible” ou celui dont on ne pouvait pallier les inconvénients par des mesures suffisantes.
Il est intéressant de noter que cette approche relative de l’irrésistibilité de la force majeure est aussi celle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a rendu un arrêt, le 17 septembre 1987, s’efforçant de donner une définition de la force majeure en excluant l’idée d’une “impossibilité absolue” (CJUE 17 septembre 1987).
La Cour de Luxembourg affirme dans cet arrêt que la force majeure « ne présuppose pas une impossibilité absolue », mais qu’elle « exige toutefois qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables mêmes si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre ».
c. Cause étrangère de l’inexécution et cause étrangère du préjudice
En matière de responsabilité contractuelle, la cause étrangère est susceptible d’affecter la chaîne de la causalité à deux endroits différents :
- En premier lieu, la cause étrangère peut être à l’origine de l’inexécution contractuelle, de sorte que cette inexécution ne pourra pas être imputée au débiteur, à tout le moins que partiellement
- En second lieu, la cause étrangère peut être à l’origine de la production du dommage de sorte que celui-ci ne pourra pas être imputé à l’inexécution contractuelle
Dans les deux cas, la survenance de la cause étrangère a pour effet de rompre, tantôt totalement, tantôt partiellement, la chaîne de la causalité.
La question qui alors se pose est de savoir dans quels cas cette rupture de la causalité justifie que le débiteur de l’obligation inexécutée puisse s’exonérer de sa responsabilité.
?: La cause étrangère de l’inexécution
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ainsi, lorsque l’inexécution contractuelle est imputable à une cause étrangère, l’article 1231-1 exonère le débiteur de sa responsabilité. Cette cause étrangère peut résulter du fait de la nature, du fait du créancier ou du fait d’un tiers.
En tout état de cause, pour être exonératoire de responsabilité, elle devra présenter les caractères de la force majeure, soit, conformément à l’article 1218, al. 1er du Code civil, consister en un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
A contrario, lorsque la cause étrangère ne revêt pas les caractères de la force majeure, les conséquences de l’inexécution contractuelle devront intégralement être supportées par le débiteur.
À l’examen, l’appréhension de la cause étrangère par la jurisprudence diffère selon qu’elle résulte du fait d’autrui ou du fait du créancier.
?La cause étrangère résulte du fait d’autrui
Pour que l’implication d’autrui dans l’inexécution contractuelle soit exonératoire de responsabilité pour le débiteur, cette implication doit présenter les caractères de la force majeure.
Dans le cas contraire, le débiteur devra indemniser le créancier du préjudice qui lui a été causé par autrui. Tout au plus, ce dernier disposera d’une action récursoire contre le tiers impliqué dans l’inexécution du contrat.
?La cause étrangère résulte du fait du créancier
Lorsque cette inexécution est imputable au créancier, deux situations doivent être distinguées :
- Première situation : l’implication du créancier dans l’inexécution contractuelle présente les caractères de la force majeure
- Dans cette hypothèse, la règle posée à l’article 1231-1 du Code civil ne soulève pas de difficulté : le débiteur peut s’exonérer de sa responsabilité
- À cet égard, il est indifférent que l’implication du créancier soit fautive : le seul fait du créancier suffit à libérer le débiteur du paiement de dommages et intérêts
- Ce qui importe c’est la caractérisation de la force majeure qui dès lors qu’elle est établie produit un effet exonératoire.
- Seconde situation : l’implication du créancier dans l’inexécution contractuelle ne présente pas les caractères de la force majeure
- La problématique est ici plus délicate à résoudre.
- En effet, se pose la question de savoir si, en raison de l’implication du créancier dans l’inexécution du contrat et, par voie de conséquence, dans la production de son propre dommage, cette, circonstance pour le moins particulière, ne pourrait pas justifier, nonobstant l’absence de force majeure, que le débiteur puisse s’exonérer de sa responsabilité.
- Une application stricte de l’article 1231-1 du Code civil devrait conduire à répondre par la négative.
- Seule la force majeure peut exonérer le débiteur de sa responsabilité.
- Reste que lorsque c’est le créancier lui-même qui concourt à la production de son propre dommage, il ne serait pas illégitime de lui en faire supporter, au moins pour partie, les conséquences de l’inexécution.
- À l’examen, la jurisprudence a tendance à exiger une faute du créancier pour que le débiteur soit dispensé, à due concurrence de son implication dans l’inexécution contractuelle, du paiement de dommages et intérêts.
- Dans un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la faute du client, lorsqu’elle revêt une certaine gravité, exonère, totalement ou partiellement en fonction de son influence causale, l’hôtelier de sa propre responsabilité » (Cass. 1ère civ., 25 nov. 2015, n°14-21434).
- Le seul fait non fautif du créancier ne permettra donc pas au débiteur de se dégager de sa responsabilité : il doit pour y parvenir démontrer la faute de son cocontractant.
?: La cause étrangère du préjudice
Lorsque la cause étrangère a pour effet de rompre la causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice, il est indifférent qu’elle présente ou non les caractères de la force majeure.
Dans cette configuration, nonobstant l’imputation de l’inexécution contractuelle au débiteur, il n’a pas concouru à la production du dommage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité, sa défaillance, bien que caractérisée, étant étrangère au préjudice causé à son cocontractant.
II) La mise en œuvre de la réparation du dommage
La mise en œuvre de la réparation est envisagée aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. Tandis que le premier encadre les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement d’une obligation, le second régit ceux dus à raison d’une condamnation en justice
A) Les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement d’une obligation de somme d’argent
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
À l’examen, ce texte reprend les dispositions de l’ancien article 1153 mais en modernise et simplifie la formulation.
Ainsi, en cas de retard d’exécution d’une obligation portant sur une somme d’argent, le texte prévoit que l’indemnisation du créancier pour le préjudice causé par ce retard, consiste en l’octroi, à titre forfaitaire, d’intérêts – moratoires – calculés au taux légal et dont l’assiette correspond au montant de la créance due. L’article 1231-6 ayant une valeur supplétive, il n’est pas interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel. Ce taux conventionnel devra néanmoins, pour s’appliquer, être expressément stipulé dans le contrat et ne peut être inférieur à trois fois le taux légal.
En tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article 1231-6 précise que les intérêts moratoires « sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Est ici posée une présomption de dommage en cas de retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent.
Cela signifie que les intérêts moratoires sont automatiquement alloués au créancier, sauf à ce que le débiteur neutralise la présomption de dommage et démontrer l’absence de préjudice à raison du retard dans l’exécution de l’obligation.
Quant au point de départ des intérêts moratoires, l’alinéa 1er de l’article 1231-6 du Code civil prévoit qu’ils courent à compter de la mise en demeure du débiteur.
L’alinéa 3 dispose, enfin, que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort de cette disposition que le retard dans l’exécution d’une obligation peut donner lieu à une indemnisation distincte des intérêts moratoires. Il appartiendra néanmoins au créancier de démontrer, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, d’autre part l’existence d’un préjudice distinct du retard.
B) Les dommages et intérêts dus à raison d’une condamnation en justice
L’article 1231-7 du Code civil dispose que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. »
À l’instar de l’article 1236-1, ce texte porte donc sur les intérêts moratoires qui, là encore, sont forfaitaires et automatiques, puisque fixés au taux légal.
La particularité de ces intérêts moratoires est toutefois triple :
- D’une part, ils sont dus à raison d’une condamnation en justice et non à raison de l’inexécution d’une obligation contractuelle
- D’autre part, ils jouent de plein droit, même en l’absence de demande ou de mention au jugement
- Enfin, ils ne sont pas circonscrits au domaine des obligations de somme d’argent : ils s’appliquent « en toute matière », contrairement aux intérêts moratoires visés à l’article 1231-6
Quant au point de départ des intérêts moratoires dus à raison d’une condamnation en justice, l’article 1231-7 pose le principe qu’ils courent à compter du prononcé du jugement, sauf si la loi ou le juge en disposent autrement.
L’alinéa 2 de cette disposition complète le dispositif en prévoyant que « en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel ».
Deux situations doivent alors être distinguées :
- Le jugement de première instance est confirmé en appel
- Dans cette hypothèse, les intérêts moratoires dus à raison de la condamnation courent à compter de la décision de première instance.
- Le jugement de première instance est infirmé en appel
- Dans cette hypothèse, les intérêts moratoires dus à raison de la condamnation courent à compter de la décision d’appel.
En dépit de la règle ainsi posée, l’article 1231-7 octroie au juge la faculté d’y déroger, ce qui pourrait impliquer qu’il décide de faire courir les intérêts moratoires à compter de la décision d’appel au lieu de la décision de première instance et inversement.
III) L’aménagement de la responsabilité contractuelle
L’aménagement conventionnel de la réparation – qui se distingue de l’aménagement de la responsabilité, puisqu’il ne porte que sur les effets de la responsabilité, même s’il peut avoir, en pratique, des effets semblables à une exonération de responsabilité – peut prendre deux formes :
- Première forme
- Il peut s’agir de clauses limitatives de réparation, se traduisant par une diminution du montant de la réparation.
- Seconde forme
- Il peut s’agir de clauses dites « pénales », par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale ou partielle, ou d’exécution tardive du contrat.
- Le forfait peut s’avérer soit plus élevé, soit plus faible que le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.
A) La clause pénale
?Notion
La clause pénale fait très souvent l’objet d’âpres discussions lors de la conclusion de contrats commerciaux. Et pour cause, c’est à ce moment précis de la négociation que les parties évoquent la question de la réparation du préjudice en cas de manquement contractuel du prestataire.
La clause pénale se définit comme la stipulation « par laquelle les parties déterminent, forfaitairement et d’avance, l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ».
En stipulant une clause pénale, les contractants cherchent à anticiper les difficultés liées à l’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive d’une obligation contractuelle. L’évaluation peut, de la sorte, être inférieure au montant du préjudice effectivement subi. Elle présentera alors de nombreuses similitudes avec les clauses limitatives de responsabilité.
Mais elle peut également prévoir une indemnisation supérieure au dommage susceptible d’être occasionné ; ce en vue de mettre la pression sur le débiteur pour qu’il satisfasse, spontanément, à ses engagements. Elle s’apparentera en ce cas à une peine privée.
Bien que la stipulation de cette clause tende à concurrencer, voire empiéter, sur le monopole juridictionnel de l’État, elle n’en a pas moins toujours été admise en droit français.
Ainsi, sous l’empire du droit antérieur, le Code civil abordait-il les clauses pénales, d’abord, de manière générale, à l’article 1152, puis, de façon plus spécifique, aux articles 1226 et suivants.
Elle est désormais régie à l’article 1231-5 qui simplifie et synthétise, en un seul texte, l’essentiel des dispositions des anciens articles 1226 à 1233 et 1152 relatifs aux clauses pénales.
?Nature
Parce que la clause pénale emprunte ses caractères à de nombreuses figures juridiques, les opinions divergent quant à sa nature.
Pour certains, elle serait une peine privée contractuelle. Les partisans de cette thèse le justifient en soutenant, tout d’abord, que la fonction principale de la clause pénale consiste à contraindre le débiteur à satisfaire à ses obligations.
Ainsi se caractériserait-elle, essentiellement, par sa fonction comminatoire. Or cette fonction est inhérente à la notion de peine.
Le deuxième argument – déterminant – avancé par les tenants de la thèse répressive consiste à dire que l’inexécution d’une obligation contractuelle suffit à déclencher l’application de la clause pénale.
Aussi, comme en matière de peine, sa mise en œuvre est indépendante de la caractérisation d’un préjudice. Enfin, si la clause pénale s’apparente à une peine privée cela s’explique par le fait que son montant est forfaitaire, de sorte que la gravité du manquement sanctionné est sans importance.
Dès lors qu’une inexécution est constatée, le débiteur doit s’acquitter de l’intégralité du montant prévu contractuellement par la clause. Bien que les arguments qui abondent dans le sens de la thèse répressive soient pour le moins séduisants, cette thèse ne fait pas l’unanimité.
Pour des auteurs tels que Demolombe, Josserand ou encore Philippe Le Tourneau, la clause pénale ne serait, en réalité, qu’une clause de dommages-intérêts. L’argument principal avancé repose sur l’ancien article 1229 du Code civil qui disposait que « la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ».
Sa fonction principale serait donc la réparation ; une réparation qui viendrait se substituer à l’évaluation judiciaire. D’où la règle énoncée à l’alinéa 2 de l’article 1229, qui prévoyait que le bénéfice de la clause pénale ne peut pas se cumuler avec l’exécution de l’obligation principale.
Le principe de non-cumul posé par cette disposition démontrerait que la clause pénale a vocation à réparer et non à punir. Là encore, les arguments avancés au soutien de la thèse réparatrice sont extrêmement convaincants.
Les auteurs qui la soutiennent demeurent néanmoins minoritaires. Au surplus, la définition de la clause pénale posée par l’ancien article 1229 du Code civil n’a pas été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016, ce qui n’est pas, désormais, sans priver leur raisonnement de base légale.
À l’examen, la majorité des auteurs estiment que la vérité se situerait au milieu, soit entre la thèse répressive et la thèse réparatrice.
Autrement dit, la clause pénale revêtirait une nature hybride. La conjugaison de sa fonction comminatoire et réparatrice ferait d’elle, tout à la fois une peine privée et une clause de dommages-intérêts.
Pour justifier cette thèse il est avancé que, dans la mesure où le montant fixé conventionnement par les parties peut être inférieur ou supérieur au préjudice éprouvé par le créancier, la clause pénale s’apparenterait, tantôt à une clause limitative de responsabilité, tantôt à une peine privée. D’où sa nature hybride.
Au total, il apparaît que, tant les théories monistes, que la théorie dualiste sont séduisantes : chaque thèse a le mérite, en faisant ressortir un ou plusieurs traits saillants de la clause pénale, de lever un peu plus le voile sur sa nature.
À cet égard, nonobstant leurs divergences, ces thèses partagent toutes un point en commun : les auteurs admettent, en effet, unanimement que la clause pénale remplit une fonction réparatrice.
Et si, pour les partisans de la thèse répressive, cette fonction n’est qu’accessoire, elle n’en demeure pas moins pour eux une caractéristique de la clause pénale. Denis Mazeaud affirme en ce sens que « quand un préjudice a été causé par l’inexécution illicite imputable au débiteur, la peine fait accessoirement fonction de réparation ».
Elle remplit ainsi la même fonction que la responsabilité contractuelle, à la différence près, néanmoins, que la clause pénale vise, non pas à réparer le préjudice effectivement subi par le cocontractant, mais à allouer au créancier une indemnité de réparation forfaitaire.
?Le caractère forfaitaire de la clause pénale
L’article 1231-5 du Code civil prévoit que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Il s’infère de cette disposition que la clause pénale présente un caractère forfaitaire, en ce sens que, en cas d’inexécution contractuelle, elle fera office d’indemnité de réparation indépendamment du montant du préjudice subi par le créancier.
L’enjeu pour les parties sera alors de fixer un montant de la clause pénale qui, d’une part, ne risque pas d’être révisé par le juge, parce qu’excessif, d’autre part, qui soit suffisamment élevé pour correspondre au préjudice qu’elle vise à réparer.
Conséquence, du caractère forfaitaire de la clause pénale, d’aucuns soutiennent qu’elle est libératoire.
?Le caractère libératoire de la clause pénale
Dans la pratique, il est un débat récurrent qui revient entre les parties : la clause pénale est-elle ou non libératoire ? L’enjeu de cette question ne saurait être mésestimé.
Dans l’hypothèse où elle le serait, le paiement de la pénalité par la partie qui a manqué à son obligation ferait purement et simplement obstacle à l’introduction postérieure, par le créancier, d’une action en responsabilité contractuelle devant les tribunaux.
À l’inverse, si l’on admettait que la clause pénale ne présente aucun caractère libératoire, cela signifierait que l’allocation de dommages et intérêts conventionnels pourrait se cumuler avec une indemnisation judiciaire. L’hésitation entre les deux thèses est permise.
D’un côté, lorsque la clause pénale stipule que le débiteur devra payer une indemnité en cas de retard dans l’exécution de sa prestation, elle se rapproche très fortement de l’astreinte. Or le prononcé d’une astreinte par le juge est indépendant de l’octroi au créancier de dommages et intérêts (Cass. 1ère civ., 28 fév. 1989, n°85-16.973).
D’un autre côté, la clause pénale vise à indemniser les conséquences d’un manquement à une obligation contractuelle. Il apparaîtrait dès lors troublant que le créancier puisse bénéficier d’une double indemnisation, avec le risque que le montant des dommages et intérêts cumulés soit supérieur à celui qui lui aurait été alloué judiciairement.
Reste que si la clause pénale se voit assigner, même accessoirement, une fonction réparatrice, il peut en être réduit qu’elle revêt, corrélativement, un caractère libératoire.
L’ancien article 1229 du Code civil prévoyait en ce sens que « la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts ». Par compensation il fallait comprendre que l’indemnité perçue par le créancier supplante l’indemnité réparatrice qui lui aurait été allouée par le juge.
À cet égard, on peut ainsi lire sous la plume d’éminents auteurs que « l’évaluation conventionnelle des dommages-intérêts est substituée à l’évaluation judiciaire qu’elle rend inutile ».
Par ailleurs, si la clause pénale n’était pas libératoire, rien ne la distinguerait de l’astreinte. Or le prononcé d’une astreinte peut se cumuler avec l’octroi de dommages et intérêts (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 28 fév. 1989, n°85-16.973).
L’application de la clause pénale ne saurait, en conséquence, se cumuler avec l’octroi d’une indemnisation judiciaire. La Cour de cassation abonde indirectement en ce sens lorsqu’elle admet qu’un cumul n’est possible que dans l’hypothèse où le préjudice dont la réparation est demandée est distinct de celui couvert par la clause (Cass. soc., 21 nov. 1978, n°76-41.060 ; Cass. com., 20 mai 1997, n°95-12.392).
Mieux, dans un arrêt du 14 juin 2006, la Cour de cassation a jugé que la clause pénale « constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice » (Cass. com. 14 juin 2016 n°15-12.734).
La solution ici dégagée par la Cour de cassation, qui ne laisse guère place au doute sur le caractère libératoire de la clause pénale, a été confirmée par l’ordonnance du 10 février 2016 qui précise à l’article 1231-5 du Code civil que cette clause vise à octroyer à cocontractant victime d’une inexécution contractuelle « une certaine somme à titre de dommages et intérêts ».
Si le créancier perçoit des dommages et intérêts du chef de l’application de la clause pénale, c’est que son préjudice a été réparé et que, par voie de conséquence, l’objet du litige potentiel susceptible de l’opposer au débiteur est épuisé.
Aussi, sera-t-il irrecevable à agir en responsabilité contractuelle une fois le montant de la clause pénale réglé. Encore faut-il que les conditions de mise en œuvre de la clause pénale soient réunies.
1. Les conditions de mise en œuvre de la clause pénale
a. Une inexécution contractuelle
La clause pénale vise à sanctionner une inexécution contractuelle, indépendamment du préjudice susceptible d’être causé au créancier.
L’inexécution donnant lieu à la mise en œuvre de la clause pénale doit néanmoins avoir été définie contractuellement pas les parties.
Autrement dit, il doit avoir été prévu, dans le contrat, le fait générateur qui ouvrira le droit au paiement de pénalités.
Quant à la nature de l’inexécution, elle peut consister, tant en un retard, qu’en l’absence de délivrance de la chose. Plus généralement elle consiste en la fourniture d’une prestation non conforme aux stipulations contractuelles.
À cet égard, il est indifférent que l’inexécution sanctionnée porte ou non sur une obligation essentielle : ce qui importe c’est que l’obligation en cause soit expressément visée par la clause pénale.
En cas de survenance d’une cause étrangère ayant pour effet d’empêcher le débiteur d’exécuter son obligation, la jurisprudence admet que le jeu de la clause pénale est neutralisé, sauf stipulation contraire (V. en ce sens Cass. req. 3 déc. 1890)
Ainsi, pour que les pénalités soient dues, l’inexécution contractuelle doit être imputable au débiteur.
Enfin, il convient d’observer que l’inexécution du contrat est une condition suffisante à la mise en œuvre de la clause pénale. Des pénalités pourront, dans ces conditions, être dues au créancier même en l’absence de préjudice (V. en ce sens Cass. 3e civ., 12 janv. 1994, n°91-19.540).
C’est là tout l’intérêt de la clause pénale, elle ne remplit pas seulement une fonction réparatrice : elle vise également à sanctionner une inexécution contractuelle.
b. La mise en demeure du débiteur
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Ainsi, la mise en œuvre de la clause pénale suppose, au préalable, la mise en demeure de la clause pénale, faute de quoi les pénalités ne sont pas dues.
Cette exigence est directement reprise de l’ancien article 1230 du Code civil qui prévoyait que « soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. »
Si la mise en demeure est la règle, le créancier en sera dispensé lorsque l’inexécution de l’obligation est définitive, soit lorsque le débiteur ne sera pas en mesure de surmonter son retard. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il a failli à son obligation d’acheminer au pli avant une date butoir.
En tout état de cause, dans les cas où elle est exigée, la mise en demeure devra être adressée au débiteur selon les formes prévues aux articles 1344 et suivants du Code civil.
Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
Au fond, l’exigence de mise en demeure préalable à toute demande d’exécution d’une obligation vise à laisser une ultime chance au débiteur de s’exécuter.
À cet égard, l’absence de mise en demeure pourrait être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond lequel est susceptible d’avoir pour effet de tenir en échec la demande d’application de la clause pénale formulée par le créancier.
Quant au contenu de la mise en demeure, l’acte doit comporter :
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :
- Soit par voie de signification
- Soit au moyen d’une lettre missive
Par ailleurs, il ressort de l’article 1344 du Code civil que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations stipulées au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
2. La révision judiciaire de la clause pénale
Pendant longtemps la question s’est posée de savoir si le montant de la clause pénale était susceptible de faire l’objet d’une révision par le juge lorsque le préjudice effectivement subi par le créancier ne correspond pas au montant des pénalités dues.
- D’un côté, il a été avancé que l’exercice de ce pouvoir de révision par le juge est justifié lorsque le montant de clause pénale est manifestement excessif.
- D’un autre côté, il est fait interdiction au juge de modifier les prévisions des parties, sauf pour les cas de contrariété d’une clause à l’ordre public
En réaction à la jurisprudence qui avait refusé d’annuler les clauses pénales dont le montant était excessif au motif qu’il n’appartenait pas au juge de s’ingérer dans les relations contractuelles des parties, le législateur lui a reconnu ce pouvoir par l’adoption de la loi du 9 juillet 1975.
Il était ainsi prévu à l’ancien article 1152, al. 2 du Code civil que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Ce pouvoir de révision de la clause pénale octroyé au juge a été confirmé par l’ordonnance du 10 février 2016 qui a repris, dans les mêmes termes, à l’article 1231-5, al. 2 du Code civil, le second alinéa de l’ancien article 1152.
Ainsi, la révision de la clause pénale doit demeurer exceptionnelle : ce n’est que dans l’hypothèse où l’écart entre le préjudice subi et le montant des pénalités dues est manifestement excessif que la clause peut être révisée.
Cette révision peut conduire le juge, tant à augmenter le montant de la clause, qu’à le diminuer, ce qui sera le plus souvent le cas.
Il doit donc se livrer à une sorte de contrôle de proportionnalité, étant précisé qu’il est interdit au juge de se référer, tant au comportement du débiteur (V. en ce sens Cass. com. 11 févr. 1997, n°95-10.851), qu’à sa situation financière (Cass. 1ère civ., 14 nov. 1995, n°94-04.008).
Le juge n’est autorisé à apprécier le caractère excessif du montant de la clause qu’au regard du préjudice effectivement subi par le créancier. À cet égard, la jurisprudence admet qu’il puisse se faire assister d’un expert (Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n°01-12.646).
Dans l’hypothèse où le juge estime que la clause est manifestement excessive, aucune obligation ne lui est faite de ramener son montant au niveau du préjudice subi par le créancier.
Par ailleurs, dans un arrêt du 24 juillet 1978, la Cour de cassation a précisé que s’« ‘il appartient aux juges du fond, souverains dans l’appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l’indemnité résultant de l’application d’une clause pénale dès lors qu’ils l’estiment manifestement excessive », ils ne peuvent toutefois pas « allouer une somme inférieure au montant du dommage » (Cass. 1ère civ. 24 juill. 1978, n°77-11.170).
Il existe donc un seuil qui s’impose au juge – le montant du préjudice subi par le créancier – en deçà duquel les pénalités dues ne peuvent pas être réduites.
Les solutions ci-dessus énoncées valent non seulement en cas d’inexécution totale de l’obligation sanctionnée par la clause pénale, mais également en cas d’inexécution partielle.
L’alinéa 3 de l’article 1231-5, qui lui reprend les termes de l’ancien article 1231, dispose en ce sens que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. »
B) Les clauses limitatives de responsabilité
1. Le principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Alors que l’on assiste à une convergence des règles qui régissent la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, une différence subsiste : tandis que la première peut être limitée, voire écartée par le jeu d’une convention, la seconde ne peut souffrir d’aucun aménagement contractuel.
- S’agissant de la responsabilité délictuelle
- La jurisprudence a toujours condamné les clauses limitatives de réparation en matière délictuelle lorsqu’elles concernent des cas de responsabilité pour faute.
- Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle » (Cass. 1ère civ. 5 juill. 2017, n°16-13.407).
- La haute juridiction admet, en revanche, de telles clauses dans le cadre de régimes de responsabilité pour faute présumée ou de responsabilité sans faute.
- Est ainsi licite la clause par laquelle des propriétaires d’animaux décident de s’affranchir de l’application des dispositions de l’article 1385 du code civil, lesquelles mettent en place une responsabilité de plein droit du propriétaire d’animaux pour les dommages causés par ces derniers (V. en ce sens Cass. req. 16 nov. 1931).
- La pertinence du maintien d’une exclusion de toute possibilité d’aménagement contractuel en matière de responsabilité pour faute prouvée est discutée.
- Certains auteurs estiment en effet souhaitable d’autoriser des clauses limitatives ou exonératoires dans des conditions plus proches de celles existant en matière contractuelle.
- Ces derniers sont, semble-t-il, en passe d’être entendus puisque le projet de réforme du droit de la responsabilité civile envisage d’autoriser la stipulation de telles clauses, dès lors qu’elles ne visent pas à limiter ou exclure l’indemnisation en cas de dommage corporel (art. 1281 C. civ.).
- S’agissant de la responsabilité contractuelle
- Parce que le débiteur n’est tenu de réparer que le préjudice prévisible, soit celui prévu par les parties au contrat, la jurisprudence a admis, très tôt, la validité des clauses limitatives de responsabilité (
- Les juridictions sont, à cet égard, allées plus loin en autorisant les parties, au nom de la liberté contractuelle, à stipuler des clauses qui exonèrent de toute responsabilité (V. en ce sens Cass. civ. 15 juin 1959, n°57-12.362).
- À l’examen, la validité des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité n’a nullement été remise en cause par la réforme du droit des obligations.
- Le nouvel article 1231-3 du Code civil prévoit, en effet, que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».
Au total, seules les clauses exonératoires ou limitatives en matière de responsabilité contractuelle bénéficient d’une validité de principe.
Elles sont particulièrement fréquentes, par exemple, dans les contrats de transport ou de déménagement, dans lesquels sont insérées des clauses dont l’objet est de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum des dommages et intérêts que le créancier pourra recevoir, c’est-à-dire, en d’autres termes, un plafond de réparation.
Reste, que la stipulation de ces clauses est prohibée dans un certain nombre de contrats, sans compter que leurs effets sont susceptibles d’être neutralisés dans plusieurs situations.
2. Les exceptions au principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Bien que, en matière de responsabilité contractuelle, la validité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité soit, par principe, admise, certains textes encadrent, voire prohibent leur stipulation.
Aux côtés de ces textes spéciaux qui tendent à se multiplier et intéressent des matières pour le moins variées, il faut également compter sur une disposition de portée générale, introduite par l’ordonnance de 10 février 2016, qui vise à réputer non-écrite toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.
2.1 Les textes spéciaux qui prohibent de l’aménagement conventionnel de la responsabilité
De nombreux textes spéciaux prohibent donc la stipulation de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité :
- En matière de contrat de travail, l’article L. 1231-4 du Code du travail prévoit que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles qui régissent le licenciement, soit, en particulier, celles qui gouvernent les indemnités de rupture
- En matière de contrat de bail d’habitation, l’article 4, m) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prohibe toute clause « qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité »
- En matière de contrat de consommation, l’article R. 212-1, 6° du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations »
- En matière de contrat de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, l’article 321-14 du Code de commerce prévoit que « les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. »
- En matière de contrat d’hôtellerie, l’article 1953, al. 2 du Code civil pose que, d’une part, les hôteliers « sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel », d’autre part, que « cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. »
- En matière de contrat de louage d’ouvrage, l’article 1792-5 du Code civil prévoit que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité [du constructeur], soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite »
- En matière de contrat de transport de marchandises, l’article 133-1 du Code de commerce énonce que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. […]. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
- En matière de contrat de transport maritime, l’article L. 5422-15 du Code des transports dispose que « est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet […] de soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l’article L. 5422-12 »
En dehors des textes spéciaux qui prohibent l’aménagement conventionnel de la responsabilité, c’est le droit commun qui s’applique. Or en droit, commun, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valides, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à une obligation essentielle du contrat.
2.2 L’atteinte à une obligation essentielle du contrat
L’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil, ce texte trouve notamment à s’appliquer aux clauses limitatives et exonératoires de responsabilité.
La codification de cette dernière solution, sur une question qui a donné lieu à de nombreux arrêts parfois inconciliables, permet de fixer clairement le droit positif sur le sort de ces clauses.
Contrairement à ce qu’avaient pu retenir certaines décisions de la Cour de cassation, une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur ne sera pas nécessairement réputée non écrite : elle n’est prohibée que si elle contredit la portée de l’engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.
a. La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia
a.1 La saga Chronopost
En résumant à gros trait, dans le cadre de l’affaire Chronopost, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulée en contradiction avec l’engagement principal pris par l’une des parties pouvait faire l’objet d’une annulation.
C’est sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tenté de répondre en se servant de cette notion comme d’un instrument de contrôle de la cohérence du contrat, ce qui n’a pas été sans alimenter le débat sur la subjectivisation de la cause.
Afin de bien saisir les termes du débat auquel a donné lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales étapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit à l’introduction d’un article 1170 du Code civil.
i. Premier acte : arrêt Chronopost du 22 octobre 1996
|
Arrêt Chronopost I
(Cass. com. 22 oct. 1996)
Sur le premier moyen :
Vu l’article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ;
Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
|
?Faits
Une société (la société Chronopost), spécialiste du transport rapide, s’est engagée à livrer sous 24 heures un pli contenant une réponse à une adjudication.
Le pli arrive trop tard, de sorte que la société cliente ne parvient pas à remporter l’adjudication.
?Demande
La société cliente demande réparation du préjudice subi auprès du transporteur
Toutefois, la société Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilité au montant du transport, soit 122 francs.
?Procédure
Par un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes, déboute la requérante de sa demande.
Les juges du fond estiment que la responsabilité contractuelle du transporteur n’aurait pu être recherchée que dans l’hypothèse où elle avait commis une faute lourde.
Or selon la Cour d’appel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute.
En conséquence, le client du transporteur ne pouvait être indemnisé du préjudice subi qu’à hauteur du montant prévu par le contrat soit le coût du transport : 122 francs.
?Solution
Par un arrêt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 22 oct. 1996, n°93-18.632).
La Cour de cassation affirme, au soutien de sa décision que dans la mesure où la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant, à ce titre, la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagée à livrer les plus de son client dans un délai déterminé, « en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».
?Analyse
Tout d’abord, il peut être observé que, en visant l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile à l’absence de cause l’hypothèse où la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité a pour effet de contredire la portée de l’obligation essentielle contractée par les parties.
En l’espèce, la société Chronopost, spécialisée dans le transport rapide, s’est engagée à acheminer le plus confié dans un délai déterminé en contrepartie de quoi elle facture à ses clients un prix bien supérieur à ce qu’il est pour un envoi simple par voie postale.
En effet, c’est pour ce service, en particulier, que les clients de la société Chronopost, se sont adressé à elle, sinon pourquoi ne pas s’attacher les services d’un transporteur classique dont la prestation serait bien moins chère.
Ainsi, y a-t-il manifestement dans le délai rapide d’acheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue l’essence même du contrat : son noyau dur.
Pourtant, la société Chronopost a inséré dans ses conditions générales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilité, en cas de non-respect du délai d’acheminement fixé, au montant du transport, alors même que le préjudice subi par le client est sans commune mesure.
D’où la question posée à la Cour de cassation : une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat, laquelle n’est autre que la stipulation en considération de laquelle le client s’est engagé ?
En d’autres termes, peut-on envisager que la société Chronopost s’engage à acheminer des plis dans un délai rapide et, corrélativement, limiter sa responsabilité en cas de non-respect du délai stipulé à la somme de 122 francs ?
Il ressort du présent arrêt, que la Cour de cassation répond par la négative à cette question.
Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilité était de nature à contredire la portée de l’engagement pris au titre de l’obligation essentielle du contrat.
En réduisant à presque rien l’indemnisation en cas de manquement à l’obligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation.
Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise l’article 1131 du Code civil, à priver de cause l’engagement du client, laquelle cause résiderait dans l’obligation d’acheminer le pli dans un délai déterminé.
Elle en déduit que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non-écrite.
?Critiques
Plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la solution retenue par la haute juridiction
- Le visa de la solution
- Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors même qu’il existe une contrepartie à l’obligation de chacun des contractants ?
- La contrepartie de l’obligation de la société Chronopost consiste en le paiement du prix par son client.
- La contrepartie de l’obligation du client consiste quant à elle en l’acheminement du pli par Chronopost.
- Jusqu’alors, afin de contrôler l’existence d’une contrepartie, le contrat était appréhendé globalement et non réduit à une de ses clauses en particulier.
- La subjectivisation de la cause
- Autre critique formulée par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachée, en l’espèce, à la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, ce qui revient à recourir à la notion de cause subjective alors que le contrôle de l’existence de contrepartie s’opère, classiquement, au moyen de la seule cause objective.
- Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminé à son destinataire dans un certain délai.
- Or, si l’on s’en tient à un contrôle de la cause objective (l’existence d’une contrepartie), cela ne permet pas d’annuler la clause limitative de responsabilité dont la mise en œuvre porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat : l’obligation de délivrer le pli dans le délai convenu.
- Pour y parvenir, il est en effet nécessaire d’apprécier la validité des clauses du contrat en considération de l’objectif recherché par les contractants.
- Le recours à la notion de cause subjective permet alors d’écarter la clause qui contredit la portée de l’engagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a déterminé les parties à contracter.
- Tel est le cas de la clause limitative de responsabilité qui fait obstacle à la réalisation du but poursuivi par les parties, cette clause étant de nature à ne pas inciter la société Chronopost à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’exécuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiés dans le délai stipulé.
- Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie à l’idée que la cause de l’obligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans faire écho à l’arrêt Point club vidéo rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tôt, où elle avait assimilé le défaut d’utilité de l’opération économique envisagé par l’une des parties à l’absence de cause.
- La sanction de l’atteinte à l’obligation essentielle
- La cause étant une condition de validité du contrat, son absence était sanctionnée, en principe, par une nullité du contrat lui-même.
- Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrêt Chronopost où la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité est seulement réputée non-écrite.
- Pourquoi cette solution ?
- De toute évidence, en l’espèce, la Cour de cassation a statué pour partie en opportunité.
- Si, en effet, elle avait prononcé la nullité du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au même résultat que si l’on avait considéré la clause valide :
- Le client reprenait son pli
- Chronopost reprend ses 122 francs.
- Aussi, en réputant la clause non-écrite, cela permet d’envisager la question de la responsabilité contractuelle de la société Chronopost, la clause limitative de responsabilité ayant été neutralisée.
- Plus largement, la sanction retenue participe d’un mouvement en faveur du maintien du contrat : plutôt que d’anéantir l’acte dans son ensemble, on préfère le maintenir, amputé de ses stipulations illicites.
- La Cour de cassation parvient donc ici à une solution équivalente à laquelle aurait conduit l’application des règles relatives à la prohibition des clauses abusives.
- Toutefois, ce corpus normatif ne trouve d’application que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- Dès lors, on peut estimer que la Cour de cassation s’est servie dans cet arrêt du concept de cause comme d’un instrument d’éradication d’une clause abusive stipulée dans un contrat qui, par nature, échappait au droit de la consommation.
ii. Deuxième acte : arrêt Chronopost du 9 juillet 2002
La solution retenue dans l’arrêt Chronopost n’a pas manqué de soulever plusieurs questions, dont une en particulier : une fois que l’on a réputé la clause limitative de responsabilité non-écrite comment apprécier la responsabilité de la société Chronopost ? Autrement dit, quelle conséquence tirer de cette sanction ?
|
Arrêt Chronopost II
(Cass. com. 9 juill. 2002)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu’à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’agriculture en vue d’une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n’ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s’y était engagée, la société Banchereau n’a pu participer aux adjudications ;
qu’elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1150 du Code civil, l’article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l’arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ;
Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
|
- Faits
- La Cour de cassation est amenée à se prononcer une seconde fois sur l’affaire Chronopost jugée une première fois par elle le 22 octobre 1996.
- Elle statue ici sur le pourvoi formé par la société Chronopost contre l’arrêt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour d’appel de Rouen.
- Problématique
- À l’instar du contrat vente, de bail ou encore de prêt, le contrat de messagerie est encadré par des dispositions réglementaires.
- Plus précisément il est réglementé par le décret du 4 mai 1988 qui organise son régime juridique.
- Aussi, dans le deuxième volet de l’affaire Chronopost, la question s’est posée de savoir si le décret du 4 mai 1988 réglementant les contrats de type transport était applicable au contrat conclu entre la société Chronopost et son client ou si c’est le droit commun de la responsabilité contractuelle qui devait s’appliquer.
- Quel était l’enjeu ?
- Si le décret s’applique, en cas de non-acheminement du pli dans les délais par le transporteur, celui-ci prévoit une clause équivalente à celle déclarée nulle par la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 octobre 1996 : le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-là même prévue dans les conditions générales de la société Chronopost.
- Si, au contraire, c’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique, une réparation du préjudice subie par la société cliente du transporteur est alors envisageable.
- Solution
- Tandis que la Cour d’appel condamne la société Chronopost sur le terrain du droit commun (réparation intégrale du préjudice) estimant que le contrat type messagerie était inapplicable en l’espèce, la Cour de cassation considère que le décret du 4 mai 1988 avait bien vocation à s’appliquer (Cass. com. 9 juill. 2002, n°99-12.554).
- Au soutien de sa décision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure où la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, cela entraîne nécessairement « l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec ».
- En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors à adopter une solution qui produit le même effet que si elle n’avait pas annulé la clause litigieuse : le remboursement de la somme de 122 francs !
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise toutefois que le plafond légal d’indemnisation est susceptible d’être écarté en rapportant la preuve d’une faute lourde imputable au transporteur.
- D’où la référence dans le visa, entre autres, à l’ancien article 1150 du Code civil qui prévoyait que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
- La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2002 a immédiatement soulevé une nouvelle question :le manquement à une obligation essentielle du contrat pouvait être assimilé à une faute lourde, ce qui dès lors permettrait d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.
iii. Troisième acte : arrêts Chronopost du 22 avril 2005
Arrêts Chronopost III
(Cass. ch. mixte, 22 avril 2005)
|
Première espèce
Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société D… France (la société D…) ayant décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de sa candidature qui n’est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société D… a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard du contrat-type “messagerie” ; Sur le second moyen :
Vu l’article 1150 du Code civil, l’article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;
Attendu que pour écarter le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type “messagerie” et condamner la société Chronopost à payer à la société D… la somme de 100 000 francs, l’arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même “d’erreur exceptionnelle d’acheminement”, sans qu’elle soit en mesure d’y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l’arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
|
|
Seconde espèce
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n’a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ;
Attendu que la société Dubosc fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, “que l’arrêt relève que l’obligation de célérité, ainsi que l’obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s’analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l’inexécution d’une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d’effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s’exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu’en décidant que faute d’établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du prix du transport, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988″ ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ;
Qu’ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
?Faits
- Dans la première espèce
- Une société qui avait décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de
- Sa candidature n’est cependant parvenue à destination que le 26 mai 1999 en raison d’un retard dans l’acheminement du pli.
- Dans la seconde espèce
- Une société a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes.
- Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999.
- Toutefois, il n’est délivré que le lendemain.
?Demande
Dans les deux arrêts, les clients de la société Chronopost demandent réparation du préjudice occasionné du fait du retard de livraison du pli confié au transporteur
?Procédure
- Première espèce
- Par un arrêt du 24 mai 2002, la Cour d’appel de Paris accède à la requête du client de la société Chronopost.
- Les juges du fond estiment que le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type messagerie devait être écarté dans la mesure où le retard d’acheminement du pli qui avait été confié à la société Chronopost « caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ».
- Seconde espèce
- Par un arrêt du 7 février 2003, la Cour d’appel de Versailles déboute le client de la société Chronopost de sa demande.
- Les juges du fond estiment dans cette espèce que si l’obligation de livrer dans les délais le pli confié au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement à cette obligation ne suffit pas à caractériser une faute lourde.
- Dès lors, pour la Cour d’appel de Versailles, il n’y a pas lieu d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par le décret qui réglemente les contrats-type messagerie.
?Solution
Tandis que dans la première espèce, la Chambre mixte casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, dans la seconde le pourvoi formé par le client de la société Chronopost est rejeté.
Deux enseignements peuvent être tirés des deux arrêts rendus le même jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 :
- Définition de la faute lourde
- La Cour de cassation répond à l’interrogation née de l’arrêt du 9 juillet 2002 : la définition de la faute lourde
- Aussi, dans la deuxième espèce jugée par la chambre mixte, la faute lourde est définie comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté ».
- La faute lourde comprendrait donc deux éléments :
- Un élément subjectif : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
- Un élément objectif : l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.
- Faute lourde et manquement à l’obligation essentielle
- Dans la première espèce la Cour de cassation estime que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°02-18.326).
- Dans la seconde espèce, la haute juridiction affirme encore que « la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112).
- En d’autres termes, il résulte des deux arrêts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement à une obligation essentielle du contrat ne saurait caractériser à lui seul une faute lourde
- Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit établie, en plus, l’existence d’un élément subjectif : le comportement d’une extrême gravité confinant au dol.
- Ainsi, était-il nécessaire de démontrer que la société Chronopost avait délibérément livré le pli qui lui a été confié en retard, ce qui n’était évidemment pas le cas en l’espèce.
- D’où le refus de la Cour de cassation d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.
- La chambre mixte a dès lors fait le choix d’une approche extrêmement restrictive de la faute lourde, à tel point que les auteurs se sont demandé si cela ne revenait pas à exclure toute possibilité d’écarter le plafond légal d’indemnisation en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve de la faute lourde.
iv. Quatrième acte : Arrêt Chronopost du 30 mai 2006
|
Arrêt Chronopost IV
(Cass. com. 30 mai 2006)
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1131 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ;
Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l’arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d’acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société JMB International était recevable et n’était pas prescrite, l’arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris
|
- Faits
- Deux montres, confiées par une société au transporteur Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport.
- Demande
- La société cliente engage la responsabilité de Chronopost.
- Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut le transporteur ne lui est pas opposable.
- Procédure
- Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour d’appel de Paris déboute le client de la société Chronopost de toutes ses demandes.
- Étonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins différente de la jurisprudence initiée par la Cour de cassation dix ans plus tôt.
- Ils considèrent que, en confiant un pli à la société Chronopost pour qu’elle l’achemine jusqu’à son destinataire, elle « avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté »
- La clause limitative de responsabilité était, dans ces conditions, parfaitement applicable à la société cliente.
- Ainsi, la Cour d’appel refuse-t-elle d’apprécier la validité de la clause limitative de responsabilité en se demandant si elle ne portait pas atteinte à une obligation essentielle, ni même si la société Chronopost n’avait pas manqué à son obligation de délivrer le pli dans le délai prévu par le contrat.
- Solution
- Par un arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 30 mai 2006, n°04-14.974).
- Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat »
- Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dégagée dans le premier arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996.
v. Cinquième acte : Arrêt Chronopost du 13 juin 2006
|
Arrêt Chronopost V
(Cass. com. 13 juin 2006)
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1150 du code civil, l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dole froid service a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi” ; que ce délai n’ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l’offre n’a pu être examinée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour dire inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémentaire de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
|
- Faits
- Une société a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi”.
- Le délai de livraison n’ayant pas été respecté, l’offre n’a pu être examinée.
- Demande
- Le client de la société Chronopost engage sa responsabilité aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
- Procédure
- Par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour d’appel de Paris accède à la demande du demandeur en déclarant le plafond légal d’indemnisation inapplicable,
- La Cour d’appel relève pour ce faire que « la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée »
- Elle en déduit que, en l’espèce, la faute lourde ce qui, conformément à l’ancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
- Solution
- Par un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond notamment au visa de l’article 1150 du Code civil (Cass. com. 13 juin 2006, n°05-12.619).
- La chambre commerciale réitère ici la solution dégagée par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
- Or en l’espèce, le seul manquement susceptible d’être reproché au transporteur était de n’avoir pas exécuté son obligation essentielle, de sorte que cela n’était pas suffisant pour caractériser une faute lourde.
- Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de démontrer d’adoption par le transporteur d’un comportement d’une extrême gravité confinant au dol.
a.2 L’épilogue de la saga Chronopost : les arrêts Faurecia
La saga des arrêts Chronopost a donné lieu à un épilogue qui s’est déroulé en deux actes.
i. Premier acte : arrêt Faurecia du 13 février 2007
|
Arrêt Faurecia I
(Cass. com. 13 févr. 2007)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ;
[…]
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 1131 du code civil ;
Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l’arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d’écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d’évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n’ait pas été livrée ou que l’installation provisoire ait été ultérieurement “désinstallée” ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
|
?Faits
La société Faurecia a souhaité déployer sur ses sites en 1997 un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale
Conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999
Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en œuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte
Dans l’attente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a été installée
Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel n’était toujours pas livrée.
La société Faurecia a dès lors cessé de régler les redevances dues à son fournisseur, la société Oracle, laquelle avait, entre-temps, cédé ses droits à la société Franfinance.
?Demande
La société Faurecia assigne alors la société Oracle ainsi que la société Deloitte aux fins d’obtenir la nullité des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties.
?Procédure
Par un arrêt du 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles a estimé que l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Faurecia en réparation de son préjudice devait être limitée au montant prévu par la clause limitative de responsabilité.
Cette clause trouvait, en effet, pleinement à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la société Faurecia ne caractérisait pas la faute lourde de la société Oracle.
Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la société Faurecia n’établit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochés à la société Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient résulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas été livré, ni que l’installation provisoire ait été ultérieurement désinstallée.
La solution de la Cour d’appel était ainsi, en tous points, conforme à la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation.
?Solution
Par un arrêt du 13 février 2007, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).
Après avoir relevé que « la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12 », la cour de cassation considère que le manquement reproché à la société Oracle portait sur une obligation essentielle.
Or elle estime que pareil manquement « est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt Faurecia I.
- En premier lieu
- Dès lors qu’une clause vient limiter la responsabilité du débiteur d’une obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite.
- Les clauses limitatives de responsabilité seraient, en somme, sans effet dès lors que le manquement reproché à une partie porterait sur une obligation essentielle.
- En second lieu
- Le seul manquement à une obligation essentielle suffit à caractériser la faute lourde.
- Il s’agit donc de la solution radicalement opposée à celle adoptée par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrêts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006.
- Sur ce point, la chambre commerciale opère donc un revirement de jurisprudence.
- Désormais, le simple manquement est suffisant quant à faire échec à la clause limitative de responsabilité.
- Il n’est plus besoin de rapporter la preuve d’un comportement d’une extrême gravité imputable au débiteur de l’obligation essentielle.
?Analyse
La position adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt Faurecia I a été unanimement critiquée par la doctrine.
Les auteurs ont reproché à la chambre commerciale d’avoir retenu une solution « liberticide » en ce sens que cela revenait à priver les parties de la possibilité de stipuler une clause limitative de responsabilité dès lors qu’une obligation essentielle était en jeu.
L’application de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, à considérer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient désormais faire l’objet d’une limitation de responsabilité, ce qui n’est pas sans porter atteinte à la liberté contractuelle des parties.
La Cour de cassation s’est, de la sorte, écartée de la solution dégagée dans l’arrêt Chronopost I où elle avait décidé que la clause limitative de responsabilité ne devait être réputée non écrite qu’à la condition que ladite clause prive la portée de l’engagement pris.
Dans l’arrêt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence.
Elle se satisfait de la seule présence dans le contrat, d’une clause limitative de responsabilité susceptible d’être activée en cas de manquement à une obligation essentielle.
Animée d’une volonté d’encadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilité la Cour de cassation est, à l’évidence, allée trop loin.
Aussi, un retour à la solution antérieure s’est très rapidement imposé.
ii. Second acte : arrêt Faurecia du 29 juin 2010
|
Arrêt Faurecia II
(Cass. com. 29 juin 2010)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d’appel a, par application d’une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 à compter du 1er mars 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : […]
Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que la société Oracle n’avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu’elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ;
Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
?Faits / procédure
Après que dans l’arrêt Faurecia I, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, décident de résister à la chambre commerciale.
Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilité était pleinement applicable en l’espèce, conformément à la solution qui avait été adoptée par la première Cour d’appel qui avait été saisie.
?Solution
Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Faurecia contre la décision de la Cour d’appel de Paris (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841).
Deux questions étaient soumises à la chambre commerciale :
- Première question : la clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle doit-elle être réputée non-écrite ?
- À cette question, la Cour de cassation répond par la négative.
- Elle affirme en ce sens que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur »
- Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle à la solution classique dégagée dans l’arrêt Chronopost I.
- Pour qu’une clause limitative de responsabilité soit annulée, elle doit vider de sa substance l’obligation essentielle.
- Dans le cas contraire, elle demeure valide.
- En l’espèce, la Chambre commerciale relève que « si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications »
- Elle en déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle
- Rien ne justifiait donc que ladite clause soit réputée non-écrite.
- Seconde question : le manquement à une obligation essentielle est-il constitutif d’une faute lourde ?
- La Cour de cassation renoue là aussi avec la solution antérieure.
- Elle affirme que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »
- Le seul manquement à une obligation essentielle ne suffit donc pas à caractériser une faute lourde.
- Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un comportant d’une extrême gravité confinant au dol imputable au débiteur de l’obligation essentielle.
- Or en l’espèce, la société Oracle n’a pas rapporté la preuve d’une telle faute.
Au total, avec l’arrêt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle s’était écartée dans l’arrêt Faurecia I.
Le législateur n’a pas manqué de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptée dans l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1170 du Code civil.
b. La consécration légale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia
Aux termes de l’article 1170 du Code civil « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Ainsi, le législateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiée par l’arrêt Chronopost I, puis qui s’est conclue sur l’arrêt Faurecia II.
Plusieurs observations peuvent être formulées au sujet de la règle introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil.
?Sur le domaine d’application de la règle
Il peut tout d’abord être observé que, de par sa généralité, l’application de la règle édictée à l’article 1170 n’est pas cantonnée au domaine des clauses limitatives de responsabilité.
Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.
On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulées sans contrepartie.
Il peut encore s’agir des clauses dites de réclamation insérées dans les contrats d’assurance vie aux termes desquelles la victime d’un sinistre doit, pour être indemnisée par son assureur, présenté sa réclamation pendant la durée de validité du contrat. À défaut, la clause a pour effet de priver l’assuré de l’indemnisation d’un sinistre alors même que celui-ci est survenu pendant la durée d’efficacité du contrat et que les primes d’assurance ont été dûment réglées.
?Sur les conditions d’application de la règle
L’application de la règle édictée à l’article 1170 du Code civil est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- L’existence d’une obligation essentielle
- Le législateur a repris à son compte la notion d’obligation essentielle dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Chronopost I
- Que doit-on entendre par obligation essentielle ?
- L’ordonnance du 10 février 2016 ne le dit pas.
- Une ébauche de définition a été donnée par Pothier qui, dès le XVIIIe siècle, décrivaient les obligations essentielles comme celles « sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l’une ou de l’autre de ces choses, ou il n’y a point du tout de contrat ou c’est une autre espèce de contrat ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’obligation en considération de laquelle les parties se sont engagées.
- Ainsi, la réalisation de l’opération économique envisagée par les parties dépend de l’exécution de l’obligation essentielle.
- Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel l’édifice contractuel tout entier est bâti.
- La stipulation d’une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle
- L’ordonnance d’une 10 février 2016 conditionne l’annulation d’une clause sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qu’à la condition qu’elle « prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur »
- Ainsi, le législateur a-t-il choisi de reprendre à l’identique la solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Faurecia II ?
- Pour mémoire, dans l’arrêt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimé que dès lors qu’une clause limitative de responsabilité portait sur une obligation essentielle elle devait être réputée non écrite (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).
- Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a été contrainte de revoir sa position dans l’arrêt Faurecia II.
- Dans cette décision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur » (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841).
- Si, indéniablement, l’article 1170 consacre cette solution, reste néanmoins une question en suspens : que doit-on entendre par « substance » ?
- Plus précisément, qu’est-ce qu’une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ?
- Dans l’arrêt Chronopost, la Cour de cassation s’était placée sur le terrain de la cause pour justifier sa solution.
- Elle estimait, en effet, que la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité conduisait à priver de son intérêt l’utilité de l’opération économique convenue par les parties : l’acheminement du pli confié au transporteur dans un bref délai.
- La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le législateur a entendu assimiler la privation de l’obligation essentielle de sa substance à l’absence de cause, telle que, envisagée dans l’arrêt Chronopost, soit dans sa conception subjective ?
- Si l’on compare les expressions « substance de l’obligation » (art. 1170) et « portée de l’obligation » (arrêt Chronopost), il apparaît que le sens de chacune d’elles est sensiblement différent.
- Le terme substance renvoie à l’idée de contenu de l’obligation : en quoi consiste la prestation convenue par les parties ?
- Le terme de portée renvoie quant à lui à l’idée de cause de l’obligation : pourquoi les contractants se sont-ils engagés ?
- Aussi, selon que l’on raisonne sur la base de l’un ou l’autre terme, le champ d’application de l’article 1170 du Code civil est susceptible d’être plus ou moins étendu.
- Si l’on s’en tient à la lettre de l’article 1170, ne pourront être pris en considération que les éléments prévus dans le contrat pour apprécier la validité d’une clause qui affecterait une obligation essentielle
- Si en revanche, l’on s’écarte de la lettre de l’article 1170 à la faveur d’une conception finaliste, pourront alors être pris en compte, les mobiles des parties, telle que l’utilité de l’opération économique envisagée individuellement par elles.
- Pratiquement, la seconde conception offre, de toute évidence, une bien plus grande marge de manœuvre au juge qui pourra, pour apprécier la validité de la clause affectant une obligation essentielle, se référer à des éléments extérieurs au contrat : les mobiles des parties.
?La sanction de la règle
Le législateur a décidé d’étendre la sanction prévue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte à une obligation essentielle du contrat : elles sont réputées non-écrite.
Cela signifie que, non seulement la clause est privée d’effet, mais encore qu’elle disparaît du contrat.
La conséquence en est un retour immédiat au droit commun qui s’appliquera à la situation juridique, initialement réglée par les parties, mais qui, sous l’effet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel.
Est-ce à dire que, dans les différents arrêts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilité permettrait aux clients d’être indemnisés de leurs préjudices ?
S’agissant de ce cas spécifique, la réponse ne peut être que négative.
Le droit commun a prévu que, en matière de contrat-type message, l’indemnisation du préjudice en cas de retard de livraison du pli ne peut excéder un certain plafond, soit celui-là même fixé par la société Chronopost.
Une suppression de la clause serait donc inopérante, sauf à ce que le client soit susceptible d’établir une faute lourde à l’encontre du transporteur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (V. notamment l’arrêt Faurecia II : Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841).
3. La neutralisation des effets des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Plusieurs moyens de droit sont susceptibles d’être invoqués aux fins de neutraliser les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité.
a. Les moyens de droit tirés de l’opposabilité de la clause
Pour être opposables, les clauses qui aménagent la responsabilité contractuelle doivent avoir été stipulées dans le contrat et acceptées par le cocontractant.
L’article 1119 du Code civil dispose en ce sens que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
Il en résulte que la clause doit être insérée dans la documentation contractuelle et être lisible. S’il est admis qu’elle puisse figurer sur une facture, c’est à la condition qu’il soit établi que la partie contre laquelle elle est stipulée en a eu connaissance et qu’elle y a consenti.
Certaines juridictions ont pu déduire ce consentement, dans le cadre de relations d’affaires, de l’absence de contestation du cocontractant dans un certain délai.
Lorsque, par ailleurs, la clause est contredite par des mentions manuscrites ou des courriers échangés entre les parties, la Cour de cassation considère qu’elle est de pur style, en conséquence de quoi elle est privée d’effet.
Dans un arrêt du 14 octobre 2008, la chambre commerciale a ainsi jugé que « c’est sans dénaturation des conclusions de la société LCI mais par une interprétation souveraine de la portée de la mention “sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs” que la cour d’appel, en relevant que cette mention était contredite par les courriers échangés, en a déduit qu’elle n’était qu’une clause de style dépourvue de valeur juridique » (Cass. com. 14 oct. 2008, n°07-18.955).
Enfin, en cas de discordance entre clauses contractuelles, l’interprétation du contrat doit se faire à la lumière des alinéas 2 et 3 de l’article 1119 du Code civil qui prévoient que :
- D’une part, « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »
- D’autre part, « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Pour produire ses pleins effets, une clause limitative ou exonératoire de responsabilité doit ainsi, non seulement, être dépourvue de toute ambiguïté quant à sa formulation, mais encore ne pas être contredite par une autre clause du contrat, voire par les échanges qui ont pu intervenir entre les parties dans le cadre de la conclusion de l’acte.
b. Les moyens de droit tirés de la faute lourde ou dolosive
En application de l’article 1231-3 du code civil, les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité peuvent être neutralisés en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier de l’obligation violée étant alors fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice.
Très tôt, la jurisprudence a abondé en ce sens. Dans un arrêt du 15 juin 1959 la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « seuls le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d’irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l’autre partie, peuvent faire échec à l’application de ladite clause » (Cass. com., 15 juin 1959, n° 57-12.362)
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par faute dolosive et faute lourde.
Si les textes sont silencieux sur ce point, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l’imprudence délibérée dans ce cas confinant à l’intention. »
C’est donc vers la jurisprudence antérieure qu’il convient de se tourner pour déterminer ce que l’on doit entendre par faute lourde et par faute dolosive.
La différence entre les deux fautes tient, en substance, à l’intention de l’auteur de la faute :
- La faute lourde
- Elle est définie par la jurisprudence, selon la formule consacrée, comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté » (V. en ce sens Cass. Ch. Mixte 22 avr. 2005, n° 03-14.112).
- La faute lourde comprend donc deux éléments :
- Un élément subjectif : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
- Un élément objectif: l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.
- La faute dolosive
- Elle est définie quant à elle comme l’inexécution délibérée, et donc volontaire, des obligations contractuelles.
- À cet égard dans un arrêt du 27 juin 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le constructeur […] est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles » (Cass. 3e civ. 27 juin 2001, n°99-21.017).
- Il ressort de la jurisprudence que la faute dolosive suppose que le débiteur ait seulement voulu manquer à ses obligations contractuelles. Il est indifférent qu’il ait voulu causer un préjudice à son cocontractant.
Nonobstant la différence qui existe entre ces deux notions, la faute lourde est régulièrement assimilée à la faute dolosive par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation a ainsi rappelé que « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité » (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2014, n°13-21.980).
L’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive aurait, selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, été reconduite par le législateur, de sorte que les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure sont toujours valides.
En tout état de cause, lorsque la faute lourde ou la faute dolosive sont caractérisées, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité est écartée à la faveur du principe de réparation intégrale qui trouve alors à s’appliquer.