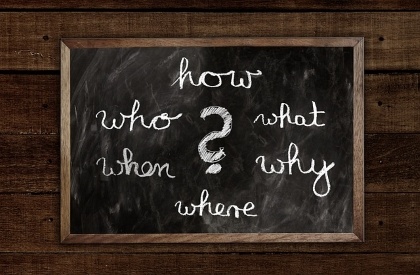C’est une nouveauté introduite par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le Code civil renferme désormais une section entière consacrée aux « obligations de sommes d’argent ».
Cette section comporte des dispositions qui constituent le droit spécial du paiement, à tout le moins elles sont présentées comme tel.
Le législateur a indiqué en ce sens, dans le Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance, que « les obligations de sommes d’argent présentent des particularités justifiant de consacrer une partie distincte aux règles propres à leur paiement. »
La particularité des obligations de sommes d’argent tient notamment au cours de la monnaie qui, par nature, peut varier. Ces obligations comportent encore des spécificités lorsqu’elles sont productives d’intérêts.
Les difficultés que sont susceptibles de soulever les obligations monétaires sont abordées aux articles 1343 et suivants du Code civil.
Après avoir posé le principe du nominalisme monétaire, ces dispositions traitent des intérêts susceptibles d’être produit par la dette. Enfin elles abordent les modalités du paiement de l’obligation de somme d’argent.
§1: Le nominalisme monétaire
I) Principe
==> Exposé du principe du nominalisme monétaire
Lorsqu’une obligation porte sur une somme d’argent, cela implique pour le débiteur de payer le créancier au moyen de monnaie.
À cet égard, la monnaie ne constitue pas seulement un instrument de paiement, elle a également pour fonction d’évaluer un bien ou un service.
Autrement dit, dans cette fonction, la monnaie s’analyse en une unité de mesure. Contrairement toutefois aux unités de mesure utilisées dans le domaine des sciences, elle présente un caractère instable dans la mesure où sa valeur est fixée par un cours. Or ce cours est susceptible de varier et, par voie de conséquence, d’affecter la valeur de la monnaie.
Aussi, la fluctuation monétaire rend-elle difficile l’évaluation des biens et services sur une période longue, en particulier durant des périodes d’inflation ou de dépréciation monétaires.
La question qui alors se pose est de savoir quel montant le débiteur d’une obligation de somme d’argent doit-il verser au créancier pour éteindre sa dette. Deux approches sont envisageables :
- Première approche : le nominalisme monétaire
- Pour se libérer de son obligation, le débiteur doit verser au créancier le montant nominal de la dette stipulé au contrat.
- L’inconvénient de cette approche est que, en cas de fluctuation monétaire entre le jour de la conclusion du contrat et le jour du paiement, la valeur de la somme d’argent réglée par le débiteur au créancier ne correspondra plus à la valeur du montant de la dette stipulé au contrat.
- Seconde approche : le valorisme monétaire
- Pour se libérer de son obligation, le débiteur doit verser au créancier une somme d’argent dont le montant a été actualisé au jour du paiement et qui donc est susceptible d’être différent de celui déterminé lors de la conclusion du contrat.
- Cette approche présente l’avantage de tenir compte des phénomènes d’inflation et de dépréciation monétaires.
Entre ces deux approches, le législateur a retenu la première. L’article 1343, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. »
Cette disposition pose donc le principe du nominalisme monétaire, principe selon lequel le débiteur doit verser la somme correspondant au montant nominal de sa dette, même si la valeur de la monnaie a varié.
Concrètement, cela signifie qu’une dette dont la valeur nominale est de 100 vaudra toujours 100 peu importe le nombre d’années qui s’est écoulé entre la conclusion du contrat et le paiement de l’obligation.
Autrement dit, le paiement doit porter sur le même nombre d’unités monétaires que celui stipulé au contrat au jour de la naissance de la dette, les fluctuations monétaires étant sans incidence sur le montant nominal dû par le débiteur.
==> Consécration du principe du nominalisme monétaire
Sous l’empire du droit antérieur, le principe du nominalisme monétaire avait été déduit de l’article 1895 du Code civil qui prévoit, en matière de prêt de consommation, que « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. »
Le second alinéa de ce texte précise que « s’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »
S’il n’est pas douteux que, en application de ce texte, l’emprunteur ne soit tenu de rembourser au prêteur que le montant nominal de la somme d’argent prêtée, on est légitimement en droit de s’interroger, en revanche, sur le domaine de la règle ainsi énoncée.
Une approche restrictive devrait conduire à cantonner le champ d’application de cette règle aux seuls prêts d’argent.
Telle n’est toutefois pas la voie qui a été empruntée par la jurisprudence qui, très tôt, a dégagé de l’article 1895 du Code civil un principe général (V. en ce sens Cass. req. 25 févr. 1929).
Afin de lever toute ambiguïté et prévenir toute difficulté d’interprétation du texte, le législateur a fait le choix, à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations, de consacrer le principe du nominalisme monétaire, énoncée désormais à l’article 1343 du Code civil.
Reste que si le principe du nominalisme monétaire pose une exigence de parfaite égalité entre le montant nominal de la somme d’argent stipulé au contrat au jour de la naissance de la créance et le montant nominal de la dette qui doit être payée par le débiteur au jour du paiement, cette correspondance pas toujours, pour autant, à la réalité économique.
II) Exceptions
En période de stabilité monétaire, le principe du nominalisme monétaire ne soulève aucune difficulté d’application pour les parties.
La valeur de la monnaie étant constante, le montant de la somme d’argent due au créancier est toujours égal au montant de la dette qui doit être réglée par débiteur.
Lorsque, en revanche, la monnaie connaît des périodes de fluctuation, le principe du nominalisme monétaire est susceptible de contrevenir à l’équité.
Afin de surmonter cette difficulté le législateur a :
- D’une part, autorisé les parties à déroger contractuellement au principe du nominalisme monétaire
- D’autre part, institué le système des dettes de valeur
A) L’aménagement contractuel du principe du nominalisme monétaire
1. Techniques contractuelles visant à déroger au principe du nominalisme monétaire
Le principe du nominalisme monétaire n’est pas d’ordre public. Il est donc admis que les parties puissent y déroger par convention contraire.
Très tôt la pratique a développé deux techniques contractuelles permettant de protéger les parties contre le phénomène de fluctuation monétaire :
- Les clauses monétaires
- Les clauses d’indexation
1.1. S’agissant des clauses monétaires
a. Notion
Une clause monétaire est celle qui vise comme unité de valeur de référence d’une créance de somme d’argent une unité monétaire ou l’or.
Il s’agit, autrement dit, de stipulations aux termes desquelles les parties conviennent de se référer à une monnaie étrangère plutôt que d’utiliser la monnaie légale, soit pour évaluer les créances, soit pour les régler.
Classiquement, on distingue deux catégories de clauses monétaires :
- Première catégorie : les clauses monnaies étrangères et les clauses-or
- Il s’agit des clauses qui stipulent que le paiement devra s’effectuer dans une monnaie autre que celle déterminée par la loi (clause monnaie étrangère) ou en or (clause-or).
- Ces clauses écartent ainsi le principe posé à l’article 1343-3, al .1er du Code civil selon lequel « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.»
- La monnaie étrangère a donc vocation à être utilisée ici, en lieu et place de la monnaie légale, aux fins de règlement de la dette
- Seconde catégorie : les clauses valeur-monnaie étrangère et les clauses valeur or
- Il s’agit des clauses qui visent la monnaie étrangère ou l’or, non pas comme une monnaie de paiement, mais comme une monnaie de compte.
- Autrement dit, elles stipulent que le paiement s’effectuera en monnaie légale (l’euro), mais que la valeur nominale de la dette variera en fonction du cours d’une monnaie étrangère ou de l’or.
- Ce type de clause vise donc à se référer à une monnaie étrangère ou au cours de l’ord pour évaluer une dette
b. Cours forcé et cours légal
Au début du XIXe siècle, en raison de la relativement grande stabilité du franc, il était admis que les parties à un contrat puissent stipuler des clauses monétaires et que donc le paiement puisse s’effectuer en monnaie étrangère ou en or.
Puis le législateur institua, par le décret du 15 mars 1848, un cours forcé des billets émis par la Banque de France ce qui signifiait les paiements devaient nécessairement être réalisés en monnaie légale et que les détenteurs de ces billets ne pouvaient plus réclamer leur conversion en monnaie métallique. L’objectif recherché était double : mettre un frein à la fuite des réserves de métaux précieux de la Banque de France et favoriser l’utilisation large des billets comme monnaie fiduciaire.
Si le cours forcé a été aboli en 1850, il a été rétabli par la loi du 12 août 1870 qui a, en outre, institué ce que l’on appelle un cours légal du billet. Selon ce cours, il est fait obligation à tout créancier d’accepter les billets de banque émis par la banque de France comme instrument de paiement au même titre que la monnaie métallique.
L’adoption du cours forcé et du cours légal n’a pas été sans incidence sur la validité des clauses monétaires.
Ces deux cours faisaient désormais obstacle au paiement d’une créance en monnaie étrangère ou en or. Leur instauration revenait ainsi à prohiber les clauses monnaies étrangères et les clauses or. Cette prohibition a, dans un premier temps, visé les clauses or (Cass. civ., 11 févr. 1873), puis les clauses monnaie étrangère (V. en ce sens Cass. civ. 17 mai 1927).
La jurisprudence a, par suite, étendu cette prohibition aux clauses valeur-monnaies étrangères et aux clauses valeur-or (V. en ce sens Cass. civ. 31 déc. 1928).
c. Régime
Si la stipulation de clauses monétaires est, par principe, prohibée pour les opérations réalisées sur le territoire français, elle est admise lorsqu’elle intéresse des opérations qui présentent un caractère international.
c.1 Les opérations internationales
La prohibition générale des clauses monétaires posée par la jurisprudence à partir de la fin du XIXe siècle est rapidement apparue comme étant inconciliable avec les exigences et impératifs du commerce international.
Le maintien de cette prohibition aurait eu pour effet d’empêcher les marchands français de commercer avec des partenaires étrangers.
Pour cette raison, très tôt la Cour de cassation a admis que les opérations présentant un caractère international échappaient à la prohibition des clauses monétaires.
Dans un arrêt Matter rendu le 17 mai 1927 (Cass. civ. 17 mai 1927), elle a ainsi jugé qu’une clause prévoyant le règlement d’une obligation dans une devise étrangère n’était pas illicite, pourvu qu’elle se rattache à une opération internationale.
Pour présenter un caractère international et donc échapper à la prohibition des clauses monétaires, l’opération doit produire un mouvement de valeurs transfrontalier, soit un flux qui circule d’un état vers un autre.
Une circulaire du garde des Sceaux aux procureurs généraux du 16 juillet 1926 a indiqué en ce sens que les règlements internationaux sont ceux « qui concernent des opérations qui se poursuivent sur le territoire de deux États, se règlent par un appel de change d’un État sur un autre et aboutissent finalement à un règlement de pays à pays ».
Dès lors que cette condition est remplie, les parties sont libres de déroger au cours légal et au cours forcé ; elles peuvent donc prévoir que les règlements s’effectueront au moyen d’une devise étrangère.
À cet égard, il peut être dérogé pour les opérations internationales au principe de prohibition des clauses monétaires, tant lorsque la monnaie étrangère est utilisée comme une monnaie de paiement (clauses monnaie étrangère) que lorsqu’elle est utilisée comme une monnaie de compte (clauses valeur-monnaie étrangère).
Dans ce dernier cas, la conversion de la devise étrangère en euro devra se faire au jour du paiement. La Cour de cassation a jugé en ce sens dans un arrêt du 18 décembre 1990, que « la contre-valeur en francs français d’une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties » (Cass. 1ère civ. 18 déc. 1990, n°88-20.232).
Si la dérogation au principe de prohibition des clauses monétaires pour les opérations internationales a été admise par la jurisprudence dès le début du XXe siècle, il a fallu attendre près d’un siècle pour qu’elle soit consacrée par le législateur.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a ainsi inséré un article 1343-3 dans un le Code civil qui prévoyait que, si « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l’obligation ainsi libellée procède d’un contrat international ou d’un jugement étranger. »
Cette disposition a toutefois fait l’objet d’un ajustement à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016.
Il a été relevé que la rédaction de l’article 1343-3, telle que retenue par cette ordonnance, était plus restrictive que l’état du droit antérieur.
Il a notamment été souligné que dans une décision rendue le 11 octobre 1989 à propos d’un contrat de prêt, la Cour de cassation s’était référée à la notion plus souple d’« opération de commerce international » et non de contrat international (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°87-16.341).
Cette notion permettait aux parties de déterminer la monnaie de compte ou de paiement de leurs obligations même si le paiement devait être réalisé sur le sol français, dès lors qu’il pouvait être qualifié d’opération de commerce international.
Il est toutefois apparu que cette notion d’« opération de commerce international » ne permettait pas non plus de couvrir l’ensemble des hypothèses dans lesquelles le paiement en monnaies étrangères était admis avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Pour s’approcher au plus près de l’état du droit antérieur et permettre aux entreprises d’utiliser la monnaie de leur choix, tout en n’affaiblissant pas la monnaie nationale, il a finalement été décidé de retenir le critère d’« opération à caractère international », à la place de celui trop restrictif de lien avec un « contrat international », cette rédaction pouvant encore être affinée au cours de la navette parlementaire.
Aussi, désormais après avoir énoncé que « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros », l’article 1343-3, al. 2e du Code civil est rédigé comme suit : « le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. »
c.2 Les opérations internes
==> Principe
Très tôt la jurisprudence a donc posé le principe de prohibition des clauses monétaires pour les opérations internes, considérant que ces clauses heurtaient l’ordre public monétaire (V. en ce sens Cass. com., 27 avr. 1964 ; Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°87-16.341).
Cette prohibition procédait notamment de l’idée que les clauses de monnaie étrangère avaient pour effet d’affaiblir la monnaie nationale.
Certains auteurs soutiennent qu’elle n’est aujourd’hui plus justifiée dans la mesure où le droit français fait figure d’exception au sein de la zone euro[1].
D’autres avances que « les règles du cours légal et du cours forcé constituent […] des fondements insuffisants à l’illicéité des clauses monétaires. Et leur cumul n’y saurait rien changer : la somme de deux arguments creux sonne creux »[2].
- S’agissant du cours forcé, il empêche seulement le détenteur de billets émis par la Banque de France de demander auprès d’elle la conversion en or ou en argent. Il ne fait a priori nullement obstacle à ce que les parties à un contrat décident que le règlement des dettes s’effectuera au moyen d’une monnaie étrangère.
- S’agissant du cours légal, il interdit, quant à lui, à tout créancier d’une obligation de refuser un paiement au moyen de billets émis par la Banque de France. Cette interdiction ne fait nullement obstacle, là encore, à ce que les parties à un contrat utilisent une devise étrangère comme moyen de règlement des obligations.
Si, en l’état du droit positif, la prohibition des clauses monétaires demeure, nonobstant les critiques – nombreuses – formulées par la doctrine, elle a toutefois connu un assouplissement, notamment sous l’impulsion du développement des clauses d’indexation.
À compter du milieu du XXe siècle, la jurisprudence a, en effet, commencé à distinguer selon que la monnaie étrangère était utilisée par les parties comme une monnaie de paiement ou comme une monnaie de compte.
Pour mémoire, tandis que dans le premier cas le contrat écarte purement et simplement la monnaie légale comme moyen de règlement des obligations (clause monnaie étrangère), dans le second cas la monnaie étrangère sert seulement à évaluer le montant des créances, le paiement s’effectuant, en tout état de cause, dans la monnaie légale (clause valeur-monnaie étrangère).
Dans l’ordre interne, alors que les clauses monnaie étrangères ont toujours été prohibées par la jurisprudence, la Cour de cassation demeurant inflexible, elle a fini par admettre la validité des clauses valeur-monnaie étrangère, soit celles n’impliquant le paiement de l’obligation dans une devise étrangère (Cass. 1ère civ. 4 déc. 1962).
La Cour de cassation subordonna toutefois leur validité au respect des règles encadrant les clauses d’indexation.
En parallèle de cette jurisprudence, elle maintint la prohibition des clauses monnaie étrangère (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 14 nov. 2013, n°12-23.208).
La violation de cette prohibition est sanctionnée par la nullité absolue, dans la mesure où elle porte atteinte à l’ordre public monétaire (Cass. 1ère civ. 18 nov. 1997, n°95-14.003).
Dans un arrêt du 2 octobre 2007, la Cour de cassation a précisé qu’il appartient, en conséquence, au juge de relever d’office cette cause de nullité du contrat (Cass. 3e civ. 2 oct. 2007, n°06-14.725).
==> Exceptions
Le principe d’interdiction de stipuler pour les contrats relevant de l’ordre interne une clause de règlement d’une obligation en devise étrangère souffre de deux exceptions :
- Première exception
- L’article 1343-3, al. 3e du Code civil prévoit que « les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »
- Cette exception, qui est issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, vise à tenir compte des réalités économiques et notamment des impératifs rencontrés dans certains domaines d’activité où il est d’usage que les paiements s’opèrent en devise étrangère et notamment en dollar américain.
- Seconde exception
- L’article L. 112-5-1 du Code monétaire et financier prévoit que « par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-3 du code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant.»
1.2. S’agissant des clauses d’indexation
Une clause d’indexation, qualifiée également de clause d’échelle mobile, est celle qui fait varier le montant de la dette en fonction d’un indice extérieur au contrat.
La clause peut renvoyer, soit à un indice publié par un organisme public ou privé, soit au cours d’une marchandise ou d’un service, pourvu qu’elle ne contrevienne pas au cours forcé.
À l’instar des clauses monétaires, pendant longtemps les clauses d’indexation ont été regardées avec méfiance par la jurisprudence, les juridictions voyant en elles un facteur d’inflation.
En effet, la clause d’indexation ne fait certes pas varier le montant de la somme due par le débiteur en fonction du cours d’une devise étrangère. Toutefois, en stipulant une telle clause les parties cherchent indirectement à se prémunir des fluctuations monétaires susceptibles d’affecter la valeur de l’obligation souscrite.
Afin de limiter le recours aux clauses d’indexation la Cour de cassation a opéré une distinction entre :
- D’un côté, les clauses qui avaient été stipulées dans le seul but d’échapper aux fluctuations monétaires.
- D’un autre côté, les clauses qui avaient été stipulées aux fins de préserver l’équivalence économique des prestations.
Tandis que les premières étaient prohibées (Cass. 1ère civ. 3 nov. 1953), les secondes ont été reconnues valables (Cass. 1ère civ. 27 déc. 1954).
Dans ce contexte de fébrilité de la jurisprudence quant à la reconnaissance des clauses de d’indexation, la question de leur validité s’est posée spécifiquement pour les contrats de prêt.
Pour mémoire, l’article 1895 du Code civil prévoit que « s’il y a eu augmentation ou diminution d’espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. »
Selon cette disposition, qui pose le principe du nominalisme monétaire en matière de prêt, le montant remboursé par l’emprunteur doit correspondre au montant nominal qui a été mis à sa disposition par le prêteur.
Est-ce à dire que, pour cette catégorie de contrat, toute clause visant à indexer le montant de la somme prêtée sur indice et donc à faire fluctuer le montant nominal de la somme devant être remboursée serait nulle ?
Se fondant sur le principe du nominalisme monétaire, certaines juridictions ont statué en ce sens.
La Cour de cassation a toutefois porté un coup d’arrêt à cette jurisprudence dans un arrêt Guyot rendu en date du 27 juin 1957 (Cass. 1ère civ. 27 juin 1957, n°57-01.212).
Aux termes de cette décision, la Première chambre civile affirma que :
- En premier lieu, que l’article 1895 ne présente aucun caractère d’ordre public dans la mesure où :
- D’une part, « il a seulement pour objet d’écarter, dans le silence de la convention, une révision judiciaire des conditions de remboursement du prêt d’argent, éventuellement demandée, en vertu de l’article 1892, pour changement de “qualité” de la monnaie. »
- D’autre part, que « l’ordre public n’exige pas, dans le prêt d’argent, une protection des emprunteurs contre la libre acceptation du risque d’une majoration de la somme à rembourser, destinée à conserver à celle-ci le pouvoir d’achat de la somme prêtée apprécié par rapport au coût d’une denrée, dès lors qu’ils peuvent assumer des risques de même importance dans d’autres contrats»
- Enfin « qu’on ne peut non plus prétendre que le caractère impératif de cet article serait justifié par des principes d’ordre monétaire, qui l’imposeraient en raison d’un danger que les clauses entraînant cette majoration présenteraient pour la stabilité de la monnaie, l’influence desdites clauses à cet égard apparaissant en l’état trop incertaine pour légitimer une nullité portant une atteinte grave à la sécurité de l’épargne et du crédit»
- En second lieu, que les lois monétaires en vigueur n’impliquent pas l’invariabilité du pouvoir d’achat de la monnaie, lequel varie avec le prix des denrées, et n’empêchant pas dès lors les prêteurs plus que les autres créanciers de faire état des variations de ce pouvoir d’achat
Ainsi, par cet arrêt, non seulement la Cour de cassation reconnaît admet qu’une clause d’indexation puisse être stipulé dans un contrat de prêt en raison du caractère non impératif de l’article 1895 du Code civil, mais encore elle pose un principe général de validité des clauses d’indexation.
Elle abandonne ainsi la distinction entre les clauses stipulées dans le but de prévenir des fluctuations monétaires et celles stipulées aux fins de garantir l’équilibre économique des prestations.
Désormais, toutes les clauses d’indexation sont réputées valables, peu importe la finalité recherchée par les parties.
Dans un arrêt du 4 décembre 1962, la Cour de cassation a, par suite, appliqué la solution retenue dans l’arrêt Guyot aux clauses valeur or.
Après avoir rappelé « qu’aucune clause d’indexation n’est interdite par l’article 1895, texte non impératif », la Première chambre civile affirme que « la stipulation faisant dépendre le nombre de francs à rembourser du cours des Pièces d’or union latine n’était pas illicite, la liberté des transactions sur ces pièces et la reconnaissance officielle des variations corrélatives de leur valeur en francs, impliquant nécessairement la possibilité pour les particuliers de subordonner le montant d’un payement a ces variations » (Cass. 1ère civ. 4 déc. 1962).
Puis dans un arrêt du 10 mai 1966, la Haute juridiction reconnaît, pour la première fois, la validité des clauses valeur-monnaie étrangère, soit celles qui utilisent la monnaie, non pas comme une monnaie de paiement, mais comme une monnaie de compte, peu importe qu’elles soient stipulées dans un contrat qui ne présente aucun caractère international (Cass. 1ère civ. 10 mai 1966).
Pour justifier sa position, la Cour de cassation a indiqué, dans plusieurs arrêts, que la fixation d’une créance en monnaie étrangère devait s’analyser en « une indexation déguisée » (Cass. 1ère civ. 11 oct. 1989, n°87-16.341).
Or dans la mesure où les clauses d’indexation sont valides, il doit en être de même pour les clauses de valeur-monnaie étrangère.
Aujourd’hui, l’article 1343, al. 2e du Code civil, issu l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations, prévoit expressément que « le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation ».
Une lecture rapide de cette disposition suggère que le législateur a entendu reconnaître les clauses d’indexation. L’apparence est toutefois trompeuse.
À l’analyse, il y a lieu de comprendre ce texte comme posant moins un principe de validité des clauses d’indexation que comme une atténuation à la règle du nominalisme monétaire.
La liberté de stipuler des clauses d’indexation est, en effet, enfermée dans des conditions strictes énoncées aux articles L. 112-1 et suivants du Code monétaire et financière. Ces dispositions sont issues des ordonnances n° 58-1374 du 30 décembre 1958 et n° 59-246 du 4 février 1959.
a. Le régime des clauses d’indexation
a.1 Principe
L’article L. 112-2 du Code monétaire et financier prévoit que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services ».
Ainsi, cette disposition prohibe le recours par les parties à des indices généraux. Lors de l’instauration de cette prohibition, le principal objectif recherché par le législateur n’était autre que la lutte contre l’inflation.
Concrètement, il est donc fait interdiction aux parties d’indexer les obligations stipulées au contrat sur :
- D’une part, le SMIC
- Dans un arrêt du 18 mars 1992, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une décision rendue par un Conseil de prud’hommes qui avait validé la clause stipulée dans un contrat de travail qui « prévoyait une rémunération brute horaire égale au SMIC augmenté de 7 %» ( soc. 18 mars 1992, n°88-43.434).
- Pour la Chambre sociale, la prohibition des « clauses prévoyant des indexations fondées sur le SMIC le salaire minimum interprofessionnel de croissance» interdisait à l’employeur de « consentir par avance une révision automatique du salaire basée sur le SMIC ».
- D’autre part, le niveau général des prix
- La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt du 27 mars 1990 qu’était nulle la clause stipulée dans un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce prévoyant que la redevance serait indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains ( com. 27 mars 1990, n°88-15.092)
- Enfin, le niveau général des salaires
- Dans un arrêt du 3 novembre 1988, la Cour de cassation a, par exemple, jugé qu’était « atteinte d’une nullité absolue » la clause stipulée dans un contrat de fourniture de marchandises prévoyant l’indexation du prix de vente « sur l’indice général des taux de salaires horaires des ouvriers toutes activités série France entière» ( com. 3 nov. 1988, n°87-10.043).
a.2 Tempéraments
i. L’indexation libre
La prohibition du recours par les parties à des indices généraux n’est pas absolue. Elle souffre d’exceptions prévues par la loi.
L’article L. 112-2, al. 3e du CMF prévoit notamment que l’indexation est libre pour les opérations intéressant les dettes d’aliments.
Par rente d’aliments il faut entendre, précise le texte « les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l’article 759 du code civil ».
L’indexation peut encore être librement stipulée pour les prestations compensatoires qui prennent la forme de rentes (art. 276-1 C. civ.)
L’article L. 112-3 du CMF autorise, par ailleurs, l’indexation de certaines conventions sur le niveau général des prix :
- Les livrets A définis à l’article L. 221-1 ;
- Les comptes sur livret d’épargne populaire définis à l’article L. 221-13 ;
- Les livrets de développement durable et solidaire définis à l’article L. 221-27 ;
- Les comptes d’épargne-logement définis à l’article L. 315-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- Les livrets d’épargne-entreprise définis à l’article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique ;
- Les livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l’article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
- Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu’aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle ;
- Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d’habitation ou sur un local affecté à des activités commerciales ou artisanales relevant du décret prévu au premier alinéa de l’article L. 112-2 ;
- Les loyers prévus par les conventions portant sur un local à usage des activités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 ;
- Les rémunérations des cocontractants de l’Etat et de ses établissements publics ainsi que les rémunérations des cocontractants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, au titre des contrats de concession et de marché de partenariat conclus dans le domaine des infrastructures et des services de transport.
L’article D. 112-1 précise que l’indexation sur le niveau général des prix autorisée pour les produits et services visés à l’article L. 112-3 est mise en œuvre en utilisant l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Enfin, l’article L. 112-3-1 du CPC prévoit que « l’indexation des titres de créance et des contrats financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l’article L. 211-1 est libre. »
ii. L’indexation encadrée
S’il est fait interdiction pour les parties à un contrat de recourir à des indices généraux aux fins d’indexer leurs créances, l’article L. 112-2 du CMF les autorise à se référer à des indices spéciaux.
Ce texte prévoit, en effet, que l’indexation est permise lorsque l’indice stipulé au contrat entretient une relation directe :
- Soit avec l’objet de la convention
- Soit avec l’activité de l’une des parties
?. L’indexation en relation directe avec l’objet de la convention
La clause d’indexation est donc valable, à la condition que l’indice choisi par les parties soit en relation directe avec l’objet de la convention.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « l’objet de la convention ».
Deux approches sont possibles :
- Une approche restrictive
- Cette approche consiste à appréhender la notion « d’objet de la convention» au regard du droit commun des contrats.
- Si l’on emprunte cette voie, l’objet de la convention désigne la prestation à propos de laquelle l’accord des parties est intervenu et autour de laquelle s’ordonne l’économie du contrat
- Une approche extensive
- Cette approche consiste à s’émanciper du droit commun des contrats pour inclure dans l’objet de la convention la finalité recherchée par les parties.
- L’objet de la convention ne se limiterait donc pas seulement à l’objet de l’obligation des parties, il embrasserait également le but poursuivi par elles.
Entre ces deux approches, la jurisprudence a opté pour la seconde. Dans un arrêt du 9 janvier 1974, la Cour de cassation a, en effet, jugé à propos de la stipulation d’une clause d’indexation dans un contrat de prêt que « l’objet de la convention, au sens de l’article 79 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 modifie par l’article 14 de l’ordonnance du 4 février 1959, doit s’entendre dans son acception la plus large et que notamment l’objet d’un prêt peut être de permettre à l’acquéreur de construire ou d’acheter un immeuble » (Cass. 1ère civ. 9 janv. 1974, n°72-13.846).
En l’espèce, pour déterminer s’il existait un lien direct entre l’indice choisi par les parties et l’objet du prêt la haute juridiction examine la finalité du contrat de prêt qui avait été conclu aux fins de financier l’acquisition d’un bien immobilier.
Elle en déduit que la clause indexant la dette d’emprunt sur l’indice du coût de la construction était parfaitement valable.
?. L’indexation en relation directe avec l’activité de l’une des parties
La clause d’indexation est également valable lorsque l’indice retenu par les parties est en relation directe avec l’activité de l’une d’elles.
Comme pour la notion d’objet de la convention, la jurisprudence s’est livrée à une interprétation extensive de la notion d’activité de l’une des parties.
Elle a, en effet, admis que l’activité en cause ne devait pas nécessairement être celle exercée à titre principal (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 mars 1984, n°83-11.094).
Dans un arrêt du 6 juin 1984, la Cour de cassation a précisé que le changement d’activité de l’une des parties au cours du contrat était indifférent dans la mesure où « la validité d’une clause d’indexation doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat et ne peut être affectée par le changement d’activité du débiteur survenu ultérieurement » (Cass. 1ère civ. 6 juin 1984, n°83-12.301).
?. Le caractère direct de la relation entre l’indice choisi et l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties
==> Appréciation de l’existence d’une relation directe
L’appréciation du caractère direct de la relation entre l’indice choisi et l’objet de la convention ou l’activité de l’une des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Dans un arrêt du 4 mars 1964, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’appréciation du rapport existant entre la nature de l’indice et l’objet du contrat, étant fonction de la part plus ou moins importante pour laquelle le produit ou service envisage est susceptible d’entrer dans la réalisation de cet objet, est une question de fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation » (Cass. com. 4 mars 1964).
À l’analyse, les juridictions font plutôt montre d’une grande indulgence en la matière. La Cour de cassation a, par exemple, jugé dans un arrêt du 31 janvier 1984 qu’il existait une relation suffisamment directe entre le prêt consenti à un restaurateur et le prix des bouteilles d’eau de la marque « Perrier » sur lequel le financement était indexé (Cass. com. 31 janv. 1984, n°82-16.533).
Il a encore été jugé que cette relation directe existait entre le prix de vente du fonds de commerce d’un garagiste et le salaire de l’ouvrier qualifié dans l’échelon le plus élevé qui avait été utilisé comme indice de valorisation du fonds (Cass. 3e civ. 15 févr. 1972, n°70-13.280).
La Troisième chambre civile a décidé, dans le même sens, qu’était valide l’indexation du prix de vente d’une exploitation agricole sur le cours du lait (Cass. 3e civ. 4 juin 1971, n°69-14.047).
Il ressort de ces décisions que la jurisprudence reconnaît l’existence d’une relation directe dans des cas où l’indexation repose sur des éléments qui ne représentent que très partiellement l’activité.
Malgré, la souplesse de la jurisprudence quant à l’appréciation de cette relation directe entre l’indice choisi et l’activité exercée par l’une des parties ou l’objet de la convention, les parties ne sont pas à l’abri de voir annuler la clause d’indexation stipulée au contrat.
Dans un arrêt du 22 octobre 1970, la Cour de cassation a, par exemple, jugé illicite l’indexation de la valeur d’un immeuble sur le cours de la pièce d’or Napoléon (Cass. 3e civ. 22 oct. 1970, n°69-11.470).
Elle a également cassé, dans un arrêt du 16 février 1993, la décision d’une Cour d’appel qui avait déclaré licite la clause prévoyant l’indexation de la redevance due par un locataire-gérant sur l’indice national du coût de la construction.
La Chambre commerciale considère que, au cas particulier, il n’y avait pas de relation directe entre l’indice choisi et l’activité exercé par l’une des parties, dans la mesure où le contrat de location-gérance d’un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti. Or l’indice du coût de la construction intéresse précisément les immeubles bâtis (Cass. com. 16 févr. 1993, n°91-13.277).
==> Présomptions de relation directe
Afin de prévenir les difficultés d’appréciation de la validité des clauses d’indexation, le législateur a posé des présomptions de relation directe jouant dans trois cas précis :
- Présomption de relation directe entre l’indice du coût de la construction et une convention relative à un immeuble bâti
- Issu de la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970 modifiant l’article 79 de l’ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, relatif aux indexations, l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier prévoit que « est réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques»
- Présomption de relation directe entre l’indice trimestriel des loyers commerciaux et certaines activités commerciales ou artisanales
- Issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, l’article L. 112-2 du Code monétaire et financier prévoit que « est réputée en relation directe […] toute clause prévoyant une indexation […] pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques.»
- Présomption de relation directe entre l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires et les conventions relatives à un immeuble conclues pour une activité autre que commerciale ou artisanale
- Issu de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, l’article L. 112-2, al. 2e du Code monétaire et financier prévoit que « est également réputée en relation directe avec l’objet d’une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret. »
iii. L’indexation interdite
Outre la prohibition générale de l’indexation automatique des prix de biens ou de services posée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, cette même disposition prévoit des interdictions spécifiques en matière de contrats à exécution successive et de baux d’habitation.
L’alinéa 2e de ce texte prévoit ainsi que « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. »
L’alinéa 3e de l’article L. 112-1 du CMF prévoit encore que « est interdite toute clause d’une convention portant sur un local d’habitation prévoyant une indexation fondée sur l’indice ” loyers et charges ” servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. »
Le texte poursuit en énonçant qu’« il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n’ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application. »
b. Sanction
La mise en œuvre d’une clause d’indexation est susceptible de se heurter à deux difficultés :
- Sont irrégularité au regard du cadre contraignant posé par le législateur
- La disparition de l’indice au cours du contrat
i. L’irrégularité de l’indice choisi par les parties
==> La nature de la nullité
Il est admis que l’irrégularité d’une clause d’indexation soit sanctionnée par la nullité absolue (Cass. com. 3 nov. 1988, n°87-10.043). La raison en est que cette irrégularité porterait atteinte à l’ordre public monétaire.
D’aucuns soutiennent toutefois que, en raison de l’admission par le législateur des clauses d’indexation, les règles encadrant leur stipulation viseraient moins à défendre l’ordre public de direction, qu’à protéger les débiteurs contre les dangers représentés par l’indexation d’une dette.
Aussi, pour une frange de la doctrine « l’indexation devrait être frappée de nullité simplement relative »[3].
Pour l’heure, la Cour de cassation n’a adopté aucune décision en ce sens.
==> L’étendue de la nullité
S’agissant de l’étendue de la nullité, la question s’est posée de savoir si elle affectait seulement la clause jugée irrégulière ou si elle anéantissait l’acte dans son entier.
Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition de portée générale régissant l’étendue de la nullité.
Tout au plus, on a pu voir dans la combinaison des articles 900 et 1172 une distinction à opérer s’agissant de l’étendue de la nullité entre les actes à titre gratuit et les actes à titre onéreux.
- Les actes à titre gratuit
- L’article 900 du Code civil prévoit que « dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites»
- Pour les actes à titre gratuit, la nullité pourrait donc n’être que partielle en cas d’illicéité d’une clause
- Les actes à titre onéreux
- L’ancien article 1172 prévoyait que « toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend»
- Sur le fondement de cette disposition les auteurs estimaient que, pour les actes à titre onéreux, l’illicéité d’une stipulation contractuelle entachait l’acte dans son ensemble de sorte que la nullité ne pouvait être totale.
Manifestement, la jurisprudence a très largement dépassé ce clivage.
Les tribunaux ont préféré s’appuyer sur le critère du caractère déterminant de la clause dans l’esprit des parties. Ella a notamment retenu cette approche pour les clauses d’indexation (Cass. 3e civ. 24 juin 1971, n°70-11.730).
Aussi, la détermination de l’étendue de la nullité supposait-elle de distinguer deux situations :
- Lorsque la clause présente un caractère « impulsif et déterminant», soit est essentielle, son illicéité affecte l’acte dans son entier
- La nullité est donc totale
- Lorsque la clause illicite ne présente aucun caractère « impulsif et déterminant», soit est accessoire, elle est seulement réputée non-écrite
- La nullité est donc partielle
Jugeant le Code civil « lacunaire » sur ce point, à l’occasion de la réforme des obligations, le législateur a consacré la théorie de la nullité partielle, reprenant le critère subjectif institué par la jurisprudence.
Aux termes de l’article 1184, al. 1er du Code civil, « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. »
Il ressort de cette disposition que quand bien même un acte est affecté par une cause de nullité, il peut être sauvé.
Le juge dispose, en effet, de la faculté de ne prononcer qu’une nullité partielle de l’acte.
Cela suppose toutefois que deux conditions soient remplies :
- L’illicéité affecte une ou plusieurs clauses de l’acte
- La stipulation desdites clauses ne doit pas avoir été déterminante de l’engagement des parties
Si ces deux conditions sont remplies, les clauses affectées par la cause de nullité seront réputées non-écrites
L’application de cette règle à la clause d’indexation signifie que si elle a été déterminante du consentement des parties, alors le contrat doit être annulé dans son intégralité.
Dans le cas contraire, la clause d’indexation doit seulement être réputée non écrite. Aussi, appartient-il aux juges de rechercher l’intention des parties.
Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui pour prononcer la nullité d’une clause d’indexation avait relevé « le caractère essentiel de l’exclusion d’un ajustement à la baisse du loyer à la soumission du loyer à l’indexation » (Cass. 3e civ. 14 janv. 2016, n°14-24.681).
Dans un arrêt du 29 novembre 2018, la Troisième chambre civile a toutefois cherché à moduler cette sanction en censurant une Cour d’appel qui avait réputé non écrite la clause d’indexation dans son entier. Or elle estime que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée doit être réputée non écrite (Cass. 3e civ. 29 nov. 2018, n°17-23.058).
Cette limite vise à contenir les conséquences financières de l’annulation de l’intégralité d’une clause d’indexation. Il s’agit, en effet, d’éviter que le créancier ait à restituer l’intégralité des sommes indûment perçues résultant de l’indexation.
Dans le droit fil de cette jurisprudence, la question s’est posée de savoir si plutôt que d’annuler la clause d’indexation, même partiellement, le juge ne pouvait pas procéder à une substitution de l’indice irrégulier.
Dans un arrêt du 14 octobre 1975, la Cour de cassation a rejeté cette thèse en affirmant que le juge ne pouvait pas « se substituer aux parties pour remplacer une clause d’indexation, déclarée nulle par la loi, par une clause nouvelle se référant à un indice diffèrent » (Cass. 3e civ. 14 oct. 1975, n°74-12.880).
Elle a toutefois tempéré son approche en admettant, dans un arrêt du 22 juin 1987, que le juge puisse substituer à l’indice annulé un indice admis par la loi, dès lors que cette substitution se déduit de la commune intention des parties (Cass. 3e civ. 22 juill. 1987, n°84-10.548).
Cette position adoptée par la Cour de cassation ne paraît pas avoir été remise en cause par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime des obligations.
Le nouvel article 1167 introduit dans le code civil par ce texte prévoit, en effet, que « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. »
Certes ce texte n’envisage la réfaction du contrat qu’en cas de disparition ou d’inapplication de l’indice. La doctrine considère toutefois que la règle peut être étendue au cas de nullité de l’indice irrégulier.
==> L’action en nullité
S’agissant des titulaires de l’action en nullité, l’article 1180 du Code civil prévoit que « la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. »
Quant au délai de prescription de l’action, il y a lieu de distinguer selon que la nullité est soulevée par voie d’action ou par voie d’exception :
Lorsque la nullité est invoquée par voie d’action, l’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ».
Lorsque, en revanche, la nullité est soulevée par voie d’action, le délai de prescription est très différent de celui imparti à celui qui agit par voie d’action.
Aux termes de l’article 1185 du Code civil « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution. »
Il ressort de cette disposition que l’exception de nullité est perpétuelle.
ii. La disparition de l’indice choisi par les parties
L’article 1167 du Code civil prévoit « lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. »
Lorsqu’ainsi l’indice choisi par les parties est inapplicable, le juge est investi du pouvoir de le remplacer par un autre indice. Ce pouvoir avait déjà été reconnu au juge sous l’empire du droit antérieur (V. en ce sens Cass. 3e civ. 12 janv. 2005, n°03-17.260)
Il a également été admis que le juge puisse se faire assister par un expert afin de déterminer les évolutions probables de l’indice qui a cessé d’exister (Cass. com. 25 févr. 1963).
En cas d’impossibilité de déterminer l’évolution de l’indice qui a cessé d’exister ou de le substituer par un nouvel indice, l’issue retenue par le juge devrait, en toute logique, être la caducité du contrat (V. en ce sens Cass. com., 30 juin 1980, n° 79-10.632).
B) Les dettes de valeur
Autre correctif au principe du nominalisme monétaire institué par le législateur : le mécanisme de la dette de valeur.
La dette de valeur s’oppose radicalement à la dette de monnaie en ce que son montant est fixé, non pas à la date de création de l’obligation, mais au jour de son paiement.
En présence d’une dette de monnaie, le débiteur doit verser au créancier à la date d’exigibilité de l’obligation, le montant nominal de la dette stipulé au contrat.
Tel n’est pas le cas en présence d’une dette de valeur. Le montant dû par le débiteur correspond à une valeur non chiffrée qui est susceptible de subir des variations jusqu’à la date d’échéance et qui ne sera convertie en valeur monétaire qu’au jour du paiement.
Le mécanisme de la dette de valeur a été consacré par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opéré par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Le nouvel article 1343, al. 3e du Code civil prévoit que « le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation. »
Nombreuses sont les domaines dans lesquels la dette de valeur trouve application :
- Les restitutions
- L’article 1352 du Code civil prévoit que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.»
- Lorsqu’ainsi un débiteur doit restituer un bien en valeur, faute de pouvoir le restituer en nature, le montant de la dette correspondra à la valeur du bien dont l’estimation sera faite à la date du jugement ordonnant la restitution
- Les dettes de réparations
- Il est admis de longue date que les dommages et intérêts alloués à la victime d’un dommage sont évalués, non pas à la date de réalisation de ce dommage, mais au jour du jugement (V. en ce sens req. 24 mars 1942).
- Dans un arrêt du 11 janvier 1979, la Cour de cassation a, par exemple, affirmé que « si le droit, pour la victime d’un accident, d’obtenir la réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été cause, l’évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision» ( 2e civ. 11 janv. 1979, n°77-12.937).
- Dans un arrêt du 13 novembre 2003, elle a encore jugé que « le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date» ( 2e civ. 13 nov. 2003, n°02-16.733).
- Les récompenses
- Le mécanisme de la dette de valeur se retrouve également en droit des régimes matrimoniaux s’agissant du calcul des récompenses.
- L’article 1469, al. 1er du Code civil prévoit que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. »
- Il est ainsi des cas où le montant de la récompense dû à un époux correspondra au profit subsistant, soit à l’enrichissement dont a bénéficié le patrimoine débiteur de la récompense à raison de la dépense faite par le patrimoine créancier.
- L’accession
- En cas de construction d’un immeuble sur le terrain d’autrui, l’article 555, al. 3e du Code civil prévoit que lorsque le propriétaire du fonds opte pour la conservation de l’ouvrage, « il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.»
- L’indivision
- L’article 815-13 du Code civil prévoit que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
La question qui se pose au regard de ces différentes applications de la technique de la dette de valeur est de savoir si les parties à un contrat pourraient y recourir en dehors des cas prévus par la loi et la jurisprudence.
Dans un arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a rappelé que « le principe du nominalisme monétaire n’est pas d’ordre public » (Cass. com. 5 juill. 2005, n°02-10.233).
Aussi, cela signifie-t-il qu’il peut y être dérogé par convention contraire, raison pour laquelle il y a lieu de penser que la stipulation d’une dette de valeur doit être admise.
§2: Les dettes productives d’intérêts
==> Vue générale
L’une des particularités des dettes de somme d’argent est qu’elles sont susceptibles de produire des intérêts.
Par intérêt il faut entendre le revenu produit par un capital prêté, placé ou dû à raison d’une convention ou d’une condamnation.
Au fond, l’intérêt correspond à ce que l’on désigne plus couramment sous la formule de « loyer de l’argent » ou encore de « prix du temps ».
De façon plus imagée, Jean Carbonnier disait de l’intérêt qu’il est « l’enfant naturel de la monnaie »[4]. On pourrait alors filer la métaphore en précisant que la monnaie donne en réalité naissance à des jumeaux ; car l’intérêt est tantôt créditeur, tantôt débiteur.
Technique, l’intérêt se calcule en appliquant un pourcentage (le taux d’intérêt) à une somme d’argent (le capital) sur une période donnée.
Classiquement on distingue l’intérêt légal de l’intérêt conventionnel :
- L’intérêt légal
- Lorsqu’il est légal, l’intérêt a vocation à s’appliquer dans un certain nombre de situations prévues par la loi ou la jurisprudence.
- Ce taux de référence est principalement utilisé dans les procédures civiles ou commerciales.
- L’article 1231 du Code civil énonce en ce sens que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure».
- L’article 1231-7 dispose encore que « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.».
- Initialement, le taux d’intérêt légal était établi par le législateur lui-même.
- Par une loi du 3 septembre 1807 il avait, par exemple, été porté à 5%.
- Afin d’apporter un peu plus de souplesse à ce système qui, en période de forte inflation monétaire, ne permettait pas de rémunérer suffisamment les créanciers, la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs a prévu que le taux d’intérêt légal serait dorénavant fixé par décret « en fonction de la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines».
- Le calcul, fondé sur le taux de financement de l’État à treize semaines conduisit toutefois à une baisse très forte de son niveau dans un contexte où les taux sans risque de court terme étaient pratiquement nuls.
- Parce qu’il était particulièrement bas, le taux légal n’était nullement dissuasif pour les débiteurs contre lesquels courraient des intérêts moratoires. Aussi, Le législateur est-il intervenu une nouvelle fois dans le dessein de le rendre plus représentatif du coût de refinancement de celui à qui l’argent est dû et de l’évolution de la situation économique.
- L’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal a institué, dans cette perspective, une distinction entre deux taux légaux fondée sur le coût de refinancement.
- L’article 313-2 du Code monétaire et financier prévoit désormais que le taux légal « comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. ».
- Dans les deux cas, il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
- Toutefois, pour les particuliers, les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
- L’intérêt conventionnel
- Le taux d’intérêt conventionnel est celui qui est prévu par les parties dans la convention de crédit.
- Ces dernières sont certes libres de convenir le taux qui leur sied. Toutefois leur liberté demeure enfermée dans une double limite.
- D’une part, conformément à l’article 1907 du Code civil, la rémunération du prêteur ne peut pas excéder le taux d’usure, lequel ne saurait céder sous l’effet du principe d’autonomie de la volonté. Dès lors que des intérêts sont stipulés en violation de la règle de prohibition de l’usure, le prêteur s’expose notamment à une réduction de son droit aux intérêts au taux légal[5].
- D’autre part, il ressort des articles L. 314-5 du Code de la consommation et L. 313-4 du Code monétaire et financier que toutes les fois qu’un crédit est consenti par un professionnel la convention qui constate l’opération doit mentionner ce que l’on appelle le taux effectif global.
Cette distinction entre l’intérêt légal et l’intérêt conventionnel puise son origine dans l’article 1907 du Code civil applicable aux prêts d’argent qui prévoit que « l’intérêt est légal ou conventionnel. »
À l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le législateur a élevé cette distinction au rang de summa divisio des obligations de somme d’argent portant intérêts.
Ces obligations sont désormais abordées aux articles 1343-1 et 1343-2 du Code civil qui, comme relevé par des auteurs « esquissent un droit commun des intérêts de somme d’argent »[6].
Car en effet, le domaine des intérêts est bien plus vaste que les règles énoncées par ces dispositions qui se limitent à poser les principes généraux qui président :
- D’une part, aux paiements des dettes portant intérêts
- D’autre part, à la stipulation d’intérêts
- Enfin, à l’anatocisme
I) Le paiement des dettes portant intérêts
A) Libération du débiteur
L’article 1343-1 du Code civil prévoit que « lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. »
Il ressort de cette disposition que lorsque d’une dette est productive d’intérêts, son extinction est subordonnée au paiement :
- D’une part, du capital
- D’autre part, des intérêts
Il s’agit là de deux éléments indissociables qui participent d’une même obligation. Aussi, le paiement du seul capital ne suffit pas à éteindre la dette.
Tant que les intérêts, accessoires de la dette, ne sont pas réglés, le débiteur n’est pas libéré de son obligation.
Ainsi, la dette d’intérêt ne saurait être regardée comme étant distincte de la dette de capital : capital et intérêts forment une seule et même dette.
À ce titre, elle est soumise, à l’instar de n’importe quelle autre dette, au principe d’indivisibilité du paiement. Or pour mémoire, en application de ce principe qui s’infère de l’article 1342-4, al. 1er du Code civil, le paiement doit nécessairement porter sur tout ce qui est dû, faute de quoi le créancier est fondé à le refuser.
B) Imputation du paiement
==> Principe
L’article 1343-1, al. 1er prévoit que si l’obligation de somme d’argent porte intérêt « le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
À l’analyse, il s’agit là d’une reprise de la règle énoncée par l’ancien article 1254 du Code civil qui disposait que « le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Ainsi, en présence du paiement partiel d’une dette unique, celui-ci s’impute :
- D’abord sur les intérêts
- Ensuite sur le capital
L’objectif recherché ici est de protéger le créancier. Tant qu’il n’a pas été intégralement payé, sa dette doit continuer à produire des intérêts.
Or la base de calcul de ces intérêts n’est autre que le capital de la dette. Aussi, imputer le paiement prioritairement sur le capital reviendrait à affecter le rendement de la dette, alors même que le créancier n’a pas été totalement satisfait.
Pour cette raison, le législateur a estimé que, en cas de paiement partiel, celui-ci devait s’imputer d’abord sur les intérêts.
Dans un arrêt du 7 février 1995, la Cour de cassation a précisé que « au même titre que les intérêts visés par l’article 1254 du Code civil, les frais de recouvrement d’une créance constituent des accessoires de la dette ; que le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, imputer les paiements qu’il fait sur le capital par préférence à ces accessoires » (Cass. 1ère civ. 7 févr. 1995, n°92-14.216).
Ainsi, la règle prévoyant d’imputer prioritairement le paiement sur les intérêts de la dette est étendue aux frais de recouvrement et plus généralement à l’ensemble des accessoires de la dette.
==> Tempéraments
Le principe posé à l’article 1343-1 du Code civil n’est pas absolu ; il est assorti d’un certain nombre de tempéraments :
- Premier tempérament
- L’article 1343-1 est une disposition supplétive de volonté, ce qui signifie que les parties peuvent y déroger.
- Aussi, sont-elles libres de prévoir que le paiement s’imputera prioritairement sur le capital.
- À cet égard, contrairement à l’hypothèse où le débiteur est tenu de plusieurs dettes, il ne pourra pas imposer un ordre d’imputation au créancier.
- Dans un arrêt du 20 octobre 1992 la Cour de cassation a jugé en ce sens :
- D’une part, que « le débiteur d’une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il a fait sur le capital par préférence aux intérêts»
- D’autre part, que « le consentement des créanciers peut seul permettre l’imputation des paiements sur le capital par préférence aux intérêts» ( com. 20 oct. 1992, n°90-13.072)
- Ainsi, l’imputation du paiement ne pourra se faire prioritairement sur le capital de la dette que si le créancier y consent.
- Deuxième tempérament
- Dans un arrêt du 11 juin 1996, la Cour de cassation a précisé que « l’imputation légalement faite du paiement effectué par le débiteur principal est opposable à la caution» ( com., 11 juin 1996, n° 94-15.097).
- Il en résulte que l’imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal sur les intérêts générés par l’obligation garantie s’impose à la caution.
- L’article 2302 du Code civil apporte une dérogation à ce principe en disposant que « dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »
- Pratiquement cela signifie que le créancier sera déchu de l’intégralité des intérêts échus tant que le défaut d’information subsistera dans la mesure où les paiements du débiteur principal ne s’imputeront d’abord sur le capital restant dû.
- Cette sanction est de nature à inciter le créancier à régulariser au plus vite sa situation, faute de quoi le règlement de ses intérêts ne sera pas garanti.
- Troisième tempérament
- L’article 1343-5 du Code civil prévoit que, dans le cadre d’une demande de délai de grâce qui lui est adressée par un débiteur justifiant d’une situation financière obérée, le juge peut ordonner notamment « que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.»
- Quatrième tempérament
- L’article L. 733-1, 2° du Code de la consommation dispose que, dans le cadre d’une procédure de surendettement, la Commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, décider que les paiements s’imputeront « d’abord sur le capital»
II) La stipulation d’intérêts
L’article 1343-1 du Code civil prévoit que « l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat ».
Il ressort de cette disposition que la création d’obligations portant intérêt n’est pas le monopole du législateur. Les parties à contrats sont également autorisées à stipuler des intérêts.
Si cette faculté ne leur a pas toujours été reconnue, elle n’est pas non plus sans être rigoureusement encadrée.
A) De la prohibition à l’admission de la stipulation d’intérêts
La stipulation d’intérêts qui se rencontre essentiellement dans les prêts d’argent, était autrefois prohibée par le droit canonique.
Pour justifier cette interdiction, Saint Thomas d’Aquin soutenait qu’il serait contraire à la loi de Dieu d’exiger un intérêt de l’emprunteur en contrepartie du prêt d’une chose, alors même que cette chose a vocation à être restituée au prêteur en nature ou par équivalent, ce qui, en toute hypothèse, est constitutif d’une opération à somme nulle.
Une dérogation existait néanmoins pour les juifs et les Lombards. Une ordonnance royale prise en 1360 leur conféra le privilège de consentir des prêts d’argent moyennant rémunération. Les chrétiens, quant à eux, demeuraient tenus d’observer les prescriptions du droit canonique.
À partir du XVIe siècle, le bien-fondé de l’interdiction commence toutefois à être discuté, notamment sous l’impulsion Du Moulin puis de Turgot.
La critique portée par ces auteurs reposait, en substance, sur la revendication du droit à disposer de ses biens, d’où il s’infère la possibilité de faire produire des fruits à son argent.
Cette thèse a emporté, sans mal, la conviction du législateur révolutionnaire qui, dès 1789, a levé l’interdiction de la stipulation d’intérêts.
Puis, en 1804, les rédacteurs du Code civil ont consacré la liberté de stipuler des intérêts à l’article 1907 du Code civil, lequel admet que le contrat de prêt puisse être conclu à titre onéreux.
À l’occasion de la réforme du régime général des obligations, le législateur a entendu conférer une portée générale à la liberté de stipuler des intérêts en insérant dans le Code civil des dispositions (les articles 1343-1 et 1343-2) qui ont vocation à s’appliquer à toutes les obligations productives d’intérêts au-delà du contrat de prêt.
Cette liberté n’est toutefois pas sans limite : la stipulation d’intérêt requiert la satisfaction de plusieurs exigences.
B) L’encadrement de la stipulation d’intérêts
==> L’exigence d’une stipulation contractuelle
L’article 1343-1, al. 2e du Code civil prévoit que « l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat ».
Il ressort de cette disposition que, pour produire intérêt, une obligation de somme d’argent doit avoir été :
- Soit prévue par la loi
- Soit stipulée dans un contrat
Aussi, en l’absence de texte ou de stipulation contractuelle, une obligation est réputée ne produire aucun intérêt.
==> L’exigence générale d’un écrit
L’article 1343-1, al. 2e poursuit en prévoyant que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
Cette disposition ne fait manifestement que reprendre l’exigence énoncée à l’article 1907 du Code civil qui prévoit, en matière de prêt d’argent que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
De toute évidence, il s’agit là d’une disposition extrêmement protectrice des intérêts du débiteur[7]. Est-ce à dire que, en cas d’inobservation de cette exigence le créancier est totalement déchu de son droit aux intérêts ?
À l’analyse, à l’instar de l’article 1907 du Code civil, l’article 1343-1, al. 2e exige l’établissement d’un écrit s’agissant de la mention, non pas de l’intérêt, mais du taux de l’intérêt, soit sa mesure.
En matière de prêt d’argent, la question s’est rapidement posée de savoir s’il s’agissait d’une règle de preuve ou d’une règle de fond.
Par un arrêt du 24 juin 1981, la Cour de cassation a opté pour la seconde solution en jugeant que « l’exigence d’un écrit mentionnant le taux de l’intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d’intérêt » (Cass. 1ère civ. 24 juin 1981, n°80-12.773).
En cas d’absence d’écrit, la sanction est donc la nullité de la prévision des parties, ce qui revient, en pratique, à priver de son intérêt la présomption simple posée à l’article 1905 du Code civil.
En effet, tandis que cette disposition autorise le prêteur à rétablir son droit aux intérêts conventionnels s’il rapporte la preuve de la stipulation, l’article 1907 écarte, dans le même temps, cette possibilité en prévoyant que la mention du taux est exigée ad validitatem.
La stipulation d’intérêts ne se concevant pas en dehors de l’établissement d’un taux, la règle de fond posée à l’article 1907 prime nécessairement sur la règle de preuve édictée à l’article 1905.
La primauté de l’exigence d’un écrit à peine de nullité est d’autant plus forte que depuis la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, il est une règle d’ordre public édictée désormais à l’article L. 314-5 du Code de la consommation aux termes de laquelle le taux effectif global doit être « mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ».
==> L’exigence de mention de la périodicité de l’intérêt
L’article 1343-1, al. 2e du Code civil prévoit que le taux d’intérêt « est réputé annuel par défaut ».
Cette précision est une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations puisqu’elle ne se retrouve pas à l’article 1907 du Code civil.
Aussi, en l’absence de stipulation contraire, le calcul des intérêts se fait sur une période d’un an.
De l’avis de la doctrine, cette règle est supplétive de volonté, ce qui implique que les parties peuvent y déroger et donc prévoir une périodicité plus courte ou plus longue.
==> L’exigence spécifique de mention du taux effectif global
Introduite par la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, la notion de taux effectif global (TEG) est au cœur du dispositif de protection de l’emprunteur en matière de crédit.
Le législateur est parti du constat que le seul taux débiteur pratiqué par le prêteur ne permettait pas de rendre compte du coût exact du crédit, ne serait-ce que parce que d’autres frais se greffent à l’opération tels que l’assurance emprunteur, la rémunération des intermédiaires ou encore les frais de dossier.
L’appréciation du caractère usuraire de la rémunération du prêteur s’en trouve alors faussée. D’où la nécessité de mettre en place un outil qui permette de mesurer avec exactitude le coût réel de l’opération supporté par l’emprunteur. Parce qu’il intègre dans son calcul tous les frais payés par l’emprunteur, le taux effectif global répond à ce besoin.
Dans un premier temps, l’utilisation de cet outil a été circonscrite au domaine de la répression de l’usure. L’article 1er de la loi 28 décembre 1966 prévoit que l’usure doit être appréciée au regard du taux effectif global dont mention doit obligatoirement être faite dans tout acte constatant une opération de crédit. L’objectif poursuivi par ce texte était ainsi la protection du consommateur, lequel doit pouvoir déterminer la licéité du taux qui lui est appliqué.
Dans un second temps, il a été recouru à la notion de taux effectif global, sous l’impulsion du législateur européen, afin de stimuler la concurrence entre les établissements bancaires. Constatant qu’il existait de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit à la consommation et que ces disparités étaient susceptibles de créer des distorsions de concurrence entre les prêteurs dans le marché commun, les instances communautaires ont en tiré la conclusion qu’il était nécessaire de faciliter la comparaison des offres de crédits.
Pour ce faire, cela suppose notamment que les emprunteurs reçoivent des informations adéquates sur les conditions et le coût du crédit. Parmi ces informations, le taux effectif global occupe une place centrale dans le dispositif mis en place par le législateur européen. La directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation a ainsi créé l’obligation pour les établissements bancaires de mentionner, et dans leurs publicités, et dans les contrats de crédits proposés aux consommateurs, le taux effectif global.
Une fois cette exigence de communication par écrit à l’emprunteur du taux effectif global posée, la problématique relative au coût du crédit n’était pas pour autant définitivement résolue. Restait, en effet, à déterminer comment calculer le taux effectif global.
S’il est aisé de se représenter à quoi correspond le taux effectif global, plus délicate est la question de sa détermination.
Parce qu’il est supposé refléter le coût réel du crédit, les juges se montrent particulièrement exigeants à l’égard du banquier. La difficulté à laquelle celui-ci est confronté tient à l’obligation qui lui est faite de communiquer à l’emprunteur un taux effectif global exact à une décimale près.
Contrairement à ce que l’on pourrait être intuitivement tenté de penser, l’obtention de ce résultat est loin de consister en l’accomplissement d’une simple formalité pour le banquier, notamment lorsque le crédit présente de nombreuses particularités.
Tout d’abord, il lui appartient de n’omettre aucuns frais dans l’assiette de calcul, ce qui n’est pas sans soulever des difficultés liées à l’opportunité d’inclure ou d’exclure certains éléments.
Ensuite, le banquier doit veiller à communiquer à l’emprunteur toutes les informations nécessaires au calcul du taux effectif global, notamment le taux de période lorsque le crédit est consenti à un professionnel.
Enfin, il peut être observé que le calcul du taux effectif global consiste à résoudre une équation dont le résultat n’est jamais un nombre fini, à tout le moins l’hypothèse est rare.
Aussi, le taux effectif global est-il la plupart du temps le résultat d’un arrondi, alors même que le législateur ne tolère qu’une erreur à une décimale près.
Pour toutes ces raisons, la détermination du taux effectif global se révèle être un exercice extrêmement périlleux pour le banquier.
Celui-ci est d’autant plus tenu de faire preuve de vigilance que les actions en responsabilité se sont multipliées ces dernières années. La détermination du taux effectif global a donné lieu à un contentieux fourni qui s’articule autour de deux reproches.
Le premier consiste pour les plaideurs à contester le calcul, en tant que tel, du taux effectif global, soit parce qu’un élément aurait été omis dans son assiette, soit parce que le banquier n’aurait pas appliqué la bonne méthode de calcul, à tout le moins pas correctement.
Le second reproche qui est adressé au banquier tient à la communication du taux effectif global qui figure sur le contrat de prêt. Le grief se focalise ici, tant sur l’inexactitude du taux annoncé, que sur l’exhaustivité des informations communiquées à l’emprunteur.
L’absence de mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat prêt, tel qu’exigé par l’article L. 314-5 du Code de la consommation quelle que soit la nature du crédit, est sanctionnée pénalement.
L’article L. 341-9 du même Code prévoit, en effet, une peine d’amende de 150.000 euros, étant précisé que, antérieurement à la loi Hamon du 17 mars 2014, elle n’était que de 4.500 euros.
L’augmentation du montant de cette amende témoigne de la volonté du législateur de sanctionner lourdement l’inexécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG.
Quant à la sanction civile, l’article L. 341-48-1 du Code de la consommation prévoit que « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
III) L’anatocisme
Il n’est pas exclu que les intérêts produits par le capital de la dette produisent eux-mêmes des intérêts. C’est ce que l’on appelle l’anatocisme. Ce terme est issu du grec ana- (« encore une fois ») et tokos (« revenu »).
Dans un arrêt du 20 janvier 1998 a parfaitement décrit le mécanisme de l’anatocisme en observant que « lorsque le créancier et le débiteur sont convenus […] que les intérêts à échoir se capitaliseront à la fin de chaque année pour produire eux-mêmes des intérêts, ils constituent non plus des intérêts mais un nouveau capital qui s’ajoute au premier » (Cass. com. 20 janv. 1998, n°95-14.101).
Ce mécanisme, qui donc consiste à capitaliser les intérêts échus, a toujours été regardé avec une certaine méfiance ; car il est de nature à accélérer l’alourdissement du poids de la dette et ce, sans que le débiteur en prenne nécessairement conscience.
Bien que les rédacteurs du Code civil aient hésité à interdire l’anatocisme[8], le législateur s’est finalement résolu à l’autoriser.
Dans un premier temps, l’anatocisme a été régi par l’article 1154 du Code civil qui prévoyait que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Cette disposition relevait d’une section du Code civil consacrée aux « dommages et intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation ».
Est-ce à dire qu’il fallait limiter le domaine de l’anatocisme aux intérêts échus, comme le suggère d’ailleurs expressément le texte. Autrement dit, fallait-il comprendre que seuls les intérêts qui faisaient l’objet d’un retard de paiement pouvaient être capitalisés ?
Aussi, serait-il fait interdiction aux parties d’établir une convention qui stipulerait une capitalisation annuelle des intérêts à échoir.
Comme relevé par les auteurs[9], la Cour de cassation a très tôt écarté cette thèse, bien que l’article 1154 du Code civil vise « les intérêts échus ».
La Haute juridiction a affirmé que le texte n’interdisait nullement la stipulation d’une clause d’anatocisme pour les intérêts à échoir. Selon elle, l’article 1154 énonçait seulement la règle selon laquelle seuls les intérêts échus peuvent faire l’objet d’une capitalisation (V. en ce sens Cass. civ. 15 févr. 1965).
Cette interprétation, pour le moins extensive de l’article 1154 du Code civil, a été validée par le législateur à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dans un second temps, le législateur a, en effet, entendu conférer une portée générale à la règle autorisant l’anatocisme puisque désormais énoncée à l’article 1343-2 du Code civil qui relève du droit commun du paiement des obligations de sommes d’argent.
Ce nouveau texte prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il s’agit là assurément d’une modernisation de l’ancien article 1154 du Code civil ; les anciennes conditions de l’anatocisme étant reprises.
Pour être valable, plusieurs conditions doivent, en effet, être réunies :
- Exigence tenant à la source de l’anatocisme
- L’article 1343-2 du Code civil prévoit que l’anatocisme ne peut jouer que si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
- L’anatocisme prévu par le contrat
- Principe
- L’anatocisme ne peut donc jouer que si une clause du contrat le prévoit.
- À défaut, les intérêts de la dette ne pourront pas être capitalisés.
- À cet égard, les parties pourront prévoir une capitalisation des intérêts, tant pour les intérêts échus, soit ceux qui font l’objet d’un retard de paiement, que pour les intérêts à échoir, pourvu que cette capitalisation soit annuelle
- Exception
- La jurisprudence considère que la stipulation d’une clause d’anatocisme est prohibée en matière de crédit consenti à un consommateur.
- Dans un arrêt du 20 avril 2022 elle a par exemple affirmé que l’article L. 313-52 du Code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article « fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’ancien article 1154 du Code civil ( 1ère civ. 20 avr. 2002, n°20-23.617).
- Principe
- L’anatocisme ordonné par une décision de justice
- Alors que l’ancien article 1154 du Code civil prévoyait que l’anatocisme pouvait résulter d’« une demande judiciaire», le nouvel article 1343-2 prévoit qu’il peut jouer « si une décision de justice le précise ».
- Cette modification du texte suggère qu’il n’est désormais plus nécessaire de formuler une demande en justice pour obtenir, faute de stipulation au contrat d’une clause d’anatocisme, la capitation des intérêts produits par une obligation.
- Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation avait refusé de reconnaître au juge le pouvoir de prononcer, de sa propre initiative, la capitalisation des intérêts ( 1ère civ. 4 avr. 82-16.683)
- Cette faculté semble désormais lui être reconnue.
- L’anatocisme prévu par le contrat
- L’article 1343-2 du Code civil prévoit que l’anatocisme ne peut jouer que si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
- Exigence tenant à l’annualité de l’anatocisme
- L’article 1343-2 du Code civil prévoit que pour être capitalisés, les intérêts échus doivent être « dus au moins pour une année entière».
- Ainsi, l’anatocisme ne peut jouer que sur la base d’une périodicité annuelle.
- Limitation vise à empêcher un alourdissement excessif du poids de la dette.
- Il s’agit là d’une règle d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger par convention contraire.
§3: Les modalités du paiement d’une obligation de somme d’argent
A) La monnaie du paiement
L’article 1343-3, al. 1er du Code civil prévoit que « le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. »
Il s’agit là d’une règle d’ordre public qui donc s’impose, tant au débiteur, qu’au créancier d’une obligation.
Cette règle n’est toutefois pas absolue ; elle ne s’applique que pour les opérations réalisées « en France ».
Pour les opérations qui présentent un caractère international, le paiement en devises étrangères est admis.
B) Les modes de paiement
Si les parties sont libres de choisir le mode de paiement qui leur sied, le législateur a posé certaines restrictions pour le paiement en espèces.
L’article L. 112-6 du Code monétaire et financier prévoit en ce sens que « ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué. »
Il ressort de cette disposition que le paiement en espèces est interdit au-delà d’un certain montant qui dépend notamment du domicile fiscal du débiteur et de s’il agit ou non pour les besoins de son activité professionnelle :
- Le débiteur a son domicile fiscal en France ou agi pour les besoins de son activité professionnelle
- L’article D. 112-3, I, 1° du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, il lui ait fait interdiction :
- de payer en espèce une somme d’argent supérieure à 1.000 euros
- de payer au moyen de monnaie électronique une somme d’argent supérieure à 3.000 euros
- L’article D. 112-3, I, 1° du Code monétaire et financier prévoit que, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, il lui ait fait interdiction :
- Le débiteur a son domicile fiscal en France ou n’agit pas pour les besoins de son activité professionnelle
- Il convient de distinguer ici selon que le paiement est ou non réalisé au profit de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier au nombre desquelles figurent notamment les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, les intermédiaires d’assurance etc.
- Le paiement est réalisé au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
- L’article D. 112-3, I, 3° du Code monétaire et financier prévoit qu’il est fait interdiction au débiteur de payer en espèces ou au moyen de monnaie électronique une somme d’argent supérieure à 15.000 euros
- Le paiement n’est pas réalisé au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
- L’article D. 112-3, I, 2° du Code monétaire et financier prévoit qu’il est fait interdiction au débiteur de payer en espèces ou au moyen de monnaie électronique une somme d’argent supérieure à 10.000 euros
- Le paiement est réalisé au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
- Il convient de distinguer ici selon que le paiement est ou non réalisé au profit de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier au nombre desquelles figurent notamment les établissements de crédit, les établissements de paiement, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance, les mutuelles, les intermédiaires en opérations de banque et services de paiement, les intermédiaires d’assurance etc.
C) Le lieu du paiement
L’article 1343-4 du Code civil prévoit que « à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. »
Ainsi, pour les obligations monétaires, le paiement est non pas quérable, mais portable, ce qui signifie que c’est au débiteur de se rendre au domicile du créancier aux fins de lui « porter » son dû.
Il s’agit là d’une nouveauté introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations.
Le législateur justifie cette nouveauté en avançant « des raisons techniques, liées à la généralisation de la monnaie scripturale (chèque, virement, paiement par carte bancaire). »
[1] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, éd. Dalloz, 2019, n°1458, p. 1534
[2] F. Grua, Paiement des obligations de sommes d’argent – Monnaie étrangère, Jcl. Notarial Répertoire, fasc. 40, n°37
[3] J. François, Les obligations – Régime général, éd. Economica, 2020, n°51, p. 52
[4] J. Carbonnier, Les biens, 19e éd., 2000, PUF, n°22.
[5] Article L. 341-48 C. conso
[6] G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations, éd. Dalloz, 2018, n°964, p. 867.
[7] F. PELTIER, « Le droit positif des taux d’intérêt conventionnels », Banque et droit, juill.-août 1991, p. 127.
[8] Le projet d’article 1154 (ancien) du Code civil prévoyait que « il n’est point dû d’intérêts d’intérêts ».
[9] V. notamment sur cette question F. terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, éd. Dalloz, 2002, n°607, p. 590.