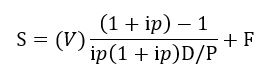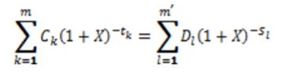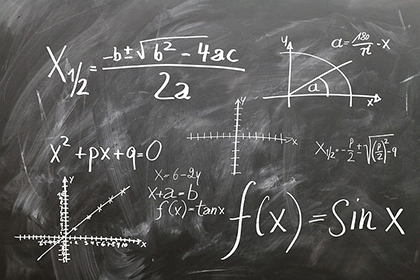En cas d’inexécution par le prêteur de son obligation de communication du TEG/TAEG à l’emprunteur, les sanctions applicables varient selon la nature du vice qui affecte cette obligation.
À cet égard, il convient de distinguer selon que le manquement consiste en l’absence de communication du TEG/TAEG (I) ou en la communication d’un taux erroné (II).
I) L’absence de communication du taux
En cas de violation de l’obligation de communiquer le TEG/TAEG à l’emprunteur, le prêteur encourt deux sortes de sanctions : une sanction pénale (A) et une sanction civile (B).
A) La sanction pénale
L’absence de mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat prêt, tel qu’exigé par l’article L. 314-5 du Code de la consommation quelle que soit la nature du crédit, est sanctionnée pénalement.
L’article L. 341-9 du même Code prévoit, en effet, une peine d’amende de 150.000 euros, étant précisé que, antérieurement à la loi Hamon du 17 mars 2014, elle n’était que de 4.500 euros.
L’augmentation du montant de cette amende témoigne de la volonté du législateur de sanctionner lourdement l’inexécution de l’obligation de communication du TEG/TAEG.
L’article L. 341-9 précise, à titre complémentaire, que les personnes physiques encourent l’interdiction « soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».
Bien que les peines encourues soient lourdes, le risque pour les établissements bancaires d’être condamnés est faible en raison de la nature de l’infraction qui, en l’absence de disposition contraire, revêt une nature intentionnelle.
Dès lors, sauf à démontrer que le prêteur avait l’intention de dissimuler le TEG/TAEG à l’emprunteur, il ne saurait être inquiété, raison pour laquelle les sanctions pénales sont rares en pratique à la différence des sanctions civiles qui, elles, sont régulièrement prononcées.
B) La sanction civile
Afin d’appréhender dans toutes ses composantes le régime de la sanction civile applicable en cas d’absence de communication du taux à l’emprunteur, il convient d’envisager, dans un premier temps, son contenu (?) et, dans un second temps, la prescription de l’action (?).
1) Le contenu de la sanction
Assez curieusement aucun texte ne prévoit de sanction civile de portée générale en cas de manquement à l’obligation de communication du TEG/TAEG.
Les seules sanctions envisagées par le Code de la consommation concernent les crédits consentis aux consommateurs.
La lecture des textes révèle qu’il convient encore de distinguer selon que l’absence de mention du TEG/TAEG porte sur le contrat de crédit en lui-même ou sur les documents de nature précontractuelle devant être fournis à l’emprunteur.
==> L’absence de mention du TAEG affecte les documents de nature précontractuelle
Par documents de nature précontractuelle, il faut entendre les fiches standardisées d’informations personnalisées et l’offre de prêt. Lorsque l’absence de mention du TAEG affecte l’un de ces documents, le Code de la consommation opère une nouvelle distinction entre les crédits à la consommation et les crédits immobiliers.
S’agissant des crédits à la consommation, l’article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. ».
Ainsi, la sanction encourue par l’établissement bancaire c’est la déchéance totale du droit aux intérêts.
Dans un arrêt du 26 novembre 2002, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « si pour le prêteur, l’absence d’offre préalable entraîne la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’en reste pas moins tenu aux intérêts au taux légal depuis la mise en demeure »[1].
| Cass. 1ère civ. 26 nov. 2002 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article L. 311-33 du Code de la consommation ; Attendu que Mme X... titulaire d'un compte à la Banque nationale de Paris a bénéficié d'une ouverture de crédit permanent "provisio" d'un montant de 28 000 francs, suivant offre acceptée le 15 mai 1996 soumise aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37, du Code de la consommation ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la banque, après avoir clôturé le compte et s'être prévalue de la déchéance du terme par mise en demeure du 4 mars 1998 a, le 26 février 1999 assigné Mme X... en paiement du solde de crédit et du solde débiteur du compte courant ; qu'après que le tribunal d'instance ait relevé avant dire droit que la banque avait consenti à Mme X..., par des avances pendant plus de trois mois, un découvert en compte constituant une ouverture de crédit qui, faute d'offre préalable régulière, entraînaient pour la banque la déchéance du droit aux intérêts, la BNP a retranché les intérêts et agios appliqués au solde débiteur du compte pour ne solliciter que le paiement avec intérêts au taux légal de la somme restant due ; Attendu que pour la débouter de sa demande le Tribunal retient que la somme à laquelle la banque a limité sa demande "est due sans intérêts ni légaux ni contractuels ; qu'en effet la sanction de l'article L. 311-33 interdit que la mise en demeure ou l'assignation fasse recouvrer aux sommes dues le caractère de créances susceptibles de produire des intérêts au sens de l'article 1351 du Code civil" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que, si pour le prêteur, l'absence d'offre préalable entraîne la déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'en reste pas moins tenu aux intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure, le Tribunal a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application, le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la BNP la somme de 18 993,43 francs sans intérêts, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Compiègne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais ; |
S’agissant des crédits immobiliers, l’article L. 341-34 du Code de la consommation prévoit que la sanction encourue en cas d’absence de mention du TAEG dans les documents précontractuels est la déchéance « du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
À la différence des crédits à la consommation, la sanction est ici facultative, à tout le moins le juge dispose du pouvoir de la moduler à proportion du manquement constaté.
Dans un arrêt du 2 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dès lors que la seule sanction civile de l’inobservation des règles de forme prévues par l’article L. 312-8 du Code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge […] le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges »[2].
| Cass. 1ère civ. 2 juill. 2002 | |
|---|---|
| Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la compagnie Generali France assurances et de la compagnie Commercial union, qui sont identiques : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, M. X..., propriétaire d'un navire de plaisance a souscrit, par l'intermédiaire des agents d'assurance Y... et Z... un contrat d'assurance auprès de la compagnie La Concorde aux droits de laquelle a succédé la société anonyme Generali France Assurance, qui intervenait en qualité d'apériteur des compagnies société anonyme La Préservatrice foncière assurances, société anonyme Mutuelle antillaise d'assurance et société anonyme Commercial union (les assureurs) ; que le navire a été intégralement perdu lors d'un naufrage ; que les assureurs ont refusé leur garantie à M. X... sur le fondement d'une clause "d'exclusion de garantie" des sinistres survenus "lorsque les papiers de bord du bateau assuré, entre autre, le certificat de navigabilité et le titre de navigation, ne sont pas en règle ou en état de validité" ; que M. X... a recherché la responsabilité de l'assureur pour manquement de l'agent général à son obligation de renseignement et de conseil ; Attendu que, pour accueillir cette prétention, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait avisé l'assureur, non seulement qu'il allait entreprendre une traversée hors des limites autorisées pour sa catégorie, mais encore qu'il avait fait changer les moteurs du navire, et que ce dernier avait tenu compte de ces indications pour rédiger les conditions particulières du nouveau contrat prévoyant la garantie pour le trajet de Miami à Pointe-à-Pitre ; Attendu, cependant, que l'obligation de conseil de l'assureur ne peut s'étendre à des circonstances qui excèdent le cadre de l'opération d'assurance qu'il propose ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la possession d'un certificat de navigabilité conforme aux exigences réglementaires s'imposait à M. X..., en dehors même de toute assurance du navire, sans qu'il incombe à l'assureur de lui rappeler cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie Generali France assurances à payer à M. X... la somme de 3 200 000 francs (487 836,85 euros), l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; |
==> L’absence de mention du TEG/TAEG affecte le contrat de prêt en lui-même
Le Code de la consommation ne prévoit aucune sanction en cas d’absence de mention du TEG/TAEG dans l’acte constatant le contrat de crédit.
Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de déterminer la sanction qu’il convenait d’appliquer en pareille hypothèse.
Alors qu’elle consacrait, dans un arrêt du 24 juin 1981, la valeur ad validitatem de l’écrit s’agissant de la régularité du contrat de crédit[3], la Cour de cassation a, le même jour, jugé que « en matière ce prêt d’argent consenti à titre onéreux, et a défaut de validité de la stipulation conventionnelle d’intérêts, il convient de faire application du taux d’intérêt légal à compter de la date du prêt »[4].
Ainsi, en cas d’absence de mention du TEG/TAEG sur le contrat de prêt, la sanction consiste à annuler la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels et à appliquer le taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts. La Cour de cassation fonde cette sanction sur l’article 1907 du Code civil qui prévoit que « le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». En l’absence d’écrit, le taux conventionnel doit ainsi être substitué par le taux légal, à charge pour le prêteur de restituer à l’emprunteur l’excédent d’intérêts indûment perçu.
Compte tenu de la portée générale de l’article 1907 du Code civil, la sanction ainsi dégagée par la jurisprudence a vocation à s’appliquer, tant aux crédits consentis aux consommateurs, qu’aux crédits destinés à financier une activité professionnelle.
Depuis lors, la haute juridiction a eu l’occasion de réitérer sa solution. Dans un arrêt du 9 avril 2002, la chambre commerciale a, par exemple, considéré, au visa de l’article 1907, al. 2 du Code civil que, « en matière de prêt d’argent à titre onéreux, même lorsqu’il s’agit d’un découvert en compte, à défaut d’écrit fixant le taux de l’intérêt conventionnel, le taux légal est applicable »[5].
| Cass. com., 9 avr. 2002 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné en paiement, Jean-Claude Y..., de même que son épouse, tenue en qualité de caution, ont, en particulier, contesté le montant des soldes débiteurs des deux comptes ouverts au nom du premier auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges qui ont enjoint au CIAL de dresser un nouveau décompte faisant apparaître les découverts en capital restant dus à la date du 18 août 1992, en excluant tous les intérêts débiteurs comptabilisés par la banque depuis l'ouverture des comptes jusqu'à cette date ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre ; Attendu que, pour confirmer le jugement et décider que les comptes ouverts au nom de M. Y... étaient des comptes ordinaires de dépôt, l'arrêt retient que les comptes n'enregistraient que des dépôts et des retraits de la part du client de la banque, les agios comptabilisés ne pouvant être assimilés à des remises de créances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats souscrits par M. Y... comportaient l'indication des "règles de fonctionnement du compte courant" et qu'elle avait constaté l'existence de remises, non seulement du titulaire du compte, mais aussi du CIAL, sous la forme d'inscription d'agios au débit du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, pour dispenser M. Y... du paiement de tout intérêt afférent au solde débiteur de ses deux comptes bancaires, la cour d'appel, par motifs adoptés, constate qu'il n'est mentionné nulle part que le découvert du compte de dépôt produit des intérêts à un taux d'intérêt déterminé, puis retient que la réception sans protestation ni réserves par le titulaire d'un compte à découvert, des relevés qui lui sont adressés périodiquement, ne peut suppléer l'absence de fixation préalable du taux d'intérêt conventionnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt d'argent à titre onéreux, même lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives aux montants des soldes débiteurs des comptes ouverts auprès du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine par M. Y..., l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; |
Il peut être observé que, dans un arrêt du 1er juin 2016, la Cour de cassation a étendu cette solution à l’absence de communication du taux de période.
La première chambre civile a considéré en ce sens que « faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation et de l’article 1907 du code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu »[6].
Cette solution est éminemment critiquable dans la mesure où, non seulement elle ne repose sur aucun fondement textuel, mais encore l’absence de communication du taux de période n’implique bien évidemment pas l’absence de TEG/TAEG. La sanction apparaît alors disproportionnée.
Pour reprendre la formule du Premier avocat général dans le cadre de son avis relatif à l’arrêt rendu en date du 3 décembre 2013, il ne faudrait « pas que le formalisme confine à l’absurde »[7].
2) La prescription de l’action
Le régime juridique de la prescription de l’action susceptible d’être engagée en cas d’absence de communication du taux à l’emprunteur n’est pas uniforme. Il convient de distinguer selon que la sanction applicable consiste en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ou en une substitution du taux conventionnel par le taux légal.
==> La sanction consiste en une déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts
Cette sanction est prononcée, pour rappel, lorsque l’absence de TAEG affecte les documents précontractuels.
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’opération est un crédit à la consommation ou un crédit immobilier. En toute hypothèse, l’action en déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts se prescrit par 5 ans en application de l’article L. 110-4, I du Code de commerce.
Pour mémoire, cette disposition prévoit que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de justifier l’application de ce texte en affirmant que la déchéance du droit aux intérêts visait à sanctionner, non pas une condition de formation du contrat de prêt, mais la violation d’une obligation légale.
En effet, seule la mention écrite du TEG/TAEG sur le contrat de prêt en lui-même est exigée ad validitatem. Il en résulte que, en dehors de cette hypothèse, la prescription de l’action visant à sanctionner l’absence de communication du TEG/TAEG ne relève pas du régime juridique de l’action en nullité.
Dans un arrêt du 2 juillet 1996, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la déchéance de l’article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n’est pas une nullité ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la simple déchéance du droit aux intérêts ne relève pas de l’article 1304 du Code civil »[8].
| Cass. 1ère civ. 2 juill. 1996 | |
|---|---|
| Attendu que, ayant délivré des commandements de payer demeurés infructueux, la société de Construction et d'aménagement pour la région parisienne et la province (CARPI) a sollicité le bénéfice des effets de la clause résolutoire contenue dans la vente à terme d'une maison d'habitation qu'elle avait conclue le 26 juillet 1984 avec les époux X... ; qu'elle a aussi demandé, outre l'expulsion des occupants, le paiement par eux des arriérés et d'une indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de toutes ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en décidant qu'un tableau d'amortissement, établi pour un prêt de 10 000 francs et distinguant le montant de l'annuité correspondant à l'amortissement du capital, celle correspondant aux intérêts et le capital restant dû, ne satisfaisait pas aux prescriptions légales uniquement parce qu'il était établi sur la base du prêt de 10 000 francs, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation ; et que, d'autre part, en prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au seul motif que la société CARPI avait méconnu l'article L. 312-8.2° du Code de la consommation et sans s'expliquer sur l'opportunité de cette sanction, la cour d'appel aurait violé les articles L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que la loi visait à garantir à l'emprunteur une information précise lui permettant, d'un seul coup d'oeil, de juger l'effort financier à consentir et de prendre connaissance de l'évolution, dans le temps, de sa dette en capital, de sorte qu'en imposant à l'emprunteur un calcul pour mesurer l'étendue et les modalités de son engagement éventuel la société CARPI a méconnu les exigences légales ; qu'ensuite la faculté ouverte par l'article L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation de prononcer la déchéance totale ou partielle des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir écarté la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts alors que, d'une part, en décidant que l'article 1304 du Code civil ne s'appliquait pas lorsque était sollicitée la déchéance des intérêts contractuels, la cour d'appel aurait violé ce texte par refus d'application ; que, de deuxième part, en décidant que la prescription ne saurait courir à compter de la date de signature du prêt, la cour d'appel aurait violé le même texte ainsi que les articles L. 312-8.2o et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation ; alors que, de troisième part, en retenant qu'aucune précision n'était apportée sur la date à laquelle l'irrégularité a été découverte, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article 1304 du Code civil qu'à l'égard de l'article 2257 du même Code et de la maxime contra non valentem agere non currit praescriptio ; qu'enfin, en refusant d'appliquer l'article 1304 du Code civil alors que la déchéance prévue par les articles L. 312-8.2o et L. 312-33, alinéa 4, du Code de la consommation, qui a pour objet de protéger les emprunteurs, est une nullité relative, la cour d'appel aurait encore violé ce texte ; Mais attendu que la déchéance de l'article L. 312-33, alinéa 4, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la simple déchéance du droit aux intérêts ne relève pas de l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; |
Régulièrement, la haute juridiction rappelle que c’est bien l’article L. 110-4 du Code de commerce qui a vocation à s’appliquer, s’agissant de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts[9]. L’enjeu réside dans le point de départ de la prescription.
Conformément à l’article 2224 du Code civil, l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Tel n’est pas le cas de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts qui, si elle est également de 5 ans, court à compter de la date de conclusion du contrat de crédit. La chambre commerciale a, notamment, fait application de cette règle dans un arrêt du 7 janvier 2004 en rappelant que « le point de départ de la prescription édictée à l’article L. 110-4 du Code de commerce devait être fixé au jour où l’obligation du débiteur avait été mise en exécution, c’est-à-dire à la date de conclusion du prêt »[10].
| Cass. com. 7 janv. 2004 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 février 2001), que les sociétés UCB et CFEC, aux droits desquelles se trouve la société UCB entreprises, ont, par acte du 21 mai 1986, consenti aux époux X... un prêt destiné à leur permettre d'acquérir un bien immobilier ; que, le 3 septembre 1996, les emprunteurs ont fait assigner les organismes prêteurs pour faire prononcer la nullité du contrat en raison du non-respect, par ces derniers, des dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-11 du Code de la consommation et subsidiairement, obtenir qu'ils soient déchus de leur droit aux intérêts ; que, réformant le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat de prêt, la cour d'appel s'est bornée à disposer que "l'action" introduite par les époux X... plus de dix ans après la conclusion de ce prêt était prescrite en rejetant l'ensemble de leurs demandes ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription décennale est applicable aux seules obligations nées à l'occasion du commerce de la partie obligée même commerçante ; que tout en constatant que l'acquisition de l'immeuble n'entrait pas dans le champ d'activité commerciale de M. X..., négociant en véhicules automobiles, la cour d'appel a néanmoins déclaré applicable la prescription décennale à l'action de M. X... ; qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; 2 / que les juges d'appel sont tenus de réfuter les motifs du jugement que s'approprient les intimés en sollicitant la confirmation du jugement entrepris ; que pour déclarer inapplicable la prescription décennale à l'action en nullité engagée par M. et Mme X..., le juge de première instance avait retenu que les emprunteurs n'avaient jamais pu être tenus à l'obligation découlant des actes sous-seing privés faute d'offre conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, de sorte qu'aucune prescription n'avait pu valablement courir ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen pertinent de nature à mettre obstacle à l'application de la prescription décennale, la cour d'appel a violé les articles 455, 954 du nouveau Code de procédure civile et 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation litigieuse étant née à l'occasion des activités commerciales de l'UCB, elle-même commerçante, la cour d'appel, loin d'avoir violé le texte visé par la première branche, en a fait au contraire l'exacte application ; Et attendu, d'autre part, qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé au jour où l'obligation du débiteur avait été mise à exécution, c'est à dire à la date de conclusion du prêt dont elle ne prononçait pas la nullité, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche ; D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Ainsi, tandis que le point de départ de l’action en nullité est susceptible de faire l’objet d’un report à la date où l’emprunteur a eu connaissance du vice affectant le contrat de prêt, ce report est inenvisageable s’agissant du point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts.
==> La sanction consiste en la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal
En application de la jurisprudence issue d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 24 juin 1981, la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal n’est encourue que dans l’hypothèse où la mention du TEG/TAEG ne figure pas sur le contrat de prêt en lui-même[11].
La sanction s’apparente ici à la nullité de la stipulation d’intérêt, raison pour laquelle il est admis que la prescription de l’action est régie, non pas par l’article L. 110-4 du Code de commerce, mais par l’article 2224 du Code civil.
Si, conformément à ce texte, l’action se prescrit par 5 ans, l’examen de la jurisprudence révèle que, pour déterminer le point de départ de la prescription, il convient d’opérer une distinction entre les crédits consentis à des consommateurs et ceux destinés à financer une activité professionnelle.
S’agissant des crédits destinés à financer une activité professionnelle, la Cour de cassation a considéré, dans trois arrêts rendus le 10 juin 2008, que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s’agissant d’un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué »[12].
| Cass. com. 10 juin 2008 | |
|---|---|
| Attendu, selon l' arrêt attaqué, que Mme X..., cliente de la Société générale (la banque) depuis 1986, a obtenu de cette dernière une ouverture de crédit et une convention d' escompte ; que le 18 décembre 1996, la banque lui a consenti un prêt professionnel de consolidation pour lui permettre d' apurer ses engagements ; que Mme X... a assigné la banque, le 3 septembre 1998, en restitution des agios prélevés au titre de l' ouverture de crédit et de la convention d' escompte ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l' article L. 313-2 du code de la consommation ; Attendu que la prescription de l' action en nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s' agissant d' un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ; Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme X... la somme de 891 901, 95 francs, soit 135 969, 57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 1998, au titre du trop perçu sur agios relatifs aux opérations d' escompte et au titre des agios relatifs au compte courant débiteur, l' arrêt, après avoir constaté que les erreurs de la banque dans le calcul du TEG pratiqué ont été révélées à Mme X... par son conseil en 1998 et qu' elle en a eu une connaissance plus complète lors du dépôt du rapport de l' expert le 20 décembre 2000, retient que ce n' est qu' à compter de l' une de ces dates que la prescription de la demande de Mme X... en nullité du TEG pratiqué par la banque avait pu commencer à courir ; Attendu qu' en statuant ainsi, la cour d' appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 238 du code de procédure civile et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la banque, en deniers ou quittances, la somme de 672 000 francs, soit 102 445, 73 euros, assortie de l' intérêt au taux légal calculé pour chacune des échéances sur une période de 84 mois, au titre du paiement des sommes restant dues sur le prêt, l' arrêt relève que si dans ses conclusions la banque a critiqué la méthode appliquée par l' expert pour le calcul du TEG, cette dernière a pu au cours des opérations d' expertise faire valoir son point de vue et qu' elle n' a en tout cas, malgré le caractère particulièrement technique des opérations expertales rendues nécessaires pour la vérification des taux effectivement appliquées par elle, nullement sollicité une contre- expertise ; que l' arrêt retient encore que les calculs de l' expert font ressortir une différence notable entre le TEG appliqué et le TEG mentionné dans l' acte de prêt, de sorte que c' est à juste titre que les premiers ont décidé que le taux du prêt devait être celui de l' intérêt au taux légal ; Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme l' y invitait la banque, si l' expert avait retenu la méthode de calcul imposée par l' article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d' appel n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu' il reçoit l' appel de Mme X..., l' arrêt rendu entre les parties le 4 avril 2005 par la cour d' appel d' Aix- en- Provence ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel d' Aix- en- Provence, autrement composée ; |
Il ressort de ces décisions que la chambre commerciale entend faire peser sur le professionnel une présomption de connaissance du vice affectant la convention au moment de sa régularisation ; d’où le point de départ de la prescription qui est fixé au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La Cour de cassation a réitéré sa position dans un arrêt du 11 mars 2010 aux termes duquel elle a jugé que « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée, en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, par un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur »[13].
S’agissant des crédits consentis à des consommateurs, la solution retenue par la haute juridiction est différente. Dans un arrêt du 7 mars 2006, la première chambre civile a jugé que le délai de la prescription quinquennale de l’action en annulation des stipulations d’intérêts litigieuses commençait de courir à compter de la révélation d’un vice affectant la convention de prêt[14].
Dans un arrêt du 11 juin 2009 elle encore affirmé, notamment au visa des articles 1304 et 1907 du Code civil, que « en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d’une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l’exception de nullité d’une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu’ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur »[15].
La Cour de cassation fait ainsi preuve de bien plus de souplesse lorsque l’action en nullité vise un contrat de prêt consenti à un consommateur. Aucune présomption de connaissance du vice ne pèse sur l’emprunteur, de sorte que la prescription de l’action ne commence à courir qu’à compter du jour de la révélation de l’erreur à ce dernier.
Toute la question est alors de savoir si ladite erreur était susceptible d’être révélée à l’emprunteur par la seule lecture du contrat de crédit ou si sa découverte exigeait un examen approfondi de la convention.
Dans un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a précisé que l’emprunteur doit avoir été en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l’acte de prêt, l’erreur qui affecte le calcul des intérêts[16].
Elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui, pour débouter un emprunteur de sa demande de report du point de départ de la prescription, a retenu que « les libellés des conditions particulières de l’offre de prêt du 26 août 1994, faisaient apparaître par leur seule lecture que les souscriptions de parts sociales n’étaient pas intégrées dans le calcul du TEG, ni les autres éléments du TEG invoqués par les emprunteurs et qu’il en était de même pour les actes authentiques de prêt »[17]. Il convenait dès lors, en l’espèce, de fixer le point de départ de la prescription à la date de conclusion du contrat.
| Cass. 1ère civ. 8 févr. 2017 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 30 novembre 2002, réitérée par acte notarié du 24 février 2004, la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier ; qu'après avoir été avisés de la déchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du prêt, M. et Mme X... ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 25 mars 2016 ; Attendu que, pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que celle-ci a été engagée plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre de prêt dont la seule lecture permettait aux emprunteurs de connaître les éléments inclus dans le calcul du taux effectif global et de déceler, par eux-mêmes, les irrégularités liées à la non-intégration de certains frais, tels que l'assurance incendie, les frais de courtage ou la facturation de services de gestion ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts sur une autre base que l'année civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation des intérêts, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; |
Dans l’hypothèse, en revanche, où la lecture du contrat se révélera difficultueuse, la jurisprudence admet que la découverte du vice soit réputée intervenir lors de la consultation d’un expert. Dans un arrêt du 30 novembre 2016, la Cour de cassation a néanmoins prévenu que « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties »[18].
La seule limite au report du point de départ de la prescription sera donc le délai de 20 ans prévu par l’article 2232, alinéa 1er du Code civil.
II) La communication erronée du taux
Concomitamment au débat qui s’est engagé sur la sanction applicable à l’absence de communication du TEG/TAEG, la question s’est posée de savoir si la mention d’un taux erroné devait être assimilée à l’absence d’écrit[19].
Un premier élément de réponse figure dans la circulaire du 18 décembre 2003 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.
Cette circulaire énonce que « sous réserve de l’appréciation de la Cour de cassation, que la mention dans le contrat de prêt d’un taux effectif global inexact constitue l’élément matériel du délit de non-mention du TEG dans un contrat de prêt ».
Elle précise, en outre, que « quelle que soit la nature du prêt, découvert en compte ou crédit classique, et quelle que soit la personne, physique ou morale, à qui il a été accordé, la non-mention du TEG dans le contrat de prêt n’a pas été dépénalisée et reste punie d’une peine d’amende correctionnelle ».
Ainsi, ce texte suggère que la communication d’un TEG/TAEG erroné à l’emprunteur soit sanctionnée de la même manière que le défaut de mention du taux dan le contrat de prêt.
Cette suggestion n’a pas laissé indifférente la Cour de cassation qui, dans un arrêt remarqué du 17 janvier 2006, pour sanctionner l’inexactitude d’un TEG, a prononcé à l’encontre du prêteur la substitution du taux d’intérêt conventionnel par le taux légal, soit la même sanction que si la mention du TEG ne figurait pas sur le contrat de prêt[20].
| Cass. com. 17 janv. 2006 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L.313-2, et R. 313-1 du Code de la consommation : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a acquis un fonds de commerce au moyen d'un prêt d'équipement consenti par le Crédit lyonnais (la banque), le 18 février 1994 ; que l'acte de prêt mentionne un taux d'intérêt annuel de 9,78%, et un taux effectif global de 10,67 % ; que l'emprunteur a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de novembre 1997 ; que la banque l'a alors poursuivi en paiement ; qu'il a contesté la validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel au motif que cet intérêt n'avait pas été appliqué à une année civile de trois cent soixante cinq jours, mais à une année de trois cent soixante jours ; Attendu que, pour se borner à ordonner la restitution des sommes trop perçues, l'arrêt retient que la banque a seulement commis une erreur dans l'application du taux d'intérêt en calculant les intérêts sur la base de 360 jours au lieu de l'année civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque était redevable à son client d'une somme de 235,55 euros perçue par elle au titre des intérêts calculés par référence à l'année bancaire de 360 jours au lieu de l'avoir été par référence à l'année civile, ce dont il se déduisait que le taux d'intérêt indiqué n'avait pas été effectivement appliqué de sorte que les exigences légales relatives à l'indication préalable et par écrit du taux effectif global n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
Cette solution a fait l’objet de nombreuses critiques, en ce que, tout d’abord, elle ne repose sur aucun fondement textuel. Surtout, elle revient à indemniser l’emprunteur au-delà du préjudice subi.
En cas d’erreur commise par l’établissement bancaire, le préjudice causé à l’emprunteur est limité au montant des intérêts non pris en compte dans le TEG/TAEG. Or en prononçant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, l’emprunteur est indemnisé à hauteur de la différence existant avec le taux légal.
Bien que pertinentes, les critiques ainsi émises par la doctrine n’ont pas suffi à convaincre la jurisprudence qui a réaffirmé sa solution à plusieurs reprises[21].
Tout au plus, la Cour de cassation a infléchi sa position lorsque la communication d’un TEG/TAEG erroné n’est pas préjudiciable à l’emprunteur. Dans un arrêt du 12 octobre 2016, la première chambre civile a considéré que lorsque le TEG était inférieur à celui qui était stipulé, l’action en nullité ne pouvait pas prospérer dans la mesure où l’erreur alléguée ne venait pas au détriment des emprunteurs[22].
Autrement dit, seule l’erreur préjudiciable à l’emprunteur est susceptible d’être sanctionnée[23]. La solution doit être approuvée. On comprendrait mal qu’un emprunteur puisse être indemnisé alors qu’il n’a subi aucun préjudice.
| Cass. 1ère civ. 16 nov. 2016 | |
|---|---|
| Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la banque), qui avait consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière ; que les emprunteurs ont excipé de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, devenus respectivement les articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3 et L. 314-4, et les articles R. 314-1, R. 314-2, R. 314-3, R. 314-4 et R. 314-5 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de fixer la créance de la banque, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné et que l'erreur porte sur une décimale ; que pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que le taux effectif global était « totalement erroné » ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. et Mme X... faisaient valoir que l'erreur de calcul entraînait une différence d'une décimale entre le taux stipulé et le taux réel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; 2°/ que l'erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel ; que cette sanction est encourue dès lors que le taux effectif global est erroné, qu'il soit inférieur au taux réellement pratiqué ou supérieur à celui-ci ; que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré qu'à supposer acquis que le taux effectif global indiqué soit en réalité supérieur au taux effectif global réel, un tel écart, provenant d'un taux erroné par excès, ne saurait fonder les prétentions des appelants à l'encontre de ce taux effectif global, puisque l'erreur n'aurait pu avoir comme conséquence que de contraindre l'emprunteur à consentir un coût global finalement supérieur à celui réellement assumé ; qu'en statuant ainsi, tandis que le caractère erroné du taux effectif global, qui atteignait la décimale, entraînait sa nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; 3°/ que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande d'annulation du taux effectif global, la cour d'appel a considéré que la situation qui bénéficie à l'emprunteur ne saurait avoir pour conséquence de contraindre la banque à restituer une partie des intérêts payés, une telle sanction paraissant au surplus non proportionnée aux griefs allégués par M. et Mme X... ; qu'en statuant ainsi, tandis que la sanction du caractère erroné du taux effectif global consiste en la substitution du taux de l'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les emprunteurs arguaient d'un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l'erreur alléguée ne venait pas à leur détriment, la cour d'appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi; |
[1] Cass. 1ère civ., 26 nov. 2002, n°00-17119.
[2] Cass. 1ère civ. 2 juill. 2002, n°99-202.
[3] Cass. 1ère civ. 24 juin 1981, n°80-12773.
[4] Cass. 1re civ., 24 juin 1981 : D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; JCP G 1982, II, 19713, note Vasseur ; RTD com. 1981, p. 809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié
[5] Cass. com., 9 avr. 2002, n°99-10028 : Banque et droit 2002, n° 84, p. 46, obs. Th. Bonneau. – V. également en ce sens Cass. 1re civ., 28 oct. 2010 : JCP E 2011, 1369, n° 15, obs. N. Mathey.
[6] Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-15.813
[7] Cass. com. 3 déc. 2013, n°12-22755.
[8] Cass. 1ère civ. 2 juill. 1996, n°94-17530.
[9] V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 mai 2013, n°11-24278.
[10] Cass. com. 7 janv. 2004, n°01-03966.
[11] Cass. 1re civ., 24 juin 1981 : D. 1982, jurispr. p. 397, note M. Boizard ; JCP G 1982, II, 19713, note Vasseur ; RTD com. 1981, p. 809, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié
[12] Cass. com., 10 juin 2008 : JCP E 2008, 2221, note A. Gourio et N. Aynès ; Banque et droit 2008, p. 28, obs. Th. Bonneau ; RD bancaire et fin. 2008, comm. 103, obs. F. Crédot et T. Samin ; D. 2009, p. 1051, note D. Martin.
[13] Cass. 1ère civ. 11 mars 2010, n°09-14236 ; V. également en ce sens Cass. 1re civ., 20 déc. 2012 : JCP E 2013, 1282, obs. N. Mathey.
[14] Cass. 1re civ., 7 mars 2006 : D. 2006, p. 913, note V.A.R. ; RD bancaire et fin. 2006, act. 93, obs. F. C. et T. S. ; Banque mag. sept. 2006, n° 683, p. 97, note J.-L. Guillot et M. Boccara. –
[15]Cass. 1re civ., 11 juin 2009 : D. 2009, p. 1689, obs. V. Avena-Robardet ; JCP E 2009, note A. Gourio ; RD Bancaire et fin. 2009, comm. 150, obs. F. Crédot et T. Samin.
[16] Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, n° 16-11.625 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 61, obs. N. Mathey.
[17] Cass. com., 7 févr. 2012, n° 11-10.883.
[18] Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-25.429.
[19] V. en ce sens J. LASSERRE CAPDEVILLE, « Taux effectif global erroné : on referme la boite de Pandore ? », D. 2014.
[20] Cass. com., 17 janv. 2006, n°04-11100 RD bancaire et fin. 2006, act. 55 ; RTD com. 2006, p. 460, obs. D. L. ; JCP E 2006, 2658, note N. Mathey.
[21] V. en ce sens Cass. 1re civ., 13 mars 2007 ; Cass. 1re civ., 28 juin 2007 ; Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-21.826 : JurisData n° 2012-024870 ; RD bancaire et fin. 2013, obs. F. Crédot et T. Samin.
[22] Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-25.034 : RD bancaire et fin. 2017, comm. 5, obs. N. Mathey.
[23] V. en ce sens Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 15-23.178.