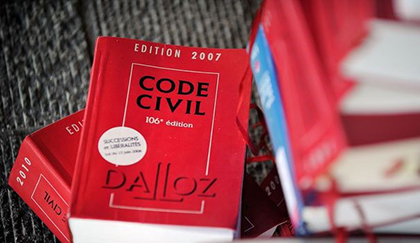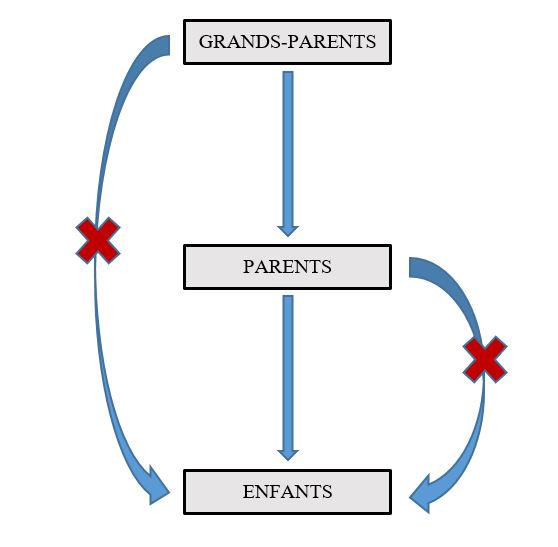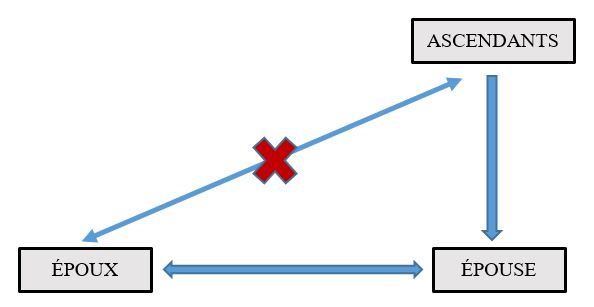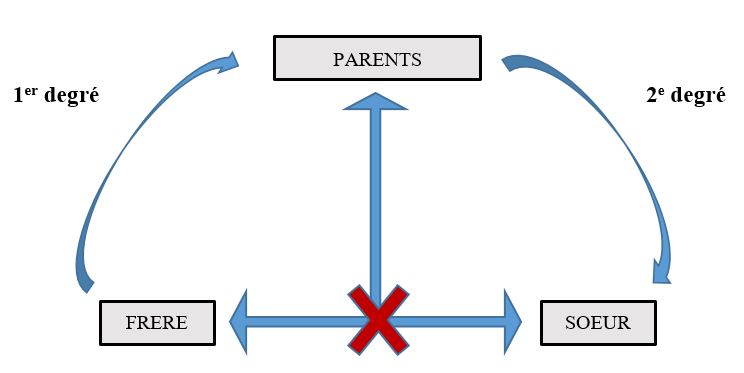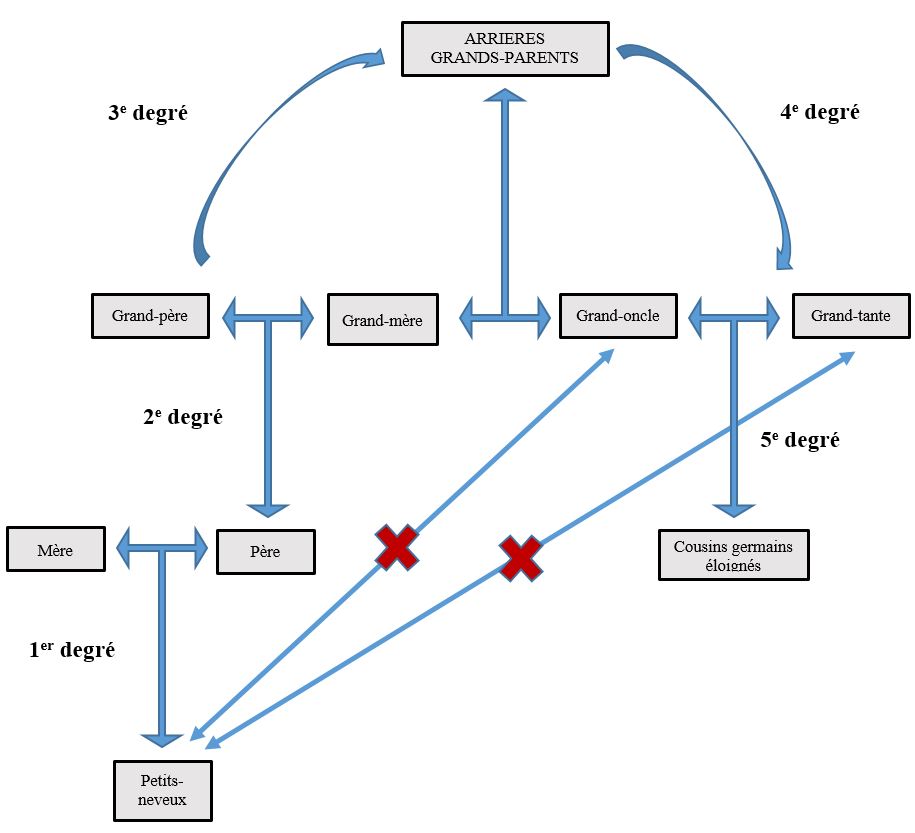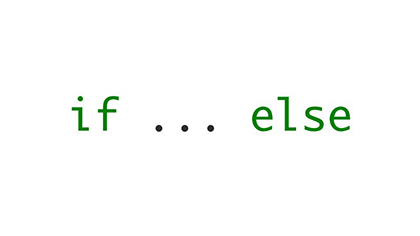L’étude de la formation du mariage suppose d’envisager, dans un premier temps, les conditions du mariage, après quoi il convient de traiter, dans un second temps, la sanction du non-respect desdites conditions.
I) Les conditions de formation du mariage
La formation du mariage est subordonnée à la satisfaction de conditions de fond et de conditions de forme.
A) Les conditions de fond
Les conditions de fond du mariage tiennent cumulativement :
- Aux qualités physiques des époux
- À la capacité juridique des époux
- Au consentement des époux
- À la parenté des époux
- À la situation conjugale des époux
- Les conditions tenant aux qualités physiques des époux
a) L’indifférence du sexe
Aux termes de l’article 143 du Code civil « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. »
Ainsi, le mariage n’est-il plus réservé aux seuls couples hétérosexuels, comme cela a été le cas jusqu’à la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, dite loi Taubira.
L’adoption de cette loi, qui a été présentée comme visant à lutter contre les discriminations et à reconnaître de nouveaux droits, met un terme au long débat jurisprudentiel, d’où il est ressorti que, si aucune norme constitutionnelle, internationale ou européenne n’impose d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe, aucune de ces normes de l’interdit.
Aussi, le législateur a-t-il été invité par les juridictions nationales à prendre ses responsabilités en se prononçant sur l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.
==> L’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars 2007
L’un des éléments déclencheurs du mouvement tendant à la reconnaissance du « mariage pour tous » est, sans aucun doute, le mariage célébré entre deux hommes, le 5 juin 2004, par Noël Mamère, alors maire de la commune de Bègles en Gironde.
Cet évènement, porté sur le devant de la scène à grand renfort de médias a été l’occasion pour les tribunaux français de préciser la portée des articles du code civil relatifs au mariage.
Par jugement du 27 juillet 2004, le mariage célébré en violation de l’article 144 du Code civil a été annulé.
Cette décision a été confirmée en appel par la Cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 19 avril 2005 (CA Bordeaux, 19 avr. 2005, n° 04/04683).
Les juges ont estimé, dans cette décision, qu’il n’existe « dans les textes fondamentaux européens et dans la jurisprudence européenne aucune contradiction avec la législation française interne relative au mariage, laquelle ne concerne que des personnes de sexe différent. Comme le premier juge, la cour considère que la différence de sexe est une condition de l’existence même du mariage, condition non remplie dans le cas de l’acte relatif à Stéphane C. et Bertrand C.. La célébration organisée par eux le 5 juin 2004 devant l’officier d’état civil de Bègles ne peut être considérée comme un mariage. Ainsi que le soutient le ministère public, l’acte qui en a été dressé n’a pas d’existence juridique et son écriture doit être annulée, avec transcription en marge de l’acte de naissance des intéressés et de l’acte lui-même ».
Pour aboutir à cette solution, ils se réfèrent notamment au Discours préliminaire sur le Projet de Code civil rédigé par Portalis lequel écrivait en 1804 que :
« on ne doit point céder à des prétentions aveugles. Tout ce qui est ancien a été nouveau… nous sommes convaincus que le mariage, qui existait avant l’établissement du christianisme, qui a précédé toute loi positive, et qui dérive de la constitution même de notre être, n’est ni un acte civil, ni un acte religieux, mais un acte naturel qui a fixé l’attention des législateurs… le rapprochement de deux sexes que la nature n’a faits si différents que pour les unir, a bientôt des effets sensibles. La femme devient mère… l’éducation des enfants exige, pendant une longue suite d’années, les soins communs des auteurs de leurs jours… Tel est le mariage, considéré en lui-même et dans ses effets naturels, indépendamment de toute loi positive. Il nous offre l’idée fondamentale d’un contrat proprement dit… ce contrat, d’après les observations que nous venons de présenter, soumet les époux, l’un envers l’autre, à des obligations respectives, comme il les soumet à des obligations communes envers ceux auxquels ils ont donné l’être, les lois de tous les peuples policés ont cru devoir établir des formes qui puissent faire reconnaître ceux qui sont tenus à ces obligations. Nous avons déterminé ces formes ».
Ainsi donc, comme le premier juge, la cour d’appel en conclut qu’en droit interne français le mariage est une institution visant à l’union de deux personnes de sexe différent, leur permettant de fonder une famille appelée légitime.
La notion sexuée de mari et femme est l’écho de la notion sexuée de père et mère. Cette différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l’existence du mariage.
Pour cette raison, le mariage contracté entre deux personnes de même sexe doit être annulé.
Par un arrêt du 13 mars 2007, la Cour de cassation a validé l’arrêt rendu par la Cour de d’appel de Bordeaux le 19 avril 2005 (Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n°05-16.627).
La première chambre civile a considéré que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ».
Lors de l’audience de la première chambre civile de la Cour de cassation, l’avocat général avait déclaré que, compte tenu des enjeux de société importants et de la dimension politique des réponses pouvant être apportées à la question, « abandonner à la seule autorité judiciaire le soin de se prononcer (…) paraît exiger du juge qu’il accomplisse une tâche excédant les limites permises de son action ».
| Cass. 1ère civ. 13 mars 2007 |
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 19 avril 2005), que, malgré l’opposition notifiée le 27 mai 2004 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, le maire de la commune de Bègles, en sa qualité d’officier d’état civil, a procédé, le 5 juin 2004, au mariage de MM. X... et Y... et l’a transcrit sur les registres de l’état civil ; que cet acte a été annulé, avec mention en marge des actes de naissance des intéressés ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que MM. X... et Y... font grief à l’arrêt d’avoir annulé l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, avec transcription en marge de cet acte et de leur acte de naissance, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en retenant que la différence de sexe constitue en droit interne français une condition de l’existence du mariage, cependant que cette condition est étrangère aux articles 75 et 144 du code civil, que le premier de ces textes n’impose pas de formule sacramentelle à l’échange des consentements des époux faisant référence expressément aux termes "mari et femme", la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu’il y a atteinte grave à la vie privée garantie par l’article 8 de la Convention lorsque le droit interne est incompatible avec un aspect important de l’identité personnelle du requérant ; que le droit pour chaque individu d’établir les détails de son identité d’être humain est protégé, y compris le droit pour chacun, indépendamment de son sexe et de son orientation sexuelle, d’avoir libre choix et libre accès au mariage ; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que par l’article 12 de la Convention se trouve garanti le droit fondamental de se marier et de fonder une famille ; que le second aspect n’est pas une condition du premier, et l’incapacité pour un couple de concevoir ou d’élever un enfant ne saurait en soi passer pour le priver du droit visé par la première branche de la disposition en cause ; qu’en excluant les couples de même sexe, que la nature n’a pas créés potentiellement féconds, de l’institution du mariage, cependant que cette réalité biologique ne saurait en soi passer pour priver ces couples du droit de se marier, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ alors que si l’article 12 de la Convention vise expressément le droit pour un homme et une femme de se marier, ces termes n’impliquent pas obligatoirement que les époux soient de sexe différent, sous peine de priver les homosexuels, en toutes circonstances, du droit de se marier ; qu’en excluant les couples de même sexe de l’institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le libellé de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’écarte délibérément de celui de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il garantit le droit de se marier sans référence à l’homme et à la femme ; qu’en retenant que les couples de même sexe ne seraient pas concernés par l’institution du mariage, et en annulant l’acte de mariage dressé le 5 juin 2004, la cour d’appel a violé l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui n’a pas en France de force obligatoire ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
Par la suite, ni le Conseil constitutionnel, ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont jugé que l’interdiction faite aujourd’hui par notre législation aux couples de personnes de même sexe de se marier était contraire à la Constitution ou à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
==> La décision du Conseil constitutionnel du 28 janvier 2011
En janvier 2011, le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation, posée par deux femmes – Corinne C. et Sophie H. – qui désiraient se marier ensemble (Décision n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011).
Elles entendaient contester la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article 75 du Code civil aux termes duquel l’officier d’état civil « recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour époux : il prononcera, au nom de la loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. »
La question prioritaire de constitutionnalité portait également sur la conformité de l’article 144 du Code civil qui, en son temps, prévoit que « l’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ».
Selon les requérantes, l’interdiction du mariage entre personnes du même sexe et l’absence de toute faculté de dérogation judiciaire porteraient atteinte à l’article 66 de la Constitution et à la liberté du mariage.
L’ouverture du mariage aux seuls couples hétérosexuels méconnaitrait, en outre, le droit de mener une vie familiale normale et l’égalité devant la loi.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel répond, en substance, que conformément à l’article 34 de la Constitution, il appartient au seul législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
Les juges de la rue de Montpensier ajoutent que le Conseil constitutionnel n’est nullement investi d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, en conséquence de quoi il est incompétent pour se prononcer sur les choix du législateur, dès lors qu’ils sont conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit.
En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel considère que, si le dernier alinéa de l’article 75 et l’article 144 du code civil ne font pas obstacle à la liberté des couples de même sexe de vivre en concubinage dans les conditions définies par l’article 515-8 de ce code ou de bénéficier du cadre juridique du pacte civil de solidarité régi par ses articles 515-1 et suivants, il n’en demeure pas moins que le droit de mener une vie familiale normale n’implique pas le droit de se marier pour les couples de même sexe
En dernier lieu, il affirme que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Aussi, en déduit-il qu’en maintenant le principe selon lequel le mariage est l’union d’un homme et d’une femme, le législateur a, dans l’exercice de la compétence que lui attribue l’article 34 de la Constitution, estimé que la différence de situation entre les couples de même sexe et les couples composés d’un homme et d’une femme peut justifier une différence de traitement quant aux règles du droit de la famille
En conséquence, il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, de cette différence de situation ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ;
La position du Conseil constitutionnel a été confirmée par la Cour européenne des droits de l’Homme.
==> Décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 24 juin 2010
Dans un arrêt Schalk et Kopf c/ Autriche du 24 juin 2010, la Cour européenne des droits de l’homme, relevant l’absence de consensus des États membres du Conseil de l’Europe sur ce point, a jugé que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’imposait pas aux États parties l’obligation de permettre le mariage des couples homosexuels.
Elle relève que « à ce jour, pas plus de six sur quarante-sept États parties à la convention autorisent un tel mariage ».
Elle observe encore que « le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre. Elle rappelle qu’elle ne doit pas se hâter de substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre ».
Pour cette raison, elle refuse ainsi d’imposer aux États parties d’ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe.
La Cour a en outre rejeté le grief selon lequel l’interdiction du mariage entre les deux requérants emportait une discrimination non justifiée, au motif que l’Autriche a depuis lors mis en place un système de « partenariat enregistré » emportant pour les partenaires des droits comparables à ceux des époux.
Aussi, dans la mesure où « les requérants peuvent désormais conclure un partenariat enregistré, la Cour n’a pas à rechercher si l’absence de reconnaissance juridique des couples homosexuels aurait emporté violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 si telle était encore la situation ».
Dans le droit fil de cette décision, la Cour européenne des droits de l’Homme a, dans un autre arrêt (Gas et Dubois c/ France) du 15 mars 2012 rejeté l’argument d’une discrimination entre les couples mariés qui peuvent adopter l’enfant du conjoint et les couples non mariés, notamment de même sexe, qui se voient refuser ce droit, sur le fondement de l’article 365 du code civil.
La Cour a estimé, comme dans l’arrêt précédemment cité, que le mariage conférait « un statut particulier à ceux qui s’y engagent, que l’exercice du droit de se marier était protégé par l’article 12 de la Convention et emporte des conséquences sociales, personnelles et juridiques, et que par conséquent, on ne saurait considérer, en matière d’adoption par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples mariés ».
La Cour en conclut que les requérantes ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle d’un couple marié.
==> Les conventions internationales
Ni la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale de l’ONU le 16 décembre 1966, n’interdisent le mariage des couples de même sexe, même s’ils ne le prévoient pas expressément.
C’est ainsi que de nombreux pays ont déjà pu procéder à cette ouverture, sans contrevenir à leurs engagements internationaux.
De la même manière, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales, dont l’article 12 relatif au « droit au mariage » précise qu’« à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit », ne fait pas obstacle à l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe.
Ainsi, dans l’affaire Schalk et Kopf c/ Autriche précitée, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé le contexte historique dans lequel la Convention a été adoptée, période au cours de laquelle le mariage était exclusivement compris comme visant l’union d’un homme et d’une femme (§ 55), puis elle a estimé que l’article 12 de la Convention n’interdisait pas le mariage des personnes de même sexe (§ 61) – avant de préciser que rien n’oblige non plus les États parties à légiférer en ce sens.
La Cour s’est aussi fondée sur l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au « Droit de se marier et de fonder une famille » qui précise que « le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».
La mention de l’homme et de la femme ne figure ainsi pas à cet article, les rédacteurs ayant tiré les conséquences de l’ouverture envisagée par certains pays du mariage entre personnes de même sexe. Le renvoi aux « lois nationales » permet ainsi de tenir compte de la diversité des législations sur le mariage.
En conclusion, si aucune jurisprudence, ni aucune norme supérieure ne contraignent le législateur français à ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe – à tout le moins en l’état de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui pourrait évoluer à terme si un plus grand nombre d’États européens ouvrait ce droit – aucune norme internationale, européenne ou constitutionnelle ne s’oppose à ce que le législateur décide de le faire aujourd’hui.
C’est la raison pour laquelle, lors de l’adoption de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe le législateur n’a rencontré aucun véritable juridique.
De toute évidence, cette loi opère un changement majeur dans l’ordonnancement juridique, ne serait-ce que parce qu’elle confère aux familles homoparentales un statut juridique, alors que, auparavant, elles existaient sans que les droits du parent social – dépourvu de lien de filiation avec l’enfant – ne soient reconnus.
b) L’âge des époux
i) Principe : la majorité
Aux termes de l’article 144 du Code civil « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » Il faut donc avoir dix-huit ans révolus pour contracter un mariage.
Jusqu’il y a peu, l’article 144 autorisait les femmes à se marier dès l’âge de quinze ans.
Legs d’une époque où le mariage était souvent arrangé, où l’espérance de vie était proche de cinquante ans et où la règle légale correspondait à la pratique sociale, cette disposition, inscrite faisait figure d’archaïsme.
De surcroît, l’âge de la majorité légale des hommes et des femmes ayant été abaissé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974, comment justifier que le mariage soit désormais réservé aux seuls hommes majeurs à la différence des femmes dont la minorité ne fait pas obstacle à un tel engagement ?
Contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi, cette différence l’était également à nos engagements internationaux.
En effet, la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, entrée en vigueur dans notre droit le 3 septembre 1981, stipule, en son article 16, que les États parties « prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité entre l’homme et la femme, le même droit de contracter mariage ».
Par ailleurs, l’élévation de l’âge au mariage des femmes constitue l’un des moyens de lutter contre les mariages forcés.
En effet, les familles désireuses d’imposer un époux à leur fille peuvent aujourd’hui le faire d’autant plus aisément que celle-ci est mineure, placée sous leur autorité et donc particulièrement vulnérable aux pressions dont elle fait l’objet.
Le phénomène des mariages forcés n’est pas anecdotique, loin s’en faut, puisqu’ils concerneraient en France près de 70 000 femmes.
C’est la raison pour laquelle, dans son rapport de novembre 2004, la Défenseure des enfants, Mme Claire Brisset, parmi d’autres, s’est prononcée pour l’élévation de l’âge légal au mariage des femmes, faisant sienne les recommandations du Comité des droits de l’enfant qui a fait part de sa « préoccupation » au sujet de la différence d’âge légal au mariage entre les hommes et les femmes.
C’est dans ce contexte que, à l’occasion de l’adoption de la loi du n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs le législateur a porté l’âge de se marier pour les filles à quinze ans.
ii) Exception : la dispense d’âge
?) L’admission de la dispense d’âge
Le législateur a estimé que, en certaines circonstances, il y aurait plus d’inconvénients que d’avantages à maintenir cette condition d’âge avec trop de rigidité
Avant la loi du 23 décembre 1970 modifiant l’article 145 du Code civil, le Code civil avait attribué au chef de l’État le pouvoir d’accorder des dispenses d’âge en lui laissant la libre appréciation de leur opportunité.
Il lui appartenait ainsi d’accorder ces dispenses par décret rendu sur le rapport du garde des Sceaux. Ce dossier était alors remis au procureur de la République qui instruisait l’affaire.
La loi n° 70-1266 du 23 décembre 1970 a modifié l’article 145 du Code civil à compter du 1er février 1971 et transféré au procureur de la République du lieu de la célébration du mariage le pouvoir d’accorder les dispenses d’âge dans les mêmes circonstances que pouvait le faire le Président de la République.
L’article 145 du Code civil dispose désormais que, « il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves ».
La dispense accordée par le procureur de la République ne fait toutefois pas disparaître la nécessité du consentement familial exigé pour les mineurs.
L’article 148 du Code civil précise, en effet, que « les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement ».
Ainsi, pour que des mineurs puissent se marier, encore faut-il qu’ils y soient autorisés :
- par leurs parents
- par le procureur de la république
?) L’exigence d’autorisation des parents
==> Principe
L’article 148 du Code civil exige que les deux parents du mineur consentent à son mariage
A défaut, il ressort des articles 182 et 183 du Code civil que l’union conjugale encourt la nullité.
L’article 182 précise qu’il s’agit d’une nullité relative, dans la mesure où le mariage « ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. »
L’exigence de consentement des deux parents n’est toutefois pas absolue.
Le législateur a assorti cette règle d’un certain nombre de tempéraments
==> Tempéraments
Le législateur a prévu que le consentement des deux parents n’était pas exigé dans un certain nombre de situations où l’obtention de ce consentement est, par nature, impossible
Plusieurs situations doivent être distinguées:
- L’existence d’un désaccord entre les parents
- Dans cette hypothèse, l’article 148 du Code civil prévoit que le dissentiment entre le père et la mère emporte consentement
- Le législateur autorise ainsi, finalement, à ce qu’un seul des deux parents autorise le mariage de l’enfant mineur, à la condition qu’ils aient tous les deux été consultés.
- À défaut, nonobstant le consentement du père ou de la mère, le mariage est susceptible d’être contesté
- L’un des parents est décédé ou se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté
- L’article 149 du Code civil que dans ces deux situations, « le consentement de l’autre suffit»
- Cette disposition précise que, il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
- La résidence actuelle de l’un des parents est inconnue
- Dans cette hypothèse, l’article 149, al. 3 dispose que, en cas d’absence de nouvelles du parent dont la résidence est inconnue pendant un an, il pourra, malgré tout, être procédé à la célébration du mariage
- Cette célébration est néanmoins subordonnée à la déclaration sous serment de l’enfant et du parent qui a donné son consentement
- Le faux serment est puni des peines édictées par l’article 434-13 du code pénal, soit de de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
- Les deux des parents sont décédés ou se trouvent dans l’impossibilité de manifester leur volonté
- L’article 150 du Code civil prévoit que, dans cette situation, les aïeuls et aïeules les remplacent.
- Par aïeuls, il faut entendre les ascendants en ligne directe.
- Les aïeuls de chaque ligne doivent consentir au mariage du mineur, ce qui suppose qu’ils soient tous consultés.
- En cas dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
- La résidence actuelle des deux parents est inconnue
- En pareil cas, l’article 150, al. 2 dispose que s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage
- Cette célébration sera là aussi subordonnée à la déclaration sous serment de l’enfant mineur et de ses aïeuls et aïeules.
- L’article 150 précise qu’il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.
- Tous les ascendants du mineur sont décédés ou sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté
- L’article 159 du Code civil prévoit que les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.
- Le pouvoir de consentir n’appartient donc pas tuteur de l’enfant, mais bien au conseil de famille.
- Le mineur a fait l’objet d’une adoption
- Il convient de distinguer selon que le mineur a fait l’objet d’une adoption simple ou d’une adoption plénière
- Le mineur a fait l’objet d’une adoption plénière
- Pour rappel, cette forme d’adoption, qui est réservée à des enfants âgés de moins de quinze ans, fait entrer l’adopté dans la famille adoptive comme s’il y était né, l’assimilant totalement et irrévocablement à un enfant légitime.
- Elle entraîne une rupture totale de la filiation de l’enfant adopté qui, sur le plan juridique, n’entretient plus aucun lien avec ses parents biologiques.
- À cet égard, l’article 358 dispose que « l’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.»
- Il en résulte que le mineur qui a fait l’objet d’une adoption plénière est soumis au même régime que les enfants qui jouissent d’une filiation par le sang
- Le mineur a fait l’objet d’une adoption simple
- L’adoption simple s’adresse à des adoptés mineurs ou majeurs qui demeurent dans leur famille d’origine et y conservent tous leurs droits.
- Doté d’une double filiation, l’une charnelle et l’autre purement juridique, l’adopté simple est traité comme l’enfant légitime de l’adoptant.
- Toutefois le lien adoptif n’établit qu’une filiation additive et révocable.
- S’agissant de l’autorisation au mariage du mineur, l’article 365 prévoit que « l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté»
- Ce sont donc les parents adoptants qui sont titulaires du pouvoir d’autoriser le mineur adopté à contracter mariage.
- Ils doivent donc être consultés tous les deux.
- En cas de dissentiment, leur désaccord emporte consentement.
- L’article 365 assortit la règle ainsi posée d’une exception : l’hypothèse où le mineur est adopté par le conjoint du père ou de la mère.
- En pareil cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.
- L’autorité parentale qui s’exerce sur le mineur a fait l’objet d’une délégation
- Cette délégation de l’autorité parentale se rencontre dans deux situations bien distinctes envisagées à l’article 377 du Code civil.
- Première situation
- Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
- Seconde situation
- En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
- S’agissant de la personne investie du pouvoir d’autoriser le mariage du mineur, cela dépend de l’inclusion de cette prérogative dans le champ de la délégation qui peut être totale ou partielle.
- La délégation de l’autorité parentale peut être totale ou partielle.
==> Modalités d’expression du consentement
L’article 73 du Code civil prévoit que l’acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls ou aïeules ou, à leur défaut, celui du conseil de famille doit contenir s’agissant des futurs époux
- leurs prénoms
- leurs noms
- leurs professions
- leur domicile des futurs
L’acte doit également porter mention de ces informations, s’agissant de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.
L’article 73 précise que hors le cas prévu par l’article 159 du code civil (l’absence d’aïeuls), cet acte de consentement est dressé :
- soit par un notaire
- soit par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’ascendant, et, à l’étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.
Lorsque l’acte est dressé par un officier de l’état civil, il ne doit être légalisé, sauf conventions internationales contraires, que lorsqu’il y a lieu de le produire devant les autorités étrangères.
c) La santé des époux (abandonnée)
Dans sa rédaction antérieure, l’article 63, al. 2 du Code civil prévoyait que « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 170, l’officier de l’état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu’après [notamment]la remise, par chacun des futurs époux, d’un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage »
Née selon Jean Hauser « dans le soupçon de l’eugénisme et du racisme », l’obligation faite aux futurs époux de se soumettre à un examen médical préalable a été instituée par les lois des 16 décembre 1942 et 29 juillet 1943, dont les principes ont été repris par l’ordonnance n° 45-2770 du 2 novembre 1945 sur la protection maternelle et infantile.
Sa portée reste toutefois limitée puisqu’il ne s’agit que d’éclairer chacun d’eux, de façon séparée, sur son propre état de santé et les contre-indications au mariage qu’il pourrait comporter en lui laissant la responsabilité d’en informer l’autre et de maintenir ou abandonner son projet de mariage.
Des conceptions plus radicales, tendant à rendre obligatoire l’information du futur conjoint ou à ériger la contre-indication en empêchement n’ont pas été retenues.
L’évolution des mœurs rendait toutefois cette exigence désuète : aujourd’hui près d’un enfant sur deux naît hors mariage et rares sont les mariages qui n’ont pas été précédés d’une période de cohabitation.
Lorsqu’il a institué le pacte civil de solidarité en 1999, le législateur ne l’a d’ailleurs pas reprise pour les futurs partenaires.
Aussi, lors de l’adoption de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit le législateur a décidé d’abandonner l’exigence d’établissement d’un certificat prénuptial.
2. Les conditions tenant à la capacité des époux
Aux termes de l’article 144 du Code civil « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ».
Il faut donc être majeur pour pouvoir se marier. À défaut, il convient, pour les mineurs, d’obtenir une autorisation de leurs parents et du procureur de la république.
Quant aux majeurs incapables, il convient de distinguer selon le régime de protection dont ils font l’objet
==> Les majeurs sous sauvegarde de justice
Aucun article ne leur interdit de se marier, ni ne subordonne l’accomplissement de cet acte à l’obtention d’une autorisation.
On peut en déduire que le majeur sous sauvegarde de justice est parfaitement libre de contracter mariage
==> Les majeurs sous curatelle
L’article 460, al. 1er dispose que « le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. »
Ainsi, les majeurs placés sous curatelle dispose de la liberté de se marier. L’exercice de cette liberté est toutefois subordonné à l’obtention de l’autorisation du curateur ou du juge des tutelles.
Si le curateur refuse de donner son consentement au mariage du curatélaire, l’un ou l’autre garde la possibilité de saisir le juge aux fins de l’autoriser ou de l’interdire.
==> Les majeurs sous tutelle
L’article 460, al. 2e dispose que « le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage. »
Ainsi, le mariage du majeur sous tutelle doit être autorisé par le conseil de famille s’il a été constitué ou par le juge dans le cas contraire.
Dans les deux cas, l’audition des futurs époux reste obligatoire.
En revanche, le conseil de famille ou le juge n’est plus tenu de recueillir l’avis du médecin traitant comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Seul l’avis des proches du majeur protégé est recueilli.
3. Les conditions tenant au consentement des époux
En vertu de l’article 146 du Code civil « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Autrefois, c’était la seule condition qui était exigée pour se marier. Le simple échange des consentements suffisait à former les liens du mariage.
Aujourd’hui, bien que d’autres exigences aient été imposées aux époux par le législateur, le consentement a conservé une place centrale dans le processus de formation du mariage.
Son appréhension n’en est pas moins toujours source de difficultés.
==>La difficile appréhension de la notion de consentement
Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.
Que l’on doit exactement entendre par consentement ?
Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, l’article 180 du Code civil se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du mariage.
L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :
- L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental
- Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale
- Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée
- Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant
- Un contractant peut également s’être engagé par erreur
Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes.
La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?
Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ?
==> Existence du consentement et vice du consentement
Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :
- Le consentement doit exister
- À défaut, le mariage n’a pas pu valablement se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé son consentement
- Or cela constitue un obstacle à la rencontre des volontés.
- Le consentement ne doit pas être vicié
- À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.
- Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :
- soit qu’il n’a pas été donné librement
- soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause
- En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.
En résumé, pour ce qui est de la condition du consentement, deux choses doivent être vérifiées :
- Le consentement doit exister (il doit avoir été manifesté)
- Le consentement doit être intègre (lors de sa manifestation il ne doit pas avoir été vicié)
Dans un ancien arrêt rendu en date du 9 novembre 1887, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 146 portant qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement comprend tout à la fois le cas où le consentement est le résultat d’une volonté oblitérée par la démence et ceux où il n’est donné qu’à la suite de violences physiques ou morales exercées sur les époux ou l’un d’eux, ou d’une erreur sur la personne avec laquelle l’un des époux a déclaré vouloir s’unir, que dans aucune de ces circonstances, le consentement ne peut être réputé l’expression d’une volonté certaine et libre, capable d’engendrer un engagement formant un lien légal entre les parties. » (Cass. civ. 9 nov. 1887)
a) L’existence du consentement
L’existence du consentement est susceptible de fait défaut dans deux situations distinctes :
- Soit l’un des membres du couple est frappé d’insanité d’esprit
- Soit l’un des époux ou les deux n’ont pas d’intention matrimoniale
a.1) L’insanité d’esprit
==> Insanité d’esprit et incapacité juridique
L’insanité d’esprit doit impérativement être distinguée de l’incapacité juridique
- L’incapacité dont est frappée une personne a pour cause :
- Soit la loi
- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice général dont sont frappés les mineurs non émancipés.
- Soit une décision du juge
- Tel est le cas s’agissant de l’incapacité d’exercice dont sont frappées les personnes majeures qui font l’objet d’une tutelle, d’une curatelle, d’une sauvegarde de justice ou encore d’un mandat de protection future
- L’insanité d’esprit n’a pour cause la loi ou la décision d’un juge : son fait générateur réside dans le trouble mental dont est atteinte une personne.
Aussi, il peut être observé que toutes les personnes frappées d’insanité d’esprit ne sont pas nécessairement privées de leur capacité juridique.
Réciproquement, toutes les personnes incapables (majeures ou mineures) ne sont pas nécessairement frappées d’insanité d’esprit.
À la vérité, la règle qui exige d’être sain d’esprit pour contracter a été instaurée aux fins de protéger les personnes qui seraient frappées d’insanité d’esprit, mais qui jouiraient toujours de la capacité juridique de contracter.
En effet, les personnes placées sous curatelle ou sous mandat de protection future sont seulement frappées d’une incapacité d’exercice spécial, soit pour l’accomplissement de certains actes (les plus graves).
L’article 146 du Code civil jouit donc d’une autonomie totale par rapport aux dispositions qui régissent les incapacités juridiques.
Il en résulte qu’une action en nullité fondée sur l’insanité d’esprit pourrait indifféremment être engagée à l’encontre d’une personne capable ou incapable.
==> Notion d’insanité d’esprit
Le Code civil ne définit pas l’insanité d’esprit
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue cette tâche
Dans un arrêt du 4 février 1941, la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’insanité d’esprit doit être regardée comme comprenant « toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée» ( civ. 4 févr. 1941).
Ainsi, l’insanité d’esprit s’apparente au trouble mental dont souffre une personne qui a pour effet de la priver de sa faculté de discernement.
Il peut être observé que la Cour de cassation n’exerce aucun contrôle sur la notion d’insanité d’esprit, de sorte que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond (V. notamment en ce sens 1re civ., 24 oct. 2000).
==> Sanction de l’insanité d’esprit
En ce que l’insanité d’esprit prive le contractant de son consentement, elle est sanctionnée par la nullité du mariage (V. en ce sens civ., 28 mai 1980).
La preuve de l’insanité d’esprit pèse sur celui qui s’en prévaut.
Dans un arrêt du 2 décembre 1992, la Cour de cassation a considéré que « d’après l’article 489 du Code civil, c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte» ( civ. 1ère 2 déc. 1992).
L’insanité d’esprit n’étant pas une notion de droit, son appréciation est laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
Dans un arrêt du 4 mai 2011, la première chambre civile a énoncé que « les juges du fond, appréciant souverainement la valeur des témoignages produits et des expertises médicales versées aux débats, ont, sans inverser la charge de la preuve, estimé que Xavier X. était affecté, à l’époque du mariage, de lourdes déficiences mentales qui lui interdisaient d’apprécier la portée de son engagement le jour de la célébration de l’union» ( 1ère civ. 4 mai 2011).
a.2) Le défaut d’intention matrimoniale ou le mariage simulé
Dans les sociétés contemporaines, le mariage est vécu et ressenti comme la relation de deux personnes ayant pour principal but la création d’une communauté de vie durable ; il offre à deux personnes la possibilité d’affirmer au grand jour leur relation et les sentiments éprouvés l’un pour l’autre.
Il consiste dans un triple engagement : un engagement à la vie commune, à la fidélité et à l’assistance morale et matérielle.
À cet égard, très tôt, la question s’est posée de savoir si le mariage ne devait pas être annulé dans l’hypothèse où les époux poursuivraient un but qui ne serait pas conforme à la finalité de l’union conjugale.
En somme, faut-il être animé par la volonté de fonder une famille, soit de procéder à l’union des personnes et des biens pour bénéficier des effets – protecteurs, sinon dérogatoires au droit commun – du mariage ?
Lorsque, autrement dit, les époux n’avaient pas, lors de la célébration de leur union, l’intention d’adhérer au statut matrimonial pris dans son essence, cette simulation est celle constitutive d’une cause de nullité ?
La réponse à cette question suppose de s’interroger, au préalable, sur la nature même du mariage : est-ce un contrat ou une institution ?
i) Le mariage : contrat ou institution ?
?) L’évolution de la conception du mariage
Dans son ouvrage Le chevalier, la femme et le prêtre, l’historien Georges Duby écrit : « c’est par l’institution matrimoniale, par les règles qui président aux alliances, par la manière dont sont appliquées ces règles, que les sociétés humaines, celles mêmes qui se veulent les plus libres ou qui se donnent l’illusion de l’être, gouvernent leur avenir, tentent de se perpétuer dans le maintien de leurs structures, en fonction d’un système symbolique, de l’image que ces sociétés se font de leur propre perfection ».
Pour la sociologue Irène Théry, l’historien ne se réfère pas à une sorte d’essence intemporelle du mariage ; bien au contraire, son travail a montré que cette institution a connu des métamorphoses, presque des révolutions, au cours de l’histoire.
Le mariage est une institution vivante, qui a la charge d’incarner un idéal social à une époque donnée.
Produit de l’histoire de notre société, le mariage a ainsi beaucoup évolué au cours des siècles passés.
Ainsi que le rappelle Jean-Claude Bologne dans son ouvrage Histoire du mariage en Occident, « en deux mille ans d’histoire, l’institution du mariage aura accompagné toutes les mutations de la civilisation occidentale », l’auteur ajoutant que « le mariage a été et demeure un miroir fidèle de la société ».
Le XXe siècle aura été marqué par le combat des féministes pour obtenir l’égalité des droits des femmes et des hommes ; un autre combat reste aujourd’hui à mener, celui de la reconnaissance de la pleine égalité des droits de tous les couples, qu’ils soient composés de personnes de sexes différents ou de même sexe.
==> L’ancien Régime
Si le pouvoir civil sous l’Ancien Régime n’avait pas totalement abandonné à l’Église la question du mariage et de la tenue de l’état civil, c’est au cours de la deuxième moitié du XVIIIe siècle que progresse la réflexion sur une distinction entre les aspects civils et religieux du mariage. Ce n’est qu’en 1791 qu’est institué le mariage civil et laïc par la Constitution du 3 septembre ; la loi du 20 septembre 1792 parachève l’évolution en prévoyant que les mariages sont contractés devant l’officier municipal, chargé désormais de tenir l’état civil. C’est cette même loi qui rend le mariage révocable par le divorce : si les deux époux le souhaitent, le mariage peut être dissout sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère.
==> La Révolution
À la conception religieuse du mariage-institution, la période révolutionnaire oppose une conception de mariage-contrat, dans le prolongement de la pensée du XVIIIe siècle sur la liberté et les restrictions jugées inacceptables que l’institution religieuse lui porte.
==> Le Code napoléonien
Le code civil de 1804 reprend pour l’essentiel la conception révolutionnaire du mariage, tout en renforçant le pouvoir de contrôle exercé par l’État et les familles : placée sous la puissance du mari, l’épouse est incapable de disposer des biens de la communauté.
Le divorce est maintenu, mais bien plus encadré que sous la période révolutionnaire, afin d’en réduire le nombre. On conçoit en effet le mariage comme dépassant le seul consentement des époux, du fait de son objectif de constitution d’une famille ; Portalis soutient d’ailleurs à l’époque que le mariage intéresse la société avant de concerner le couple et qu’il ne saurait être laissé aux « passions » des individus.
Depuis le code Napoléon, le mariage civil – qui précède obligatoirement le mariage religieux, rétabli par le Concordat de 1801 – n’a varié que sur des détails, le plus souvent pour en simplifier la procédure.
==> La Restauration
La Restauration ne remit pas son existence en cause, même si elle supprima le divorce en 1816. Celui-ci sera rétabli en 1884, à l’initiative du député radical Alfred Naquet, permettant un retour partiel aux acquis révolutionnaires.
==> L’ère moderne
Le XXe siècle s’est ouvert sur des incertitudes : dans l’atmosphère qui domine le pays après la défaite de 1870, la peur de voir la France se dépeupler attise la méfiance à l’égard du mariage–contrat au profit de la conception du mariage–institution.
Ce siècle a ensuite été marqué par les combats des mouvements féministes en faveur de l’union libre puis de la reconnaissance de l’égalité des droits.
Les progrès liés à la contraception et l’émancipation des femmes ont bouleversé le modèle familial et notre conception du mariage.
La pleine égalité des conjoints n’existe dans les textes que depuis la loi du 4 juin 1970 : depuis lors, l’article 213 du code civil dispose que « les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille ».
La loi du 11 juillet 1975 modernise le droit du divorce, reconnaissant trois cas : le divorce par consentement mutuel, le divorce par rupture de vie commune et le divorce pour « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ».
Des conceptions très différentes ont tour à tour dominé l’histoire du mariage, au gré des tensions entre les familles – désireuses de contrôler les alliances de leurs enfants –, l’Église et le pouvoir civil.
Les buts premiers du mariage ont ainsi beaucoup varié selon les époques : préservation des biens ; procréation et éducation des enfants au sein d’un noyau familial stable ; alliances politiques ; promotion d’un statut social ; amour, plus récemment…
Aujourd’hui, le mariage n’apporte plus réellement un statut social, davantage conféré par l’emploi qu’on occupe ; le développement de l’union libre et les possibilités de reconnaître en droit les enfants nés hors mariage rendent plus ténu le lien entre mariage et procréation (cf. infra). S’il conserve sa valeur symbolique, le mariage ne peut plus être considéré comme un modèle unique.
?) La définition du mariage
Le code civil ne contient aucune définition du mariage. Les rédacteurs du code civil de 1804 n’avaient pas éprouvé le besoin de définir le mariage, tant la définition allait alors de soi.
Tout au plus, on en trouve une définition dans le Discours préliminaire au projet de code civil prononcé le 1er pluviôse An IX (21 janvier 1801).
Portalis y définissait le mariage comme « la société de l’homme et de la femme qui s’unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie et pour partager leur commune destinée ».
Bien que le Code civil soit silencieux sur le concept de mariage, il n’en définit pas moins les éléments essentiels de son existence et de sa validité, exigeant deux contractants de sexe différent ou de même sexe, d’âge nubile, respectant l’interdit de l’inceste et de la bigamie, consentant librement à une communauté de vie au cours d’une cérémonie publique.
La nature du mariage serait donc double.
- Il est un contrat
- On dit que les époux « contractent » mariage
- Le mariage se forme par l’échange des consentements
- Or c’est là l’essence même du contrat lequel repose sur un accord de volontés
- Ajouté à cela, les époux sont désormais libres de défaire l’union qu’ils ont constituée au moyen du divorce par consentement mutuel, de sorte qu’ils ne sont plus enfermés dans les liens du mariage
- Le mariage est une institution
- Bien que le mariage se forme par l’échange des consentements, il n’est pas soumis à la libre négociation contractuelle, à tout le moins à la marge.
- En se mariant, les époux sont soumis à ce que l’on appelle le régime primaire impératif qui se compose d’un ensemble de règles auxquelles les époux ne peuvent déroger par convention contraire.
- Autre marque de la dimension institutionnelle du mariage, la société est témoin de l’union, célébrée publiquement dans la maison commune après publication de bans
- En outre, bien que les époux puissent, pour rompre leur union, emprunter la voie du divorce par consentement mutuel, à l’exception du divorce par acte d’avocat, le mariage ne peut être dissous que par un juge.
- Le mariage emporte, en outre, modification de l’état civil des époux.
Ainsi, le mariage comporte une dimension : contractuelle et institutionnelle.
Toutefois, pour certains auteurs, en ce que le mariage se fonde, aujourd’hui, essentiellement sur l’amour que se portent deux êtres, amour auquel il apporte une forme de reconnaissance sociale, cette évolution fragilise la dimension contractuelle du mariage.
D’aucuns estiment que le mariage serait passé du statut de contrat–institution organisant la filiation au sein du couple à celui d’union de deux individus amoureux.
Ce constat étant fait, revenons à notre question initiale : l’absence d’intention matrimoniale est-elle une cause de nullité du mariage ?
- Si l’on considère que le mariage est un contrat
- Dans cette hypothèse, le mariage simulé doit être admis car, en matière contractuelle, seule l’intention conventionnelle compte.
- Dans un contrat, sauf contrariété à l’ordre public, le but poursuivi par les parties est indifférent
- Si l’on considère que le mariage est une institution
- Dans cette hypothèse, le mariage simulé doit être sanctionné par la nullité, car l’intention légale doit être respectée.
- En plus de s’épouser l’un l’autre, les époux doivent adhérer à la finalité de l’institution qu’est le mariage
Ainsi, est-ce, en quelque sorte, en ces termes, que la question de l’exigence d’intention matrimoniale s’est posée à la jurisprudence.
ii) L’appréhension du mariage simulé
?) Le cadre jurisprudentiel
Sur la question de savoir si les époux devaient être animés d’une intention matrimoniale pour contracter mariage, la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt Appietto du 20 novembre 1963.
Appietto
(Cass. 1ère Civ. 20 nov. 1963) |
Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond qu'Appietto a demandé la nullité du mariage qu'il a contracté à Ajaccio avec demoiselle Liliane Feibelman, exposant qu'il n'avait consenti à cette union que dans le but de conférer la légitimité à l'enfant dont il était le père, mais qu'il n'avait aucune intention de fonder un foyer et qu'il fut convenu entre les futurs époux que le divorce serait demandé dès la célébration du mariage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (CA Bastia, 9 avr. 1962) d'avoir débouté l'appelant de sa demande, au motif que le mariage n'était ni entaché du vice d'erreur ni du vice de violence, alors que les époux n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille ;
Mais attendu que si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime ;
Attendu que tant par ses motifs propres que par ceux des premiers juges qu'il adopte, l'arrêt relève exactement que "le désir et le souci d'assurer à un enfant une naissance légitime au sein d'un foyer légalement fondé constitue l'une des raisons majeures (...) de l'institution du mariage" et que le mariage est "une institution d'ordre public à laquelle les parties contractantes ne peuvent apporter les modifications que leur intérêt ou les circonstances exigeraient" ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui est motivé, n'a pas violé les textes visés au moyen et que le grief doit être écarté ;
Par ces motifs, rejette...
|
- Faits
- Mariage contracté par un couple en vue de conférer à leur enfant le statut d’enfant légitime
- Le couple avait néanmoins convenu, avant le mariage, qu’ils divorceraient peu de temps après la célébration n’ayant pas l’intention de fonder un foyer ensemble
- Procédure
- Par un arrêt confirmatif du 9 avril 1962, la Cour d’appel de Bastia rejette l’action en nullité du requérant
- Les juges du fond estiment que le mariage n’a nullement été simulé en l’espèce, dès lors que l’attribution de la légitimité à l’enfant issue du couple, constitue l’un des principaux effets du mariage
- Le mariage était donc pleinement valide
- Solution
- Par un arrêt du 20 novembre 1963, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’époux
- Au soutien de sa décision, elle affirme que « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux et notamment leur consentement que dans le but de conférer à l’enfant commun la situation d’enfant légitime»
- Bien que, en l’espèce, la Cour de cassation valide le mariage contracté entre les époux, elle juge que lorsque les époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale, le mariage encourt la nullité
- Pour apprécier l’intention matrimoniale des époux, la Première chambre civile pose le critère de l’existence d’une volonté « d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale».
- Consécutivement à cet arrêt, la question s’est immédiatement posée de savoir pourquoi le mariage n’avait pas été annulé en l’espèce dans la mesure où les époux se sont mariés avec pour seul but de légitimer leur enfant naturel.
À l’examen, il ressort de la décision que deux éléments permettent de déterminer ce que l’on doit entendre par « résultat étranger à l’union matrimoniale »
En effet, la Cour de cassation opère une distinction entre les effets primaires et les effets secondaires du mariage :
- Les effets primaires
- Ils ne peuvent être obtenus que par le mariage
- Filiation
- Communauté de biens
- Les effets secondaires
- Ils peuvent être obtenus par d’autres biais que le mariage
- Acquisition de la nationalité
- Avantages fiscaux
- Avantages patrimoniaux
Au total, pour déterminer si un mariage est fictif, il convient de se demander si les époux recherchaient exclusivement ses effets secondaires – auquel cas la nullité est encourue – ou s’ils recherchaient et/ou ses effets primaires, en conséquence de quoi l’union est alors parfaitement valide.
Cette appréciation du défaut d’intention matrimoniale a parfaitement été exprimée par la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 11 juin 1974 a précisé que « un mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’un effet secondaire du mariage, étranger aux buts de l’institution, avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales » (CA Paris, 11 juin 1974)
Dans le droit fil de cette décision, la Cour de cassation a récemment jugé que « ayant ainsi fait ressortir que celle-ci n’avait pas eu l’intention de se soumettre à toutes les obligations nées de l’union conjugale, c’est à bon droit que la cour d’appel, après avoir retenu que Mme X… s’était mariée dans le but exclusif d’appréhender le patrimoine de Philippe Y…, en a déduit, sans méconnaître les exigences conventionnelles de la liberté du mariage, qu’il y avait lieu d’annuler celui-ci, faute de consentement » (Cass. 1ère civ. 19 déc. 2012)
Le critère pour apprécier le défaut d’intention matrimoniale réside ainsi dans la volonté de rechercher les seuls effets secondaires du mariage.
?) Le cadre légal
Lorsque des époux sont dépourvus de toute intention matrimoniale lors de la célébration de leur union, on dit que le mariage ainsi célébré est blanc ou gris.
- Le mariage blanc
- Appelé également mariage de complaisance, il s’agit de l’union frauduleusement contractée sans intention matrimoniale.
- Les futurs époux cachent le réel motif de leur union.
- Dans la grande majorité des cas, l’obtention d’un titre de séjour prolongé en France motive cet acte qui dénature le mariage.
- Le mariage gris
- Cette situation se rencontre lorsque le conjoint de nationalité étrangère dissimule ses vrais sentiments et trompe ainsi son conjoint en lui faisant croire à un réel amour.
- Cette escroquerie sentimentale conduit à un abus de l’autre, du citoyen français, de plus, une fois son but atteint, le trompeur demande en général le divorce.
Dans les cas de mariage blanc ou gris l’objectif de l’immigré illégal est d’éviter une reconduite à la frontière, devenir français malgré son entrée illégale ou obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » de par son statut de conjoint.
Afin de lutter plus efficacement contre ces pratiques, les lois de 1993 et 2003 ont institué préalablement au mariage l’audition des futurs époux ainsi que la saisine par l’officier de l’état civil du procureur de la République en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales ainsi que son pouvoir d’opposition.
Un délit spécifique a été créé, à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Cette disposition prévoit que : « Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont également encourues lorsque l’étranger qui a contracté mariage a dissimulé ses intentions à son conjoint.
Ces mêmes peines sont applicables en cas d’organisation ou de tentative d’organisation d’un mariage ou d’une reconnaissance d’enfant aux mêmes fins.
Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. ».
L’article L. 623-2 du CESEDA prévoit un certain nombre de peines complémentaires :
« 1° L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus ;
2° L’interdiction du territoire français, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif ;
3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sous les réserves mentionnées à l’article 131-27 du code pénal.
Les personnes physiques condamnées au titre de l’infraction visée au troisième alinéa de l’article L. 623-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Afin de lutter efficacement contre les mariages blancs et gris, la loi n° 2003-119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a renforcé les moyens de contrôler l’existence d’une intention matrimoniale.
==> Le mariage célébré en France
A été introduite l’obligation, pour les officiers de l’état civil, de s’entretenir avec les futurs époux, afin de vérifier leur intention matrimoniale. Cette obligation d’audition conditionne la publication des bans.
L’article 63 du Code civil prévoit en ce sens que « la publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée [notamment] à l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. »
Cette obligation est également mise à la charge des agents diplomatiques ou consulaires pour les mariages célébrés à l’étranger.
En toute hypothèse, la personne en charge d’assurer la célébration apprécie lui-même m’opportunité d’auditionner les futurs époux.
L’article 63, 2°, al. 2 précise que « l’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux. »
La loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration et modifiant le code civil a mis en place une procédure d’opposition à la célébration du mariage en cas d’indices sérieux laissant présumer l’absence de réelle intention matrimoniale.
Cette procédure a été renforcée par la loi du 26 novembre 2003 précitée, en permettant notamment au procureur de la République de surseoir à la célébration pour un mois renouvelable une fois.
==> Le mariage célébré à l’étranger
- Évolution du cadre légal
- La loi n° 93-1027 du 24 août 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France a instauré un mécanisme de contrôle a posteriori de la validité des mariages conclus à l’étranger lorsqu’un conjoint est Français.
- Ce contrôle s’exerce au moment de la demande de transcription du mariage sur les registres de l’état civil français.
- Il passe par l’obligation pour l’agent diplomatique ou consulaire de surseoir à la transcription en cas d’indices sérieux de mariage frauduleux, et d’informer le ministère public qui doit se prononcer dans un délai de six mois.
- En outre, la loi du 26 novembre 2003 a prévu l’obligation d’auditionner les époux préalablement à la transcription.
- Le décret n° 2005-170 du 23 février 2005 a concentré les contentieux relatifs aux mariages à l’étranger sur le seul tribunal de grande instance de Nantes.
- Cette centralisation, effective depuis le 1er mars 2005, est le gage d’une jurisprudence unifiée émanant d’une juridiction spécialisée dans le domaine de l’état civil étranger.
- En mai 2005, le ministère de la justice a précisé les modalités d’application de la réforme de 2003 par voie de circulaire adressée aux parquets des tribunaux.
- Un an plus tard, la loi du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage a précisé la chronologie des formalités administratives précédant la célébration, les vérifications d’identité des futurs époux et les modalités de l’audition séparée en cas de doute sur la sincérité des intentions matrimoniales, en donnant la possibilité pour le maire ou le consul, de déléguer l’audition à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil quand l’un des futurs époux réside à l’étranger.
- La loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a renforcé les formalités administratives relatives aux mariages célébrés à l’étranger entre un Français et un étranger.
- Principe de validité du mariage célébré à l’étranger
- L’article 171-1 du Code civil prévoit que le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
- Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
- Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.
- Formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
- Le certificat de capacité à mariage
- L’article 171-2 du Code civil prévoit que lorsqu’il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63, soit de la régularisation des bans
- La publication des bans est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence.
- L’audition des époux
- À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.
- L’opposition à mariage
- Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
- Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.
- La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
- Transcription du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère
- L’opposabilité du mariage
- L’article 171-5 du Code civil prévoit que pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français.
- En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants.
- La demande de transcription
- Elle est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
a.3) Le mariage posthume
==> Principe
Aux termes de l’article 171 du Code civil « le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement»
Ainsi, la procédure du mariage posthume prévue à l’article 171 du code civil permet au Président de la République, lorsque des motifs graves le justifient, d’autoriser la célébration d’un mariage en dépit du décès de l’un des deux époux, à la condition que le consentement du défunt soit établi sans équivoque par l’accomplissement de formalités officielles relatives à ce mariage.
Historiquement cette procédure a notamment permis de garantir la filiation légitime d’enfants conçus avant le mariage des époux ou d’assurer la protection nécessaire au conjoint du défunt.
En tout état de cause, il appartient au chef de l’État d’apprécier souverainement si les éléments présentés sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux décédé ( 1ère civ. Civ. 17 octobre 2007)
Quant au juge, il doit vérifier, en cas de contentieux tendant à l’annulation du mariage posthume, si ce consentement a bien persisté jusqu’au décès ( 1ère civ. 28 février 2006).
Lors de l’adoption de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit les conditions relatives aux éléments susceptibles d’établir la réalité du consentement ont été assouplies
Ce texte a, en effet, remplacé la condition tenant à l’accomplissement préalable de formalités officielles, jugée trop restrictive car limitée à trop peu d’actes, par une condition liée à la seule réunion de faits suffisants pour établir le consentement du défunt au mariage.
Toutefois l’exigence du caractère non équivoque et certain du consentement est donc bien maintenue, sous le contrôle du chef de l’État et du juge.
==> Effets
les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux.
Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.
b) L’intégrité du consentement
Il ne suffit donc pas que les futurs époux soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.
Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :
- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte
- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause
Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté la condition centrale du mariage, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.
Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.
Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation de leur union.
C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.
En droit commun du contrat, il résulte de l’article 1130, al. 1er du Code civil que les vices du consentement qui constituent des causes de nullité du contrat sont au nombre de trois :
- L’erreur
- Le dol
- La violence
En matière de mariage, le nombre des vices du consentement est réduit à deux.
L’article 180 du Code civil prévoit seulement que :
« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Il ressort de cette disposition que seules l’erreur et la violence sont des causes de nullité du mariage.
Le dol n’est pas visé par cette disposition, ce qui inévitablement conduit à l’exclure des vices du consentement susceptible d’anéantir le mariage.
b.1) L’exclusion du dol
i) En droit commun
Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.
Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité.
Lorsqu’il constitue un vice du consentement, le dol doit être distingué de plusieurs autres notions :
- Dol et erreur
- Contrairement au vice du consentement que constitue l’erreur qui est nécessairement spontanée, le dol suppose l’établissement d’une erreur provoquée par le cocontractant.
- En matière de dol, le fait générateur de l’erreur ne réside donc pas dans la personne de l’errans, elle est, au contraire, le fait de son cocontractant.
- En somme, tandis que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé sur le contrat, dans l’hypothèse du dol ce dernier a été trompé.
- Dol au stade de la formation du contrat et dol au stade de l’exécution
- Au stade de la formation du contrat, le dol consiste en une tromperie qui vise à conduire l’autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction
- Au stade de l’exécution du contrat, le dol s’apparente à un manquement délibéré d’une partie à une ou plusieurs obligations qui lui échoient
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 une disposition unique était consacrée au dol : l’article 1116 du Code civil.
Cette disposition prévoyait à son alinéa 1er que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». L’alinéa 2 précisait qu’« il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Dorénavant, trois articles sont consacrés par le Code civil au dol : les articles 1137 à 1139. Le législateur s’est, toutefois, contenté d’entériner les solutions classiquement adoptées par la jurisprudence.
Aux termes de l’article 1137, alinéa 1er du Code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Bien que, en droit commun des contrats, en ce qu’il constitue un vice du consentement, le dol est une cause de nullité, telle n’est pas la solution retenue en matière matrimoniale.
ii) En droit matrimonial
Aucune des règles qui encadrent le consentement en matière matrimoniale ne vise le dol comme cause de nullité du mariage.
Il en résulte qu’il ne saurait fonder l’anéantissement de l’union conjugale, nonobstant l’exercice par l’un des époux de manœuvres dolosives.
La raison en est que, pas de nullité sans texte !
Au vrai, comme remarqué par les auteurs, « ce silence est intentionnel »[1]. Il a pris racine dans le célèbre adage énoncé par le jurisconsulte Antoine Loysel qui, au XIXe siècle, écrivait dans les Institutes Coutumières « en mariage trompe qui peut ».
L’exclusion du dol des causes de nullité du mariage se justifie par la nature de la relation entretenue entre les futurs époux qui, par essence, relève de la séduction.
Admettre le dol reviendrait à prendre le risque que le mariage puisse être annulé trop facilement, notamment au prétexte que l’un des époux aurait été séduit par le discours fallacieux de son conjoint.
Comme exprimé dans une vieille décision du Tribunal de grande instance du Mans rendue en date du 18 mars 1965 « le mariage est un acte solennel dont la stabilité est essentielle à la société ; qu’il faut fermer autant que faire se peut la porte au repentir tardif des époux ».
On relèvera néanmoins que, dans de nombreuses décisions, la jurisprudence admet le dol en ce qu’il a provoqué une erreur déterminante du consentement d’un époux.
Dans un arrêt rendu en date du 27 janvier 1998 la Cour de cassation a ainsi validé l’annulation d’un mariage après avoir relevé que « le pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond qui, de l’ensemble des éléments de preuve soumis à leur appréciation, ont souverainement retenu que M. X… n’a jamais eu l’intention sincère de fonder un foyer avec Mme Y… qu’il avait trompée sur ses intentions véritables et dont il avait surpris le consentement » (Cass. 1ère civ. 27 janv. 1998).
Cette décision est somme toute contestable, en ce qu’elle se situe à la lisière entre le dol et l’erreur. Au fond, qu’est-ce que le dol, sinon une erreur provoquée ?
En toute hypothèse, dans bien des cas l’erreur déterminante d’un époux sur les qualités essentielles de son conjoint résultera de manœuvres dolosives
b.2) L’erreur
i) En droit commun
L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.
L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.
Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.
Il peut donc exister de multiples erreurs :
- L’erreur sur la valeur des prestations: j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.
- L’erreur sur la personne: je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous
- Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux
Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.
Cela justifie-t-il, pour autant, qu’elles entraînent la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.
Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804, qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.
Pour constituer une cause de nullité l’erreur doit, en toutes hypothèses, être, déterminante et excusable.
En outre, aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
C’est là que s’opère la distinction entre le droit commun et le droit matrimonial.
À l’évidence, en matière de mariage, seule l’erreur sur les qualités essentielles de l’époux apparaît pertinente.
ii) En droit matrimonial
L’article 180, al. 2 du Code civil dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Ainsi, à l’instar du droit commun, l’erreur est une cause de nullité du mariage. Son champ d’application est toutefois plus restreint qu’en droit des contrats.
Pour justifier l’anéantissement du mariage, elle doit porter :
- Soit dans la personne de l’époux
- Soit sur des qualités essentielles de la personne de l’époux
Initialement, l’article 180 ne visait que l’erreur « dans la personne ». Ce n’est que tardivement que l’erreur « sur les qualités essentielles de la personne » a été envisagée par le législateur.
La modification de cette disposition résulte de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce qui, à l’inverse de l’effet recherché, a ajouté à la confusion initiale du texte.
==> L’ancien droit
Dans sa version en vigueur en 1804, l’article 180 du Code civil disposait que « lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur »
En application de cette disposition, la Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur la notion d’erreur dans la personne dans un célèbre arrêt Berthon.
Arrêt Berthon
(Cass. ch. Runies, 24 avr. 1862) |
REJET du pourvoi formé par Zoé-Marie-Louise Herbin contre un Arrêt rendu par la Cour impériale d'orléans, le 6 juillet 1861, en faveur du sieur X..., son mari.
Du 24 Avril 1862.
LA COUR, chambres réunies,
Ouï M. Legagneur, conseiller, en son rapport ; Maître Ambroise A..., en ses observations, à l'audience publique du 22 avril ; Maître Z..., en ses observations, et M. le procureur général Dupin, en ses conclusions, à l'audience publique d'hier ;
Vidant le délibéré en chambre du conseil ;
Attendu que l'erreur dans la personne dont les articles 146 et 180 du Y... Napoléon ont fait une cause de nullité du mariage ne s'entend, sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la personne elle-même ;
Attendu que si la nullité, ainsi établie, ne doit pas être restreinte au cas unique de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration ;
Si elle peut également recevoir son application quand l'erreur procède de ce que l'un des époux s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne, et s'est attribué les conditions d'origine et la filiation qui appartiennent à un autre ;
Le texte et l'esprit de l'article 180 écartent virtuellement de sa disposition les erreurs d'une autre nature, et n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur l'identité de la personne et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir ;
Qu'ainsi la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies, et spécialement à l'erreur de l'époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s'en est suivie ;
Que la déchéance établie par l'article 34 du Code pénal ne constitue par elle-même ni un empêchement au mariage ni une cause de nullité de l'union contractée ;
Qu'elle ne touche non plus en rien à l'identité de la personne ; qu'elle ne peut donc motiver une action en nullité du mariage pour erreur dans la personne ;
Qu'en le jugeant ainsi et en rejetant la demande en nullité de son mariage formée par Zoé Herbin, et motivée sur l'ignorance où elle avait été à l'époque du mariage de la condamnation à quinze ans de travaux forcés qu'avait antérieurement subie Berthon, son mari, et de la privation des droits civils et civiques qui en avait été la suite, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et saine application des articles 146 et 180 du Y... Napoléon.
LA COUR REJETTE,
Ainsi fait et prononcé, Chambres réunies.
|
- Faits
- Mariage entre un ex-bagnard avec une fille de bonne famille
- Une fois seulement le mariage célébré, l’épouse apprend le passé de criminel de son mari
- Demande
- Action en nullité du mariage engagée par l’épouse
- Procédure
- Par un arrêt du 6 juillet 1861, la Cour d’appel d’Orléans déboute la requérante de sa demande
- Les juges du fond estiment que seule une erreur sur l’identité de la personne est susceptible de fonder une action en nullité du mariage
- Problème de droit
- Une épouse qui ignorait le passé criminel de son époux est-elle fondée à engager une action en nullité de son mariage ?
- Solution
- Par un arrêt du 24 avril 1862, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse
- Au soutien de sa décision elle affirme que « l’erreur dans la personne dont les articles 146 et 180 du Y… Napoléon ont fait une cause de nullité du mariage ne s’entend, sous la nouvelle comme sous l’ancienne législation, que d’une erreur portant sur la personne elle-même»
- Elle en déduit que « la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu’elle aurait subies, et spécialement à l’erreur de l’époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s’en est suivie»
- Au total, pour la Cour de cassation, seuls deux cas d’erreur constituent des causes de nullité du mariage :
- L’erreur sur l’identité physique de la personne
- Ce cas de figure correspond à la substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration
- L’erreur sur l’identité civile de la personne
- Est ici envisagée l’hypothèse où l’un des époux s’est fait agréer en se présentant comme membre d’une famille qui n’est pas la sienne, et s’est attribué les conditions d’origine et la filiation qui appartiennent à un autre
- En l’espèce, l’erreur commise par Madame Berthon ne répondait à aucune de ces hypothèses, raison pour laquelle la haute juridiction a rejeté son pourvoi
- Pour la Cour de cassation, Madame Berthon s’est trompée, non pas sur la personne de son époux, mais sur sa qualité, soit celle d’ancien bagnard.
- Or l’erreur sur les qualités de la personne n’est pas une cause de nullité du mariage.
- Voilà une conception de l’erreur bien restrictive qui a été adoptée par la Cour de cassation dans cette décision.
- Cette conception a été jugée tellement restrictive par la doctrine, que le législateur est intervenu, en 1971, pour compléter l’article 180 du Code civil.
En suite de l’arrêt Berthon, la jurisprudence a, dans l’ensemble, appliqué à la conception de l’erreur adoptée par la Cour de cassation en refusant d’annuler le mariage, toutes les fois que les époux invoquaient une erreur sur les qualités de la personne.
Les juridictions ont ainsi rejeté :
- L’erreur sur les aptitudes sexuelles du conjoint
- L’erreur sur le passé du conjoint
- L’erreur de la vertu de la femme
- L’erreur de la fortune du conjoint
- L’erreur sur la religion de l’époux
À compter des années 1960, les Tribunaux ont néanmoins assoupli leur position en admettant, en contradiction avec la solution retenue dans l’arrêt Berthon, de plus en plus facilement l’erreur sur les qualités de la personne.
Sous l’impulsion de ce mouvement de libéralisation de la jurisprudence, le législateur a pris conscience de la trop grande étroitesse de la conception de l’erreur en droit français, d’où son intervention en 1971.
==> Le droit positif
La loi du 11 juillet 1971 a mis un terme à la conception restrictive de l’erreur. Pour ce faire, elle a précisé l’article 180 du Code civil qui prévoit désormais que l’erreur peut porter, outre dans la personne de l’époux, sur ses « qualités essentielles »
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « qualités essentielles ».
Trois critères cumulatifs ont été posés par la jurisprudence :
- Un critère objectif
- Pour être prise en considération, la qualité de la personne doit être essentielle en vue du mariage : il s’agit d’apprécier la qualité de la personne eu égard à l’institution du mariage.
- Le juge va donc chercher à s’appuyer sur des critères objectifs.
- L’examen de la jurisprudence, permet d’établir un certain nombre de ces qualités essentielles ou accessoires.
- Exemples
- La santé physique et mentale
- Les aptitudes sexuelles
- Les croyances religieuses
- L’honorabilité du conjoint
- Un critère subjectif
- Pour que l’erreur soit prise en considération, il est nécessaire que la victime de l’erreur rapporte la preuve que l’absence de la qualité qu’elle reproche à son conjoint était antérieure au mariage.
- Cette exigence vaut, notamment pour ce qui concerne l’état mental ou l’aptitude aux rapports sexuels.
- Le caractère déterminant de l’erreur
- Pour être une cause de nullité du mariage, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de l’errans.
- Autrement dit, celui qui a commis l’erreur doit établir que s’il avait eu connaissance de l’absence de la qualité essentielle qui fait défaut chez son conjoint, il ne l’aurait pas épousé.
- À défaut de parvenir à rapporter la preuve du caractère déterminant de l’erreur, quand bien même elle porterait sur une qualité objectivement essentielle, elle ne constituera pas une cause de nullité.
b.3) La violence
Pour mémoire, l’article 180 du Code civil prévoit, en son alinéa 1er, que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
Il ressort de cette disposition que ce qui est cause de nullité c’est moins la violence qui est exercée à l’encontre d’un époux que l’absence de liberté de son consentement.
Toutefois, les juridictions ont très tôt assimilé le défaut de liberté à la violence. Il en a été déduit qu’il convenait de se reporter, pour apprécier la liberté de consentement d’un époux, aux règles qui connaissent de la violence en matière contractuelle.
Ces règles sont édictées aux articles 1140 à 1143 du Code civil.
==> Notion
Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur une personne aux fins de le contraindre à consentir à la conclusion d’un acte.
Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
Il ressort de cette définition que la violence doit être distinguée des autres vices du consentement pris dans leur globalité, d’une part et, plus spécifiquement du dol, d’autre part.
- Violence et vices du consentement
- La violence se distingue des autres vices du consentement, en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause.
- Cependant, elle n’a pas contracté librement
- Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement, seulement elle s’est engagée sous l’empire de la menace
- Violence et dol
- Contrairement au dol, la violence ne vise pas à provoquer une erreur chez le cocontractant.
- La violence vise plutôt à susciter la crainte de la victime
- Ce qui donc vicie le consentement de cette dernière, ce n’est pas l’erreur qu’elle aurait commise sur la portée de son engagement, mais bien la crainte d’un mal qui pèse sur elle.
- Dit autrement, la crainte est à la violence ce que l’erreur est au dol.
- Ce qui dès lors devra être démontré par la victime, c’est que la crainte qu’elle éprouvait au moment de la conclusion de l’acte a été déterminante de son consentement
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil consacrait cinq dispositions à la violence : les articles 1111 à 1115.
L’article 1112 prévoyait notamment que « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».
Dorénavant, quatre articles sont consacrés par le Code civil au dol : les articles 1140 à 1143. Fondamentalement, le législateur n’a nullement modifié le droit positif, il s’est simplement contenté de remanier les dispositions existantes et d’entériner les solutions classiquement admises en jurisprudence.
Aussi, ressort-il de ces dispositions que la caractérisation de la violence suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son origine
i) Les conditions relatives aux éléments constitutifs de la violence
Il ressort de l’article 1140 du Code civil que la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis :
- L’exercice d’une contrainte
- L’inspiration d’une crainte
?) Une contrainte
==> L’objet de la contrainte : la volonté de l’époux
Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée aux articles 180 et l’article 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.
La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet que d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement.
==> La consistance de la contrainte : une menace
La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.
Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.
Ainsi, peut-il s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens
==> Le caractère de la contrainte : une menace illégitime
La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.
A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.
La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.
En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984 avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif» ( 3e civ. 17 janv. 1984).
Quel enseignement retenir de la règle énoncée par la jurisprudence, puis reprise sensiblement dans les mêmes termes par le législateur ?
Un principe assorti d’une limite
- Principe
- La menace exercée à l’encontre d’un contractant est toujours légitime lorsqu’elle consiste en l’exercice d’une voie de droit
- Ainsi, la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime.
- Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé en ce sens, au sujet d’un cautionnement qui aurait été conclu sous la contrainte, que « la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d’un banquier, dès lors qu’il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n’était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n’était intervenue que quinze mois plus tard et qu’aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l’aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement» ( com. 22 janv. 2013).
- Limites
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
- Soit détournée de son but
- Il en va ainsi lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut
- La Cour de cassation a, de la sorte, approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance» ( 1ère civ. 25 mars 2003)
- Soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif
- La menace sera ainsi considérée comme illégitime lorsqu’elle est exercée en vue d’obtenir un avantage hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué
- La Cour de cassation a ainsi estimé que la contrainte consistant à menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs ( com. 28 avr. 1953).
?) Une crainte
La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne sera constitutive d’une cause de nullité que si, conformément à l’article 1140, elle inspire chez la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Aussi, ressort-il de cette disposition que pour que la condition tenant à l’existence d’une crainte soit remplie, cela suppose :
- d’une part que cette crainte consiste en l’exposition d’un mal considérable
- d’autre part que ce mal considérable soit dirigé
- soit vers la personne même de la victime
- soit vers sa fortune
- soit vers ses proches
==> L’exposition à un mal considérable
- Reprise de l’ancien texte
- L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil qui prévoyait déjà cette condition.
- Ainsi, le législateur n’a-t-il nullement fait preuve d’innovation sur ce point-là.
- Notion
- Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?
- Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.
- Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit conclu l’acte à des conditions différentes
- Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
- La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes, ou encore la qualité de la victime.
- Dans un arrêt du 13 janvier 1999, la Cour de cassation a par exemple approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé l’annulation d’une vente pour violence morale.
- La haute juridiction relève, pour ce faire que la victime avait «subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu’en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble» ( 3e civ. 13 janv. 1999).
- Il ressort manifestement de cet arrêt que la troisième chambre civile se livre à une appréciation in concreto.
- L’admission de la crainte révérencielle
- En droit commun des contrats, la crainte référentielle ne permet pas de retenir la violence contre un contractant.
- L’ancien article 1114 du Code civil prévoyait en ce sens que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »
- Cette disposition signifiait simplement que la crainte de déplaire ou de contrarier ses parents ne peut jamais constituer en soi un cas de violence.
- En matière de droit matrimonial c’est la solution inverse qui a été retenue, et par la jurisprudence, et par le législateur.
- Ce dernier a consacré cette solution lors de l’adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs
- Ainsi, l’article 180 a-t-il été complété, la précision suivante ayant été ajoutée : « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
- La crainte révérencielle est donc bien une cause de nullité du mariage.
==> L’objet de la crainte
Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »
Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :
- soit sa personne
- soit sa fortune
- soit celles de ses proches
Ainsi, le cercle des personnes visées l’ordonnance du 10 février 2016 est-il plus large que celui envisagé par les rédacteurs du Code civil.
2. Les conditions relatives à l’origine de la violence
Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence est sanctionnée quel que soit son auteur.
L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Les auteurs justifient cette règle par le fait que la violence n’a pas seulement pour effet de vicier le consentement de la victime : elle porte atteinte à sa liberté de contracter.
La personne qui fait l’objet de violences est donc privée de tout consentement, d’où la sévérité du législateur à son endroit.
En conséquence, peu importe que la violence soit exercé par un époux ou un tiers, ce qui importe c’est que le consentement du conjoint n’ait pas été donné librement.
4. Les conditions tenant à la parenté des époux
La subordination de la validité du mariage au respect de conditions tenant à la parenté des époux, s’explique par la prohibition générale de l’inceste en droit français
a) La prohibition de l’inceste
Les origines de l’interdit de l’inceste ont été longuement étudiées par les sciences humaines et sociales.
De façon schématique, l’interdit de l’inceste relève de considérations :
- Biologiques: les unions consanguines créent un risque de dégénérescence de l’espèce
- Sociales: la prohibition de l’inceste est une règle de l’échange social, qui se traduit par l’obligation de prendre femme en dehors du clan familial
- Psychanalytiques: l’interdiction de tuer son père et d’épouser sa mère découle de l’interdit du meurtre et du cannibalisme
Dans l’ouvrage collectif De l’inceste, Boris Cyrulnik relève que « le mot « inceste » désigne des circuits sexuels très variables d’une culture à l’autre. Pourtant, chaque fois qu’il est employé, il suscite un authentique sentiment d’horreur, comme si tous les membres d’un groupe s’en servaient pour charpenter un imaginaire commun ».
Le droit français ne reconnaît pas explicitement la notion d’inceste. À aucun moment cette notion n’est évoquée explicitement dans notre législation : comme l’a écrit Jean Carbonnier, « paradoxalement, ce tabou si profond n’est inscrit en termes généraux dans aucun texte, ni au code civil ni au nouveau code pénal (non plus que dans les Dix Commandements). Et il n’est point constitutionnalisé : il plane très au-dessus des droits de l’homme ».
Néanmoins, cet interdit universel que constitue l’union sexuelle au sein de la famille sous-tend, d’une part, les dispositions du code civil relatives au mariage et à la filiation, et, d’autre part, les dispositions du code pénal relatives à la répression des violences sexuelles commises au sein de la famille.
En droit pénal, il n’existe pas d’incrimination spéciale de l’inceste mais une circonstance aggravante des viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles sur mineur lorsque ceux-ci sont commis « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime »
Le code pénal distingue en effet trois catégories de violences sexuelles :
- Le viol (articles 222-23 à 222-26 du code pénal), défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise» et puni de quinze ans de réclusion criminelle ;
- L’agression sexuelle (articles 222-22, 222-27 à 222-31 du code pénal), définie comme « toute atteinte sexuelle [autre que le viol] commise avec violence, contrainte, menace ou surprise» et punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende ;
- L’atteinte sexuelle (articles 227-25 à 227-27-1 du code pénal), définie comme « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans» et punie également de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.
Lorsque l’infraction a été commise « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime », les peines sont donc aggravées :
- Le viol est alors puni de vingt ans de réclusion criminelle, qu’il ait été commis sur un mineur de quinze ans ou non
- L’agression sexuelle est quant à elle punie de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende si elle est commise sur un majeur ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, et de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende si elle est commise sur un mineur de quinze ans
- L’atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende
En droit civil, l’interdit de l’inceste fonde l’interdiction du mariage entre personnes de la même famille (ou, le cas échéant, la nullité d’un tel mariage) ainsi que l’interdiction de faire reconnaître la filiation d’un enfant qui serait issu d’une telle union.
b) Le domaine de l’inceste
i) La prohibition de l’inceste en ligne directe
L’article 161 du Code civil dispose que « en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut y avoir de mariage à peine de nullité :
==> Entre ascendant et descendant en ligne directe
L’ascendant est la personne dont est issue une autre personne (le descendant) par la naissance ou l’adoption
Ligne généalogique dans laquelle on remonte du fils au père.
La ligne directe est celle des parents qui descendent les uns des autres.
Ainsi, les ascendants et descendants en ligne directe correspond à la ligne généalogique dans laquelle on remonte du fils au père
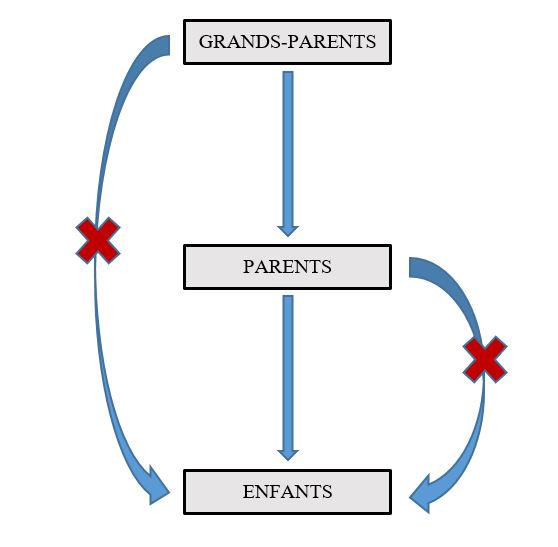
==> Entre alliés en ligne directe
Les alliés sont, par rapport à un époux, les parents de son conjoint (beau-père, belle-mère, gendre, bru etc…).
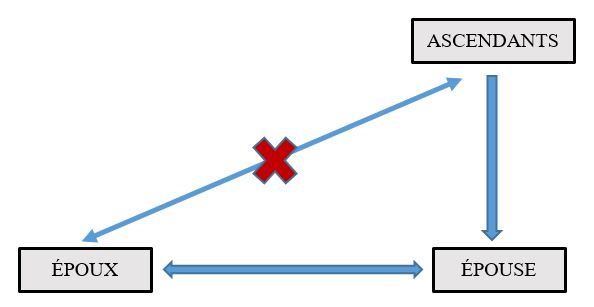
L’article 161 du Code civil est formel : le mariage entre alliés en ligne direct est prohibé.
La question s’est toutefois posée de savoir si cette prohibition s’imposait toujours en cas de divorce du couple marié.
La Grande Bretagne qui connaît une interdiction similaire a, en effet, été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt du 13 septembre 2005 (CEDH 13 sept. 2005, B. et L. c/ United Kingdom, req. no 36536/02) dans une affaire opposant un beau-père et sa belle-fille.
Dans cet arrêt, les Juges strasbourgeois ont considéré qu’un tel empêchement, bien que poursuivant un but légitime de protection de l’intégrité de la famille, constituait une atteinte excessive au droit au mariage, ce en violation de l’article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Pour mémoire, cette disposition, qui garantit le droit au mariage, prévoit que « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».
Non sans une certaine surprise, dans un arrêt du 4 décembre 2013, la Cour de cassation a semblé adopter la solution inverse de celle retenue par la Cour européenne des droits de l’Homme (Cass. 1ère civ. 4 déc. 2013, n°12-26.006).
Dans cette décision, la Première chambre civile a, en effet, décidé que le prononcé de la nullité du mariage d’un beau-père avec sa belle-fille, divorcée d’avec son fils, revêt à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans.
Toutefois, les circonstances de fait ont joué un rôle déterminant dans cette affaire où l’annulation du mariage avait été sollicitée, et prononcée par les juges du fond, sur le fondement de l’article 161 du code civil, qui interdit notamment le mariage entre le beau-père et sa belle-fille, lorsque l’union de cette dernière avec le fils de celui-ci a été dissoute par divorce.
| Cass. 1ère civ. 4 déc. 2013 |
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Claude Y... se sont mariés le 6 septembre 1969 et qu’une fille, née le 15 août 1973, est issue de leur union ; qu’après leur divorce, prononcé le 7 octobre 1980, Mme X... a épousé le père de son ex mari, Raymond Y..., le 17 septembre 1983 ; qu’après avoir consenti à sa petite fille une donation le 31 octobre 1990, ce dernier est décédé le 24 mars 2005 en laissant pour lui succéder son fils unique et en l’état d’un testament instituant son épouse légataire universelle ; qu’en 2006, M. Claude Y... a, sur le fondement de l’article 161 du code civil, assigné Mme X... en annulation du mariage contracté avec Raymond Y... ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu’ainsi que l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt récent, les limitations apportées au droit au mariage par les lois nationales des Etats signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d’une manière telle que l’on porte atteinte à l’essence même du droit, retient que la prohibition prévue par l’article 161 du code civil subsiste lorsque l’union avec la personne qui a créé l’alliance est dissoute par divorce, que l’empêchement à mariage entre un beau père et sa bru qui, aux termes de l’article 164 du même code, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l’alliance, est justifié en ce qu’il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial, que cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d’eux, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des conclusions de sa fille que le mariage célébré le 17 septembre 1983, alors qu’elle n’était âgée que de dix ans, a opéré dans son esprit une regrettable confusion entre son père et son grand père, que l’article 187 dudit code interdit l’action en nullité aux parents collatéraux et aux enfants nés d’un autre mariage non pas après le décès de l’un des époux, mais du vivant des deux époux, qu’enfin, la présence d’un conjoint survivant, même si l’union a été contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour M. Claude Y..., unique enfant et héritier réservataire de Raymond Y..., des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux, la donation consentie à Mme Fleur Y... et la qualité de Mme Denise X... en vertu du testament du défunt étant sans incidence sur cette situation, de sorte que M. Claude Y... a un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le prononcé de la nullité du mariage de Raymond Y... avec Mme Denise X... revêtait, à l’égard de cette dernière, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition prononçant l’annulation du mariage célébré le 17 septembre 1983 entre Raymond Y... et Mme Denise X..., ainsi qu’en sa disposition allouant une somme à M. Claude Y... sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
|
- Faits
- Le fils de l’époux avait introduit l’action en nullité du mariage, 22 ans après sa célébration, après le décès de son père, lequel avait institué son épouse légataire universelle.
- Celle-ci avait invoqué, pour s’y opposer, une atteinte à la substance du droit au mariage garanti par l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en se fondant sur un arrêt rendu en ce sens le 13 septembre 2005 par la Cour européenne des droits de l’homme, relatif à un projet de mariage entre alliés, se prévalant de nombreuses années de vie commune.
- Procédure
- Dans un arrêt du 21 juin 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli la demande de nullité en considérant que l’empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru, prévu par l’article 161 du code civil, était justifié en ce qu’il répondait à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille et qu’en l’espèce, la présence d’un conjoint survivant entraînait nécessairement des conséquences successorales préjudiciables à cet unique héritier qui, dès lors, justifiait d’un intérêt à l’annulation.
- Solution
- La Cour de cassation a jugé que les constatations des juges du fond étaient suffisantes pour en déduire que le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commandait de rejeter la demande d’annulation de ce mariage, célébré sans que le ministère public ait formé opposition au mariage, alors que les pièces d’état civil qui avaient été produites par les futurs époux révélaient nécessairement la cause de l’empêchement au mariage.
- Portée
- En raison de son fondement, la portée de cette décision est limitée au cas particulier examiné.
- Ainsi, le principe de la prohibition du mariage entre alliés n’est pas remis en question par cette décision de la Cour de cassation
Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation a confirmé la prohibition du mariage entre alliés en ligne direct (Cass. 1ère civ. 8 déc. 2016, n°15-27.201).
Au soutien de sa décision elle rappelle que « que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale »
À cet égard, elle précise « qu’il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi »
En l’espèce, la Cour de cassation relève que :
- D’une part, la belle-fille avait 9 ans quand son beau-père a épousé sa mère en troisièmes noces
- D’autre part, qu’elle avait 25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l’a épousée
Il en résulte que l’intéressée a vécu, alors qu’elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu’elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu’elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique
La Première chambre civile relève encore que l’union de la belle-fille avec son beau-père n’avait duré que huit années lorsque l’action en nullité a été engagée et qu’aucun enfant n’est issu de cette union prohibée
Au regard de tous ces éléments, la Cour de cassation valide la décision des juges du fond qui ont pu valablement déduire que l’annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la belle-fille au regard du but légitime poursuivi.
| Cass. 1ère civ. 8 déc. 2016 |
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 2014), que Pierre Y..., né le 10 janvier 1925, et Mme Z..., née le 6 juillet 1949, se sont mariés le 28 janvier 1984 ; qu’après leur divorce, prononcé par jugement du 13 décembre 2000, Pierre Y... a épousé, le 12 janvier 2002, Mme X..., fille de Mme Z..., née le 24 avril 1975 d’une précédente union ; qu’après le décès de Pierre Y..., le 5 avril 2010, Mme Anne Y..., épouse A... et MM. Philippe, Jacques et Frédéric Y... (les consorts Y...) ont assigné Mme X... aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 161 du code civil, l’annulation de son mariage avec leur père et beau-père ; que, Mme X... ayant été placée sous curatelle renforcée en cours de procédure, son curateur, l’ATMP du Var, est intervenu à l’instance ;
Attendu que Mme X... et l’ATMP du Var font grief à l’arrêt de prononcer l’annulation du mariage et, en conséquence, de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe, après la dissolution par divorce de la première union qui avait été contractée par l’un des deux alliés avec le parent du second, porte une atteinte disproportionnée au droit du mariage ; qu’en prononçant, sur le fondement de l’article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre Y... et Mme X..., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand l’empêchement à mariage entre alliés en ligne directe, qui peut néanmoins être célébré en vertu d’une dispense si celui qui a créé l’alliance est décédé et ne repose pas sur l’interdiction de l’inceste, inexistant entre personnes non liées par le sang, porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage, la cour d’appel a violé l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ;
2°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe est susceptible de revêtir, à leur égard, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leur union, célébrée sans opposition, a duré plusieurs années ; qu’en prononçant, sur le fondement de l’article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre Y... et Mme X..., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand ce mariage célébré sans opposition, avait duré pendant huit années, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; que, selon l’article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt ;
Qu’aux termes de l’article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ;
Que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, si l’exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des Etats contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même ; qu’il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d’appréciation des Etats contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l’exercice du droit au mariage ;
Que, cependant, le droit de Mme X... et Pierre Y... de se marier n’a pas été atteint, dès lors que leur mariage a été célébré sans opposition et qu’ils ont vécu maritalement jusqu’au décès de l’époux ; qu’en annulant le mariage, la cour d’appel n’a donc pas méconnu les exigences conventionnelles résultant du texte susvisé ;
Attendu, en second lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ;
Que l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l’annulation d’un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale ;
Qu’il appartient toutefois au juge d’apprécier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, la mise en oeuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;
Attendu que l’arrêt relève, d’abord, que Mme X... avait 9 ans quand Pierre Y... a épousé sa mère en troisièmes noces, qu’elle avait 25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l’a épousée ; qu’il en déduit que l’intéressée a vécu, alors qu’elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu’elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu’elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ; qu’il constate, ensuite, que son union avec Pierre Y... n’avait duré que huit années lorsque les consorts Y... ont saisi les premiers juges aux fins d’annulation ; qu’il relève, enfin, qu’aucun enfant n’est issu de cette union prohibée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que l’annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., au regard du but légitime poursuivi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
|
ii) La prohibition de l’inceste en ligne collatérale
L’article 162 du Code civil prévoit encore que « en ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la sœur, entre frères et entre sœurs »
L’article 163 du Code civil ajoute que « le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. »
Ainsi, il ne peut y avoir de mariage à peine de nullité :
==> Entre collatéraux
La ligne collatérale est celle des parents qui ne descendent pas les uns des autres mais d’un auteur commun.
Le degré correspond à un intervalle séparant deux générations et servant à calculer la proximité de la parenté, chaque génération comptant pour un degré
L’article 741 du Code civil dispose que « la proximité de parenté s’établit par le nombre de générations ; chaque génération s’appelle un degré. »
L’interdiction s’étend aux degrés suivants :
- Au deuxième degré
- Entre frères et sœurs, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils sont germains, consanguins ou utérins.
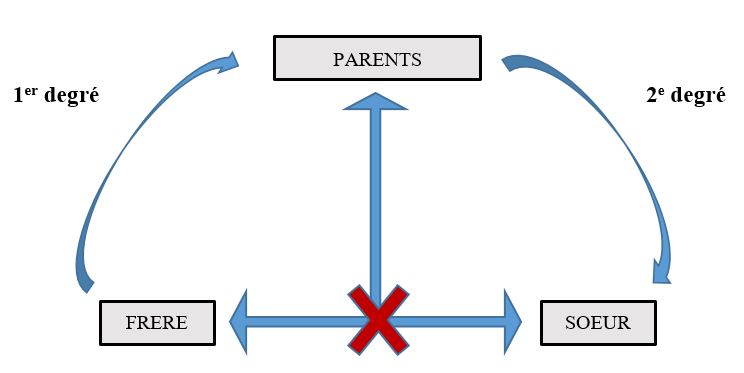
- Au troisième degré
- Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce

- Au quatrième degré
- Très tôt la question s’est posée de savoir s’il convenait d’étendre la prohibition de l’inceste au quatrième degré et plus particulièrement entre grand-oncle et petite-nièce et grand-tante et petit-neveu
- Dans un avis du 23 avril 1808, le Conseil d’État répondit par la négative à cette question validant le mariage entre les personnes visées.
- Toutefois, cet avis fut immédiatement réprouvé par l’Empereur qui, aux termes d’une décision publiée au Bulletins des lois du 7 mai 1808, arrêta que « le mariage entre un grand-oncle et sa petite-nièce ne peut avoir lieu qu’en conséquence de dispenses accordées conformément à ce qui est prescrit par l’article 164 du Code civil…».
- Cette position a été confirmée, 70 ans plus tard, par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 1877 ( req. 28 nov. 1877).
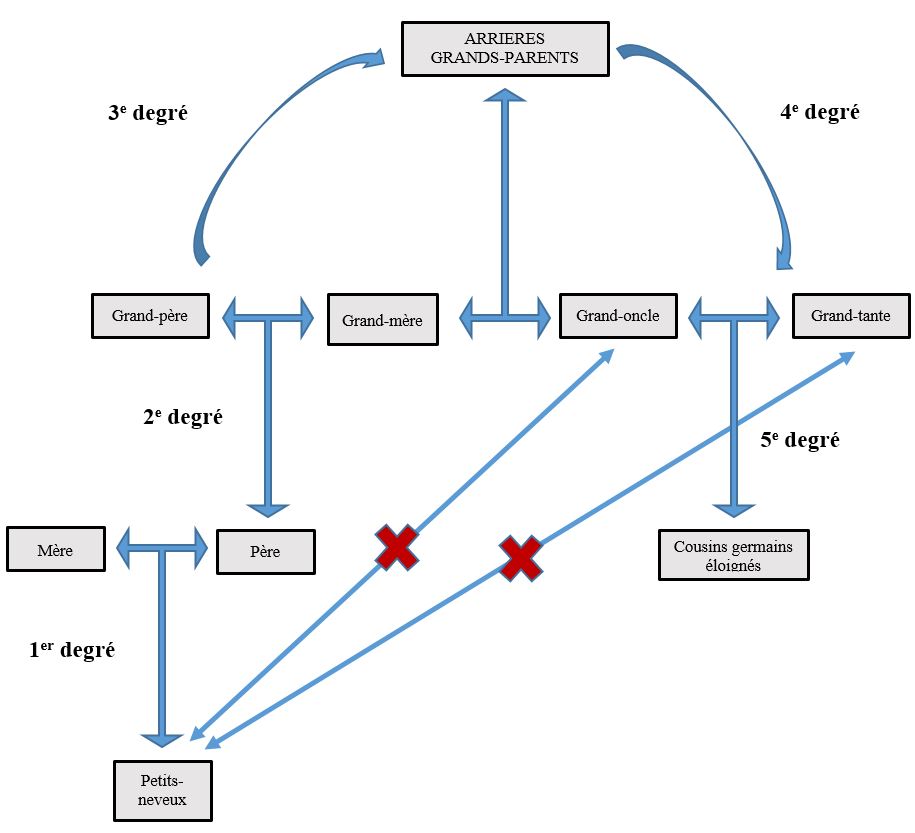
iii) Les dispenses
Deux sortes d’empêchements doivent être distinguées en matière de prohibition de l’inceste :
- Les empêchements absolus qui ne peuvent faire l’objet d’aucune dispense
- Les empêchements relatifs qui peuvent être levés au moyen d’une dispense
==> Les empêchements absolus
Il s’agit de tous ceux pour lesquels aucune dispense n’est prévue. Il en va ainsi de l’interdiction à mariage notamment entre :
- Parents en ligne directe
- Alliés en ligne directe
- Frères et sœurs
==> Les empêchements relatifs
Il s’agit de toutes les interdictions à mariage pour lesquelles le législateur a prévu une dispense.
L’article 164 du Code civil prévoit qu’il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
- Par l’article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;
- Par l’article 163, soit les interdictions à mariage qui intéressent l’oncle et la nièce, la tante et le neveu.
L’article 366, al. 7 dispose encore que la prohibition au mariage portée entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.
La dispense ne pourra être obtenue qu’à la condition de justifier d’un motif grave. L’examen de la jurisprudence révèle que l’intérêt de l’enfant né ou à naître est l’une des principales causes d’obtention d’une dispense.
5. Les conditions tenant à la situation conjugale des époux
L’article 147 du Code civil prévoit que « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. »
Ainsi, la polygamie est-elle interdite en droit français.
La transgression de cette interdiction est sanctionnée à l’article 433-20 du Code pénal aux termes duquel « le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Dans l’hypothèse où l’officier d’état civil qui a célébré le mariage avait connaissance de cette situation, il encourt les mêmes peines que l’auteur du délit.
Afin de prévenir la polygamie, l’article 70 du Code civil commande à l’officier d’état civil de procéder à un certain nombre de vérifications.
En particulier, l’alinéa 1er de cette disposition prévoit que « chacun des futurs époux remet à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage l’extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance, qui ne doit pas dater de plus de trois mois s’il a été délivré par un officier de l’état civil français. »
B) Les conditions de forme
- La constitution du dossier de mariage
L’article 63 du code civil liste les pièces devant être produites par les futurs époux pour la constitution de leur dossier de mariage.
Il précise à cet égard que doivent être fournis les documents suivants :
- Les copies intégrales de leur acte de naissance ou le cas échéant, un acte de notoriété (pièces visées aux articles 70 et 71 du code civil) ;
- La justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;
- L’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère
==> Sur la production de copie intégrale
L’article 70 du code civil prévoit la remise par chacun des futurs époux d’une copie intégrale de son acte de naissance à l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage.
Cet article précise que la copie de l’acte de naissance ne doit pas être datée de plus de trois mois si elle a été délivrée en France, six mois si elle a été délivrée dans un consulat à l’étranger.
Un certain nombre de questions ont été posées à la Chancellerie s’agissant de l’appréciation de ce délai.
S’agissant du point de départ du délai de validité de la copie intégrale de l’acte, celle-ci doit être appréciée au jour du dépôt du dossier du mariage et non au jour de la célébration du mariage dès lors que c’est ce dépôt qui conditionne la publication des bans.
Toutefois, si avant la célébration du mariage, l’état civil d’un des futurs époux a été modifié, celui-ci doit en aviser l’officier de l’état civil chargé de célébrer son mariage en produisant une nouvelle copie de son acte mis à jour.
Cette précaution, dont doivent être avertis les candidats au mariage au moment de la constitution de leur dossier, doit permettre d’éviter à l’usager de solliciter la rectification ultérieure de son acte de mariage.
Concernant la production d’un acte de naissance étranger, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) préconise, par extension, que la copie soit datée de moins de six mois.
Les copies intégrales d’actes de naissance produites en vue de la célébration sont versées aux pièces annexes de l’acte de mariage.
==> Sur les autres pièces à produire
- Justificatifs de domicile
- Les dispositions figurant aux articles 165 et 166 du code civil requièrent que les futurs époux justifient du domicile ou de la résidence de l’un d’eux et/ou de leur parent, dès lors que cette preuve fonde la compétence de l’officier de l’état civil devant célébrer leur union et permet d’ordonner la publicité des bans à la mairie ou à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage et à celles du domicile ou de la résidence des futurs époux.
- En effet, les justificatifs du domicile et le cas échéant de la résidence des futurs époux sont requis pour permettre à l’officier de l’état civil célébrant le mariage d’adresser l’avis aux fins de publication des bans dans les diverses mairies et autorités diplomatiques ou consulaires françaises.
- À cet égard, l’officier de l’état civil doit solliciter la production de toutes pièces justificatives permettant d’établir la réalité du domicile ou de la résidence à cette adresse (bail locatif, quittances de loyer, factures EDF, GDF, factures de téléphone à l’exclusion de téléphonie mobile, avis d’imposition ou de non-imposition, avis de taxe d’habitation, attestation ASSEDIC, attestation de l’employeur,…).
- Si ces éléments de preuve ne sont pas exhaustifs, il convient de relever qu’une simple attestation sur l’honneur ne peut constituer une preuve suffisante.
- Ces pièces doivent par ailleurs présenter un caractère récent au jour de la constitution du dossier.
- En cas de doute, les officiers de l’état civil doivent saisir le parquet territorialement compétent.
- Prévention de la bigamie
- Quelle que soit la nationalité des futurs époux, les conditions d’ordre public de la loi française doivent être observées par ces derniers comme, par exemple, la prohibition de la bigamie prévue à l’article 147 du code civil.
- Ainsi lorsque la copie d’acte de naissance ne permet pas de rapporter la preuve que le futur époux n’est pas lié par un précédent mariage (ex : mariage dissous par le décès d’un époux ou acte de naissance étranger provenant d’un système juridique ne prévoyant pas la mise à jour des actes de l’état civil, voir ci-dessus), cette preuve peut notamment être constituée par la production d’une copie de l’acte de décès de son précédent conjoint, par un certificat de coutume établi attestant du célibat de l’intéressé, etc.
- S’agissant des ressortissants étrangers, ces derniers doivent rapporter la preuve du contenu de leur loi personnelle notamment par la production d’un certificat de coutume afin de permettre à l’officier de l’état civil de s’assurer du respect de ses conditions.
2. La publication des bans
Aux termes de l’article 63, al. 1er du Code civil « avant la célébration du mariage, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. ».
Cette obligation est plus connue sous le nom d’exigence de publication des bans.
==> Le moment de la publication des bans
La chancellerie a été interpellée sur la question de savoir à quel moment l’officier de l’état civil peut procéder à la publication des bans.
Sauf cas de dispense, les bans ne peuvent en principe être publiés qu’après que les futurs époux ont remis un dossier complet et le cas échéant, ont été auditionnés conformément à l’article 63 du code civil.
Toutefois, si le ou les futurs époux demeure(nt) dans l’attente de la preuve du contenu de sa (leur) loi personnelle, la publication des bans peut être effectuée sous réserve que les autres pièces précitées aient été produites.
==> L’avis de publication des bans
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a élargi le lieu de célébration du mariage au lieu du domicile ou de la résidence de l’un des parents d’un futur époux (articles 74 et 165 du code civil).
La circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi du 17 mai 2013 a rappelé que cette loi n’avait pas modifié les dispositions relatives à la publication des bans.
Conformément à l’article 166 du code civil, la publication des bans est faite à la mairie du lieu du mariage ainsi qu’à la mairie du domicile ou à défaut de domicile à la mairie de la résidence de chacun des futurs époux.
Dès lors, l’officier de l’état civil chargé de célébrer le mariage doit adresser un avis de publication des bans à la mairie du domicile de chacun des époux.
À défaut de domicile en France, cette formalité sera faite à la mairie de la résidence en France du ou des époux.
En cas de domicile à l’étranger (et en l’absence de résidence en France), l’officier de l’état civil adressera un avis de publication à la représentation diplomatique ou consulaire française dans le ressort du domicile du futur époux de nationalité française.
Lorsque le futur époux est de nationalité étrangère, il lui appartient de faire procéder à cette publication des bans prévue par le droit français auprès de l’autorité locale compétente sous réserve que la loi étrangère reconnaisse cette formalité préalable au mariage.
La saisine du procureur de la République par l’officier de l’état civil communal ou consulaire en cas d’indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue à l’article 63 du code civil, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre des articles 146 et 180 du code civil ne suspend pas la publication des bans.
Celle-ci doit être opérée dès lors que les pièces requises ont été données et l’audition effectuée. La formule de l’avis de publication des bans indique pour chacun des futurs époux son domicile et éventuellement sa résidence, à défaut d’un domicile en France.
Cette indication permet de justifier la compétence de la mairie destinataire de l’avis pour procéder à la publicité du mariage.
Elle n’a pas pour objet de justifier la compétence de l’officier de l’état civil pour procéder à la célébration du mariage prévue par la loi.
L’élargissement par la loi du lieu du mariage au domicile ou à la résidence du ou des parents des futurs mariés ne justifie donc pas d’indiquer dans les avis de publication une résidence des futurs époux au domicile des parents.
3. La célébration du mariage
Rappelant que le mariage civil est le seul à produire des effets juridiques, à la différence du mariage religieux, l’article 165 du Code civil est modifié afin de consacrer explicitement et symboliquement le caractère républicain du mariage.
Cet article énonce que « le mariage sera célébré publiquement lors d’une cérémonie républicaine par l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle l’un des époux, ou l’un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 169 ci-après. ».
Ainsi, la publication des bans est une condition requise pour procéder à la célébration du mariage.
De même, le maire doit effectuer les vérifications légales résultant en particulier de l’article 63 du Code civil et visant à s’assurer de la véritable intention matrimoniale des futurs époux.
À l’issue de ces vérifications, le maire, en sa qualité d’officier de l’état civil doit, sauf opposition du parquet ou décision en ce sens du tribunal de grande instance, procéder à la célébration.
Comme rappelé dans la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés, il n’entre pas dans les pouvoirs du maire d’apprécier l’opportunité de la célébration d’un mariage, et, a fortiori, il ne peut refuser, pour des motifs d’ordre personnel, de respecter la loi et de célébrer un mariage.
Un tel refus exposerait l’officier de l’état civil au prononcé
- D’une part, de sanctions administratives : suspension ou révocation en application de l’article L 2122-16 du code général des collectivités territoriales
- D’autre part, de sanctions pénales : articles 432-1 et suivants du code pénal
Lors de la célébration, l’officier de l’état civil fera lecture aux époux des articles du Code civil énoncés à l’article 75 du même code à l’exception de l’article 220 dont la lecture a été supprimée.
Enfin, à l’issue de la célébration, l’officier de l’état civil invitera les époux et les témoins à signer avec lui l’acte de mariage lequel sera adapté si nécessaire selon le sexe des époux et nommera les époux dans l’ordre choisi par eux lors de la constitution du dossier de mariage.
L’officier de l’état civil, lors de la remise de celui-ci attirera l’attention des futurs époux sur ce point. Il remettra aux époux un livret de famille ou complètera pour les couples de personnes de sexe différent le livret de famille des parents ayant ensemble un enfant commun.
Pour mémoire, si l’un des époux possède un livret délivré à l’occasion de la naissance ou l’adoption de son enfant, ce livret ne pourra être complété avec la référence au mariage lorsque l’autre époux n’est pas le parent de l’enfant.
II) La sanction de l’inobservation des conditions de formation du mariage
Le non-respect des conditions de formation du mariage peut faire l’objet de deux sortes de sanctions
- Une sanction préventive : l’opposition
- Une sanction curative : la nullité
A) La sanction préventive : l’opposition à mariage
==> Opposition / empêchement
L’opposition est l’acte par lequel celui qui connaît un empêchement au mariage, le signale à l’officier d’état civil en lui faisant défense de célébrer le mariage.
L’opposition a ainsi pour effet de faire obstacle à la célébration du mariage en raison de l’existence d’un empêchement à mariage.
Par empêchement, il faut entendre le non-respect d’une condition de formation du mariage.
C’est pourquoi il « empêche » la tenue de la célébration. La théorie des empêchements à mariage est assise sur l’idée qu’il convient d’agir en amont et de ne pas risquer que le mariage soit annulé après coup.
Une fois le mariage célébré, il n’est plus possible de revenir en arrière. Or la découverte, a posteriori, de la violation d’une condition de formation du mariage peut avoir des conséquences graves pour les époux.
S’il est dirimant, l’empêchement constitue, en effet, une cause de nullité de leur union.
==> Empêchements dirimants et empêchements prohibitifs
Classiquement, on distingue deux sortes d’empêchements :
- L’empêchement dirimant
- Il s’agit d’un l’empêchement relatif à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
- L’empêchement prohibitif
- Il s’agit d’un empêchement relatif à une condition dont le non-respect fait seulement obstacle à la célébration du mariage sans, pour autant, être de nature à entraîner la nullité du mariage
En toute hypothèse, que l’empêchement soit prohibitif ou dirimant il est une cause d’opposition à mariage, laquelle opposition doit être formée auprès de l’officier d’état civil.
Immédiatement une question alors se pose : quels sont les empêchements dirimants et quels sont les empêchements prohibitifs ?
Le Code civil ne nous fournit aucune liste de ces empêchements, ni aucun critère formel de distinction.
Pour les identifier, il convient alors de se reporter aux articles 180, 182 et 184 du Code civil, lesquels envisages les conditions de formation du mariage dont le non-respect est sanctionné par la nullité.
En application du principe général « pas de nullité sans texte », on peut en déduire quelles sont les conditions qui ne sont pas sanctionnées par l’anéantissement du mariage.
Il est alors possible d’opérer, à partir de cette déduction, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs.
À l’examen, seules deux conditions de formation du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité :
- Défaut de publication des bans
- L’existence d’une opposition en elle-même
Toutes les autres conditions sont susceptibles d’entraîner la nullité du mariage si elles ne sont pas respectées.
En pratique, la distinction entre les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs ne présente aucun intérêt.
En outre, aujourd’hui, l’opposition, qui était un moyen jadis pour les familles de mettre à mal les mariages qu’elles n’approuvaient pas, n’est que très exceptionnellement soulevée.
Son terrain de prédilection est désormais celui des mariages simulés, soit des mariages blancs.
De surcroît, pour former opposition, il faut remplir un certain nombre de conditions. Ses effets dans le temps sont, par ailleurs limités.
- Les conditions de l’opposition
a) Les conditions de fond
Les conditions de fond tiennent :
- D’une part, aux personnes qui ont qualité pour former opposition
- D’autre part, aux motifs invoqués au soutien de l’opposition
==> Opposition du conjoint
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 172 du Code civil prévoit que « le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.»
- Cette disposition confère ainsi le droit de former opposition au conjoint non-divorce de l’un des futurs époux
- Motif allégué
- Le conjoint non divorcé du futur époux n’est fondé à former opposition que si le motif allégué a trait à la bigamie
==> Opposition des ascendants
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 173 du Code civil prévoit que « le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.»
- Cette disposition énonce un ordre hiérarchique des personnes qui ont qualité à former opposition parmi les ascendants des futurs époux :
- Père et mère
- À défaut, les grands-parents
- À défaut, les aïeuls
- Motif allégué
- Les ascendants des futurs époux peuvent alléguer, au soutien de leur opposition, n’importe quel motif, dès lors qu’il s’agit de la violation d’une condition de formation du mariage.
- Il peut donc s’agir de la bigamie, d’un vice du consentement, de la non-publication des bans ou encore du défaut d’autorisation parentale
- Épuisement du droit d’opposition
- L’alinéa 2 de l’article 173 prévoit que « après mainlevée judiciaire d’une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration »
- Ainsi, les ascendants du futur époux ne peuvent former opposition à mariage qu’une seule fois
- Il s’agit d’éviter que les ascendants forment tour à tour opposition afin d’empêcher la célébration du mariage
==> Opposition des collatéraux
- Titularité du droit d’opposition
- L’article 174 du Code civil prévoit que « à défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants»
- Il ressort de cette disposition que les collatéraux ne peuvent former opposition qu’à titre subsidiaire, soit à défaut d’ascendants.
- Au sein du cercle des collatéraux, le législateur n’a pas institué d’ordre hiérarchique
- Motif allégué
- L’article 174 du Code civil prévoit que les collatéraux ne peuvent former opposition que dans deux cas précis :
- Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 159, n’a pas été obtenu
- Il s’agit de l’hypothèse s’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille
- Cela suppose donc que le futur époux soit mineur et n’est plus d’ascendants
- Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux
- Il appartient toutefois à l’opposant de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
- À défaut, la mainlevée pure et simple de l’opposition pourra être prononcée
==> Opposition du tuteur et du curateur
- Titularité de l’action
- L’article 175 du Code civil prévoit que « le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer. »
- Il résulte de cette disposition que le tuteur et le curateur sont titulaires du droit de former opposition dans les mêmes conditions que les collatéraux, soit à défaut d’ascendants du futur époux, soit à titre subsidiaire
- La référence au curateur est toutefois inopérante, dans la mesure où depuis la loi du 14 décembre 1964, le mineur émancipé n’est plus soumis au régime de la curatelle.
- Quant à la curatelle des majeurs, elle ne comporte pas de conseil de famille
- L’hypothèse visée n’a donc plus de sens
- Motif allégué
- Les motifs susceptibles d’être allégués par le tuteur sont :
- Le défaut de consentement du conseil de famille, dans l’hypothèse où le futur époux est mineur et n’a plus d’ascendants
- L’état de démence du futur époux
==> Opposition du ministère public
- Titularité de l’action
- L’article 175-1 du Code civil prévoit que « le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. »
- Cette prérogative a été conférée au ministère public en particulier pour lutter contre les mariages simulés
- Motif allégué
- L’article 175-1 du Code civil prévoit que le ministère public ne peut former une opposition à mariage que pour les cas où il peut demander la nullité du mariage.
- Ces cas ne sont autres que les empêchements dirimants, soit tous les empêchements relatifs à une condition dont le non-respect est sanctionné par la nullité du mariage
- Aussi, le seul empêchement dont ne pourra pas se prévaloir le ministère public, c’est la non-publication des bans
- Cas particulier des mariages de complaisance
- L’article 175-2 du Code civil prévoit que « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63, que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé au titre de l’article 146 ou de l’article 180, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République.»
- En cas de signalement au ministère public d’un mariage de complaisance, plusieurs étapes doivent être observées :
- Première étape
- Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine :
- soit de laisser procéder au mariage
- soit de faire opposition à celui-ci
- soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder.
- Deuxième étape
- Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.
- La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
- Troisième étape
- À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder au mariage ou s’il s’oppose à sa célébration.
- Quatrième étape
- L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours.
- La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.
b) Les conditions de forme
==> Notification de l’opposition
L’article 66 du Code civil prévoit que
- D’une part, les actes d’opposition au mariage sont signés sur l’original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration, spéciale et authentique
- D’autre part, ils sont signifiés, avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l’officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l’original.
Ainsi, l’opposition à mariage doit être formée par voie d’huissier.
==> Enregistrement de l’opposition
Aux termes de l’article 67 du Code civil, à réception de l’opposition, l’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages
==> Contenu de l’acte d’opposition
L’article 176 du Code civil prévoit que tout acte d’opposition :
- Énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former
- Contient les motifs de l’opposition
- Reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition
- Contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré.
Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, soit en cas de mariage de complaisance, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
==> Sanctions
L’article 176, al. 2 prévoit que les exigences de forme sont prévues :
- à peine de nullité de l’acte d’opposition
- l’opposition sera alors sans effet
- à peine de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition
- L’huissier pourra ainsi refuser de prêter son concours à l’opposant
2. Les effets de l’opposition
==> La suspension de la célébration
L’article 68 du Code civil dispose que « en cas d’opposition, l’officier d’état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu’on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 3 000 euros d’amende et de tous dommages-intérêts. »
Ainsi est-il fait défense à l’officier d’état civil, en cas d’opposition de procéder à la célébration du mariage.
C’est là tout l’intérêt même de l’opposition : faire obstacle à l’union des époux dont l’une des conditions de formation n’est pas remplie.
Il peut être observé que, l’officier d’état civil n’est pas le juge du bien-fondé du motif de l’opposition, quand bien même s’il a la conviction que l’empêchement allégué n’est pas justifié.
L’existence d’une opposition constitue, en elle-même, un motif de suspension de la célébration du mariage
En conséquence, l’officier d’état civil a, quel que soit le motif invoqué, l’obligation de ne pas célébrer le mariage. C’est au seul Juge qu’il appartiendra de se prononcer sur la mainlevée de l’opposition.
==> La durée de l’opposition
L’article 176, al. 3 du Code civil prévoit que « après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. »
Ainsi, l’opposition n’est valable qu’un an.
À l’expiration de ce délai elle devient caduque.
==> Le renouvellement de l’opposition
L’opposition peut, par principe, être renouvelée, à l’exception de deux cas :
- Dans l’hypothèse où elle a été formée par un ascendant.
- Dans l’hypothèse où la mainlevée judiciaire a été prononcée
3. La mainlevée de l’opposition
La mainlevée consiste en un retrait de l’opposition, soit à priver l’acte de son efficacité. Si la mainlevée est prononcée, le mariage peut, de nouveau être célébré.
Il existe deux sortes de mainlevée :
- La mainlevée volontaire
- La mainlevée est volontaire lorsque l’opposant consent à se désister, ce qu’il peut faire devant l’officier d’état civil au moment de la célébration
- Ce dernier pourra néanmoins toujours refuser de célébrer le mariage, s’il estime que l’empêchement à mariage subsiste
- La mainlevée judiciaire
- La mainlevée est judiciaire lorsqu’elle est prononcée par un juge après que l’un des futurs époux a rapporté la preuve du mal-fondé de l’opposition
- Procédure
- Le tribunal de grande instance doit se prononcer dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs ( 177 C. civ.)
- Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts ( 179, al. 1 C. civ.)
- Voies de recours
- La décision du Juge est susceptible d’appel ( 178 C. civ.)
- La Cour devra alors statuer également dans les dix jours
- Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.
B) La sanction curative : la nullité du mariage
En ce que le mariage comporte une dimension contractuelle, il est envisagé par le législateur comme un acte juridique.
À ce titre, la violation de ses conditions de formation est sanctionnée par la nullité. Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a pour effet d’anéantir le mariage.
Ainsi, cette sanction met-elle fin à l’union conjugale, au même titre que le divorce.
Toutefois, il convient de bien distinguer ce mode de rupture du mariage du divorce, notamment en ce qu’elle n’emporte pas les mêmes effets.
- La nullité
- Elle vient sanctionner la violation d’une des conditions de formation du mariage (excepté la non-publication des bans qui constitue un empêchement prohibitif).
- La nullité agit rétroactivement, de sorte que le mariage est réputé n’avoir jamais existé.
- Elle met donc fin tant aux effets passés, qu’aux effets futurs du mariage
- Par exception, en cas de mariage putatif certains effets bénéficient toujours aux enfants et, parfois, à l’époux de bonne foi.
- Le divorce
- Il met fin au mariage soit à la suite d’une décision conjointe des époux, soit pour sanctionner une violation, non pas d’une condition de formation du mariage, mais d’une obligation née de la formation du mariage
- Le divorce ne met fin au mariage que pour l’avenir.
- Il n’est pas rétroactif comme peut l’être la nullité.
- Le divorce produit ses effets à l’égard des deux époux.
- Il n’est pas question de faire ici comme si le mariage n’avait jamais existé.
- Au contraire, le divorce va donner lieu à la liquidation de l’union matrimoniale
==> Notion
La nullité est donc la sanction encourue par un acte judiciaire entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond.
Par « nul », il faut comprendre, poursuit cette disposition, qu’il « est censé n’avoir jamais existé. »
Il ressort de cette définition générale de la nullité qu’elle présente deux caractères principaux :
- Elle sanctionne les conditions de formation de l’acte irrégulier
- Elle anéantit l’acte qu’elle frappe rétroactivement
Compte tenu de la gravité de cette sanction qui, donc est susceptible de mettre un terme à l’union conjugale, le législateur a aménagé le régime juridique des nullités en matière de mariage, de sorte qu’il se distingue de celui applicable aux contrats.
Trois différences notables avec le droit commun peuvent être observées :
- D’une part, la violation d’une condition de formation du mariage n’est pas nécessairement sanctionnée par une nullité (non-publication des bans)
- D’autre part, les conditions d’exercice de l’action en nullité du mariage sont restreintes
- Enfin, les effets de la nullité du mariage sont adoucis, en ce sens que la rétroactivité de la sanction est, sur certains points, écartée
Pour le reste, les principes généraux qui gouvernent les nullités s’appliquent au mariage, de sorte qu’il est permis d’envisager leur régime juridique, à maints égards, par analogie avec le droit commun.
==> La summa divisio des nullités
Traditionnellement, on distingue deux catégories de nullités :
- Les nullités relatives
- Les nullités absolues
La question qui immédiatement se pose est alors se savoir quel critère retenir pour les distinguer. Sur cette question, deux théories se sont opposées : l’une dite classique et l’autre moderne
- La théorie classique
- Selon cette théorie, née au XIXe siècle, le critère de distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues serait purement anthropomorphique.
- Autrement dit, l’acte juridique pourrait être comparé à un être vivant, lequel est composé d’organes.
- Or ces organes peuvent, soit faire défaut, ce qui serait synonyme de mort, soit être défectueux, ce qui s’apparenterait à une maladie.
- Selon la doctrine de cette époque, il en irait de même pour l’acte juridique qui est susceptible d’être frappé par différents maux d’une plus ou moins grande gravité.
- En l’absence d’une condition d’existence (consentement, objet, cause) l’acte serait mort-né : il encourrait la nullité absolue
- Lorsque les conditions d’existence seraient réunies mais que l’une d’elles serait viciée, l’acte serait seulement malade : il encourrait la nullité relative
- Cette théorie n’a pas convaincu les auteurs modernes qui lui ont reproché l’artifice de la comparaison.
- La théorie moderne
- La théorie classique des nullités a été vivement critiquée, notamment par Japiot et Gaudemet.
- Selon ces auteurs, le critère de distinction entre la nullité relative et la nullité absolue réside, non pas dans la gravité du mal qui affecte l’acte, mais dans la finalité poursuivie par la règle sanctionnée par la nullité.
- Ainsi, selon cette théorie :
- La nullité absolue viserait à assurer la sauvegarde de l’intérêt général, ce qui justifierait qu’elle puisse être invoquée par quiconque à un intérêt à agir
- La nullité relative viserait à assurer la sauvegarde d’un intérêt privé, ce qui justifierait qu’elle ne puisse être invoquée que par la personne protégée par la règle transgressée
- S’il est indéniable que le critère de distinction proposé par la doctrine moderne est d’application plus aisé que le critère anthropomorphique, il n’en demeure pas moins, dans certains cas, difficile à mettre en œuvre.
Au bilan, il ressort de la distinction opérée par la jurisprudence que la nullité est :
- absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
- relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
==> Les cas de nullité relative et absolue
Le principe général « pas de nullité sans texte » s’applique en matière de mariage.
Cela signifie que la nullité du mariage n’est encourue qu’à la condition d’être envisagée par une disposition. À défaut, l’irrégularité ne donne pas lieu à l’annulation du mariage.
Lorsque, en revanche, que la nullité est prévue, il convient de déterminer, s’il s’agit d’une nullité relative ou absolue.
- Les nullités relatives
- Il s’agit des nullités qui visent à sanctionner la violation d’un intérêt privé
- Au nombre de ces nullités, on compte :
- Les vices du consentement
- Erreur sur les qualités essentielles de la personne
- La violence
- Le défaut d’autorisation de la famille
- Les nullités absolues
- Il s’agit des nullités qui visent à sanctionner la violation de l’intérêt génal
- Les cas de nullités absolues sont manifestement, en matière de mariage, plus nombreux que les cas de nullités relatives :
- Le défaut d’âge légal
- L’absence de consentement
- L’absence de l’époux lors du mariage
- La bigamie
- L’inceste
- La clandestinité
- L’incompétence de l’officier d’état civil
Une fois déterminée la nature de la nullité par laquelle est sanctionnée l’irrégularité dont est entaché le mariage, il conviendra d’exercer une action en justice aux fins de la faire constater par le Juge (1)
Que la nullité soit absolue ou relative, cela n’aura toutefois aucune répercussion sur les effets de la nullité (2)
- L’action en nullité
a) Les titulaires de l’action en nullité
Selon que la nullité est relative ou absolue, les personnes susceptibles d’exercer l’action en nullité varient
i) Les nullités relatives
Le principe général est, en la matière, que seule la personne protégée par la règle sanctionnée par une nullité relative a qualité à agir.
En matière de mariage, cette règle a été quelque peu aménagée.
==> Les nullités pour vice du consentement
Il convient ici de distinguer l’erreur de la violence :
- La nullité pour violence
- L’article 180, al. 1er du Code civil prévoit que deux personnes ont qualité à agir pour exercer l’action en nullité :
- Le ou les époux victime de la violence
- Le ministère public
- La nullité pour erreur
- L’article 180, al. 2e du Code civil prévoit que seul l’époux qui a été induit en erreur a qualité à agir pour exercer l’action en nullité
==> Le défaut d’autorisation familiale
L’article 182 du Code civil prévoit que « le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement. »
Il ressort de cette disposition que, en cas de défaut d’autorisation familiale, l’action en nullité peut être exercée :
- Par l’époux incapable
- La personne dont le consentement était requis
ii) Les nullités absolues
Le principe général est, en la matière, que quiconque possède un intérêt peut exercer l’action en nullité absolue.
En matière de mariage, le cercle de ces personnes ayant qualité à agir a cependant été considérablement restreint.
Il ressort de la combinaison des articles 184 et 185 du Code civil que, en matière de nullité absolue, pour déterminer les titulaires de l’action, il convient de distinguer entre les personnes qui doivent justifier d’un intérêt pécuniaire et celles qui n’ont pas besoin de justifier d’un tel intérêt
- Les personnes n’ayant pas à justifier d’un intérêt pécuniaire
- Les époux
- Le conjoint du futur époux
- Les père et mère
- Les ascendants
- Le Conseil de famille en l’absence d’ascendants
- Le ministère public (ne peut agir que du vivant des époux)
- Les personnes devant justifier d’un intérêt pécuniaire
- Les collatéraux
- Les enfants nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux
- Les créanciers des époux
b) La prescription de l’action en nullité
L’action en nullité se prescrit différemment selon que la nullité invoquée est absolue ou relative
==> La prescription de la nullité absolue
- Délai
- L’article 184 du Code civil prévoit que « tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.»
- Dans un arrêt du 29 mai 2013, la Cour de cassation a précisé que « la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l’action en nullité absolue du mariage » (Cass 1ère, 29 mai 2013).
- Point de départ
- La prescription court à compter du jour de la célébration du mariage
- En cas d’impossibilité pour le titulaire de l’action d’agir, conformément à l’article 2234 du Code civil, la prescription est suspendue de sorte que l’action peut être exercée au-delà du délai de trente ans (Cass 1ère, 29 mai 2013)
| Cass 1ère civ., 29 mai 2013 |
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2011), qu'après s'être marié le 20 juillet 1950 avec Mme X..., Michel Y...a épousé Mme Z... au Mexique le 18 juin 1964 ; que son divorce d'avec Mme X...a été prononcé le 13 février 1967 et que son mariage avec Mme Z... a été transcrit au consulat général de France à Mexico le 30 novembre 1974 ; qu'après le prononcé de son divorce d'avec Mme Z... le 17 septembre 1990, Michel Y...s'est remarié avec Mme B...le 27 décembre 1991 ; que Michel Y...étant décédé le 13 janvier 2009, Mme B...a assigné Mme Z... en annulation du mariage célébré le 18 juin 1964, pour cause de bigamie ;
Attendu que Mme B...fait grief à l'arrêt de déclarer l'action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen :
1°/ que, antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et nonobstant la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 qui ne concerne que les actions relatives à la filiation, l'action en nullité du mariage pour bigamie n'était encadrée dans aucun délai de prescription ; que par suite, tant en application de l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qu'en application des règles générales gouvernant les conflits de lois dans le temps, la prescription trentenaire, telle que prévue par l'article 184 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, n'a pu courir que du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 147 et 184 du code civil, ensemble l'article 2 du même code et l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°/ que, à supposer que le délai de trente ans institué par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et inséré à l'article 184 du code civil ait pu s'appliquer pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, en toute hypothèse, le délai de prescription n'était pas susceptible de courir tant que Mme B...n'était pas en mesure d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si la demanderesse n'avait pas été mise dans l'impossibilité d'agir avant la transcription du mariage attaqué sur l'acte de naissance de Michel Y...le 18 octobre 1979, en sorte que le point de départ de la prescription trentenaire devait être reporté à cette date, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 184 et 2234 nouveaux du code civil ;
3°/ que, à supposer que les règles gouvernant en l'espèce le point de départ ou la suspension du délai de prescription fussent celles qui étaient en vigueur avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'arrêt encourrait encore la cassation, pour la raison exposée à la première branche du moyen, pour défaut de base légale au regard de l'article 184 ancien du code civil et de la règle selon laquelle la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui se trouve dans l'impossibilité d'agir ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la loi du 17 juin 2008 a maintenu à trente ans le délai de prescription applicable à l'action en nullité absolue du mariage ;
Attendu, d'autre part, que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ayant relevé que Mme B...indiquait dans ses écritures qu'elle aurait pu connaître la situation matrimoniale antérieure de son époux à la date de mention du mariage contracté avec Mme Z... sur l'acte de naissance de Michel Y..., soit le 18 octobre 1979, et qu'elle aurait pu prendre connaissance de l'acte de naissance de son conjoint lors de son mariage en décembre 1991, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que Mme B...disposait encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, et que son action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
==> La prescription de la nullité relative
- Délai
- L’article 181 du Code civil prévoit que « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. »
- Ce délai est donc considérablement réduit en comparaison de celui qui court en matière de nullité absolue
- Point de départ
- La prescription de l’action en nullité relative a pour point de départ le jour de la célébration du mariage
- En cas d’impossibilité d’exercer cette action, elle pourra toujours être exercée au-delà du délai de prescription, en application de l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, soit une prescription ne peut s’appliquer contre quelqu’un qui ne peut pas agir
- Cas particulier du défaut d’autorisation familiale
- L’article 183 du Code civil prévoit que « l’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l’époux, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage.»
- Il ressort de cette disposition se prescrit différemment selon le titulaire de l’action
- Action des parents et ascendants
- Le délai de prescription est de 5 ans
- Il commence à courir à compter du jour où les parents ont et connaissance du mariage
- Aucune action en nullité ne peut plus être intentée à l’expiration du délai de 5 ans
- Action de l’époux
- Le délai de prescription est également pour l’époux de 5 ans
- Toutefois, le délai commence à courir à compter du jour où il a atteint l’âge requis pour contracter mariage, soit 18 ans révolus
2. Les effets de la nullité
a) L’effet rétroactif de la nullité
Le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé.
Cela signifie, autrement dit, que le mariage est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans la mesure où le mariage aura nécessairement reçu un commencement d’exécution, son annulation du contrat suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.
L’effet rétroactif est attaché, tant à la nullité relative, qu’à la nullité absolue.
La rétroactivité à plusieurs conséquences sur la situation des époux, quant à leur personne et quant à leurs biens
L’obligation de communauté de vie, le devoir de fidélité, d’assistance et de secours sont considérés comme n’ayant jamais existé.
Un époux ne saurait, en conséquence, se prévaloir de l’adultère de son conjoint consécutivement à la rupture, ou encore revendiquer le paiement d’une prestation compensatoire.
Plus généralement, les rapports patrimoniaux entre les époux se régleront selon les règles du droit commun et non selon le droit des régimes matrimoniaux.
b) Le mariage putatif
==> Principe
Compte tenu de la gravité de la sanction que constitue la nullité, en ce qu’elle met brutalement un terme à l’union conjugale, le législateur a adouci, à certains égards, ses effets.
Cet assouplissement des effets de la nullité se traduit, notamment par l’instauration du mariage putatif.
Ce système consiste, non pas à préserver l’union conjugale dont la rupture est d’ores et déjà consommée, mais à limiter l’annulation aux seuls effets à venir.
Autrement dit, la nullité n’opérera pas sur les effets passés du mariage.
Cette limitation des effets de la nullité est sous-tendue par l’idée que, ni les enfants, ni l’époux de bonne foi ne doivent être touchés par la sévérité de la sanction, en conséquence de quoi il apparaît juste de faire perdurer, à leur seul bénéfice, certains effets du mariage.
==> Conditions
- L’exigence de bonne foi des époux
- L’article 201 du Code civil prévoit que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. »
- Il ressort de cette disposition que le mariage putatif opère, à la seule et unique condition que les époux soient de bonne foi.
- La bonne foi consiste pour un époux en l’ignorance de l’existence d’un empêchement dirimant, soit de la cause de nullité du mariage
- L’erreur commise par l’époux peut être de droit ou de fait
- La jurisprudence n’exige pas que l’erreur soit excusable, ni ne distingue selon les vices qui affectent la validité du mariage
- Il suffit que la bonne foi existe au moment du mariage
- Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à l’époux qui conteste l’application du mariage putatif de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son conjoint
- Il n’est pas nécessaire que les deux époux soient de bonne foi.
- L’alinéa 2 de l’article 201 prévoit en ce sens que « si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.»
- L’indifférence de la situation des enfants
- L’article 202 du Code civil prévoit que le mariage putatif « produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi. »
- Ainsi, est-il indifférent qu’aucun des époux ne soit de bonne foi s’agissant des effets du mariage putatif à l’égard des enfants.
==> Effets
- Les effets à l’égard des époux
- Plusieurs situations sont susceptibles de se présenter
- Les deux époux sont de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse le mariage putatif n’opérera pour aucun des deux
- Cela signifie que la nullité anéantira, tant les effets futurs du mariage que ses effets passés
- Le mariage sera réputé n’avoir produit aucun effet à l’égard des époux
- Aucun d’eux ne pourra se prévaloir des conventions matrimoniales
- Un des époux est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, la nullité opérera sans rétroactivité pour l’époux de bonne foi
- Quant au conjoint de mauvaise foi, il ne pourra pas bénéficier du mariage putatif
- Il subira les effets de la rétroactivité de la nullité qui donc lui interdira de se prévaloir des effets passés du mariage
- Les deux époux sont de bonne foi
- Le mariage putatif opérera pour les deux époux, si bien que seuls les effets futurs du mariage seront anéantis
- Les effets passés seront maintenus, nonobstant l’annulation de l’union conjugale
- Les rapports entre époux se régleront selon les prescriptions du droit des régimes matrimoniaux
- Les époux pourront alors conserver le bénéfice des libéralités consenties l’un à l’autre
- Les effets à l’égard des enfants
- Les enfants bénéficieront, en toute hypothèse, du mariage putatif, peu importe que leurs parents soient de bonne ou de mauvaise foi
- Cette faveur présentait un intérêt particulier lorsque le droit opérait une distinction entre les enfants légitimes (issus du mariage) et les enfants naturels (issus du concubinage).
- En effet, les enfants conservaient la légitimité qu’ils avaient acquise sous l’effet du mariage de leur parent
- Désormais, ce régime de faveur n’a que peu d’intérêt en pratique dès lors que la distinction entre la filiation légitime et naturelle a été abolie par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation
- L’alinéa 2 de l’article 202 prévoit seulement que « le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. »
- Les effets à l’égard des tiers
- Aucune disposition du Code civil ne règle les effets du mariage putatif à l’égard des tiers
- Il en résulte que c’est le droit commun qui leur est applicable, en particulier la théorie de l’apparence
- Le mariage entaché de nullité étant réputé n’avoir jamais existé, les époux sont considérés comme des concubins
- Or la jurisprudence admet que dès lors que des concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir des dispositions qui régissent leurs relations avec les époux, notamment l’article 220 relatif à la solidarité des dettes ménagères.
- L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
- Une situation contraire à la réalité
- Une croyance légitime du tiers
- Une erreur excusable du tiers
- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable