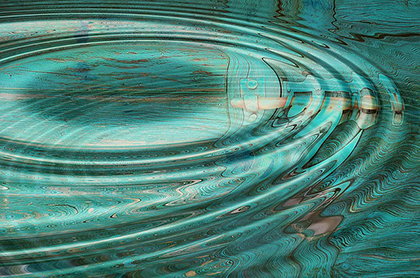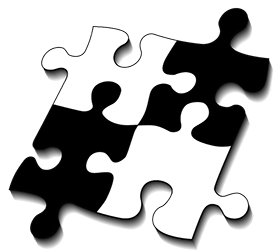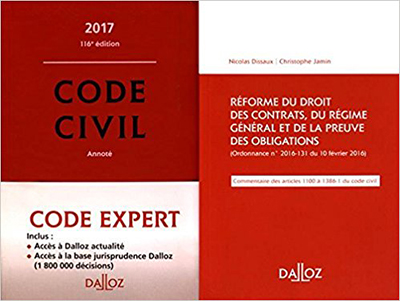L’aménagement conventionnel de la réparation – qui se distingue de l’aménagement de la responsabilité, puisqu’il ne porte que sur les effets de la responsabilité, même s’il peut avoir, en pratique, des effets semblables à une exonération de responsabilité – peut prendre deux formes :
- Première forme
- Il peut s’agir de clauses limitatives de réparation, se traduisant par une diminution du montant de la réparation.
- Seconde forme
- Il peut s’agir de clauses dites « pénales », par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale ou partielle, ou d’exécution tardive du contrat.
- Le forfait peut s’avérer soit plus élevé, soit plus faible que le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation.
Nous nous focaliserons ici sur les clauses limitatives de réparation.
1. Le principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Alors que l’on assiste à une convergence des règles qui régissent la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, une différence subsiste : tandis que la première peut être limitée, voire écartée par le jeu d’une convention, la seconde ne peut souffrir d’aucun aménagement contractuel.
- S’agissant de la responsabilité délictuelle
- La jurisprudence a toujours condamné les clauses limitatives de réparation en matière délictuelle lorsqu’elles concernent des cas de responsabilité pour faute.
- Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d’ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d’exonération ou d’atténuation de responsabilité en matière délictuelle » (Cass. 1ère civ. 5 juill. 2017, n°16-13.407).
- La haute juridiction admet, en revanche, de telles clauses dans le cadre de régimes de responsabilité pour faute présumée ou de responsabilité sans faute.
- Est ainsi licite la clause par laquelle des propriétaires d’animaux décident de s’affranchir de l’application des dispositions de l’article 1385 du code civil, lesquelles mettent en place une responsabilité de plein droit du propriétaire d’animaux pour les dommages causés par ces derniers (V. en ce sens Cass. req. 16 nov. 1931).
- La pertinence du maintien d’une exclusion de toute possibilité d’aménagement contractuel en matière de responsabilité pour faute prouvée est discutée.
- Certains auteurs estiment en effet souhaitable d’autoriser des clauses limitatives ou exonératoires dans des conditions plus proches de celles existant en matière contractuelle.
- Ces derniers sont, semble-t-il, en passe d’être entendus puisque le projet de réforme du droit de la responsabilité civile envisage d’autoriser la stipulation de telles clauses, dès lors qu’elles ne visent pas à limiter ou exclure l’indemnisation en cas de dommage corporel (art. 1281 C. civ.).
- S’agissant de la responsabilité contractuelle
- Parce que le débiteur n’est tenu de réparer que le préjudice prévisible, soit celui prévu par les parties au contrat, la jurisprudence a admis, très tôt, la validité des clauses limitatives de responsabilité (
- Les juridictions sont, à cet égard, allées plus loin en autorisant les parties, au nom de la liberté contractuelle, à stipuler des clauses qui exonèrent de toute responsabilité (V. en ce sens Cass. civ. 15 juin 1959, n°57-12.362).
- À l’examen, la validité des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité n’a nullement été remise en cause par la réforme du droit des obligations.
- Le nouvel article 1231-3 du Code civil prévoit, en effet, que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».
Au total, seules les clauses exonératoires ou limitatives en matière de responsabilité contractuelle bénéficient d’une validité de principe.
Elles sont particulièrement fréquentes, par exemple, dans les contrats de transport ou de déménagement, dans lesquels sont insérées des clauses dont l’objet est de fixer, une fois la faute contractuelle établie, le maximum des dommages et intérêts que le créancier pourra recevoir, c’est-à-dire, en d’autres termes, un plafond de réparation.
Reste, que la stipulation de ces clauses est prohibée dans un certain nombre de contrats, sans compter que leurs effets sont susceptibles d’être neutralisés dans plusieurs situations.
2. Les exceptions au principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Bien que, en matière de responsabilité contractuelle, la validité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité soit, par principe, admise, certains textes encadrent, voire prohibent leur stipulation.
Aux côtés de ces textes spéciaux qui tendent à se multiplier et intéressent des matières pour le moins variées, il faut également compter sur une disposition de portée générale, introduite par l’ordonnance de 10 février 2016, qui vise à réputer non-écrite toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.
2.1 Les textes spéciaux qui prohibent de l’aménagement conventionnel de la responsabilité
De nombreux textes spéciaux prohibent donc la stipulation de clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité :
- En matière de contrat de travail, l’article L. 1231-4 du Code du travail prévoit que l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles qui régissent le licenciement, soit, en particulier, celles qui gouvernent les indemnités de rupture
- En matière de contrat de bail d’habitation, l’article 4, m) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prohibe toute clause « qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité »
- En matière de contrat de consommation, l’article R. 212-1, 6° du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations »
- En matière de contrat de vente volontaire de meubles aux enchères publiques, l’article 321-14 du Code de commerce prévoit que « les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. »
- En matière de contrat d’hôtellerie, l’article 1953, al. 2 du Code civil pose que, d’une part, les hôteliers « sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel », d’autre part, que « cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. »
- En matière de contrat de louage d’ouvrage, l’article 1792-5 du Code civil prévoit que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité [du constructeur], soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite »
- En matière de contrat de transport de marchandises, l’article 133-1 du Code de commerce énonce que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. […]. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
- En matière de contrat de transport maritime, l’article L. 5422-15 du Code des transports dispose que « est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet […] de soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l’article L. 5422-12 »
En dehors des textes spéciaux qui prohibent l’aménagement conventionnel de la responsabilité, c’est le droit commun qui s’applique. Or en droit, commun, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont valides, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à une obligation essentielle du contrat.
2.2 L’atteinte à une obligation essentielle du contrat
L’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil, ce texte trouve notamment à s’appliquer aux clauses limitatives et exonératoires de responsabilité.
La codification de cette dernière solution, sur une question qui a donné lieu à de nombreux arrêts parfois inconciliables, permet de fixer clairement le droit positif sur le sort de ces clauses.
Contrairement à ce qu’avaient pu retenir certaines décisions de la Cour de cassation, une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur ne sera pas nécessairement réputée non écrite : elle n’est prohibée que si elle contredit la portée de l’engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.
a. La construction de la jurisprudence Chronopost et Faurecia
a.1 La saga Chronopost
En résumant à gros trait, dans le cadre de l’affaire Chronopost, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si une clause stipulée en contradiction avec l’engagement principal pris par l’une des parties pouvait faire l’objet d’une annulation.
C’est sur le terrain de la cause que la Cour de cassation a tenté de répondre en se servant de cette notion comme d’un instrument de contrôle de la cohérence du contrat, ce qui n’a pas été sans alimenter le débat sur la subjectivisation de la cause.
Afin de bien saisir les termes du débat auquel a donné lieu la jurisprudence Chronopost, revenons sur les principales étapes de cette construction jurisprudentielle qui a conduit à l’introduction d’un article 1170 du Code civil.
i. Premier acte : arrêt Chronopost du 22 octobre 1996
|
Arrêt Chronopost I (Cass. com. 22 oct. 1996) Sur le premier moyen : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la société Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la société Chronopost, venant aux droits de la société SFMI ; que ces plis n’ayant pas été livrés le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la société Chronopost s’y était engagée, la société Banchereau a assigné en réparation de ses préjudices la société Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Attendu que, pour débouter la société Banchereau de sa demande, l’arrêt retient que, si la société Chronopost n’a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l’expédition avant midi, elle n’a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat ; Attendu qu’en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société Banchereau dans un délai déterminé, et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen. |
?Faits
Une société (la société Chronopost), spécialiste du transport rapide, s’est engagée à livrer sous 24 heures un pli contenant une réponse à une adjudication.
Le pli arrive trop tard, de sorte que la société cliente ne parvient pas à remporter l’adjudication.
?Demande
La société cliente demande réparation du préjudice subi auprès du transporteur
Toutefois, la société Chronopost lui oppose une clause qui limite sa responsabilité au montant du transport, soit 122 francs.
?Procédure
Par un arrêt du 30 juin 1993, la Cour d’appel de Rennes, déboute la requérante de sa demande.
Les juges du fond estiment que la responsabilité contractuelle du transporteur n’aurait pu être recherchée que dans l’hypothèse où elle avait commis une faute lourde.
Or selon la Cour d’appel le retard dans la livraison du pli ne constituait pas une telle faute.
En conséquence, le client du transporteur ne pouvait être indemnisé du préjudice subi qu’à hauteur du montant prévu par le contrat soit le coût du transport : 122 francs.
?Solution
Par un arrêt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 22 oct. 1996, n°93-18.632).
La Cour de cassation affirme, au soutien de sa décision que dans la mesure où la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant, à ce titre, la fiabilité et la célérité de son service, s’était engagée à livrer les plus de son client dans un délai déterminé, « en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».
?Analyse
Tout d’abord, il peut être observé que, en visant l’ancien article 1131 du Code civil, la Cour de cassation assimile à l’absence de cause l’hypothèse où la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité a pour effet de contredire la portée de l’obligation essentielle contractée par les parties.
En l’espèce, la société Chronopost, spécialisée dans le transport rapide, s’est engagée à acheminer le plus confié dans un délai déterminé en contrepartie de quoi elle facture à ses clients un prix bien supérieur à ce qu’il est pour un envoi simple par voie postale.
En effet, c’est pour ce service, en particulier, que les clients de la société Chronopost, se sont adressé à elle, sinon pourquoi ne pas s’attacher les services d’un transporteur classique dont la prestation serait bien moins chère.
Ainsi, y a-t-il manifestement dans le délai rapide d’acheminement une obligation essentielle soit une obligation qui constitue l’essence même du contrat : son noyau dur.
Pourtant, la société Chronopost a inséré dans ses conditions générales une clause aux termes de laquelle elle limite sa responsabilité, en cas de non-respect du délai d’acheminement fixé, au montant du transport, alors même que le préjudice subi par le client est sans commune mesure.
D’où la question posée à la Cour de cassation : une telle clause ne vide-t-elle pas de sa substance l’obligation essentielle du contrat, laquelle n’est autre que la stipulation en considération de laquelle le client s’est engagé ?
En d’autres termes, peut-on envisager que la société Chronopost s’engage à acheminer des plis dans un délai rapide et, corrélativement, limiter sa responsabilité en cas de non-respect du délai stipulé à la somme de 122 francs ?
Il ressort du présent arrêt, que la Cour de cassation répond par la négative à cette question.
Elle estime, en ce sens, que la stipulation de la clause limitative de responsabilité était de nature à contredire la portée de l’engagement pris au titre de l’obligation essentielle du contrat.
En réduisant à presque rien l’indemnisation en cas de manquement à l’obligation essentielle du contrat, la clause litigieuse vide de sa substance ladite obligation.
Aussi, cela reviendrait, selon la Cour de cassation qui vise l’article 1131 du Code civil, à priver de cause l’engagement du client, laquelle cause résiderait dans l’obligation d’acheminer le pli dans un délai déterminé.
Elle en déduit que la clause limitative de responsabilité doit être réputée non-écrite.
?Critiques
Plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la solution retenue par la haute juridiction
- Le visa de la solution
- Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors même qu’il existe une contrepartie à l’obligation de chacun des contractants ?
- La contrepartie de l’obligation de la société Chronopost consiste en le paiement du prix par son client.
- La contrepartie de l’obligation du client consiste quant à elle en l’acheminement du pli par Chronopost.
- Jusqu’alors, afin de contrôler l’existence d’une contrepartie, le contrat était appréhendé globalement et non réduit à une de ses clauses en particulier.
- Pourquoi annuler la clause du contrat sur le fondement de l’ancien article 1131 du Code civil alors même qu’il existe une contrepartie à l’obligation de chacun des contractants ?
- La subjectivisation de la cause
- Autre critique formulée par les auteurs, la Cour de cassation se serait attachée, en l’espèce, à la fin que les parties ont poursuivie d’un commun accord, ce qui revient à recourir à la notion de cause subjective alors que le contrôle de l’existence de contrepartie s’opère, classiquement, au moyen de la seule cause objective.
- Pour la Cour de cassation, en concluant un contrat de transport rapide, les parties ont voulu que le pli soit acheminé à son destinataire dans un certain délai.
- Or, si l’on s’en tient à un contrôle de la cause objective (l’existence d’une contrepartie), cela ne permet pas d’annuler la clause limitative de responsabilité dont la mise en œuvre porte atteinte à l’obligation essentielle du contrat : l’obligation de délivrer le pli dans le délai convenu.
- Pour y parvenir, il est en effet nécessaire d’apprécier la validité des clauses du contrat en considération de l’objectif recherché par les contractants.
- Le recours à la notion de cause subjective permet alors d’écarter la clause qui contredit la portée de l’engagement pris, car elle entrave la fin poursuivie et ainsi la cause qui a déterminé les parties à contracter.
- Tel est le cas de la clause limitative de responsabilité qui fait obstacle à la réalisation du but poursuivi par les parties, cette clause étant de nature à ne pas inciter la société Chronopost à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d’exécuter son obligation, soit acheminer les plis qui lui sont confiés dans le délai stipulé.
- Au total, la conception que la Cour de cassation se fait de la cause renvoie à l’idée que la cause de l’obligation correspondrait au but poursuivi par les parties, ce qui n’est pas sans faire écho à l’arrêt Point club vidéo rendu le 3 juillet 1996, soit trois mois plus tôt, où elle avait assimilé le défaut d’utilité de l’opération économique envisagé par l’une des parties à l’absence de cause.
- La sanction de l’atteinte à l’obligation essentielle
- La cause étant une condition de validité du contrat, son absence était sanctionnée, en principe, par une nullité du contrat lui-même.
- Tel n’est cependant pas le cas dans l’arrêt Chronopost où la Cour de cassation estime que la clause limitative de responsabilité est seulement réputée non-écrite.
- Pourquoi cette solution ?
- De toute évidence, en l’espèce, la Cour de cassation a statué pour partie en opportunité.
- Si, en effet, elle avait prononcé la nullité du contrat dans son ensemble, cela aurait abouti au même résultat que si l’on avait considéré la clause valide :
- Le client reprenait son pli
- Chronopost reprend ses 122 francs.
- Aussi, en réputant la clause non-écrite, cela permet d’envisager la question de la responsabilité contractuelle de la société Chronopost, la clause limitative de responsabilité ayant été neutralisée.
- Plus largement, la sanction retenue participe d’un mouvement en faveur du maintien du contrat : plutôt que d’anéantir l’acte dans son ensemble, on préfère le maintenir, amputé de ses stipulations illicites.
- La Cour de cassation parvient donc ici à une solution équivalente à laquelle aurait conduit l’application des règles relatives à la prohibition des clauses abusives.
- Toutefois, ce corpus normatif ne trouve d’application que dans le cadre des relations entre professionnels et consommateurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- Dès lors, on peut estimer que la Cour de cassation s’est servie dans cet arrêt du concept de cause comme d’un instrument d’éradication d’une clause abusive stipulée dans un contrat qui, par nature, échappait au droit de la consommation.
ii. Deuxième acte : arrêt Chronopost du 9 juillet 2002
La solution retenue dans l’arrêt Chronopost n’a pas manqué de soulever plusieurs questions, dont une en particulier : une fois que l’on a réputé la clause limitative de responsabilité non-écrite comment apprécier la responsabilité de la société Chronopost ? Autrement dit, quelle conséquence tirer de cette sanction ?
|
Arrêt Chronopost II (Cass. com. 9 juill. 2002) Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 22 octobre 1996, bulletin n° 261), qu’à deux reprises, la société Banchereau a confié à la Société française de messagerie internationale (SFMI), un pli destiné à l’office national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’agriculture en vue d’une soumission à une adjudication de viande ; que ces plis n’ayant pas été remis au destinataire le lendemain de leur envoi, avant midi, ainsi que la SFMI s’y était engagée, la société Banchereau n’a pu participer aux adjudications ; qu’elle a assigné la SFMI en réparation de son préjudice ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1150 du Code civil, l’article 8, paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er et 15 du contrat type messagerie, établi par décret du 4 mai 1988, applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer inapplicable le contrat type messagerie, l’arrêt retient que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport ; Attendu qu’en statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, ce qui entraînait l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; |
- Faits
- La Cour de cassation est amenée à se prononcer une seconde fois sur l’affaire Chronopost jugée une première fois par elle le 22 octobre 1996.
- Elle statue ici sur le pourvoi formé par la société Chronopost contre l’arrêt rendu sur renvoi le 5 janvier 1999 par la Cour d’appel de Rouen.
- Problématique
- À l’instar du contrat vente, de bail ou encore de prêt, le contrat de messagerie est encadré par des dispositions réglementaires.
- Plus précisément il est réglementé par le décret du 4 mai 1988 qui organise son régime juridique.
- Aussi, dans le deuxième volet de l’affaire Chronopost, la question s’est posée de savoir si le décret du 4 mai 1988 réglementant les contrats de type transport était applicable au contrat conclu entre la société Chronopost et son client ou si c’est le droit commun de la responsabilité contractuelle qui devait s’appliquer.
- Quel était l’enjeu ?
- Si le décret s’applique, en cas de non-acheminement du pli dans les délais par le transporteur, celui-ci prévoit une clause équivalente à celle déclarée nulle par la Cour de cassation dans l’arrêt du 22 octobre 1996 : le remboursement du montant du transport, soit la somme de 122 francs, celle-là même prévue dans les conditions générales de la société Chronopost.
- Si, au contraire, c’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique, une réparation du préjudice subie par la société cliente du transporteur est alors envisageable.
- Solution
- Tandis que la Cour d’appel condamne la société Chronopost sur le terrain du droit commun (réparation intégrale du préjudice) estimant que le contrat type messagerie était inapplicable en l’espèce, la Cour de cassation considère que le décret du 4 mai 1988 avait bien vocation à s’appliquer (Cass. com. 9 juill. 2002, n°99-12.554).
- Au soutien de sa décision, la Cour de cassation affirme que dans la mesure où la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, cela entraîne nécessairement « l’application du plafond légal d’indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec ».
- En appliquant le droit commun des transports, cela revient alors à adopter une solution qui produit le même effet que si elle n’avait pas annulé la clause litigieuse : le remboursement de la somme de 122 francs !
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise toutefois que le plafond légal d’indemnisation est susceptible d’être écarté en rapportant la preuve d’une faute lourde imputable au transporteur.
- D’où la référence dans le visa, entre autres, à l’ancien article 1150 du Code civil qui prévoyait que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. »
- La solution retenue par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2002 a immédiatement soulevé une nouvelle question :le manquement à une obligation essentielle du contrat pouvait être assimilé à une faute lourde, ce qui dès lors permettrait d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.
iii. Troisième acte : arrêts Chronopost du 22 avril 2005
Arrêts Chronopost III
(Cass. ch. mixte, 22 avril 2005)
|
Première espèce Attendu, selon l’arrêt attaqué que la société D… France (la société D…) ayant décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de sa candidature qui n’est parvenue à destination que le 26 mai 1999 ; que la société D… a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard du contrat-type “messagerie” ; Sur le second moyen : Vu l’article 1150 du Code civil, l’article 8 paragraphe II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ; Attendu que pour écarter le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type “messagerie” et condamner la société Chronopost à payer à la société D… la somme de 100 000 francs, l’arrêt retient que la défaillance de la société Chronopost consistant en un retard de quatre jours, qualifié par elle-même “d’erreur exceptionnelle d’acheminement”, sans qu’elle soit en mesure d’y apporter une quelconque explication, caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Chronopost, l’arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
|
Seconde espèce Sur le moyen unique, qui est recevable : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003), que le 31 décembre 1998, la société Dubosc et Landowski (société Dubosc) a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes ; que le dossier qui aurait dû parvenir au jury avant le 4 janvier 1999, a été livré le lendemain ; que la société Dubosc, dont la candidature n’a pu de ce fait être examinée, a assigné la société Chronopost en réparation de son préjudice ; que cette dernière a invoqué la clause limitative d’indemnité pour retard figurant au contrat-type annexé au décret du 4 mai 1988 ; Attendu que la société Dubosc fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, “que l’arrêt relève que l’obligation de célérité, ainsi que l’obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s’analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l’inexécution d’une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d’effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s’exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu’en décidant que faute d’établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu’à l’indemnisation du prix du transport, la cour d’appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988″ ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; Qu’ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il convenait de limiter l’indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
?Faits
- Dans la première espèce
- Une société qui avait décidé de concourir à un appel d’offres ouvert par la ville de Calais et devant se clôturer le lundi 25 mai 1999 à 17 h 30, a confié à la société Chronopost, le vendredi 22 mai 1999 l’acheminement de
- Sa candidature n’est cependant parvenue à destination que le 26 mai 1999 en raison d’un retard dans l’acheminement du pli.
- Dans la seconde espèce
- Une société a confié à la société Chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant son dossier de candidature à un concours d’architectes.
- Le dossier devait parvenir au jury avant le 4 janvier 1999.
- Toutefois, il n’est délivré que le lendemain.
?Demande
Dans les deux arrêts, les clients de la société Chronopost demandent réparation du préjudice occasionné du fait du retard de livraison du pli confié au transporteur
?Procédure
- Première espèce
- Par un arrêt du 24 mai 2002, la Cour d’appel de Paris accède à la requête du client de la société Chronopost.
- Les juges du fond estiment que le plafond d’indemnisation prévu au contrat-type messagerie devait être écarté dans la mesure où le retard d’acheminement du pli qui avait été confié à la société Chronopost « caractérise une négligence d’une extrême gravité, constitutive d’une faute lourde et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée ».
- Seconde espèce
- Par un arrêt du 7 février 2003, la Cour d’appel de Versailles déboute le client de la société Chronopost de sa demande.
- Les juges du fond estiment dans cette espèce que si l’obligation de livrer dans les délais le pli confié au transporteur constitue une obligation essentielle du contrat, le manquement à cette obligation ne suffit pas à caractériser une faute lourde.
- Dès lors, pour la Cour d’appel de Versailles, il n’y a pas lieu d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par le décret qui réglemente les contrats-type messagerie.
?Solution
Tandis que dans la première espèce, la Chambre mixte casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel, dans la seconde le pourvoi formé par le client de la société Chronopost est rejeté.
Deux enseignements peuvent être tirés des deux arrêts rendus le même jour par la chambre mixte le 22 avril 2005 :
- Définition de la faute lourde
- La Cour de cassation répond à l’interrogation née de l’arrêt du 9 juillet 2002 : la définition de la faute lourde
- Aussi, dans la deuxième espèce jugée par la chambre mixte, la faute lourde est définie comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté ».
- La faute lourde comprendrait donc deux éléments :
- Un élément subjectif : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
- Un élément objectif : l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.
- Faute lourde et manquement à l’obligation essentielle
- Dans la première espèce la Cour de cassation estime que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat-type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissements sur la cause du retard » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°02-18.326).
- Dans la seconde espèce, la haute juridiction affirme encore que « la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l’engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l’existence d’une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison » (Cass. ch. mixte, 22 avril 2005, n°03-14.112).
- En d’autres termes, il résulte des deux arrêts rendus par la chambre mixte le 22 avril 2005 que le simple manquement à une obligation essentielle du contrat ne saurait caractériser à lui seul une faute lourde
- Pour que la faute lourde soit retenue, il aurait fallu que soit établie, en plus, l’existence d’un élément subjectif : le comportement d’une extrême gravité confinant au dol.
- Ainsi, était-il nécessaire de démontrer que la société Chronopost avait délibérément livré le pli qui lui a été confié en retard, ce qui n’était évidemment pas le cas en l’espèce.
- D’où le refus de la Cour de cassation d’écarter le plafond légal d’indemnisation prévu par le décret du 4 mai 1988.
- La chambre mixte a dès lors fait le choix d’une approche extrêmement restrictive de la faute lourde, à tel point que les auteurs se sont demandé si cela ne revenait pas à exclure toute possibilité d’écarter le plafond légal d’indemnisation en raison de l’impossibilité de rapporter la preuve de la faute lourde.
iv. Quatrième acte : Arrêt Chronopost du 30 mai 2006
|
Arrêt Chronopost IV (Cass. com. 30 mai 2006) Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l’article 1131 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que deux montres, confiées par la société JMB International à la société Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport ; que la société JMB International a contesté la clause de limitation de responsabilité que lui a opposée la société Chronopost ; Attendu que pour débouter la société JMB International de toutes ses demandes, l’arrêt retient que celle-ci, qui faisait valoir le grave manquement de la société Chronopost à son obligation essentielle d’acheminement du colis à elle confié, avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté ; Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a dit que l’action de la société JMB International était recevable et n’était pas prescrite, l’arrêt rendu le 11 mars 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris |
- Faits
- Deux montres, confiées par une société au transporteur Chronopost pour acheminement à Hong Kong, ont été perdues pendant ce transport.
- Demande
- La société cliente engage la responsabilité de Chronopost.
- Au soutien de sa demande, elle avance que la clause limitative de responsabilité dont se prévaut le transporteur ne lui est pas opposable.
- Procédure
- Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour d’appel de Paris déboute le client de la société Chronopost de toutes ses demandes.
- Étonnamment, les juges du fond adoptent une solution pour le moins différente de la jurisprudence initiée par la Cour de cassation dix ans plus tôt.
- Ils considèrent que, en confiant un pli à la société Chronopost pour qu’elle l’achemine jusqu’à son destinataire, elle « avait nécessairement admis, en déclarant accepter les conditions générales de la société Chronopost, le principe et les modalités d’une indemnisation limitée en cas de perte du colis transporté »
- La clause limitative de responsabilité était, dans ces conditions, parfaitement applicable à la société cliente.
- Ainsi, la Cour d’appel refuse-t-elle d’apprécier la validité de la clause limitative de responsabilité en se demandant si elle ne portait pas atteinte à une obligation essentielle, ni même si la société Chronopost n’avait pas manqué à son obligation de délivrer le pli dans le délai prévu par le contrat.
- Solution
- Par un arrêt du 30 mai 2006, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 30 mai 2006, n°04-14.974).
- Sans surprise, la chambre commerciale reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la clause limitative d’indemnisation dont se prévalait la société Chronopost, qui n’était pas prévue par un contrat-type établi par décret, ne devait pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat »
- Ainsi, la haute juridiction fait-elle une exacte application de la solution dégagée dans le premier arrêt Chronopost rendu le 22 octobre 1996.
v. Cinquième acte : Arrêt Chronopost du 13 juin 2006
|
Arrêt Chronopost V (Cass. com. 13 juin 2006) Sur le moyen unique : Vu l’article 1150 du code civil, l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et les articles 1er, 22-2, 22-3 du décret 99-269 du 6 avril 1999, applicable en la cause ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Dole froid service a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi” ; que ce délai n’ayant pas été respecté, la société Dole froid service, dont l’offre n’a pu être examinée, a assigné la société Chronopost service en réparation de son préjudice ; Attendu que pour dire inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et du contrat type messagerie applicables en la cause et condamner en conséquence la société Chronopost à payer à la société Dole froid service la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice, l’arrêt retient que la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Chronopost à verser à la société Dole froid service la somme complémentaire de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
- Faits
- Une société a confié à la société Chronopost l’acheminement d’un pli contenant une soumission pour un marché d’équipement de matériel de rafraîchissement et portant la mention : “livraison impérative vendredi avant midi”.
- Le délai de livraison n’ayant pas été respecté, l’offre n’a pu être examinée.
- Demande
- Le client de la société Chronopost engage sa responsabilité aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
- Procédure
- Par un arrêt du 2 décembre 2004, la Cour d’appel de Paris accède à la demande du demandeur en déclarant le plafond légal d’indemnisation inapplicable,
- La Cour d’appel relève pour ce faire que « la société Chronopost, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, s’était obligée de manière impérative à faire parvenir le pli litigieux le vendredi avant midi à Champagnole, localité située à 25 kilomètres du lieu de son expédition, où il avait été déposé la veille avant 18 heures, qu’elle n’avait aucune difficulté à effectuer ce transport limité à une très courte distance et que, au regard de ces circonstances, sa carence révèle une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission qu’il avait acceptée »
- Elle en déduit que, en l’espèce, la faute lourde ce qui, conformément à l’ancien article 1150 du Code civil, rendait inapplicable la clause légale de limitation de responsabilité du transporteur résultant de l’article 8, paragraphe II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
- Solution
- Par un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond notamment au visa de l’article 1150 du Code civil (Cass. com. 13 juin 2006, n°05-12.619).
- La chambre commerciale réitère ici la solution dégagée par la chambre mixte le 22 avril 2005 en affirmant que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».
- Or en l’espèce, le seul manquement susceptible d’être reproché au transporteur était de n’avoir pas exécuté son obligation essentielle, de sorte que cela n’était pas suffisant pour caractériser une faute lourde.
- Pour y parvenir, la Cour de cassation rappelle que cela suppose de démontrer d’adoption par le transporteur d’un comportement d’une extrême gravité confinant au dol.
a.2 L’épilogue de la saga Chronopost : les arrêts Faurecia
La saga des arrêts Chronopost a donné lieu à un épilogue qui s’est déroulé en deux actes.
i. Premier acte : arrêt Faurecia du 13 février 2007
|
Arrêt Faurecia I (Cass. com. 13 févr. 2007) Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; […] Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l’article 1131 du code civil ; Attendu que, pour limiter les sommes dues par la société Oracle à la société Faurecia à la garantie de la condamnation de cette société au paiement de la somme de 203 312 euros à la société Franfinance et rejeter les autres demandes de la société Faurecia, l’arrêt retient que la société Faurecia ne caractérise pas la faute lourde de la société Oracle qui permettrait d’écarter la clause limitative de responsabilité, se contentant d’évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caractériser ce que seraient les premiers et les secondes et dès lors que de tels manquements ne peuvent résulter du seul fait que la version V 12 n’ait pas été livrée ou que l’installation provisoire ait été ultérieurement “désinstallée” ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait, d’abord, constaté que la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE |
?Faits
La société Faurecia a souhaité déployer sur ses sites en 1997 un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale
Conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999
Des contrats de licence, de maintenance et de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en œuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte
Dans l’attente de la livraison de la livraison du nouveau logiciel, une solution provisoire a été installée
Toutefois, cette solution provisoire ne fonctionnait pas correctement et la version V 12 du logiciel n’était toujours pas livrée.
La société Faurecia a dès lors cessé de régler les redevances dues à son fournisseur, la société Oracle, laquelle avait, entre-temps, cédé ses droits à la société Franfinance.
?Demande
La société Faurecia assigne alors la société Oracle ainsi que la société Deloitte aux fins d’obtenir la nullité des contrats conclus pour dol et subsidiairement leur résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties.
?Procédure
Par un arrêt du 31 mars 2005, la Cour d’appel de Versailles a estimé que l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société Faurecia en réparation de son préjudice devait être limitée au montant prévu par la clause limitative de responsabilité.
Cette clause trouvait, en effet, pleinement à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la société Faurecia ne caractérisait pas la faute lourde de la société Oracle.
Les juges du fond avancent au soutien de cette affirmation que, non seulement la société Faurecia n’établit aucun des manquements aux obligations essentiels reprochés à la société Oracle, mais encore que ces manquements ne sauraient résulter du seul fait que le logiciel ne lui a pas été livré, ni que l’installation provisoire ait été ultérieurement désinstallée.
La solution de la Cour d’appel était ainsi, en tous points, conforme à la jurisprudence Chronopost de la Cour de cassation.
?Solution
Par un arrêt du 13 février 2007, la chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles au visa de l’article 1131 du Code civil (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).
Après avoir relevé que « la société Oracle s’était engagée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu’elle n’avait exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure, puis relevé qu’il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V 12 », la cour de cassation considère que le manquement reproché à la société Oracle portait sur une obligation essentielle.
Or elle estime que pareil manquement « est de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt Faurecia I.
- En premier lieu
- Dès lors qu’une clause vient limiter la responsabilité du débiteur d’une obligation essentielle, elle doit être réputée non écrite.
- Les clauses limitatives de responsabilité seraient, en somme, sans effet dès lors que le manquement reproché à une partie porterait sur une obligation essentielle.
- En second lieu
- Le seul manquement à une obligation essentielle suffit à caractériser la faute lourde.
- Il s’agit donc de la solution radicalement opposée à celle adoptée par la Cour de cassation, par deux fois, dans ses arrêts du 22 avril 2005 et du 13 juin 2006.
- Sur ce point, la chambre commerciale opère donc un revirement de jurisprudence.
- Désormais, le simple manquement est suffisant quant à faire échec à la clause limitative de responsabilité.
- Il n’est plus besoin de rapporter la preuve d’un comportement d’une extrême gravité imputable au débiteur de l’obligation essentielle.
?Analyse
La position adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt Faurecia I a été unanimement critiquée par la doctrine.
Les auteurs ont reproché à la chambre commerciale d’avoir retenu une solution « liberticide » en ce sens que cela revenait à priver les parties de la possibilité de stipuler une clause limitative de responsabilité dès lors qu’une obligation essentielle était en jeu.
L’application de cette jurisprudence aurait conduit, en effet, à considérer que seules les obligations accessoires au contrat pouvaient désormais faire l’objet d’une limitation de responsabilité, ce qui n’est pas sans porter atteinte à la liberté contractuelle des parties.
La Cour de cassation s’est, de la sorte, écartée de la solution dégagée dans l’arrêt Chronopost I où elle avait décidé que la clause limitative de responsabilité ne devait être réputée non écrite qu’à la condition que ladite clause prive la portée de l’engagement pris.
Dans l’arrêt Faurecia I, la chambre commerciale ne formule pas cette exigence.
Elle se satisfait de la seule présence dans le contrat, d’une clause limitative de responsabilité susceptible d’être activée en cas de manquement à une obligation essentielle.
Animée d’une volonté d’encadrer le recours aux clauses limitatives de responsabilité la Cour de cassation est, à l’évidence, allée trop loin.
Aussi, un retour à la solution antérieure s’est très rapidement imposé.
ii. Second acte : arrêt Faurecia du 29 juin 2010
|
Arrêt Faurecia II (Cass. com. 29 juin 2010) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu’elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre ces sociétés ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d’appel a, par application d’une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia ; que cet arrêt a été partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 février 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus dans les termes de l’article 1154 à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Faurecia fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : […] Mais attendu que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; que l’arrêt relève que si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications ; que la cour d’appel en a déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Faurecia fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’après avoir constaté que la société Oracle n’avait pas livré la version V 12, en considération de laquelle la société Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu’elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne démontrait aucune faute imputable à la société Faurecia qui l’aurait empêchée d’accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d’appel a jugé que n’était pas rapportée la preuve d’une faute d’une gravité telle qu’elle tiendrait en échec la clause limitative de réparation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ; Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que les deuxième et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
?Faits / procédure
Après que dans l’arrêt Faurecia I, la Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Versailles, l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris.
Par un arrêt du 26 novembre 2008, les juges parisiens, qui donc statuent sur renvoi, décident de résister à la chambre commerciale.
Ils estiment, en effet, que la clause limitative de responsabilité était pleinement applicable en l’espèce, conformément à la solution qui avait été adoptée par la première Cour d’appel qui avait été saisie.
?Solution
Par un arrêt du 29 juin 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société Faurecia contre la décision de la Cour d’appel de Paris (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841).
Deux questions étaient soumises à la chambre commerciale :
- Première question : la clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle doit-elle être réputée non-écrite ?
- À cette question, la Cour de cassation répond par la négative.
- Elle affirme en ce sens que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur »
- Ainsi, la Cour de cassation renoue-t-elle à la solution classique dégagée dans l’arrêt Chronopost I.
- Pour qu’une clause limitative de responsabilité soit annulée, elle doit vider de sa substance l’obligation essentielle.
- Dans le cas contraire, elle demeure valide.
- En l’espèce, la Chambre commerciale relève que « si la société Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l’indemnisation négocié aux termes d’une clause stipulant que les prix convenus reflètent la répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en résultait, n’était pas dérisoire, que la société Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat prévoit que la société Faurecia sera le principal représentant européen participant à un comité destiné à mener une étude globale afin de développer un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d’un statut préférentiel lors de la définition des exigences nécessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d’Oracle pour la version V 12 d’Oracles applications »
- Elle en déduit que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle
- Rien ne justifiait donc que ladite clause soit réputée non-écrite.
- Seconde question : le manquement à une obligation essentielle est-il constitutif d’une faute lourde ?
- La Cour de cassation renoue là aussi avec la solution antérieure.
- Elle affirme que « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur »
- Le seul manquement à une obligation essentielle ne suffit donc pas à caractériser une faute lourde.
- Il est nécessaire de démontrer l’existence d’un comportant d’une extrême gravité confinant au dol imputable au débiteur de l’obligation essentielle.
- Or en l’espèce, la société Oracle n’a pas rapporté la preuve d’une telle faute.
Au total, avec l’arrêt Faurecia II la Cour de cassation renoue avec la jurisprudence Chronopost dont elle s’était écartée dans l’arrêt Faurecia I.
Le législateur n’a pas manqué de saluer ce revirement en consacrant la solution adoptée dans l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1170 du Code civil.
b. La consécration légale de la jurisprudence Chronopost et Faurecia
Aux termes de l’article 1170 du Code civil « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »
Ainsi, le législateur a-t-il entendu consacrer la jurisprudence initiée par l’arrêt Chronopost I, puis qui s’est conclue sur l’arrêt Faurecia II.
Plusieurs observations peuvent être formulées au sujet de la règle introduite par l’ordonnance du 10 février 2016 dans le Code civil.
?Sur le domaine d’application de la règle
Il peut tout d’abord être observé que, de par sa généralité, l’application de la règle édictée à l’article 1170 n’est pas cantonnée au domaine des clauses limitatives de responsabilité.
Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute clause qui porterait atteinte à une obligation essentielle du contrat.
On peut ainsi envisager que cela concerne, par exemple les clauses de non-concurrence qui seraient stipulées sans contrepartie.
Il peut encore s’agir des clauses dites de réclamation insérées dans les contrats d’assurance vie aux termes desquelles la victime d’un sinistre doit, pour être indemnisée par son assureur, présenté sa réclamation pendant la durée de validité du contrat. À défaut, la clause a pour effet de priver l’assuré de l’indemnisation d’un sinistre alors même que celui-ci est survenu pendant la durée d’efficacité du contrat et que les primes d’assurance ont été dûment réglées.
?Sur les conditions d’application de la règle
L’application de la règle édictée à l’article 1170 du Code civil est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :
- L’existence d’une obligation essentielle
- Le législateur a repris à son compte la notion d’obligation essentielle dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Chronopost I
- Que doit-on entendre par obligation essentielle ?
- L’ordonnance du 10 février 2016 ne le dit pas.
- Une ébauche de définition a été donnée par Pothier qui, dès le XVIIIe siècle, décrivaient les obligations essentielles comme celles « sans lesquelles le contrat ne peut subsister. Faute de l’une ou de l’autre de ces choses, ou il n’y a point du tout de contrat ou c’est une autre espèce de contrat ».
- Il s’agit, autrement dit, de l’obligation en considération de laquelle les parties se sont engagées.
- Ainsi, la réalisation de l’opération économique envisagée par les parties dépend de l’exécution de l’obligation essentielle.
- Elle constitue, en somme, le pilier central autour duquel l’édifice contractuel tout entier est bâti.
- La stipulation d’une clause qui viderait de sa substance l’obligation essentielle
- L’ordonnance d’une 10 février 2016 conditionne l’annulation d’une clause sur le fondement de l’article 1170 du Code civil qu’à la condition qu’elle « prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur »
- Ainsi, le législateur a-t-il choisi de reprendre à l’identique la solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Faurecia II ?
- Pour mémoire, dans l’arrêt Faurecia I, la Chambre commerciale avait estimé que dès lors qu’une clause limitative de responsabilité portait sur une obligation essentielle elle devait être réputée non écrite (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).
- Sous le feu des critiques, la Cour de cassation a été contrainte de revoir sa position dans l’arrêt Faurecia II.
- Dans cette décision, elle choisit de renouer avec la jurisprudence Chronopost en affirmant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur » (Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841).
- Si, indéniablement, l’article 1170 consacre cette solution, reste néanmoins une question en suspens : que doit-on entendre par « substance » ?
- Plus précisément, qu’est-ce qu’une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle ?
- Dans l’arrêt Chronopost, la Cour de cassation s’était placée sur le terrain de la cause pour justifier sa solution.
- Elle estimait, en effet, que la mise en œuvre de la clause limitative de responsabilité conduisait à priver de son intérêt l’utilité de l’opération économique convenue par les parties : l’acheminement du pli confié au transporteur dans un bref délai.
- La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si le législateur a entendu assimiler la privation de l’obligation essentielle de sa substance à l’absence de cause, telle que, envisagée dans l’arrêt Chronopost, soit dans sa conception subjective ?
- Si l’on compare les expressions « substance de l’obligation » (art. 1170) et « portée de l’obligation » (arrêt Chronopost), il apparaît que le sens de chacune d’elles est sensiblement différent.
- Le terme substance renvoie à l’idée de contenu de l’obligation : en quoi consiste la prestation convenue par les parties ?
- Le terme de portée renvoie quant à lui à l’idée de cause de l’obligation : pourquoi les contractants se sont-ils engagés ?
- Aussi, selon que l’on raisonne sur la base de l’un ou l’autre terme, le champ d’application de l’article 1170 du Code civil est susceptible d’être plus ou moins étendu.
- Si l’on s’en tient à la lettre de l’article 1170, ne pourront être pris en considération que les éléments prévus dans le contrat pour apprécier la validité d’une clause qui affecterait une obligation essentielle
- Si en revanche, l’on s’écarte de la lettre de l’article 1170 à la faveur d’une conception finaliste, pourront alors être pris en compte, les mobiles des parties, telle que l’utilité de l’opération économique envisagée individuellement par elles.
- Pratiquement, la seconde conception offre, de toute évidence, une bien plus grande marge de manœuvre au juge qui pourra, pour apprécier la validité de la clause affectant une obligation essentielle, se référer à des éléments extérieurs au contrat : les mobiles des parties.
?La sanction de la règle
Le législateur a décidé d’étendre la sanction prévue initialement pour les seules clauses abusives, aux clauses qui portent atteinte à une obligation essentielle du contrat : elles sont réputées non-écrite.
Cela signifie que, non seulement la clause est privée d’effet, mais encore qu’elle disparaît du contrat.
La conséquence en est un retour immédiat au droit commun qui s’appliquera à la situation juridique, initialement réglée par les parties, mais qui, sous l’effet de la sanction du juge, est devenue orpheline de tout cadre contractuel.
Est-ce à dire que, dans les différents arrêts Chronopost la suppression de la clause limitative de responsabilité permettrait aux clients d’être indemnisés de leurs préjudices ?
S’agissant de ce cas spécifique, la réponse ne peut être que négative.
Le droit commun a prévu que, en matière de contrat-type message, l’indemnisation du préjudice en cas de retard de livraison du pli ne peut excéder un certain plafond, soit celui-là même fixé par la société Chronopost.
Une suppression de la clause serait donc inopérante, sauf à ce que le client soit susceptible d’établir une faute lourde à l’encontre du transporteur, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (V. notamment l’arrêt Faurecia II : Cass. com. 29 juin 2010, n°09-11.841).
3. La neutralisation des effets des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Plusieurs moyens de droit sont susceptibles d’être invoqués aux fins de neutraliser les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité.
a. Les moyens de droit tirés de l’opposabilité de la clause
Pour être opposables, les clauses qui aménagent la responsabilité contractuelle doivent avoir été stipulées dans le contrat et acceptées par le cocontractant.
L’article 1119 du Code civil dispose en ce sens que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
Il en résulte que la clause doit être insérée dans la documentation contractuelle et être lisible. S’il est admis qu’elle puisse figurer sur une facture, c’est à la condition qu’il soit établi que la partie contre laquelle elle est stipulée en a eu connaissance et qu’elle y a consenti.
Certaines juridictions ont pu déduire ce consentement, dans le cadre de relations d’affaires, de l’absence de contestation du cocontractant dans un certain délai.
Lorsque, par ailleurs, la clause est contredite par des mentions manuscrites ou des courriers échangés entre les parties, la Cour de cassation considère qu’elle est de pur style, en conséquence de quoi elle est privée d’effet.
Dans un arrêt du 14 octobre 2008, la chambre commerciale a ainsi jugé que « c’est sans dénaturation des conclusions de la société LCI mais par une interprétation souveraine de la portée de la mention “sans reconnaissance de responsabilité de la part des armateurs” que la cour d’appel, en relevant que cette mention était contredite par les courriers échangés, en a déduit qu’elle n’était qu’une clause de style dépourvue de valeur juridique » (Cass. com. 14 oct. 2008, n°07-18.955).
Enfin, en cas de discordance entre clauses contractuelles, l’interprétation du contrat doit se faire à la lumière des alinéas 2 et 3 de l’article 1119 du Code civil qui prévoient que :
- D’une part, « en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. »
- D’autre part, « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »
Pour produire ses pleins effets, une clause limitative ou exonératoire de responsabilité doit ainsi, non seulement, être dépourvue de toute ambiguïté quant à sa formulation, mais encore ne pas être contredite par une autre clause du contrat, voire par les échanges qui ont pu intervenir entre les parties dans le cadre de la conclusion de l’acte.
b. Les moyens de droit tirés de la faute lourde ou dolosive
En application de l’article 1231-3 du code civil, les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité peuvent être neutralisés en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier de l’obligation violée étant alors fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice.
Très tôt, la jurisprudence a abondé en ce sens. Dans un arrêt du 15 juin 1959 la Cour de cassation a, par exemple, jugé que « seuls le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d’irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l’autre partie, peuvent faire échec à l’application de ladite clause » (Cass. com., 15 juin 1959, n° 57-12.362)
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par faute dolosive et faute lourde.
Si les textes sont silencieux sur ce point, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l’imprudence délibérée dans ce cas confinant à l’intention. »
C’est donc vers la jurisprudence antérieure qu’il convient de se tourner pour déterminer ce que l’on doit entendre par faute lourde et par faute dolosive.
La différence entre les deux fautes tient, en substance, à l’intention de l’auteur de la faute :
- La faute lourde
- Elle est définie par la jurisprudence, selon la formule consacrée, comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté » (V. en ce sens Cass. Ch. Mixte 22 avr. 2005, n° 03-14.112).
- La faute lourde comprend donc deux éléments :
- Un élément subjectif : le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
- Un élément objectif: l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.
- La faute dolosive
- Elle est définie quant à elle comme l’inexécution délibérée, et donc volontaire, des obligations contractuelles.
- À cet égard dans un arrêt du 27 juin 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le constructeur […] est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles » (Cass. 3e civ. 27 juin 2001, n°99-21.017).
- Il ressort de la jurisprudence que la faute dolosive suppose que le débiteur ait seulement voulu manquer à ses obligations contractuelles. Il est indifférent qu’il ait voulu causer un préjudice à son cocontractant.
Nonobstant la différence qui existe entre ces deux notions, la faute lourde est régulièrement assimilée à la faute dolosive par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation a ainsi rappelé que « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité » (Cass. 1ère civ. 29 oct. 2014, n°13-21.980).
L’assimilation de la faute lourde à la faute dolosive aurait, selon le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, été reconduite par le législateur, de sorte que les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure sont toujours valides.
En tout état de cause, lorsque la faute lourde ou la faute dolosive sont caractérisées, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité est écartée à la faveur du principe de réparation intégrale qui trouve alors à s’appliquer.
- J. Carbonnier, Droit civil : les biens, les obligations, éd. PUF, coll. « Quadrige », 2004, t. 2, n°1094, p. 2222 ?
- J. Béguin, Rapport sur l’adage “nul ne peut se faire justice soi-même” en droit français, Travaux Association H. Capitant, t. XVIII, p. 41 s ?
- D. Mazeaud, La notion de clause pénale, LGDJ, coll. « bibliothèque de droit privé », 1992, n°495, p. 287 et s. ?
- J. Mestre, obs. RTD civ. 1985, p. 372 s ?
- D. Mazeaud, op. cit., n°630, p. 359 ?
-
F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil : les obligations, 9e éd. Dalloz, coll. « Précis droit privé », 2005, n°624, p. 615 ?