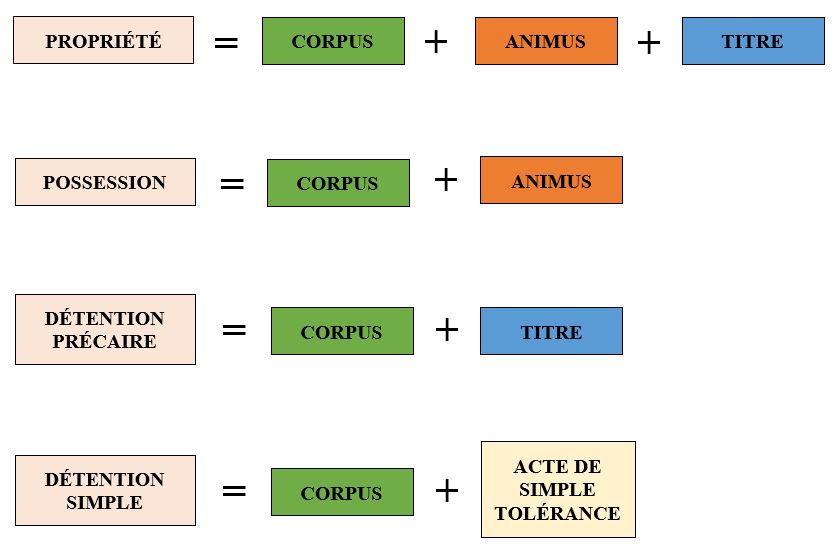==> Notion
L’usufruit est défini à l’article 578 du Code civil comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
L’usufruitier dispose ainsi d’un droit réel d’usage et de jouissance sur la chose d’autrui, par le jeu d’un démembrement de la propriété.
Ce démembrement s’opère comme suit :
- L’usufruitier recueille temporairement dans son patrimoine l’usus et le fructus qui, à sa mort, en vocation à être restitués au nu-propriétaire sans pouvoir être transmis aux héritiers
- Le nu-propriétaire conserve, pendant toute la durée de l’usufruit, l’abusus qui, à la mort de l’usufruitier, se verra restituer l’usus et le fructus, recouvrant alors la pleine propriété de son bien
L’usufruit est, de toute évidence, le droit de jouissance le plus complet, en ce sens qu’il confère à l’usufruitier le droit de jouir des choses « comme le propriétaire lui-même ».
Cela implique donc que l’usufruitier peut, non seulement tirer profit de l’utilisation de la chose, mais encore en percevoir les fruits, notamment en exploitant le bien à titre commercial.
C’est là une différence majeure entre l’usufruitier et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation, ce dernier ne disposant pas du pouvoir de louer le bien. Il est seulement autorisé à en faire usage pour ses besoins personnels et ceux de sa famille.
Seule limite pour l’usufruitier quant à la jouissance du bien : pèse sur lui une obligation de conservation de la chose. Il ne dispose donc pas du pouvoir de la détruire ou de la céder.
==> Nature
L’usufruit confère à l’usufruitier un droit réel sur la chose, de sorte qu’il exerce sur elle un droit direct et immédiat.
La qualification de droit réel de l’usufruit est parfois contestée par certains auteurs. D’aucuns avancent, en effet, que si la nature de droit réel se conçoit parfaitement lorsqu’il porte sur une chose corporelle, il n’en va pas de même lorsqu’il a pour objet une chose incorporelle. Il y a, selon eux, une incompatibilité entre l’intangibilité de la chose et l’exercice d’un pouvoir direct et immédiat sur elle.
Cette thèse est, toutefois, selon nous inopérante, dans la mesure où l’incorporalité d’une chose ne fait nullement obstacle à ce que son propriétaire exerce sur elle une emprise qui, certes, ne sera pas physique, mais qui consistera à contrôler son utilisation.
Aussi, partageons-nous l’idée que le droit exercé par l’usufruitier sur la chose, présente un caractère réel.
À cet égard, la nature de ce droit dont est investi l’usufruitier permet de le distinguer du locataire qui est titulaire, non pas d’un droit réel, mais d’un droit personnel qu’il exerce contre son bailleur.
Pour mémoire, le droit personnel consiste en la prérogative qui échoit à une personne, le créancier, d’exiger d’une autre, le débiteur, l’exécution d’une prestation.
Il en résulte que le droit pour le preneur de jouir de la chose procède, non pas du pouvoir reconnu par la loi à l’usufruitier en application de l’article 578 du Code civil, mais de la conclusion du contrat de bail qui oblige le bailleur, conformément à l’article 1719 du Code civil, à délivrer au preneur la chose louée et lui assurer une jouissance paisible.
Le preneur est donc investi d’un droit qu’il exerce non pas directement sur le bien loué, mais contre le bailleur sur lequel pèse un certain nombre d’obligations en contrepartie du paiement d’un loyer.
À l’examen, la situation dans laquelle se trouvent l’usufruitier et le nu-propriétaire est radicalement différente.
Il n’existe entre l’usufruitier et le nu-propriétaire aucun lien contractuel, de sorte que, ni l’usufruitier, ni le nu-propriétaire n’ont d’obligations positives l’un envers l’autre.
La seule obligation qui pèse sur l’usufruitier est de conserver la substance de la chose, tandis que le nu-propriétaire doit s’abstenir de la détruire.
Aussi, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.
François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».
Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.
Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.)
==> Caractère temporaire
L’usufruit présente cette particularité d’être temporaire. C’est la raison pour laquelle un droit réel qui procéderait de la conclusion d’un contrat et qui ne serait assorti d’aucun terme extinctif ne pourrait pas être qualifié d’usufruit.
Aussi, en l’absence de stipulation particulière, l’usufruit est viager, soit s’éteint à cause de mort. Lorsqu’il est dévolu à une personne morale, sa durée est portée à 30 ans.
L’usufruit, a donc, en toute hypothèse, vocation à revenir au nu-propriétaire qui recouvra la pleine propriété de son bien.
À cet égard, c’est là le seul intérêt de la nue-propriété, le nu-propriétaire étant privé, pendant toute la durée de l’usufruitier de toutes les utilités de la chose (usus et fructus).
§1 : Le domaine de l’usufruit
A) L’objet de l’usufruit
L’usufruit peut tout autant porter sur un bien pris individuellement, que sur un ensemble de biens.
- L’usufruit porte sur un bien
L’article 581 du Code civil prévoit que l’usufruit « peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles. »
Il ressort de cette disposition que l’usufruit peut porter sur n’importe quel type de bien. Il est néanmoins soumis à des règles particulières lorsqu’il a pour objet une chose consomptible, d’où la nécessité d’envisager cette catégorie de choses séparément.
a) Les choses non-consomptibles
i) Les choses corporelles
Pour mémoire, les choses corporelles sont tout ce qui peut être appréhendé par les sens et qui est extérieur à la personne.
Elles ont, autrement dit, une réalité matérielle, en ce qu’elles peuvent être touchées physiquement. Tel est le cas d’une maison, d’un arbre, d’une pièce de monnaie, d’une table, un terrain, etc..
Les choses corporelles sont le terrain d’élection privilégié de l’usufruit, en ce que sa nature de droit réel trouve pleinement vocation à s’exprimer, en ce sens que l’usufruitier pourra exercer un pouvoir direct et immédiat sur la chose.
À cet égard, ainsi que l’écrivait Proudhon « considéré dans l’objet auquel il s’applique, l’usufruit emprunte le corps de la chose même qui doit être livrée à l’usufruitier pour qu’il en jouisse : la loi le place au rang des meubles ou immeubles, suivant qu’il est établi sur des choses mobilières ou immobilières ».
L’usufruit peut, de la sorte, consister tantôt en un droit réel mobilier, tantôt en un droit réel immobilier.
ii) Les choses incorporelles
Les choses incorporelles se distinguent des choses corporelles en ce qu’elles n’ont pas de réalité physique. Elles sont tout ce qui ne peut pas être saisi par les sens et qui est extérieur à la personne.
Parce qu’elles sont dépourvues de toute substance matérielle et qu’elles n’existent qu’à travers l’esprit humain, les choses incorporelles ne peuvent pas être touchées.
Il résulte qu’elles ne peuvent jamais être le fruit de la nature : elles sont toujours artificielles, soit le produit d’une activité humaine.
L’intangibilité des choses incorporelles ne fait pas obstacle à ce qu’elle fasse l’objet d’un usufruit.
Il est notamment admis que l’usufruit puisse porter sur :
- Des créations intellectuelles
- L’usufruit peut avoir pour objet une œuvre de l’esprit, un brevet d’invention ou encore une marque
- Dans cette hypothèse, l’usufruitier pourra tirer profit de l’exploitation commerciale des créations intellectuelles par l’exercice des droits patrimoniaux attachés à ces créations (reproduction, représentation, concession etc..)
- Un usufruit
- Rien n’interdit d’envisager la constitution d’un usufruit d’usufruit
- Cette situation correspond à l’hypothèse où un droit d’usage et d’habitation serait établi sur un usufruit
- Une créance
- L’usufruit peut porter sur une créance ce qui emportera pour conséquence d’obliger le débiteur à régler entre les mains, non pas du créancier, mais de l’usufruitier (V. en ce sens com., 12 juill. 1993, n° 91-15667).
- Encore faut-il que le débiteur ait été prévenu de la constitution d’un usufruit, ce qui soulève la problématique de son opposabilité.
- Pour être opposable au débiteur, cette constitution d’usufruit doit-elle lui être notifiée selon les formes prescrites par les règles qui régissent la cession de créance ?
- L’article 1324 du Code civil prévoit notamment que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte».
- Si la doctrine est partagée sur l’accomplissement de cette formalité, on ne voit pas comment l’usufruitier pourrait y échapper, ne serait-ce que s’il veut se prémunir d’un paiement entre les mains du créancier.
- Une rente
- L’article 588 du Code civil envisage la possibilité de constituer un usufruit sur une rente viagère.
- Cette disposition prévoit en ce sens que « l’usufruit d’une rente viagère donne aussi à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.»
- Par arrérages, il faut entendre le montant échu de la rente qui est versée périodiquement
- Des droits sociaux
- Il est admis que l’usufruit puisse porter sur des droits sociaux, peu importe qu’il s’agisse d’actions ou de parts sociales.
- L’article 1844 du Code civil envisage cette situation en prévoyant que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier».
- Il ressort de cette disposition que, le nu-propriétaire, conserve le droit de vote dont il demeure titulaire, à tout le moins pour les décisions les plus graves qui intéressent la société (modification des statuts), tandis que l’usufruitier est appelé à percevoir les dividendes.
- Ce dernier est également investi du pouvoir de se prononcer sur les décisions relatives à l’affectation des bénéfices (distribution ou mise en réserve).
- Cette prérogative de l’usufruitier a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 2004.
- Dans cette décision, la chambre commerciale a validé l’annulation d’une clause statutaire qui privait l’usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices et subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d’user de la chose grevée d’usufruit et d’en percevoir les fruits, alors que l’article 578 du Code civil attache à l’usufruit ces prérogatives essentielles ( com. 31 mars 2004, n°03-16694).
- Cette jurisprudence n’est pas sans avoir agité la doctrine, en particulier sur la question de savoir, qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier, endosse la qualité d’associé.
- La réponse à cette question a de véritables incidences pratiques, car elle permet de déterminer si l’usufruitier peut exercer l’action sociale ut singuli ou s’il peut encore formuler une demande de désignation de l’expert en gestion.
- A cet égard, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a précisé que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu’il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 22 févr. 2005, n°03-17421).
- Il ressort de cette disposition que les statuts sont susceptibles de prévoir que l’usufruitier est investi du droit de vote pour toutes les décisions auquel cas il se rapproche du statut d’associé.
- Des auteurs ont néanmoins interprété un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 29 novembre 2006 comme déniant à l’usufruitier la qualité d’associé ( 3e civ. 29 nov. 2006, n°05-17009).
- Dans un autre arrêt, cette fois-ci rendu par la chambre commerciale le 2 décembre 2008, les statuts d’une société civile avaient attribué l’intégralité du droit de vote à l’usufruitier.
- Ce dernier avait alors approuvé, en assemblée générale extraordinaire, le projet de fusion absorption de la société dont il détenait une partie des titres.
- L’un des nus-propriétaires, opposé à cette fusion, a assigné l’usufruitier en nullité de la délibération sociale ayant conduit à la fusion, en excipant l’illicéité de la clause statutaire qui réservait au seul usufruitier l’intégralité des droits de vote.
- Par un arrêt du 19 février 2008 la Cour d’appel de Caen a fait droit aux demandes du nu-propriétaire quant à déclarer illicite la clause statutaire octroyant l’intégralité des droits de vote à l’usufruitier et annuler la délibération litigieuse.
- La chambre commerciale de la Cour de cassation a néanmoins censuré cette décision au motif que « les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle, si une part est grevée d’usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, dès lors qu’ils ne dérogent pas au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives» ( com. 2 déc. 2008, n°08-13185).
- Quel enseignement tiré de cette décision ?
- En premier lieu, il est possible de priver le nu-propriétaire de son droit de vote à la condition qu’il puisse participer à la prise de décision ce qui concrètement implique qu’il puisse assister à la délibération et exprimer son avis.
- En second lieu, l’usufruitier semble être mis sur un même pied d’égalité que les autres associés puisque, alors même qu’il s’agit d’une décision qui intéresse la fusion absorption de la société, c’est à lui que revient le droit de voter et non au nu-propriétaire.
- Enfin, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir expliqué « en quoi l’usufruitier aurait fait du droit de vote que lui attribuaient les statuts un usage contraire à l’intérêt de la société, dans le seul dessein de favoriser ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés»
- Elle affirme donc, en creux, qu’il appartient à l’usufruitier d’agir dans l’intérêt de la société.
- Or n’est-ce pas là l’objectif assigné à tout associé ?
- D’aucuns considèrent que cet arrêt reconnaît à l’usufruitier la qualité d’associé et opère ainsi un revirement de jurisprudence si l’on se réfère à la décision du 29 novembre 2006.
- La décision rendue n’est toutefois pas sans comporter des zones d’ombre, raison pour laquelle il convient de rester prudent sur le sens à lui donner.
- Aussi, la question de l’octroi à l’usufruitier de la qualité d’associé demeure grande ouverte.
- Elle n’a encore jamais été clairement tranchée par la Cour de cassation.
b) Les choses consomptibles
Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.
Exemple : l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.
À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulève une difficulté qui tient à la fonction même de l’usufruit.
Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.
Si l’in appliquait cette règle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait à priver l’usufruitier d’en jouir et donc de vider le droit réel dont il est titulaire de sa substance.
C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisé à disposer de la chose, telle le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).
L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
La conséquence en est que le nu-propriétaire qui, de fait, perd l’abusus n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Il est un simple créancier de l’usufruitier.
2. L’usufruit porte sur un ensemble de biens
Tout autant que l’usufruit peut porter sur un bien, pris individuellement, il peut porter sur un ensemble de biens constitutif d’une universalité. Il est indifférent que cette universalité soit de fait ou de droit.
- L’usufruit d’une universalité de fait
- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une même finalité économique.
- Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale déterminée.
- Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire.
- Appliqué au fonds de commerce, cela signifie que, à l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur équivalente.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent le fonds de commerce (machines, outils, marchandises, matières premières etc.)
- L’usufruitier est ainsi autorisé à accomplir tous les actes de nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale (achat et vente de marchandises etc.)
- À cet égard, c’est lui qui percevra les bénéfices tirés de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualité de commerçant et qui, à ce titre, sera soumis à l’obligation d’immatriculation.
- L’usufruit d’une universalité de droit
- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne
- Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine.
- Selon le cas, il sera qualifié d’usufruit à titre universel ou d’usufruit à titre particulier.
- Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consécutivement à une dévolution successorale ou testamentaire.
- Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portée de l’usufruit est radicalement différente de la situation où il a pour objet une universalité de fait.
- En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituée par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
- La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
B) La durée de l’usufruit
Par nature, l’usufruit présente un caractère temporaire l’objectif recherché étant de permettre au nu-propriétaire de récupérer, à terme, les utilités de la chose, faute de quoi son droit de propriété serait vidé de sa substance et la circulation économique du bien paralysé.
Si, tous les usufruits présentent ce caractère temporaire, leur durée peut être, tantôt viagère, tantôt déterminée.
- L’usufruit à durée viagère
==> Principe
L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.
==> Tempéraments
Bien que l’interdiction qui est faite à l’usufruitier de transmettre son droit après sa mort soit une règle d’ordre public, elle comporte deux tempéraments
- Premier tempérament : l’usufruit simultané
- L’usufruit peut être constitué à la faveur de plusieurs personnes simultanément, ce qui revient à créer une indivision en usufruit.
- Cette constitution d’usufruit est subordonnée à l’existence de tous les bénéficiaires au jour de l’établissement de l’acte.
- Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteint progressivement à mesure que les usufruitiers décèdent, tandis que le nu-propriétaire recouvre corrélativement la pleine propriété de son bien sur les quotes-parts ainsi libérées
- Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se réduise au gré des décès qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de réversibilité.
- Dans cette hypothèse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prédécédé accroît celle des autres, qui en bénéficient pour la totalité, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
- Le dernier survivant a ainsi vocation à exercer un monopole sur l’usufruit du bien.
- Second tempérament : l’usufruit successif
- L’usufruit peut également être constitué sur plusieurs têtes, non pas simultanément, mais successivement.
- Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de réversibilité aux termes de laquelle au décès de l’usufruitier de « premier rang », une autre personne deviendra usufruitière en second rang.
- Dans cette hypothèse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose : ils se succéderont, le décès de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre.
- Chacun jouira ainsi, tout à tour, de l’intégralité de l’usufruit constitué.
- Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en présence « d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifié à l’autre» mais d’« usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour à tour, chacun à l’extinction du précédent par la mort de son titulaire ».
- La Cour de cassation a précisé que la clause de réversibilité de l’usufruit « s’analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte» ( 1ère civ. 21 oct. 1997, n°95-19759).
- Il en résulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est différé, non sa constitution, ce qui évite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future.
2. L’usufruit à durée déterminée
Il est deux situations où l’usufruit n’est pas viager : lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulé par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constitué à la faveur d’une personne morale
==> L’usufruit est assorti d’un terme stipulé par le constituant
Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme déterminé. Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteindra :
- Soit à l’expiration du terme fixé par l’acte constitutif
- Soit au décès de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixé
La seule limite à la liberté des parties quant à la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilité de transmettre l’usufruit à cause de mort.
==> L’usufruit est constitué au profit d’une personne morale
Dans l’hypothèse où l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’être perpétuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associés réalisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succéder éternellement, par le jeu, soit des transmissions à cause de mort, soit des cessions de droits sociaux.
Aussi, afin que la règle impérative qui assortit l’usufruit d’un caractère temporaire s’applique également aux personnes morales, l’article 619 du Code civil que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. »
Cette règle est d’ordre public, de sorte que la durée ainsi posée ne saurait être allongée. Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler, en jugeant que « l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans » (Cass. 7 mars 2007, n°06-12568).
§2 : La constitution de l’usufruit
A) Les modes de constitution de l’usufruit
L’article 579 du Code civil dispose que « l’usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l’homme. »
À ces deux modes de constitution de l’usufruit visés par le texte, on en ajoute classiquement un troisième : la prescription acquisitive.
- La loi
La loi prévoit plusieurs cas de constitution d’un usufruit sur un ou plusieurs biens :
- L’usufruit légal du conjoint survivant sur un ou plusieurs biens du de cujus
- Le droit de jouissance légale des parents sur les biens de leurs enfants mineurs
- Le droit de l’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire
==> L’usufruit légal du conjoint survivant
La loi a toujours octroyé au conjoint survivant un droit d’usufruit sur les biens du de cujus, lorsque celui-ci est en concours avec des descendants ou des descendants.
Sous l’empire du droit antérieur, ce droit d’usufruit était limité à une quote-part des biens du prédécédé.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001, les droits du conjoint survivant ont été renforcés.
En effet, l’article 757 du Code civil dispose que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de distinguer selon que le conjoint survivant est ou non en présence d’enfants communs.
- En présence d’enfants communs
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant, il dispose d’une option :
- Soit il peut réclamer un droit d’usufruit sur la totalité du patrimoine du de cujus
- Soit il peut obtenir un quart en pleine propriété des biens de cujus
- S’il opte pour l’usufruit, cette solution permet au conjoint survivant de se maintenir dans son cadre de vie habituel, sans préjudicier aux droits des héritiers du de cujus, en particulier des enfants.
- En l’absence d’enfants communs
- Le conjoint survivant ne disposera d’aucune option, il ne pourra revendiquer qu’un quart des biens du de cujus en pleine propriété.
- Il s’agit ici d’éviter de préjudicier aux enfants qui ne seraient pas issus de cette union
- Le droit d’option est également refusé au conjoint survivant s’il vient en concours avec les père et mère
- L’article 757-1 du Code civil prévoit en ce sens que si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens.
- L’autre moitié est alors dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
- Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant.
- Enfin, en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ( 752-2 C. civ.)
==> Le droit de jouissance légale des parents
L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.
Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration. »
La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens Cass. civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.
À cet égard, l’article 386-2 précise que le droit de jouissance cesse :
- Soit dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
- Soit par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ;
- Soit par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
L’article 386-3 ajoute que, les charges de cette jouissance sont :
- Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
- La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ;
- Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
En contrepartie, les parents perçoivent les fruits civils, naturels ou industriels que peuvent produire les biens de l’enfant (encaissement des loyers, des intérêts d’un compte rémunéré etc.).
Enfin, l’article 383-4 parachève le régime du droit de jouissance légale conféré aux parents en prévoyant que certains biens sont exclus de son périmètre, au nombre desquels figurent :
- Les biens que l’enfant peut acquérir par son travail ;
- Les biens qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n’en jouiront pas ;
- Les biens qu’il reçoit au titre de l’indemnisation d’un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
==> L’époux bénéficiaire d’une prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270, al. 2 du Code civil « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. »
Ainsi, dans le cadre des mesures qui accompagnent un divorce,
Le juge peut octroyer une prestation compensatoire à un époux, laquelle vise à compenser la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux.
Le principe posé par la loi est que cette prestation compensatoire doit être octroyée sous forme de capital
L’article 270, al. 2 prévoit en ce sens que la prestation compensatoire « a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge »
Pour que le principe de versement d’une prestation compensatoire sous forme de capital puisse être appliqué efficacement, le législateur a prévu d’encourager le versement en numéraire tout en diversifiant les formes de paiement de ce capital, notamment en autorisant l’abandon d’un bien en pleine propriété.
À cet égard, l’article 274 du Code civil prévoit que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes:
- Soit versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
- Soit attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
Cette disposition a été adoptée afin de diversifier les formes d’attribution d’un capital et de permettre au débiteur qui ne dispose pas de liquidités suffisantes d’abandonner ses droits en propriété sur un bien mobilier ou immobilier propre, commun ou indivis.
Il peut également préférer céder à son conjoint un droit d’usufruit sur le logement de famille pendant une durée qui peut être soit temporaire, soit viagère.
En tout état de cause, il appartiendra au juge, qui a l’obligation de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital, de procéder à une évaluation de l’usufruit.
La Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler cette règle dans un arrêt du 22 mars 2005 aux termes duquel elle a affirmé que « lorsque le juge alloue une prestation compensatoire sous forme d’un capital il doit quelles qu’en soient les modalités en fixer le montant » (Cass. 1ère civ. 22 mars 2005, n°02-18648).
2. La volonté de l’homme
En application de l’article 579 du Code civil, l’usufruit peut être établi, nous dit le texte, « par la volonté de l’homme ».
Par volonté de l’homme, il faut entendre, tout autant l’accomplissement d’un acte unilatéral, que la conclusion d’une convention.
- L’usufruit par acte unilatéral
- Cette hypothèse correspond à l’établissement par le propriétaire d’un testament aux termes duquel il gratifie un ou plusieurs bénéficiaires d’un droit d’usufruit sur un bien ou sur tout ou partie de son patrimoine
- Il peut ainsi consentir un usufruit à un légataire désigné et réserver la nue-propriété à ses héritiers ab intestat (légaux)
- En la matière, le disposant dispose d’une relativement grande liberté sous réserve de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
- Pour mémoire, cette réserve héréditaire consiste en « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. » ( 912 C. civ.)
- Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public ( req., 26 juin 1882).
- Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
- C’est sur cette quotité disponible que le disposant aura toute liberté pour constituer un ou plusieurs usufruits
- L’usufruit par acte conventionnel
- Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par convention à titre gratuit (donation) ou onéreux (cession)
- L’usufruit peut alors être constitué selon deux schémas différents
- Constitution de l’usufruit per translationem
- Dans cette hypothèse, le propriétaire aliène directement l’usufruit (usus et fructus) en conservant la nue-propriété (abusus)
- Constitution de l’usufruit per deductionem
- Dans cette hypothèse, le propriétaire se réserve l’usufruit, tandis qu’il aliène la nue-propriété
- Le plus souvent l’usufruit sera constitué selon le second schéma, l’objectif recherché étant, par exemple, pour des parents, de consentir à leurs enfants une donation de leur vivant, tout en conservant la jouissance du bien transmis.
- La constitution d’un usufruit par convention n’est subordonnée à l’observation d’aucunes particulières, sinon celles qui régissent la validité des actes juridiques et la publicité foncière lorsque l’usufruit est constitué sur un immeuble.
- Reste qu’il convient de distinguer selon que la constitution procède d’une donation ou d’une cession
- La constitution d’usufruit à titre gratuit
- Dans cette hypothèse, la constitution procédera d’une donation, ce qui implique qu’elle doit, d’une part, faire l’objet d’une régularisation par acte authentique, et, d’autre part, satisfaire aux règles du droit des successions.
- En effet, en cas de donation excessive, la constitution d’usufruit pourra donner lieu à des restitutions successorales, notamment au titre de la réserve héréditaire à laquelle il serait porté atteinte ou au titre de l’égalité qui préside au partage de cette réserve héréditaire
- La constitution d’usufruit à titre onéreux
- Le propriétaire est libre de constituer un usufruit par voie de convention conclue à titre onéreux
- L’hypothèse est néanmoins rare, dans la mesure où la constitution d’un usufruit par convention vise le plus souvent à organiser la transmission d’un patrimoine familial.
- Reste que lorsque l’usufruit est constitué à titre onéreux, la contrepartie consistera pour l’acquéreur à verser, tantôt un capital, tantôt une rente viagère.
- Par hypothèse, l’opération n’est pas sans comporter un aspect spéculatif, en raison du caractère viager de l’usufruit.
- Aussi, pourrait-elle être requalifiée en donation déguisée dans l’hypothèse où le prix fixé serait déraisonnablement bas, l’objectif recherché étant, pour les parties, d’échapper au paiement des droits de mutation.
3. La prescription acquisitive
Bien que prévu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse être acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachée à la possession.
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier.
Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. Le possesseur aura ainsi été institué usufruitier a non domino.
S’agissant de la durée de la prescription acquisitive, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.
- S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.
- S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.
B) Les formalités de constitution de l’usufruit
Avant d’entrer en jouissance, l’usufruitier a l’obligation de faire dresser un inventaire des choses sur lesquels il a vocation à exercer son droit. Il doit, en outre, fournir caution de jouir raisonnablement de la chose.
Ces formalités qui s’imposent à l’usufruitier visent à préserver les droits et intérêts du nu-propriétaire qui se dessaisit temporairement de son bien.
Ainsi que l’observait le doyen Carbonnier au sujet du nu-propriétaire et de l’usufruitier « ce ne sont pas seulement deux droits réels, ce sont deux individus qui sont rivaux », de sorte que « l’usufruitier a intérêt à exploiter le plus possible, au risque d’épuiser la substance ».
À cet égard, parce que c’est l’usufruitier qui possède la maîtrise matérielle de la chose, celle échappant totalement au contrôle du nu-propriétaire, il y a lieu de prévenir les manquements qui seraient de nature à altérer sa substance et diminuer sa valeur.
Les obligations qui échoient à l’usufruitier participent ainsi du dispositif qui vise à protéger le nu-propriétaire qui, à l’expiration de l’usufruit, a vocation à recouvrer la pleine propriété de son bien.
- L’inventaire
a) L’obligation d’inventaire
==> Principe
L’article 600 du Code civil dispose que « l’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition : d’une part, lors de son entrée en jouissance, l’usufruitier prend les choses en l’état, d’autre part, il lui appartient d’en dresser un inventaire.
- L’état des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit
- L’article 600 du Code civil précise donc que l’usufruitier prend les choses « dans l’état où elles sont» lors de son entrée en jouissance
- Cette précision n’est pas sans importance : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire que la chose soit en bon état d’usage et de réparation ainsi que peut l’exiger un locataire au titre du contrat de bail
- Obligation est seulement faite au nu-propriétaire de délivrer la chose dans l’état où elle se trouve et à l’usufruitier de la restituer dans le même état à l’expiration de son droit.
- À cet égard, l’inventaire permettra de procéder à une évaluation de l’état des biens au moment de l’entrée en jouissance.
- Lors de la restitution de la chose au nu-propriétaire il permettra encore de déterminer s’il y a lieu de la remettre en état aux frais de l’usufruitier.
- L’inventaire des choses sur lesquelles s’exerce l’usufruit
- L’article 600 exige que préalablement à l’entrée en jouissance un inventaire soit dressé des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit
- Cet inventaire vise ;
- D’une part, à répertorier les biens qui formeront l’assiette de l’usufruit et qui ont été délivrés à l’usufruitier
- D’autre part, à évaluer l’état de ces biens en vue de prévenir toute contestation lors de leur restitution au nu-propriétaire
- Il s’agit, autrement dit, lors de l’inventaire de fixer, non seulement la consistance des biens donnés en usufruit, mais encore leur état qui devra être conservé, aux frais de l’usufruitier, pendant toute la durée de la jouissance.
- Dans un arrêt du 11 février 1959 la Cour de cassation a précisé « que, si aucun inventaire n’a été dressé à cette époque, il appartenait aux propriétaires de le requérir, puisque c’est dans leur intérêt, pour assurer la restitution des biens à la fin de l’usufruit, que l’article 600 du Code civil, l’impose aux usufruitiers» ( 1ère civ. 11 févr. 1959)
==> Exceptions
La règle qui prévoit l’obligation de dresser un inventaire n’est que supplétive, de sorte qu’il peut y être dérogé par clause contraire.
Le principal intérêt de stipuler pareille clause est de dispenser l’usufruitier d’accomplir cette démarche qui peut s’avérer fastidieuse et lourde et de supporter la charge des frais d’inventaire qui peuvent être élevés.
Dans un arrêt du 23 juillet 1957, la Cour de cassation a validé une clause de dispense d’inventaire qui avait été stipulée dans un testament après avoir relevé que « la dame Perrai avait, dans le libellé même de l’acte, attaché une importance spéciale à la dispense d’inventaire, constatent que, en l’espèce, les opérations auxquelles devra se livrer le notaire liquidateur doivent suffire à établir la consistance active et passive de la succession ; qu’ils observent également que chacune des parties propose un notaire pour y procéder et que le jugement entrepris… décide que les deux notaires ainsi désignés y procéderont ».
Elle en déduit que « au vu de ces constatations, qu’il était inutile d’ordonner, en outre, la confection de l’inventaire, sollicité par les époux Descotes, l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision » (Cass. 1ère civ. 23 juill. 1957).
Certains arrêts ont même admis que la clause de dispense d’inventaire pouvait être implicite. Tel sera notamment le cas lorsque l’usufruitier sera dispensé par le constituant d’assumer la charge des travaux de réparation et d’entretien du bien donné en usufruit (V. en ce sens Cass. 3e civ., 17 oct. 1984).
==> Exceptions à l’exception
La clause de dispense d’inventaire ne peut être stipulée qu’autant que la loi n’exige pas ce formalisme à peine de nullité.
Aussi, cette clause est-elle expressément prohibée dans deux cas :
- Libéralités entre époux en présence d’enfants
- L’article 1094-3 du Code civil dispose que « les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l’usufruit, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles, qu’il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.»
- Ainsi, cette disposition octroie-t-elle le droit pour les enfants d’exiger en cas de legs de l’usufruit au conjoint survivant, qu’un inventaire soit dressé.
- L’objectif visé est ici de protéger les héritiers ab intestat des manquements susceptibles d’être commis par le légataire de l’usufruit.
- Reste que lorsque la libéralité prendra la forme, non pas d’une donation, mais d’un don manuel, l’exigence d’inventaire ne sera pas observée, l’opération consistant seulement en une remise par tradition de la chose, soit de main à la main
- Donation de biens meubles
- L’article 948 du Code civil prévoit que « tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.»
- Dès lors qu’une donation consiste en la transmission d’un bien meuble, le donataire a l’obligation de faire dresser un inventaire, nonobstant toute clause contraire.
- S’agissant des immeubles, ils ne sont pas visés par cette disposition dans la constitution d’un usufruit sur cette catégorie de biens est subordonnée à la régularisation d’un acte authentique.
- Un état descriptif de l’immeuble sera donc nécessairement mentionné dans l’acte notarié constitutif d’usufruit
b) Les modalités de l’inventaire
- Quand ?
- L’article 600 du Code civil prévoit que l’inventaire doit être dressé préalablement à l’entrée en jouissance du ou des biens sur lequel l’usufruit est constitué
- Est-ce à dire que lorsque l’usufruitier est déjà entré en jouissance, il est trop tard pour faire dresser un inventaire ?
- À l’analyse, les juridictions admettent que l’inventaire puisse être dressé ultérieurement lorsque les circonstances l’exigent.
- Par ailleurs, il est admis qu’un inventaire complémentaire soit réalisé lorsque le premier inventaire était lacunaire.
- Le nu-propriétaire peut encore saisir le juge aux fins de faire réaliser un second inventaire, lequel visera à vérifier que les biens sujets à l’usufruit ont bien été conservés par l’usufruitier
- Comment ?
- Aucun formalisme n’est exigé quant à la réalisation de l’inventaire
- Il peut donc être réalisé, tant par acte sous seing privé, que par acte authentique
- Lorsque le nu-propriétaire et l’usufruitier sont en conflit, le juge pourra être saisi aux fins de désignation d’un officier ministériel qui sera chargé de réaliser l’inventaire
- En tout état de cause, l’inventaire consistera à répertorier les biens et à évaluer leur état
- Il pourra être assorti d’un état estimatif, bien que cette démarche soit facultative (V. en ce sens 1ère civ., 4 juin 2009, n° 08-11985).
- En présence de qui ?
- L’article 600 du Code civil prévoit expressément que l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent être « dûment appelé» à se joindre aux opérations d’inventaire
- Cet inventaire doit être dressé contradictoirement, faute de quoi il ne sera pas opposable à celui qui était absent
- Si néanmoins le nu-propriétaire ou l’usufruitier n’étaient pas présents lors de la réalisation des opérations d’inventaire, alors même qu’ils ont été régulièrement convoqués par acte d’huissier par exemple, l’inventaire leur sera parfaitement opposable
- Frais
- Les frais d’inventaire sont à la charge exclusive de l’usufruitier, sauf à ce que l’usufruitier soit dispensé de dresser un inventaire
- En cas de dispense, dans l’hypothèse ou le nu-propriétaire solliciterait la réalisation d’un inventaire, c’est à lui-seul que reviendra la charge de supporter les frais
c) La sanction du défaut d’inventaire
En l’absence de texte, le défaut d’inventaire ne saurait entraîner la déchéance du droit de l’usufruitier.
Dans un arrêt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « le défaut d’inventaire ne prive pas M. Z… de ses droits d’usufruitier, mais autorise simplement les nus-propriétaires à prouver par tous moyens la consistance des objets soumis à usufruit » (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1992, n°91-10.970).
Tout au plus, le nu-propriétaire peut donc, soit provoquer la réalisation d’un inventaire en saisissant le juge (V. en ce sens Cass. civ. 10 janv. 1859).
Soit il peut encore refuser d’exécuter son obligation de délivrance du bien à l’usufruitier. Ce droit de rétention dont est titulaire le nu-propriétaire s’infère de l’article 600 du Code civil qui prévoit que l’usufruitier « ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser […] un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit ».
Dans cette hypothèse, l’usufruitier conserve néanmoins son droit de percevoir les fruits des biens non encore délivrés par le nu-propriétaire. Ils devront donc être restitués à l’usufruitier une fois les opérations d’inventaire réalisées.
2. La caution
a) L’obligation de fournir une caution
==> Principe
L’article 601 du Code civil dispose que l’usufruitier « donne caution de jouir en bon père de famille, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »
Cette disposition prescrit ainsi l’obligation pour l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire.
Cette obligation vise à garantir le paiement de dommages et intérêts dont l’usufruitier pourrait devenir redevable en cas de manquement à ses obligations de conservation et d’entretien de la chose soumise à l’usufruit.
La question qui alors se pose est de savoir quelles sont les garanties qui satisfont à l’exigence posée à l’article 601 du Code civil.
==> Nature de la garantie
Il ressort du texte que la fourniture d’une caution simple suffit. Celui-ci n’exige nullement qu’une solidarité soit stipulée entre l’usufruitier et le garant.
Parce que la garantie requise par l’article 601 consiste en un cautionnement, il s’agira pour l’usufruitier d’obtenir d’un tiers qu’il s’engage envers le nu-propriétaire à garantir les dettes qui pourraient naître de ses rapports avec ce dernier.
À cet égard, l’article 2295 du Code civil prévoit que « le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. »
L’article 2296 précise que « la solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. » et de poursuivre « on n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation »
==> Substitution de garantie
Dans l’hypothèse où l’usufruitier ne parviendrait pas à obtenir le cautionnement d’un tiers, il n’aura d’autre choix que de consentir au nu-propriétaire une hypothèque sur ses immeubles ou de donner en gage des biens mobiliers.
Le nu-propriétaire ne pourra pas refuser à l’usufruitier cette substitution de garantie, l’article 2318 du Code civil prévoyant expressément que « celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. »
==> Exceptions
L’article 601 du Code civil prévoit que l’usufruit peut être dispensé de fournir une caution au nu-propriétaire.
Cette dispense procède tantôt de la loi, tantôt de la volonté du constituant :
- Dispenses légales
- La loi dispense, dans deux cas, l’usufruitier de fournir une caution au nu-propriétaire
- Dispense des pères et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants
- L’article 386-1 du Code civil confère aux parents d’un enfant mineur un droit de jouissance légale sur les biens qu’ils administrent.
- Cette disposition prévoit en ce sens que « la jouissance légale est attachée à l’administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d’entre eux qui a la charge de l’administration.»
- La jouissance octroyée par la loi aux parents sur les biens de leurs enfants s’assimile à un véritable usufruit (V. en ce sens civ., 24 janv. 1900), précision faite que cet usufruit ne présente pas de caractère viager.
- Surtout, l’article 601 dispense les parents de fournir caution à leurs enfants en garantie de la préservation de leurs droits.
- Cette dispense procède de la nature des liens particuliers et étroits qui existent entre ces derniers
- On présume que les parents sont animés des meilleures intentions quant à l’administration des biens de leurs enfants et que, par conséquent, ils s’emploieront à accomplir toutes les diligences utiles pour en assurer la conservation
- Dispense du vendeur ou du donateur, sous réserve d’usufruit
- Lorsque le donateur ou le vendeur d’une chose se réserve sur cette chose l’usufruit, l’article 601 le dispense de fournir au donataire ou à l’acquéreur une caution.
- La raison en est que l’on présume que cette dispense procède de la volonté des parties.
- Il est, en effet, peu probable que celui qui aliène la nue-propriété de son bien souhaite, en outre, être assujetti à l’obligation de fournir caution, en particulier s’il s’agit d’une donation.
- Tel ne sera, en revanche, pas le cas dans l’hypothèse inverse, soit lorsque le donateur ou le vendeur aliène, non pas la nue-propriété de son bien, mais l’usufruit.
- En pareil cas, l’exigence de fourniture d’une caution sera maintenue, sauf à ce qu’il en soit décidé autrement par les parties à l’acte.
- Dispenses volontaires
- L’article 601 du Code civil prévoit expressément la possibilité pour le constituant de dispenser, par sa seule volonté, l’usufruitier de fournir une caution.
- À cet égard, cette dispense sera fréquemment stipulée dans les testaments et donation, l’auteur de la libéralité ne souhaitant pas faire peser une charge trop importante sur la tête du bénéficiaire.
- Très tôt, la jurisprudence a, par ailleurs, admis qu’une telle dispense puisse être accordée à l’usufruitier, alors même que le bien grevé relèverait de bien relevant, pour la nue-propriété, de la réserve héréditaire des descendants ou des ascendants (V. en ce sens civ. 5 juill. 1876).
- Tel sera notamment le cas lorsqu’une libéralité sera consentie au conjoint survivant.
- S’agissant de la forme de la dispense, elle peut être expresse ou tacite, le juge ayant alors pour tâche rechercher si la volonté du constituant résulte clairement de l’acte constitutif d’usufruit
- Dans un arrêt du 4 décembre 1958, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la dispense accordée par le testateur au légataire d’un usufruit de fournir caution peut être implicite et s’induire des dispositions testamentaires» ( 1ère civ. 4 déc. 1958)
Lorsque la dispense consentie à l’usufruitier est régulière, le nu-propriétaire a l’obligation de lui délivrer le ou les biens soumis à l’usufruit.
Aussi, l’usufruitier doit pouvoir exercer son droit comme s’il avait fourni la caution exigée par l’article 601. Il est libre de jouir du bien, sans qu’aucune restriction ne puisse lui être imposée par le nu-propriétaire.
À cet égard, ce dernier ne saurait solliciter l’adoption de mesures conservatoires, au seul motif qu’il a un doute sur la capacité de l’usufruitier à apporter tous les soins requis à la chose.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier l’intervention du juge qui ne pourra prononcer des mesures conservatoires que s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux droits et intérêts du nu-propriétaire.
==> Exceptions à l’exception
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il est établi que l’usufruitier met en péril, par ses actes ou par un changement survenu dans sa situation personnelle, les droits du nu-propriétaire, l’adoption de mesures conservatoires peut être ordonnée par le juge (V. en ce sens Cass. civ. 7 déc. 1891).
Tel sera notamment le cas en cas d’abus de jouissance de l’usufruitier, soit lorsqu’il accomplira des actes qui seront de nature à mettre en péril la consistance des biens soumis à l’usufruit ou lorsqu’il les laissera dépérir faute d’entretien (V. en ce sens Cass. req. 26 mars 1889).
L’abus de jouissance peut d’ailleurs conduire le juge, en application de l’article 618 du Code civil, à prononcer la déchéance de l’usufruit.
La solution est extrême, c’est la raison pour laquelle il privilégiera, d’abord, l’adoption de mesures visant à assurer la conservation du bien.
Ces mesures, ne seront pas seulement justifiées en cas d’abus de jouissance. Il a également été admis qu’elles puissent être prononcées en cas d’incapacité de l’usufruitier à gérer ses biens, en cas d’insolvabilité (Cass. req. 22 oct. 1889) ou en cas de soupçons légitimes de malversations (Cass. req. 21 janv. 1845).
Lorsque, pareillement, si les garanties qu’il a fournies lors de la constitution de l’usufruit diminuent, le juge pourra être saisi aux fins de préservation des intérêts du nu-propriétaire.
b) La sanction du défaut de caution
À l’instar du défaut d’inventaire, l’impossibilité pour l’usufruitier de fournir une caution ou des garanties de substitution suffisantes n’est pas sanctionnée par la déchéance de l’usufruit, faute de texte.
Il est néanmoins admis que le nu-propriétaire dispose d’un droit de rétention sur le bien soumis à usufruit droit qu’il pourra exercer tant que la caution requise par l’article 601 du Code civil ne lui sera pas fournie.
L’article 604 précise que, en tout état de cause, « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »
Ainsi, le nu-propriétaire aura l’obligation de restituer à l’usufruitier l’ensemble des fruits perçus lorsqu’il aura régularisé sa situation.
Faute, malgré tout, pour l’usufruitier d’être en mesure de fournir une caution, les articles 602 et 603 du Code civil envisagent l’adoption de mesures différentes, selon que les biens soumis à l’usufruit sont des immeubles ou des meubles :
- L’usufruit porte sur des biens meubles
- Dans cette hypothèse, L’article 602 prévoit que, si l’usufruitier ne trouve pas de caution « les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre»
- Il s’agira, autrement dit, de confier les immeubles à un gardien dont la mission consistera à les administrer
- Aussi, aura-t-il l’obligation d’apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
- L’usufruit porte sur des biens meubles
- Dans cette hypothèse, l’article 602 du Code civil prévoit que si l’usufruitier ne trouve pas de caution
- Les sommes comprises dans l’usufruit sont placées ;
- Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
- Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier.
- L’article 603 ajoute que « le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l’usufruitier jouit de l’intérêt pendant son usufruit
- L’idée est ici de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation de la valeur des biens soumis à l’usufruit.
- Lorsque, de la sorte, il s’agira de denrées ou de choses qui dépérissent par l’usage il y aura lieu de les vendre et de placer le produit de la vente, sauf à ce que le nu-propriétaire s’y oppose, ce qui est son droit, charge à lui de les conserver en tant que dépositaire, ce lui interdit de s’en servir.
- Le même sort sera réservé aux sommes d’argent, l’objectif recherché étant de leur faire produire des intérêts.
- Seule limite à l’absence de délivrance du bien soumis à l’usufruit en cas de défaut de caution, l’article 603 du Code civil prévoit que « l’usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l’extinction de l’usufruit. »
- Par caution juratoire, il faut entendre le serment qui doit être prêté par l’usufruitier de restituer les biens dont il conserve la jouissance, nonobstant le défaut de caution, au nu-propriétaire à l’expiration de son droit.
§3 : Les effets de l’usufruit
L’usufruit confère à son titulaire un droit réel. L’exercice de ce droit n’est, toutefois, pas sans contrepartie.
Un certain nombre d’obligations sont mises à la charge de l’usufruitier la principale d’entre elles étant la restitution du bien dans le même état que celui où il se trouvait au moment de l’entrée en jouissance.
De son côté, le nu-propriétaire exerce également un droit réel sur la chose. Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durée de l’usufruit pour le moins restreinte, a, au fond, pour intérêt majeur de garantir au nu-propriétaire le recouvrement de la pleine propriété de la chose à l’expiration de l’usufruit.
À cet effet, le nu-propriétaire a pour principale obligation de ne pas nuire à l’usufruitier dans sa jouissance de la chose.
À l’analyse, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.
François Terré et Philippe Simler ont écrit en ce sens que « le Code civil a conçu l’usufruit et la nue-propriété comme deux droits réels, coexistant sur la chose et juxtaposés, mais séparés : il n’y a pas communauté, mais bien séparation d’intérêts entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ».
Il n’y a donc, entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.
Les seules limites à l’exercice indépendant de ces droits réels dont ils sont titulaires sont celles posées par la loi, laquelle met à la charge de l’usufruitier plusieurs obligations propter rem (art. 600 à 615 C. civ.).
I) La situation de l’usufruitier
A) Les droits de l’usufruitier
La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.
Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.
En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.
Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.
Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus »[1].
En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits
- Les droits qui s’exercent sur la chose
- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
- Les droits qui s’exercent sur la chose
Les droits dont est titulaire l’usufruitier sur la chose procèdent de l’usus et du fructus que lui confère l’usufruit.
a) Le droit d’user de la chose : l’usus
==> Principes généraux
Parce qu’il est titulaire de l’usus, l’usufruitier est investi du pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle.
Le Doyen Carbonnier définissait l’usus comme « cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user) ».
À cet égard, le droit d’user de la chose confère à son titulaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts.
À cet égard l’article 597 du Code civil précise, s’agissant de l’usufruitier, qu’« il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. »
L’usufruitier peut ainsi :
- Utiliser la chose pour ses besoins personnels et pour autrui (habiter une maison, utiliser une voiture
- Donner la chose à bail
- Exploiter la chose (cultiver des terres, exploiter un fonds de commerce ou le donner en location-gérance etc..)
- Consommer les choses consomptibles, à charge de les restituer par équivalent ou en valeur à l’expiration de l’usufruit
- Construire un ouvrage dès lors que cela n’affecte pas de manière irréversiblement la substance de la chose
L’article 589 du Code civil précise que si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Cela signifie donc que, pour les choses qui se détériorent par l’usage, l’usufruitier ne devra aucune indemnité au nu-propriétaire lors de la restitution du bien, dès lors qu’il en aura fait un usage normal.
Lorsque, en revanche, l’usage qu’il en fait est inapproprié et est de nature à précipiter la détérioration de la chose, l’usufruitier engagera sa responsabilité.
Il est encore fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).
==> Cas particulier de la conclusion de baux
L’article 595, al. 1er du Code civil prévoit que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »
Ainsi, l’usufruitier est-il autorisé, par principe, à donner la chose soumise à l’usufruit à bail.
Toutefois, la conclusion de certains baux s’apparente parfois à un véritable acte de disposition. Tel est le cas de la régularisation d’un bail commercial ou encore d’un bail rural
Aussi, afin qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits du nu-propriétaire qui, en présence d’un tel bail, serait contraint d’en supporter la charge à l’extinction de l’usufruit, le législateur a encadré l’opposabilité des actes accomplis en la matière par l’usufruitier.
- S’agissant des baux conclus pour une durée égale ou inférieure à neuf ans
- Le principe posé par l’article 595 du Code civil, c’est que l’usufruitier pour conclure seul ce type de baux, de sorte qu’ils sont parfaitement opposables au nu-propriétaire.
- Ils auront donc vocation à se poursuivre à l’expiration de l’usufruit sans que le nu-propriétaire puisse s’y opposer.
- L’alinéa 3 de l’article 595 a néanmoins apporté un tempérament à cette règle en prévoyant que « les baux de neuf ans ou au-dessous que l’usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l’expiration du bail courant s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la cessation de l’usufruit.».
- L’objectif visé par cette règle est de limiter les conséquences d’un renouvellement de bail par anticipation.
- Ainsi, selon qu’il s’agit d’un bail rural ou d’un autre type de bail, le renouvellement du bail ne pourra intervenir que trois ans ou deux avant l’expiration du bail en cours
- S’agissant des baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans
- Il ressort de l’article 595 du Code civil que lorsque le bail est conclu pour une durée supérieure à 9 ans, il est inopposable au nu-propriétaire.
- L’alinéa 2e de cette disposition prévoit en ce sens que « les baux que l’usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l’usufruit, obligatoires à l’égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n’ait que le droit d’achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve»
- S’agissant des baux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal
- L’article 595, al. 4 dispose que « l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »
- Pour les baux visés par cette disposition, l’usufruitier est donc contraint d’obtenir l’accord du nu-propriétaire.
- Cet accord n’est toutefois pas indispensable, dans la mesure où le texte ouvre une action à l’usufruitier qui peut solliciter le juge aux fins de l’autoriser à conclure le bail.
- Elle lui sera accordée lorsqu’il s’avère que le refus du nu-propriétaire est seulement animé par l’intention de nuire ou qu’elle ne repose sur aucune raison valable.
- En cas d’absence d’autorisation du nu-propriétaire ou du juge, la sanction encourue c’est la nullité du bail et non l’inopposabilité (V. en ce sens 3e civ., 26 janv. 1972).
- Dans un arrêt du 16 décembre 1987, la Cour de cassation a précisé que « l’exercice de l’action en nullité découlant de l’article 595 du Code civil n’est pas subordonné à la cessation de l’usufruit?» ( 3e civ., 16 déc. 1987, n° 86-15324).
- Il en résulte que l’action peut être engagée sans qu’il soit besoin d’attendre la fin de l’usufruit
- À cet égard, la nullité est ici relative, de sorte que l’action appartient au seul nu-propriétaire.
b) Le droit de jouir de la chose : le fructus
L’usufruit ne confère pas seulement à l’usufruitier le droit de faire usage de la chose, il lui confère également le droit d’en jouir.
Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir de percevoir les revenus que le bien lui procure.
Pour l’usufruitier d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
L’article 582 du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. »
Immédiatement, il convient alors de préciser ce que l’on doit entendre par « fruits », lesquels doivent être distingués des « produits. »
i) Distinction en les fruits et les produits
L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière des pierres.
La question qui a lors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.
La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.
En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.
Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.
- Exposé de la distinction
- Les fruits
- Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
- Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
- Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
- Les fruits naturels
- L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
- Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
- Les fruits industriels
- L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
- Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
- Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
- Les fruits civils
- L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
- L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
- Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
- Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
- Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères :
- La périodicité (plus ou moins régulière)
- La conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
- Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
- Les produits
- Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
- Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
- Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé»[2].
- Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
- Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
- Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
- Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
- Intérêt de la distinction
- La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
- En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
Manifestement, la qualification de fruit ou de produit du revenu généré par la chose est d’importance, car elle détermine qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier en bénéficiera.
Si, en principe, cette qualification est prédéterminée par la nature de la chose, il est des cas où elle dépend de la volonté du propriétaire qui selon l’exploitation qu’il en fait pourra en retirer, tantôt des fruits, tantôt des produits.
Illustration est faite de cette possibilité dans le code civil qui distingue selon que sont présents sur un fonds soumis à usufruit des arbres de haute futaie des forêts ou des bois taillis.
- S’agissant des bois taillis
- Il s’agit des arbres qui ont vocation à être coupés à échéance périodique avant qu’ils n’atteignent leur pleine maturité pour qu’ils se développent à nouveau à partir de leur souche
- Cette périodicité de la coupe des bois taillis leur confère la qualité de fruit : ils reviennent donc au seul usufruitier
- À cet égard, l’article 590, al.1er du Code civil précise « si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissanc»
- L’alinéa 2 ajoute que l’usufruitier doit se conformer aux usages des lieux pour le remplacement
- S’agissant des arbres de haute futaie des forêts
- Principe
- Contrairement aux bois taillis, les arbres de haute futaie des forêts sont ceux qui sont laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité
- Ils n’ont donc pas vocation à être coupés à échéance périodique ce qui fait d’eux des produits
- Aussi reviennent-ils au nu-propriétaire et non à l’usufruitier qui ne peut y toucher.
- Tout au plus l’article 592 du Code civil autorise l’usufruitier à « employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. »
- Exception
- L’article 591 du Code civil envisage un cas où les arbres de haute futaie peuvent être qualifiés de fruits : lorsqu’ils sont aménagés et plus précisément lorsqu’ils sont soumis à une coupe réglée.
- Dans cette hypothèse, ils reviennent à l’usufruitier et non au nu-propriétaire
- Le texte prévoit en ce sens que « l’usufruitier profite encore […] des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. »
- Cette prérogative conférée à l’usufruitier est toutefois subordonnée au respect par lui de l’exigence de se conformer « aux époques et à l’usage des anciens propriétaires».
- Dans le prolongement de cette faculté consenti à titre dérogatoire à l’usufruitier sur les arbres de haute futaie, l’article 593 du Code civil prévoit que « il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires».
Enfin, l’article 594 du Code civil envisage le sort des arbres fruitiers présents sur le fonds soumis à l’usufruit.
Le texte prévoit que « les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. »
ii) L’acquisition des fruits
==> Le moment d’acquisition des fruits
L’article 604 du Code civil dispose que « le retard de donner caution ne prive pas l’usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. »
Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut percevoir les fruits produits par la chose à compter du moment où son droit est ouvert.
La question qui alors se pose est de savoir à quel moment s’opère cette ouverture du droit de l’usufruitier ?
À l’examen, il convient de distinguer selon que l’usufruit est d’origine légale, conventionnelle, testamentaire ou judiciaire.
- L’usufruit d’origine légale
- Dans cette hypothèse, pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier de percevoir les fruits, il convient de se reporter au point de départ fixé par la loi.
- Ainsi, le droit du conjoint survivant qui est susceptible d’opter en présence d’enfants communs pour l’usufruit de la totalité des biens du de cujus s’ouvre à compter du décès de ce dernier
- S’agissant du droit de jouissance légal des parents sur les biens de leur enfant il naît à compter du jour de l’acquisition du bien
- L’usufruit conventionnel
- Dans cette hypothèse, c’est la volonté des parties qui détermine le point de départ de l’usufruit.
- À défaut, le droit de l’usufruitier est réputé être ouvert à compter du jour de la conclusion du contrat, soit de la régularisation de l’acte.
- L’usufruit judiciaire
- Dans cette hypothèse, c’est le juge qui, en octroyant à une partie, un droit d’usufruit, fixera son point de départ.
- Lorsque, par exemple, l’usufruit sera constitué dans le cadre de l’octroi d’une prestation compensatoire, le droit du bénéficiaire prendra le plus souvent effet au jour de prononcé du jugement
- L’usufruit testamentaire
- Dans cette hypothèse, il convient de distinguer selon que l’usufruit est consenti à un légataire universel ou à un légataire à titre particulier.
- L’usufruit consenti à un légataire universel ou à titre universel
- Pour rappel, le légataire universel est celui qui se voit léguer l’universalité des biens du testateur, soit l’ensemble de son patrimoine ( 1003 C. civ.)
- Quant au légataire à titre universel il s’agit de la personne qui recueille une quote-part des biens dont la loi permet au testateur de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier ( 1010 C. civ.).
- À l’examen, la jurisprudence ne distingue pas selon que l’usufruitier est légataire universel ou légataire à titre universel
- Dans les deux cas, les juridictions font application de l’article 1005 du Code civil.
- En application de cette disposition le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque
- À défaut, précise le texte, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
- Dans un arrêt du 6 décembre 2005 la cour de cassation est venue préciser que « le conjoint survivant, investi de la saisine sur l’universalité de l’hérédité, a, dès le jour du décès et quelle que soit l’étendue de la vocation conférée par le legs qui lui a été consenti, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d’occupation» ( 6 déc. 2005, n°03-10211).
- Il ressort de cette disposition que lorsque l’usufruitier cumule les qualités de légataire universel ou à titre universel et d’héritier son droit s’ouvre, en tout état de cause, au jour du décès du de cujus.
- L’usufruit consenti à un légataire à titre particulier
- Tout d’abord, le légataire à titre particulier est celui qui se voit léguer par le testateur un ou plusieurs biens individualisés
- Dans cette hypothèse pour déterminer la date d’ouverture du droit de l’usufruitier à percevoir les fruits, il convient de se reporter à l’article 1014, al. 2e du Code civil.
- Cette disposition prévoit que « le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. »
- Il en résulte que le légataire à titre universel devra attendre la délivrance de la chose par les héritiers saisis pour percevoir les fruits.
==> Les modes d’acquisition des fruits
Les règles qui régissent l’acquisition des fruits diffèrent selon qu’il s’agit de fruits naturels, de fruits industriels ou encore de fruits civils.
- Les fruits naturels
- L’article 583, al. 1er du Code civil prévoit que « les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. »
- Il s’agit autrement dit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
- S’agissant de leur perception, elle procède de leur séparation du sol.
- Ainsi, l’article 585, al. 1er du Code civil prévoit que les fruits naturels pendants par branches ou par racines au moment où l’usufruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier.
- Encore faut-il néanmoins que l’usufruitier se donne la peine de les récolter.
- L’alinéa 2e de l’article 585 précise, en effet, que les fruits « qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d’autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au métayer, s’il en existait un au commencement ou à la cessation de l’usufruit. »
- Ainsi les fruits qui n’auraient pas été perçus par l’usufruitier lorsque l’usufruit vient à expirer deviennent la propriété du propriétaire, ce, quand bien même le coût de la cultivation a été entièrement supporté par l’usufruitier.
- Ce dernier ne peut réclamer ni la restitution du produit de la vente, ni indemnisation
- Les fruits industriels
- L’article 583, al. 2e prévoit que « les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu’on obtient par la culture. »
- Il s’agit donc des fruits dont la production procède directement du travail de l’homme.
- Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
- À l’instar des fruits naturels, les fruits industriels s’acquièrent par la perception, soit par leur séparation de la chose productrice ( 585 C. civ.)
- Les fruits civils
- L’article 584 al. 1er prévoit que « les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. »
- L’alinéa 2 précise que « les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. »
- Il s’agit donc des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
- Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
- S’agissant de leur perception, l’article 586 du Code civil prévoit que « les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s’applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. »
- Il ressort de cette disposition que les fruits civils sont répartis, pour les années d’ouverture et d’expiration du droit d’usufruit entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata temporis.
- Peu importe donc la date de la perception ; ce qui importe c’est la prise d’effet et d’extinction du droit.
- Le calcul s’opérera sur la base d’une année de 365 jours, étant précisé que, l’usufruitier a droit aux fruits civils proportionnellement à la durée réelle de sa jouissance.
- Pour exemple, si l’usufruit expire au 1er juillet, l’usufruitier percevra la moitié des loyers annuels et le nu-propriétaire l’autre moitié.
- Si, en revanche, l’usufruit expire au 4 mars, l’usufruitier percevra les loyers dus pour les mois de janvier et février auxquels s’ajoutera le montant du loyer correspondant à 4 jours de jouissance.
2. Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
L’usufruitier n’est pas seulement investi d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, il dispose également de la faculté d’aliéner son droit et d’engager toutes les actions en justice utiles pour en assurer la préservation.
==> Le droit d’aliéner l’usufruit
- Principe
- L’article 595 du Code civil dispose que « l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. »
- Il ressort de cette disposition que l’usufruitier est investi du droit d’aliéner son droit d’usufruit.
- À cet égard, l’usufruitier peut :
- Céder son droit à titre onéreux ou à titre gratuit
- Constituer une sûreté réelle sur la chose soumise à l’usufruit (gage pour les meubles et hypothèque pour les immeubles)
- Effectuer un apport en société avec l’usufruit
- En outre, il est admis que l’usufruit puisse faire l’objet d’une saisie
- Limites
- La faculté pour l’usufruitier d’aliéner son droit n’est pas sans limites
- Tout d’abord, l’usufruit demeure, en tout état de cause intransmissible à cause de mort.
- Ensuite, parce que l’usufruit présente un caractère temporaire son aliénation ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte à la substance de la chose, ni aux droits du nu-propriétaire
- Enfin, lorsque l’acte de constitution comporte une clause d’inaliénabilité, il est fait défense à l’usufruitier de le céder
- Portée
- L’aliénation de l’usufruit est sans incidence sur sa durée en ce sens qu’il a vocation à s’éteindre, soit au décès de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme prévu dans l’acte constitutif
- Par ailleurs, c’est le cédant de l’usufruit qui répond des préjudices causés au nu-propriétaire à raison de fautes commises par le cessionnaire.
==> Le droit d’agir en justice
Afin de préserver son droit réel, notamment des atteintes qui pourraient lui être portées par le nu-propriétaire, plusieurs actions en justice sont ouvertes à l’usufruitier.
- L’action confessoire
- Cette action dont est titulaire l’usufruitier vise à faire reconnaître son droit de jouissance sur la chose, soit à obtenir la délivrance de la chose qui serait détenue, soit par un tiers, soit par le nu-propriétaire
- Dans un arrêt du 7 avril 2004, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier peut ester en justice, dans la mesure où il agit pour défendre ou protéger son droit de jouissance, et que ce droit lui permet d’exercer aussi bien une action personnelle que réelle» ( 3e civ. 7 avr. 2004, n°02-13703).
- Cette action est, en quelque sorte, à l’usufruit ce que l’action en revendication est à la propriété.
- Reste que, à la différence de l’action en revendication, l’action confessoire n’est pas imprescriptible : l’usufruitier doit agir dans un délai de trente ans peu importe que l’usufruit porte sur un bien meuble ou sur un immeuble
- L’action personnelle
- Ainsi qu’il l’a été jugé la Cour de cassation dans l’arrêt du 7 avril 2004, l’usufruitier dispose d’une action personnelle
- Cette action poursuit parfois la même finalité que l’action confessoire : obtenir la délivrance de la chose.
- Dans cette hypothèse, son domaine est toutefois bien plus restreint que celui de l’action confessoire puisqu’elle ne peut être dirigée que contre le nu-propriétaire et ses ayants droits.
- L’action personnelle peut également avoir pour finalité de sanctionner les troubles de jouissance dont l’usufruitier est susceptible d’être victime.
- Il sera, par exemple, fondé à engager la responsabilité du nu-propriétaire qui accomplirait des actes qui lui causeraient un préjudice
B) Les obligations de l’usufruitier
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.
Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.
De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :
- L’obligation de conserver la substance de la chose
- L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
- L’obligation de conserver la substance de la chose
L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.
Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.
L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;
- L’interdiction de détruire ou détériorer la chose
- La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
- Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
- À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
- La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
- L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
- L’accomplissement d’actes conservatoires
- Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
- Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
- Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
- L’article 614 du Code civil prévoit encore que « si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.»
- Il résulte de cette disposition que l’usufruitier doit, dès qu’il en a connaissance, dénoncer les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il jouit.
- À défaut, l’usufruitier engagera sa responsabilité, le risque pour le nu-propriétaire étant que la prescription acquisitive le dépossède de son bien.
- L’usage de la chose conformément à sa destination
- Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
- Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
- Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
- Dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit» ( 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).
- Elle est ensuite venue préciser, dans un arrêt du 2 février 2005 que l’obligation de respect de la destination de la chose, ne doit pas être comprise comme une interdiction de toute variation dans le mode d’exploitation de la chose.
- Dans cette décision, elle ainsi validé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait admis que les usufruitiers de terres agricoles puissent conclure un bail commercial avec deux sociétés en vue de leur permettre de construire et d’exploiter une plate-forme de compostage de déchets organiques.
- Au soutien de sa décision la troisième chambre civile relève que « le bail commercial envisagé obéissait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique et à la réglementation sur la protection de l’environnement, qu’il ne dénaturait ni l’usage auquel les parcelles étaient destinées, ni leur vocation agricole, qu’il était profitable à l’indivision, mais sans porter atteinte aux droits des nus-propriétaires dans la mesure où le preneur s’engageait en fin de bail à remettre les lieux dans leur état d’origine, la cour d’appel, qui en a déduit qu’il ne portait pas atteinte à la substance de la chose, a pu autoriser les usufruitiers à conclure seuls un bail commercial sur les parcelles en cause» ( 3e civ. 2 févr. 2005, n°03-19729).
- À l’examen, la jurisprudence semble admettre les aménagements de la destination du bien, dès lors qu’ils n’impliquent pas une altération de la chose qui serait irréversible.
- Si les travaux à engager sont minimums, à tout le moins, ne sont pas de nature à porter atteinte à la substance du bien, le nu-propriétaire ne pourra pas s’y opposer.
- L’obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose
- Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait ( 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
- Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
- Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
- Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières.
- Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver» ( 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
- Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
2. L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
Afin de comprendre la logique qui préside aux charges usufructuaires, relisons le Doyen Carbonnier qui a écrit : « l’idée générale est que, dans la gestion d’une propriété, il y a des frais et des dettes qu’il est rationnel de payer avec les revenus et d’autres avec le capital. Si la propriété est démembrée, le passif de la première catégorie doit être à la charge de l’usufruitier, l’autre à la charge du nu-propriétaire ».
Aussi, les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.
Au nombre des charges usufructuaires figurent :
- Les charges périodiques
- Les frais et dépenses de réparation
Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.
a) Les charges périodiques
L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
Classiquement, on oppose les charges périodiques aux charges extraordinaires qui sont visées à l’article 609 du Code civil.
Cette disposition les définit comme celles « qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ».
Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage.
L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit :
- Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital
- L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts
L’alinéa 3 du texte précise que si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire
b) Les frais et dépenses de réparation
Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
Ces réparations peuvent être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
- D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
i) Les dépenses d’entretien
==> Notion
Les dépenses d’entretien sont donc celles qui visent à conserver le bien en bon état. En application de l’article 605 du Code civil, elles sont à la charge du seul usufruitier.
Le législateur a, en effet, considéré qu’elles résultaient de la jouissance du bien et que, par conséquent, elles devaient être payées avec les revenus qui précisément reviennent à l’usufruitier.
Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépense d’entretien, la réponse déterminant si elle doit ou non être supportée par l’usufruitier.
À l’examen, les dépenses de réparation et d’entretien s’entendent de celles qui correspondent à des travaux ayant pour objet de maintenir ou de remettre en bon état le bien et d’en permettre un usage normal, conforme à sa destination, sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial.
Plus généralement, ainsi que l’indique l’article 606, al. 3e du Code civil les dépenses d’entretien sont toutes celles qui ne sont pas des grosses réparations.
==> Exécution de l’obligation
Il peut être observé que si l’usufruitier ne peut pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer des grosses réparations ainsi que nous le verrons plus après, l’inverse n’est pas vrai.
Dans un arrêt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugé que « le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » (Cass. 1ère civ. 21 mars 1962).
À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
ii) Les grosses réparations
==> Notion
Contrairement aux dépenses d’entretien qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606.
En application de cette disposition elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures.
La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui « intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » tandis que les réparations d’entretien « sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764).
Il a par exemple été jugé que :
- La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle ( 1ère civ. 2 févr. 1955)
- Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien ( 1ère civ. 21 mars 196)
Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières.
Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » (Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816).
Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien.
==> Répartition
- Principe
- Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire.
- Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit.
- Exceptions
- Négligence de l’usufruitier
- L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
- Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût.
- Travaux d’amélioration
- Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’améliorations, elles demeurent à la charge de l’usufruitier
- Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée» ( com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424).
- Reconstruction du bien
- L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.»
- Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit.
- Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement.
==> Exécution de l’obligation
La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537).
La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.
Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.
Reste que dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit.
Dans un arrêt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit (Cass. civ. 17 juill. 1917).
c) La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
Il ressort des articles 610- 611 et 612 du Code civil que, selon que l’usufruit est universel, à titre universel, ou à titre particulier, l’usufruitier sera ou non tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
Pour rappel :
- L’usufruit universel est celui qui porte sur une l’universalité des biens, soit sur l’ensemble d’un patrimoine
- L’usufruit à titre universel est celui qui porte sur une quote-part des biens, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier
- L’usufruit à titre particulier est celui qui porte sur un ou plusieurs biens individualisés
Ceci étant rappelé, le Code civil opère une distinction entre :
- D’une part, l’usufruitier à titre particulier qui n’est pas tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont relève le ou les biens dont il jouit
- D’autre part, l’usufruitier universel et à titre universel qui est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine ou la quotité de patrimoine soumis à l’usufruit
S’agissant de l’usufruitier à titre particulier, l’article 611 du Code civil précise que qu’il « n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s’il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l’article 1020, au titre ” Des donations entre vifs et des testaments ” ».
Ainsi, en cas d’usufruit constitué sur un bien grevé d’une hypothèque, la dette attachée à la sûreté n’incombe pas à l’usufruitier. Reste qu’il peut être poursuivi par le créancier hypothécaire au titre de son droit de suite. L’usufruitier, s’il veut conserver la jouissance du bien, n’aura alors d’autre choix que de régler la dette, charge à lui de se retourner contre le nu-propriétaire.
S’agissant de l’usufruitier universel et à titre universel, l’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine ou d’une quote-part de celui-ci. Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruit le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
À cet égard, tandis que l’article 610 régit la contribution de l’usufruitier aux rentes viagères et pensions alimentaires qui grèvent le patrimoine dont il jouit, l’article 612 règle la contribution aux autres dettes.
- S’agissant des rentes viagères et des pensions alimentaires
- En application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
- S’il est usufruitier universel il prendra en charge l’intégralité des arrérages et s’il est usufruitier à titre universel il y contribuera dans la proportion de sa jouissance
- S’agissant des dettes qui ne sont ni des rentes viagères, ni des pensions alimentaires
- En application de l’article 612 du Code civil, l’usufruitier universel et à titre universel doit supporter le coût des intérêts de la dette.
- Là encore, il devra contribuer au règlement des intérêts de la dette à proportion de l’étendue de sa jouissance.
- À cet égard, l’article 612 envisage plusieurs modes de contribution à la dette.
- Tout d’abord, si l’usufruitier veut avancer la somme nécessaire au règlement de la dette, le capital lui sera restitué à la fin de l’usufruit, sans aucun intérêt.
- Ensuite, Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance de capital, le propriétaire a le choix :
- Soit payer cette somme, et, dans ce cas, l’usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l’usufruit
- Soit faire vendre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit.
En tout état de cause, et indépendamment des modes de contributions envisagés par le Code civil, il a très tôt été admis que les créanciers puissent agir contre le nu-propriétaire pour le capital et les intérêts de la dette (Cass. civ. 23 avr. 1888).
II) La situation du nu-propriétaire
Aux côtés de l’usufruitier qui bénéficie de la jouissance de la chose (usus et fructus), le nu-propriétaire conserve le droit d’en disposer (abusus).
Ce droit, dont l’assiette est pendant toute la durée de l’usufruit pour le moins restreinte a pour intérêt majeur de garantir au nu-propriétaire le recouvrement de la pleine propriété de la chose à l’expiration de l’usufruit.
Parce que le nu-propriétaire, à l’instar de l’usufruitier, exerce un droit réel sur la chose, il est investi de prérogatives tout autant qu’il lui incombe des obligations.
A) Les droits du nu-propriétaire
Par hypothèse, le nu-propriétaire ne bénéficie pas de la jouissance de la chose. Il en résulte que ses prérogatives sont bien moins nombreuses que celles exercées par l’usufruitier.
- Le droit de disposer de la chose : l’abusus
Tandis que l’usufruitier est titulaire des droits d’user et de jouir de la chose, le nu-propriétaire est investi du droit d’en disposer.
Ce droit de disposer de la chose est néanmoins restreint, car il ne lui permet pas de détruire le bien, alors même que cette prérogative relève de l’abusus.
La raison en est que s’il détruisait la chose, il porterait atteinte au droit – réel de l’usufruitier – qui serait privé de la faculté d’en jouir.
C’est donc un droit de disposer diminué qui est conféré au nu-propriétaire. Il conserve néanmoins la faculté de céder son droit ou de grever la nue-propriété de droits réels (sûretés, servitudes).
À cet égard, l’article 621 du Code civil précise que « la vente du bien grevé d’usufruit, sans l’accord de l’usufruitier, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue à jouir de son usufruit sur le bien s’il n’y a pas expressément renoncé. »
2. Le droit de percevoir les produits
Si l’usufruitier est titulaire du droit de percevoir les fruits engendrés par la chose, c’est au nu-propriétaire que reviennent les produits.
Pour rappel, les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine. Il en va de même des arbres de haute futaie des forêts qui sont ceux laissés en place pour qu’ils atteignent leur pleine maturité. N’ayant pas vocation à être coupés à échéance périodique, on les qualifie de produits.
Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé »[3].
C’est la raison pour laquelle, les produits ne peuvent être perçus que par le nu-propriétaire dont le droit s’exerce sur le capital.
3. Actes conservatoires
Bien que l’accomplissement d’actes conservatoires relève des prérogatives de l’usufruitier, le nu-propriétaire est directement intéressé par la conservation de la chose. Et pour cause, il a vocation à recouvrer la pleine propriété du bien à l’expiration de l’usufruit.
Aussi, est-il admis que, pour assurer la sauvegarde de la substance de la chose, le nu-propriétaire puisse accomplir tous les actes conservatoires requis, notamment en cas de carence de l’usufruitier.
Il pourra donc s’agir d’engager une procédure de recouvrement, renouveler une sûreté, interrompre un délai de prescription
Il pourra encore contraindre l’usufruitier à prendre toutes les mesures utiles aux fins d’éviter que la chose ne se détériore et plus généralement à engager des travaux d’entretien.
Dans un arrêt du 21 mars 1962 la Cour de cassation a, en effet, jugé que « le nu-propriétaire peut, pendant la durée de l’usufruit, contraindre l’usufruitier à effectuer les réparations d’entretien tendant à la conservation de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble grevée d’usufruit » (Cass. 1ère civ. 21 mars 1962).
À cet égard, en cas d’inaction de l’usufruitier il est un risque qu’il soit déchu de son droit. L’article 618 du Code civil prévoit, en effet, que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
4. Actions en justice
Le nu-propriétaire est fondé à engager toutes les actions en justice qui vise à préserver son droit de propriété.
Il peut donc exercer l’action en revendication, en contestation ou reconnaissance d’une servitude.
Le nu-propriétaire peut encore dénoncer en justice les empiétements susceptibles d’affecter le fonds dont il est propriétaire, tout autant qu’il peut saisir le juge pour toute question relative au bornage ou à la clôture du terrain.
Il peut enfin agir contre l’usufruitier qui manquerait à ses obligations, en particulier s’il constate qu’il commet un abus de jouissance, lequel abus est sanctionné par la déchéance de l’usufruit.
5. Le droit à être informé de la modification de la substance de la chose
De manière générale, le nu-propriétaire est en droit d’être informé par l’usufruitier de toutes les modifications qui affectent la substance de la chose.
La raison en est qu’il doit pouvoir agir au plus vite afin de prendre toutes les mesures utiles que requiert la situation. Il doit néanmoins pouvoir empêcher l’usufruitier d’accomplir des actes qui auraient des conséquences irréversibles.
Ce droit à être informé dont est titulaire le nu-propriétaire a été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 1998 qui, dans cette affaire, avait qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières.
Dans un arrêt du 3 décembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « pour déterminer la substance conservée et la valeur du bien à partager, il est nécessaire que l’usufruitière puisse donner tous les éléments nécessaires pour déterminer si les seules valeurs subsistantes au jour du partage, représentent bien toute la substance de l’universalité qu’elle était chargée de conserver » (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
B) Les obligations du nu-propriétaire
À l’examen, trois obligations pèsent sur la tête du nu-propriétaire :
- Ne pas porter atteinte au droit de jouissance de l’usufruitier
- Supporter la charge des grosses réparations
- S’acquitter des charges extraordinaires
- L’obligation de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier
L’article 599, al. 1er du Code civil dispose que « le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. »
Il ressort de cette disposition qu’il est fait défense au nu-propriétaire d’entraver l’exercice des droits d’usage et de jouissance de l’usufruitier.
Autrement dit, le nu-propriétaire ne peut apporter aucune modification à la substance de la chose puisque celle-ci constitue l’assiette de l’usufruit.
Dans un arrêt du 28 novembre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que méconnaissait les droits de l’usufruitier le nu-propriétaire qui en défrichant et en clôturant un domaine anéantissait toute possibilité de chasse (Cass. 1ère civ. 28 nov. 1972).
Les seuls travaux d’ampleur que le nu-propriétaire est autorisé à effectuer sont ceux qui visent à réaliser des grosses réparations.
2. L’obligation de supporter la charge des grosses réparations
==> Notion
Contrairement aux dépenses d’entretien qui ne sont pas définies par le Code civil, les grosses réparations sont listées par l’article 606.
En application de cette disposition elles s’entendent des réparations des gros murs, voûtes et planchers, du rétablissement des poutres, des couvertures entières, des digues, murs de soutènement et clôtures.
La Cour de cassation a défini les grosses réparations comme celles qui « intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale » tandis que les réparations d’entretien « sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2005, n°04-13764).
Il a par exemple été jugé que :
- La réfection de zingueries affectant une partie exceptionnelle de l’immeuble était une grosse réparation car engageant une dépense exceptionnelle ( 1ère civ. 2 févr. 1955)
- Le recrépissement ou le ravalement d’un immeuble est, en revanche, une réparation d’entretien ( 1ère civ. 21 mars 196)
Les grosses réparations correspondent donc aux travaux de restauration d’une structure essentielle de l’immeuble, tels que la réfection d’un mur pignon ou le rétablissement de poutres ou de couvertures entières.
Dans un arrêt du 27 novembre 2002, la troisième chambre civile a précisé que « l’article 606 du Code civil énumère limitativement les grosses réparations » (Cass. 3e civ. 27 nov. 2002, n°01-12816).
Il en résulte que les juridictions ne peuvent pas ajouter des travaux à la liste énoncée par l’article 606. Les grosses réparations doivent se limiter à celles qui touchent à la solidité et à la structure du bien.
==> Répartition
- Principe
- Parce que les grosses réparations se rattachent à la substance même de la chose, l’article 605 prévoit qu’elles sont à la charge du seul nu-propriétaire.
- Il devra s’acquitter de son obligation au plus tard à l’expiration de l’usufruit.
- Exceptions
- Négligence de l’usufruitier
- L’article 605 indique que les grosses réparations restent à la charge de l’usufruitier lorsqu’elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
- Ainsi, dans l’hypothèse où les grosses réparations résulteraient de la faute de l’usufruitier qui n’auraient pas satisfait à son obligation d’entretien et de conservation de la chose en bon état, c’est lui qui en supportera le coût.
- Travaux d’amélioration
- Lorsque les grosses réparations s’apparentent à des travaux d’améliorations, elles demeurent à la charge de l’usufruitier
- Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée» ( com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424).
- Reconstruction du bien
- L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.»
- Lorsque, de la sorte, un immeuble est tombé en ruine, aucune obligation n’est faite au nu-propriétaire de le rebâtir, sous réserve que la cause de l’état du bien réside dans le cas fortuit.
- Dans l’hypothèse où la destruction de l’immeuble serait imputable au nu-propriétaire, il devra indemniser l’usufruitier et inversement.
==> Exécution de l’obligation
La Cour de cassation a jugé dans plusieurs arrêts que l’usufruitier ne pouvait pas contraindre le nu-propriétaire à effectuer les grosses réparations sur le bien (V. en ce sens Cass. 3e civ. 10 juill. 2002, n°00-22158 ; Cass. 3e civ. 18 déc. 2013, n°12-18537).
La raison en est qu’ils sont tous deux titulaires de droits réels qui sont indépendants l’un de l’autre.
Aussi, il n’y a entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, ni indivision, ni société. Tous deux exercent directement un pouvoir sur la chose sans avoir à se soucier des intérêts de l’autre.
Reste que dans l’hypothèse où l’usufruitier a été contraint de supporter la charge des grosses réparations, il disposera d’un recours contre le nu-propriétaire qu’il pourra exercer à l’expiration de l’usufruit.
Dans un arrêt du 17 juillet 1911 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’usufruitier qui a supporté le coût d’une grosse réparation était fondé à réclamer le montant de la plus-value en résultant lors de la cessation de l’usufruit (Cass. civ. 17 juill. 1917).
3. L’obligation de s’acquitter des charges extraordinaires
Tandis que les charges périodiques incombent à l’usufruitier (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière etc.), car directement attachées à la jouissance du bien, l’article 609 du Code civil fait supporter au nu-propriétaire les charges dites extraordinaires.
Cette disposition les définit comme celles « qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l’usufruit ».
Ces charges sont attachées à la substance de la chose, au capital. Il s’agit, par exemple, des frais de bornage.
L’article 609, al. 2e répartit les charges extraordinaires entre le nu-propriétaire et l’usufruitier comme suit :
- Le nu-propriétaire supporte le coût des charges pour le capital
- L’usufruitier supporte, quant à lui, le coût des intérêts
L’alinéa 3 du texte précise que si les charges extraordinaires sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l’usufruit.
Reste que les créanciers ne peuvent agir, pour le recouvrement du capital de la dette, que contre le nu-propriétaire
§4 : L’extinction de l’usufruit
I) Les causes d’extinction
Parce que l’usufruit est un droit qui, à la différence de la nue-propriété, est un droit réel qui présente un caractère temporaire, il a vocation à s’éteindre.
La raison en est que la loi n’est pas favorable au maintien d’une dissociation entre le pouvoir de disposer de la chose et le pouvoir de l’exploiter.
Aussi, l’objectif recherché est de permettre au nu-propriétaire de récupérer, à terme, les utilités de la chose, faute de quoi son droit de propriété serait vidé de sa substance et la circulation économique du bien paralysé.
Les causes d’extinction de l’usufruit sont énoncées aux articles 617 et 618 du Code civil.
A) Le décès
==> Principe
L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ». Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.
==> Tempéraments
Bien que l’interdiction qui est faite à l’usufruitier de transmettre son droit après sa mort soit une règle d’ordre public, elle comporte deux tempéraments
- Premier tempérament : l’usufruit simultané
- L’usufruit peut être constitué à la faveur de plusieurs personnes simultanément, ce qui revient à créer une indivision en usufruit.
- Cette constitution d’usufruit est subordonnée à l’existence de tous les bénéficiaires au jour de l’établissement de l’acte.
- Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteint progressivement à mesure que les usufruitiers décèdent, tandis que le nu-propriétaire recouvre corrélativement la pleine propriété de son bien sur les quotes-parts ainsi libérées
- Afin d’éviter que l’assiette de l’usufruit ne se réduise au gré des décès qui frappent les usufruitiers, il est possible de stipuler une clause dite de réversibilité.
- Dans cette hypothèse, la quote-part de celui des usufruitiers qui est prédécédé accroît celle des autres, qui en bénéficient pour la totalité, jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
- Le dernier survivant a ainsi vocation à exercer un monopole sur l’usufruit du bien.
- Second tempérament : l’usufruit successif
- L’usufruit peut également être constitué sur plusieurs têtes, non pas simultanément, mais successivement.
- Il s’agira autrement dit de stipuler une clause de réversibilité aux termes de laquelle au décès de l’usufruitier de « premier rang », une autre personne deviendra usufruitière en second rang.
- Dans cette hypothèse, les usufruitiers n’exerceront pas de pouvoirs concurrents sur la chose : ils se succéderont, le décès de l’un, ouvrant le droit d’usufruit de l’autre.
- Chacun jouira ainsi, tout à tour, de l’intégralité de l’usufruit constitué.
- Selon M. Grimaldi nous ne sommes pas en présence « d’un unique usufruit qui passerait mortis causa d’un gratifié à l’autre» mais d’« usufruits successifs, distincts qui s’ouvriront tour à tour, chacun à l’extinction du précédent par la mort de son titulaire ».
- La Cour de cassation a précisé que la clause de réversibilité de l’usufruit « s’analysait en une donation à terme de bien présent, le droit d’usufruit du bénéficiaire lui étant définitivement acquis dès le jour de l’acte» ( 1ère civ. 21 oct. 1997, n°95-19759).
- Il en résulte que seul l’exercice du droit d’usufruit est différé, non sa constitution, ce qui évite de tomber sous le coup de la prohibition des pactes sur succession future.
B) Le terme
L’article 617, al. 3 dispose que « l’usufruit s’éteint […] par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé »
À l’analyse, il est deux situations où l’usufruit n’est pas viager : lorsque, d’une part, il est assorti d’un terme stipulé par le constituant et lorsque, d’autre part, il est constitué à la faveur d’une personne morale
==> L’usufruit est assorti d’un terme stipulé par le constituant
Il est admis que le constituant assortisse l’usufruit d’un terme déterminé. Dans cette hypothèse, l’usufruit s’éteindra :
- Soit à l’expiration du terme fixé par l’acte constitutif
- Soit au décès de l’usufruitier qui peut potentiellement intervenir avant le terme fixé
La seule limite à la liberté des parties quant à la fixation du terme de l’usufruit, c’est l’impossibilité de transmettre l’usufruit à cause de mort.
==> L’usufruit est constitué au profit d’une personne morale
Dans l’hypothèse où l’usufruitier est une personne morale, il est susceptible d’être perpétuel. En effet, une personne morale vit aussi longtemps que ses associés réalisent son objet social. Or ces derniers sont susceptibles de se succéder éternellement, par le jeu, soit des transmissions à cause de mort, soit des cessions de droits sociaux.
Aussi, afin que la règle impérative qui assortit l’usufruit d’un caractère temporaire s’applique également aux personnes morales, l’article 619 du Code civil que « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans. »
Cette règle est d’ordre public, de sorte que la durée ainsi posée ne saurait être allongée. Dans un arrêt du 7 mars 2007, la Cour de cassation n’a pas manqué de le rappeler, en jugeant que « l’usufruit accordé à une personne morale ne peut excéder trente ans » (Cass. 7 mars 2007, n°06-12568).
C) La consolidation
==> Principe général
L’article 617, al 4 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire »
Cette cause d’extinction de l’usufruit correspond à l’hypothèse d’acquisition :
- Soit de la nue-propriété par l’usufruitier
- Soit de l’usufruit par le nu-propriétaire
- Soit de l’usufruit et de la nue-propriété par un tiers
Lorsque cette acquisition procède de l’accomplissement d’un acte juridique, la consolidation est subordonnée à la validité de cet acte. En cas d’irrégularité, le démembrement produira à nouveau tous ses effets.
L’acte opérant cette consolidation peut consister en une cession, une donation, un legs, un échange et plus généralement en toute opération translative de propriété.
==> Cas particulier de la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété
L’article 621 du Code civil dispose que « en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix. »
Cette disposition est directement issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités qui a tenté de régler une difficulté à laquelle étaient confrontés les praticiens du droit.
En effet, dans le cas de la cession d’un bien démembré, la question se pose fréquemment de savoir comment répartir le prix de cession entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Cette question ne concerne pas spécifiquement les partages successoraux, mais vise à préciser de manière générale le règlement de la vente globale d’un bien démembré, quel qu’en soit le contexte ou la raison.
La jurisprudence s’est abondamment prononcée en faveur de la répartition du prix de vente au prorata entre l’usufruit et la nue-propriété, considérant que tant l’usufruitier que le nu-propriétaire avaient droit à une portion du prix total correspondant à la valeur comparative de l’usufruit avec la nue-propriété (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 20 oct. 1987 ; Cass. 2e civ. 18 oct. 1989).
Il a, par suite, été jugé que les intérêts dus sur le prix de vente devaient également être partagés dans les mêmes proportions, sans que l’usufruitier puisse prétendre à leur totalité (Cass. 3e civ., 3 juillet 1991).
Mais, inversement, certains auteurs de la doctrine ont pu estimer qu’il convenait de reporter le démembrement de propriété sur le prix[4]. Cette thèse était toutefois minoritaire.
À l’examen, l’article 621, al. 1er du Code civil est venu consacrer la jurisprudence l’objectif recherché étant d’atteindre l’équité
Ainsi, cette disposition prévoit-elle que le prix de cession est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire – ou, ainsi que le dit le texte, entre l’usufruit et la nue-propriété – selon la valeur « respective » de chacun de ces droits.
Les parties conservent néanmoins la faculté de décider que l’usufruit se reportera sur le prix, ce qui revient à constituer un quasi-usufruit à la faveur de l’usufruitier, lequel pourra alors librement disposer de l’intégralité du prix de cession.
La contrepartie pour le nu-propriétaire résidera dans la restitution, à l’extinction de l’usufruit, du prix de cession lequel viendra s’imputer sur la masse successorale, puisque constituant une dette inscrite au passif. Cette dette viendra d’autant réduire l’assiette des droits de succession ; d’où l’intérêt de l’opération.
Quid de la valorisation de l’usufruit et de la nue-propriété ?
Comme dans le cas de la conversion de l’usufruit total du conjoint survivant en rente viagère, les modalités de calcul de la valorisation respective des droits démembrés ne sont pas précisées par l’article 621.
Cette imprécision renvoie alors à la totale liberté des parties, dont le contentieux éventuel devra être tranché par le juge.
À cet égard, la jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur le mode de calcul de la valeur de l’usufruit, en acceptant de ne pas l’asseoir nécessairement sur le barème de l’article 762 du Code général des impôts, dont l’application ne s’impose qu’en matière fiscale,
BARÈME DE L’USUFRUIT EN PROPORTION DE LA VALEUR EN PLEINE PROPRIÉTÉ
| Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
| Jusqu'à 20 ans | 90% | 10% |
| De 21 à 30 ans | 80% | 20% |
| De 31 à 40 ans | 70% | 30% |
| De 41 à 50 ans | 60% | 40% |
| De 51 à 60 ans | 50% | 50% |
| De 61 à 70 ans | 40% | 60% |
| De 71 à 80 ans | 30% | 70% |
| De 81 à 90 ans | 20% | 80% |
| À partir de 91 ans | 10% | 90% |
Dans un arrêt du 25 février 1997, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la répartition du prix entre les venderesses, usufruitière et nue-propriétaire des actions, devait être proportionnelle à la valeur comparative de l’usufruit et de la nue-propriété et en retenant souverainement que l’évaluation de l’usufruit devait se faire en tenant compte de l’âge de l’usufruitière et du revenu net qu’elle pouvait espérer obtenir des actions vendues » (Cass. 3e civ. 25 févr. 1997).
Une autre solution consiste à s’appuyer sur le dispositif fiscal, au moins par défaut.
Toutefois, cette méthode présente le double inconvénient d’être moins respectueuse de la liberté des parties, et de s’éloigner de la valeur économique réelle.
En pratique, il existe globalement assez peu de contentieux, et donc de jurisprudence, en matière de répartition du prix entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette situation traduit le caractère souvent consensuel des ventes de biens dont la propriété est démembrée.
Les parties se mettent en effet d’accord sur la valeur respective des droits, soit en se basant sur la valeur fiscale prévue par le code général des impôts, soit au regard des tables actuarielles dites « de Xénard » – du nom du notaire qui les a élaborées – permettant de déterminer la valeur économique de l’usufruit et auxquelles les praticiens se réfèrent souvent.
Une nouvelle évaluation de l’usufruit contraindrait à une élaboration mathématique nécessairement complexe, susceptible d’entraîner débats et contestations au plan réglementaire.
Il a donc logiquement semblé préférable de laisser aux parties, en cas de contestation devant le juge, le soin de faire fixer la valeur des droits d’usufruit et de nue-propriété par voie d’expert[5].
En tout état de cause, l’appréciation de cette valeur respective variera naturellement selon qu’il s’agit d’un usufruit à durée limitée, ou viager.
S’agissant d’un usufruit à durée limitée, la valeur fiscale de l’usufruit est fixée par le même article 669 du CGI à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de 10 ans, dans la limite de la valeur de l’usufruit viager.
D) La renonciation
Proche du mécanisme de la consolidation, la renonciation de l’usufruitier à son droit est une cause d’extinction de l’usufruit. Elle peut prendre plusieurs formes.
En effet, la renonciation peut être :
- Conventionnelle ou unilatérale
- Onéreuse ou libérale
En tout état de cause, il est admis que la renonciation emporte mutation d’un droit réel. La raison en est que la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe que lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit ou par le décès de l’usufruitier (art. 1133 CGI).
Aussi, lorsque la réunion a lieu avant l’expiration du terme convenu pour la durée de l’usufruit ou avant l’expiration normale de celui-ci par le décès de l’usufruitier, par l’effet d’une renonciation de l’usufruitier ou d’une convention quelconque, l’impôt de mutation est dû sur la convention intervenue.
En outre, lorsque l’usufruit porte sur un immeuble, obligation est faite au renonçant d’accomplir toutes les formalités de publicité foncière en application de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, faute de quoi l’acte de renonciation sera inopposable aux tiers.
Enfin, l’article 622 du Code civil prévoit que « les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice. ».
Autrement dit, si l’usufruitier agit en fraude de leurs droits, ils pourront demander la réintégration de l’usufruit dans son patrimoine pour mieux pouvoir l’appréhender en cas de mise en œuvre de procédures d’exécution forcée.
E) Le non-usage
L’article 617, al. 4 du Code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par le non-usage du droit pendant trente ans ».
Il ressort de cette disposition que, à la différence du droit de propriété qui est imprescriptible, le droit d’usufruit succombe sous l’effet de la prescription extinctive dont le délai est fixé à trente ans. Ce délai court à compter du dernier acte accompli par l’usufruitier.
Il est indifférent que l’usufruit s’exerce sur un meuble ou un immeuble : la prescription extinctive produit ses effets dès lors qu’est constaté le non-usage de la chose.
A contrario, cela signifie que dès lors que l’usufruitier exerce son droit d’user et de jouir de la chose, même très rarement, le jeu de la prescription extinctive est neutralisé.
Plus précisément, cela suffit à l’interrompre et donc à effacer le délai de prescription acquis et faire courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
À cet égard, il importe peu que l’acte interruptif soit accompli par l’usufruitier lui-même ou qu’il soit accompli par un tiers en son nom (locataire, mandataire, etc.)
F) L’usucapion
Bien que prévu par aucun texte, il est admis que l’usufruit puisse être acquis par le jeu de la prescription acquisitive attachée à la possession, ce qui a pour conséquence de faire perdre à l’usufruitier initial son droit de jouissance sur la chose.
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
La prescription acquisitive aura vocation à jouer lorsque celui qui tire profit de la jouissance de la chose se comportera comme le véritable usufruitier.
Tel sera notamment le cas, lorsqu’il aura acquis l’usufruit, en vertu d’un titre, auprès d’une personne qui n’était pas le véritable propriétaire du bien. Le possesseur aura ainsi été institué usufruitier a non domino.
S’agissant de la durée de la prescription acquisitive, elle dépend de la nature du bien objet de la possession.
- S’il s’agit d’un immeuble, la prescription pourra être de 10 ans en cas de bonne foi du possesseur et de justification d’un juste titre. À défaut, la durée de la prescription acquisitive est portée à trente ans.
- S’il s’agit d’un meuble, l’effet acquisitif de la possession est immédiat, sauf à ce que le possesseur soit de mauvaise foi auquel cas la durée de la prescription sera de trente ans.
G) La perte de la chose
==> Principe
L’article 617, al. 4 du Code civil prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »
La perte de la chose a donc pour conséquence de mettre fin à l’usufruit, car le privant d’objet.
Cette perte peut consister :
- Soit en une disparition de la chose lorsqu’elle est corporelle
- Soit en la perte d’un droit lorsque la chose est incorporelle
À cet égard, les auteurs assimilent à la perte de la chose, le cas où elle ferait l’objet d’une modification qui l’altérerait dans ses caractères essentiels et qui la rendrait impropre à l’usage auquel elle était destinée (V. en ce sens Aubry et Rau).
En outre, l’article 624 du Code civil envisage le cas particulier de l’usufruit portant sur un immeuble.
Cette disposition distingue, selon qu’est ou non inclus dans son assiette le sol.
- L’usufruit porte sur le sol et le bâtiment
- Dans cette hypothèse, en cas de destruction du bâtiment, l’usufruit pourra continuer à jouir du sol et des matériaux
- L’usufruit porte sur le seul bâtiment
- Dans cette hypothèse, en cas de destruction du bâtiment soit par incendie ou par un autre accident, ou qu’il s’écroule de vétusté, l’usufruitier n’aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.
Enfin, le texte précise que seule la perte totale de la chose a pour effet d’éteindre l’usufruit. Lorsque, par conséquent, cette perte n’est que partielle, les droits de l’usufruitier subsistent, l’assiette de l’usufruit s’en trouvant seulement réduite.
L’article 623 du Code civil prévoit en ce sens que « si une partie seulement de la chose soumise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se conserve sur ce qui reste. »
==> Exception
Par exception, il est admis que lorsque la perte de la chose donne lieu au paiement d’une indemnité, l’usufruit se reporte sur cette indemnité par le jeu d’une subrogation réelle.
Pour rappel, cette forme de subrogation réalise la substitution, dans un patrimoine, d’une chose par une autre.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
La subrogation réelle est susceptible d’intervenir dans trois situations distinctes :
- La perte de la chose donne lieu à l’octroi d’une indemnité d’assurance
- La perte de la chose a pour cause une expropriation pour cause d’utilité publique dont la contrepartie est le paiement d’une juste et préalable indemnité.
- L’article L. 13-7 du Code de l’expropriation prévoit en ce sens que « dans le cas d’usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l’usufruitier exercent leurs droits sur le montant de l’indemnité au lieu de les exercer sur la chose. »
- La perte de la chose donne lieu au paiement de dommages et intérêts
H) La déchéance pour abus de jouissance
L’article 618 du Code civil dispose que « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
Il ressort de cette disposition que l’usufruitier peut être déchu de son droit lorsqu’il commet un abus de jouissance.
Par abus de jouissance, il faut entendre une faute dont la gravité est de nature à altérer la substance du bien grevé par l’usufruit ou à en menacer la restitution.
Aussi, doit-il s’agit d’une faute commise, soit par l’usufruitier, soit par la personne dont il répond.
Au nombre des fautes constitutives d’un abus de jouissance, l’article 618 vise expressément :
- Les dégradations sur le fonds
- Le dépérissement du fonds par manque d’entretien
Dans un arrêt du 12 mars 1970, la Cour de cassation a de la sorte validé la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé que « Dame veuve X était responsable de la ruine des immeubles soumis à son usufruit “même si x… Michel avait la charge de faire procéder en même temps qu’elle a des travaux confortatifs “, a constaté qu’un défaut d’entretien, remontant à dix-neuf années et imputable à l’usufruitière, avait entraîné la détérioration du gros œuvre des immeubles » (Cass. 3e civ. 12 mars 1970).
De son côté, la jurisprudence a admis qu’une le changement de destination du bien soumis à l’usufruit était susceptible de constituer un abus de jouissance.
Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est, en effet, fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
C’est ainsi que dans un arrêt du 4 juin 1975 la Cour de cassation a jugé que « la conclusion d’un bail commercial sur des lieux destines à un autre usage constitue en elle-même une altération de la substance de la chose soumise à usufruit et peut caractériser un abus de jouissance de nature à entraîner la déchéance de l’usufruit » (Cass. 3e civ. 4 juin 1975, n°74-10777).
II) Les effets de l’extinction
L’extinction de l’usufruit emporte deux conséquences :
- La restitution de la chose
- Le règlement des comptes
A) La restitution de la chose
- Principe
==> Droit commun
La première obligation qui échoit à l’usufruitier à l’expiration de son droit consiste à restituer la chose soumise à l’usufruit au nu-propriétaire
Cette restitution doit, en principe, intervenir en nature. Elle doit alors être restituée dans l’état où elle se trouvait au moment de la délivrance, et plus précisément tel que décrit dans l’inventaire qui a été dressé en application de l’article 600 du Code civil.
À défaut d’inventaire, notamment dans le cas d’une dispense, il appartiendra au nu-propriétaire de prouver que l’état dans lequel le bien lui est restitué ne correspond pas à celui dans lequel il se trouvait au jour de sa délivrance.
==> Cas particulier de l’universalité de biens
Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de biens, il convient de distinguer selon que cette universalité est de droit ou de fait
- L’usufruit d’une universalité de fait
- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur un ensemble de biens unis par une même finalité économique.
- Tel est le cas notamment du fonds de commerce qui regroupe l’ensemble des biens nécessaires à l’exploitation d’une activité commerciale déterminée.
- Lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Il ne s’agit donc pas d’un quasi-usufruit, mais bien d’un usufruit ordinaire.
- Appliqué au fonds de commerce, cela signifie que, à l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier devra restituer un fonds de commerce de valeur équivalente.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent le fonds de commerce (machines, outils, marchandises, matières premières etc.)
- L’usufruitier est ainsi autorisé à accomplir tous les actes de nécessaires à l’exploitation de l’activité commerciale (achat et vente de marchandises etc.)
- À cet égard, c’est lui qui percevra les bénéfices tirés de l’exploitation du fonds, tout autant que c’est lui qui endossera la qualité de commerçant et qui, à ce titre, sera soumis à l’obligation d’immatriculation.
- L’usufruit d’une universalité de droit
- Dans cette hypothèse, l’usufruit porte sur une masse de biens qui, de nature et d’origine diverses, et matériellement séparés, ne sont réunis par la pensée qu’en considération du fait qu’ils appartiennent à une même personne
- Autrement dit, l’usufruit a ici pour objet un patrimoine ou une fraction de patrimoine.
- Selon le cas, il sera qualifié d’usufruit à titre universel ou d’usufruit à titre particulier.
- Cette forme d’usufruit se rencontre le plus souvent consécutivement à une dévolution successorale ou testamentaire.
- Lorsqu’il porte sur un patrimoine, la portée de l’usufruit est radicalement différente de la situation où il a pour objet une universalité de fait.
- En effet, l’assiette du droit de l’usufruitier est constituée par l’ensemble des biens qui composent le patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
- La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
- Pour les autres biens, non-consomptibles, il devra les restituer au nu-propriétaire dans le même état que celui dans lequel ils se trouvaient au jour de la délivrance
2. Exceptions
==> La restitution de la chose par équivalent
Il est des cas où la restitution de la chose ne pourra pas intervenir en nature. Il en va ainsi lorsque soit la chose est consomptible, soit elle a été perdue.
- La chose est consomptible
- Les choses consomptibles sont celles qui se consomment par le premier usage, en ce sens qu’elles disparaissent à mesure de l’utilisation que l’on en fait.
- Exemple: l’argent, des aliments, une cartouche d’encre etc.
- À l’évidence, lorsque l’usufruit porte sur une chose consomptible, cette situation soulève une difficulté qui tient à la fonction même de l’usufruit.
- Il est, en effet, de principe que l’usufruit ne confère à l’usufruitier qu’un droit d’usage sur la chose, de sorte qu’il ne peut pas en disposer.
- Si l’in appliquait cette règle strictement aux choses consomptibles, cela reviendrait à priver l’usufruitier d’en jouir et donc de vider le droit réel dont il est titulaire de sa substance.
- C’est la raison pour laquelle, par exception, l’usufruitier est autorisé à disposer de la chose, telle le véritable propriétaire (on parle alors de quasi-usufruit).
- L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution».
- En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
- La chose a été perdue
- Lorsque cette situation se présente, par hypothèse, la chose ne peut pas être restituée au nu-propriétaire.
- Il est donc fondé à réclamer une restitution par équivalent, laquelle prendra la forme de dommages et intérêts
- Une indemnisation sera également due en cas de détérioration de la chose imputable à l’usufruitier ou à la personne dont il répond
- Afin d’évaluer la valeur de la chose, il conviendra de se reporter à l’inventaire qui devrait comporter une estimation de sa valeur
==> La restitution de la chose en l’état
L’article 589 du Code civil dispose que « si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. »
Ainsi, lorsque la détérioration procède d’un usage normal de la chose, il n’y a pas lieu pour l’usufruitier à indemniser le nu-propriétaire.
On considère ici qu’elle se serait autant détériorée si elle avait été entre ses mains. Si toutefois cette détérioration résulte d’un manquement imputable à l’usufruitier qui n’aurait pas joui de la chose comme un bon père de famille, il sera redevable de dommages et intérêts à l’égard du nu-propriétaire.
==> L’absence de restitution de la chose
L’article 607 du Code civil prévoit que « ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. »
Lorsqu’ainsi la détérioration de la chose est due à un événement indépendant de la volonté de l’usufruitier (phénomène naturel, guerre, grève etc.) il ne doit aucune indemnité au nu-propriétaire et inversement.
B) Le règlement des comptes
À l’expiration de l’usufruit, il conviendra de procéder à un règlement des comptes afin de déterminer ce que doit l’usufruitier au nu-propriétaire et ce qui lui est dû
1. S’agissant des dettes de l’usufruitier
À l’expiration de l’usufruit, le nu-propriétaire est en droit de réclamer à l’usufruitier :
- Les indemnités dues en réparation de la détérioration fautive de la chose ( 618 C. civ.)
- Les intérêts charges extraordinaires au nombre desquelles figurent les frais de bornage, de clôture ( 609 C. civ.)
- Restitution des fruits civils perçus postérieurement à l’expiration de l’usufruit ( 586 C. civ.)
2. S’agissant des créances de l’usufruitier
==> Principe général
À l’expiration de son droit, l’usufruitier est susceptible de solliciter auprès du nu-propriétaire le remboursement :
- Du montant réglé au titre des grosses réparations, dans la limite de la plus-value apportée à l’immeuble
- Des avances effectuées au titre des charges extraordinaires
==> Sort des dépenses d’amélioration
Il peut être précisé que lorsque l’usufruitier a entrepris des travaux d’amélioration, les dépenses engagées demeurent à la charge de l’usufruitier.
Par amélioration, il faut entendre tous les travaux qui ne se justifient pas par la conservation du bien et qui visent, au contraire, à lui apporter une plus-value.
L’article 599, al. 2e du Code civil prévoit en ce sens que « l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. »
Dans un arrêt du 12 juin 2012 la Cour de cassation elle a fait une application de la règle ainsi énoncée en jugeant que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien et que les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ; que ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée » (Cass. com. 12 juin 2012, n°n° 11-11424).
L’objectif recherché ici est d’éviter tout contentieux sur l’estimation de la plus-value réalisée et de protéger le nu-propriétaire de dépenses dispendieuses qui pourraient être engagées par l’usufruitier, celui-ci pouvant être encouragé par la perspective d’être intégralement indemnisé à l’expiration de son droit. Ce sera là une charge très lourde qui pourrait être imposée au nu-propriétaire, alors même qu’il n’a rien demandé, ni n’a été en mesure d’y consentir.
Pour c’est raison, il est constant en jurisprudence que les dépenses d’amélioration demeurent à la charge du seul usufruitier.
Cette position n’est pas sans faire l’objet de critiques dans la mesure où cela revient :
- D’une part, à admettre un cas d’enrichissement sans cause, ce en contravention avec l’article 1303 du Code civil
- D’autre part, à placer l’usufruitier dans une situation bien moins avantageuse que le possesseur de mauvaise foi qui, en application de l’article 555, al. 3 du Code civil, est fondé à obtenir une indemnité lorsqu’il a édifié une construction sur le fonds qu’il occupe et que le propriétaire décide d’exercer son droit à la conserver
Malgré ces critiques, la jurisprudence est demeurée intransigeante. Elle a notamment refusé de distinguer, ainsi que cela avait été suggéré, de distinguer selon que la défense engagée vise à améliorer le bien soumis à usufruit ou à en acquérir un nouveau.
La Cour de cassation considère que cette règle s’applique en tout état de cause, y compris lorsque l’amélioration du bien consiste en l’édification d’une construction/
Dans un arrêt du 4 novembre 1885, elle a par exemple jugé que « suivant l’esprit de [l’article 599], on ne doit considérer comme améliorations soit les constructions ayant pour effet d’achever un bâtiment commencé, ou bien d’agrandir un édifice préexistant » (Cass. req. 4 nov. 1885).
Dans un arrêt du 19 septembre 2012 la troisième chambre civile a précisé « qu’il n’existait aucun enrichissement pour la nue-propriétaire qui n’entrera en possession des constructions qu’à l’extinction de l’usufruit, l’accession n’a pas opéré immédiatement au profit du nu-propriétaire du sol » (Cass. 3e civ. 19 sept. 2012, n°11-15460).
Seule limite à la règle ainsi posée : l’alinéa 3 de l’article 599 du Code civil autorise l’usufruitier à « enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. »
[1] F. Zénati et Th. Revet, Les biens, éd. PUF, 2008, n°244
[2] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, t.1, p. 253, n°228.
[3] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, t.1, p. 253, n°228.
[4] F.-X. Royet, « L’article 815-5 du Code civil et la vente en pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit », J.C.P. 1985, I, p. 102. De même, voir étude de J. Patarin, Rép. Defrénois 1954, art. 27306.
[5] V. en ce sens étude publiée au Defrenois par M. L.-C. Brault, notaire, n° 36042, en 1995.