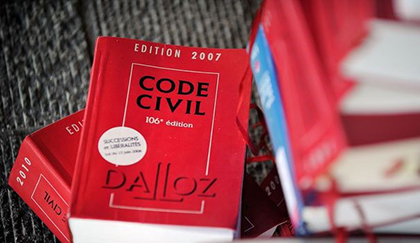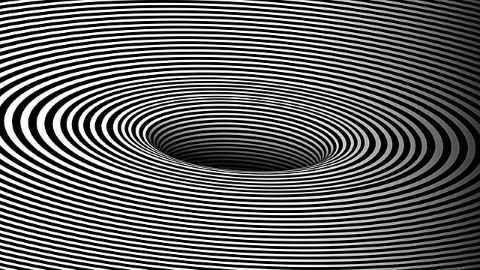Les servitudes unilatérales se caractérisent par l’absence de réciprocité de la charge qui pèse le propriétaire d’un fonds.
Surtout, à la différence de la servitude réciproque, la servitude unilatérale donne lieu à une indemnisation du propriétaire du fonds servant. Son préjudice n’est, en effet, pas compensé par la réciprocité de la charge qui pèse sur lui.
Aussi, une indemnité est due par le propriétaire du fonds dominant, dont la propriété est valorisée par l’existence d’une telle servitude constituée à son profit.
L’illustration même de la servitude unilatérale, c’est la servitude de passage qui est une servitude positive puisqu’elle autorise le propriétaire du fonds dominant à accomplir un acte sur le fonds servant (passage, puisage etc.), à la différence des servitudes négatives qui exigent du propriétaire du fonds servant une abstention.
Cette servitude légale est régie aux articles 682 à 685-1 du Code civil, étant précisé qu’elle n’est envisagée qu’en cas d’enclave du fonds. L’une des principales difficultés consistera ainsi à définir ce qu’est un fonds enclavé, puisque c’est ce qui déterminera la constitution d’une servitude de passage.
A) Constitution de la servitude
L’article 682 du Code civil prévoit que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Ainsi, en cas de situation d’enclave d’un fonds, soit sans issue sur la voie publique, la loi confère à son propriétaire le droit d’exiger l’établissement d’un passage sur le fonds voisin.
L’objectif recherché ici par le législateur est de permettre l’exploitation du fonds conformément à sa destination. Sans accès à la voie publique, l’exercice du droit de propriété sur le fonds est, en effet, pour le moins limité, sinon illusoire.
Aussi, afin que le fonds enclavé puisse être exploité et puisse arborer une certaine valeur marchande dans une logique de circulation économique des biens une servitude légale est consentie au propriétaire.
L’exercice de cette servitude – de passage – est néanmoins subordonné à la réunion de plusieurs conditions, à commencer par l’existence d’une situation d’enclave.
Cette situation doit, par ailleurs, ne peut être le fait du propriétaire du fonds enclavé faute de quoi il ne pourra se prévaloir d’aucun droit de passage sur le fonds voisin.
- Principe
1.1 Les conditions tenant à la configuration du fonds
Il ressort de l’article 682 du Code civil que pour que puisse être constituée une servitude de passage :
- D’une part, le fonds doit être enclavé
- D’autre part, un besoin d’exploitation du fonds doit exister
a) Un fonds enclavé
Première condition exigée pour qu’une servitude de passage puisse être constituée, le propriétaire qui s’en prévaut doit justifier de l’état d’enclave de son fonds.
Cette condition ressort expressément de l’article 682 du Code civil qui définit le fonds enclavé comme celui qui ne comporte, soit aucune issue, soit qu’un accès réduit et insuffisant à la voie publique.
La situation d’enclave se caractérise ainsi par la réunion de deux éléments cumulatifs
- L’absence ou l’insuffisance d’accès à une voie
- L’absence de voie ouverture au public
a.1. L’absence ou l’insuffisance d’accès à une voie
==> L’absence d’issue sur la voie publique
L’article 682 du Code civil prévoit que le fonds enclavé est d’abord celui « qui n’a sur la voie publique aucune issue »
À l’examen, cette absence d’issue peut tenir, soit à l’impossibilité physique s’accéder au fonds, soit à une impossibilité juridique.
- L’impossibilité matérielle d’accéder au fond
- Critère physique
- La situation d’enclave d’un fonds est le plus souvent liée à la configuration des lieux qui rendent sont accès impossible.
- Cette situation se rencontrera lorsque le fonds est entouré par des terres qui appartiennent à d’autres propriétaires.
- Il a par exemple été jugé dans un arrêt du 30 janvier 1884 rendu par la Cour de cassation que l’état d’enclave était caractérisé lorsque le fonds était séparé de la voie publique par un talus dont la pense rendait impossible le passage des chevaux et des bestiaux affectés à son exploitation ( req. 30 janv. 1884).
- Plus généralement, cet état d’enclave est établi lorsqu’il est physiquement impossible d’aménager un accès à la voie publique, en raison du relief, de la position du fonds, ou de la configuration des lieux.
- Il convient enfin d’observer que l’état d’enclave s’apprécie globalement, soit en considération de l’ensemble des parcelles contiguës susceptibles d’être détenus par un même propriétaire et constituant un même fonds.
- En effet, La servitude de passage est réservée à celui dont le fonds est enclavé, et n’est pas applicable dès lors que seulement l’une des parcelles qui compose le fonds est enclavée.
- La demande en reconnaissance de servitude de passage est par conséquent infondée dès lors que le fonds est constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, le propriétaire de ce fonds devant faire son affaire de l’enclavement de l’autre parcelle (CA Douai, 1re ch., 2e sect., 25 janv. 2018, n° 17/02067).
- Critère économique
- Afin d’apprécier le caractère enclavé d’un terrain, les juridictions tiennent compte du coût des travaux à réaliser pour établir une communication avec la voie publique.
- Dans un arrêt du 4 juin 1971 la Cour de cassation a jugé en ce sens que l’état d’enclave était établi lorsque les chemins ruraux permettant d’accéder au fonds sont impraticables et que leur remise en état engendrerait une dépense excessive « qui serait hors de proportion avec l’usage qui en serait fait et la valeur de la propriété» ( 3e civ. 4 juin 1971, n°70-11857).
- Les juges refuseront, en revanche, de considérer qu’un fonds est enclavé lorsqu’il est possible de le rendre accessible en mettant en œuvre des moyens normaux et raisonnables.
- Ainsi, les juridictions doivent-elles vérifier si le propriétaire du fonds enclavé ne dispose pas d’une solution de nature à remédier à l’absence d’issue ( 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-18488).
- Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a par exemple reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « comme il le lui était demandé, s’il suffisait à Mme X… de réaliser sur ses parcelles des travaux permettant un accès à la voie publique dont le coût ne serait pas disproportionné par rapport à la valeur de son fonds» ( 3e civ. 8 juill. 2009, n°08-11745).
- La troisième chambre civile a néanmoins précisé dans un arrêt du 8 avril 1999, qu’il n’appartient pas au juge de procéder d’office à cette recherche tenant à la disproportion du coût des travaux à réaliser pour désenclaver le fonds ( 3e civ. 8 avr. 1999, n°97-11716).
- Ce moyen doit être soulevé par les parties, faute de quoi le juge ne pourra pas tenir compte du critère économique pour déterminer si le fonds est enclavé.
- Critère physique
- L’impossibilité juridique d’accéder au fonds
- La situation d’enclave d’un terrain ne tient pas seulement à la configuration physique des lieux, elle peut également procéder de contraintes juridiques.
- Tel sera le cas lorsque l’accès à la voie publique est interdit, soit par une règle juridique, soit par une décision prise par une autorité compétente.
- Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la Cour de cassation a, par exemple, admis l’état d’enclave juridique d’un fonds, au motif que « le certificat d’urbanisme interdisait tout accès direct depuis la route départementale 183 au fonds de la SCI»
- Or dans la mesure où cette dernière « ne pouvait se voir contrainte à exercer un recours à l’encontre de cet acte […] le fonds concerné était enclavé et devait bénéficier d’une servitude légale de passage» ( 3e civ. 14 janv. 2016, n°14-26640).
- Dans un arrêt du 8 octobre 1985, la troisième chambre civile a précisé qu’il ne suffit pas que l’accès à la voie publique soit subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative, encore faut-il que la demande d’autorisation soit valablement refusée ( 3e civ. 8 oct. 1985, n°84-12213).
==> L’insuffisance de l’issue sur la voie publique
La situation d’enclave d’un fonds est caractérisée, non seulement lorsque celui-ci ne comporte aucune issue, mais encore lorsque l’accès qui le relie à la voie publique est insuffisant.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par la notion d’« issue insuffisance » visée par l’article 682 du Code civil.
À l’examen, cette insuffisance d’accès est appréciée, selon la formule de la Cour de cassation, en considération « de l’état des lieux et des communications nécessaires à l’utilisation normale du fonds dominant, compte tenu de sa destination » (Cass. 1ère civ. 8 mars 1965, n°63-11698).
En la matière les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain d’appréciation, la Cour de cassation se limitant à un contrôle restreint de la motivation (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004, n° 03-15151).
L’insuffisance d’accès justifiant la constitution d’une servitude de passage résultera le plus souvent de la configuration des lieux.
Tel est le cas notamment lorsque l’accès qui relie le fonds à la voie publique est :
- Soit trop étroit, de telle sorte qu’il ne peut pas être emprunté en voiture ou qu’il n’est pas possible de faire passer des véhicules utilitaires ou des engins agricoles (V. en ce sens 3e civ., 16 mars 2017, 15-28551).
- Soit trop dangereux, en ce sens que son utilisation fait courir un risque au propriétaire car supposant, par exemple, d’emprunter une voie d’eau, de longer une falaise ou encore d’utiliser un chemin escarpé en proie aux éboulements ( req., 31 juill. 1844).
En revanche, l’état d’enclave sera refusé :
- Soit en cas de possibilité d’aménagement de l’accès
- Lorsque des travaux dont le coût n’est pas excessif eu égard la valeur du fonds peuvent être réalisés afin d’aménager un accès à la voie publique, le terrain ne sera pas considéré comme enclavé ( 3e civ., 11 févr. 1975, n° 73-13974).
- Ainsi, lorsque les obstacles qui limitent l’accès peuvent être facilement supprimés au moyen d’aménagement peu coût, le propriétaire du fonds ne sera pas fondé à réclamer la constitution d’une servitude.
- Il ne faut toutefois pas que le coût des travaux à réaliser soit hors de proportion avec l’usage qui sera fait du fonds et la valeur de la propriété.
- C’est donc sur la base d’un critère économique qu’il pourra être déterminé si un aménagement de l’accès à la charge du propriétaire du fonds est envisageable dans des conditions raisonnables.
- Soit en cas de simple commodité
- Un terrain ne sera pas considéré comme enclavé lorsque l’insuffisance d’accès dont se prévaut le propriétaire du fonds procède d’une simple commodité personnelle, en ce sens que la constitution de la servitude n’est pas indispensable à l’usage normal du fonds ( 3e civ. 24 juin 2008, n°07-15944).
- Tel sera le cas lorsque le fonds dispose déjà d’un accès à la voie publique et que son propriétaire cherche à réduire son temps de trajet pour y accéder (CA Nîmes, 2e ch. civ., A, 6 oct. 2016, n° 14/04909)
- Si dès lors il existe un passage suffisant pour accéder au fonds, la demande de désenclavement ne pourra pas prospérer, les juridictions considérant qu’elle relève de la simple commodité ainsi que de la convenance personnelle.
- La constitution d’une servitude de passage est une atteinte significative au droit de propriété
- Aussi, ne doit-elle être admise que lorsqu’il est démontré qu’elle est indispensable et que le propriétaire du fonds ne dispose d’aucune alternative raisonnable pour y accéder.
a.2. L’existence d’une voie ouverte au public
L’état d’enclave suppose, outre la difficulté d’accès au fonds, l’absence d’issue sur la voie publique.
La notion de « voie publique » doit être entendue de façon extensive, en ce sens qu’il faut l’envisager, non pas sous l’angle du droit public – ce qui exclurait les voies privées –, mais la comprendre dans une acception générale.
Par « voie publique », il faut ainsi plutôt comprendre voie « ouverte au public » ou « affectée à l’usage du public ».
Il suffit pour s’en convaincre de tourner le regard vers un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 13 mai 2009 (Cass. 3e civ. 13 mai 2009, n°08-14640).
Dans cette affaire, une Cour d’appel avait admis la constitution d’une servitude de passage considérant que le fonds bénéficiaire était seulement desservi par des voies privées et non par une voie publique.
La Cour de cassation censure cette décision au motif que les juges du fonds auraient dû rechercher si les parcelles étaient ouvertes au public et permettaient à leur propriétaire d’accéder à son fonds.
Le statut de la voie par laquelle est desservi le fonds est ainsi sans incidence sur la qualification d’enclave. Il est indifférent que cette voie relève du domaine privé ou qu’elle soit détenue à titre privatif.
Seul importe qu’elle soit ouverte au public et que, par conséquent, elle puisse être empruntée par le propriétaire du fonds qui se prévaut d’une situation d’enclave.
Au nombre des voies affectées à l’usage du public figurent les voies terrestres mais également les voies d’eau, pourvu qu’elles constituent les moyens normaux de communication, de transport et d’exploitation des terrains qui les bordent.
Dès lors que la voie est interdite d’accès au public et qu’elle représente la seule issue pour un fonds, la situation d’enclave sera établie (CA Nancy, 1re ch. civ., 9 déc. 2008).
b) Le besoin d’exploitation du fonds
==> Utilisation normale du fonds
Pour que l’état d’enclave soit caractérisé, il ne suffit pas d’établir l’absence ou l’insuffisance d’issue stricto sensu, il faut encore démontrer que la difficulté d’accès empêche l’exploitation du fonds et plus précisément son utilisation normale.
C’est là le sens de l’article 682 du Code civil qui précise qu’il y a enclave si l’issue est insuffisante pour la desserte complète du fonds dans lequel est exercée une activité agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété ou sur lequel sont susceptibles d’être réalisées des opérations de construction ou de lotissement.
Selon le Doyen Cornu, « l’état d’enclave est toujours apprécié par rapport à une situation d’activité. ». Autrement dit, la desserte doit toujours s’apprécier en fonction de l’exploitation de la parcelle enclavée et des moyens nécessaires à celle-ci, étant précisé que cette desserte doit être complète (Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n ° 16-22841).
Alors que l’article 682 du Code civil ne vise que des activités professionnelles comme susceptibles de justifier l’état d’enclave, la Cour de cassation considère que la notion d’exploitation doit être entendue largement, ce qui signifie que la constitution d’une servitude de passage peut être sollicitée pour n’importe quel besoin d’exploitation du fonds (V. en ce sens Cass. req., 7 mai 1879).
Ainsi, pour la Cour de cassation, « le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, est fonction non de l’existence d’une exploitation agricole ou industrielle, au sens étroit de ces termes, mais de l’utilisation normale du fonds, quelle qu’en soit la destination » (Cass. 1ère civ. 2 mai 1961).
Dans le même sens, la Cour de cassation rappelle régulièrement, sous la même formulation, que l’article 682 du Code civil ne distingue pas « entre les divers modes d’exploitation dont peut être l’objet le fonds dominant » (Cass. 3e civ. 7 avr. 1994, n°89-20964 ; Cass. 3e civ. 2 juin 1999, n°96-21594).
La Cour de cassation a ainsi admis qu’un fonds était enclavé, car l’exploitation d’un cinéma exigeait la création d’une issue de secours (Cass. 3e civ. 5 mars 1974). Elle a statué dans le même sens dans les situations suivantes :
- Besoin de la création d’un passage qui puisse être emprunté par un véhicule, compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d’incendie ( 3e civ. 28 oct. 1974).
- Besoin de la création d’un passage qui puisse être emprunté par des machines agricoles pour les besoins d’exploitation du fonds ( 3e civ. 9 mars 1976)
- Besoin de la création d’un passage pour que la clientèle d’un hôtel puisse y accéder au moyen d’un véhicule (CA Chambéry, 2e ch., 11 oct. 2005, n° 04/01893).
- Besoin de la création d’un passage en raison de la construction d’un grand ensemble immobilier, le fonds bénéficiaire étant insuffisamment desservi pour la réalisation de cette opération ( 3e civ. 29 avr. 1981).
Ce qui devra être démontré par le propriétaire du fonds qui se prévaut d’un droit de passage sur le fonds voisin, c’est que sans la constitution de la servitude il ne peut pas faire un usage normal de son fonds.
L’appréciation des besoins d’utilisation normale du fonds sera appréciée objectivement par le juge qui vérifiera si le besoin exprimé est réel et réalisable.
Si, en effet, il s’agit de solliciter un droit de passage en prétextant qu’il a vocation à permettre la réalisation d’une opération immobilière, alors que le terrain ne se situe pas sur une zone constructible, la demande sera rejetée par le juge (CA Aix-en-Provence, 4e ch., A, 2 juill. 2015, n° 14/17422).
==> Changement de destination
S’agissant du changement de destination du fonds, la Cour de cassation considère qu’il ne s’agit pas d’un obstacle à la constitution d’une servitude de passage (V. en ce sens Cass. req. 7 mai 1879).
Dans un arrêt du 4 octobre 2000, la troisième chambre civile a, par exemple, confirmé la décision d’une Cour d’appel qui avait admis que le changement de destination d’un terrain puisse justifier l’octroi d’un droit de passage à son propriétaire sur le fonds voisin.
Les juges du fonds avaient constaté que « le terrain des consorts X…, précédemment à vocation agricole et forestière, avait été classé en zone constructible du plan d’occupation des sols (POS) modifié de la commune, que l’autorisation de bâtir avait cependant été refusée en 1995 en raison de ce que le projet ne comportait qu’un accès unique, générateur d’insécurité dans l’usage de la voie publique, et relevé que l’opération de lotissement envisagée constituait une utilisation normale du fonds »
Prenant ensuite considération « les exigences du POS en la matière et les nécessités de circulation découlant de la vocation nouvelle du fonds des consorts X… à être loti », ils en déduisent que « les passages existants, reliant les terrains des demandeurs à la voie publique à travers ceux de la SICA, tels que résultant de servitudes conventionnelles, n’assuraient pas une desserte suffisante du futur lotissement, et que celui-ci se trouvait donc en état d’enclave » (Cass. 3e civ. 4 oct. 2000, n°98-12284).
Il est donc indifférent que la demande de droit de passage soit fondée sur le changement de destination du fonds dont l’exploitation qui était antérieurement à vocation agricole, est devenue industrielle.
Ce qui importe c’est que la nouvelle exploitation corresponde à une utilisation normale et légitime du fonds (CA Chambéry, 6 févr. 1951).
Dans un arrêt du 25 juin 1997, la Cour de cassation a affirmé que le changement de destination du fonds ne devait pas être confondu avec la situation de l’enclave volontaire, cause d’exclusion de la constitution d’une servitude de passage, dès lors que la nouvelle exploitation s’apparentait à une utilisation normale du fonds (Cass. 3e civ. 25 juin 1997, n°95-15772).
1.2. Les conditions tenant à l’exercice du droit de passage
La constitution d’une servitude ne suppose pas seulement que soit établie une situation d’enclave, il faut encore que :
- D’une part, que celui qui se prévaut d’un droit de passage soit titulaire d’un droit réel
- D’autre part, que le propriétaire du fonds grevé par la servitude soit indemnisé
==> La titularité du droit
La question qui se pose ici est de savoir qu’elle est la nature du droit qui doit être exercé sur le fonds enclavé pour que celui qui l’exploite soit fondé à solliciter un droit de passage.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 682 du Code civil qui ne laisse que peu de place à l’ambiguïté.
Il ressort, en effet, de cette disposition que seul « le propriétaire dont les fonds sont enclavés » peut solliciter la constitution d’une servitude de passage.
Plus généralement, il est admis que la demande d’octroi d’un droit de passage puisse émaner de celui qui exerce un droit réel sur le fonds.
Dans un arrêt du 6 juin 1999, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le texte, qui accorde l’exercice de l’action au titulaire possédant un droit réel sur le fonds dominant, n’interdisant nullement que cette utilisation du fonds soit mise en œuvre par un autre que le propriétaire, auquel celui-ci a donné son agrément » (Cass. 3e civ. 6 juin 1969).
Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire d’être investi de tous les attributs du droit de propriété pour solliciter la constitution d’une servitude de passage. Ce droit est également ouvert à l’usufruitier, l’usager ou l’emphytéote.
En revanche, les personnes qui exploitent le fonds au titre d’un droit personnel qu’ils exercent contre le propriétaire, ne sont pas fondées à solliciter l’octroi d’un droit de passage sur le fonds voisin.
Dans un arrêt du 2 mars 1983, la Cour de cassation a, par exemple, jugé « qu’un fermier est sans droit à se prévaloir de l’état d’enclave pour réclamer une servitude de passage au profit du fonds qui lui est donne à bail » (Cass. 3e civ. 2 mars 1983, n°81-16323).
La même solution pourrait être retenue pour le titulaire d’un bail commercial ou d’un bail d’habitation, celui-ci n’étant investi que d’un droit personnel contre le bailleur.
Dans un arrêt du 18 décembre 1991, la troisième chambre civile a précisé que « toute servitude étant une charge imposée à un héritage pour l’usage et l’utilité d’un autre héritage, seules peuvent être prises en considération, pour reconnaître à un fonds le bénéfice d’une servitude, les conditions que les conventions ou la loi ont posées pour ce bénéfice [de sorte] qu’il importe peu, lorsque le fonds est mis en vente, que la réclamation de la servitude soit formulée par le propriétaire vendeur ou le propriétaire acquéreur » (Cass. 3e civ. 18 déc. 1991, n°89-19245).
==> Versement d’une indemnité
L’article 682 du Code civil prévoit que si le propriétaire d’un fonds enclavé peut solliciter la constitution d’une servitude sur le fonds voisin, cette constitution ne peut intervenir qu’en contrepartie du versement « d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
Cette indemnité vise à réparer le préjudice résultant de l’atteinte portée au droit de propriété du propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage.
Dans un arrêt du 16 avril 1973, la Cour de cassation a précisé que « le propriétaire d’un fonds assujetti au passage a droit à une indemnité proportionnée au dommage que le passage peut occasionner, donc indépendante du profit procuré au propriétaire du fonds enclave » (Cass. 3e civ. 16 avr. 1973, n°71-14703).
Il en résulte que l’indemnité versée doit être fixée en considération, non pas de la valeur vénale du terrain correspondant à l’assiette de passage, mais du seul préjudice occasionné par le passage (V. en ce sens Cass. 3e civ. 9 févr. 1994, n°92-11500).
S’agissant de la forme de l’indemnité, elle peut consister en le versement d’un capital ou d’une redevance annuelle (Cass. req. 15 juin 1875).
Enfin, l’article 685, al. 2e du Code civil prévoit que « l’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. »
La prescription de l’action est ici attachée à la possession de la servitude par le propriétaire du fonds dominant, de sorte qu’elle se prescrit par trente ans.
Son point de départ correspond au jour où le droit de passage à commencer à s’exercer, soit à partir du moment où les éléments constitutifs de la possession sont réunis (Cass. req. 10 févr. 1941).
Cette possession devra, en outre, satisfaire à toutes les exigences prescrites à l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
2. Exceptions
Par exception au principe posé à l’article 682 du Code civil qui octroie au propriétaire d’un fonds enclavé un droit de passage sur le fonds voisin, il est certains cas où ce droit de passage lui sera refusé.
==> L’enclave procède du fait volontaire du propriétaire du fonds
Lorsque la situation d’enclave du fonds procède d’un fait volontaire du propriétaire, il n’est pas fondé à solliciter la constitution d’une servitude de passage sur le fonds voisin.
Dans un arrêt du 4 mai 1964, la Cour de cassation a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait jugé que le propriétaire d’un fonds « ne pouvait invoquer un état d enclave de son immeuble dès lors qu’il avait lui-même obstrué l’issue lui donnant accès à la voie publique et ouvert une porte sur la cour intérieure pour le desservir » (Cass. 1ère civ. 4 mai 1964).
Tout l’enjeu consistera alors à déterminer si la situation d’enclave du fonds résulte du fait personnel de son propriétaire, les juges du fonds étant investis, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. 3e civ., 7 févr. 1969).
Aussi, l’enclave pour justifier la constitution d’une servitude de passage ne peut procéder que d’un cas événement indépendant de la volonté du propriétaire du fonds (cas fortuit, force majeure, fait d’un tiers etc.).
C’est seulement lorsqu’il sera établi que l’absence ou l’insuffisance d’issue est imputable au fait personnel du propriétaire du fonds qu’il lui est fait interdiction de se prévaloir du dispositif prévu à l’article 682 du Code civil. Il peut s’agir, tant d’un fait positif, tel qu’un mauvais aménagement du fonds, ou la création d’un obstacle, que d’un fait négatif, tel qu’un défaut d’entretien qui a rendu la voie d’accès au fonds impraticable.
Dans un arrêt du 7 mai 1986, la Cour de cassation a précisé que la charge de la preuve du caractère volontaire devait être supportée par le propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ. 7 mai 1986, n°84-16957).
L’enclave volontaire ne serait toutefois pas caractérisée lorsque l’absence ou l’insuffisance d’issue procède d’un changement de destination du fonds qui, alors qu’il était affecté à une exploitation agricole par exemple, est affecté à une exploitation industrielle (Cass. 3e civ. 25 juin 1997, n°95-15772).
==> Le propriétaire du fonds enclavé dispose d’un droit de passage conventionnel
Le propriétaire d’un fonds enclavé ne peut pas non plus se prévaloir d’un droit de passage, lorsqu’il dispose d’un accès établi conventionnellement avec le propriétaire d’un fonds voisin.
Il importe peu que cet accès soit moins commode que celui auquel pourrait prétendre le propriétaire du fonds en application de l’article 683 du Code civil, soit « être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ».
Ce qui compte c’est qu’il dispose d’une issue conduisant sur une voie ouverte au public et que cette issue permet une utilisation normale du fonds.
Si dès lors, le fonds est affecté à une exploitation agricole et que l’issue établie conventionnellement ne peut pas être empruntée par des engins agricoles, le propriétaire du fonds pourra se prévaloir d’un droit de passage.
Aussi, c’est aux juges qu’il appartiendra de déterminer souverainement si l’accès conventionnel permet un usage normal du fonds enclavé.
==> Le fonds enclavé comporte une issue de tolérance
Il est admis que lorsque le fonds enclavé comporte une issue de tolérance sont propriétaire ne peut pas se prévaloir d’un droit de passage.
Dans un arrêt du 16 juin 1981, la Cour de cassation a par exemple jugé que le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage lui permettant un libre accès pour les besoins de son exploitation, n’est pas enclavé tant que cette tolérance est maintenue (Cass. 3e civ. 16 juin 1981, n°80-11230).
La troisième chambre civile a encore statué en ce sens dans un arrêt du 27 septembre 2007 (Cass. 3e civ. 27 sept. 2007, n°05-16451).
Dans cette affaire elle a notamment estimé qu’une parcelle n’est pas enclavée dès lors que les propriétaires du fonds voisin ont laissé en toute connaissance de cause son propriétaire passer sur leur parcelle pendant vingt-sept ans sans protester.
Cette situation s’analyse, manifestement, en une tolérance de passage qui, parce qu’elle offre une issue au fonds enclavé, fait obstacle à la constitution d’une servitude.
Seule la révocation de la tolérance est de nature à justifier la demande d’un droit de passage par le propriétaire du fonds enclavé (V. en ce sens Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 16-27702).
Dans un arrêt du 2 juin 1999, la Cour de cassation a précisé qu’il convenait, pour déterminer si l’existence d’une tolérance faisait obstacle à la demande d’un droit de passage, que cette tolérance permette un usage normal du fonds conformément à sa destination.
Ainsi, a-t-elle validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir relevé « que les consorts Y… exploitaient dans les lieux un poney club et que l’ouverture d’une entrée sur le parc de stationnement communal, dont ils bénéficiaient en vertu d’une tolérance de la municipalité, ne permettait pas le passage de véhicules de plus de 3 tonnes 5 assurant la livraison du fourrage ou le transport des équidés, a […] caractérisé l’utilisation normale du fonds et souverainement retenu l’état d’enclave de celui-ci » (Cass. 3e civ. 2 juin 1999, n°96-21594).
==> La division du fonds consécutivement à l’accomplissement d’un acte
- Principe
- L’article 684 du Code civil dispose que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. »
- Ainsi, lorsque la situation d’enclave d’un fonds est le résultat de la division de l’unité foncière d’origine en plusieurs parcelles, il appartient aux parties à l’opération de s’entendre pour octroyer une issue au fonds enclavée, issue qui doit nécessairement prendre assise sur les fonds divisés, peu importe que l’accès créé soit moins commode que si son assiette avait été déterminée application de l’article 682 du Code civil.
- Il est classiquement admis que la règle posée à l’article 684 du Code civil se justifie par l’obligation de garantie qui pèse sur les parties à l’acte de division.
- Elles ne sauraient, en effet, faire peser la charge d’un droit de passage aux propriétaires des fonds voisins qui sont étrangers à l’opération.
- Au surplus, il est admis de longue date que la constitution d’une servitude sur l’héritage d’autrui ne peut jamais procéder de son propre fait ( req. 27 avr. 1898).
- Aussi, ainsi que l’ont écrit des auteurs les parties à l’acte de division du fonds « sont tenus d’une obligation de garantie qui implique de fournir un accès permettant l’exploitation du fonds»[1].
- Il en résulte que l’acquéreur d’un fonds enclavé issu d’une division après partage ne peut réclamer un droit de passage qu’à ses copartageants (V. en ce sens 3e civ., 3 mars 1993, n°91-16065).
- Exception
- Ce n’est que lorsqu’aucun passage suffisant ne peut être créé sur les fonds qui ont fait l’objet d’une division que l’article 682 du Code civil redevient applicable.
- Cette exception est issue de la loi du 20 août 1881 qui a admis que, bien que le passage nécessaire à l’exploitation d’un fonds actuellement enclavé à la suite d’une division aurait du être pris sur les autres portions de l’ancienne unité foncière, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le passage par d’autres terrains limitrophes ne serait pas plus court et moins dommageable, une exception aux articles 682 et 683 du Code civil ne pouvait être invoquée par les voisins lorsque, à raison de la conformation des lieux, il y avait impossibilité d’établir ailleurs que sur leur fonds un chemin offrant les moyens de communication nécessaires.
- Ainsi, afin de déterminer si la servitude doit ou non être constituée sur un autre fonds que ceux objet de la division, il conviendra d’établir qu’aucune issue suffisante permettant une utilisation normale du fonds enclavé ne peut être créée sur les fonds divisés.
- Ce n’est que lorsque cette insuffisance d’accès sera démontrée, que l’article 682 du Code civil pourra s’appliquer.
- La conséquence en est qu’une servitude de passage pourra alors être constituée sur un autre fonds que ceux objet de la division.
- Dans cette hypothèse, non seulement une indemnité sera due au propriétaire du fond servant, mais encore celui-ci ne pourra pas y renoncer dans l’acte de division, l’article 682 étant d’ordre public sur ce point.
B) Exercice de la servitude de passage
- Les fonds assujettis au droit de passage
Il est admis que la servitude de passage est susceptible de grever tous les fonds voisins qui séparent le fonds enclavé de la voie publique.
Peu importe la nature de ces fonds, qu’ils soient contigus, qu’ils soient bâtis ou encore qu’ils soient clôturés. Leur configuration physique ou juridique est indifférente.
Il pourra donc s’agir d’un fonds sur lequel est établi une habitation, un jardin, un parc, soit n’importe quel fonds au travers duquel il est possible de relier la parcelle enclavée à la voie publique.
La seule limite a été posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 1994 qui a jugé « qu’il résulte du principe de l’inaliénabilité des biens du domaine public qu’ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, et notamment d’un droit de passage en cas d’enclave » (Cass. 1ère civ. 2 mars 1994, n°87-16932).
Ainsi, les fonds qui relèvent du domaine public ne peuvent être grevés d’aucune servitude de passage, en raison de leur inaliénabilité.
2. La détermination de l’assiette de passage
Lorsque les conditions de constitution d’une servitude de passage sont réunies, cette dernière grève de plein droit les fonds voisins permettant de libérer le fonds dominant de son enclave.
Reste qu’il y a lieu de déterminer l’endroit où la servitude prendra son emprise, étant précisé que son assiette sera limitée à ce qui est nécessaire pour ouvrir une issue suffisante au fonds enclavé.
La détermination de cette assiette peut résulter de plusieurs situations :
- La conclusion d’une convention
- La décision du juge
- La prescription
- La division du fonds
a) La détermination de l’assiette de passage par convention
L’assiette du droit de passage peut, tout d’abord, être fixé par convention entre propriétaires du fonds servant et du fonds dominant.
Ce mode de détermination de l’assiette de la servitude présente l’avantage de permettre aux contractants de déroger aux critères énoncés par l’article 683 du Code civil qui aura vocation à s’appliquer faute d’accord.
La seule contrainte dont ne peuvent pas s’exonérer les parties a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mai 2000 : « une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété »
Il en résulte que la constitution d’une servitude doit se limiter à « l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire » (Cass. 3e civ. 24 mai 2000, n°97-22255).
| Cass. 3e civ. 24 mai 2000 |
|---|
| Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 637 de ce Code ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1997) que les consorts Y..., propriétaires d'un terrain, portant plusieurs bâtiments, ont vendu, après division parcellaire, à la société Toutes transactions immobilières (TTI), le 13 septembre 1988, le lot B, 21, rue Fabre-d'Eglantine et le 9 juillet 1990 le lot A, ... ; que la société TTI a revendu le lot B à la société immobilière Bust, puis le lot A à la société Natiocrédibail-Sicomi (Natiocrédibail) ; que celle-ci et la société Leva, constructeur d'un nouvel immeuble sur le terrain correspondant au lot A, ont assigné la société Immobilière Bust et le syndicat des copropriétaires du 21, rue Fabre-d'Eglantine, pour faire juger que l'enclave, dans le lot A, d'un petit local avec cabinet d'aisances attaché au lot n° 51 du lot B, était leur propriété et obtenir, avec la suppression de l'empiétement, la libération de ce local et la réparation de leur préjudice ; que la société Immobilière Bust a assigné la société Cabinet Fabre-d'Eglantine, cessionnaire d'un bail consenti par les consorts Y... en 1985 et occupant à ce titre le lot n° 51 du lot B, ainsi que la société TTI ; que les instances ont été jointes ; Attendu que pour dire que la société Immobilière Bust dispose d'un droit de jouissance sur la parcelle, portant le cabinet d'aisances litigieux, propriété de la société Natiocrédibail, et que le bail consenti à la société Cabinet Fabre-d'Eglantine incluant ce local est opposable à la société Natiocrédibail, l'arrêt retient que l'empiétement reproché, continu et apparent, antérieur à la division parcellaire et maintenu en l'état par les auteurs communs des deux lots, relève d'une servitude de père de famille, de l'auteur commun, de droit exclusif de jouissance grevant le lot A au profit du lot B, de l'enclave incorporée dans les locaux commerciaux du lot B donnés à bail par l'auteur et qui revêt un caractère définitif compte tenu de la configuration des lieux antérieurement murés et hermétiques du côté du fonds servant et ouverts et accessibles seulement du côté du fonds dominant à partir du lot auquel la servitude est attachée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude ne peut être constituée par un droit exclusif interdisant au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met M. X..., ès qualités, hors de cause, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. |
Enfin, il est admis que le propriétaire du fonds dominant renonce unilatéralement à la servitude de passage.
Dans un arrêt du 3 mars 2009, la troisième chambre civile a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait fait application de l’article 682 du Code civil afin de reconnaître l’établissement d’une servitude de passage, alors même que le propriétaire du fonds enclavé y avait renoncé par déclaration unilatérale.
Au soutien de sa décision la Cour de cassation avance que « la renonciation à un droit peut résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son bénéficiaire d’y renoncer », de sorte que la renonciation du propriétaire du fonds dominant à son droit de passage était pleinement valide (Cass. 3e civ., 3 mars 2009, n°08-11.540).
b) La détermination de l’assiette de passage par décision du juge
Ce n’est que lorsque le propriétaire d’un fonds enclavé n’est pas parvenu à s’entendre sur son droit de passage avec le propriétaire du fonds voisin que le juge a vocation à intervenir.
Son intervention aura pour objet, outre la confirmation du bien-fondé de la demande de constitution d’une servitude, de déterminer son assiette.
Pour ce faire, il lui faudra faire application des critères légaux, étant précisé, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation dans un arrêt du 4 janvier 1991 « qu’il appartient au juge et non au propriétaire du fonds servant de fixer l’assiette du passage pour la desserte d’une parcelle enclavée, conformément aux dispositions de l’article 683 du Code civil » (Cass. 3e civ. 4 janv. 1991, n°89-18492).
À cet égard, l’article 683 du Code civil adresse une double directive au juge en prévoyant que :
- D’une part, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
- D’autre part, il doit néanmoins être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Il ressort de cette disposition que si, en principe, le trajet du passage reliant le fonds enclavé à la voie publique, c’est la ligne droite, celle-ci peut, en application de l’alinéa 2 de l’article 683, subir quelques contorsions afin de limiter le préjudice causé propriétaire du fonds servant.
En somme, l’objectif qui devra être recherché par le juge, c’est de concilier les intérêts en présence, ce qui consistera :
- D’un côté, à définir le passage le plus court et qui corresponde à une utilisation normale du fonds dominant conformément à sa destination
- D’un autre côté, à veiller à ce que ce passage soit le moins dommageable pour le fonds servant et qui soit compatible avec les contraintes d’urbanisme et environnementales applicables au fonds servant situé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
A priori, le tracé qui permet de remplir au mieux cet objectif de conciliation des intérêts c’est la ligne droite car elle permet :
- Du point de vue du propriétaire du fonds servant, une emprise moindre de la servitude de passage sur son terrain
- Du point de vue du propriétaire du fonds dominant, un accès à la voie publique plus rapide et moins onéreux
À l’évidence, si le trajet rectiligne consiste a priori, en la solution la plus avantageuse pour les propriétaires voisins, cela est vrai tant que trajet ne se heurte pas à une construction où à un obstacle topographique, telle qu’un rocher ou une pente trop abrupte.
Lorsque, en effet, un obstacle se dresse sur le chemin le plus court offrant au fonds enclavé un accès sur la voie publique, il appartiendra au juge de définir des trajets alternatifs en combinant avec méthode les alinéas 1 et 2 de l’article 683 du Code civil.
À cet égard, la Cour de cassation rappelle régulièrement que les juges du fond sont investis d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer l’assiette qui répond aux exigences fixées par le texte (Cass. 1ère civ. 19 janv. 1969).
La Cour de cassation n’hésite pas à censurer les Cours d’appel qui retiendront la de solution de désenclavement la plus adéquate pour le fonds dominant sans rechercher si elle constitue l’endroit le moins dommageable pour le fonds servant (Cass. 3e civ. 3 mars 1993, n°91-12673).
La troisième chambre civile a précisé que dans un arrêt du 20 décembre 1989 que lorsque le maintien de l’assiette de passage à son emplacement initial entraînait un trouble au fonds dominant et que sa modification n’intervenait que pour la commodité du propriétaire du fonds servant qui avait modifié l’usage de son terrain, les frais d’implantation afférents à la nouvelle assiette sont à la seule charge de ce dernier (Cass. 3e civ. 20 déc. 1989, n°88-15376).
c) La détermination de l’assiette de passage par prescription
L’article 685, al. 1er dispose que « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu. »
Il ressort de cette disposition que la détermination de l’assiette du passage peut résulter de la prescription acquisitive.
La prescription aura pour effet de figer cette assiette, quand bien même elle ne répondrait pas aux exigences fixées à l’article 683 du Code civil.
Tel ne sera pas le cas, en revanche, du passage qui résultera d’un acte de pure faculté ou de simple tolérance lequel consiste en la permission tacite ou expresse du propriétaire octroyé à autrui.
Aussi, pour que la démarche du propriétaire du fonds enclavé puisse faire jouer la prescription acquisitive, elle devra remplir les conditions énoncées à l’article 2261 qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Aussi, est-il absolument nécessaire que le propriétaire du fonds enclavé emprunte toujours le même trajet, faute de quoi la prescription ne pourra pas jouer.
Lorsqu’il existera plusieurs tracés de servitude, la Cour de cassation considérera qu’il s’agit là d’une circonstance impropre à caractériser une possession non équivoque de l’assiette de la servitude de passage de sorte que la possession ne pourra produire aucun effet acquisitif (Cass. 3e civ. 19 oct. 2017, n° 16-23.679)
Dans un arrêt du 17 septembre 2008, la Cour de cassation a précisé que « le propriétaire d’un fonds bénéficiant d’une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue » (Cass. 3e civ., 17 sept. 2008, n°07-14043).
Il ressort de cette décision que la prescription ne permet pas de modifier une assiette qui a été fixée conventionnellement. Admettre le contraire reviendrait à contrevenir à l’article 691 du Code civil qui prévoit que les servitudes discontinues ne peuvent pas être établies par prescription.
En dehors de ce cas, lorsque la prescription trentenaire est acquise, l’article 683 du Code civil ne pourra plus être invoqué aux fins de modifier l’assiette de passage, quand bien même le chemin tracé serait plus long pour le propriétaire du fonds dominant ou plus dommageable pour le propriétaire du fonds servant (V. en ce sens Cass. civ. 26 août 1874).
La possession trentenaire a donc pour effet de figer irrévocablement l’assiette du passage à l’endroit où il a toujours été exercé sans protestation.
Seule solution pour les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant s’ils éprouvent le besoin d’anéantir les effets de la prescription : conclure une convention modifiant l’assiette de passage fixée par prescription (Cass. req. 16 juill. 1899). Cela suppose néanmoins que s’opère une rencontre des volontés, faute de quoi aucun accord ne saurait être scellé.
d) La détermination de l’assiette de passage procède d’une division
- Principe
- L’article 684 du Code civil dispose que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. »
- Ainsi, lorsque la situation d’enclave d’un fonds est le résultat de la division de l’unité foncière d’origine en plusieurs parcelles, il appartient aux parties à l’opération de s’entendre pour octroyer une issue au fonds enclavée, issue qui doit nécessairement prendre assise sur les fonds divisés, peu importe que l’accès créé soit moins commode que si son assiette avait été déterminée application de l’article 682 du Code civil.
- Il est classiquement admis que la règle posée à l’article 684 du Code civil se justifie par l’obligation de garantie qui pèse sur les parties à l’acte de division.
- Elles ne sauraient, en effet, faire peser la charge d’un droit de passage aux propriétaires des fonds voisins qui sont étrangers à l’opération.
- Au surplus, il est admis de longue date que la constitution d’une servitude sur l’héritage d’autrui ne peut jamais procéder de son propre fait ( req. 27 avr. 1898).
- Aussi, ainsi que l’ont écrit des auteurs les parties à l’acte de division du fonds « sont tenus d’une obligation de garantie qui implique de fournir un accès permettant l’exploitation du fonds»[1].
- Il en résulte que l’acquéreur d’un fonds enclavé issu d’une division après partage ne peut réclamer un droit de passage qu’à ses copartageants (V. en ce sens 3e civ., 3 mars 1993, n°91-16065).
- Conditions
- Deux conditions doivent être réunies pour que l’article 684 du Code civil s’applique :
- La division doit résulter d’un fait volontaire
- La règle édictée à l’article 684, al.1er du Code civil ne s’applique que si la division de l’unité foncière d’origine procède d’un fait volontaire des parties à l’acte.
- Lorsque, dès lors, elle résulte d’une vente forcée qui s’inscrit dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou d’une procédure d’expropriation, l’article 684 ne sera pas applicable
- La situation d’enclave doit être la conséquence directe de la division
- Pour que l’article 684 du Code civil s’applique, il faut que la situation d’enclave soit la conséquence directe de l’opération de division.
- Cela signifie que l’unité foncière d’origine devait comporte, avant la division, une issue sur la voie publique
- À défaut, les articles 682 et 683 demeurent applicables
- Dans un arrêt du 27 novembre 1973, la Cour de cassation a précisé que lorsque des fonds proviennent de la division d’une parcelle d’un auteur commun en application de l’article 684, le passage peut être demandé sur les terrains qui ont fait l’objet de cet acte sans qu’il puisse être opposé aux acquéreurs le fait de l’enclave volontaire de leur auteur ( 3e civ. 27 nov. 1973, n°72-13948).
- Plus récemment, la troisième chambre civile a encore affirmé, au visa des articles 682 et 684 du Code civil, que consécutivement à une division de fonds « l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée» ( 3e civ. 24 oct. 2019, n°18-20.119).
- Ainsi, la renonciation par le propriétaire d’une parcelle dont la situation d’enclave procède d’une division à un droit de passage, ne fait pas obstacle à ce que l’acquéreur se prévale de l’article 682 du Code civil afin de solliciter la constitution d’une servitude de passage.
- La division doit résulter d’un fait volontaire
- Deux conditions doivent être réunies pour que l’article 684 du Code civil s’applique :
- Versement d’une indemnité
- Initialement, la servitude de passage telle qu’envisagée à l’article 684 du Code civil, était regardée comme une servitude conventionnelle car procédant de l’accomplissement d’un acte – conventionnel – de division.
- La jurisprudence en tirait la conséquence qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité au propriétaire du fonds grevé par la servitude de passage, celle-ci étant incluse dans l’estimation des fonds divisés (V. en ce sens req. 1er août 1861).
- La Cour de cassation a néanmoins revu sa position dans un arrêt du 15 octobre 2013 aux termes duquel elle censure la décision d’une Cour d’appel qui avait refusé l’octroi d’une indemnité au propriétaire du fonds servant, considérant que la servitude de passage avait un fondement conventionnel car instituée sur le fondement de l’article 684 du Code civil.
- La troisième chambre civile prend le contre-pied de ce raisonnement en jugeant que « alors qu’elle constatait que la parcelle E 156 était enclavée et que l’acte de partage n’avait pas pour effet de modifier le fondement légal de la servitude et ne contenait aucune renonciation des propriétaires du fonds servant à la perception d’une indemnité, la cour d’appel a violé les textes susvisés» ( 3e civ. 15 oct. 2013, n°12-19563).
- Ainsi, pour la Cour de cassation, parce que le droit de passage envisagé à l’article 684 a un fondement légal et non conventionnel, il justifie le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds servant.
- Elle précise néanmoins que cette indemnité est due sauf clause contraire dans l’acte de division.
- À l’examen, il ressort de cette décision que l’article 684 du Code civil doit être lu comme opérant une dichotomie entre, d’une part, la fixation de l’assiette du droit de passage et, d’autre part, le versement d’une indemnité au propriétaire du fonds servant.
- S’agissant de la détermination de l’assiette du droit de passage
- L’article 684 est d’ordre public de sorte qu’il ne peut pas y être dérogé par convention contraire.
- Cela signifie que la servitude devra prioritairement être constituée sur les fonds issus de la division de l’unité foncière d’origine.
- Elle ne pourra pas être établie sur les parcelles étrangères à l’opération de partage
- S’agissant du versement d’une indemnité
- Lorsque la servitude est constituée sur le fondement de l’article 684 du Code civil, l’indemnité due au propriétaire du fonds servant n’est pas d’ordre public
- Ce dernier peut y renoncer dans l’acte de division, ce qui devra être expressément stipulé
- S’agissant de la détermination de l’assiette du droit de passage
- Exception
- Ce n’est que lorsqu’aucun passage suffisant ne peut être créé sur les fonds qui ont fait l’objet d’une division que l’article 682 du Code civil redevient applicable.
- Cette exception est issue de la loi du 20 août 1881 qui a admis que, bien que le passage nécessaire à l’exploitation d’un fonds actuellement enclavé à la suite d’une division aurait du être pris sur les autres portions de l’ancienne unité foncière, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le passage par d’autres terrains limitrophes ne serait pas plus court et moins dommageable, une exception aux articles 682 et 683 du Code civil ne pouvait être invoquée par les voisins lorsque, à raison de la conformation des lieux, il y avait impossibilité d’établir ailleurs que sur leur fonds un chemin offrant les moyens de communication nécessaires.
- Ainsi, afin de déterminer si la servitude doit ou non être constituée sur un autre fonds que ceux objet de la division, il conviendra d’établir qu’aucune issue suffisante permettant une utilisation normale du fonds enclavé ne peut être créée sur les fonds divisés.
- Ce n’est que lorsque cette insuffisance d’accès sera démontrée, que l’article 682 du Code civil pourra s’appliquer.
- La conséquence en est qu’une servitude de passage pourra alors être constituée sur un autre fonds que ceux objet de la division.
- Dans cette hypothèse, non seulement une indemnité sera due au propriétaire du fond servant, mais encore celui-ci ne pourra pas y renoncer dans l’acte de division, l’article 682 étant d’ordre public sur ce point.
3. Les modalités du passage
Ni l’article 682, ni l’article 683 du Code civil n’évoque les modalités du passage octroyé au propriétaire du fonds enclavé.
Aussi, c’est à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de définir les règles applicables, au premier rang desquelles figure celle imposant que le titulaire de la servitude puisse avoir une utilisation normale du fonds conformément à sa destination.
La largeur du passage devra, de la sorte, être plus ou moins importante, selon que le fonds est affecté à une exploitation agricole ou à usage d’habitation.
Dans un arrêt du 19 juin 2002, la Cour de cassation a, par exemple, après avoir rappelé que « le droit pour le propriétaire d’une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination » censuré à une Cour d’appel qui pour déterminer les modalités du passage octroyé au propriétaire du fonds enclavé s’est « déterminée par un motif d’ordre général sans caractériser une telle utilisation ni rechercher si l’accès des voitures automobiles aux parcelles de M. X… répondait à des nécessités découlant de cette utilisation » (Cass. 3e civ. 19 juin 2002, n°00-11675).
Au cas particulier, les juges du fonds avaient estimé que le bénéficiaire de la servitude devait pouvoir accéder à son fonds avec le mode de locomotion habituel en cette fin de XXème siècle : une voiture automobile, alors même que celui-ci était totalement inexploité
L’enseignement à retirer de cet arrêt, c’est que les modalités du passage dépendent du seul besoin du propriétaire du fonds dominant.
| Cass. 3e civ. 19 juin 2002 |
|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que les parcelles appartenant à M. X... sont enclavées et que leur desserte s'effectue par le chemin privé situé sur la propriété de ses voisins les époux Y..., l'arrêt attaqué (Montpellier 2 décembre 1999), rendu après expertise judiciaire, retient que les époux Y... ne contestent pas les constatations techniques de l'expert mais la qualité d'exploitant agricole de M. X... et la nature de ses parcelles qui sont inexploitées et que, quel que soit le mode d'exploitation dont peuvent faire l'objet ses parcelles, ce dernier doit pouvoir y accéder avec le mode de locomotion habituel en cette fin de XXème siècle : une voiture automobile ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général sans caractériser une telle utilisation ni rechercher si l'accès des voitures automobiles aux parcelles de M. X... répondait à des nécessités découlant de cette utilisation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; |
La question se pose également de la nature de la voie de passage susceptible d’être empruntée. S’agit-il nécessairement de la voie terrestre, ou peut-il également s’agir de la voie aérienne, souterraine ou encore fluviale ?
À l’examen, la jurisprudence est assez libérale, celle-ci n’excluant aucune possibilité. L’objectif recherché c’est de permettre une utilisation normale du fonds.
Dès lors, tous les modes de passage sont envisageables, à commencer par la voie souterraine qui a été admise très tôt par la jurisprudence.
Dans cet arrêt du 22 novembre 1937, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le droit de passage visé par ce texte doit s’entendre en ce sens que les mots “sur les fonds de ses voisins” ne visent pas seulement la surface du sol, mais peuvent aller jusqu’à comprendre “le dessous”, afin d’assurer les communications strictement nécessaires à l’utilisation normale du fonds enclavé ; qu’il s’applique ainsi aux canalisations souterraines indispensables à cet effet » (Cass. civ. 22 nov. 1937).
| Cass. civ. 22 nov. 1937 |
|---|
| La Cour, Ouï, en l'audience publique du 8 novembre 1937, M. le conseiller Kastler, en son rapport ; Maîtres Bosviel et Aguillon, avocat des parties en leurs observations respectives, ainsi que M. Chartrou, avocat général, en ses conclusions. Et après en avoir délibéré le 22 novembre 1937, en la chambre du conseil ; Sur le moyen unique : Attendu que le droit de passage visé par ce texte doit s'entendre en ce sens que les mots "sur les fonds de ses voisins" ne visent pas seulement la surface du sol, mais peuvent aller jusqu'à comprendre "le dessous", afin d'assurer les communications strictement nécessaires à l'utilisation normale du fonds enclavé ; qu'il s'applique ainsi aux canalisations souterraines indispensables à cet effet ; Attendu que la demoiselle X..., propriétaire à Trouville-sur-Mer, d'une maison n'ayant d'accès à la voie publique qu'au moyen d'une ruelle appartenant au sieur Y..., a fait ouvrir dans celle-ci des tranchées destinées à l'adduction de l'eau, de gaz, de l'électricité et à l'évacuation des eaux ménagères, mais que l'arrêt attaqué a décidé que si, en raison de l'état d'enclave, elle possédait un droit de passage, ce droit lui permettait uniquement le passage à pied, à cheval ou en voiture, l'établissement de travaux permanents destinés à un autre usage ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 682 du Code civil ; Mais attendu qu'en statuant ainsi au lieu de rechercher, d'une part, si les travaux projetés seraient de nature à réagir sur le montant de l'indemnité prévue par l'article susvisé, et d'autre part, si ces travaux pouvaient s'effectuer d'une façon moins dommageable pour le fonds servant et aussi appropriés aux besoins de l'exploitation du fonds dominant, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision Par ces motifs ; Casse. |
La Cour de cassation a encore validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir constaté que la cave, a usage de champignonnière, située dans le sous-sol du fonds appartenant à un exploitant, était enclavée a accordé, pour sa desserte, un droit de passage à travers la cave attenante où son voisin exploitait une industrie de même nature (Cass. 1ère 3 déc. 1962).
Il est également admis que la voie souterraine puisse être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur leur propriété, notamment lorsqu’il s’avère que le trajet le plus court pour rejoindre la voie publique était une ligne droite traversant, à l’endroit le moins dommageable, plusieurs parcelles, et s’identifiant au chemin empierre sous lequel se trouvaient des canalisations d’eau et d’électricité (Cass. 3e civ., 14 déc. 1977, n°76-11254).
S’agissant de la voie aérienne, elle est également susceptible de servir d’assiette à la servitude de passage, notamment lorsqu’il s’agit de tirer des câbles entre la voie publique et le fonds enclavé afin de le raccorder à l’électricité (V. en ce sens Cass. civ., 24 févr. 1930).
C) Extinction de la servitude de passage
- Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur il a longtemps été soutenu par les auteurs que la fin de l’état d’enclave emportait nécessairement remise en cause de la servitude qui était, en quelque sorte, privée de cause.
Surtout, admettre le contraire reviendrait à maintenir une servitude qui ne répondrait plus aux exigences énoncées à l’article 682 du Code civil.
Au surplus, ce serait là porter une atteinte excessive au droit de propriété du propriétaire du fonds servant qui ne doit souffrir d’un passage qu’en cas d’absolue nécessité, soit dans l’hypothèse où l’absence d’issue fait obstacle à l’utilisation normale du fonds enclavé.
Il a été opposé à cette thèse, que parce que les servitudes sont perpétuelles, le désenclavement du fonds dominant ne suffit pas à éteindre le droit de passage exercé par son propriétaire.
Finalement, la Cour de cassation a tranché en faveur dernière position, considérant que dans deux cas au moins, la servitude subsiste même quand l’enclave a cessé, d’une part, lorsqu’elle trouve sa source dans un contrat, et, d’autre part, lorsque son assiette et son mode d’exercice ont été déterminés par trente ans d’usage continu (Cass. civ., 26 août 1874, n°75.1.124).
Si le maintien de la servitude en cas de disparition de l’enclave se justifie aisément lorsqu’elle résulte d’un accord qui aura été librement discuté et négociée par les propriétaires des fonds concernés, ce maintien est moins évident lorsqu’il procède de la prescription acquisitive qui, pour la jurisprudence valait titre.
En effet, l’article 691 du Code civil pose que les servitudes discontinues, au nombre desquelles figure le droit de passage, ne peuvent pas être établies par prescription.
Admettre que, au bout de trente années d’exercice de droit de passage, le propriétaire du fonds enclavé acquiert la servitude définitivement, y compris en cas de désenclavement, c’était là manifestement faire une entorse malheureuse à la règle, car portant une atteinte excessive au droit de propriété du voisin, à plus forte raison parce que la servitude grevant son fonds n’était plus nécessaire.
Entendant les nombreuses critiques formulées par la doctrine à l’encontre de cette position jurisprudentielle, le législateur est intervenu en 1971 pour y mettre un terme.
2. Droit positif
La loi du 25 juin 1971 relative à l’extinction de la servitude de passage pour cause d’enclave a été adoptée afin d’anéantir la solution retenue par la Cour de cassation qui consistait à maintenir la servitude de passage acquise par prescription alors même que l’état d’enclave du fonds dominant avait cessé.
Selon les mots du rapporteur de ce texte, il apparaîtrait pourtant logique qu’en contrepartie de la sujétion parfois très lourde imposée au propriétaire sur le terrain duquel s’exerce la servitude, celle-ci soit limitée dans le temps par la durée même des circonstances qui en ont justifié la création.
C’est la raison pour laquelle le texte prévoit expressément que la servitude disparaît lorsque cesse l’enclave.
==> Principe
La règle est énoncée à l’article 685-1 du Code civil qui dispose que « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 ».
Il ressort de cette disposition que la disparition de l’état d’enclave du fonds grevé emporte anéantissement de la servitude lorsqu’elle a été établie dans les conditions de l’article 682 du Code civil.
Le jeu de la prescription acquisitive ne permet donc plus de faire subsister la servitude dont le sort est désormais lié au seul état d’enclave du fonds.
==> Domaine
Peu de temps après l’adoption de la loi du 25 juin 1971, la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 27 février 1974 que « l’article 685-1 du code civil qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles » (Cass. 3e civ. 27 févr. 1974, n°72-14016).
Ainsi, lorsque l’établissement du droit de passage procède d’un accord de volonté des propriétaires, la disparition de la situation d’enclave est sans effet sur la servitude qui subsiste.
Il en va de même lorsqu’elle a été établie par destination du père de famille. Cette solution a été affirmée dans un arrêt du 16 juillet 1974 aux termes duquel il a été jugé, dans les mêmes termes que la décision précédente, que l’article 685-1 du Code civil « qui ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave, laisse en dehors de son champ d’application, les servitudes conventionnelles ou résultant de la destination du père de famille » (Cass. 3e civ. 16 juill. 1974, n°73-12580).
La jurisprudence a toutefois précisé que lorsque la convention visait seulement à fixer l’assiette et les modalités du passage, l’article 685-1 demeurait applicable
Dans un arrêt du 3 novembre 1982, la troisième chambre civile a affirmé en ce sens que « en cas de cessation de l’enclave, et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du même code » (Cass. 3e civ. 3 nov. 1982).
L’application de l’article 685-1 du Code civil est donc exclue uniquement lorsque l’accord conclu entre les propriétaires porte sur le principe même de l’établissement de la servitude de passage.
Aussi, appartient-il aux juridictions de vérifier si l’état d’enclave n’a pas été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d’une servitude de passage, faute de quoi l’accord conclu entre les parties ne pourra pas faire obstacle à la disparition de la servitude engendrée par le désenclavement du fonds (Cass. 3e civ. 18 févr. 1997, n°95-14.389).
==> Conditions
Pour que l’extinction de la servitude de passage soit acquise, deux conditions doivent être réunies :
- Première condition : le désenclavement du fonds
- L’article 685-1 du Code civil prévoit que l’extinction du droit de passage est subordonnée à la disparition de l’état d’enclavement du fonds.
- Autrement dit, il doit être démontré que le propriétaire fonds qui était enclavé dispose désormais d’un accès suffisant sur la voie publique.
- Plus précisément il faut que cet accès permette une utilisation normale du fonds correspondant aux besoins de son exploitation ( 3e civ., 12 déc. 2006, n° 05-20857).
- C’est donc la démonstration inverse à celle qui avait permis la constitution de la servitude qui doit être faite.
- À cet égard, peu importe la cause du désenclavement qui peut être le fait du propriétaire lui-même, du fait d’un tiers ou d’un cas fortuit.
- Ce qui compte c’est que ce désenclavement ait lui et qu’il offre une issue suffisante.
- Seconde condition : constatation conventionnelle ou judiciaire
- La disparition de l’état d’enclave du fonds n’emporte pas cessation de plein droit de la servitude du passage.
- Pour que cette cessation soit effective, encore faut-il qu’elle soit constatée, soit par convention, soit par décision de justice (V. en ce sens 3e civ. 1er juill. 1980, n°79-11264)
- Cette exigence s’infère du second alinéa de l’article 658-1 du Code civil dispose que « à défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
- On pourrait légitimement s’interroger sur la nécessité de ce second alinéa : si la servitude est éteinte du seul fait de la cessation de l’enclave, pourquoi devoir recourir à une décision de justice ?
- Pour le rapporteur de la loi du 25 juin 1971, il semble toutefois que cette disposition soit indispensable pour assurer au texte une certaine souplesse d’application.
- Plusieurs raisons sont avancées :
- Tout d’abord, il peut y avoir lieu à contestation sur l’existence même d’une cause de cessation de l’enclave, celle-ci étant caractérisée par l’absence d’une sortie suffisante sur la voie publique.
- Or, même s’il a acquis des parcelles d’un seul tenant jusqu’à celle-ci, le propriétaire peut rester enclavé en fait, à cause, notamment, de l’existence d’obstacles naturels.
- Ensuite, la servitude a pu entraîner le versement d’une indemnité au profit du propriétaire du fonds servant, indemnité consistant soit en une somme en capital payée une fois pour toutes, soit en une somme annuelle, proportionnelle au dommage causé par l’exercice du droit de passage ( Req., 25 nov. 1845).
- En outre, le bénéficiaire de la servitude a pu être amené à engager d’autres dépenses : construction d’un chemin, par exemple.
- Il appartiendra, dans toutes ces hypothèses, au tribunal de déterminer si les frais assumés par le bénéficiaire de la servitude n’ont pas excédé le montant du préjudice qu’il a causé au propriétaire du fonds servant, ou si, au contraire, ce dernier ne bénéficie pas, du fait de la cessation de la servitude, d’un enrichissement sans cause, tant du fait des sommes reçues par lui en contrepartie d’une servitude qui n’existe plus qu’en raison des travaux accomplis par l’ancien bénéficiaire et qui peuvent conserver une utilité.
- Le tribunal appréciera, dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité éventuellement due par le propriétaire du terrain sur lequel s’exerçait antérieurement la servitude.
- Enfin, Le tribunal devra dans le cas d’une servitude ayant fait l’objet d’une convention entre les parties, apprécier si l’état d’enclave a constitué la cause déterminante de cette convention, qui se trouve ainsi remise en cause si l’enclave cesse, ou si, au contraire, il s’agit d’un droit de passage pour la simple convenance du bénéficiaire, auquel cas la convention reste valable, la cause qui l’a motivée restant inchangée.
- Pour toutes ces raisons, le législateur a souhaité mettre un garde-fou, le juge, faute d’accord amiable entre les propriétaires.
[1] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les biens, 9e éd., Précis Dalloz, 2014, n° 306
[2] E. Gavin-Millan Oosterlynck, « Servitudes légales, Distances à observer pour les plantations », J.-Cl. Civil Code, art. 671 à 673, 2010, n° 3.
[3] V. en ce sens l’article L. 511-3 du code rural et de la pêche maritime
[4] F. Rerré et Ph. Simler, Droit civil – Les Biens, éd. Dalloz, 2004, n°291, p239.
[5] F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les biens, 9e éd., Précis Dalloz, 2014, n° 306