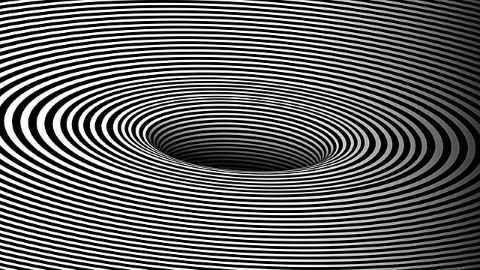Annoncée à l’article 1625 c.civ., la garantie des vices cachés est définie à l’article 1641 c.civ. :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Cette garantie, à laquelle le vendeur est légalement tenu (1), peut être modulée contractuellement (2). Elle est en outre complétée par différents dispositifs légaux (voy. sur ce point, l’article “La vente – Les systèmes spéciaux de garantie”).
1.- La garantie légale des vices cachés
Il faut envisager successivement les conditions (1.1) et les effets (1.2) de la garantie légale des vices cachés.
1.1.- Les conditions de la garantie légale
Le jeu de la garantie légale des vices cachés exige que soient précisées les ventes à l’occasion desquelles cette garantie est due (a), que soient identifiés les acteurs de cette garantie (b), que soit décrit le fait contre lequel elle prémunit l’acheteur (c) et, enfin, que soient posées les conditions dans lesquelles ce dernier peut agir (d).
a.- Les ventes donnant lieu à la garantie légale
Si la garantie légale est due par principe, deux exceptions sont cependant réservées :
- d’abord, la garantie « n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice» (art. 1649 c.civ.) ;
- ensuite, elle est exclue lorsque l’acheteur, prenant le bien en l’état, assume le risque d’existence d’un défaut caché ; pourvu, dans ce cas, que le vendeur ait effectivement ignoré ce dernier (art. 1643 c.civ. a contrario).
b.- Les acteurs de la garantie légale
Le débiteur (1) et le créancier (2) de la garantie légale doivent être évoqués.
Le débiteur
Le débiteur de la garantie légale est le vendeur. Si l’affirmation peut paraître évidente, elle ne l’est pas tant que cela :
- tout d’abord, dans la mesure où la loi vise le vendeur, il faut exclure a priori une garantie due par le producteur du bien. Une telle solution paraissait peu équitable ; elle a été amendée de différentes manières (voy. l’article préc.) ;
- ensuite sont concernés tous les vendeurs, qu’ils soient professionnels ou non-professionnels, de bonne ou de mauvaise foi – ce dernier élément jouant sur la quotité de la garantie, et non sur son principe.
Le créancier
La garantie des vices cachés est instituée au profit de l’acquéreur. Elle profite également aux sous-acquéreurs du bien (Civ., 25 janv. 1820, S. 1820, 1, 213). Ceux-ci disposent donc :
- d’une première action contre leur vendeur ;
- d’une seconde action contre l’auteur de leur vendeur ;
- le cas échéant, d’une énième action contre l’auteur de l’auteur, etc., jusqu’à l’action contre le fabricant du bien.
L’action du sous-acquéreur revêt plusieurs particularités. Son domaine, d’abord, embrasse non seulement les chaînes homogènes de contrats de vente (une vente suivie d’une vente) mais aussi les chaînes hétérogènes (par ex. une vente, puis un contrat d’entreprise), pourvu que les contrats successifs soient tous translatifs de propriété (Ass. plén., 7 avr. 1986, n° 83-14.631, Bull. civ., Ass. plén., 2).
Sa nature, ensuite : « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Civ. 1, 9 oct. 1979, n° 78-12.502, Bull. civ. I, 241 ; comp., en présence d’une chaîne de contrats non translatifs de propriété, Ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Bull. civ., Ass. plén., 6). Il faut en tirer les conséquences.
D’une part, le vendeur contre lequel est dirigée l’action n’est tenu qu’à hauteur du prix qu’il a perçu (nonobstant l’indemnisation éventuelle), et non à hauteur du prix qu’a reçu le vendeur intermédiaire des mains du sous-acquéreur exerçant l’action rédhibitoire (Civ. 1, 4 mars 1997, n° 94-22.026). Il n’en va pas différemment lorsque le premier vendeur est attrait en garantie par le revendeur à raison de l’action engagée par le sous-acquéreur : le premier vendeur ne garantit le revendeur qu’à hauteur du prix qu’il avait reçu de celui-ci (Civ. 1re, 17 mars 2011, n° 09-15.724).
D’autre part, celui contre lequel est dirigée l’action peut opposer au sous-acquéreur les exceptions (moyens de défense) qu’il aurait opposées à son propre acquéreur, telle qu’une clause limitative de responsabilité (Civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-13.898, Bull. civ. I, 175). En revanche, « une clause de non-garantie opposable par un vendeur intermédiaire à son propre acquéreur ne peut faire obstacle à l’action directe de l’acquéreur final contre le vendeur originaire, dès lors qu’aucune clause de non-garantie n’a été stipulée lors de la première vente » (Civ. 3, 16 nov. 2005, n° 04-10.824, Bull. civ. III, 222).
c.- Le fait garanti par la loi
L’article 1641 du Code civil vise les « défauts cachés ».
Le vice
Le vice, selon l’article 1641 c.civ., s’entend d’un « défaut » de la chose. Le vice est donc « nécessairement inhérent à la chose elle-même » et ne saurait découler de facteurs extrinsèques – ainsi, un médicament n’est pas affecté d’un risque à raison de son incompatibilité avec un autre (Civ. 1, 8 avr. 1986, n° 84-11.443, Bull. civ. I, 82) –, quoique la jurisprudence admette que des éléments liés à la chose contiennent le vice de celle-ci – ainsi, la fragilité du sol sur lequel est bâti un immeuble peut constituer le vice (Civ. 3, 24 janv. 2012, n° 11-10.420).
L’existence du vice n’est pas une condition suffisante au jeu de la garantie des vices cachés. Il faut encore que le vice rende « impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée », ou « en diminue […] cet usage » (art. 1641 c.civ.). Le terme d’« usage » appelle quelques précisions.
Il s’agit d’abord d’un usage normal. Par exemple, ne constitue pas un usage normal, pour un véhicule de collection, l’utilisation quotidienne qu’en fait l’acquéreur qui ne peut, dès lors, se prévaloir à l’encontre du vendeur d’un vice caché au titre des désordres causés par cette utilisation (Civ. 1, 24 nov. 1993, n° 92-11.085, Bull. civ. I, 347). Si le vendeur a eu connaissance de l’usage particulier auquel l’acquéreur destinait la chose, l’adéquation de celle-ci à sa future destination relèvera plus sûrement de l’obligation de délivrance conforme (voy. l’article “La vente – L’obligation de délivrance du vendeur”), voire du devoir de conseil, que de la garantie des vices cachés.
Il s’agit ensuite de l’utilité première de la chose et des conditions dans lesquelles cette utilité est rendue. Quoique la finalité d’une friteuse, qui est de produire des frites, soit bien remplie, ce matériel est affecté d’un vice caché dès lors que « les odeurs engendrées par le fonctionnement de l’appareil sont insupportables aux voisins dans un tissu urbain dense », (Com., 1er déc. 1992, n° 91-10.275, Bull. civ. IV, 389).
Toutefois, un défaut léger n’affectant que l’agrément qui peut être tiré de la chose ne constitue pas un vice (Civ. 3, 4 juill. 2001, n° 99-19.586).
Quelle que soit sa nature, le défaut garanti est le défaut antérieur à la vente (Civ. 1, 20 mai 2010, n° 08-21.576) ou, plus précisément, au transfert des risques. L’antériorité, qu’il appartient à l’acheteur de prouver (Com., 8 juill. 1981, n° 79-13.110, Bull. civ. IV, 316), est avérée s’il est établi que le vice n’existait qu’en germe avant la vente, peu importe que ses conséquences se soient pleinement déployées après celle-ci.
Le vice caché
Si le vendeur est tenu des « défauts cachés » de la chose (art. 1641 c.civ.), il ne l’est pas « des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (art. 1642 c.civ.).
Au regard du vendeur, le terme « caché » ne signifie pas « dissimulé ». Quoique, par opportunité, le vendeur professionnel est souvent présumé connaître tous les défauts de la chose, le texte ne fait pas de la dissimulation ou de la mauvaise foi une condition de son application. Le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus » (art. 1643 c.civ.) et même s’il croyait qu’ils étaient apparents pour l’acquéreur.
Au regard de l’acquéreur, l’apparence ou la non-apparence du vice est plus délicate à cerner. L’acquéreur a pu prendre lui-même connaissance du défaut ou a pu en être informé.
Le défaut apparent et défaut non apparent
Lorsque l’acheteur est un profane, il n’est tenu, en prenant possession de la chose, qu’à un examen sommaire. Il ne saurait donc lui être fait grief de s’être cantonné à un examen externe, ni de ne s’être pas fait assister d’un expert : l’acquéreur profane d’un immeuble qui ne s’est pas glissé dans les combles, dont l’accès « peut-être difficile, n’était pas impossible », pour monter sur la toiture afin de vérifier le bon état de la charpente et des tuiles, ni ne s’est fait accompagner d’un homme de l’art lors de la délivrance peut ainsi invoquer la garantie des vices cachés (Ass. plén., 27 oct. 2006, n° 05-18.977, Bull. civ., Ass. plén., 13). En revanche, la présence d’un tel spécialiste aux côtés de l’acquéreur profane est de nature à rendre le vice apparent (Civ. 3, 16 sept. 2014, n° 13-19.911), et donc à exclure la garantie.
Lorsque l’acheteur est un professionnel de la même spécialité que le vendeur, il est présumé être compétent et connaître les défauts affectant la chose (Civ. 1, 18 déc. 1962, Bull. civ. I, 554). La garantie est alors exclue. La présomption n’est qu’une présomption simple « de connaissance des vices décelables selon une diligence raisonnable » (Civ. 3, 28 févr. 2012, n° 11-10.705). L’acheteur la renverse en démontrant que le défaut ne pouvait être révélé qu’à la suite d’examens approfondis, voire destructifs ; il recouvre alors le bénéfice de la garantie des vices cachés.
L’information sur le défaut
La garantie des vices cachés ne saurait jouer, quelles que soient les qualités des parties, dès lors que l’acheteur a été informé du vice ou de son éventualité. Ne sauraient se prévaloir de cette garantie les acquéreurs d’un immeuble infesté de termites dès lors que l’agent immobilier « leur avait signalé l’existence d’une infestation de capricornes dans la charpente et leur avait conseillé de prendre l’avis d’un spécialiste » (Civ. 3, 26 févr. 2003, n° 01-12.750, Bull. civ. III, 53 ; comp. Civ. 3, 17 déc. 2008, n° 07-20.450).
Si la preuve de l’information incombe a priori au vendeur, la jurisprudence atténue cependant cette rigueur, en admettant que l’information soit donnée implicitement ou qu’elle résulte des circonstances entourant la vente. Le très faible prix payé pour une voiture révèle ainsi la connaissance qu’avait l’acheteur du vice qui l’affectait (Civ. 1re, 13 mai 1981, n° 80-10.876, Bull. civ. I, 165).
La mise en œuvre de la garantie légale
L’action en garantie des vices cachés doit être engagée « dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648, al. 1er, c.civ.). En fonction du point de départ – la découverte du vice –, le délai dans lequel doit être introduite l’action est donc plus long que le délai imposé à l’acquéreur consommateur au titre de la garantie de conformité.
Jusqu’à l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article 1648 du Code civil prévoyait que l’action devait être engagée non « dans un délai de deux ans », mais dans un « bref délai » suivant la découverte du vice. Il incombait au juge du fond, usant de son pouvoir souverain, d’apprécier au cas par cas si le bref délai était respecté.
1.2.- Les effets de la garantie légale des vices cachés
La garantie légale des vices cachés se traduit par deux actions, différentes au regard de leur objet : l’action rédhibitoire (a) et l’action estimatoire (b).
« L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (art. 1644 c.civ.). La jurisprudence majoritaire s’accorde pour considérer que « le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire prévu à l’article 1644 du Code civil appartient à l’acheteur et non au juge qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point » (Civ. 3, 20 oct. 2010, n° 09-16.788, Bull. civ. III, 191 ; contra, en présence d’une demande principale et d’une demande subsidiaire : Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254). Très ponctuellement, la loi impose l’action rédhibitoire (art. L. 223-7, C. rur.).
À l’une ou l’autre de ces actions s’ajoute, le cas échéant, le droit de l’acquéreur de prétendre à des dommages-intérêts (c).
a.- L’action rédhibitoire
L’action rédhibitoire (typique d’un défaut inacceptable) a pour objet l’anéantissement de la vente. Elle affecte la situation de l’acheteur et celle du vendeur.
- La situation de l’acheteur
L’acheteur est tenu de rendre la chose. Encore faut-il qu’il soit en mesure de le faire : à défaut, et à moins que la disparition résulte de la « mauvaise qualité » de la chose, l’acheteur ne peut qu’emprunter la voie de l’action estimatoire (art. 1647, C. civ. ; Civ. 3, 3 déc. 1996, n° 94-19.176, Bull. civ. III, 441). En l’absence de disparition totale de la chose, la condition de restitution n’est pas trop lourde pour l’acheteur : la chose doit être restituée dans l’état où elle est au jour de la résolution du contrat, non dans l’état dans lequel elle se trouvait au jour de la vente (Civ. 1, 8 déc. 2009, n° 08-21.138).
L’acheteur restituant la chose n’est pas tenu d’indemniser le vendeur à raison de l’usage fait de celle-ci avant que se révèle le vice ou de la dépréciation de la chose résultant de cet usage (civ. 1, 19 févr. 2014, n° 12-15.520, Bull. civ. I, 26 ; comp., à propos de l’obligation de délivrance conforme, v. supra)
- La situation du vendeur
Le vendeur est tenu à la restitution du prix ainsi qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), mais ne paraît pas tenu des intérêts. Lorsque l’action est exercée par le sous-acquéreur, le vendeur n’est tenu qu’à hauteur du prix reçu du vendeur intermédiaire.
Il peut néanmoins proposer à l’acheteur, et non lui imposer (Civ. 1, 11 juin 1980, n° 79-10.581, Bull. civ. I, 185 ; comp., à propos de la garantie de légale de conformité en matière de consommation, v. infra), de réparer le bien, voire de lui en substituer un autre ; l’acquéreur qui accepte renonce alors à la garantie légale des vices cachés (Com., 1er févr. 2011, n° 10-11.269).
b.- L’action estimatoire
L’action estimatoire est ouverte à l’acheteur qui entend conserver la chose en dépit du vice qui l’affecte. Elle a pour objet « de replacer l’acheteur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n’avait pas été atteinte de vices cachés » (Civ. 3, 1er févr. 2006, n° 05-10.845, Bull. civ. III, 22).
L’acheteur peut prétendre au remboursement d’une partie d’un prix (art. 1644 c.civ.), et non à l’intégralité de celui-ci, même s’il s’avère que les coûts de remise en l’état de la chose sont supérieurs au prix de vente (Civ. 1, 19 avr. 2000, n° 98-12.326, Bull. civ. I, 87).
Cette fraction du prix reste à fixer. La valeur est « arbitrée par des experts » (art. 1644 c.civ.), à charge pour le juge de retenir soit les coûts de remise en état de la chose (Civ. 3e, 1er févr. 2006, préc.), soit la différence entre le prix et la valeur vénale de la chose atteinte d’un vice.
c.- Les dommages-intérêts
La bonne ou la mauvaise foi du vendeur est indifférente au jeu de la garantie légale des vices cachés. Cela n’exclut pas que le vendeur de mauvaise foi soit plus rigoureusement obligé que le vendeur de bonne foi. Alors que le second ne doit que la restitution du prix et le remboursement des frais occasionnés par la vente (art. 1646 c.civ.), le premier est tenu « outre la restitution du prix […] de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » (art. 1645 c.civ.).
L’action en réparation est autonome : elle n’est pas soumise au délai de 2 ans (Civ. 3, 25 juin 2014, n° 13-17.254) et peut être engagée seule, sans que l’acheteur intente l’action rédhibitoire ou estimatoire (Civ. 1, 26 sept. 2012, n° 11-22.399, Bull. civ. I, 192).
La mauvaise foi du vendeur. La bonne foi se présume. Il incombe en principe à l’acheteur de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice affectant la chose (art. 2274 c.civ.). La jurisprudence a cependant renversé ce principe à l’encontre des vendeurs professionnels, sur qui pèse une présomption irréfragable de connaissance des vices affectant la chose vendue.
Sont visés non seulement les professionnels qui ont pour activité principale la vente de la chose concernée, mais encore ceux qui n’assurent cette vente qu’à titre accessoire, quoique récurrent (Civ. 1, 30 sept. 2008, n° 07-16.876). De plus, il est parfaitement indifférent que l’acheteur soit ou non un professionnel ; toutefois, l’appréciation de l’apparence du vice est réalisée plus rigoureusement à propos de l’acheteur professionnel (v. supra).
L’indemnisation. Le vendeur de mauvaise foi est tenu de réparer l’intégralité des désordres affectant la chose ainsi que ceux qui, émanant du vice de celle-ci, ont été causés à d’autres biens ou à des personnes, peu importe que ces personnes soient tiers au contrat de vente.
Sous la seule réserve de l’existence d’un lien de causalité entre le vice et le dommage (Com., 15 mars 1976, n° 74-13.587, Bull. civ. IV, 99), le montant de la réparation ne connaît pas de limite a priori (Civ. 3, 8 oct. 1997, n° 95-19.808, Bull. civ. III, 193).
2.- La garantie conventionnelle des vices cachés
Les parties sont libres d’améliorer la garantie légale ; de manière plus restrictive, il leur est parfois autorisé de la réduire.
2.1.- L’amélioration de la garantie légale
Cette garantie est, en droit, toujours valable : le vendeur peut donc l’étendre, quelle que soit la forme de cette extension (renonciation au délai de deux ans, obligation de proposer un remplacement, engagement d’indemniser peu important sa bonne foi…).
La pratique, en revanche, est parfois discutable : sous couvert d’accroître la garantie légale des vices cachés, certains professionnels tendent ainsi à la réduire, si ce n’est en droit, du moins dans l’esprit des consommateurs. Tel est le cas lorsqu’ils proposent, en cas de défaut de la chose vendue, la substitution d’un autre produit ou le remboursement sous forme d’à-valoir. Le Code la consommation prévoit expressément une obligation d’information de l’acheteur sur les droits que celui-ci tire de la loi (art. L. 211-15, C. consom., v. supra).
2.2.- La limitation de la garantie légale
Le principe et la limite de l’aménagement conventionnel de la garantie des vices cachés sont prévus à l’article 1643 c.civ. Pourvu qu’une telle stipulation ait été insérée, la limitation de garantie est possible à l’endroit du vendeur ignorant le vice de la chose.
a.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur non professionnel
La limitation de garantie, partielle ou totale, est permise et produit ses effets, à moins que l’acheteur démontre que le vendeur avait connaissance des défauts cachés affectant la chose (Civ. 3, 6 oct. 2010, n° 09-70.266).
Le vendeur non professionnel de bonne foi bénéficiant d’une clause exclusive de responsabilité échappe donc à l’indemnisation des désordres causés par le vice affectant la chose (parce qu’il est de bonne foi), et aux actions rédhibitoire ou estimatoire (par le jeu de la clause).
b.- La limitation de la garantie légale au profit du vendeur professionnel
Le vendeur professionnel étant irréfragablement présumé connaître les vices affectant la chose qu’il cède, il ne devrait pas pouvoir limiter la garantie légale. Tel est effectivement le cas, en application tant de la législation (art. R. 132-1 et L. 211-15, C. consom.) que de la jurisprudence, lorsque l’acheteur est un non-professionnel, voire, en application de la jurisprudence seulement, lorsque l’acheteur est un professionnel (Civ. 1, 20 déc. 1983, n° 82-15.191, Bull. civ. I, 308).
Toutefois, l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité est admise lorsque celles-ci sont stipulées entre professionnels de même spécialité (Civ. 1, 8 oct. 1973, n° 71-14.322, Bull. civ. I, 308).