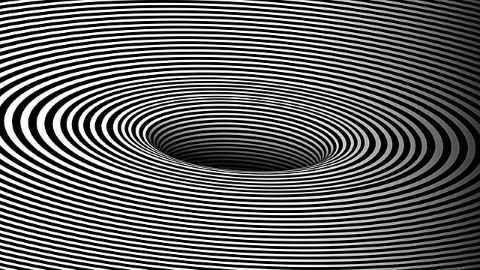Hésitation. En première approche, le sujet fleure bon l’oxymore – c’est-à-dire la figure de style par laquelle on allie de façon inattendue deux termes qui s’excluent ordinairement –, la contradiction in terminis. Je veux dire par là qu’il ne semble pas qu’il puisse y avoir usage abusif d’un droit quelconque : un seul et même acte ne peut être, tout à la fois, conforme et contraire au droit (Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 5ème éd., 1909, n° 871). On sait cela depuis Rome ; Neminem laedit qui suo jure utitur : ne lèse personne celui qui use de son droit (Ulpien). Si j’use de mon droit, mon acte est licite ; et quand il est illicite, c’est que je dépasse mon droit et que j’agis sans droit. Autrement dit : « le droit cesse où l’abus commence » (Planiol). L’abus de droit : c’est un non-sujet…à tout le moins en première approche, car la définition des termes de l’énoncé laisse augurer une bien délicate question de théorie générale du droit : les questions sous-jacentes ne sont pas seulement d’ordre technique ; elles mettent en jeu des choix philosophiques et politiques.
Définitions. Les dictionnaires de langue française et de droit concordent. Abus correspond étymologiquement à « usage excessif » puis au résultat d’un tel usage, c’est-à-dire à une attitude mauvaise (Dictionnaire historique de la langue française). C’est l’usage mauvais qu’on fait de quelque chose (Littré). C’est plus précisément l’usage excessif d’une prérogative juridique ; une action consistant pour le titulaire d’un droit, d’un pouvoir, d’une fonction (sur la distinction de ces notions, Starck et alii, Introduction générale au droit), à sortir, dans l’exercice qu’il en fait, des normes qui en gouvernent l’usage licite (Vocabulaire juridique). Un droit exercé dans l’unique dessein de nuire à autrui paraît dégénérer en exercice abusif. Au for externe, le sujet est parfaitement dans son droit ; au for interne, il paraît au contraire largement condamnable. Alors, contrairement à ce qui nous avait intuitivement semblé, ce qui paraît un non-sens juridique est une réalité et finit par avoir un contenu, si l’on veut bien considérer un comportement non seulement en droit mais aussi en morale (en ce sens, M. Rotondi, Le rôle et la notion de l’abus de droit, RTDciv. 1980, pp. 66-69).
Le mot « droit » désigne deux notions distinctes : le droit objectif, qu’on écrit ordinairement avec un grand « D » majuscule, et les droits subjectifs (qu’on écrit habituellement avec un petit « d » minuscule). Le droit objectif est l’ensemble des règles qui régissent la vie en société. Compris dans cette première acception, le droit appartient, avec la morale et les mœurs, à la nébuleuse des systèmes sociaux à caractère normatif. Fondamentalement, le droit est la science du juste et de l’utile, cependant « il n’est ni un dieu de bonté ni un terrifiant labyrinthe, mais une manière, évidemment perfectible, de rendre la société plus vivable » (Ph. Jestaz, Le droit, connaissance du droit, 5ème éd., Dalloz, 2007). Son dessein est de rechercher la justice et d’assurer la survie du groupe, maintenir son organisation, sa cohérence, faire régner l’ordre. Les droits subjectifs sont, quant à eux, des prérogatives reconnues (attribuées) par le droit objectif à des individus ou à des groupes d’individus pour la satisfaction de leurs intérêts personnels et dont le respect s’impose à autrui. En résumé, on est en présence d’une règle générale et abstraite d’un côté et de prérogatives individuelles et concrètes de l’autre. Ceci précisé, faut-il comprendre qu’il nous échoit de disserter sur l’abus du Droit ou sur l’abus des droits subjectifs ? Le sujet donne à penser. C’est la raison pour laquelle il a été donné aux candidats au concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature. Réflexion faite, la réponse à la question s’impose, elle est du reste suggérer par le thème de la leçon, il s’agit de s’interroger sur l’abus des droits.
Appréhension. Sitôt cette idée nouvelle découverte, à savoir que l’on peut être constitué en faute en exerçant abusivement un droit, au sens de l’article 1382 devenue 1240 C.civ. (c’est au visa de cet article que le juge sanctionne l’exercice abusif d’un droit – ou les mérites de la clausula generalis de residuo), la doctrine se passionne. Des auteurs – Raymond Saleilles, Georges Ripert (doyen de la faculté de droit de Paris), Louis Josserand, not. (V. Dictionnaire historique des juristes français, PUF, 2007 ; Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Dalloz, 2008) – approuvent sa consécration par le droit positif.
L’abus des droits est le nom donné par Josserand à sa théorie (1905). Développée dans « De l’esprit des droits et de leur relativité » (1927), l’éminent professeur-juge (Faculté de droit de Lyon puis Cour de cassation) n’aura de cesse de défendre, sa carrière durant, ladite théorie notamment contre Planiol puis Ripert (v. extraits in S. Carval, La construction de la responsabilité civile, PUF, 2001, pp. 159 s.). L’histoire a donné raison à Josserand. La virulente dispute théorique qui l’a opposé à ces derniers auteurs n’a guère retenti sur la jurisprudence, ni sur la législation. « Sa puissance d’évocation, écrit Cornu, lui a valu un succès judiciaire et doctrinal » (Les biens, 13ème éd., Montchrestien, 2007, n° 38). Les tribunaux ont largement utilisé la notion d’abus de droit. Pour cause, on ne saurait tolérer qu’une application trop rigoureuse de la loi puisse déboucher sur une injustice suprême, qu’un droit, avec un petit « d », puisse être poussé à l’extrême au point d’aller contre le Droit, avec un grand « D ». Jus est ars boni et aequi : le droit est l’art du bon et de l’équitable. Les romains ont du reste eu à l’esprit qu’il importait de défendre l’usage méchant du droit ou contraire à sa finalité sociale : male enim nostro jure uti non debemus (nous ne devons pas user de notre droit injustement), encore summum jus, summa injuria (comble de droit, comble de l’injustice), disait Cicéron. Vous l’aurez compris : ce dernier adage forme antithèse avec dura lex, sed lex, qui invite à la résignation.
Et pourtant, certains droits échapperaient à tout contrôle ; par hypothèse, leur usage ne serait jamais abusif. On qualifie ces drôles de droits d’absolus ou de discrétionnaires (Rouast, Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés, RTDciv. 1944, p. 1 s ; Roets, Les droits discrétionnaires : une catégorie juridique en voie de disparition ?, D. 1997, p. 92). Selon une jurisprudence traditionnelle, le droit de réponse est un droit « général et absolu ». Toutefois, les conditions de son exercice sont strictement délimitées par la loi et par la jurisprudence. La question se pose alors de savoir si le droit de réponse est bien, comme l’affirment nombre d’auteurs, un droit discrétionnaire. Une première analyse, fondée sur la distinction abus d’un droit/dépassement d’un droit conduit à une réponse positive. On peut, en effet, soutenir que franchir les limites du droit de réponse n’est pas en abuser. Dès lors, il y aurait dépassement du droit de réponse constitutif d’une faute justifiant le refus d’insérer et, éventuellement, l’allocation de dommages-intérêts. Mais, en tant que tel, l’exercice du droit de réponse ne serait pas contrôlé. Dans une seconde analyse – « fonctionnaliste » -, on peut tout aussi bien soutenir que le non-respect des conditions précédemment rappelées constitue un détournement du droit de réponse, c’est-à-dire un abus. L’exercice de ce dernier serait donc, dans cette perspective, l’objet d’un contrôle. Pour éviter une telle contradiction, le doyen Rouast qualifiait habilement le droit de réponse de « semi-discrétionnaire » (développements empruntés à Damien Roets, art. préc.). Le Droit a décidément grand peine à abandonner aux sujets la libre disposition des droits dont ils sont titulaires.
Comparaison. Le Code civil du Québec (8 déc. 1991 in Titre 1er : De la jouissance et de l’exercice des droits civils) a formellement consacré cette théorie. Les articles 6 et 7 disposent respectivement : art. 6 : « Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi » ; art. 7 : « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi ». Le Code civil suisse (10 déc. 1907 in Titre préliminaire, B) Étendue des droits civils, 1. Devoirs généraux) renferme de semblables dispositions : « Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi » (art. 2, al. 1er) ; « L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi » (art. 2, al. 2). L’article 226 du Code civil allemand (BGB : Bürgerliches Gesetzbuch) dispose que « l’exercice d’un droit n’est pas permis, lorsqu’il ne peut avoir d’autre but que de causer un dommage à autrui ».
Résignation. Le législateur français n’a pas su ou voulu procéder de la sorte. Il y a bien eu une tentative, mais les travaux de la commission de réforme du Code civil, créée à la libération, en juin 1945, sont restés lettre-morte. Nulle part il n’a posé le principe d’une façon générale. Les prises de position sont sûrement par trop périlleuses. En revanche, la loi sait faire allusion au contrôle de l’exercice abusif des droits. Une consultation sommaire de la législation codifiée sur le site Internet de diffusion du droit en ligne (www.legifrance.gouv.fr) l’atteste : on dénombre plus de trois cents articles, tous codes confondus, qui renferment le vocable sous étude, dont 6 dans le Code civil (v. aussi la table alphabétique du Code civil, v° Abus). En droit de la filiation adoptive, par exemple, l’article 348-6 C.civ. dispose « le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime abusif le refus de consentement opposé par les parents ou par l’un d’entre eux seulement, lorsqu’ils se sont désintéressés de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité (al. 1er). Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille (al. 2). Autre exemple, en droit des biens : « l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien » (C.civ., art. 618). L’avant-projet de réforme du droit des obligations (droit savant, droit de professeurs) renfermait une innovation réelle, qui provient de la consécration de l’idée d’exploitation abusive d’une situation de faiblesse provoquée par un état de nécessité ou de dépendance (art. 1114-1 : La menace d’une voie de droit ne constitue une violence qu’en cas d’abus. L’abus existe lorsque la voie de droit est détournée de son but ou brandie pour obtenir un avantage manifestement excessif). Pour l’heure, le normateur paraît peu enclin à légiférer sur cette question. A noter toutefois les articles 1164 et 1165 nouv. C.civ. qui régissent l’abus dans la fixation du prix.
Conclusion. En somme, les applications positives de la théorie, sont pour l’essentiel, l’œuvre de la jurisprudence. L’abus de droit a été admis pour la première fois par la Cour de cassation dans l’arrêt Coquerel c/ Clément-Bayard (Cass. req., 3 août 1915). Les faits prêtent à sourire. Coquerel avait installé sur son terrain, attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses de bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues. Ce dispositif n’avait pour lui aucune utilité (sauf à soutenir qu’il entendait ainsi se défendre contre les risques d’intrusions du dirigeable du voisin dans sa propriété du dessus…ce qui est pour le moins peu convaincant), mais avait été édifié dans l’unique but de nuire à son voisin, en rendant plus difficiles les manœuvres du dirigeable, notamment par grand vent, dont il faisait loisir. Et la Cour de cassation de dire que « l’arrêt (d’appel) a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit ». Déjà dans notre ancien droit, les Parlements n’hésitaient pas à réprimer tout abus malicieux ; ainsi fut condamné par le Parlement d’Aix, le 1er février 1577, un cardeur de laine (carder : Travailler les fibres textiles afin de les démêler à l’aide de cardes) qui chantait dans le seul dessein d’importuner un avocat, son voisin. Domat (jurisconsulte du XVIIe s., précurseur du Code civil, il publie « Les lois civiles dans leur ordre naturel », 1689. Le canoniste Boileau écrira que cet ouvrage lui a permis de discerner dans la science du droit une raison qui lui était demeurée jusqu’alors étrangère) admettait que l’exercice d’un droit engage la responsabilité quand il est malicieux ou n’est justifié par aucun intérêt (Mazeaud et Chabas, Leçons de droit civil, t. 2, Obligations, 9ème éd., Montchrestien, 1998, n° 456). Il en résulte une difficulté certaine pour discerner avec sûreté, parmi de multiples solutions éparses, la cohérence d’un ensemble aux contours fuyants (J. Ghestin et alii, Traité de droit civil, Introduction générale, 4ème éd., L.G.D.J., 1994, n° 761). Et le professeur Durry d’écrire : « moins que jamais, il ne paraît possible d’établir une théorie unitaire de l’abus de droit (…). Les tribunaux refusent en cette matière de se laisser enfermer dans aucun système » (RTDciv. 1972, p. 398). Et pourtant, la modélisation de ce phénomène complexe faciliterait grandement sa compréhension. Faute de parvenir à systématiser l’attitude générale des tribunaux, on pourrait se laisser guider par la fantaisie, l’humeur du moment. Mais, on manquerait, d’une part, à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit ; on oublierait, d’autre part, que le Droit est un système organisé de valeurs, de principes, d’instruments techniques, etc. qu’expriment des règles dont on ne peut négliger ni les fondements, ni les manifestations concrètes ou formelles. Aussi bien il importe de tenter de cerner les lignes directrices qui se dégagent de l’ensemble des décisions qui nous occupe. C’est du reste une disposition d’esprit qu’il faut avoir en toute circonstance. La réglementation de détail, si poussée qu’elle soit, ne peut tout prévoir, alors que les principes généraux peuvent abriter de multiples situations nouvelles et imprévues. [Une bonne formation des étudiants devrait être mieux nourrie de théorie générale et moins gravée de simples connaissances accumulées (J.-L. Bergel). Le certificat d’études judiciaires y participe.] Que l’on se place au niveau macro-juridique de l’ensemble d’un système de Droit, ou au niveau micro-juridique d’une règle, l’élaboration, la compréhension et l’application du droit exigent que l’on s’interroge, notamment, sur le pourquoi et le comment. Le « pourquoi » du droit permet d’en détecter la finalité et l’esprit dont le respect s’impose pour l’interprétation, l’évolution et l’application de la norme, afin qu’elle ne soit pas détournée de son objet et que la cohérence du système de soit pas mise à mal. Le « comment répond » au caractère impératif ou supplétif des dispositions considérées (J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 4ème éd., Dalloz, n° 7).
Afin d’être plus à-même de saisir les tenants et aboutissants de ce que l’on désigne par convention « théorie de l’abus de droits », nous aborderons en premier lieu, la fonction de l’abus de droit (pourquoi) et, en second lieu, les critères de l’abus de droit (comment ou quand).
I – Fonction de l’abus de droit (pourquoi)
« L’abus de droit est un instrument de police des droits subjectifs par rapport à la finalité que leur assigne le droit objectif » (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, op. cit., n° 30). Bien que destinés à la satisfaction des intérêts individuels de leur titulaire, lesdits droits subjectifs ne leur confèrent pas des prérogatives illimitées (F. Terré et alii, Grands arrêts de la jurisprudence civile, 67). Carbonnier écrit en ce sens « si, sans en dépasser les limites matérielles, un individu se sert de son droit pour nuire à autrui ; si, tout en en respectant la lettre, il en viole l’esprit, on dira qu’il abuse, non plus qu’il use de son droit et cet abus ne saurait être juridiquement protégé » (Droit civil, Introduction, Les personnes, n° 45). L’article 2, al. 2, du Code civil suisse ne dit pas autre chose : « L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi ».
Autrement dit, l’application aveugle de la règle de droit risque de conduire à des conséquences iniques. Souvenons-nous : summum jus, summa injuria. Il ne s’agirait pas que la technique juridique, par la combinaison des règles et leur utilisation, s’exerçât au mépris des finalités du système juridique, qu’un droit avec un petit « d » s’exerçât au mépris du Droit avec un grand « D ». Il est des cas où la rigueur logique de la combinaison des règles de droit révèle les failles du système : la technique juridique risque alors de se retourner contre les fins qu’elle prétend servir. Si les exigences d’ordre moral, les impératifs d’une harmonieuse organisation des rapports sociaux, le souci de justice, viennent à être gravement menacés, de telles déviations doivent être redressées (J. Ghestin, op. cit., n° 760).
La société créé le droit, le droit ne peut donc être exercé contre la société. Ce serait, en quelque sorte, la révolte de la créature contre le créateur (G. Ripert, Abus ou relativité des droits, Revue critique, 1929). L’hypothèse n’est pas d’école. Il ne suffit que de se songer à la législation nazie (ou soviétique). Encore que, à la réflexion, pareille législation ne saurait jamais avoir engendré un quelconque droit, sauf à faire passer pour droit ce qui en est la violation la plus parfaire. C’est ce qu’on nomme la perversion du droit (renversement). [Le Doyen Vedel, regardant en mai 1945 les affligeants cortèges de déportés libérés des camps nazis, de déclarer : je ne sais pas ce qu’est le droit, mais je sais ce qu’est un État sans droit]. Il faut bien comprendre que « l’office du juge est d’abord de rechercher dans les litiges qui lui sont soumis la solution juste, c’est-à-dire celle qui (…) ne heurte ni sa conscience, ni la conscience collective ». Il n’est pas indifférent de rappeler que le gouvernement de Vichy, notamment, se réserva le pouvoir de relever les magistrats de leurs fonctions « nonobstant toute dispositions législatives et réglementaires contraires » (acte dit loi du 17 juillet 1940).
Un peu à la manière de la Matrice et des machines qui sont entrées en guerre contre les humains et leur velléité de survie (in Matrix, http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrix), symbolisée par l’élu, Néro, le droit crée les moyens de contrôler sa propre application. Les juges sont alors en première ligne. Pour cause : ils se trouvent directement au contact des difficultés que suscite la mise en œuvre des droits. Il leur appartient de trouver les solutions qui sauvegardent la finalité du système juridique. Ils doivent procéder sur-le-champ, sans attendre un hypothétique secours du législateur qui serait, de toute façon, trop tardif (J. Ghestin, op. cit., n° 760). Planiol a raison lorsqu’il écrit (pour le dénoncer) que le juge « est obligé de scruter les consciences, de connaître et de peser les motifs », mais la fin justifie le moyen.
Voici un extrait de la thèse de Josserand : « toute prérogative, tout pouvoir juridique sont sociaux dans leur origine, dans leur essence et jusque dans la mission qu’ils sont destinés à remplir ; comment se pourrait-il en être autrement, puisque le droit objectif pris dans son ensemble n’est autre chose que la règle sociale obligatoire ? (…) Si la société reconnaît [des] prérogatives au propriétaire et au créancier, ce n’est pas pour leur être agréable, mais bien pour assurer sa propre conservation ; comme la nature elle-même, et suivant la remarque profonde de Jhéring (1818-92), elle rattache son propre but à l’intérêt d’autrui ; elle fait en sorte que chacun travaille dans son intérêt bien compris, au salut de la collectivité ; elle met les égoïsmes individuels au service de la communauté (…) ; et, puisque chaque égoïsme concourt au but final, il est de toute évidence que chacun de nos droits subjectifs doit être orienté et tendre vers ce but final, (…) chacun d’eux doit se réaliser conformément à l’esprit de l’institution ; en réalité, et dans une société organisée, les prétendus droits subjectifs sont des droits-fonctions ; ils doivent demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon leur titulaire commet un détournement, un abus de droit ». Et l’auteur de conclure : « l’acte abusif est l’acte contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa finalité ».
II – Critères de l’abus de droit
Sérier le ou les critères de l’abus de droit revient à s’interroger sur la question de savoir dans quel(s) cas le titulaire d’un droit abuse-t-il des prérogatives individuelles conférées par la loi (au sens matériel du terme). De prime abord, c’est chose peu aisée que de déterminer les limites d’un droit subjectif, et, par voie de conséquences, les frontières de l’abus. La lecture de Planiol laisse poindre la vanité de l’entreprise. L’auteur écrit que « les hommes passent leur vie à se nuire les uns aux autres ; la vie des sociétés est une lutte perpétuelle et universelle ; (…) toute homme, toute nation qui acquière une supériorité dans une branche quelconque de son activité en supplante d’autres, évince ses concurrents, leur nuit et c’est son droit de leur nuire. Telle est la loi de la nature et l’humanité n’a pas d’intérêt à s’y soustraire, parce qu’elle est le seul stimulant de son énergie (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, L.G.D.J., 1909, pp. 287, 288). La vie est sûrement une jungle. Mais, contrairement à ce que paraît suggérer Planiol, elle n’est pas laissée à l’état de nature. Le Droit la discipline. C’est la condition de la survie du groupe, du maintien de son organisation et de sa cohérence.
La définition des prérogatives que la loi confère au titulaire d’un droit subjectif s’opère sur deux plans. Il y a les limites externes du droit et les limites internes du droit. Seules ces dernières ont partie liée avec la théorie de l’abus des droits.
Certains pouvoirs, décrits objectivement d’après leur nature ou leur objet sont accordés, d’autres refusés. Un propriétaire peut construire sur son terrain ; il ne peut empiéter sur celui de son voisin. Des ouvriers peuvent se mettre en grève ; ils n’ont pas le droit de séquestrer leur employeur. Dans ces circonstances, il est question de défaut de droit, non pas d’abus, à proprement parler. La théorie de l’abus des droits n’est pas nécessaire pour sanctionner l’action illégitime ou illégale.
Les limites internes tiennent à ceci que les prérogatives accordées à une personne par la loi ne le sont pas de façon absolue. Il y a une mesure à respecter dans leur exercice. Dire qu’un propriétaire a le droit de construire sur son propre terrain ne signifie pas nécessairement qu’il peut construire n’importe quoi n’importe comment. Dire qu’un agent économique a le droit de nuire à un concurrent ne signifie pas qu’il peut procéder par voie de concurrence déloyale. Si un propriétaire édifie un ouvrage à seule fin de gêner son voisin, il sort de son droit, bien qu’il n’en dépasse pas les limites externes. Le droit peut accorder certains pouvoirs et restreindre leur mise en œuvre. Seulement, ces limites internes sont rarement exprimées formellement par la loi lorsqu’elle énonce les prérogatives qu’elle accorde. De sorte que c’est dans les principes généraux, voire dans l’esprit du système juridique qu’il faut rechercher de telles limites.
Les auteurs qui se sont appliqués à analyser le contenu de l’abus s’ordonnent, schématiquement, autour de deux pôles extrêmes, entre lesquels, à la vérité, les tribunaux n’ont jamais formellement choisi. Les uns soutiennent qu’il importe d’opter pour une conception subjective ou moraliste, les autres défendent une conception objective ou téléologique (finaliste).
Les premiers, dont Ripert et Boulanger sont les hérauts, le droit subjectif, dérivé de la grande loi naturelle de l’inégalité, est par nature un pouvoir égoïste. C’est celui qui courbe le débiteur devant le créancier, l’ouvrier devant le patron. Pour cette raison, il n’y a pas à scruter le but recherché par le droit, sa finalité. Dans cette conception, l’abus n’existera que si le droit a été exercé avec l’intention de nuire. Cette démarche est fondée sur la recherche de l’intention de l’agent (Ph. le Tourneau et L. Cadiet, op. cit., n° 24). C’est précisément ainsi que la Chambre des requêtes a procédé dans l’arrêt princeps du 3 août 1915. Il est, du reste, de jurisprudence constante que l’intention de nuire suffit à entacher de faute un comportement objectivement correct. Les seconds, au rang desquels on compte Josserand, définissent l’abus de droit comme l’acte contraire au but de l’institution, à son esprit, à sa finalité. Ce faisant, ils rejoignent la notion administrative de détournement de pouvoir. Les droits sont des fonctions qu’il n’est pas permis de détourner de leur destination sociale. Dans cette optique, l’intention de nuire ne prête pas à conséquence. Le contenu psychologique de l’abus est quasiment inexistant. Il suffit de rechercher si l’activité entrait dans les prévisions du législateur (J. Ghestin, op. cit., n° 765).
Cornu proposa de retenir un critère objectif raisonnable et souple : « l’exercice d’un droit est abusif lorsqu’il inflige des à intérêts légitimes un sacrifice manifestement disproportionné avec la satisfaction dérisoire qu’il procure à son titulaire (Introduction, 13ème éd., Montchrestien, 2007, n° 151 – Les biens, 13ème éd., Montchrestien, n° 39).
Quel que soit le critère retenu, une critique d’ordre pratique se fait jour. L’équité, la politique juridique, ce sont là des notions bien vagues, qui donnent à la théorie de l’abus des droits des traits incertains. Sous cet angle de vue, il est fâcheux d’abandonner au juge le soin de définir les limites et/ou la finalité des droits en conflits. Dans le dessein de ne pas dévoyer le système, on prendrait le risque de retirer toute stabilité et toute sécurité aux rapports juridiques établis selon la législation. Ripert écrira : « en réalité, le droit individuel, dominé par le principe de la relativité, ne donne plus à son titulaire ni la sécurité de l’action, ni la jouissance du pouvoir. Il n’est accordé que pour permettre d’accomplir la fonction. Il était attribut de maître, il est devenu rétribution du fonctionnaire » (cité par S. Carval, op. cit., p. 197). La critique n’est pourtant pas décisive. Ces traits incertains sont à la fois sa faiblesse et sa force. Il est maints domaines où le juge est appelé à se prononcer en dehors d’une application littérale des textes de loi sans que le chaos en résulte. Le jeu des voies de recours et le contrôle de la Cour de cassation garantit la cohérence et une suffisante continuité des orientations judiciaires.
Je laisserai la conclusion de ces quelques développements à Monsieur le professeur Ghestin (Introduction générale au droit, op. cit.). Le bien commun est sûrement le maître-mot qui doit rattacher la théorie finaliste des droits et de leurs abus à la philosophie de Saint Thomas d’Aquin ou la doctrine de l’ordre naturel selon Aristote. « Il n’est pas périmé de soutenir que le juste est en définitive cela qui sert le bien de l’homme, un bien commun qui n’est point donné à l’avance, que la mission même du juriste est de découvrir, de susciter » (M. Villey, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, p. 134, note 2. V. aussi A. Sériaux, Philosophie du droit, PUF). Orienter l’activité humaine dans un sens conforme au bien commun est un objectif qui n’a rien d’inquiétant. C’est le rôle du droit en général. C’est à quoi doit contribuer techniquement la théorie de l’abus des droits (J. Ghestin, op. cit., n° 789).
J.B.
Voyez encore M. Cozian, Précis de droit fiscal des entreprises, LexiNexis, spéc. p. 794
“L’abus de droit est le châtiment des surdoués de la fiscalité. Bien évidemment ils ne violent aucune prescription de la loi et se distinguent en cela des vulgaires fraudeurs (…). L’abus de droit est un péché non contre la lettre mais contre l’esprit de la loi. C’est également un péché de juriste. L’abus de droit est une manipulation des mécanismes juridiques là où la loi laisse place à plusieurs voies pour obtenir un même résultat ; l’abus de droit, c’est l’abus de choix juridiques”.