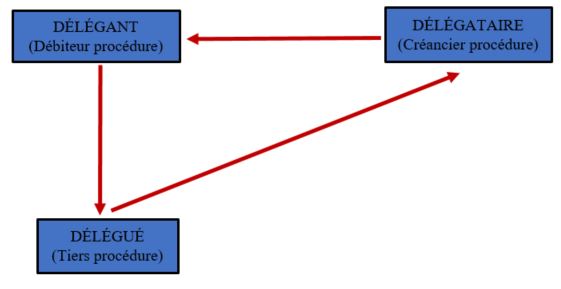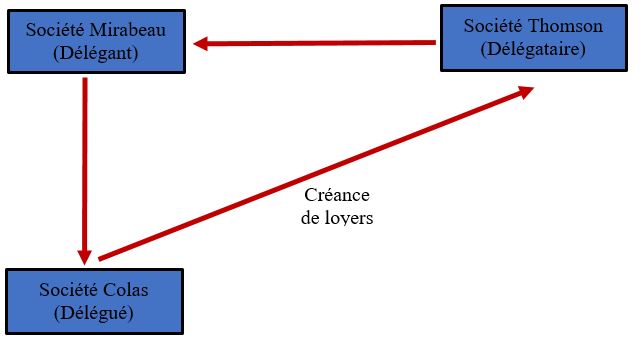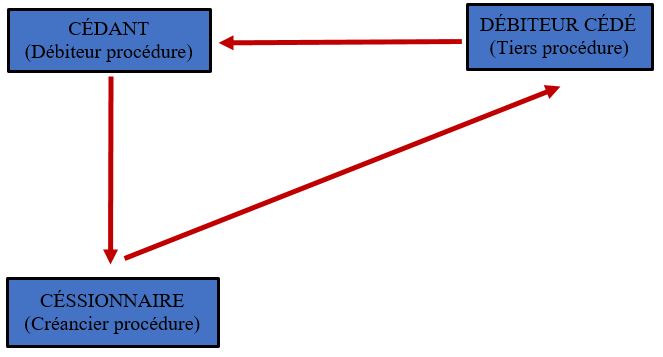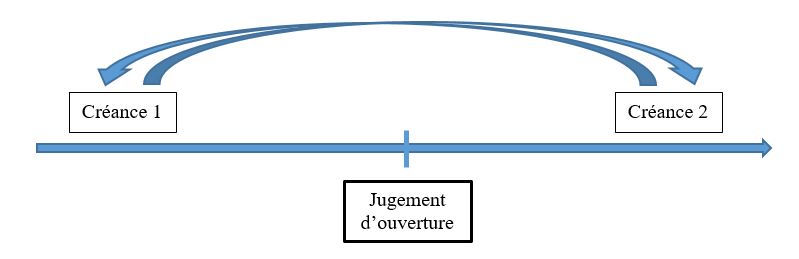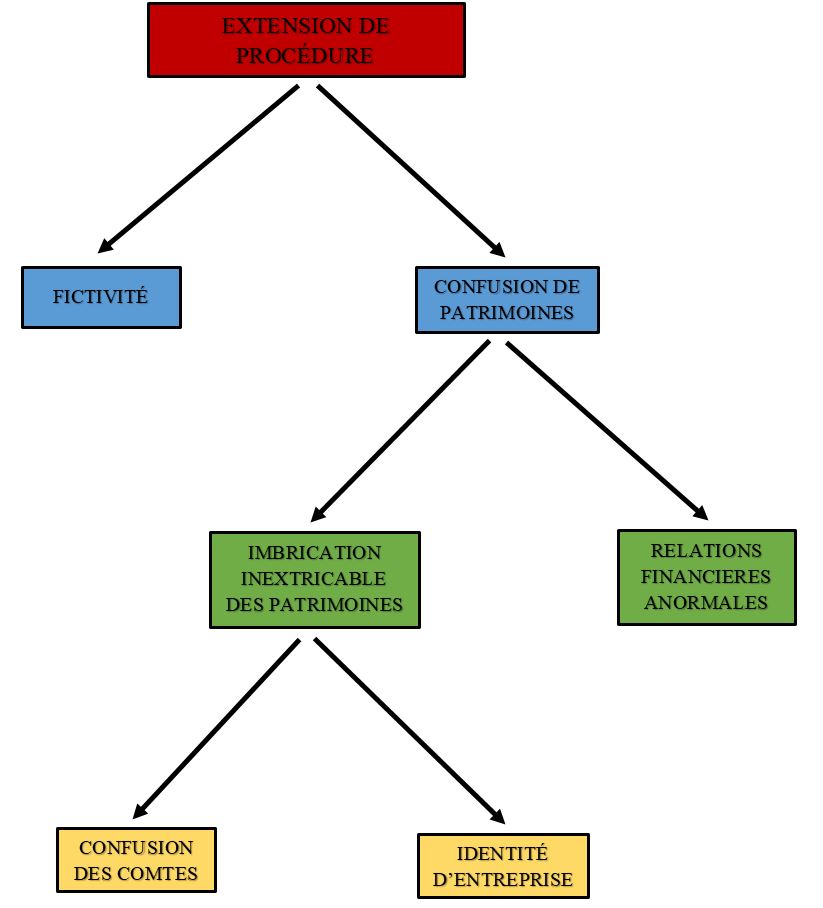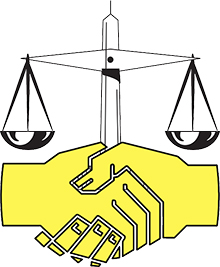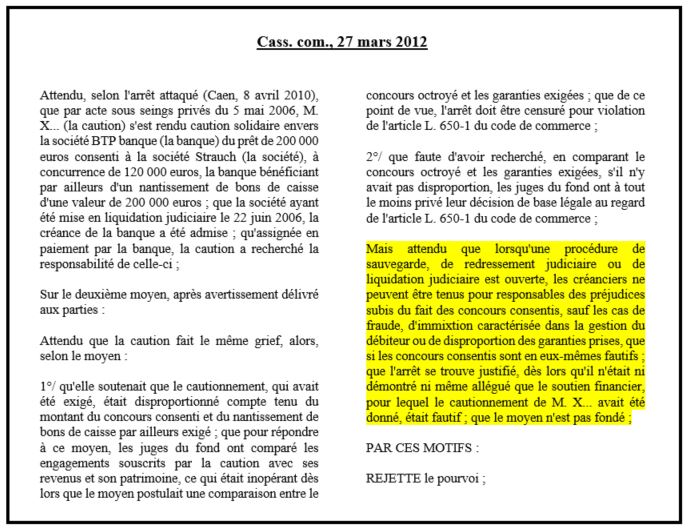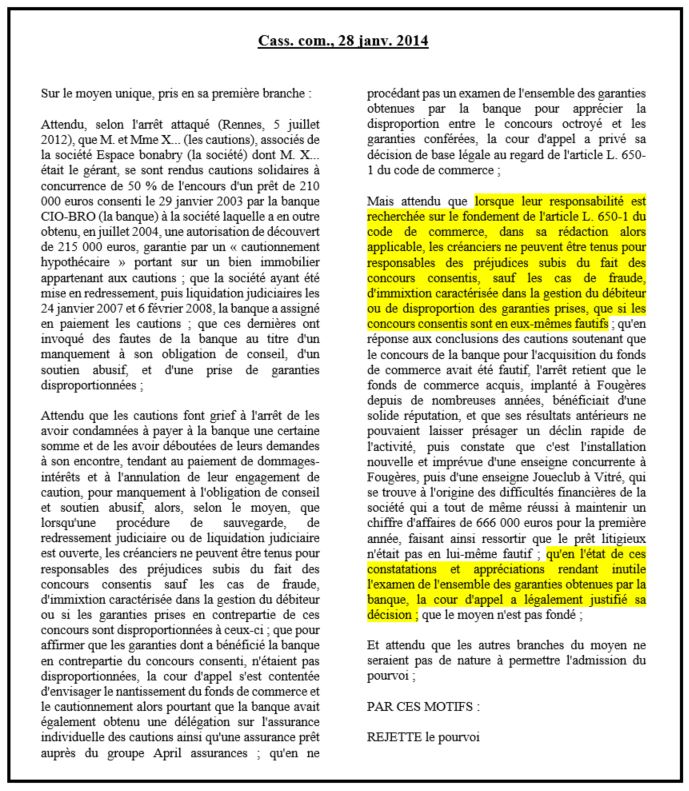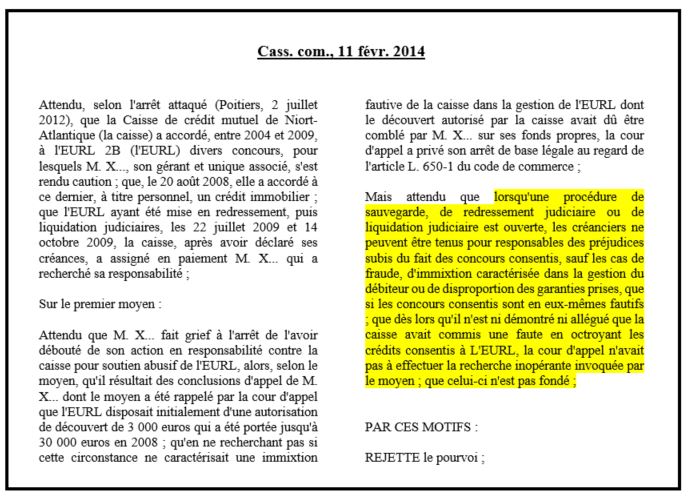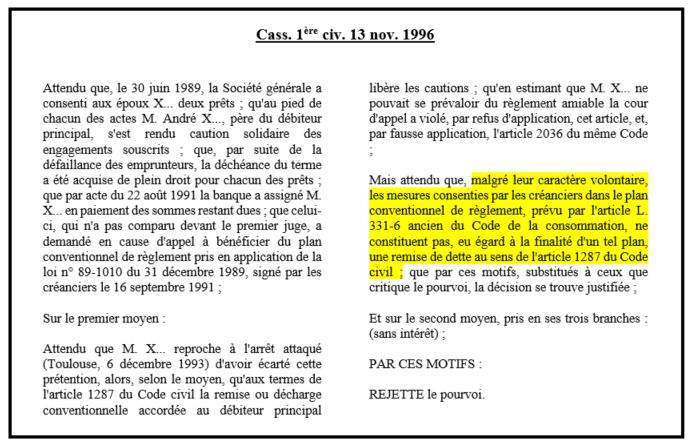I) Définition
A) L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
==> Notion
Elle est définie à l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier comme « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation. »
Aussi, cette activité ne consiste pas en l’accomplissement d’opérations de banque ou en la fourniture de services de paiement, elle vise seulement à mettre en relation des clients avec un établissement agréé pour fournir ce type de prestation, le plus souvent en établissement de crédit.
L’article R. 519-1 du Code monétaire et financier précise que « est considéré comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d’une opération de banque ou à la fourniture d’un service de paiement le fait pour toute personne de solliciter ou de recueillir l’accord du client sur l’opération de banque ou le service de paiement ou d’exposer oralement ou par écrit à un client potentiel les modalités d’une opération de banque ou d’un service de paiement, en vue de sa réalisation ou de sa fourniture. »
L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement fait ainsi l’objet d’une définition extrêmement large.
==> Les opérations visées
Elle peut porter sur toute opération de banque au sens de l’article L. 311-1 du Code de monétaire et financier.
Selon cette disposition « les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement. »
Trois sortes d’opérations peuvent donc faire l’objet d’une intermédiation :
- La réception de fonds du public
- L’article L. 312-2 dispose que sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer.
- Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
- Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
- Les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l’appréciation de ce seuil, il n’est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.
- La fourniture de crédit
- L’article L. 313-1 du Code monétaire et financier prévoit que :
- D’une part, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie
- D’autre part, sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat.
- L’article L. 313-1 du Code monétaire et financier prévoit que :
- La fourniture de services de paiement
- L’article L. 314-1 du Code monétaire et financier prévoit que
- Sont des services de paiement :
- Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement
- Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
- L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
- Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
- Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
- Les virements, y compris les ordres permanents ;
- L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
- Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
- Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
- Les virements, y compris les ordres permanents ;
- L’émission d’instruments de paiement et / ou l’acquisition d’ordres de paiement ;
- Les services de transmission de fonds ;
- L’exécution d’opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l’opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d’intermédiaire entre l’utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services.
- N’est pas considérée comme un service de paiement :
- La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
- Un titre de service sur support papier ;
- Un chèque de voyage sur support papier ;
- Un mandat postal sur support papier tel que défini par l’Union postale universelle ;
- La réalisation des opérations de paiement liées au service d’actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.
- La réalisation d’opérations fondées sur l’un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
- Sont des services de paiement :
- L’article L. 314-1 du Code monétaire et financier prévoit que
==> Fourniture additionnelle de conseil en matière de crédit
Le rôle des IOBSP ne se cantonne pas à la facilitation de la réalisation d’opérations de banque et de services de paiements, ils sont également autorisés à dispenser des conseils à leurs clients en matière de crédit.
- Objet de la fourniture de conseil
- L’article L. 519-1-1 du Code de la consommation prévoit que « les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent fournir à leurs clients un service de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit mentionnés à l’article L. 313-1 du code de la consommation, à l’exclusion des opérations de regroupement de crédits définies aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code.»
- Le service de conseil consiste, selon cette disposition, en la fourniture au client, y compris au client potentiel, de recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit.
- Conditions de la fourniture de conseil
- Le conseil personnalisé peut porter sur un ou plusieurs contrats de crédits à la condition que lesdits contrats soient adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :
- d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits pour les intermédiaires agissant en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit ou une société de financement ; ou
- d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d’un mandat délivré par un client.
- L’article R. 519-22-1 du Code monétaire et financier précise que lorsque l’intermédiaire intervient dans le cadre d’un service de conseil, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.
- En outre, la recommandation doit être fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.
- Enfin, l’intermédiaire doit communiquer au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.
- Le conseil personnalisé peut porter sur un ou plusieurs contrats de crédits à la condition que lesdits contrats soient adaptés aux besoins et à la situation financière du client sur le fondement de la prise en considération :
- Caractères de la fourniture de conseil
- La fourniture de conseil constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
- Le conseil est qualifié d’indépendant dès lors qu’il est rendu en considération d’un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et que sa fourniture ne donne lieu à aucune autre rémunération que celle versée, le cas échéant, par le client, ni à aucune forme d’avantage économique.
- L’intermédiaire de crédit qui fournit une prestation de service de conseil indépendant peut se prévaloir de l’appellation de conseiller indépendant.
B) Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
==> Notion
L’article L. 519-1 du Code monétaire et financier prévoit que « est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire ou qui fournit un service de conseil au sens de l’article L. 519-1-1. »
Il ressort de cette définition que l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) peut être, tant une personne physique qu’une personne morale.
Toutefois, l’article L. 519-2 du Code monétaire et financier précise que :
- D’une part, l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s’exercer qu’entre deux personnes dont l’une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
- D’autre part, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut agir qu’en vertu d’un mandat délivré par l’établissement dont il distribue les produits.
==> Conditions
Pour être intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- Objet de l’intermédiation
- L’intermédiation ne peut avoir pour objet qu’une opération de banque ce qui comprend
- La réception de fonds du public
- La fourniture de services de paiement
- La fourniture de crédits
- L’intermédiation ne peut avoir pour objet qu’une opération de banque ce qui comprend
- Exercice à titre habituel
- Pour être soumis au régime juridique de l’intermédiation en opération de banque et en services de paiement, l’intermédiaire doit exercer cette activité à titre habituel
- On peut en déduire que lorsque l’opération d’intermédiation est ponctuelle, elle ne tombe pas sous le coup des dispositions du Code monétaire et financier.
- Existence d’une contrepartie
- Il ressort de l’article L. 519-1 du code monétaire et financier que le statut d’IOBSP est subordonné à l’octroi d’une rémunération.
- L’article R. 519-5 du Code monétaire et financier précise que la rémunération doit s’entendre comme tout versement pécuniaire ou toute autre forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation.
- Aussi, lorsque l’intermédiation est assurée par un opérateur à titre gratuit, il est insusceptible d’endosser le statut d’IOBSP et n’est donc pas soumis aux obligations y afférent.
II) Classification
Tandis que le Code monétaire et financier a réparti en plusieurs catégories les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, en parallèle certaines personnes sont exclues du champ d’application du dispositif.
A) Catégories
- Exposé des catégories
L’article R. 519-4, I du Code monétaire et financier répartit les IOBSP en quatre catégories :
==> Les courtiers
- Conditions
- Immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement
- Conclusion d’un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
- Exclusions
- Le courtier doit agir en qualité de mandataire du client
- Le mandant ne peut pas être
- Soit un établissement de crédit
- Soit une société de financement
- Soit un établissement de paiement
- Soit un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
==> Les mandataires exclusifs
Plusieurs conditions doivent être remplies pour endosser cette qualité:
- Conclusion d’un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Soit d’un établissement de crédit
- Soit d’une société de financement
- Soit d’un établissement de paiement
- Soit d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement
- Exclusivité de la relation contractuelle pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement
==> Les mandataires non exclusifs
Pour endosser cette qualité il suffit de conclure un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Soit d’un établissement de crédit
- Soit d’une société de financement
- Soit d’un établissement de paiement
- Soit d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement
==> Les mandataires d’intermédiaires
- Pour endosser cette qualité il suffit de conclure un mandat d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, à la faveur
- Soit d’un courtier
- Soit d’un mandataire exclusif
- Soit d’un mandataire non-exclusif
2. Règles propres aux catégories
==> Règle de non-cumul
L’article R. 519-4, II du Code monétaire et financier dispose que « une même personne ne peut cumuler l’exercice de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au titre de plusieurs catégories que pour:
- Soit la fourniture d’opérations de banque de nature différente
- Sont ici spécifiquement visés
- le crédit à la consommation,
- le regroupement de crédits
- le crédit immobilier
- le prêt viager hypothécaire.
- Soit la fourniture de services de paiement
- Sont ici spécifiquement visés
==> Règle propre aux mandataires d’intermédiaires
Les mandataires d’intermédiaires ne peuvent pas bénéficier de certaines dispositions relatives à la liberté d’établissement (règles édictées à l’article L. 519-8 du CMF) pour l’exercice de l’activité d’intermédiation en matière de contrat de crédit immobilier
B) Exclusions
Un certain nombre d’opérateurs sont exclus du champ d’application du régime juridique de l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiements.
Les exclusions sont d’ordre légal et réglementaire.
- Les exclusions légales
L’article 519-1, II du Code monétaire et financier prévoit que le statut d’IOBSP ne s’applique pas :
- aux établissements de crédit
- aux sociétés de financement
- aux sociétés de gestion de portefeuille lorsqu’elles agissent pour un placement collectif qu’elles gèrent
- aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement,
- aux établissements de paiement
- aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement
- aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d’un établissement de crédit, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d’un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services
- aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
- aux notaires ( L. 519-3 CMF)
2. Les exclusions réglementaires
L’article R. 519-2 introduit par le décret n°2014-1315 du 3 novembre 2014 dans le Code monétaire et financier prévoit que ne sont pas intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L. 519-1 et ne sont pas soumis aux obligations y afférent :
==> Les « petits » intermédiaires
Les personnes offrant des services d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle mais qui ne remplissent pas les exigences de seuil n’endossent pas le statut d’IOPSB
- Conditions
- Il faut que le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile
- d’une part n’excèdent pas
- pour les opérations de banque : soit vingt opérations par an, soit un montant annuel de deux cent mille euros (200 000 €)
- pour les services de paiement mentionnés au II de l’article L. 314-1 : vingt opérations par an.
- d’autre part, soit compris dans la limite de trente opérations ou de 300 000 euros.
- d’une part n’excèdent pas
- Il faut que le nombre total des opérations de banque ou de services de paiement ou le montant total des crédits octroyés ou des services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile
- Exception
- Cette exclusion ne s’applique pas
- aux personnes qui agissent dans le cadre d’une opération de démarchage
- aux personnes dont l’activité d’intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations:
- de crédit immobilier
- de regroupement de crédits
- de prêt viager hypothécaire
- Au bilan, l’exclusion ne s’applique que pour l’intermédiation portant sur des crédits à la consommation ou des crédits consentis à des professionnels hors situation de démarchage.
- Cette exclusion ne s’applique pas
==> Les indicateurs
- Notion
- L’indicateur est celui dont la fonction se limite à la seule mise en relation entre un établissement bancaire et un client.
- L’article R. 519-2 du Code monétaire et financier définit l’indicateur au moyen d’un critère fonctionnel.
- L’indicateur est :
- Soit la personne dont le rôle se limite à indiquer un établissement bancaire à une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement en lui remettant des documents à caractère publicitaire
- Soit la personne dont le rôle se limite à transmettre à un établissement bancaire les coordonnées d’une personne intéressée à la conclusion d’une opération de banque ou de services de paiement
- Régime
- Rôle
- Le rôle de l’indicateur se limite à la seule mise en relation.
- Aussi, ne saurait-il, en aucune manière, apporter son concours dans le processus de conclusion du contrat.
- Tout au plus, il peut diffuser auprès de sa clientèle les brochures publicitaires de l’établissement bancaire, voire transmettre à celui-ci des coordonnées.
- S’il sort de ce rôle – par exemple en réceptionnant des documents contractuels ou supervisant l’échange des signatures – il s’expose à une condamnation pour exercice illégal de la profession d’IOBSP
- Rémunération
- L’article R. 519-2 du Code monétaire et financier n’exclut pas la faculté pour l’indicateur de percevoir une rémunération en contrepartie du service d’intermédiation qu’il fournit à l’établissement bancaire.
- Pourtant, l’article R. 519-5, II du Code monétaire et financier pose l’interdiction pour toute personne qui n’endosserait pas la qualité d’IOBSP de se voir allouer une rémunération au titre de l’activité d’intermédiation.
- Cette disposition précise néanmoins en son III que cette interdiction « ne fait pas obstacle au versement d’une commission d’apport aux indicateurs».
- Aussi, peut-on en déduire que les indicateurs sont autorisés à percevoir une commission, à la condition exclusive de conclure avec l’établissement bancaire une convention d’indication ou d’apport d’affaires.
- Publicité
- Contrairement aux IOBSP, les indicateurs ne peuvent pas communiquer, en leur qualité d’intermédiaire, sur les produits bancaires vers lesquels ils orientent leurs clients en vertu d’une convention d’indication.
- Cette interdiction se déduit de l’article L. 546-3, al. 1er du Code monétaire et financier qui prévoit que « il est interdit à toute personne autre que l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 546-1 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre mentionné à l’article L. 546-1 au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière. »
- Il y a fort à parier que l’indicateur qui communiquerait sur les produits pour lesquels il intervient en tant qu’intermédiaire tomberait sous le coup de cette interdiction.
- Rôle
- Sanction
- L’exercice illégal de la profession d’IOBSP est réprimé par l’article L. 571-15 du Code monétaire et financier
- Cette disposition prévoit que « le fait, pour toute personne physique, d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 519-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.»
==> Les agents de prestataires de services de paiement
Il s’agit des personnes visées à l’article L. 523-1 du Code monétaire et financier.
Cette disposition prévoit que les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d’un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.
Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci.
Tout agent agit en vertu d’un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d’informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu’ils entrent en contact avec eux.
Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir.
À cet effet, ils communiquent à l’Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l’enregistrement des agents.
Lorsqu’un agent ne remplit plus les conditions d’enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d’en informer l’autorité auprès de laquelle l’agent a été enregistré.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d’enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
==> Les personnes mandatées par les établissements de crédit
Il s’agit des personnes visées à l’article L. 523-6 du Code monétaire et financier.
Cette disposition prévoit que les établissements de crédit peuvent mandater toute personne exerçant par ailleurs une autre profession, en vue de la délivrance de monnaie exclusivement à leurs clients disposant d’un compte présentant les caractéristiques mentionnées à l’article L. 314-1 ouvert dans leurs livres, contre un ordre de paiement donné avec un moyen de paiement associé au compte précité.
L’établissement de crédit demeure pleinement responsable, vis-à-vis de ses clients, des actes de la personne mentionnée au premier alinéa nés à l’occasion de l’activité mentionnée au même alinéa, y compris du respect par cette dernière de la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans le cadre de cette activité.
L’activité du mandataire doit demeurer accessoire et non significative par rapport à la profession principale du mandataire.
==> Les personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée des services ou opérations connexes
L’activité doit être liée :
- Soit au conseil et à l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et d’une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l’exercice illégal de certaines professions ( 311-2 CMF)
- Soit à la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d’entreprises ( L. 321-2 CMF)
III) Conditions d’exercice
Parce qu’ils prêtent leur concours à la réalisation d’opérations de banque et de services de paiement, plusieurs obligations pèsent sur les IOBSP.
A) Obligation d’immatriculation
L’article L. 519-3-1 du Code monétaire et financier dispose que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont immatriculés sur le registre unique des intermédiaires (ORIAS) qui est librement accessible au public.
- Modalités de l’immatriculation
- L’immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’ORIAS, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 250 euros.
- Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’ORIAS, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l’Etat.
- Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’inscription ou de la demande de renouvellement.
- Lorsque la demande d’inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l’informant qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d’inscription ne pourra être prise en compte.
- Dans le cas d’une demande de renouvellement, le courrier indique que l’absence de paiement entraîne la radiation du registre.
- L’article L. 546-2 du Code monétaire et financier précise que lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les IOBSP sont tenues de transmettre à l’ORIAS toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l’accès à leur activité et à son exercice.
- Elles sont également tenues d’informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu’elles ne respectent plus ces conditions.
- Responsabilité du mandant
- L’article L. 519-3-2 du Code monétaire et financier prévoit que « les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s’assurer que ceux-ci sont immatriculés auprès de l’ORIAS.
- À défaut, l’établissement bancaire engage sa responsabilité.
- Mission de l’ORIAS
- L’ORIAS est chargé de l’établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes immatriculées.
- À ce titre il reçoit les dossiers de demandes d’immatriculation ou de renouvellement de l’immatriculation et statue sur ces demandes.
- Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l’inscription dans les conditions prévues au VIII de l’article R. 546-3.
- La commission chargée des immatriculations est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus.
- À cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions d’éligibilité à l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement
- Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l’ORIAS, du nom de l’entreprise ou de l’établissement auprès desquels les IOBSP ont souscrit un contrat d’assurance ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l’article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.
- Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.
- Sanction
- L’article L. 546-3 du Code monétaire et financier prévoit deux interdictions
- D’une part, il est interdit à toute personne autre qu’un IOBSP d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu’elle est immatriculée sur le registre tenu par l’ORIAS au titre de l’une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.
- D’autre part, il est interdit à une personne immatriculée sur le registre tenu par l’ORIAS de laisser entendre qu’elle a été immatriculée au titre d’une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
- L’article L. 546-4 du Code monétaire et financier précise que
- Le fait, pour toute personne, de méconnaître l’une des interdictions prescrites par l’article L. 546-3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
- Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-35 du code pénal.
- L’article L. 546-3 du Code monétaire et financier prévoit deux interdictions
B) Conclusion d’un contrat de mandat
L’article L. 519-2 du Code monétaire et financier prévoit que l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, ou un établissement de paiement.
Le mandat en vertu duquel l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu’il est habilité à accomplir.
Ainsi, non seulement le mandat conclu entre l’établissement bancaire et l’IOBSP doit être écrit, mais encore il doit être précis et détaillé.
C) Capacité d’exercice
Pour exercer l’activité d’IOBSP il faut remplir des conditions qui tiennent, d’une part, aux compétences professionnelles et, d’autre part, à l’honorabilité.
L’article L. 519-3-3 du Code monétaire et financier dispose en ce sens que « les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle. »
==> Compétences professionnelles
L’article R. 519-8 du Code monétaire et financier prévoit que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et leurs mandataires doivent justifier des compétences professionnelles résultant :
- Soit d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’un niveau de formation II ;
- Soit d’une expérience professionnelle :
- D’une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise en tant que cadre au cours des trois années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1 ;
- D’une durée de quatre ans dans des fonctions liées à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des cinq années précédant l’immatriculation sur le registre unique mentionné à l’article L. 546-1
- Soit d’une formation professionnelle de 150 heures adaptée à la réalisation d’opérations de banque ou de services de paiement, suivie :
- Auprès d’un établissement de crédit, d’un établissement de paiement ou d’une entreprise d’assurance ;
- Auprès d’un organisme de formation choisi par l’intéressé, son employeur ou, le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l’article R. 519-12.
==> Honorabilité
L’article R. 519-6 du Code monétaire et financier ferme l’accès à l’activité d’IOBSP aux personnes qui
- Soit font l’objet:
- D’une condamnation définitive depuis moins de 10 ans
- Pour crime
- À une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins six mois avec sursis pour :
- L’une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l’escroquerie et l’abus de confiance ;
- Recel ou l’une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
- Blanchiment ;
- Corruption active ou passive, trafic d’influence, soustraction et détournement de biens ;
- Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique, falsification des marques de l’autorité ;
- Participation à une association de malfaiteurs ;
- Trafic de stupéfiants ;
- Proxénétisme ou l’une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
- L’une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
- L’une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
- Banqueroute ;
- Pratique de prêt usuraire ;
- L’une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
- L’une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ;
- Fraude fiscale ;
- L’une des infractions prévues aux articles L. 121-8 à L. 121-10, L. 222-6, L. 132-2 et L. 132-3, L. 132-13 à L. 132-15, L. 413-1 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1 et L. 441-2, L. 451-1 à L. 451-16, L. 454-1 à L. 454-7, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
- L’une des infractions prévues par le CMF ;
- L’une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
- Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
- L’une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
- À la destitution des fonctions d’officier public ou ministériel.
- D’une interdiction de diriger, gérer, administrer ni être membre d’un organe collégial de contrôle d’un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1 et L. 543-1, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
- D’une interdiction d’exercer l’une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 547-1 et L. 548-1 et L. 550-1.
- D’une condamnation définitive depuis moins de 10 ans
- Soit font l’objet :
- D’une interdiction d’effectuer certaines opérations d’intermédiation et toutes autres limitations dans l’exercice de cette activité ;
- D’une interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation.
D) Assurance
==> L’obligation d’assurance
Deux situations doivent être distinguées :
- La couverture par le mandant des conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle de l’IOBSP
- L’article L. 519-3-4 du Code monétaire et financier prévoit que lorsqu’un IOBSP intervient pour le compte d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un établissement de paiement ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d’un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté.
- La couverture par un contrat d’assurance des conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle de l’IOBSP
- Dans l’hypothèse où l’IOBSP n’intervient pas pour le compte d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un établissement de paiement ou d’un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, ce dernier doit souscrire un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile.
Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.
==> Les modalités de l’obligation d’assurance
L’article R. 519-16 du Code monétaire et financier apporte quatre précisions à l’obligation d’assurance de l’IOBSP :
- Première précision
- Le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à celles définies ci-dessous :
- Le niveau minimal de la garantie du contrat d’assurance est fixé à 500 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d’assurance pour un même intermédiaire
- Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n’est pas opposable aux victimes.
- Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
- Le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à celles définies ci-dessous :
- Deuxième précision
- Les personnes qui débutent l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent souscrire un contrat d’assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des IOBSP jusqu’au 1er mars de l’année suivante.
- Troisième précision
- L’assureur délivre à la personne garantie une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
- Quatrième précision
- Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d’assurance, est portée sans délai par l’assureur à la connaissance de l’ORIAS
E) Garantie financière
==> L’obligation de garantie
- Principe
- L’article L. 519-4 du Code monétaire et financière dispose que tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d’une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux clients.
- Condition
- Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution pris par un établissement de crédit ou une société de financement habilité à cet effet ou une entreprise d’assurance ou de capitalisation régie par le code des assurances.
- Sanction
- Aux termes de l’article L. 571-16 du Code monétaire et financier, le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l’obligation instituée à l’article L. 519-4 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
==> Les modalités de l’obligation de garantie
- Mise en œuvre de la caution
- L’engagement de caution prévu à l’article L. 519-4 est mis en œuvre du fait de la défaillance de l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, sans que la caution puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion ou de division.
- Cette défaillance de la personne garantie est réputée acquise un mois après la date de réception par celle-ci d’une lettre recommandée exigeant le paiement de sommes dues ou d’une sommation de payer demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire.
- Paiement de la caution
- Le paiement est effectué par la caution dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception de la première demande écrite, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception.
- Si d’autres demandes sont reçues pendant le délai de trois mois, une répartition a lieu au marc-le-franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
- Montant du cautionnement
- Le montant minimal du cautionnement est fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
- Durée du cautionnement
- L’engagement de caution, dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois, est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
- Le montant du cautionnement est révisé le cas échéant lors de la reconduction du contrat.
- Couverture du cautionnement
- Les personnes qui débutent l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement doivent fournir une garantie financière sous la forme d’un engagement de caution couvrant la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des IOBSP jusqu’au 1er mars de l’année suivante.
IV) Obligations
A) Obligation générale
L’article L. 519-4-1 du Code monétaire et financier prévoit que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts des clients, y compris des clients potentiels.
Cette disposition précise que les règles de bonne conduites applicables aux IOBSP prévoient notamment les obligations à l’égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
Ces obligations sont applicables aux différents stades de la relation entre l’IOBSP et son client.
B) Publicité
Plus mentions légales doivent figurer sur la publicité diffusée par un IOBSP :
- Mentions du Code monétaire et financier (art. L. 519-4-2)
- Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’IOBSP doit fournir au client des informations relatives notamment à
- son identité
- son immatriculation
- l’existence de liens financiers et économiques avec son mandant
- L’IOBSP doit aussi indiquer au client s’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement
- Il informe, en outre, le client que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements ou sociétés.
- Avant la conclusion d’une opération de banque ou d’un service de paiement, l’IOBSP doit fournir au client des informations relatives notamment à
- Mentions du Code de la consommation (art. L. 322-2 et L. 322-3 C. conso)
- Plusieurs mentions sont exigées par le Code de la consommation :
- En matière de crédit immobilier (art. L. 322-2 C. conso)
- Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier comporte, de manière apparente, la mention suivante :
- « Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. »
- Cette publicité indique le nom et l’adresse du mandant pour le compte duquel l’intermédiaire exerce son activité.
- Toute publicité diffusée par ou pour le compte d’une personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par un particulier comporte, de manière apparente, la mention suivante :
- En toute hypothèse (art. L. 322-3 C. conso)
- Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un IOBSP indiquent, de manière apparente
- l’étendue des pouvoirs de l’intermédiaire
- s’il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.
- Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d’un IOBSP indiquent, de manière apparente
- En matière de crédit immobilier (art. L. 322-2 C. conso)
- Plusieurs mentions sont exigées par le Code de la consommation :
C) Démarchage
L’article L. 519-5 du Code monétaire et financier autorise les IOBSP à se livrer à une activité de démarchage à la condition de remplir plusieurs conditions :
==> Produits bancaires exclus du démarchage
Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l’objet de démarchage :
- Les produits dont le risque maximum n’est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial, à l’exception :
- des parts de sociétés civiles de placement immobilier. À l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l’objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital
- des produits entrant dans le cadre d’une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales
- Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l’article L. 151-2 ;
- Les produits relevant de l’article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et de l’article L. 214-169
- Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l’article L. 423-1, à l’exception des parts ou actions d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, des titres financiers offerts au public après établissement d’un document d’information dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d’un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du code du travail
- Les bons de caisse.
==> Obligation d’information
En temps utile, avant qu’elle ne soit liée par un contrat, la personne démarchée reçoit des informations fixées par décret en Conseil d’Etat, portant notamment sur :
- Les conditions de l’offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par la personne démarchée ou, lorsqu’un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix, permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci
- L’existence ou l’absence du droit de rétractation, prévu selon les cas, aux articles L. 222-7 à L. 222-12 du code de la consommation ou à l’article L. 341-16 du présent code, ainsi que ses modalités d’exercice
- La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause concernant le choix d’une juridiction.
==> Domaine d’intervention
Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.
==> Droit de rétractation
- Délai de rétractation
- La personne démarchée dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
- Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :
- Soit à compter du jour où le contrat est conclu ;
- Soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
- Exercice du droit de rétractation
- Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue qu’au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou du service financier effectivement fourni entre la date de conclusion du contrat et celle de l’exercice du droit de rétractation, à l’exclusion de toute pénalité.
- Le démarcheur ne peut exiger de la personne démarchée le paiement du produit ou du service mentionné au premier alinéa que s’il peut prouver que la personne démarchée a été informée du montant dû, conformément au 5° de l’article L. 341-12.
- Toutefois, il ne peut exiger ce paiement s’il a commencé à exécuter le contrat avant l’expiration du délai de rétractation sans demande préalable de la personne démarchée.
- Le démarcheur est tenu de rembourser à la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toutes les sommes qu’il a perçues de celle-ci en application du contrat, à l’exception du montant mentionné au premier alinéa. Ce délai commence à courir le jour où le démarcheur reçoit notification par la personne démarchée de sa volonté de se rétracter.
- La personne démarchée restitue au démarcheur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours, toute somme et tout bien qu’elle a reçus de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où la personne démarchée notifie au démarcheur sa volonté de se rétracter.
- L’exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d’administration d’instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.
- Exclusion du droit de rétractation
- Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas :
- Aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1
- Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d’une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s’appliquent en matière de démarchage ;
- Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n’exerce son droit de rétractation.
- Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s’applique pas :
- Délai de réflexion
- En cas de démarchage qui consisterait à se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, les démarcheurs ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1 ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, avant l’expiration d’un délai de réflexion de quarante-huit heures.
- Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d’un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l’article L. 341-12.
- Le silence de la personne démarchée à l’issue de l’expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.
D) Obligation d’information
- Contenu de l’obligation d’information
Conformément à l’article R. 519-20 du Code monétaire et financier, lors de l’entrée en relation, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement fournit au client, y compris au client potentiel, les informations suivantes :
==> Pour tous les IOBSP
Ils doivent indiquer :
- Leur nom ou sa dénomination sociale
- Leur adresse professionnelle ou celle de leur siège social
- La catégorie d’intermédiaire à laquelle ils appartiennent
- Leur numéro d’immatriculation d’intermédiaire
- Les moyens leur permettant de vérifier cette immatriculation.
- Les procédures de recours et de réclamation, y compris, pour les réclamations, les coordonnées et l’adresse des personnes auxquelles elles doivent être transmises
- Les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
- S’ils proposent le service de conseil mentionné à l’article L. 519-1-1 et, le cas échéant:
- S’il s’agit d’un conseil indépendant mentionné à l’article L. 519-1-1
- Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
- Si le client doit acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant.
==> Pour les mandataires d’intermédiaires
Ils doivent indiquer :
- le nom ou la dénomination sociale
- l’adresse professionnelle ou celle de son siège social
- le numéro d’immatriculation de leur mandant
==> Pour les mandataires exclusifs
Ils doivent indiquer le nom des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille de manière exclusive
==> Pour les courtiers et mandataires non exclusifs
Ils doivent indiquer le nom du ou des établissements avec lesquels ils ont enregistré au cours de l’année précédente une part supérieure au tiers de leur chiffre d’affaires au titre de l’activité d’intermédiation ainsi que toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % de leurs droits de vote ou de leur capital, détenue par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, une de ces entreprises ;
==> Pour les courtiers et leurs mandataires
- Dans leurs rapports avec le client
- Information d’ordre général
- En premier lieu, l’intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu’il a recueillies auprès de lui.
- En second lieu, Avant la conclusion de toute opération de banque ou la fourniture de tout service de paiement ou de tous travaux et conseils préparatoires, l’intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel
- Le nombre et le nom des établissements de crédit, de la société de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement avec lesquels il travaille
- S’il perçoit, au titre de cette opération ou de ce service, une rémunération de l’établissement de crédit, de la société de financement, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et quels en sont le montant et les modalités de calcul
- S’il détient une participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de l’établissement de crédit, de la société de financement, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement concerné et qu’il peut, à sa demande, lui communiquer le niveau de cette participation.
- Information sur l’analyse des contrats
- Principe
- L’article R. 518-28 du Code monétaire et financier prévoit que ces intermédiaires sont tenus d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.
- À ce titre, pèse sur eux une obligation d’information renforcée :
- Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
- Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l’éclairer sur l’étendue de ses devoirs et obligations.
- Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu’ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s’abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
- Exception
- Lorsque le courtier ou son mandataire ne fournit au client qu’une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d’une opération de banque ou d’un service de paiement, il peut, par dérogation limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client.
- Dans ce cas, il est soumis aux seules obligations
- de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité
- d’informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l’éclairer sur l’étendue de ses devoirs et obligations.
- Principe
- Information d’ordre général
- Dans leurs rapports avec les établissements bancaires
- Deux obligations pèsent sur les courtiers et leurs mandataires envers les établissements bancaires
- D’une part, ils doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l’établissement de crédit, de la société de financement, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu’elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.
- D’autre part, ils doivent s’abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l’établissement de crédit, la société de financement, l’établissement de paiement ou l’établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
- Deux obligations pèsent sur les courtiers et leurs mandataires envers les établissements bancaires
2. Modalités de l’obligation d’information
==> Pour toute activité d’intermédiation
Conformément à l’article R. 519-23 du Code monétaire et financier l’information doit être communiquée au client selon deux modalités cumulatives :
- D’abord, toute information fournie par l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de la présente section doit être communiquée avec clarté et exactitude.
- Ensuite, la communication doit être faite sur support durable à la disposition du client, y compris du client potentiel, et auquel celui-ci a facilement accès.
==> Pour l’activité de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier
Lorsque l’intermédiaire intervient dans le cadre d’un service de conseil, il doit communiquer au client :
- le nombre de contrats de crédits examinés
- la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés
- Sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable.
==> En cas de commercialisation d’un contrat à distance
Les informations précontractuelles fournies au client, y compris au client potentiel, doivent être conformes aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-18 du code de la consommation, soit des règles particulières relatives :
- À l’obligation d’information précontractuelle
- À la formation et à l’exécution du contrat
- Au délai de rétractation
E) Vérification de la situation du client
==> Pour toute activité d’intermédiation
- Pour toute opération
- L’article R. 519-22 du Code monétaire et financier prévoit que l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement présente au client, y compris au client potentiel, les caractéristiques essentielles du service, de l’opération ou du contrat proposé.
- L’intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d’expérience du client, y compris du client potentiel.
- Pour l’opération de crédit
- L’article R. 519-21 du Code monétaire et financier exige que, lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s’enquiert auprès du client, y compris du client potentiel :
- D’une part, de ses connaissances et de son expérience en matière d’opérations de banque
- D’autre part, de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
- Enfin, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu’aux prêts en cours qu’il a contractés, permettant à l’établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.
- Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l’intermédiaire doit appeler l’attention du client, y compris du client potentiel, sur les conséquences que la souscription du contrat pourrait avoir sur sa situation financière et, le cas échéant, sur les biens remis en garantie.
- L’article R. 519-21 du Code monétaire et financier exige que, lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s’enquiert auprès du client, y compris du client potentiel :
==> Pour l’activité de conseil en matière d’opérations relatives à des contrats de crédit immobilier
Lorsque l’intermédiaire intervient dans le cadre d’un service de conseil, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.
La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé.
F) Domaine d’intervention
==> Étendue du domaine d’intervention
Conformément l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier l’activité des IOBSP se limite à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Quatre sortes d’activités peuvent donc faire l’objet d’une intermédiation :
- La réception de fonds du public
- La fourniture de crédit
- La fourniture de services de paiement
- La fourniture d’un service de conseil en matière d’opérations de banque et de services de paiement
==> Prohibitions
L’article L. 322-1 du Code de la consommation prévoit qu’il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :
- D’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement
- De rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette.
- D’intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.
G) Correspondances
Aux termes de l’article R. 519-24 du Code monétaire et financier toute correspondance ou publicité, quel qu’en soit le support, émanant d’un intermédiaire agissant en cette qualité indique :
- son nom ou sa dénomination sociale
- son adresse professionnelle ou celle de son siège social
- son numéro d’immatriculation d’intermédiaire
- la catégorie d’intermédiaire à laquelle il appartient.
V) Rémunération
A) Paiement de la rémunération
- Principe
- L’article L. 519-6 du Code monétaire pose qu’il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt d’argent, de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
- Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.
- Exception
- L’article L. 519-6-1 prévoit que par dérogation à l’article 519-6 et dans le cadre de la fourniture d’un service de conseil indépendant, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement peuvent percevoir une rémunération de leur client.
- Sanction
- La violation des règles applicables en matière de rémunération est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
B) Fixation de la rémunération
Aux termes de l’article L. 322-4 du Code monétaire et financier avant la conclusion d’un contrat de crédit, l’intermédiaire de crédit et l’emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l’emprunteur à l’intermédiaire de crédit pour ses services.
L’article R. 519-26 du Code monétaire et financier opère en outre une distinction selon le statut de l’intermédiaire et la nature de l’activité exercée :
- Pour toute opération
- Lorsque l’intermédiaire fournit un service de conseil
- Avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, il doit indiquer au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul.
- Lorsque l’intermédiaire est mandataire exclusif ou non exclusif
- Il lui échoit de communiquer à la demande du client ou du client potentiel toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, qu’ils détiennent dans un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
- Lorsque l’intermédiaire fournit un service de conseil
- Pour les opérations de crédit
- Lorsque l’opération de banque est relative à un contrat de crédit, l’intermédiaire précise s’il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l’établissement de crédit, de la société de financement, de l’établissement de paiement ou de l’établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n’est pas connu, les modalités de son calcul.
- L’intermédiaire doit, en outre, rappeler à son client
- D’une part, qu’il lui est interdit de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d’entremise quelconque, avant le versement effectif des fonds prêtés.
- D’autre part, qu’il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, de présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise ou des commissions mentionnés à l’alinéa précédent.