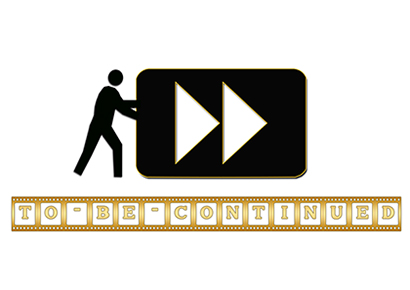L’une des principales finalités de la procédure de sauvegarde est la poursuite de l’activité économique de l’entreprise (Art. L. 621-1 C. com.)
Pour ce faire, cela suppose de faire le tri parmi les contrats conclus avec ses partenaires commerciaux.
Tandis que certains contrats sont nécessaires à la survie de l’entreprise, d’autres constituent un poids pour elle dont il convient de se délester.
Conformément à l’article L. 622-13 du Code de commerce, ce choix appartient, en principe, à l’administrateur. Il lui appartient de déterminer les contrats dont l’exécution doit être maintenue et ceux qui doivent, soit ne pas être reconduits, soit être résiliés.
En toute hypothèse, ce choix constitue une prérogative exorbitante du droit commun, dans la mesure où l’administrateur peut, d’autorité, décider de la continuation d’un contrat d’un cours, alors même que le concontractant souhaiterait mettre un terme à la relation contractuelle ou, pis, que le débiteur a manqué à ses obligations.
Parce qu’il serait particulièrement injuste de faire peser sur le créancier, sans contrepartie, le risque d’insolvabilité du débiteur en le contraignant à poursuivre l’exécution du contrat, le législateur a instauré un régime de faveur pour ce dernier.
Cet effort constant de recherche d’équilibre entre la préservation des intérêts des créanciers et l’objectif de poursuite de l’activité de l’entreprise se retrouve, tant dans l’appréhension par la jurisprudence de la notion de contrat en cours que dans le régime juridique attaché à cette notion.
I) La notion de contrat en cours
Les actes visés par le droit d’option qui échoit à l’administrateur sont « les contrats en cours ».
L’article L. 622-13 du Code de commerce ne définit pas la notion de sorte qu’il convient de se tourner vers la jurisprudence pour en cerner les contours.
A) Un contrat
Pour être qualifié de contrat en cours, encore faut-il que l’acte visé endosse la qualification de contrat.
Pour mémoire, le nouvel article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Cela signifie que dès lors que la conclusion d’un acte procède d’une rencontre des volontés, le principe de continuation des contrats en cours a vocation à s’appliquer.
L’examen des textes révèle toutefois que cette règle n’est pas absolue.
Tandis qu’il est des cas où le législateur a expressément exclu du champ d’application de l’article L. 622-13 certaines catégories de contrats, la jurisprudence a, de son côté, parfois tenté d’élargir le domaine des exceptions en y incluant les contrats conclus intuitu personae.
- Les exclusions catégorielles
Plusieurs catégories de contrats échappent à l’application du principe de continuation des contrats en cours
- Les exclusions prévues par le Code monétaire et financier
- En application des articles L. 211-40, 330-1 et L. 330-2 du Code monétaire et financier, trois catégories de contrats sont exclues du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours
- Les opérations de compensation et de cessions de créances financières
- Les contrats de garantie financière
- Les systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers
- Les exclusions prévues par le Code de commerce
- Accord de conciliation amiable
- Aux termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué en application de l’article
- Les contrats de travail
- En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, le contrat de travail échappe au régime juridique des contrats en cours ( L. 622-13 C. com.)
- Les contrats de fiducie
- Les contrats de fiducie échappent également à l’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce, sauf à ce que « le débiteur conserve l’usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. »
2. Le cas particulier des contrats conclus intuitu personae
S’il est un certain nombre de contrats qui sont expressément écartés par la loi du champ d’application du principe de continuation des contrats en cours, plus problématique a été la question de savoir si l’on devait appliquer cette exclusion, malgré le silence de la loi, à une autre catégorie d’acte : les contrats conclus intuitu personae.
La particularité de ces contrats est qu’ils sont conclus en considération de la personne du cocontractant.
Aussi, la question s’est-elle posée de savoir si l’application du principe de continuation du contrat en cours ne conduisait pas à porter une atteinte trop grande à la liberté contractuelle.
La fin (la poursuite de l’activité de l’entreprise) doit-elle justifier les moyens (maintien d’une relation non désirée) ?
Cette question s’est notamment posée en matière bancaire, les conventions portant sur les crédits d’exploitation consentis aux entreprises (conventions de compte courant et ouvertures de lignes de crédits) étant particulièrement marquée par l’intuitu personae.
Pour mémoire lorsqu’une telle convention est conclue pour une durée indéterminée, en application de l’ancien article 60 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 – désormais codifié à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier – la résiliation d’une telle convention par l’établissement de crédit est soumise au régime juridique suivant :
- Principe
- L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 prévoyait que tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours.
- Ainsi, la résiliation de la convention de compte courant ou d’ouverture de crédit était-elle subordonnée à l’observation d’un délai de préavis.
- Exception
- L’ancien article 60 de la loi du 24 juillet 1984 posait deux tempéraments à l’exigence d’observation d’un délai de préavis en cas de résiliation unilatérale de la convention de crédit d’exploitation :
- En cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit
- En cas de situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur
Compte tenu de cette faculté conférée aux établissements bancaires de résilier avec ou sans préavis la convention de crédit consenti au débiteur, lors de la consécration du principe de continuation des contrats en cours à l’article 37 la loi du 25 janvier 1985, la question s’est rapidement posée de savoir si l’on devait ou non faire primer cette disposition sur l’application de l’article 60 de la loi du 24 juillet 1984.
Autrement dit, comment concilier ces deux dispositions dont il est difficile de déterminer si l’on est une qui doit déroger à l’autre ? L’adage specialia generalibus derogant n’est, manifestement, d’aucune utilité en l’espèce.
Quid de la jurisprudence ?
Il ressort des décisions rendues en la matière que la position de la Cour de cassation a sensiblement évolué.
==> Première étape : Non application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant
Dans la plupart des contrats synallagmatiques, la personne de l’une des parties au moins est appréciée à travers certains éléments objectifs :
- Sa solvabilité
- Sa notoriété
- Ses connaissances
- Son aptitude
C’est qualités que présente le cocontractant font, en principe, gage de la bonne exécution du contrat.
C’est la raison pour laquelle, selon une jurisprudence traditionnelle, les contrats conclus intuitu personae doivent être rompus de plein droit lors de l’ouverture d’une procédure collective.
Cette position prétorienne reposait sur le fondement de deux textes :
- L’article 2003 du Code civil qui met fin au mandat au cas de « déconfiture » de l’une des parties, soit en cas de faillite
- Le contrat de mandat est par essence un contrat conclu intuitu personnae
- L’article 1865-4 du Code civil qui prévoyait, avant la réforme du 4 janvier 1978, que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d’un associé emportait dissolution d’une société civile.
Ainsi, sur le fondement de ces deux dispositions, la jurisprudence refusait-elle d’appliquer le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae.
Cependant, avec l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la nécessité de redresser l’entreprise en difficulté a provoqué une évolution, tant en législation qu’en jurisprudence.
Surtout, la loi du 4 janvier 1978 modifiant les dispositions du Code civil sur les sociétés, n’a pas repris le contenu de l’ancien article 1865-4 qui prévoyait la dissolution de plein droit de la personne morale en cas de « faillite » de l’un des associés.
Le nouvel article 1860 prévoit seulement que « s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé. »
Autrement dit, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’un des membres d’une société entraîne, sauf clause contraire des statuts ou décision unanime des coassociés, son exclusion du groupement.
L’intuitus personae dans les sociétés civiles a donc enregistré un recul avec la loi de 1978.
Sous l’empire de la loi du 13 juillet 1967, les magistrats ont pareillement tempéré le principe de rupture des contrats conclus intuitu personae au cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens de l’une des parties.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a estimé, en ce sens, que l’ouverture d’une procédure contre un locataire-gérant n’avait pas pour effet d’engendrer à elle seule la résiliation de la location-gérance du fonds de commerce.
C’est surtout un arrêt de la Cour de Paris en date du 21 mai 1985 qui retient l’attention.
Les faits :
- Lors de sa mise en règlement judiciaire, un distributeur de film était lié par un contrat de mandat professionnel à un producteur
- Ce dernier, pour mettre un terme à la convention, s’appuyait sur l’article 2003 du Code civil, celui-là même qui prévoit la rupture de l’accord de représentation au cas de « déconfiture » de l’une des parties et qui a toujours été mis en œuvre en cas de « faillite » de l’une d’elles.
La Cour d’appel rejette la prétention du producteur.
Les juges parisiens ont refusé d’appliquer la règle d’extinction du mandat en termes dépourvus d’équivoque : « La disposition de l’article 38 de la loi de 1967 s’inscrit dans les règles qui, ayant pour fondement le sauvetage de l’entreprise en difficulté, suspendent pendant le cours de la procédure collective l’effet de l’article 2003 du Code civil : la poursuite des contrats en cours à la seule volonté du syndic qui peut l’exiger, est, en effet, l’un des moyens essentiels de la continuation de l’activité ou de l’exploitation ».
Cette volonté dont ont fait montre certains tribunaux a trouvé écho chez le législateur qui, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985, a adopté un article 37, al. 5 lequel dispose que « nonobstant toute disposition légale », aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours « ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ».
Le principe de continuation des contrats en cours aurait donc vocation à s’appliquer à tous les contrats.
Aussi, l’article 2003 du Code civil ne saurait-il désormais justifier l’exclusion de l’application de ce principe aux contrats conclus intuitu persoane en cas de déconfiture de l’une des parties.
Au fond, ce texte est neutralisé par l’article 37, alinéa 5 de la loi du 26 juillet 1985 qui prive d’efficacité « toute disposition légale visant à faire dépendre la vie d’un contrat de l’absence de procédure collective. »
C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêt du 8 décembre 1987 rendu par la Cour de cassation !
Il n’y avait désormais, plus aucune raison de faire échapper au principe de continuation des contrats en cours, les contrats conclus intuitu personnae.
==> Deuxième étape : application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant
Par un arrêt remarqué du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a donc estimé que le principe de continuation des contrats en cours était dorénavant pleinement applicable aux contrats bancaires (Cass. Com. 8 déc. 1987).
| Cass. Com. 8 déc. 1987 |
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que la société Stratimme Cappello disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque nationale de Paris (BNP) et bénéficiait, dans le cadre du fonctionnement de ce compte, d'un plafond d'escompte et d'un découvert dont les montants étaient déterminés, qu'elle a été mise en redressement judiciaire avec M. X... pour administrateur, que ce dernier a informé la BNP qu'usant de la faculté que lui offrait l'article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, il optait pour la poursuite de la convention de compte courant, que la banque lui a répondu qu'elle considérait que le compte courant avait été clôturé de plein droit par l'effet du redressement judiciaire, que la société Stratimme Cappello et l'administrateur ont assigné la BNP devant le tribunal qui avait ouvert la procédure pour qu'il ordonne que soient continués la convention de compte courant ainsi que le plafond d'escompte et le découvert contractuellement fixés, et que les premiers juges ont accueilli cette demande ; .
Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Vu les articles 1er et 37, alinéas 1er et 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'administrateur d'un redressement judiciaire a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu'il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ; qu'il en résulte que l'administrateur doit, lorsqu'il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d'observation, des conventions de compte courant, d'ouverture de crédits, de découvert ou d'autorisation d'escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l'établissement financier à bénéficier des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s'il y a lieu, de celle du deuxième alinéa de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu que pour décider que M. X... ne pouvait exiger le maintien de la convention de compte courant et des concours financiers antérieurement accordés par la BNP, la cour d'appel s'est fondée sur ce que ces conventions et concours avaient été consentis par la banque à la société Stratimme Cappello en considération de la personne de son client et, spécialement, de la confiance qu'il lui inspirait, après avoir énoncé, à tort, que le mécanisme de règlement simplifié et de garantie propre au compte courant s'opposait à la continuation de celui-ci et empêchait que l'on puisse tirer un solde provisoire et le déclarer ;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
|
- Faits
- Une convention de compte courant est conclue entre une société et une banque.
- Puis une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de la société
- L’administrateur décide alors d’opter pour la continuation du contrat, conformément à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985
- « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur»
- La banque lui oppose que le compte courant aurait été clôturé de plein droit par l’effet du redressement judiciaire
- Demande
- Assignation de la banque par l’administrateur en vue d’obtenir la continuation de l’exécution de la convention de compte courant
- Procédure
- Par un arrêt du 30 janvier 1987, la Cour d’appel d’Amiens déboute l’administrateur de sa demande
- Les juges du fond relèvent que la convention conclue entre la banque et la société faisait l’objet d’une procédure de redressement était un contrat conclu intuitu personae.
- Or selon eux cette catégorie de contrats échapperait à l’application du principe de continuation des contrats en cours
- Solution de la Cour de cassation
- Par un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens
- Au soutien de sa décision, la Cour de cassation considère que « l’administrateur d’un redressement judiciaire a la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lors du prononcé de ce redressement judiciaire sans qu’il puisse être fait de distinction selon que les contrats ont été ou non conclus en considération de la personne ; qu’il en résulte que l’administrateur doit, lorsqu’il le demande, obtenir la continuation, pendant la période d’observation, des conventions de compte courant, d’ouverture de crédits, de découvert ou d’autorisation d’escomptes en cours au jour du jugement de redressement judiciaire, sauf pour l’établissement financier à bénéficier des dispositions de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et, s’il y a lieu, de celle du deuxième alinéa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984»
- Ainsi, la chambre commerciale juge que le principe de continuation des contrats en cours s’applique à tous les contrats, qu’ils présentent ou non un caractère intuitu personae.
- L’article L. 622-13 du Code de commerce n’opère aucune distinction : il n’y avait donc pas lieu de distinguer.
- Aussi, l’administrateur était-il parfaitement fondé à réclamer, en l’espèce, la poursuite de l’exécution de la convention de compte-courant !
- Analyse
- La solution adoptée ici par la Cour de cassation était loin d’être acquise.
- À la vérité, il s’agit là d’une problématique qui, en son temps, a fortement divisé la doctrine.
- Trois arguments ont été avancés contre l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personae:
- 1er argument
- Certains auteurs ont soutenu l’existence d’une faculté de résiliation unilatérale des prêts consentie à durée indéterminée
- L’article 60 de la loi du 24 janvier 1984 pour mémoire que « l’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise».
- Ainsi, si elle est à durée indéterminée, ce qui est le plus souvent le cas, l’ouverture de crédit en compte courant est, en vertu du droit commun. résiliable unilatéralement.
- La loi de 1985 n’ayant pas modifié ce texte (à l’époque) il dérogerait donc au principe de continuation des contrats en cours.
- Aussi, serait inconcevable que la survenance de la procédure collective prive le banquier de sa faculté de résiliation unilatérale.
- Cela reviendrait à créer à sa charge un engagement perpétuel.
- 2e argument
- La technique même du compte courant serait incompatible avec une continuation automatique de celui-ci, puisqu’en cas de continuation, les remises postérieures au jugement d’ouverture se fondraient dans le compte et permettrait le règlement de créances antérieures ce qui est contraire au principe d’interdiction des paiements
- 3e argument
- La jurisprudence antérieure n’appliquait pas le principe de continuation des contrats en cours aux contrats conclus intuitu personnae
- Bien que séduisant, ces arguments n’ont manifestement pas emporté la conviction de la Cour de cassation, laquelle était d’autant plus forte que le législateur avait abondé en ce sens deux ans plus tôt, lors de l’adoption de la loi du 26 juillet 1985 entrée en vigueur deux ans plus tôt abondaient en ce sens.
- Depuis cet arrêt, les conventions de compte courant n’étaient plus exclus du champ d’application de l’article L. 622-13 du Code de commerce.
==> Troisième étape : limitation de l’application du principe de continuation des contrats en cours aux conventions de compte courant
Par un arrêt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation a posé une limite à l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires : l’article 60, al. 2 de la loi bancaire du 24 janvier 1984 aux termes duquel « l’établissement de crédit n’est tenu de respecter aucun délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. »
| Cass. com. 1er oct. 1991 |
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tanneries Carriat, titulaire d'un compte courant à la société Bordelaise de CIC (la banque), qui lui consentait des concours, a été mise en redressement judiciaire le 7 avril 1987 ; qu'à la suite d'un accord entre M. X..., administrateur, et la banque, sur les modalités du maintien des crédits, le juge-commissaire, à la requête de l'administrateur, a ordonné le 17 avril 1987 l'ouverture dans les livres de la banque de nouveaux comptes fonctionnant dans le cadre de cet accord ; que la période d'observation a été prolongée jusqu'au 12 avril 1988 ; que, le 15 avril 1988, le Tribunal a sursis à statuer sur le plan de redressement déposé ; que, par lettre du 19 mai 1988, la banque a fait connaître à M. X... qu'elle ne maintiendrait pas les crédits et la ligne d'escompte après le 23 mai 1988 ; que M. X... a assigné la banque en référé devant le président du tribunal de grande instance afin qu'il soit enjoint à celle-ci de fournir ses prestations et de continuer ses concours dans les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ayant accueilli cette demande ;
[…]
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que la banque devait continuer ses concours jusqu'à décision du Tribunal sur le plan de redressement, l'arrêt énonce que la cessation par la banque, pendant la période d'observation, des crédits antérieurs poursuivis au cours de cette période, n'est pas juridiquement possible, la procédure elle-même interdisant à quiconque d'imposer sa volonté à l'administrateur et au Tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, sont réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
|
- Faits
- Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société qui avait conclu avait une banque une convention de compte courant
- Un accord est trouvé entre l’administrateur et la banque s’agissant des modalités du maintien du fonctionnement du compte
- La période d’observation va, dans le même temps être prolongée
- Par suite, la banque décide de refuser une ouverture de crédit et d’escompte à la société
- Demande
- Assignation par l’administrateur de la banque en référé en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant
- Procédure
- Par un arrêt du 16 février 1989, la Cour d’appel de Pau accède à la requête de l’administrateur
- Les juges du fond estiment que le principe posé à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 de continuation des contrats en cours fait obstacle à la décision de la banque de résilier unilatéralement la convention de compte courant à laquelle elle était partie.
- Seul l’administrateur a le pouvoir de mettre fin à pareille convention pendant la période d’observation
- Solution
- Par un arrêt du 1er octobre 1991, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1985
- Elle juge, dans cet arrêt, que « la continuation des concours bancaires par application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n’interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d’observation si les conditions fixées par l’article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées »
- Or cette disposition prévoit que le banquier dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat de prêt consenti à un client « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise».
- La Cour de cassation pose ainsi une limite à l’application du principe de continuation des contrats en cours aux contrats bancaires.
- Analyse
- Il ressort de cette décision, que la Cour de cassation a essayé de concilier l’article 60 de la loi bancaire avec l’article 622-13 du Code de commerce, soit la faculté pour le bancaire de résilier la convention de compte courant et le pouvoir de l’administrateur de contraindre le banquier à poursuivre sa relation contractuelle avec le débiteur.
- Cette conciliation procède de l’idée que qu’il est difficilement concevable de maintenir le banquier dans les liens d’une convention de compte courant, alors que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise
- Cela reviendrait à imposer au banquier l’obligation de financer la liquidation judiciaire, soit de régler les dettes de l’entreprise en difficulté
- Il échoit certes au banquier de concourir au relèvement de la situation de l’entreprise en difficulté.
- Son concours ne saurait toutefois aller au-delà.
- Si la Cour de cassation avait refusé l’application de l’article 60 de la loi bancaire, cela aurait eu pour effet de dissuader les banques de prendre des risques dans le financement de l’activité économique.
==> Quatrième étape : la concession au banquier dispensateur de crédit du bénéfice de priorité des créanciers postérieurs
Il ressort d’un arrêt du 9 juin 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qu’en cas de maintien du concours du banquier lors de l’ouverture d’une procédure collective, un solde provisoire doit être établi, afin qu’il puisse bénéficier du privilège dont jouissent les créanciers postérieurs (Cass. com. 9 juin 1992).
Pour mémoire, aux termes de l’article L. 622-17, I du Code de commerce « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance »
==> Cinquième étape : encadrement de l’exercice de la faculté de résiliation du banquier dispensateur de crédit
Si, conformément à la position adoptée par la Cour de cassation, le banquier dispose de la faculté de résilier unilatéralement la convention de compte courant qui le lie au débiteur lorsque les conditions de l’ancien article 60, désormais codifié à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, sont remplies, quid des modalités d’exercice de ce droit dans la mesure où, conformément à l’article L. 622-13 du Code de commerce, cette prérogative appartient, en principe, au seul administrateur ?
La chambre commerciale a répondu à cette question dans un arrêt du 28 juin 1994 (Cass. com. 28 juin 1994).
| Cass. com. 28 juin 1994 |
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 novembre 1991), que la société Crédit du Nord (la banque) a adressé, le 28 janvier 1991, à la société Tempier Roustant (la société) une lettre de résiliation de tous ses concours, en invoquant les dispositions de l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 ; que, le même jour, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société ; que, le 31 janvier 1991, le juge-commissaire a ordonné le maintien des concours bancaires en cours au jour du jugement d'ouverture, tandis que la société recevait la notification de la décision de la banque ; que l'administrateur judiciaire ayant assigné la banque pour obtenir le maintien de ses concours durant la période d'observation, le Tribunal a accueilli la demande ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que la continuation des concours bancaires par application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit pas que ces concours soient interrompus pendant la période d'observation si les conditions fixées par l'alinéa 1er de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 sont réalisées ; qu'en l'espèce, la banque avait dénoncé par écrit ses concours qui devaient prendre fin pendant la période d'observation à l'expiration du délai de préavis contractuel ; qu'en décidant que l'administrateur pouvait exiger le maintien de ces concours pendant la période d'observation au-delà du délai de préavis contractuel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984 et, ensemble, l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'interruption, dans les conditions fixées par l'article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continués pendant la période d'observation ne peut, en vertu de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, être provoquée par l'établissement de crédit pour des causes antérieures au jugement d'ouverture et doit donner lieu à une notification écrite à l'administrateur judiciaire qui, en vertu de l'alinéa 1er du même texte, a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant ; qu'en présence d'une résiliation avec préavis décidée par la banque le jour du jugement d'ouverture et en l'absence de notification de la décision de résiliation à l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'ordonnance du juge-commissaire enjoignant à la banque de poursuivre ses concours durant la période d'observation devait recevoir son entier effet ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
|
- Faits
- Une société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 janvier 1991
- Le jour même la banque avec laquelle le débiteur a conclu une convention de compte courant lui notifie sa décision de résilier ladite convention
- Le 31 janvier le juge commissaire ordonne le maintien de la convention de compte-courant, tandis que la société reçoit la notification de la banque
- Demande
- Assignation par l’administrateur de la banque en vue d’obtenir la continuation de la convention de compte courant durant la période d’observation
- Procédure
- Par un arrêt du 19 novembre 1991, la Cour d’appel d’Aix en Provence fait droit à la demande de l’administrateur judiciaire.
- Les juges du fond estiment que conformément à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, l’administrateur était fondé à réclamer la continuation de la convention de compte courant
- Moyens des parties
- La banque soutient avoir satisfait aux conditions exigées par l’alinéa 1er de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984.
- Pour mémoire cette disposition prévoit que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours».
- Ainsi, la banque argue-t-elle qu’elle a bien notifié le préavis à la société et que, par conséquent, elle était en droit de résilier unilatéralement la convention de compte courant
- Problème
- La question qui se pose est de savoir si la résiliation unilatérale, par une banque, d’une convention de compte courant notifiée le jour de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du titulaire du compte est efficace
- Solution
- Par un arrêt du 28 juin 1994, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque
- Au soutien de sa décision elle considère que « l’interruption, dans les conditions fixées par l’article 60, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, des concours bancaires continués pendant la période d’observation ne peut, en vertu de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, être provoquée par l’établissement de crédit pour des causes antérieures au jugement d’ouverture et doit donner lieu à une notification écrite à l’administrateur judiciaire qui, en vertu de l’alinéa 1er du même texte, a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant».
- Il en résulte « qu’en présence d’une résiliation avec préavis décidée par la banque le jour du jugement d’ouverture et en l’absence de notification de la décision de résiliation à l’administrateur judiciaire»
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette décision :
- D’une part, le bénéfice de l’article 60 de la loi du 24 janvier 1984, à savoir la faculté pour la banque de résilier unilatéralement une convention de compte ne peut pas être provoqué par la banque si les causes de son invocation sont antérieures au jugement d’ouverture
- D’autre part, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, seul l’administrateur a la faculté de prendre la décision de l’arrêt ou de la continuation de la convention de compte courant, de sorte que c’est à lui que la banque aurait dû notifier son intention de résilier la convention de compte courant.
- Analyse
- Il ressort de cet arrêt que la Cour de cassation opère une distinction entre deux périodes :
- La période antérieure à l’ouverture de la procédure
- La période postérieure à l’ouverture de la procédure
- Pour la chambre commerciale, la banque ne sera fondée à solliciter le bénéfice de l’ancien article qu’à la condition que les causes de la résiliation soient postérieures au jugement d’ouverture.
- Elle précise que cela vaut tant pour l’alinéa 1er (résiliation avec préavis) que pour l’alinéa 2e (résiliation en raison de la situation du débiteur, sans préavis nécessaire) de l’article 60.
- A contrario, cela signifie donc que la banque peut demander le bénéfice de l’article 60 si les conditions de sa réalisation sont réunies postérieurement à l’ouverture de la procédure.
- Immédiatement, la question se pose alors de savoir pourquoi exiger que les conditions soient réalisées postérieurement à l’ouverture de la procédure pour autoriser la banque à exercer sa faculté de résiliation unilatérale ?
- Dit autrement, pourquoi refuser le bénéfice de l’article 60 pour les conventions dont les causes de résiliation sont antérieures au jugement d’ouverture de la procédure ?
- Pour le comprendre, il convient de se tourner vers l’article L. 622-21 du Code de commerce.
- Cette disposition prévoit, en effet, le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites.
- Reconnaître au banquier le pouvoir de résilier une convention de compte courant en invoquant des causes antérieures au jugement d’ouverture serait revenu à admettre que les créanciers puissent poursuivre le débiteur pour le paiement de créances antérieures.
- Or cette possibilité est formellement exclue par l’article L. 622-21 du Code de commerce !
==> Sixième étape : généralisation de l’application du principe de continuation des contrats en cours à tous les contrats conclus intuitu personae
La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 décembre 1987 a été étendue à tous les contrats conclus intuitu personae, de sorte que le principe de continuation des contrats en cours est désormais applicable à tous les contrats, sans qu’il y ait lieu de distinguer.
Application :
- Au contrat de crédit-bail
- Au contrat de location-gérance
- Au contrat d’entreprise
- Au contrat d’affacturage
- Au contrat de franchise
- Au contrat de concession
B) Un contrat en cours
Si l’article L. 622-13 du Code de commerce ne dit pas ce qu’est un contrat en cours, en devine qu’il s’agit:
- d’une part, d’un contrat définitivement formé
- d’autre part, d’un contrat dont l’exécution n’est pas achevée.
Si, la première condition ne soulève pas difficulté, plus délicate est l’appréhension de la seconde qui interroge sur deux points :
- Quid de la date d’efficacité de la résiliation / résolution d’un contrat ?
- À partir de quand considérer qu’un contrat est intégralement exécuté ?
Un contrat en cours ne peut, a priori, s’entendre que comme un contrat, non arrivé à son terme, non résilié ou résolu et non intégralement exécuté.
- Un contrat non arrivé à son terme
Un contrat en cours est celui dont le terme n’est pas intervenu. Par terme, il faut entendre, non pas l’événement dont dépend l’exigibilité de l’obligation, mais celui qui produit un effet extinctif.
Dans cette hypothèse, tant que l’événement stipulé dans le contrat ne s’est pas réalisé, le débiteur doit s’exécuter. Le contrat peut, en conséquence, être regardé comme étant « en cours ».
Lorsque, en revanche, l’échéance fixée se réalise, le contrat est aussitôt anéanti.
Si donc le terme intervient avant le jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce sera inapplicable.
Dans le cas contraire, l’administrateur disposera de sa faculté d’opter pour la continuation du contrat.
2. Un contrat non résilié ou résolu
Pour être en cours, le contrat ne doit pas avoir été anéanti avant l’ouverture de la procédure collective. Or tel est l’effet produit par l’acte de résiliation ou de résolution.
Aussi, dès lors que la résiliation ou la résolution de l’acte est définitivement acquise avant le prononcé du jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable.
Encore faudra-t-il néanmoins être en mesure de déterminer la date à compter de laquelle la résiliation est acquise, ce qui n’est pas souvent aisé, notamment en matière de bail commercial.
Quid, en effet, de l’hypothèse où un congé est régulièrement notifié au débiteur avant le jugement d’ouverture et qu’il prend effet après cette date ?
Doit-on considérer que le contrat de bail a pris fin au jour de la notification du congé ou à la date d’expiration du congé ?
Cette question a donné lieu à l’intervention de l’assemblée plénière qui y a donné une réponse dans un arrêt du 7 mai 2004 (Cass. ass. plén. 7 mai 2004).
| Cass. ass. plén. 7 mai 2004 |
La société Dumas et M. Luigi Y... agissant en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de cette société, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (3ème chambre) en date du 20 janvier 1995 ;
Cet arrêt a été cassé le 17 février 1998 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 1er février 2002 dans le même sens que la cour d’appel de Lyon par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, M. le premier président a, par ordonnance du 23 décembre 2003, renvoyé la cause et les parties devant l’Assemblée plénière.
Le demandeur invoque, devant l’Assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Gatineau, avocat de M. Philippe X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dumas ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lesourd, avocat de la SCI Dumas ;
Le rapport écrit de M. Gillet, conseiller, et le projet d’avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
(...)
Sur le premier moyen :
Vu les articles 5 et 7 du décret du 30 septembre 1953 devenus les articles L. 145-9 et L. 145-12 du Code de commerce, et l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l’effet du congé ; qu’il en résulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exécution ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 17 février 1998, Bull., IV, n° 72) que, le 30 juin 1993, la société civile immobilière Dumas (la SCI) a délivré à sa locataire la société anonyme Dumas (la société) un congé pour le 31 décembre 1993, date d’expiration du bail commercial conclu entre elles le 8 octobre 1984, en proposant le renouvellement de ce bail pour un loyer supérieur au précédent ; qu’après avoir accepté le principe du renouvellement en contestant le loyer proposé, la société a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1993 ; que, le 31 décembre 1993, la SCI a mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail ; que celui-ci a répondu, le 11 février 1994, qu’il entendait "poursuivre" le bail aux conditions initiales ; que la SCI a assigné la société et son administrateur en résiliation du bail, expulsion et paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l’arrêt retient que le congé n’a pas mis fin aux relations contractuelles qui se poursuivaient après l’expiration du bail initial et que le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois entraîne une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, le bail en vigueur à la date d’ouverture de la procédure collective étant arrivé à son terme, les relations entre les parties ne pouvaient se poursuivre qu’en vertu d’un nouveau bail, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un contrat en cours au sens du dernier des textes susvisés, la cour d’appel a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;
|
- Faits
- Le 8 octobre 1984, une SCI a donné à bail commercial des locaux à la société Dumas.
- Le 30 juin 1993 elle lui délivre un congé pour le 31 décembre 1993, accompagné d’une offre de renouvellement pour un loyer supérieur au précédent avec exclusion de certains locaux.
- Le 26 juillet 1993, le locataire a accepté le principe du renouvellement sans donner son accord sur le montant du nouveau loyer.
- Le 22 décembre 1993, le preneur a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
- Le 31 décembre 1993, le bailleur, inquiet pour la conservation de ses droits, a adressé une mise en demeure à l’administrateur de se prononcer sur la continuation du
- L’administrateur, non informé des stipulations du bail en cours lors de l’ouverture de la procédure collective n’a pu demander communication d’une copie du contrat de bail et du congé délivré au preneur que le 20 janvier 1994.
- Ces documents lui étant parvenus le 27 janvier 1994, le 11 février 1994, il décidait de continuer le bail renouvelé aux conditions de l’ancien contrat.
- Les 18 et 28 mars 1994, la SCI, invoquant le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois, l’a assigné avec la société en résiliation du bail.
- Demande
- La SCI bailleuse demande la résiliation du bail
- Procédure
- Les juges du fond (CA Lyon 20 janv. 1995) font droit à sa demande en relevant que le congé n’avait pas mis fin au contrat de bail initial et que le défaut de réponse dans le délai d’un mois de l’administrateur judiciaire avait entraîné une présomption irréfragable de renonciation à la poursuite du contrat.
- Dans un premier arrêt du 17 février 1998, la Cour de cassation casse et annule cette décision ( com. 17 févr. 1998).
- La chambre commerciale estime que « à la date de la mise en demeure adressée à l’administrateur, le bail en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective arrivait à son terme et un nouveau bail était susceptible d’être conclu après fixation du montant du loyer, de sorte que les dispositions de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 étaient sans application en l’espèce»
- Par un arrêt du 1er février 2002, la Cour d’appel de Chambéry statuant sur renvoi va résister à la position adoptée par la Chambre commerciale et accéder à la requête de la SCI qui revendiquait le bénéfice de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985.
- Les juges du fond estiment que :
- D’une part, le congé délivré par la SCI n’a pas mis fin aux relations contractuelles qu’elle entretenait avec la société preneur
- Pour la Cour d’appel le renouvellement a été accepté dans son principe, de sorte que le congé a été privé d’effet
- D’autre part, le défaut de réponse de l’administrateur dans le délai d’un mois, entraine, conformément à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 une renonciation à la poursuite du contrat !
- Enjeux du débat
- L’article 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l’article L. 622-13 du Code du commerce, confère à l’administrateur le pouvoir d’exiger l’exécution des contrats en cours.
- Cette disposition organise donc un droit d’option régissant la continuation des contrats en cours au jour du redressement judiciaire.
- L’exercice de ce droit varie selon que l’administrateur reçoit ou non une lettre de mise en demeure.
- Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le sort du contrat, ce délai pouvant être réduit ou prolongé par le juge-commissaire dans le délai de deux mois, ce que n’a pas demandé, en l’espèce, l’administrateur de la société Dumas .
- La SCI Dumas, en application de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a mis en demeure l’administrateur au redressement judiciaire de se prononcer sur la poursuite du bail le 31 décembre 1993, soit au jour de l’échéance du congé qu’elle avait délivré au preneur
- Elle lui a indiqué, par ailleurs, qu’à défaut de réponse dans le mois il serait présumé y avoir renoncé.
- Ce n’est que le 11 février 1994 que l’administrateur a informé la SCI de sa décision de poursuivre le
- La notion de contrat en cours est donc au cœur de l’espèce.
- Selon que le bail commercial arrivé à son terme est qualifié ou non de contrat en cours, le délai d’un mois prévu à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à la prise de position de l’administrateur ou ne l’est pas.
- Si ce délai de l’article 37 est applicable, la SCI est habilitée à assigner l’administrateur avec la société en résiliation du bail, car on serait en présence d’un contrat en cours
- Si le délai de l’article 37 n’est pas applicable, cela signifie que l’on est en présence d’un nouveau contrat de bail.
- Or le défaut de réponse à la mise en demeure de l’administrateur n’entraine résiliation de plein droit que des seuls contrats en cours
- Cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer aux nouveaux contrats.
- C’est là tout l’enjeu de la qualification de contrat en cours.
- Solution
- Par un arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- L’assemblée plénière estime en l’espèce que « le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l’effet du congé ; qu’il en résulte qu’il ne constitue pas un contrat en cours dont l’administrateur du redressement judiciaire du preneur peut exiger l’exécution»
- Autrement dit, pour la haute juridiction, en raison de la délivrance d’un congé au preneur, le bail était arrivé à son terme.
- Il en résulte que les parties étaient liées, en réalité, par un nouveau contrat de bail
- Dès lors, pour la Cour de cassation le bailleur n’était pas fondé à se prévaloir de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, cette disposition n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux contrats en cours !
- Au fond, en raison du congé délivré au bailleur, il y a eu une rupture de la continuité du contrat de bail.
- Pour la Cour de cassation, il aurait donc fallu que le congé ait été délivré après le jugement d’ouverture pour que l’on soit en présence d’un contrat en cours.
- En définitive, il ressort de cette définition que la délivrance d’un congé consomme l’extinction du bail.
3. Un contrat non intégralement exécuté
Le contrat non intégralement exécuté est celui dont les effets ne sont pas totalement épuisés.
Autrement dit, dès lors que toutes les obligations du contrat n’ont pas été exécutées au jour du jugement d’ouverture, l’article L. 622-13 du Code de commerce est, a priori, applicable.
Il ressort de la jurisprudence qu’il convient, en réalité, de distinguer selon que la prestation caractéristique a ou non été fournie.
==> La prestation caractéristique a été fournie
Dans cette hypothèse, le contrat échappe au principe de continuation des contrats en cours.
En matière de contrat de vente, il conviendra néanmoins de distinguer plusieurs situations :
- En présence d’un transfert de propriété avant le jugement d’ouverture
- Lorsque, dans un contrat de vente, le transfert de propriété est intervenu avant le jugement d’ouverture, le principe de continuation des contrats en cours est inapplicable
- Dans un arrêt du 9 avril 1991, la Cour de cassation censure une Cour d’appel pour avoir qualifié de contrat en cours un contrat de vente « alors que les créances des sociétés pour les sommes échues après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente et le contrat de prêt conclus antérieurement et que ces contrats n’étaient plus en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriété des immeubles vendus s’étant, en l’espèce, réalisé dès la signature de l’acte de vente et le montant du prêt ayant été versé par la SOFREA» ( com. 9 avr. 1991).
- En présence d’un transfert de propriété après le jugement d’ouverture
- Il de s’agit donc de l’hypothèse où le paiement du prix est effectué antérieurement au jugement d’ouverture et que le transfert de propriété s’opère durant la période d’observation.
- Dans un arrêt du 1er février 2001, la Cour de cassation que le principe de continuation des contrats en cours redevenait pleinement applicable.
- Elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait décidé « que le contrat de vente de l’immeuble dont l’une des clauses subordonne le transfert de propriété au paiement intégral du prix est un contrat de vente à terme n’incluant pas un prêt et que ce contrat était en cours lors de l’ouverture de la procédure collective, une partie du prix restant à payer » ( com. 1er févr. 2001).
- En présence d’une clause de réserve de propriété
- Conformément au nouvel article 2367, al. 2 du Code civil, ma clause de réserve de propriété s’analyse comme « l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.»
- Combiné à l’article L. 624-16, al. 4 du Code de commerce qui prévoit que la revendication du bien vendu sous réserve de propriété peut être écartée lorsque le prix est payé immédiatement avec autorisation du juge commissaire, on peut en déduire que, la vente assortie d’une clause de réserve de propriété dont le prix n’a pas été payé avant le jugement d’ouverture, ne peut pas être regardée comme un contrat en cours.
- Telle est la solution qui a été retenue par la Cour de cassation dans un arrêt, remarqué, du 3 avril. 2001 ( com. 3 avr. 2001).
- En présence d’une promesse unilatérale de vente
- La Cour de cassation a jugé, en matière de promesse unilatérale de vente, que pour être un contrat en cours la levée de l’option doit intervenir après le jugement d’ouverture ( com., 3 mai 2011, n° 10-18.031).
- La chambre commerciale justifie cette solution en soutenant que la « vente ne devient parfaite que par la levée d’option pendant la période d’observation».
==> La prestation caractéristique n’a pas été fournie
Dans cette hypothèse, le contrat est susceptible de faire l’objet d’une continuation par l’administrateur.
Tel sera le cas en matière de prêt, lorsque les fonds prêtés ne sont pas intégralement remis à l’emprunteur.
Dans un arrêt du 2 mars 1993, la Cour de cassation a considéré en ce sens s’agissant de contrats de prêt que « dès lors qu’il n’est pas allégué que les fonds n’avaient pas été intégralement remis à l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire, [ils] n’étaient pas des contrats en cours au sens de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985 » (Cass. com. 2 mars 1993).
| Cass. com. 2 mars 1993 |
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt déféré (Lyon, 28 septembre 1990), que la Société de développement régional du Sud-Est (la SDR) a consenti en 1982 deux prêts à la Société civile immobilière du 5 de la rue Ampère à Lyon (la SCI) remboursables chacun en onze annuités ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la SDR a déclaré sa créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir admis au titre de la créance de la SDR le montant des intérêts à échoir du jour du jugement d'ouverture de la procédure jusqu'au jour des échéances fixées pour diverses annuités alors, selon le pourvoi, que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 précise qu'outre les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la déclaration de créance contient en particulier les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu la conformité d'une déclaration précisant simplement le montant des intérêts à échoir sans indiquer le mode de calcul de ces intérêts ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 67 du décret précité ;
Mais attendu que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'exige l'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas interrompu que dans le cas où le montant des intérêts ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions de la SCI selon lequel la poursuite des contrats de prêt en cours après le jugement arrêtant le plan de redressement ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, applicables à la seule période d'observation en sorte que ces contrats se trouvaient résiliés ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à défaut par le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise de l'avoir décidé, les contrats de prêt litigieux ne sauraient avoir été poursuivis ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 61, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les contrats de prêt litigieux, dès lors qu'il n'est pas allégué que les fonds n'avaient pas été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'étaient pas des contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'application de ce texte, n'encourt pas la critique formulée par le troisième moyen ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
|
II) Le régime des contrats en cours
Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce, « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
Deux points doivent ici être envisagés :
- L’exercice de l’option
- Les effets de l’option
A) Le mécanisme de l’option
- La titularité de l’option
Deux situations doivent être distinguées :
==> En présence d’un administrateur
Lorsqu’un administrateur est désigné, soit pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de 3.000.000 euros et employant au moins 20 salariés, les termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce sont extrêmement clairs : l’administrateur a seul pouvoir d’opter pour la continuation des contrats en cours.
==> En l’absence d’administrateur
L’article L. 627-2 du Code de commerce prévoit, dans cette hypothèse, que « le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l’administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 »
Cette disposition ajoute que « en cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. »
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 26 juillet 2005, la question s’était posée de savoir si le débiteur devait obtenir l’autorisation du juge commissaire uniquement pour la décision de continuer un contrat en cours ou s’il devait également solliciter ladite autorisation pour mettre un terme à la relation contractuelle.
L’ancien article L. 621-137 du Code de commerce disposait en effet que « le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l’article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l’article L. 621-122 et par l’article L. 621-28 s’il y est autorisé par le juge-commissaire »
Dans un arrêt du 9 janvier 1996, la chambre commerciale a estimé que « s’agissant de l’exercice de l’option prévue à l’article 37 de la loi du 25 janvier 1985, que, dans la procédure simplifiée de redressement judiciaire, en l’absence d’administrateur, l’autorisation du juge-commissaire n’est requise par l’article 141 de la même loi que pour l’exercice par le débiteur de la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours et non pour renoncer à leur poursuite » (Cass. com. 9 janv. 1996).
Pour les auteurs, tout porte à croire que cette jurisprudence est applicable au nouvel article L. 627-2 du Code de commerce, à tout le moins les termes de cette disposition n’imposent pas formellement au débiteur de solliciter l’avis conforme du mandataire judiciaire quant à la renonciation d’un contrat en cours.
2. Les modalités de l’option
a) Le caractère d’ordre public de l’option
Aux termes de l’article L. 622-13, I « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. »
La faculté d’opter pour la continuation d’un contrat en cours est ainsi un droit d’ordre public. Il ne peut donc pas y être dérogé par convention contraire.
Cela signifie que l’administrateur jouit d’une liberté totale pour opter.
b) L’exercice de l’option
Dans la mesure où l’option appartient au seul administrateur, le cas échéant au débiteur, deux situations doivent être envisagées :
==> L’administrateur prend l’initiative d’exercer l’option
- L’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours
- L’article L. 622-13 du Code de commerce n’exigeait pas de l’administrateur qu’il manifeste de façon expresse sa volonté de poursuivre un contrat en cours.
- Et pour cause, en cas d’inaction de ce dernier, tant que le cocontractant ne s’est pas manifesté le contrat se poursuit de plein droit.
- Dans un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a ainsi censuré une Cour d’appel qui avait estimé que « la société Hygeco n’avait pas mis en demeure l’administrateur d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat en cours et relevé que ni l’administrateur ni la société Hygeco n’avait demandé l’exécution du contrat, retient que les dispositions de l‘article L. 621-28, alinéa 3, du code de commerce, édictant qu’à défaut de paiement dans les conditions prévues, le contrat est résilié de plein droit»
- La Cour de cassation retient à l’inverse que « l’administrateur n’avait ni expressément ni tacitement opté pour la continuation du contrat, de sorte que sa non-exécution par cet administrateur n’avait pu entraîner sa résiliation de plein droit » ( com. 7 nov. 2006).
- Ainsi, la décision de l’administrateur d’opter pour la continuation d’un contrat en cours peut être tacite et notamment se déduire de l’exécution du contrat par le débiteur postérieurement à l’ouverture de la procédure.
- Toutefois, il prend un risque à ne pas se prononcer explicitement.
- L’article L. 622-13, V prévoit, en effet, que « si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif.»
- En toute hypothèse, si l’administrateur choisi d’opter pour la continuation du contrat en cours, l’article L. 622-13, II formule deux préconisations
- Première préconisation
- Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.
- Seconde préconisation
- S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
- L’administrateur renonce à la continuation du contrat en cours
- Droit antérieur
- De la même manière que lorsqu’il opte pour la continuation du contrat en cours, antérieurement à 2008 il n’était pas nécessaire que la décision de renonciation de l’administrateur soit expresse.
- L’article L. 622-13 n’interdisait pas que cette décision soit tacite, pour autant que l’acte de renonciation en lui-même ne soit pas équivoque.
- À l’instar de la décision de poursuite d’un contrat en cours qui peut être vécu par le cocontractant comme une atteinte à sa liberté contractuelle, le choix de l’administrateur de renoncer à une relation contractuelle peut tout autant être perçu comme une atteinte à un droit acquis, notamment lorsqu’il s’agit d’un contrat de bail.
- Aussi, la question s’est-elle posée de savoir comment concilier le droit pour l’administrateur de renoncer à un contrat en cours et le droit au bail dont jouit le cocontractant lorsqu’il endosse la qualité de preneur ?
- Dans un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation a estimé que « la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire »
- Faits
- Conclusion de baux commerciaux entre deux sociétés
- La société bailleur fait par la suite l’objet d’une procédure de redressement judiciaire
- Dans le cadre de cette procédure l’administrateur décide de résilier les baux, ce qui a été validé par le juge-commissaire
- Demande
- Le preneur conteste devant le Tribunal la résiliation des baux dont elle bénéficie
- Procédure
- Par un arrêt du 7 juin 2001, la Cour d’appel de Lyon juge l’appel interjeté par la société preneuse irrecevable.
- Les juges du fond estiment qu’il appartient au seul juge-commissaire de statuer sur le sort des contrats en cours.
- La résiliation du bail était dans ces conditions parfaitement fondée puisque validée par le juge-commissaire, puis par le Tribunal
- Solution
- Par un arrêt du 19 mai 2004, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’article 37 de la loi du 25 janvier 1958
- La Cour de cassation estime en l’espèce « qu’en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice et qu’une telle demande n’entre pas dans les attributions du juge-commissaire»
- Autrement dit, pour la chambre commerciale, en matière de contrat de bail, la renonciation par l’administrateur au contrat de bail produit pour seul effet, non pas de mettre un terme au contrat, mais d’ouvrir le droit au preneur de saisir le Tribunal compétent en vue d’obtenir la résiliation en justice.
- Aussi, le preneur pourra-t-il, s’il le souhaite, conserver le bénéfice de son bail.
- Droit positif
- L’ordonnance du 18 décembre 2008 a introduit à l’article L. 622-13 un IV qui prévoit désormais que « à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant».
- Ainsi, dans l’hypothèse où l’administrateur n’a pas été mis en demeure d’opter, la résiliation du contrat en cours n’opère pas de plein droit .
- Pour être effective, la résiliation doit satisfaire à 3 trois conditions cumulatives :
- Elle doit être judiciairement prononcée par le juge-commissaire
- Elle doit être nécessaire à la sauvegarde du débiteur
- Elle ne doit pas porter une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
- Il ressort de cette disposition que le pouvoir de renonciation spontanée de l’administrateur à la poursuite d’un contrat en cours est désormais très encadré.
==> L’administrateur ne prend pas l’initiative d’exercer l’option
Afin de ne pas laisser le cocontractant dans l’incertitude, l’article L. 622-13 du Code de commerce lui offre la possibilité d’interpeller l’administrateur aux fins d’obtenir une réponse quant à sa volonté d’opter.
Cette disposition prévoit que « après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ».
Il ressort de cette disposition que lorsque l’administrateur n’a pas exercé son option, plusieurs étapes sont susceptibles de déterminer le sort du contrat en cours.
- Première étape : la mise en demeure de l’administrateur
- Le cocontractant du débiteur peut mettre en demeure l’administrateur d’opter
- Tant qu’aucune décision n’a été prise, l’exécution du contrat en cours se poursuit.
- Deuxième étape : l’ouverture d’un délai d’un mois à l’administrateur
- La mise en demeure de l’administrateur ouvre un délai d’un mois à l’expiration duquel l’administrateur est réputé avoir renoncé au contrat.
- Le délai a pour point de départ la date de réception par l’administrateur de la mise en demeure.
- L’article R. 622-13 du Code de commerce précise que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats en cours ainsi que la date de cette résiliation.
- Troisième étape : la possible réduction ou prolongation du délai d’un mois
- Tant que le délai d’un mois n’est pas acquis, le juge-commissaire peut, soit réduire ce délai, soit le proroger.
- La prorogation du délai ne peut excéder deux mois
- Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l’administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l’article L. 622-13.
B) Les effets de l’option
- La continuation du contrat en cours
En cas de continuation du contrat en cours deux périodes doivent être distinguées
==> La période antérieure au jugement d’ouverture
- La poursuite de l’exécution du contrat
- Aux termes de l’article L. 622-13, I du Code de commerce « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. »
- Ainsi, dès lors que l’administrateur opte pour la continuation du contrat en cours, le cocontractant du débiteur n’a d’autre choix de poursuivre l’exécution du contrat sans qu’il puisse lui opposer le manquement à ses obligations contractuelles antérieurement au jugement d’ouverture
- L’exception d’inexécution est en somme neutralisée par l’ouverture de la procédure.
- La Cour de cassation a rappelé cette règle dans un arrêt du 28 juin 2011 dans lequel elle affirme que « le cocontractant du débiteur doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par celui-ci d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture» ( com. 28 juin 2011).
- Sort des créances antérieures
- La continuation du contrat en cours ne confère pas plus de droit au cocontractant sur les créances antérieures au jugement d’ouverture dont il est susceptible de se prévaloir
- L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que « le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.»
- Cette dispose suggère toutefois, il en ira différemment pour les créances postérieures.
==> La période postérieure au jugement d’ouverture
- Obligation d’exécution
- L’article L. 622-13, II, al. 1er prévoit que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. »
- Il s’agit là de la contrepartie que le cocontractant du débiteur est légitimement en droit d’attendre, compte tenu de l’atteinte portée à sa liberté contractuelle.
- L’administrateur a donc l’obligation de veiller à la bonne exécution du contrat.
- Qui plus est, toutes les clauses demeurent opposables à l’administrateur ; il ne dispose pas de la possibilité de s’y soustraire.
- En cas d’inexécution du contrat par le débiteur, son cocontractant disposera de la faculté de solliciter l’exécution forcée, alors même que le jugement d’ouverture a pour effet de suspendre les poursuites.
- Paiement à échéance
- L’ancien article L. 622-13 du Code de commerce prévoyant que, en cas de continuation du contrat en cours, le cocontractant jouissant du droit d’être payé à l’échéance.
- Ce traitement de faveur a toutefois été supprimé pour la procédure de sauvegarde par l’ordonnance du 12 mars 2014.
- Le paiement au comptant ne peut désormais être sollicité que dans le cadre de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
- L’article L. 622-13 prévoit seulement désormais que « au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. »
- Cette disposition précise que « s’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. »
- Autrement dit, il appartient à l’administrateur d’apprécier la solvabilité du débiteur et sa capacité à satisfaire à ses obligations.
- S’il constate qu’il n’y parviendra pas, il doit en tirer toutes les conséquences en dénonçant le contrat.
- L’article L. 622-13, III précise ajoute que « à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.»
- Quid de la sanction de l’administrateur en cas de mauvaise appréciation de la solvabilité du débiteur ?
- Il engagera sa responsabilité civile à raison de l’exercice de son droit d’opter (V. en ce sens com., 6 juill. 2010)
2. La résiliation du contrat en cours
Il ressort de l’article L. 622-13, III du Code de commerce que deux hypothèses doivent être envisagées :
==> L’absence de réponse à la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 622-13 du Code de commerce « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. »
Si donc l’administrateur ne répond pas à l’interpellation du cocontractant, il est réputé avoir renoncé à la continuation du contrat.
==> L’absence de fonds nécessaires
L’article L. 622-13, III du Code de commerce prévoit encore que « le contrat en cours est résilié de plein droit à défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. »
Cette disposition ajoute que « en ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation. »
En toute hypothèse, l’article L. 622-13, IV prévoit que « à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. »
L’article R. 622-13 apporte deux précisions :
- D’une part, la demande de résiliation présentée par l’administrateur en application du IV de l’article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe.
- D’autre part, le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise l’administrateur de la date de l’audience.