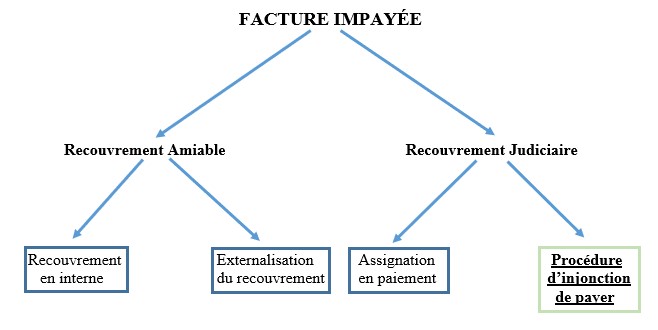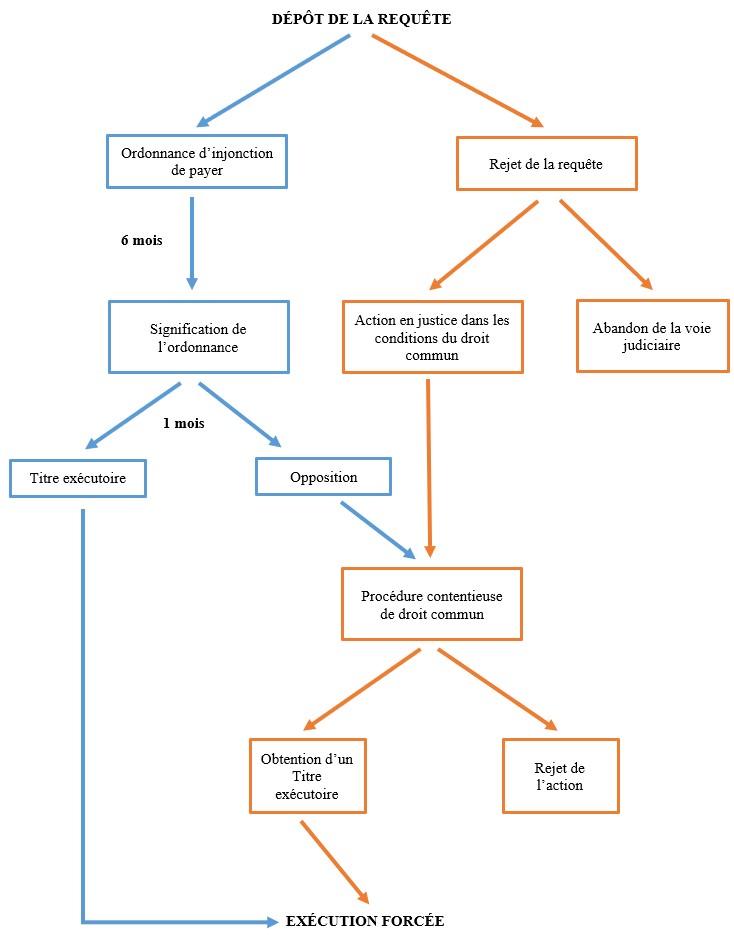La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées[1], elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains, l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps »[2]. Pour d’autres, la caducité évoque « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur »[3]. D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité »[4]. L’idée générale qui ressort de ces descriptions est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc, de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non. C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence. La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.
Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément, il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie[5], la capacité [6] du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué[7]. Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit s’estompe peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution »[8]. L’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend, dans ces conditions, tout son sens[9]. Aussi, cela s’est-il traduit par la consécration de la caducité dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations[10]. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé. Si les auteurs sont partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil[11], tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction. En droit judiciaire privé la caducité aurait pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’ont pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi[12]. Au vrai, si l’application de la caducité en droit judiciaire privé ne soulève guère de difficultés particulières, ses effets ne sont pas sans susciter de nombreuses interrogations quant à leur étendue.
La raison en est qu’aucun texte ne connaît des effets de la caducité judiciaire. La seule certitude que l’on peut se risquer à formuler à leur sujet, c’est que lorsqu’un acte est frappé de caducité, la procédure s’arrête sèchement ; il y est mis fin. Autrement dit, l’acte caduc est anéanti pour l’avenir. Une fois ce principe énoncé, nous n’avons cependant répondu qu’à la moitié de la question. Reste à déterminer ce qu’il advient des effets passés de l’acte caduc. Cela revient à se demander si la caducité qui atteint un acte de procédure peut être assortie d’un effet rétroactif. L’acte caduc est-il seulement anéanti pour l’avenir ou est-il supprimé rétroactivement de l’ordonnancement juridique, semblablement à l’acte nul ? Sur ce point, la jurisprudence est pour le moins hésitante. Quant à la doctrine, rares sont auteurs qui parviennent à emporter la conviction. La question est pourtant d’importance. En reconnaissant à la caducité un effet rétroactif, cela implique, notamment, que l’effet interruptif de prescription de l’acte caduc est anéanti. Il s’ensuit que ce n’est pas seulement la procédure judiciaire qui est éteinte ; le droit d’agir est susceptible de l’être aussi. D’où la nécessité de savoir si la caducité des actes de procédure produit un effet rétroactif. Pour le déterminer, il conviendra, dans un premier temps, de décrypter la jurisprudence, laquelle semble répondre par l’affirmative à cette question (I). Puis, dans un second temps, nous nous focaliserons sur l’association de la caducité à la rétroactivité, association qui n’est pas sans poser quelques problèmes de compatibilité (II).
I) La timide reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure
Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution »[13]. C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée[14]. Il eût été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet. La non-rétroactivité est, certes, toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité. Mais les données du problème ont changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé[15]. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale[16]. Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur le point suivant : les situations engendrées par la caducité justifient-elles que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé »[17] ? Comme le souligne Jean Deprez, autant il est normal « qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un évènement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé »[18]. Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme »[19]. En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif. Si, indéniablement, l’on assiste à l’émergence d’une reconnaissance de pareil effet (A), sa portée n’en demeure pas moins encore mal définie (B).
A) L’émergence récente de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure
Bien que les juridictions soient régulièrement amenées à statuer sur la question de la rétroactivité de la caducité, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives. À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis. La question de la rétroactivité de la caducité s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusé à procéder à une telle assimilation[20]. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus par l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive[21]. Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987[22]. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.
Si ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite[23], on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation. Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue[24]. S’il se trompe, cela ne saurait, en tout état de cause, être interprété comme portant un coup d’arrêt au mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif. Les cas où la caducité est assortie de rétroactivité ne se limitent pas à l’assignation caduque. La jurisprudence en a envisagé d’autres. Ainsi, dans un arrêt du 23 novembre 2000 la Cour de cassation a-t-elle jugé que, dans l’hypothèse où une saisie-attribution serait frappée de caducité en raison de l’absence de dénonciation au débiteur dans un délai de huit jours, le tiers saisi qui aurait manqué à son obligation de renseignement ne saurait être condamné au paiement des causes de la saisie[25]. La deuxième chambre civile reprend, trait pour trait, la solution suggérée dans un avis rendu le 21 juin 1999[26] par la Cour de cassation où elle avait estimé que, parce que la caducité d’une saisie « la prive rétroactivement de tous ses effets [cette circonstance] s’oppose à ce que le créancier saisissant puisse faire condamner le tiers saisi, sur le fondement de l’article 238 du décret du 31 juillet 1992, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée » [27]. La position adoptée par la haute juridiction ne laisse guère de place à l’ambiguïté : la caducité qui atteint une saisie attribution ou conservatoire produit un effet rétroactif. Cette solution a été confirmée dans un arrêt du 3 mai 2001[28], puis dans plusieurs autres décisions[29]. Mieux, elle a été très récemment étendue à la caducité touchant un commandement de payer délivré dans le cadre d’une saisie immobilière.
Dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a, en effet, jugé que « la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière […] le prive rétroactivement de tous ses effets »[30]. Conséquemment, selon elle, d’une part, la prescription biennale qui courrait en l’espèce n’a pas été interrompue par le commandement de payer et, d’autre part, tous les actes de procédure subséquents doivent être déclarés caducs. Quelques mois plus tôt, la deuxième chambre civile s’était déjà prononcée en ce sens[31]. Aussi, avec ces deux arrêts, la Cour de cassation revient-elle sur une décision du 24 mars 2005 où elle avait décidé, dans un cas d’espèce similaire, qu’un commandement de payer « avait valablement interrompu la prescription, bien que la procédure de saisie immobilière dont il constituait le premier acte ne fût pas arrivée à son terme » [32]. Peut-on déduire de ces différents arrêts – qui reprennent sensiblement, dans les mêmes termes, la solution retenue par la Cour de cassation dans son avis du 21 juin 1999 – un principe général de rétroactivité qui s’appliquerait à la caducité des actes de procédure ? Certainement pas. Dans le même temps, la Cour de cassation a été amenée à adopter une position radicalement inverse.
B) L’émergence contrariée de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure
Si, les récentes décisions rendues par la Cour de cassation laissent à penser qu’elle reconnaîtrait à la caducité des actes de procédure un effet rétroactif, cette reconnaissance doit être nuancée. Dans une décision du 6 mai 2004, la deuxième chambre civile a, par exemple, estimé que « sauf disposition contraire, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité »[33]. Il s’agissait en l’espèce d’une convention temporaire de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales, puis déclarée caduque pour défaut de renouvellement de la demande des époux dans les six mois conformément à l’ancien article 231 du Code civil.[34]. Dans cette convention, l’époux s’obligeait à verser à sa conjointe une pension alimentaire. Celui-ci n’ayant pas satisfait à son engagement, son épouse décide d’engager une procédure de saisie des rémunérations. Contestant la mesure d’exécution diligentée à son encontre, le débiteur soulève, dès lors, devant le Tribunal d’instance la caducité de l’ordonnance d’homologation. Débouté de sa demande, il forme un pourvoi devant la Cour de cassation qui considère que « les mensualités impayées de la pension alimentaire [qui] étaient dues pour une période antérieure à la caducité de la convention temporaire […] n’étaient pas atteintes par la caducité ». Ainsi, la deuxième chambre civile se refuse-t-elle, en l’espèce, à anéantir rétroactivement un acte de procédure caduc.
Cette décision n’est pas isolée. Dans un arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation a jugé que nonobstant la caducité d’une ordonnance de non-conciliation octroyant à une épouse la jouissance du domicile conjugal, le mari n’est pas fondé à réclamer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité d’occupation[35]. Pour justifier sa décision, la Cour de cassation reprend exactement à l’identique, dans sa motivation, la formule déjà employée dans l’arrêt du 6 mai 2004 par la deuxième chambre civile : « sauf dispositions contraires, la caducité d’un titre exécutoire ne le prive pas de son efficacité pour la période antérieure à la caducité ». Comment interpréter cette jurisprudence ? Est-elle conciliable avec les décisions dans lesquelles la Cour de cassation affirme que la caducité qui atteint une assignation ou une mesure d’exécution forcée « la prive rétroactivement de tous ses effets » ? Pour certains auteurs, les derniers arrêts statuant sur les effets de la caducité ne sont pas nécessairement inconciliables. Selon Roger Perrot, afin de surmonter leur apparente contradiction, cela suppose de distinguer les actes de procédures qui produisent leurs effets « en un trait de temps », telle qu’une assignation ou une saisie-attribution, et les actes dont les effets s’échelonnent dans le temps, telle qu’une saisie des rémunérations ou une ordonnance attribuant la jouissance du domicile conjugal à une épouse[36]. Pour les premiers, dans la mesure où « l’acte n’a pas pu atteindre sa perfection », il doit être anéanti rétroactivement[37]. Pour les seconds, en revanche, « la caducité a pour conséquence de remettre en cause une situation juridique complètement formée qui avait atteint sa perfection », de sorte que l’on ne saurait nier que l’acte caduc a existé[38]. En procédant à cette distinction, la jurisprudence de la Cour de cassation prendrait tout son sens. On pourrait y voir la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité qui affecte les actes de procédure dont les effets se réalisent instantanément. Bien que séduisant à maints égards, le fondement juridique sur lequel reposerait cette reconnaissance n’en demeure pas moins fragile pour plusieurs raisons qu’il convient d’examiner.
II) La difficile compatibilité entre la rétroactivité et la caducité des actes de procédure
Depuis que la caducité n’est plus cantonnée au domaine des actes qui n’ont reçu aucune exécution, certains auteurs ont cherché à se départir de la conception classique selon laquelle la caducité serait dépourvue d’effet rétroactif. Pour Rana Chaaban, le péché originel a été commis lorsque l’on a érigé la « non-rétroactivité de la caducité des legs […] en principe général applicable à toutes les hypothèses de caducité »[39]. Reprenant les travaux de Jean Deprez sur la notion de rétroactivité[40], cet auteur poursuit son raisonnement en soutenant que la rétroactivité est une notion contingente. Dès lors, elle « ne saurait être abstraitement rattachée à une institution particulière ni au contraire lui être théoriquement refusée »[41]. Il en résulte qu’aucun principe général de non-rétroactivité de la caducité n’existerait. Pour déterminer si un cas de caducité produit un effet rétroactif, il conviendrait de « scruter la situation juridique spécifique à laquelle la caducité donne naissance »[42]. C’est manifestement dans cette voie que se sont engagés les auteurs qui soutiennent qu’en matière d’acte de procédure, pour savoir si la caducité qui atteint un acte est ou non assortie d’un effet rétroactif, il convient de distinguer selon que l’effet produit par l’acte visé est instantané ou s’étire dans la durée. Dans cette dernière hypothèse, Roger Perrot soutient que dans la mesure où l’on est en présence d’une situation juridique qui a produit des effets qui se sont inscrits dans le temps, il est impossible de « faire abstraction de l’instant précis où s’est produit l’événement qui a engendré la caducité »[43]. En somme, on ne peut plus faire machine arrière. La caducité ne saurait, en conséquence, opérer rétroactivement. Le rapprochement peut être fait avec la résiliation en matière contractuelle. Lorsque, en revanche, l’effet de l’acte frappé de caducité est instantané, la situation est toute autre. Aucun effet n’a, véritablement, été « consommé »[44]. Rien ne s’oppose donc à ce que la caducité anéantisse l’acte rétroactivement. Malgré l’avantage certain que procure cette thèse, ne serait-ce que parce qu’elle permet de concilier, comme nous l’avons vu, les dernières décisions rendues en la matière par la Cour de cassation, elle ne résiste pas à la critique (A). L’erreur commise par les auteurs viendrait de la confusion qui est faite entre la validité et l’efficacité des actes (B).
A) La rétroactivité de la caducité source de perturbation du droit positif
Reconnaître à la caducité de certains actes de procédure un effet rétroactif est susceptible de conduire, de l’aveu même des partisans de cette reconnaissance, à l’adoption de solutions qui, sur le plan la logique juridique, sont très discutables. En témoigne, tout d’abord, la série de décisions rendues par la Cour de cassation dans lesquelles, en raison de l’effet rétroactif de la caducité qui affecte un acte de saisie, le banquier, malgré la caractérisation d’une faute qui lui était imputable, a pu s’exonérer de sa responsabilité[45]. Pour bien comprendre de quoi il s’agit, remémorons nous les faits qui étaient sensiblement les mêmes dans les espèces qu’a eus à connaître la haute juridiction : une saisie-attribution ou conservatoire est frappée de caducité faute de dénonciation dans les huit jours au débiteur conformément aux articles R. 211-3 et R. 523-3 du Code des procédures civiles d’exécution. En réaction, le créancier décide d’engager une action en responsabilité contre la banque. Au soutien de sa demande, il invoque un manquement par le banquier à son obligation de renseignement[46]. Alors que dans les espèces qui lui étaient soumises il est avéré que les déclarations faites par le tiers saisi étaient erronées, la Cour de cassation a néanmoins jugé que ce dernier n’engageait pas sa responsabilité. Selon elle, la caducité de la saisie « la prive de tous ses effets ». Autrement dit, pour la Cour de cassation, en anéantissant rétroactivement l’acte de saisie, la caducité prive de sa cause l’obligation de renseignement qui échoit au banquier, tant et si bien que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur ce fondement. Si, de prime abord, cette solution, approuvée par la doctrine[47], ne semble pas prêter le flanc à la critique. La cour de cassation tire ici parfaitement les conséquences de l’application du principe de rétroactivité. À la vérité, elle est un exemple topique du danger que représente la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité.
Comment concevoir que la banque puisse échapper à sa responsabilité en invoquant la caducité de l’acte de saisie alors que la déclaration faite à l’huissier de justice instrumentaire était erronée ? Cette situation est d’autant plus difficile à comprendre que si le créancier n’a pas dénoncé la saisie – événement qui, on le rappelle, est à l’origine de la caducité – c’est précisément parce qu’au regard des informations qui lui ont été communiquées, la poursuite de la procédure était dénuée de tout intérêt, sauf à engager des frais d’actes qui ne seraient pas couverts par la saisie. Or elle s’annonçait infructueuse. Aussi, la position de la Cour de cassation revient-elle à admettre que le tiers saisi qui, par sa faute, a provoqué la caducité de la saisie, puisse se réfugier derrière cette même caducité pour s’exonérer de sa responsabilité. De toute évidence, cette solution est difficilement justifiable, tant sur le plan moral, que juridique. Certains juges du fond ont bien tenté de ne pas tomber dans cet écueil en considérant que seule la caducité d’une saisie fructueuse était assortie d’effets rétroactifs[48]. Cela permettait, d’une part, de dédouaner le créancier qui n’avait pas dénoncé la saisie consécutivement à la notification erronée par le banquier de l’absence de compte bancaire ouvert au nom du débiteur ou de l’existence d’un compte présentant un solde négatif et, d’autre part, de retenir la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de renseignement. La Cour de cassation a cependant, fort logiquement, censuré les décisions statuant en ce sens, estimant que c’était ajouter « aux dispositions réglementaires une condition qui n’entrait pas dans leur prévision »[49]. La lecture des textes visés lui donne incontestablement raison. Les articles R 523-3, R 523-4 et R 523-5 du Code des procédures civiles d’exécution n’opèrent aucune distinction entre les saisies fructueuses et infructueuses. Il ne peut donc être fait aucune différence dans la mise en œuvre des effets de la caducité. Sitôt que la procédure est caduque, l’inefficacité dont elle fait l’objet produit les mêmes conséquences, quelle que soit l’issue de la saisie. Afin de pallier les effets pervers de la position adoptée par la Cour de cassation sur cette question, ne pourrait-on pas envisager d’engager la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ? Certains auteurs le suggèrent[50]. Cela suppose, toutefois, pour le créancier de démontrer l’existence d’une faute distincte du manquement à l’obligation de renseignement. Par ailleurs, quid lorsque le tiers saisi n’a commis aucune faute ou lorsqu’une cause étrangère est venue perturber son action ? Aucune réponse n’ayant encore été apportée par la Cour de cassation à ces interrogations, le tiers saisi jouit, pour l’heure, d’une immunité de responsabilité lorsque le créancier n’a pas dénoncé la saisie.
Là n’est pas la seule anomalie engendrée par la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité. L’adoption de cette solution par la haute juridiction en matière de saisie immobilière est également source de difficulté. Dans une décision remarquée, la deuxième chambre civile a jugé qu’un commandement valant saisie immobilière frappé de caducité perdait son effet interruptif de prescription[51]. Selon la formule, désormais consacrée, « la caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets ». Si la Cour de cassation marque ici sa volonté de ne pas permettre au créancier de se ménager le bénéfice de la prescription biennale indéfiniment en délivrant ponctuellement à son débiteur des commandements de payer, sans pour autant mener à bien la procédure de saisie immobilière, sa position se heurte, néanmoins, à la lettre de l’article 2243 du Code civil qui prévoit, pour rappel, que « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». La caducité n’étant pas expressément visée par cette disposition – comme cela avait été relevé par les juges du fond – on est légitimement en droit de s’étonner de la position de la Cour de cassation qui se livre à une interprétation extensive de l’article 2243 du Code civil. Cette décision est d’autant plus étonnante que l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution, applicable à la procédure de saisie-vente, dispose que, nonobstant la caducité de la saisie, « l’effet interruptif de prescription du commandement demeure ». Plus surprenant encore, dans l’arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation précise que la caducité du commandement valant saisie immobilière « atteint tous les actes de procédure de saisie qu’il engage »[52], ce qui visait, en l’espèce, l’assignation à l’audience d’orientation délivrée au débiteur, conformément à l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles. L’article 2241 du Code civil prévoit toutefois que le délai de la prescription extinctive est interrompu, quand bien même « l’acte de la saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Bien qu’il n’existe pas d’incompatibilité absolue entre les dispositions relatives aux causes d’interruption de la prescription extinctives et la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité, leur conciliation repose manifestement sur une interprétation pour le moins discutable des textes.
B) La rétroactivité de la caducité source de confusion entre validité et efficacité des actes
Finalement, il apparaît que toutes les fois où la Cour de cassation a décidé que la caducité d’un acte de procédure devait être assortie d’un effet rétroactif, une question de compatibilité avec le droit positif s’est posée. Est-ce à dire que la caducité et le phénomène de rétroactivité seraient inconciliables comme a pu le soutenir récemment Caroline Pelletier[53] ? La tendance est pourtant à la démonstration de la thèse inverse[54]. Rappelons l’argument principal avancé par les auteurs pour justifier la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité des actes de procédure. Reprenant la définition de Gérard Cornu, Roger Perrot adhère à l’idée que la caducité consiste en l’« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte »[55]. Autrement dit, l’acte caduc est réduit à néant ; il est censé n’avoir jamais existé. Il en résulte un anéantissement rétroactif de tous les effets y afférant ; d’où la privation d’effet interruptif de prescription pour l’acte de procédure caduc ou la disparition de l’obligation de renseignement incombant au banquier lorsque la saisie n’a pas été dénoncée au débiteur. Imparable en apparence, ce raisonnement comporte une faille. S’il est incontestable que l’acte caduc doit être supprimé de l’ordonnancement juridique en raison de la perte d’un élément essentiel l’empêchant de prospérer utilement, rien ne justifie pour autant qu’il fasse l’objet d’un anéantissement rétroactif. Pourquoi vouloir anéantir l’acte caduc rétroactivement, soit faire comme s’il n’avait jamais existé, alors qu’il était parfaitement valable au moment de sa formation ? Cela n’a pas grand sens. Dès lors qu’un acte est valablement formé, il produit des effets sur lesquels on ne doit plus pouvoir revenir, sauf à nier une situation juridiquement établie[56]. D’aucuns invoquent, pour réfuter cette thèse, le mécanisme de la résolution judiciaire qui a pour effet d’anéantir rétroactivement un contrat au cours de son exécution alors qu’il réunissait les conditions de validité exigées lors de sa conclusion[57]. À cet argument, il peut être opposé que la résolution tient son effet rétroactif de la loi. Elle répond, dans ces conditions, à une logique qui lui est propre. Aussi, ne saurait-on en tirer une quelconque conséquence s’agissant de la caducité, laquelle ne s’apparente nullement à la résolution et dont les effets ne sont régis par aucun texte.
Au vrai, l’erreur commise par les partisans de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité vient de la confusion qui est faite entre la validité de l’acte juridique et son efficacité. Ces deux questions doivent cependant être distinguées. La seule condition qui doit être remplie pour qu’un acte soit valable, c’est que, tant son contenu, que ses modalités d’édiction soient conformes aux normes qui lui sont supérieures. On peut en déduire que la validité d’un acte ne se confond pas avec son efficacité. Si tel était le cas, cela reviendrait à remettre en cause sa validité à chaque fois que la norme dont il est porteur est violée. Or comme l’a démontré Denys de Béchillon « une norme juridique ne cesse pas d’être juridique lorsqu’elle n’est pas respectée »[58]. L’inefficacité de l’acte caduc se distingue certes de l’hypothèse précitée en ce qu’elle est irréversible et n’a pas le même fait générateur. Elle s’en rapproche néanmoins dans la mesure où, d’une part, elle s’apprécie au niveau de l’exécution de l’acte et, d’autre part, elle consiste en une inopérance de ses effets. Ainsi, les conséquences que l’on peut tirer de la caducité d’un acte sont les mêmes que celles qui peuvent être déduites du non-respect d’une norme : l’inefficacité qui les atteint ne conditionne nullement leur validité. D’où l’impossibilité logique d’anéantir rétroactivement l’acte ou la norme qui font l’objet de pareille inefficacité. Partant, lorsqu’une saisie n’est pas dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, seule son efficacité fait défaut. L’acte de saisie en lui-même reste valable, en conséquence de quoi il ne saurait faire l’objet d’un anéantissement rétroactif. Il en va de même pour le commandement de payer valant saisie immobilière qui n’aurait pas été publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification[59].
Pour conclure, il apparaît que la caducité d’un acte de procédure peut difficilement être assortie d’un effet rétroactif. En l’admettant, comme le fait de plus en plus souvent la Cour de cassation, cela revient à considérer que l’efficacité d’un acte se confond avec sa validité. Or il s’agit là de deux choses radicalement différentes. Qui plus est, la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité pose, comme nous l’avons vu, de sérieux problèmes de compatibilité avec le droit positif.
[1] V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963 ; N. Fricero-Goujon, La caducité en droit judiciaire privé : thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L’Harmattan, coll. « logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducité des actes juridiques, LGDJ, 2006.
[2] R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559.
[3] M.-C. Aubry, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625.
[4] H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. « Traités », 2002, n°02, p. 38.
[5] Article 1089 du Code civil.
[6] Article 1043 du Code civil.
[7] Article 1042, alinéa 1er du Code civil.
[8] V. Wester-Ouisse, « La caducité en matière contractuelle : une notion à réinventer », JCP G, n°, Janv. 2001, I 290.
[9] V. en ce sens F. Garron, La caducité du contrat : étude de droit privé, PU Aix-Marseille, 2000.
[10] Le régime juridique de la caducité contractuelle figure désormais aux nouveaux articles 1186 et 1187 du Code civil.
[11] Pour Caroline Pelletier la caducité envisagée par les civilistes et la caducité que l’on rencontre en droit judiciaire privé forment une seule et même notion (C. Pelletier, op. cit., n°402, p.494-495). À l’inverse, Rana Chaaban estime qu’il s’agit là de caducités différentes (R. Chaaban, op. cit., n°29, p. 20). Elle estime en ce sens que, « contrairement à la caducité judiciaire, la caducité de droit civil éteint un droit substantiel, et non un élément processuel ».
[12] V. en ce sens S. Guinchard, « Le temps dans la procédure civile », in XVe Colloque des instituts d’études judiciaires, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76.
[13] R. Chaaban, op. cit., n°371, p. 333.
[14] Pierre Hébraud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc « se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delà, sans s’accompagner, notamment de rétroactivité » (P. Hébraud, Préface de la thèse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963, p. VI).
[15] Dès 1971 la notion de caducité fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrêts remarqués, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exécution d’un contrat, à l’exigence de déterminabilité du prix (Cass. com., 27 avr. 1971, n° 69-10.843, n° 70-10.752 et n° 69-12.329 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrêts] ; JCP G, 1972, II, 16975 note J. Boré ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch).
[16] Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducité aux actes juridiques non entrés en vigueur « ne reflète plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvénient, résulter d’un fait générateur intervenant après le début de l’exécution de l’acte juridique » (C. Pelletier, op. cit., n°3, p. 17).
[17] R. Houin, « Le problème des fictions en droit civil », Travaux de l’association H. Capitant, 1947, p. 247.
[18] J. Deprez, La rétroactivité dans les actes juridiques : Thèse, Rennes, 1953, n°1.
[19] Ibid., n°61.
[20] Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 : Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 févr. 1985 : JCP G 1985, IV, 15.
[21] L’ancien article 2247 du Code civil disposait: « si l’assignation est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s’il laisse périmer l’instance, ou si sa demande est rejetée, l’interruption est regardée comme non avenue ».
[22] Cass. ass. plén., 3 avr. 1987 : JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD Civ., 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien.
[23] Cass. soc., 21 mai 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° 99-13.592, D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° 99-16.269 : Bull. civ. 2001, II, n° 153 ; Com. 14 mars 2006, n° 03-10.945.
[24] V. en ce sens L. Miniato, « La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ? », D. 2008, p. 2592.
[25] Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, Bull. civ. II, n° 155, D. 2001.182, JCP 2001.IV.1108 ; RTD Civ., 2001, 667, obs. R. Perrot.
[26] Cass., avis, 21 juin 1999, Defrénois 1999, art. 37080, p. 1344 ; D. 1999, IR, p. 206 ; JCP éd. G 1999, I, no 10160, note H. Croze et T. Moussa ; Dr. et patrimoine, nov.2000, p. 105, note Ph. Théry.
[27] Cet avis concernait certes la caducité d’une saisie conservatoire. Comme le révèle l’arrêt en l’espèce, la solution qu’il propose est toutefois transposable à la caducité affectant une saisie attribution.
[28] Cass. 2e civ., 3 mai 2001, Bull. civ. 2001, II, n° 89 ; D. 2001, p. 1671 ; Dr. et proc. 2001, p. 328, obs. J.-J. B. ; RTD civ. 2001, p. 667, obs. R. Perrot.
[29] Cass. 2e civ., 6 mai 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 217 ; D. 2004, p. 1646 ; JCP G 2004, II, 10150, note O. Salati ; Dr. et proc. 2004, p. 284, note E. Putman ; Defrénois, nov. 2004, n°22, p. 1549, note Ch. Lefort ; Civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 04-16.511 : RTD Civ., 2007. 180, note R. Perrot ; Civ. 2e, 6 déc. 2007 n° 07-13964 : Bull. civ. II, RTD Civ., 2008. 162, note R. Perrot; Cass. 2e civ., 9 févr. 2011 : Dr. et proc. 2011, p. 125, note C. Lefort.
[30] Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445 : Procédures, avril 2015, comm. 119, C. Laporte ; RD bancaire et fin, mai 2015, n°3, comm. 94, note S. Piedelièvre ; Procédures, novembre 2014, comm. 293.
[31] Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.935 : RD bancaire et fin. 2014, comm. 205, obs. Piedelièvre.
[32] Cass. 2e civ., 24 mars 2005, 2 arrêts, n° 02-20.216 et 03-16.312 : Bull. civ. 2005, II, n° 85 ; JCP G 2005, IV, 2059 et 2066 ; Procédures 2005, comm. 122, obs. R. Perrot ; D. 2005, p. 1609, obs. P. Julien et G. Taormina ; RTD civ., 2006, p. 603, note Ph. Théry.
[33] Cass. 2e civ., 6 mai 2004, n° 02-18.985 : Bull. civ. 2004, II, n° 220 ; RTD civ. 2004, p. 559, obs. R. Perrot ; RD bancaire et fin, janvier 2005, n°1, 25, note S. Piedelièvre.
[34] Cette disposition a depuis fait l’objet d’une abrogation par la loi n°2004-439 du 26 mai 2004.
[35] Cass. 1ère civ., 9 févr. 2011, n° 09-72.653 : Dr. et proc. 2011, p. 125, note C. Lefort. ; D. 2011. 594 ; AJ famille 2011. 153, obs. S. David; RTD Civ., 2011, p. 591, note R. Perrot.
[36] R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559.
[37] R. Perrot, « Caducité : produit-elle un effet rétroactif ? », RTD Civ., 2011, p. 591.
[38] Ibid.
[39] R. Chaaban, op. cit., n°370, p. 333.
[40] J. Deprez, op. cit.
[41] R. Chaaban, op. cit., n°468, p. 401.
[42] Ibid.
[43] R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559.
[44] Ibid.
[45] V. en ce sens Cass. 2e civ. 21 juin 1999 ; Cass. 2e civ. 23 nov. 2000 ; Cass. 2e civ. 3 mai 2001 ; Cass. 2e civ. 6 mai 2004 ; Cass. 2e civ. 21 déc. 2006.
[46] Les articles R. 211-5 et R. 523-5 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient respectivement que, en matière de saisie attribution ou conservatoire « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier ».
[47] V. notamment en ce sens O. Salati, note sous Cass. 2e civ., 6 mai 2004 : JCP G, 2004, II, 10150 ; R. Perrot, note sous Cass. 2e civ., 23 nov. 2000 : RTD Civ., 2001, p. 667.
[48] V. en ce sens CA. Chambéry, 8 janv. 2002 Banque populaire des Alpes c/ Le prince Mohamad Bin Fahad Bin Abdulaziz AI Saud, note J.-M. Delleci, RD bancaire et fin., Mars 2002, n°2, 73.
[49] Cass. 2e civ., 6 mai 2004 : Bull. civ. 2004, II, n° 217 ; D. 2004, p. 1646 ; JCP G 2004, II, 10150, note O. Salati.
[50] V. notamment en ce sens O. Salati, note sous Cass. 2e civ., 6 mai 2004 : JCP G, 2004, II, 10150 ; C. Lefort, note sous Cass. 2e civ., 6 mai 2004 : Defrenois, nov. 2004, n°22, p. 1549.
[51] Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.935 : RD bancaire et fin. 2014, comm. 205, obs. Piedelièvre.
[52] Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 13-28.445 : Procédures, avril 2015, comm. 119, C. Laporte ; RD bancaire et fin, mai 2015, n°3, comm. 94, note S. Piedelièvre ; Procédures, novembre 2014, comm. 293.
[53] C. Pelletier, op. cit., pp. 384 et s.
[54] R. Chaaban, op. cit.
[55] G. Cornu, Vocabulaire juridique, Puf, 2014, V. Caducité.
[56] V. en ce sens A. Foriers, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur formation, Bruylant, 1998, n°54 et s.
[57] R. Chaaban, op. cit., n°460, p. 397.
[58] D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, éd. Odile Jacob, 1997, p. 61. V. également en ce sens F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit » in les usages sociaux du droit, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, 1989, p. 130 ; P. Amselek, « Kelsen et les contradictions du positivisme », APD, 1983, n°28, p. 274. Pour la thèse opposée V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, éd. Bruylant-LGDJ, 1999, trad. Ch. Eisenmann, p. 19 et s.
[59] Article R. 321-6 du Code des procédures civiles d’exécution.