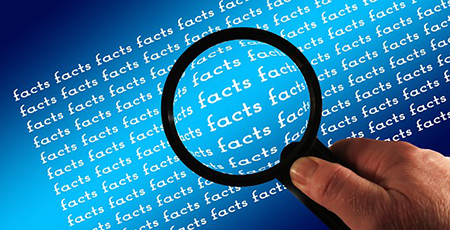Si l’enrôlement de l’affaire est un prérequis pour que la juridiction soit valablement saisie, cette démarche seule ne suffit pas à permettre au juge de se saisir matériellement du dossier.
Une fois l’affaire inscrite au rôle, il est, en effet, nécessaire que l’affaire soit « orientée » vers un juge :
- Soit pour qu’il soit procédé à son instruction
- Soit aux fins de jugement
- Soit aux fins de régularisation d’une convention de procédure participative
- Soit aux fins d’orientation vers une audience de règlement amiable
Lorsque le Président estime à l’issue, soit de la première audience d’orientation, soit de la seconde, que l’affaire pas en état d’être jugée, il prononcera un renvoi devant le Juge de la mise en état, en application de l’article 779 du CPC. C’est ce que l’on appelle la voie du circuit long.
Le greffe doit alors aviser les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état, étant précisé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle est donc insusceptible de voie de recours.
En tout état de cause, conformément à l’article 770, al. 2e du CPC, la décision du Président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie de l’assignation.
Une fois transmise au Juge de la mise en état, l’affaire est instruite sous son seul contrôle. Celui-ci a notamment pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’instruction de l’affaire dans le cadre de la procédure applicable devant le Tribunal judiciaire comporte plusieurs aspects :
- La désignation du Juge de la mise en état
- Les missions et les pouvoirs du Juge de la mise en état
- Les décisions du Juge de la mise en état
- Les incidents d’instance
- La clôture de la mise en état
I) La désignation du Juge de la mise en état
En application de l’article 779 du CPC, la désignation du Juge de la mise en état peut intervenir dans deux cas :
🡺Dans le cadre de la procédure de mise en état conventionnelle
Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont opté pour la conclusion d’une convention de procédure participative.
Plus précisément, un juge de la mise en état sera désigné si les parties ont formulé une demande de date de fixation de l’audience de clôture de l’instruction et une date d’audience de plaidoiries.
Bien que, par hypothèse, la mise en état soit ici conventionnelle, le juge désigné est chargé de trancher toutes les difficultés susceptibles de naître dans le cadre de la procédure participative.
Cette faculté de saisir le juge est une nouveauté introduite par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile qui a modifié les termes de l’article 1555, 5 du CPC.
En effet, cette disposition prévoit désormais que si l’ensemble des parties en sont d’accord, il est désormais possible de saisir le juge d’une difficulté en cours de procédure participative sans que cela ne mette fin à la convention (art. 1555, 5° CPC).
🡺Dans le cadre de la procédure de mise en état judiciaire
En application de l’article 779 du CPC, lorsque, à l’issue de la procédure d’orientation, le Président du Tribunal ou le Président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, décide de ne pas renvoyer l’affaire à l’audience aux fins de jugement, il procède à la désignation d’un juge de la mise en état aux fins d’instruction de l’affaire.
Cette désignation peut être décidée, tant au moment de la première audience d’orientation, qu’au moment de la seconde audience qui est susceptible de se tenir lorsque le Président considérera qu’il convient de consentir un délai aux parties avant de décider de l’orientation de l’affaire.
En tout état de cause, la désignation du juge de la mise en état, amorce la voie de ce que l’on appelle le circuit long.
Elle se produira toutes les fois que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, à moins que l’une des parties ait été négligente dans l’observation des délais impartis pour conclure ou produire des pièces auquel cas le Président disposera toujours de la faculté de renvoyer directement l’affaire à l’audience de plaidoiries en guise de sanction, à la condition, toutefois, que la demande ait été formellement exprimée par un avocat.
Lorsque le Précisent décide de désigner le juge de la mise en état aux fins d’instruction de l’affaire qui, par hypothèse, n’est pas en état d’être jugée, le greffe est tenu d’en aviser les avocats, conformément au dernier alinéa de l’article 779 du CPC.
II) Les missions du Juge de la mise en état
La mission du Juge de la mise en état est d’assurer l’instruction de l’affaire. L’article 780 prévoit en ce sens que « l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée. »
Afin de mener à bien cette mission, le juge de la mise en état doit être guidé par deux objectifs dont l’atteinte conditionne le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement :
- Premier objectif
- Il appartient au Juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
- Autrement dit, le Juge de la mise en état doit être le garant de la bonne tenue du débat judiciaire et, en particulier, du respect du principe du contradictoire.
- L’observation de ce principe est une condition absolument nécessaire pour qu’il puisse être statué sur l’affaire.
- L’article 16 du CPC dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
- Le principe de la contradiction est l’un des fondements du procès équitable.
- Il participe du principe plus général du respect des droits de la défense et du principe de loyauté des débats.
- À cet égard, pour la Cour européenne, le principe de la contradiction implique notamment le droit pour une partie de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l’autre, ainsi que de les discuter (CEDH, 20 février 1996, Lobo Machado c. Portugal, requête n° 15764/89).
- Second objectif
- L’article 799 du CPC prévoit que le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée
- Ainsi, le second objectif qui doit être atteint par le Juge de la mise en état est d’impulser, en adoptant au besoin toutes les mesures utiles, les échanges de conclusions et les communications de pièces jusqu’à ce que le débat soit épuisé.
- Autrement dit, il a pour tâche de faire en sorte que l’affaire soit en état d’être jugée.
- Cette mission implique qu’il rythme la procédure en fixant un calendrier procédural, qu’il sollicite des auditions, qu’il entende les avocats, qu’il leur adresse des injonctions ou bien encore qu’il ordonne toute mesure d’instruction légalement admissible.
Au bilan, l’objectif d’efficacité et de célérité des procédures impose d’accorder une attention particulière à la mise en état.
Déjà plusieurs fois améliorée, elle est une phase essentielle et dynamique du procès civil dont l’objectif est de permettre d’audiencer des affaires véritablement en état d’être jugées.
Elle ne doit pas se limiter à de simples échanges de conclusions entre parties. Il s’agit en effet de permettre une mise en état non pas purement formelle mais une mise en état dite « intellectuelle » ce qui implique, de la part du juge notamment, une pleine connaissance de l’état du dossier.
Pour parvenir à cet objectif qui lui est assigné, le Juge de la mise en état dispose de nombreuses prérogatives dont certaines relèvent de sa compétence exclusive, soit de pouvoirs qui lui sont propres.
À cet égard, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu les pouvoirs du Juge de la mise en état.
Il a désormais compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris lorsqu’il est nécessaire de trancher préalablement une question de fond.
Cette innovation est présentée par le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile comme visant à désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d’introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables.
III) Les pouvoirs du Juge de la mise en état
À l’examen, les pouvoirs – nombreux et étendus – dont est investi le Juge de la mise en état peuvent être classés en deux catégories :
- Première catégorie : les pouvoirs d’administration judiciaire
- Ces pouvoirs sont conférés aux juges de la mise en état afin qu’il exerce sa mission de contrôle et d’impulsion de l’instruction.
- L’adoption de mesures d’administration judiciaire va, en effet, lui permettre d’impulser le débat et de discipliner les parties dans l’échange des conclusions et la production des pièces
- La particularité des décisions instaurant des mesures d’administration judiciaire est qu’elles sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée et qu’elles sont insusceptibles de voies de recours.
- Seconde catégorie : les pouvoirs juridictionnels
- Les pouvoirs juridictionnels dont est investi le juge de la mise en état visent à lui permettre de trancher les contestations et incidents susceptibles d’intervenir au cours de l’instruction de l’affaire
- À la différence des mesures judiciaires, les actes juridictionnels sont assortis de l’autorité de la chose jugée, tantôt au principal, tantôt au provisoire.
- Ils sont également susceptibles de voies de recours, ce qui dès lors tempère le caractère discrétionnaire et irrévocable des décisions prises par le Juge de la mise en état
- Enfin, les actes juridictionnels doivent répondre au formalisme qui s’impose au juge lorsqu’il rend un jugement, en particulier à l’exigence de motivation de tout jugement
A) Les pouvoirs d’administration judiciaire
1. Fixation du calendrier procédural
Il ressort de l’article 781 du CPC que le calendrier procédural peut être fixé selon deux modalités différentes.
Il peut être le produit :
- Soit d’une décision unilatérale du Juge de la mise en état qui imposera aux avocats des délais sans qu’ils aient pu les discuter
- Soit d’une concertation entre avocats auxquels le Juge de la mise en état aura octroyé la possibilité d’en négocier les termes
🡺La fixation unilatérale du calendrier procédural
- La fixation de délais
- L’article 781, al. 1er du CPC dispose que « le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. »
- Il ressort de cette disposition que si lorsque le juge de la mise en état fixe des délais il doit ;
- D’une part, tenir compte d’un certain nombre de critères (urgence, complexité et nature de l’affaire) lesquels doivent lui permettre d’apprécier la durée du délai accordé
- D’autre part, solliciter l’avis des avocats, ce qui signifie qu’ils doivent être convoqués à l’audience et invité à présenter leurs observations, bien qu’il ne soit pas lié par leurs demandes.
- Les délais fixés par le Juge de la mise en état visent à permettre aux parties d’échanger des conclusions et de communiquer des pièces
- Ainsi, le débat contradictoire est-il rythmé par des dates butoirs qui s’imposent tantôt au demandeur, tantôt au défendeur.
- Les parties se voient de la sorte invitée tour à tour à conclure dans un délai fixé par le Juge de la mise en état.
- En application de l’article 792 du CPC la décision du juge fait l’objet d’une simple mention au dossier.
- Parce qu’il s’agit d’une mesure judiciaire, elle est insusceptible de voies de recours.
- L’octroi de prorogations
- Lorsque les délais fixés n’ont pas été respectés, soit parce que trop courts, soit parce que les parties ont été négligentes, le juge de la mise en état peut accorder des prorogations (art. 781, al. 2 CPC).
- Cette faculté reste à la discrétion du juge qui devra apprécier l’opportunité d’octroyer une telle prorogation.
- Autre alternative susceptible d’être retenue par le juge, l’article 764, al. 6 prévoit qu’il peut également renvoyer l’affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
- Les injonctions
- Lorsqu’une partie ne respecte pas le délai qui lui était imparti pour conclure, l’article 780 du CPC confère au Juge de la mise en état le pouvoir de prononcer des injonctions de conclure ou de communiquer les pièces attendues
- L’article 774 prévoit, à cet égard, que les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d’un bulletin
- Ce bulletin doit être daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.
- Les sanctions
- En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, deux sanctions sont encourues par les parties, selon que la négligence est imputable à une seule d’entre elles ou aux deux
- La clôture partielle en cas de défaut d’une seule partie
- L’article 800 du CPC prévoit que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ».
- On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente.
- Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.
- Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture
- La copie de l’ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
- La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.
- Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.
- La radiation de l’affaire en cas de négligence des deux parties
- Principe
- L’article 801, al. 1er du CPC dispose que « si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours. »
- L’alinéa 2 précise que « copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence. »
- Le Juge de la mise en état dispose ainsi de la faculté, en cas de négligence des deux parties, de prononcer la radiation de l’affaire.
- Cette faculté est un rappel de la règle plus générale énoncée à l’article 381 du CPC qui prévoit que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».
- Effets
- La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
- Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
- L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.
- En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
- Régime
- En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
- Reste que l’article 801 du CPC impose au juge
- D’une part, de provoquer l’avis des avocats
- D’autre part, de rendre ordonnance de radiation qui doit être motivée.
🡺La fixation concertée du calendrier procédural
L’article 781, al. 3 du CPC prévoit que le juge de la mise en état « peut, après avoir recueilli l’avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. »
L’alinéa 4 de cette disposition précise que le calendrier comporte alors « le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article 450, celle du prononcé de la décision. »
S’inspirant des pratiques de juridictions ayant mis en place des « contrats de procédure », l’article 781 introduit par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 a consacré ce dispositif.
L’ancienne rédaction prévoyait seulement que le juge fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, « au fur et à mesure ».
Prise à la lettre, cette disposition interdisait donc les calendriers de procédure. À tout le moins, elle n’incitait pas les juges de la mise en état à s’orienter dans cette voie.
Désormais, le juge, après avoir recueilli l’accord des conseils des parties, peut donc fixer le calendrier de la mise en état qui comportera la date de toutes les étapes de la procédure, y compris celle du jugement.
Ce calendrier ne doit pas se limiter à un simple énoncé de dates. Il doit procéder, pour être efficace, d’une collaboration volontaire et étroite entre les avocats et le juge et résulter d’une action concertée au sein des juridictions.
Sans bouleverser les règles du procès civil, il conduit à un travail en commun qui impose que chacun connaisse tous les éléments du dossier à chaque étape de son traitement et puisse, en quelque sorte, anticiper l’évolution de la mise en état.
En impliquant davantage les auxiliaires de justice, ce dispositif innovant permet indubitablement de raccourcir les délais de procédure en supprimant les audiences formelles de mise en état et en éliminant les temps morts.
L’article 781 prévoit d’ailleurs, spécifiquement les conditions dans lesquelles ce calendrier peut être modifié, afin qu’il ne reste pas seulement indicatif.
Les délais fixés dans le calendrier peuvent, en effet, être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée. À défaut, il conviendra de prononcer la radiation de l’affaire.
2. L’orientation du procès
Le juge de la mise en état a pour mission principale d’adopter toutes les mesures utiles pour que l’affaire soit en état d’être jugée.
À cette fin, il est investi du pouvoir de développer l’instance, soit d’orienter le procès dans son organisation, mais également dans son contenu.
🡺Sur l’orientation du procès quant à son organisation
- La jonction et la disjonction d’instance
- L’article 783 du CPC autorise le Juge de la mise en état à procéder aux jonctions et disjonctions d’instance.
- La jonction d’instance se justifie lorsque deux affaires sont connexes, soit, selon l’article 367 du CPC, « s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
- L’examen de la jurisprudence révèle que ce lien sera caractérisé dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
- Le lien de connexité peut donc tenir, par exemple, à l’identité des parties ou encore à l’objet de leurs prétentions.
- Réciproquement, il conviendra de disjoindre une affaire en plusieurs lorsqu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que certains points soient jugés séparément.
- Ainsi, le Juge de la mise en état dispose-t-il du pouvoir d’élargir ou de réduire le périmètre du litige pendant devant lui.
- L’invitation des parties à mettre en cause tous les intéressés
- L’article 786 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige. »
- Cette disposition n’est qu’un rappel de l’article 332 du CPC qui relève d’une section consacrée à l’intervention forcée.
- Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
- La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation (Art. 331 CPC) ;
- La mise en cause pour jugement commun (Art. 331 CPC) :
- L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée (Art. 334 et s.).
- L’article 333 du CPC prévoit que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
- Lorsque le Juge de la mise en état invite les parties à mettre en cause un tiers, il ne peut pas les y contraindre : il ne peut qu’émettre une suggestion.
- Constater la conciliation des parties et homologuer des accords
- L’article 785 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. »
- En pareil cas, il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
- La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
- Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
- Désigner un médiateur
- Innovation du décret du 11 décembre 2019, l’article 785, al. 2 du CPC autorise le Juge de la mise en état à désigner un médiateur.
- Cette désignation s’opérera dans les conditions de l’article 131-1 du CPC qui prévoit que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
- Cette désignation ne pourra donc intervenir qu’à la condition d’avoir recueilli le consentement des parties.
- La mission du médiateur consistera alors à assister les parties dans une recherche mutuelle de résolution du litige.
- Orienter les parties vers une audience de règlement amiable
- Nouveauté introduite par le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, l’article 785, al. 4e du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 ».
- Ainsi, à tous les stades de l’instruction de l’affaire, les parties peuvent être invitées par le juge ou de leur propre initiative à tenter de trouver un compromis dans le cadre d’une audience de règlement amiable.
- Si elles parviennent à un accord, elles peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater cet accord, dans les conditions des articles 130 et 131, al. 1er du CPC.
- En application de ces dispositions, la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties, le greffier et le juge.
- Les extraits de ce procès-verbal délivrés par le greffe valent titre exécutoire en application de l’article 131 du CPC.
- Dans l’hypothèse où un accord serait trouvé après la tenue de l’audience de règlement amiable, les parties peuvent le soumettre à l’homologation du juge de la mise en état.
🡺Sur l’orientation du procès quant à son contenu
- L’invitation des parties à préciser leurs positions
- L’article 782 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768. »
- Cette prérogative dont est investi le juge de la mise en état a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
- Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
- De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
- L’invitation des parties à communiquer des pièces
- Dans le droit fil de son pouvoir d’inviter les parties à préciser leurs positions respectives, le juge de la mise en état peut exiger que l’original ou une des pièces visées dans leurs écritures lui soient communiqués (art. 782 CPC)
- Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
- À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
- L’audition des parties
- Autre prérogative conférée au juge de la mise en état, l’article 784 prévoit qu’il « peut, même d’office, entendre les parties. »
- En toute hypothèse, cette audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
- Le juge de la mise en état pourra être tenté d’auditionner les parties, soit pour obtenir des précisions orales sur un moyen de fait ou de droit qui a retenu son attention, soit lorsqu’il considérera qu’une conciliation est possible
B) Les pouvoirs juridictionnels
Le juge de la mise en état n’est pas seulement investi du pouvoir de contrôler et d’organiser l’instance, il lui incombe également de régler toutes les difficultés qui surviennent en son cours.
Il ne s’agira pas ici pour le juge de la mise en état d’adopter des mesures d’administration judiciaires dont la finalité est d’assurer le bon déroulement de l’instance, mais de rendre des décisions à caractère juridictionnel, lesquels vise à trancher une contestation ou un incident.
Le juge de la mise en état est investi du pouvoir de rendre des décisions à caractère juridictionnelles que l’on peut classer en deux catégories
- Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au provisoire
- Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au principal
Tandis que les premières s’imposent aux parties dans l’attente que le litige soit tranché au fond, les secondes sont définitives, en ce sens que le juge ne peut pas être saisi ultérieurement pour les mêmes fins.
1. Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au provisoire
Ces décisions sont donc celles qui ne lient pas le juge du fond saisi ultérieurement ou concomitamment pour les mêmes fins.
Les parties disposent donc de la faculté de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont l’objet est identique à celui sur lequel le juge de la mise en état s’est prononcé.
Quant au juge statuant au fond, il n’est nullement tenu de statuer dans le même sens que la décision rendue par le Juge de la mise en état, ni même de tenir compte de la solution adoptée qui, par nature, est provisoire.
En résumé, lorsqu’il est statué au provisoire, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge de la mise en état, ni par les déductions qu’il a pu en faire, ni par sa décision.
Au nombre des pouvoirs juridictionnels du Juge de la mise en état qui l’autorisent à statuer au provisoire on peut distinguer ceux qu’il détient en propre, de ceux qu’il emprunte au Juge des référés
🡺Les pouvoirs propres du Juge de la mise en état
On recense plusieurs pouvoirs autorisant le Juge de la mise à statuer au provisoire que l’article 789 du CPC lui confère en propre :
- Les pouvoirs relatifs à la production de pièces
- L’article 788 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
- Cette disposition lui confère donc le pouvoir de statuer selon les règles communes à toutes les procédures énoncées aux articles 132 du CPC.
- Ainsi, en application de ces règles, le juge peut, par exemple enjoindre à une partie, sous astreinte, de communiquer une pièce (art. 133 CPC).
- Il peut encore, toujours sous astreinte, fixer le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication (art. 134 CPC).
- Enfin, il peut également écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (art. 135 CPC).
- Les pouvoirs relatifs à l’adoption de mesures d’instruction
- L’article 789, 5° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. »
- De toute évidence, cette disposition fait directement écho aux articles 143 et suivants du CPC qui régissent les mesures d’instruction susceptible d’être prises dans le cadre du procès civil
- En particulier, l’article 143 du CPC dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
- L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
- En application de ces textes, le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction.
- Dans la mesure où la loi ne pose aucune limite, les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient légalement admissibles.
- Ces mesures peuvent consister en :
- La désignation d’un expert
- La désignation d’un huissier de justice
- La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers
- L’article 147 du CPC l’autorise à conjuguer plusieurs mesures d’instruction.
- Il peut ainsi, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
- Le juge peut encore accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
- Bien qu’il dispose de toute latitude pour prescrire des mesures d’instruction, l’article 147 du CPC intime au Juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
- Les pouvoirs relatifs à l’allocation de provisions ad litem
- L’article 789, 2° autorise le juge de la mise en état à allouer une provision pour le procès
- L’octroi de cette provision ad litem (en vue du procès) vise à permettre à une partie, en situation de difficultés financières, de faire face à certains coûts de l’instance, tels que, par exemple, les frais d’expertise.
- Les pouvoirs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles
- L’article 790 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
- Cette prérogative lui a été conférée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005
- S’agissant des dépens ce sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire
- S’agissant des frais irrépétibles, ils se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du nouveau Code de procédure civile.
- Le pouvoir dont est investi le juge de la mise en état, l’autorise à statuer sur les frais de l’instance dont il a pu constater l’extinction mais également sur les frais exposés par les parties aux fins de mettre en œuvre les mesures conservatoires, provisoires ou d’instruction prononcées.
- Si, par principe, lorsque le Juge de la mise en état statue sur les dépens et les frais irrépétibles sa décision est seulement assortie de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il en va autrement lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure ou des incidents d’instance.
🡺Les pouvoirs empruntés au Juge des référés
À l’examen, plusieurs pouvoirs conférés par l’article 789 du CPC au juge de la mise en état sont semblables à ceux dont est investi le juge des référés.
Cette disposition précise néanmoins que, dès lors que le juge de la mise en état est saisi, il dispose d’une compétence exclusive de toute intervention du Juge des référés.
Autrement dit, la désignation d’un Juge de la mise en état fait obstacle à la saisie du Juge des référés.
L’article 789, al.1er précise expressément que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour exercer un certain nombre de pouvoirs, dont ceux qu’il emprunte au Juge des référés.
Dans un arrêt du 10 novembre 2010, la Cour de cassation a toutefois nuancé la règle en affirmant que son monopole est circonscrit à l’objet du litige dont le Tribunal est saisi au fond (Cass. 2e civ. 10 nov. 2010, n°09-17.147).
Par ailleurs, si le juge des référés a été saisi avant la nomination du juge de la mise en état il demeure compétent.
L’article 789 du CPC confère, en effet, une compétence exclusive à ce dernier uniquement « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation ».
Autrement dit, dès lors qu’il est saisi en premier, les parties n’ont d’autre choix que de s’en remettre au Juge de la mise en état, quand bien même leur demande serait susceptible de relever de la compétence du Juge des référés.
En tout état de cause, le Juge de la mise en état emprunte au Juge des référés un certain nombre de pouvoirs énoncés à l’article 789 du CPC :
- Allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- Ce pouvoir du Juge de la mise en état rejoint la prérogative conférée par l’article 835, al. 2 du CPC au juge des référées
- Pour mémoire, cette disposition prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
- Pareillement à l’article 835, al. 2e du CPC l’article 789, 3° du CPC subordonne la demande d’une provision à l’absence d’obligation sérieusement contestable.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « obligation sérieusement contestable ».
- L’existence d’une obligation une obligation sérieusement contestable doit se comprendre comme l’interdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait qu’il tranche une question au fond.
- En d’autres termes le prononcé de la mesure sollicité ne doit, en aucun cas, préjudicier au principal.
- La contestation sérieuse s’oppose ainsi à ce qui est manifeste et qui relève de l’évidence.
- À cet égard, la contestation sera qualifiée de sérieuse toutes les fois qu’il s’agira :
- Soit de trancher une question relative au statut des personnes
- Soit de se prononcer sur le bien-fondé d’une action en responsabilité
- Soit d’interpréter ou d’apprécier la validité un acte juridique
- Lorsque l’absence d’obligation sérieusement contestable est établie, le juge intervient dans sa fonction d’anticipation, en ce sens qu’il va faire produire à la règle de droit substantiel objet du litige des effets de droit.
- D’où la faculté dont il dispose d’allouer une provision, en prévision du jugement à intervenir.
- Aussi lorsque l’obligation invoquée sera sérieusement contestable, le pouvoir du Juge de la mise en état sera cantonné à l’adoption de mesures conservatoires.
- Autre élément qui rapproche le Juge de la mise en état du Juge des référés, l’article 789 du CPC prévoit, dans les mêmes termes que l’article 489 relatif à l’ordonnance de référé, qu’il peut « subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 »
- À cet égard, l’article 517 du Code de procédure civile précise que « l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
- La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
- Par ailleurs, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
- En outre, le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires
- L’article 789, 4° du CPC prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées »
- Ce pouvoir du Juge de la mise en état se rapproche très étroitement de l’office du Juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement des articles 834 ou 835, al. 1er du CPC.
- Tous les deux sont investis du pouvoir d’adopter des mesures conservatoires.
- La mesure conservatoire est à l’opposé de la mesure d’anticipation, en ce qu’elle ne doit pas consister à anticiper la décision au fond.
- Plus précisément, il s’agit de mesures qui, en raison de l’existence d’un différend, doivent permettre d’attendre la décision au principal
- La mesure prononcée sera donc nécessairement éloignée des effets de la règle de droit substantielle dont l’application est débattue par les parties.
- Elle peut consister en la suspension de travaux, en la désignation d’un administrateur judiciaire pour une personne morale, en la désignation d’un séquestre etc.
- Ainsi, la mesure prise ne consistera pas à anticiper la décision rendue au fond, mais seulement à geler une situation conflictuelle dans l’attente qu’il soit statué au principal sur le litige.
- La ressemblance entre les prérogatives du Juge de la mise en état et du juge des référés en matière de mesures provisoires se renforce à la lecture des articles 789, 4° in fine et 488 du CPC qui les autorisent respectivement à « modifier ou compléter » des mesures qui auraient déjà été ordonnées soit par eux-mêmes, soit par un autre juge statuant au provisoire « en cas de survenance d’un fait nouveau ».
2. Les décisions à caractère juridictionnel assorties de l’autorité de la chose jugée au principal
Le pouvoir que le Code de procédure civile confère au Juge de la mise en état ne se limite pas à statuer au provisoire. Il est également investi du pouvoir de rendre des décisions assorties de l’autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi, certaines décisions prises par le Juge de la mise en état, sont rendues par lui à titre définitif. Pour ces décisions, le Code de procédure civile lui confère un pouvoir exclusif.
Il ressort de l’article 789, 1° du CPC que tel est le cas lorsqu’il statue sur les exceptions de procédures et les incidents d’instance.
Quant aux fins de non-recevoir, si depuis la réforme de la procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur elles, elles restent soumises à un régime spécifique.
a. Les décisions du Juge de la mise en état relatives aux exceptions de procédure et aux incidents d’instance
i. Principe
L’article 789, 1° du CPC dispose, en effet, que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge »
Il ressort de cette disposition que le Juge de la mise en état est donc investi du pouvoir de connaître des exceptions de procédure et des incidents d’instance.
🡺Les exceptions de procédure relevant du pouvoir du Juge de la mise en état
L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Il ressort de cette définition que l’exception de procédure se distingue très nettement de la défense au fond et des fins de non-recevoir.
L’exception de procédure s’oppose à la défense au fond car elle ne repose pas sur une contestation du bien-fondé de la prétention du demandeur, mais porte uniquement sur la procédure dont elle a pour objet de paralyser le cours.
L’exception de procédure se distingue également de la fin de non-recevoir, en ce qu’elle est constitutive d’une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure ; elle affecte la validité de la procédure, alors que la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir et atteint l’action elle-même : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » (articles 32 et 122 du CPC).
Au nombre des exceptions de procédure figurent :
- Les exceptions d’incompétence
- Les exceptions de litispendance et de connexité
- Les exceptions dilatoires
- Les exceptions de nullité
Cette liste est-elle limitative ? Selon certains auteurs, comme Serge Guinchard ou Isabelle Pétel-Teyssié, la définition de l’article 73 du CPC permet de concevoir d’autres exceptions, dès lors qu’elles tendent à la finalité énoncée par cet article.
Cette opinion a été illustrée par la jurisprudence qui a qualifié d’exception de procédure la règle « le criminel tient le civil en l’état » (Cass. 1ère civ., 28 avril 1982, n°80-16.546) en précisant que l’exception était de la nature de celle visée à l’article 108 du CPC, c’est-à-dire une exception dilatoire ou encore l’incident tendant à faire constater la caducité du jugement par application de l’article 478 du CPC procédure civile (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, n°99-17.875) ou l’incident de péremption (Cass. 2e civ., 31 janv. 1996).
S’agissant des exceptions de procédure relevant du pouvoir du Juge de la mise en état, l’article 789, 1° du CPC n’opère aucune distinction, de sorte que, en application de l’adage ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, il n’y a pas lieu de distinguer : toutes sont concernées y compris celles qui seraient découvertes par la jurisprudence.
🡺Les incidents d’instance relevant du pouvoir du Juge de la mise en état
Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.
Si le Code de procédure ne définit pas ce qu’est un incident d’instance, il les énumère.
Ainsi, au nombre des incidents d’instance figurent :
- La jonction et la disjonction d’instances
- Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances.
- Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs (art. 367 CPC).
- Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu’à l’égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes.
- L’interruption de l’instance
- Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement à compter d’une notification de ces événements faite à l’autre partie.
- Événements emportant de plein droit interruption de l’instance (art.369 CPC)
- La majorité d’une partie
- La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire
- L’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement ou liquidation judiciaires) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur
- La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
- La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable
- Événements interrompant l’instance à compter d’une notification de ces événements à la partie adverse (art. 370 CPC)
- Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible (art. 370 CPC), étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d’une société en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation.
- la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur (art. 370 CPC)
- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice (art. 370 CPC).
- La suspension de l’instance
- L’instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.
- Tel est le cas pour :
- Le sursis à statuer
- La radiation de l’affaire
- Le retrait du rôle
- L’extinction de l’instance
- Le jugement est l’issue normale de tous les procès ; cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières.
- Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.
- Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).
- Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
- L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).
- Péremption d’instance
- L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 CPC).
- En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.
- Désistement d’instance
- Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement.
- Acquiescement à la demande
- L’acquiescement est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire (art. 408 CPC).
- À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action.
- L’acquiescement à la demande doit être distingué de l’acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
- Caducité de la citation
- Par application de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. Cependant, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
- Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
S’agissant de l’article 789, 1° qui confère au Juge de la mise en état le pouvoir de connaître des incidents d’instance, comme pour les exceptions de procédure, il n’opère aucune distinction, de sorte que tous relèvent de sa compétence.
Ainsi, peut-il être amené à statuer, tant sur les incidents qui affectent la poursuite de l’instance, que ceux qui conduisent à son extinction.
ii. Régime
- Le monopole du Juge de la mise en état
- L’article 789 du CPC prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance »
- Cela signifie donc que dès lors qu’il est désigné, le Juge de la mise en état est investi d’un monopole : tant qu’il est saisi les exceptions de procédure et les incidents d’instance ne peuvent être tranchés que par lui « à l’exception de toute autre juridiction ».
- Ce monopole qui portait d’abord sur les exceptions dilatoires a, par suite, été étendu à toutes les exceptions de procédure (décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998), puis aux incidents d’instance (décret n° 2004-836 du 20 août 2004)
- Pour comprendre le sens de cette exclusivité de la compétence du juge en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents d’instance, il convient de se remémorer que l’institution du juge de la mise en état avait pour objet de permettre de purger la procédure des incidents avant son renvoi à l’audience, afin que le tribunal n’ait à juger que le fond du droit.
- Reste que si le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance tant qu’il est saisi, encore faut-il que les parties décident de lui faire trancher cette catégorie d’incidents sans attendre que l’incident soit jugé avec le fond de l’affaire, par le tribunal.
- Pour pallier cette difficulté, il a donc été décidé que les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance devaient être tranchés immédiatement.
- Aussi, afin que la clôture de la mise en état produise un effet de purge des exceptions de procédure, l’article 789 du CPC oblige les parties, à peine d’irrecevabilité, à soulever les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance devant le juge de la mise en état, qui les tranchera.
- Cette obligation ne vise évidemment pas les exceptions et incidents qui surviendraient postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
- Les limites du monopole du Juge de la mise en état
- Si, l’article 789 du CPC confère une compétence exclusive au Juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents d’instance, il précise que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
- Cela signifie que le dessaisissement du juge de la mise en état a pour effet d’interdire aux parties de soulever des exceptions de procédure et des incidents instance.
- Pratiquement, les parties seront donc irrecevables à s’en prévaloir, sauf à établir qu’elles se sont révélées postérieurement au dessaisissement du Juge de la mise en état.
- Par principe, la formation de jugement n’a donc pas vocation à connaître les exceptions de procédure et les incidents d’instance qui doivent toutes avoir été purgées lors de l’instruction de l’affaire.
b. Les décisions du Juge de la mise en état relatives aux fins de non-recevoir
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative : des fins de non-recevoir nombreuses existent en droit de la famille (procédure de réconciliation des époux dans la procédure de divorce, filiation…), en matière de publicité foncière (fin de non-recevoir pour non-publication de la demande au bureau des hypothèques, dans les actions en nullité ou en résolution affectant des droits immobiliers – décret 4 janvier 1955, art 28), en matière de surendettement des particuliers (absence de bonne foi du demandeur).
Tandis que l’exception de procédure est une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure qui affecte la validité de la procédure, la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir : elle affecte l’action elle-même, la justification même de l’acte.
Au nombre des fins de non-recevoir figurent, celles énoncées par l’article 122 du CPC que sont :
- Le défaut de qualité
- Le défaut d’intérêt
- La prescription
- Délai préfix
- Chose jugée
Les fins de non-recevoir relèvent-elles du pouvoir du Juge de la mise en état ? Tandis que la jurisprudence répondait négativement à cette question jusqu’à la réforme de la procédure civile, le législateur est venu modifier la règle par l’adoption du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
i. Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, les fins de non-recevoir n’étaient pas visées par l’ancien l’article 771, 1° du Code de procédure civile, devenu l’article 789, 1°.
On en déduisait, par voie de conséquence, qu’elles échappaient purement et simplement à l’office du Juge de la mise en état.
Dans un avis du 13 novembre 2006, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « les incidents mettant fin à l’instance visés par le deuxième alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n’incluent pas les fins de non-recevoir ».
Manifestement, cet avis a été diversement accueilli par la doctrine.
Un auteur a, par exemple, estimé que la mise en état rénovée par le décret du 28 décembre 2005 « doit permettre de traiter les exceptions et fins de non-recevoir afin que seul le fond de l’affaire soit évoqué lors d’une audience de plaidoiries » (E. Bonnet,Gaz. Pal. du 1er au 5 janvier 2006, p. 9 et 10)
Par ailleurs, pour M. Beauchard, le Juge de la mise en état « est dorénavant compétent pour statuer non seulement sur les exceptions de procédure, mais également sur les fins de non-recevoir qui ont pour effet, lorsqu’elles sont admises, de mettre fin à l’instance (défaut d’intérêt ou de qualité pour agir, autorité de la chose jugée, prescription) ».
Biens que certains auteurs se soient ainsi élevés contre cette exclusion des fins de non-recevoir de la sphère de compétence du Juge de la mise en état, la Cour de cassation n’est jamais revenue sur sa position, ce dont se félicitait la doctrine majoritaire.
En effet, les fins de non-recevoir constituent des moyens de défense définis au titre V du livre premier du CPC. Elles sont donc différentes des incidents d’instance définis au titre XI.
Permettre au juge de la mise en état de statuer sur ces moyens de défense reviendrait donc, selon les auteurs, à les assimiler aux incidents d’instance alors qu’ils n’ont pas le même statut juridique, ce qui est contraire à la logique intellectuelle et juridique du CPC.
L’article 123 du CPC permet de proposer une fin de non-recevoir en tout état de cause. Or admettre que le Juge de la mise en état puisse statuer sur celle-ci, conduirait à neutraliser cette règle, la fin de non-recevoir ne pouvant plus, une fois tranchée, être invoquée devant la formation de jugement.
Aussi, comment concilier l’article 123 du CPC avec le pouvoir exclusif du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir ?
Dire que les fins de non-recevoir constituent des incidents mettant fin à l’instance au sens de l’article 789,1° du CPC aurait pour conséquence d’introduire une disparité de traitement entre les procédures avec mise en état et les procédures sans mise en état où les fins de non-recevoir pourraient continuer à être proposées en tout état de cause. Il paraît difficile de faire de l’article 123 un article à géométrie variable.
À cet égard, on peut noter que dans la circulaire du 8 février 2006, la chancellerie avait repris les termes du décret pour dire que le juge de la mise en état est désormais seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
La question de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir lui avait été précisément posée.
Elle avait alors répondu dans les termes suivants dans un document du 14 avril 2006 intitulé « Réflexions sur le décret du 28 décembre 2005 ».
« Non, les compétences dévolues au juge de la mise en état par le premier alinéa de l’article 771 du nouveau code de procédure civile portent exclusivement sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les fins de non-recevoir sont distinctes des incidents mettant fin à l’instance. Elles tendent à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Elles recouvrent notamment le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription et la chose jugée et peuvent être soulevées en tout état de cause. Elles sont susceptibles de régularisation. Une nouvelle instance pourra toujours être réintroduite suite à un jugement ayant admis une fin de non-recevoir.
Les incidents mettant fin à l’instance sont énumérés aux articles 384 et 385 du nouveau code de procédure civile. Il s’agit de la transaction, de l’acquiescement, de la péremption, de la caducité, du désistement et du décès d’une partie. Ils ne sont pas sanctionnés par l’irrecevabilité de l’action mais par l’extinction de l’instance en raison d’un événement de la volonté ou de la négligence des parties. Ils ne sont pas susceptibles de régularisation. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une action introduite après une décision déclarant l’instance éteinte.
Le juge de la mise en état n’est donc pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les premières décisions rendues sur la question par les juges du fond se sont prononcées majoritairement pour une impossibilité du juge de la mise en état de statuer sur les fins de non- recevoir (TGI Toulouse, ord. JME, 1er ch., 12 avril 2006, RG 03/01865).
Par exemple, un conseiller de la mise en état ne s’est pas reconnu le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité d’un appel-nullité en matière de procédures collectives car « les notions d’exceptions de procédure et d’incidents mettant fin à l’instance doivent être appréciées au regard des définitions données par le nouveau code de procédure civile et ne sauraient englober les défenses au fond et les fins de non-recevoir, et ne sauraient s’entendre au sens large d’incidents de mise en état » (CA Toulouse, ord. CME, 2ème ch., 15 mars 2006, RG 05/04909).
Plusieurs autres décisions ont statué dans le même sens (V. en ce sens CA Rouen, ord. CME, 3avril 2006, RG 05/02395 ; CA Montpellier, ord. CME, 29 mars 2006, RG 05/02183).
Reste que le législateur a entendu revenir sur cette position de la jurisprudence en conférant au Juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir
ii. Réforme de la procédure civile
🡺L’extension des pouvoirs du Juge de la mise en état
L’article 789, 6° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. »
Le décret du 11 décembre 2019 a ainsi opéré une extension des pouvoirs du Juge de la mise en état qui peut désormais connaître des fins de non-recevoir.
Cette innovation est présentée par le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile comme visant à désencombrer le rôle des affaires dont les conditions d’introduction compromettent leur examen au fond ou qui apparaissent manifestement irrecevables.
Pour que la faculté de statuer sur les fins de non-recevoir reconnue au Juge de la mise en état soit cohérente avec les termes de l’article 123 du CPC qui détermine le régime des fins de non-recevoir, il est désormais précisé que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement »
Tel est donc le cas, lorsque l’affaire fait l’objet d’une mise en état dans le cadre de la procédure écrite pendante devant le Tribunal judiciaire.
🡺Régime
- Le monopole du Juge de la mise en état
- En application du 1er alinéa de l’article 789 du CPC, le juge de la mise en état est, en principe, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
- Cela signifie donc que dès lors qu’il est désigné, le Juge de la mise en état est investi d’un monopole : tant qu’il est saisi les exceptions de procédure et les incidents d’instance ne peuvent être tranchés que par lui « à l’exception de toute autre juridiction ».
- Reste que si le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir tant qu’il est saisi, encore faut-il que les parties décident de lui faire trancher cette catégorie d’incidents sans attendre que l’incident soit jugé avec le fond de l’affaire, par le tribunal.
- Pour pallier cette difficulté, il a donc été décidé que les fins de non-recevoir devaient être tranchés immédiatement.
- Aussi, afin que la clôture de la mise en état produise un effet de purge des fins de non-recevoir à l’instar des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l’instance, l’article 789, al. 3e du CPC oblige les parties, à peine d’irrecevabilité, à soulever les fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, qui les tranchera.
- Cette obligation ne vise évidemment pas les fins de non-recevoir qui surviendraient postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
- Reste que, comme relevé par Mehdi Kebir, « les parties sont désormais textuellement soumises à un principe de concentration des fins de non-recevoir devant le magistrat instructeur. Le changement est notable et s’inscrit dans la continuité d’une solution dont les jalons ont déjà été posés en jurisprudence en ce qui concerne le conseiller de la mise en état ».
- Les limites du monopole du Juge de la mise en état
- L’article 789, 2e du CPC envisage l’hypothèse où l’examen de la fin de non-recevoir par le Juge de la mise en état nécessite qu’il tranche au préalable une question de fond.
- Doit-il se désister à la faveur de la juridiction de jugement ou peut-il se prononcer sur la question de fond qui, en principe, ne relève pas de sa compétence ?
- Le décret du 11 décembre 2019 a répondu à cette interrogation en posant un principe qu’il a assorti d’exceptions.
- Principe
- L’article 789, al. 2 du CPC pose que « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. »
- Ainsi, le juge de la mise en état se voit-il conférer le pouvoir de trancher une question de fond, lorsque de son examen dépend l’appréhension de la fin de non-recevoir.
- Exceptions
- Par exception, la question de fond et la fin de non-recevoir peuvent être tranchées par la formation de jugement :
- Soit à la demande des parties
- L’article 789 al. 2 dispose que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer.
- Ainsi lorsque dans la phase du jugement c’est une formation collégiale de la juridiction qui a vocation à connaître de l’affaire, les parties peuvent contraindre le Juge de la mise en état à renvoyer l’affaire devant une formation de jugement.
- Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 789, le texte précise le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
- Le texte invite alors la formation de jugement à statuer sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond.
- Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
- Soit à l’initiative du Juge de la mise en état
- Le renvoi devant la formation de jugement peut également être provoqué par le Juge de la mise en état lui-même, s’il l’estime nécessaire.
- Dans la mesure où il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire, comme précisé par l’article 789, cette décision de renvoi est insusceptible d’une voie de recours.
- Si la formation de jugement estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher au préalable la question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir elle peut renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état.
- En tout état de cause, l’article 789 dispose que lorsque le juge de la mise en état ou la formation de jugement sont amenés à statuer sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir, ils doivent le faire par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement.
C) Les décisions du Juge de la mise en état
1. La forme des décisions du Juge de la mise en état
Les décisions prises par le Juge de la mise en état sont susceptibles de prendre trois formes différentes, selon leur nature :
🡺Principe : une simple mention au dossier
L’article 792 du CPC prévoit que, par principe, les mesures prises par le Juge de la mise en état font l’objet d’une simple mention au dossier, laquelle mention est assortie d’un avis donné aux avocats.
Il en va notamment ainsi des mesures tenant à :
- La détermination du calendrier procédurale (octroi de délais, prorogation, injonctions etc..)
- L’invitation des parties à répondre à un moyen de fait ou de droit
- L’audition des parties
- L’instruction du dossier
- La jonction et la disjonction d’instance
À cet égard, l’article 771 du CPC prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire.
🡺Exception : l’ordonnance
L’alinéa 2 de l’article 792 apporte un tempérament au principe posé par l’alinéa 1er : « dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction. »
Il ressort de cet alinéa qu’il est des cas où la décision prise par le Juge de la mise en état requiert qu’il rende une ordonnance.
Bien que l’article 792 ne le dise pas, il convient de distinguer les mesures qui exigent l’établissement d’une ordonnance motivée de celles qui ne le requièrent pas.
- Les décisions exigeant l’établissement d’une ordonnance simple
- Au nombre des mesures qui ne requiert pas l’établissement d’une ordonnance motivée figurent :
- La décision constatant et homologuant l’accord des parties
- La décision prononçant la clôture totale ou partielle de l’instruction.
- Les décisions exigeant l’établissement d’une ordonnance motivée
- Les décisions qui requièrent l’établissement d’une ordonnance motivée sont celles visées aux articles 787 à 790 du CPC, soit :
- Les décisions qui constatent l’extinction de l’instance
- Les mesures tenant à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
- Les décisions relatives aux exceptions de procédure
- Les décisions relatives aux incidents d’instance
- Les décisions relatives à l’octroi d’une provision ad litem
- Les décisions relatives à l’octroi d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- Les décisions relatives à l’adoption de mesures provisoires ou conservatoires
- Les décisions relatives à toute mesure d’instruction
- Les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
2. L’exécution des décisions du Juge de la mise en état
L’article 514 du CPC prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Les décisions rendues en première instance sont donc, par principe, assorties de l’exécution provisoire.
C’est là une nouveauté – importante sinon marquante – de la réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Sous l’empire du droit antérieur, le principe était que, pour bénéficier de l’exécution provisoire, les parties devaient en faire la demande au juge, faute de quoi l’effet suspensif de l’appel faisait obstacle à toute exécution de la décision rendue.
Désormais, le principe est inversé : la décision rendue en première instance doit être exécutée par la partie qui succombe.
L’article 514-1 CPC pose néanmoins une limite à ce principe lorsque l’exécution provisoire est de droit :
Le texte prévoit, en effet, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’alinéa 3 de l’article 514-1 tempère toutefois cette faculté de neutralisation de l’exécution provisoire en disposant que le juge ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
S’agissant des décisions rendues par le Juge de la mise en état, il ressort de cette disposition qu’il convient de distinguer deux sortes de décisions rendues par lui :
- Les décisions qui intéressent l’adoption de mesures provisoires, conservatoires ou qui allouent une provision à l’une des parties
- Pour ces décisions, elles sont assorties de l’exécution provisoire de plein droit, sans que le Juge de la mise en état ne puisse la neutraliser.
- Les décisions qui n’intéressent pas l’adoption de mesures provisoires, conservatoires ou qui allouent une provision à l’une des parties
- Pour ces décisions, si elles sont également assorties de l’exécution provisoire de plein droit, et c’est une nouveauté, le Juge de la mise en état pourra écarter l’exécution provisoire à la condition toutefois qu’il soit établi qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
- Il pourra statuer sur le maintien de l’exécution provisoire, soit d’office, soit à la demande d’une partie.
3. Les voies de recours contre les décisions du Juge de la mise en état
Les voies de recours contre les décisions prises par le Juge de la mise en état diffèrent selon la nature des décisions contestées.
🡺Pour les décisions qui font l’objet de l’inscription d’une simple mention au dossier
Il s’agit de mesures d’administration judiciaire, en conséquence de quoi elles sont insusceptibles de voies de recours (art. 537 CPC).
Cela signifie que ces mesures ne peuvent être déférées, ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation.
Quant à la voie de recours exercée, toutes sont concernées qu’il s’agisse de l’appel ou de l’opposition.
🡺Pour les décisions qui font l’objet de l’établissement d’une ordonnance
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que l’appel est la seule voie de recours ouverte contre les décisions du Juge de la mise en état, à tout le moins pour celles qui ne sont pas constitutives d’une mesure d’administration judiciaire.
L’article 795, al. 1er prévoit en ce sens que « les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. »
Quant au pourvoi en cassation, il ne peut être formé qu’une fois rendu le jugement statuant au fond (art. 795, al. 2 CPC).
L’appel, quant à lui, peut être exercé selon des modalités différentes, selon la nature de la décision prise par le Juge de la mise en état.
À cet égard, il convient de distinguer les décisions qui sont susceptibles de faire l’objet d’un appel immédiat, de celles qui ne peuvent être frappées que d’une voie de recours différée.
- Principe : l’appel différé
- L’article 795, al. 2 du CPC prévoit que lorsqu’une décision rendue par le Juge de la mise en état est susceptible d’appel, la voie de recours ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
- La conséquence en est pour les parties, qu’elles ne pourront exercer une voie de recours contre les ordonnances du Juge de la mise en état qu’après que le jugement au fond aura été rendu.
- Exceptions : l’appel immédiat
- Par exception, l’article 795, 1°, 2°, 3° et 4° prévoit que dans un certain nombre de cas, par souci de bonne administration de la justice et de célérité de l’instance, l’appel peut être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance du juge de la mise en état.
- Les décisions visées sont celles qui :
- Lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction
- Même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin qui statuent sur une exception de procédure (Cass. 2e civ. 11 juill. 2013, n°12-15.994).
- Ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
- Ont statué sur une exception de procédure (Cass. 2e civ. 14 mai 2009, n°08-10.292) ou une fin de non-recevoir.
- Le texte précise que « lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ».
- Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
- Qui ont trait aux mesures d’expertise et au sursis à statuer à la double condition que :
- D’une part, de l’obtention de l’autorisation du Premier Président de la Cour d’appel
- D’autre part, qu’il soit justifié d’un motif grave et légitime
IV) Les incidents d’instance
Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions.
À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité (suspension ou interruption), soit en ce qu’ils provoquent son extinction (péremption, désistement, acquiescement, etc.).
Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent :
- La jonction et la disjonction d’instance
- L’interruption de l’instance
- La suspension de l’instance
- L’extinction de l’instance
A) La jonction et la disjonction d’instances
Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances.
Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs (art. 367 CPC).
Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu’à l’égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes.
L’article 368 du CPC prévoit que « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Il en résulte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours.
B) L’interruption de l’instance
1. Les causes d’interruption de l’instance
Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement à compter d’une notification de ces événements faite à l’autre partie.
🡺Les événements emportant de plein droit interruption de l’instance
L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance :
- La majorité d’une partie
- La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire
- Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur
- La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle
- La décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
🡺Les événements interrompant l’instance à compter d’une notification de ces événements à la partie adverse
L’article 370 du CPC énonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnées à leur notification :
- Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d’une société en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation (Cass. com. 21 oct. 2008, n°07-19.102).
- La cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur
- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice
2. Le moment de l’interruption
L’article 371 du CPC prévoit que « en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. »
Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des débats, soit le moment où à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée, soit au demandeur, soit au juge rapporteur.
3. Les effets de l’interruption de l’instance
L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli.
Bien que le juge demeure saisi de l’affaire (art. 376 CPC), l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours (Cass. com., 17 juill. 2001, n° 98-19.258).
Surtout, l’article 372 du CPC précise que « les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue.
4. La reprise de l’instance
a. Les modalités de reprise de l’instance
🡺La reprise de l’instance initiée par les parties
L’article 373 du CPC prévoit que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense »
Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de procédure.
Cette reprise peut être impulsée, soit par la partie à la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire.
Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées :
- La reprise de l’instance est initiée par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue, elle peut être formalisée selon deux modalités différentes :
- En matière de procédure écrite, la reprise peur être engagée au moyen de la prise de conclusions
- En matière de procédure orale, la reprise pourra être déclenchée au moyen d’une déclaration du greffe de la juridiction saisie.
- La reprise de l’instance est initiée par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue
- Dans cette hypothèse, la reprise de l’instance ne pourra être effectuée que par voie de citation, selon les mêmes modalités que l’acte introductif d’instance
- À cet égard, l’article 375 du CPC précise que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire
🡺La reprise de l’instance provoquée par le Juge
L’article 376 du CPC prévoit que le juge « peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. »
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- La reprise de l’instance peut être provoquée par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les « inviter » à accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des débats, ce qui peut se traduire par la fixation de délais
- En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
- Cette faculté réservée au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrôle.
- Second enseignement
- En cas de non-respect des délais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire
- La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
- Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
- L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.
- En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
b. Les effets de la reprise de l’instance
L’article 374 du CPC dispose que « l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. »
Dans la mesure où l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption, ce délai court à nouveau à compter de la reprise de l’instance.
C) La suspension de l’instance
L’instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours.
Tel est le cas pour :
- Le sursis à statuer
- La radiation de l’affaire
- Le retrait du rôle
1. Le sursis à statuer
🡺Notion de sursis à statuer
Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer : le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif.
- S’agissant du sursis à statuer obligatoire
- Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC.
- Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit :
- Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer
- Soit d’un bénéfice de discussion ou de division
- Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
- S’agissant du sursis à statuer facultatif
- Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé
- Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance :
- Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant
- Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation
- D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal
🡺Nature du sursis à statuer
En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer.
En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents :
- Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties.
- Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance
La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même.
- Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure :
- En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer
- L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir (Art. 74 CPC).
- La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats (art. 799 in fine CPC).
- Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure.
- Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure : les voies de recours.
- L’article 794 du CPC prévoit que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
- Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée.
- Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente
- La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement
- S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ?
Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation « si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que (…) ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ».
À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance.
Certains arrêts de cours d’appel (CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622), rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif.
La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC (« délai d’attente en vertu de la loi ») et sur le rôle du juge.
- Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état.
- Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement.
Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre :
- Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose : « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit (…) d’un délai d’attente en vertu de la loi » et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure,
- Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état.
L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités :
- L’alinéa 2 : la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ;
- L’alinéa 3 : la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif.
Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état (CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819).
Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero : n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ?
Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ?
Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge.
Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer.
La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique.
Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré « la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond.
a. Les causes du sursis à statuer
Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas.
🡺Les cas de suspension visés par la loi
Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi.
- Le délai d’option successorale
- L’article 108 du CPC prévoit que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer ».
- Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte.
- L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
- Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter.
- À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois.
- Le bénéfice de discussion ou de division
- L’article 108 prévoit encore que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division », étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution.
- Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement.
- Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
- Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagés par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires.
- La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer.
- Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions.
- Le délai d’appel à un garant
- L’article 109 du CPC prévoit que « le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. »
- Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle.
- À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
- Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant.
- C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense.
- Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire
- L’article 110 du CPC prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. »
- Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer.
- Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis.
- L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive.
🡺Les cas de suspension non visés par la loi
L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »
Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte.
Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi.
L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont :
- La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif
- Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. »
- La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité
- La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »
- Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance.
- En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
- Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité.
- Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation.
- Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
- Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité.
- Le criminel tient le civil en l’état
- L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile « tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».
- Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel « le criminel tient le civil en l’état ».
- La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence.
- Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement.
- En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits.
- Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale.
- La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction (V. en ce sens Cass., civ., 11 juin 1918).
- La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était « susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile ».
- Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence.
- Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil.
- Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction.
- Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal.
b. Les effets du sursis à statuer
L’article 378 du CPC prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »
Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance :
- Soit pendant un temps fixé par le Juge
- Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé
En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé.
À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante.
Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié.
c. Les recours contre la décision de sursis à statuer
L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
2. La radiation de l’affaire
🡺Les causes de radiation du rôle
L’article 381 du CPC prévoit que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».
À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses :
- Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours (art. 801 CPC).
- Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné (art. 97 CPC)
- Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (art. 524 CPC).
- En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (art. 376 CPC)
🡺Notification de la décision de radiation
La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Cette notification vise à :
- D’une part, informer les parties de la suspension de l’instance
- D’autre part, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour engager sa reprise
🡺Les effets de la radiation du rôle
L’article 381 du CPC prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression « du rang des affaires en cours ».
Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance : elle la suspend
L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation.
En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire (art. 383 CPC), elle est insusceptible de voie de recours.
3. Le retrait du rôle
L’article 382 du CPC prévoit que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.
Pour être acceptée, la radiation est subordonnée à l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetée si la demande émane d’une seule partie.
En application de l’article 383 du CPC et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours.
L’alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf à ce que celle-ci soit périmée. Il n’est pas nécessaire que cette demande soit formulée par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigé.
La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties.
D) L’extinction de l’instance
Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.
Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).
Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).
1. Péremption d’instance
🡺Définition
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 CPC).
En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.
Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice.
La péremption d’instance vise à « sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass. com., 9 nov. 2004, n°01-16.726).
La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile.
🡺Domaine de la péremption
La péremption d’instance concerne toutes les juridictions (première instance, cour d’appel, Cour de cassation), sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils (Cass. 2e civ., 20 mai 1992, n° 90-15.496).
Elle concerne, en principe, toutes les instances.
🡺Conditions de la péremption
- Le délai
- La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties.
- Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas (Cass. 1ère civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.647).
- Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction.
- L’interruption du délai
- Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences.
- Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties (Cass. 3e civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734), et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu.
- Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré.
- Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries (Cass. 2e civ., 12 février 2004, n°01-17.565).
- De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-14.298).
- Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074).
- Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n°04-17.992), ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n°13-17.294).
- Les incidents affectant le délai de péremption
- Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance
- Il en va ainsi des événements suivants :
- L’interruption de l’instance
- L’article 392, al. 1er du CPC prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
- Ainsi, pour tous les cas d’interruption de l’instance prévus par la loi, le délai de péremption est interrompu.
- Dès lors que le délai de péremption de l’instance est interrompu, un nouveau délai ne commence pas à courir immédiatement.
- Un effet, l’interruption du délai de péremption dure aussi longtemps que l’interruption de l’instance.
- Comme indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1993, l’interruption du délai de péremption « ne prend fin que par la reprise de l’instance » (Cass. 2e civ. 5 avr. 1993, n°91-18.734).
- Autrement dit, le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la reprise de l’instance.
- Il peut être observé que lorsque l’instance a été interrompue par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’alinéa 3e de l’article 392 du CPC précise que le nouveau délai de péremption court à compter de l’extinction de cette convention.
- Lorsque, par ailleurs, l’instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, l’alinéa 4e de l’article 392 du CPC, prévoit que le nouveau délai de péremption de l’instant court, quant à lui, « à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l’affaire. »
- La suspension de l’instance
- En cas de suspension de l’instance, l’article 392, al. 2e du CPC prévoit que le délai de péremption continue à courir.
- La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption de l’instance dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.
- Par exception, la suspension de l’instance affecte le délai de péremption lorsqu’elle intervient pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
- Pour ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
🡺Procédure
- Une instance en cours
- Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause), date qui peut donc varier
- Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification (V. en ce sens Cass. 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12.259).
- Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire (Cass. 2e civ., 27 juin 1990, n° 89-14.276), et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut.
- Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée.
- Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel (Cass. 2e civ., 12 mars 1986, n° 84-16.642).
- De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge (Cass. 3e civ., 8 octobre 1997, n° 92-21.483).
- Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise (Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n°99-21.883), sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte (par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité).
- Les parties
- L’article 387 du CPC prévoit que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. »
- Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance.
- Forme de la demande
- La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations
- L’article 387, al. 2e du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
- Moment de la demande
- L’article 388 du CPC prévoit que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit »
- Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant
- Les exceptions de procédure
- Les fins de non-recevoir
- Les défenses au fond
- La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance.
- Rôle du Juge
- Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur.
- Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu’elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate que la péremption est acquise (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10.709).
🡺Effets de la péremption
- Extinction de l’instance
- L’article 389 du CPC prévoit que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
- Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite.
- Survie de l’action
- Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-20.154).
- Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir.
- Acquisition de la force jugée du jugement
- L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
- Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée.
- Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause.
- Opposabilité de la péremption d’instance
- L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
- Les frais d’instance
- L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance
- Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles.
2. Désistement d’instance
🡺Définition
Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement.
Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action
- Le désistement d’instance
- Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance.
- La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance
- Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire.
- Le désistement d’action
- Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande
- Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice
- En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé
S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition.
a. Le désistement en première instance
🡺Domaine
L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public.
🡺Conditions
- Un acte de volonté
- Principe
- L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition
- Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité
- Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur.
- S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite
- Exceptions
- Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions.
- En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté
- Soit aucune défense au fond
- Soit aucune fin de non-recevoir
- Une décision
- L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
- Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer
- D’une part, l’existence d’un accord entre les parties
- D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle
- L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties.
- Le jugement constatant l’accord (de donner acte) est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
🡺Effets
- Exception de l’instance
- L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
- La conséquence est alors double :
- Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis
- Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite.
- Les frais d’instance
- L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
- Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement
- Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public.
b. Le désistement de l’appel ou de l’opposition
🡺Domaine
À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement.
A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance.
🡺Conditions
- Les conditions de fond
- Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition
- S’agissant du désistement de l’appel
- L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition :
- Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions
- Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
- En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise.
- S’agissant du désistement de l’opposition
- L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
- À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse
- À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise.
- Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse.
- Les conditions de forme
- Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite
- De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies.
🡺Effets
Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets :
- Premier effet
- Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance.
- L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse.
- Deuxième effet
- Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement.
- Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’« il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »
- Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement.
- Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui.
- Troisième effet
- Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
3. L’acquiescement
🡺Notion
Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement
- S’agissant de l’acquiescement à la demande
- C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire (art. 408 CPC).
- À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action.
- S’agissant de l’acquiescement au jugement
- Il se distingue de l’acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours.
- L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel.
🡺Conditions
- Conditions communes
- Principe : un acte de volonté
- Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir.
- L’article 410, al. 1er du CPC prévoit que l’acquiescement peut être exprès ou implicite
- Exception : l’effet de la loi
- L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
- Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement :
- D’une part, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assortie de l’exécution provisoire
- D’autre part, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision.
- Conditions spécifiques
- S’agissant de l’acquiescement à la demande
- L’article 408 dispose qu’« il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
- Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l’article 323 du Code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractère d’ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles.
- S’agissant de l’acquiescement au jugement
- L’article 409 du CPC prévoit qu’« il est toujours admis sauf disposition contraire » en premier et dernier ressort
- S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement.
- Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que « un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. »
🡺Effets
- L’acquiescement à la demande
- Il produit deux effets majeurs
- D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondé des prétentions de son adversaire
- D’autre part, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l’instance.
- L’acquiescement au jugement
- Il emporte
- D’une part, soumission aux chefs de la décision
- L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu
- D’autre part, renonciation aux voies de recours
- Dans l’hypothèse, toutefois où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement.
- En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle (Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21.061)
4. Caducité de la citation
🡺Généralités
La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé.
En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoquerait « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ».
D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ». L’idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.
🡺Caducité et nullité
C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.
🡺La caducité en matière civile
Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie ou la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.
Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s’estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution » si bien que l’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé.
🡺La caducité en matière procédurale
Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil, tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction.
En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi.
À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance.
Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai.
a. Les causes de caducité
Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice
- La caducité pour défaut de saisine du Juge
- Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses
- En première instance
- L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte (2 mois ou 15 jours).
- Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (Cass. 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14.443).
- Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe (art. 843 CPC).
- En appel
- La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité.
- En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité.
- Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci.
- La caducité pour défaut de comparution
- La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation.
- Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée.
- L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables :
- Première alternative
- Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
- Seconde alternative
- Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
- La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
- Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
- La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité
- L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables :
- Première Alternative
- Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
- Seconde alternative
- Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque
- Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur.
b. Le prononcé de la caducité
🡺Décision
- L’indifférence de l’établissement d’un grief
- Le pouvoir du juge
- Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité
- La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge
- Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office
- En première instance
- L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
- Il en va de même pour la procédure à jour fixe (art. 843 CPC).
- En appel
- Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement.
- La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office (Cass. 2e Civ., 26 juin 2014, n°13-20.868).
- Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief.
- La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur
- L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation.
- Il s’agit néanmoins d’une simple faculté
- Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur
- La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité
- Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation.
- L’article 469 dispose en ce sens que « le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. »
- Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision.
🡺Voies de recours
L’article 407 du CPC prévoit que « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. »
Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation.
S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable.
c. Les effets de la caducité
Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets :
- Pour l’avenir
- Pour le passé
🡺Pour l’avenir : extinction de l’instance
Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire.
Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. »
Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement.
L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que « la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
🡺Pour le passé : anéantissement rétroactif des actes de procédure
Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, « dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution ».
C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet.
Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs : elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale.
Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer « une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé ».
Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal « qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé ».
Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est « justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme ». En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif.
Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives.
À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis.
Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue.
Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusée à procéder à pareille assimilation. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive.
Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’« interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif.
Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation.
Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif.
V) La clôture de l’instruction
La clôture de l’instruction intervient lorsque le Juge de la mise en état rend ce que l’on appelle une ordonnance de clôture. Cette ordonnance est issue de la réforme engagée en 1975 par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau Code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 1976.
L’ordonnance de clôture a été institué afin de mettre fin aux abus des plaideurs qui consistaient à communiquer à l’adversaire ses pièces à la dernière heure avant l’audience, ce qui n’était pas sans contrevenir au principe du contradictoire.
À cet égard, dans son article « La réforme du code de procédure civile par le décret du 13 octobre 1965 et les principes directeurs du procès », Henri Motulsky rappelant la pratique des prétoires sous le régime du juge chargé de suivre la procédure, déplorait que l’affaire ne fût instruite qu’in extremis, quelques jours avant l’audience des plaidoiries sinon la veille et stigmatisait « l’usage des communications de pièces de dernière heure », « la grave altération consécutive de la loyauté du débat judiciaire », ainsi que « l’irritant appel des causes à l’audience sans être en état d’être plaidées » et même parfois, « le regrettable spectacle des audiences blanches comme des déplacements inutiles ».
Il achevait de brosser ce tableau affligeant en affirmant qu’il n’« est pas concevable qu’on impose la plaidoirie à une partie qui vient seulement d’avoir connaissance, tant du véritable système d’argumentation de son adversaire que des documents essentiels destinés à l’appuyer ».
L’institution de la procédure de la mise en état dans sa conception actuelle a donc eu pour objet de remédier à cette situation. On ne saurait prétendre qu’elle n’y a pas apporté de remède.
Toutefois, la tentation des parties de recourir à ces pratiques dénoncées par le professeur Motulsky subsiste, tentation qui doit être contenue par l’autorité effectivement exercée par le juge, sous peine de revenir auxdites pratiques.
De toute évidence, l’instauration d’une ordonnance de clôture s’inscrit dans cette volonté de mettre un terme à des pratiques abusives des plaideurs qui étaient devenues trop fréquences.
Parce qu’elle marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, l’ordonnance de clôture a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office (article 802 CPC).
Pour cette raison, elle est une pierre angulaire de l’instance. Ajouté à cela, l’ordonnance de clôture annonce le passage de la phase écrite de la procédure à la phase orale.
À l’exception de la procédure d’urgence à jour fixe, elle est une étape incontournable pour les plaideurs qui vont être directement touchés par ses effets. Leur situation ne sera néanmoins pas figée puisqu’ils disposeront toujours, lorsque les conditions seront réunies, de la faculté de solliciter sa révocation.
A) Le prononcé de l’ordonnance de clôture
1. Les causes justifiant le prononcé de l’ordonnance de clôture
Trois situations sont susceptibles de justifier le prononcé de l’ordonnance de clôture :
- En cas de renvoi à l’audience sans que l’affaire ne fasse l’objet d’une mise en état (circuit court)
- Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée
- Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente parce que ne concluant pas dans les délais impartis
- Lorsque les parties demandent d’elles-mêmes la césure du procès
🡺Le renvoi de l’affaire à l’audience sans qu’elle fasse l’objet d’une mise en état
L’article 778 du CPC prévoit que, lors de l’audience d’orientation, l’affaire peut être renvoyée immédiatement à l’audience aux fins de jugement. C’est ce que l’on appelle le circuit court.
Il peut être opté pour ce circuit court dans plusieurs cas :
- Premier cas : l’affaire est en état d’être jugée
- L’article 778, al. 1er du CPC prévoit en ce sens que « le président renvoie à l’audience les affaires qui, d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond. »
- La question qui alors se pose est de savoir à partir de quand peut-on estimer qu’une affaire est en état d’être jugée.
- À l’évidence, tel sera le cas lorsque les parties auront pu valablement débattre sur la base de conclusions échangées et de pièces communiquées.
- Le Président devra s’assurer, avant de renvoyer l’affaire à l’audience, que le débat est épuisé et que le principe du contradictoire a été respecté.
- Aussi, le renvoi ne pourra être prononcé qu’à la condition que le défendeur ait eu la faculté de conclure, soit de répondre à l’assignation dont il a fait l’objet.
- C’est là une exigence expressément posée par l’article 778 qui précise que le renvoi ne peut avoir lieu qu’« au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées ».
- Deuxième cas : le défendeur ne comparaît pas
- L’article 778, al. 2 prévoit que le Président « renvoie également à l’audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation du défendeur. »
- Il s’infère de cette disposition que deux conditions doivent être remplies pour que le renvoi soit acquis de plein droit :
- Le défendeur ne doit pas comparaître
- L’affaire doit être en état d’être jugée
- Ainsi, le Président devra s’assurer que toutes les mesures ont été prises pour que le défendeur soit prévenu de la procédure dont il fait l’objet et qu’il ait été en mesure de constituer avocat.
- Plus précisément, il doit veiller :
- D’une part, à ce que le principe du contradictoire ait bien été respecté
- D’autre part, à ce que les éléments produits et les prétentions présentées par le défendeur soient suffisamment sérieux
- Si le Président s’aperçoit que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il peut imposer au demandeur de réassigner le défendeur.
- Troisième cas : l’instance a été introduite au moyen d’une requête conjointe
- Ce troisième cas n’est certes pas visé par l’article 758 du CPC qui traite de l’orientation de l’affaire lorsqu’elle procède du dépôt d’une requête conjointe.
- Toutefois, elle est admise par la jurisprudence qui considère que dans la mesure où les parties sont d’accord sur les termes du litige, il n’y a pas lieu à procéder à une instruction de l’affaire.
- Il est, en effet, fort probable qu’elles se soient entendues sur le dispositif de la décision sollicitée qui se traduira, la plupart du temps, par l’homologation d’un accord.
Dans tous les cas, en application des articles 778 et 779 du CPC lorsque le Président constate que toutes les conditions sont réunies pour que l’affaire soit jugée sans qu’il y ait lieu de la renvoyer devant le Juge de la mise en état, il doit déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, étant précisé que celle-ci peut être tenue le jour même.
Le dernier alinéa de l’article 778 du CPC précise, et c’est une innovation du décret du 11 décembre 2019, que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le président déclare l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu. »
En toute hypothèse, cette clôture de l’instruction se matérialise par le prononcé d’une ordonnance de clôture qui donc annonce l’ouverture de la phase des débats oraux.
🡺Le juge de la mise en état estime que l’instruction de l’affaire est achevée
L’article 799 du CPC prévoit que « sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 781, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. »
Il ressort de cette disposition que dès lors que le Juge de la mise en état constate que l’instruction est achevée, il doit rendre une ordonnance de clôture aux termes de laquelle il met un terme à la mise en état et renvoi l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal pour être plaidée.
À cet égard, l’article779 précise que la date de la clôture arrêtée par le Juge de la mise en état doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
Cette obligation qui échoit au juge n’est toutefois assortie d’aucune sanction. Reste que plus le délai entre le prononcé de l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie sera long et plus il est un risque que des faits nouveaux interviennent entre-temps et donc justifient la révocation de l’ordonnance. Le magistrat a, dans ces conditions, tout intérêt à choisir une date rapprochée.
À ce stade de la procédure, les parties peuvent toujours demander à ce que l’affaire soit jugée sans qu’elle soit plaidée, au préalable, dans le cadre d’une audience.
L’article 799, al. 3 du CPC prévoit en ce sens que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. »
🡺Le Juge de la mise en état souhaite sanctionner une partie négligente
En cas de non-respect des délais fixés par le juge de la mise en état, l’article 800 du CPC autorise le Juge de la mise en état à prononcer la clôture partielle à l’égard de la partie négligente.
Plus précisément cette disposition prévoit que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours ».
On parlera alors de clôture partielle, car prononcée à l’encontre de la partie qui aura été négligente. Cette clôture partielle est seulement subordonnée au non-respect d’un délai fixé par le juge.
Le juge n’est pas contraint, pour prononcer cette sanction, de constater l’inobservation d’une injonction, ni de provoquer l’avis des avocats : une simple défaillance suffit à fonder la clôture
La copie de l’ordonnance de clôture partielle est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. La partie sanctionnée sera dès lors privée du droit de communiquer de nouvelles pièces et de produire de nouvelles conclusions.
Reste que lorsque des demandes ou des moyens nouveaux sont présentés au Juge de la mise ou en cas de cause grave et dûment justifié, ce dernier peut toujours, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, rétracter l’ordonnance de clôture partielle afin de permettre à la partie contre laquelle la clôture partielle a été prononcée de répliquer.
🡺La demande des parties de césure du procès
Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit dans le Code de procédure civile une nouvelle cause de clôture de l’instruction : la césure du procès civil.
Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.
Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.
Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.
Conformément à l’article 807-1, al. 1er du CPC, la césure du procès est laissée à l’initiative exclusive des parties.
Cette faculté peut être exercée, précise le texte, « à tout moment » de la mise en état.
L’article 807-1, al. 2e du CPC prévoit encore que la demande d’ouverture d’une césure se fait au moyen d’un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles l’ensemble des parties constituées sollicitent un jugement partiel.
La demande doit donc porter sur une ou plusieurs prétentions pour lesquelles les parties se sont entendues pour solliciter un jugement partiel.
Aussi, sont-ce les parties qui déterminent le périmètre de la césure demandée sans que le juge ne puisse le modifier.
Il peut être observé que pour être recevable, la demande d’ouverture d’une césure doit porter sur des prétentions sécables.
Autrement dit, ces prétentions doivent pouvoir donner lieu à des jugements partiels indépendants du reste de la matière litigieuse.
Dans le cas contraire, le juge est autorisé à rejeter la demande d’ouverture d’une césure ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 807-1 du CPC. Dans cette hypothèse, l’affaire reprend son cours.
2. Le formalisme attaché au prononcé de l’ordonnance de clôture
🡺Dispositions générales
L’article 798 du CPC prévoit que « la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats. »
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- Un acte d’administration judiciaire
- Il résulte de l’article 798 du CPC que l’ordonnance de clôture s’apparente à un acte d’administration judiciaire
- C’est la raison pour laquelle elle est insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours.
- Motivation de l’ordonnance de clôture
- Principe
- Parce qu’il s’agit d’un acte d’administration judiciaire, l’ordonnance de clôture n’a pas à être motivée
- Exception
- Le seul cas où le Juge de la mise en l’état a l’obligation de motiver l’ordonnance de clôture, c’est lorsqu’elle est rendue sur le fondement de l’article 800 du CPC
- C’est l’hypothèse où, souhaitant sanctionner une partie négligence, le Juge de la mise en état prononce la clôture partielle
- L’article 800 prévoit en ce sens que « si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. »
- Notification de l’ordonnance
- Une copie de l’ordonnance de clôture doit être délivrée aux avocats
- Lorsque la clôture n’est que partielle, l’article 800 du CPC précise que copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
- Tenue du dossier
- En application de l’article 727 du CPC, une copie de l’ordonnance de clôture doit être versée au dossier constitué par le greffe
- Conformément à l’article 771, al. 2 du CPC, la mention de la clôture doit, en outre, figurer sur la fiche permettant de connaître l’état de l’affaire
🡺Cas particulier de la clôture partielle résultant d’une césure du procès
L’article 807-1 du CPC prévoit que « s’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. »
Si donc les conditions d’ouverture de la césure sont réunies, le juge rend une ordonnance de clôture partielle de l’instruction. L’acte contresigné par avocats exprimant la demande d’ouverture d’une césure doit être annexé à l’ordonnance.
Cette clôture se limite aux prétentions visées dans la demande d’ouverture d’une césure. Comme souligné par l’ordonnance du 17 octobre 2023, « la décision du juge de la mise en état d’ordonner ou non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice ».
S’agissant de la date de la clôture partielle, en application de l’article 807-1, al. 4e du CPC, elle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
B) Les effets de l’ordonnance de clôture
Lorsqu’elle est rendue par le Juge de la mise en état, l’ordonnance de clôture produit deux effets :
- Elle opère le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal
- Elle rend irrecevable le dépôt de conclusions et de pièces
1. Le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement du Tribunal
En application de l’article 799 du CPC l’ordonnance de clôture a pour effet de renvoyer l’affaire
devant le tribunal pour être plaidée.
À cet égard, il doit s’ensuivre la fixation de la date de l’audience.
🡺La fixation de la date de l’audience
Il s’évince de l’article 799 du CPC que seul le Président dispose de cette prérogative, de sorte que deux hypothèses doivent être distinguées :
- L’ordonnance de clôture est rendue par le Président de la juridiction ou de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée (circuit court)
- Dans cette hypothèse, l’ordonnance fixe la date de l’audience.
- L’ordonnance de clôture est rendue par le Juge de la mise en état
- Dans cette hypothèse, deux situations peuvent être envisagées :
- Le juge de la mise en état a reçu délégation du Président pour fixer la date de l’audience auquel cas il peut l’arrêter dans l’ordonnance de clôture
- Le juge de la mise en état n’a pas reçu délégation du Président pour fixer la date de l’audience auquel cas il ne peut que renvoyer l’affaire sans fixer de date, charge au Président de la fixer lui-même
🡺La détermination de la date de l’audience
Quant à la date de l’audience, l’article 799 du CPC prévoit que « la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »
Le délai entre ces deux dates doit être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles en mois.
La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance.
🡺Le dépôt du dossier au greffe
Lorsque l’affaire est renvoyée à l’audience, le dépôt du dossier de l’avocat peut être requis dans deux cas énoncés par l’article 799 du CPC pris en ses alinéas 2 et 3.
- Demande du Juge de la mise en état en vue de l’élaboration de son rapport
- L’article 799, al. 2 prévoit que « s’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. »
- L’établissement de ce rapport a été rendu obligatoire par le décret du 28 décembre 2005, le législateur considérant que l’audience ne devait plus être le lieu des seules plaidoiries, mais également le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.
- Aussi, cela implique-t-il une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.
- La demande de dépôt du dossier par le Juge est une simple faculté qu’il n’est pas tenu d’exercer systématiquement.
- En pratique, les avocats devanceront sa demande en lui déposant leurs dossiers de plaidoiries respectifs.
- Demande des avocats de ne pas plaider l’affaire à l’audience
- Dans la pratique, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés.
- Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, elle aussi, été officialisée par le décret du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.
- À cet égard, le troisième alinéa de l’ancien article 779 du CPC prévoyait que « le président ou le juge de la mise en état, s’il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries. »
- Cette faculté des parties à solliciter une dispense d’audience a été généralisée à tous les stades de l’instance
- Cette demande peut être formulée dès l’acte introductif d’instance, ce qui se traduit par l’insertion d’une mention dans l’assignation ou la requête conjointe.
- Au stade de l’achèvement de l’instruction de l’affaire, l’article 799, al. 3 prévoit que « lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. »
- Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public. »
- Par ailleurs, à la date annoncée, les parties devront être informées du nom des juges et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
- Ces informations sont impératives, tout justiciable devant savoir par qui il est jugé et quand il le sera.
2. L’irrecevabilité des conclusions et des pièces tardives
🡺Principe
L’article 802 du CPC dispose que « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. »
Il résulte de cette règle que, postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, les parties sont irrecevables à produire des conclusions et des pièces.
Il est indifférent que la production tardive soit fautif, le seul critère d’irrecevabilité devant être apprécié par le Juge étant la date de l’ordonnance de clôture.
À cet égard, en application de l’article 802 du CPC, il appartient au Juge de relever d’office l’irrecevabilité.
La conséquence en est que ce dernier ne pourra rendre sa décision qu’en se rapportant aux dernières conclusions déposées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Dans un arrêt du 11 mars 1992, la Cour de cassation a précisé que « le juge, qui relève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de conclusions déposées après l’ordonnance de clôture, n’a pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen » (Cass. 2e civ. 11 mars 1992, n°90-19.699).
Reste que pour écarter les conclusions et pièces hors délai, le Juge devra s’assurer que le concluant ait bien eu connaissance de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n°09-17.159).
🡺Le sort des conclusions et pièces de dernière heure
L’ordonnance de clôture, qui marque la fin de l’instruction à la date fixée par le juge, a pour effet d’interdire, à compter de la date où elle est prononcée, le dépôt de toutes conclusions et la production de toutes pièces à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Si les conclusions déposées et les pièces produites après l’ordonnance de clôture sont irrecevables, a contrario, elles sont recevables si elles l’ont été avant l’ordonnance. Le sont-elles dans tous les cas ?
À l’analyse, l’article 802 du CPC n’interdit pas de façon littérale le dépôt de pièces à la veille du prononcé de l’ordonnance de clôture.
Cependant l’article 15 du même code dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Quant au contrôle de la mise en œuvre du principe fondamental de la contradiction ainsi exprimé, il est assuré par le juge auquel l’article 16 du CPC fait obligation d’observer et de faire observer lui-même le respect de ce principe.
Lorsque les conclusions sont déposées et les pièces produites en dernière heure, c’est-à-dire à une date très proche de la date de clôture, laquelle aura été portée à l’avance à la connaissance des parties par le juge de la mise en état, le principe de la contradiction ne peut pas être respecté dès lors que la partie adverse ne dispose pas d’un délai suffisant dans le temps restant pour prendre connaissance des pièces et conclusions et y répliquer.
L’article 135 du CPC permet, dans ces conditions, au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées « en temps utile ».
Cette notion de temps utile, qui fait référence à la même notion visée à l’article 15 du même code, ne s’applique qu’aux productions de pièces et non aux conclusions, pour lesquelles n’existe pas de disposition correspondante.
Ce concept de « temps utile » crée, selon le rapport annuel de la Cour de cassation publié en 1995, une sorte de « période suspecte » antérieure à l’ordonnance de clôture, durant laquelle les productions et communications de pièces sont exposées à un rejet.
À cet égard, le professeur Perrot a fait observer que « la notion de temps utile est malaisée à définir. C’est essentiellement une question de fait appréciée par le juge dans chaque cas d’espèce. Pour déterminer si les communications et notifications à l’adversaire ont eu lieu en temps utile, le juge doit procéder à une sorte de compte à rebours très aléatoire, en partant de la date à laquelle tout débat doit être arrêté et en se demandant si le temps dont l’adversaire a disposé peut être considéré comme suffisant pour organiser utilement sa défense. On devine la marge d’incertitude que comporte une telle appréciation ».
Lorsque l’on se tourne vers la jurisprudence, il apparaît que la décision d’irrecevabilité des pièces ou conclusions, prononcée d’office ou à la demande d’une partie, fait l’objet d’un contrôle très strict de la Cour de cassation qui s’explique par le fait qu’elle constitue une mesure radicale.
La jurisprudence exige que les conclusions aient été déposées de manière que la partie adverse ait été mise dans l’impossibilité de répliquer avant la clôture, ce qui suppose, d’une part, que les conclusions ou pièces nécessitaient une réponse, d’autre part, que le délai encore disponible pour y répondre était insuffisant.
Une jurisprudence abondante des trois chambres civiles et de la chambre commerciale exprime cette exigence : « le juge ne peut écarter des débats des conclusions déposées avant l’ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction » (Cass. 2e civ. 11 janv. 2001, n°99-13.060 )
Il s’agit donc de savoir selon Antoine Bolze si, au cas par cas, le dépôt tardif a été déloyal dans la mesure où « son contenu fait entrer dans la phase préparatoire qui s’achève des éléments dont la nouveauté désorganise la défense de l’adversaire ».
Dans un arrêt du 5 décembre 2012 la Cour de cassation a réitéré sa position en considérant que des conclusions ou pièces tardives ne pouvaient être déclarées irrecevables qu’à la condition qu’il soit établi l’existence de circonstances particulières ayant empêché le respect de la contradiction (Cass. 1ère civ. 5 déc. 2012, n°11-20.552).
🡺Exceptions
Le principe d’irrecevabilité des conclusions et pièces tardives est assorti de quatre exceptions énoncées aux alinéas 2 et 3 de l’article 802 du CPC.
Ces exceptions se justifient par l’impossibilité pour le concluant, dans certains cas, de présenter ses demandes.
Aussi, des conclusions et pièces pourront toujours être produites dans les cas suivants :
- Dépôt de demandes en intervention volontaire
- Dans cette hypothèse, il s’agit d’autoriser les tiers à intervenir à l’instance, ces derniers ne pouvant pas connaître, par hypothèse, la date de clôture de l’instruction.
- L’article 803, al. 2e du CPC précise que « si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. »
- Ainsi, c’est au juge de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, ce qu’il sera contraint de faire si, compte tenu de l’objet de la demande en intervention volontaire, il n’est pas en mesure de statuer sur l’ensemble de l’affaire.
- Reste que la Cour de cassation a néanmoins admis que le juge puisse choisir de statuer d’abord sur la cause principale, si la demande en intervention volontaire risque de retarder à l’excès le jugement sur le fond (V. en ce sens Cass. com. 20 févr. 2001, n°97-16.019).
- Dépôt de conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats
- Cette hypothèse se justifie par la nécessité d’actualiser les montant évoqués dans les conclusions prises par les parties.
- La clôture de l’instruction n’interrompt nullement le cours des intérêts, ni l’exigibilité des loyers, raison pour laquelle il est nécessaire de permettre aux parties de mettre à jour leurs écritures, mais seulement sur ces éléments pécuniaires.
- Formulation de demandes de révocation de l’ordonnance de clôture
- Cette hypothèse se justifie par la reconnaissance même d’un droit de révoquer l’ordonnance de clôture.
- Par hypothèse, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne peut être formulée que postérieurement à la décision du Juge, d’où cette dérogation au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives posé par l’article 802 du CPC.
- Dépôt de conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption
- Cette hypothèse se rencontrera lorsqu’une cause d’interruption de l’instance interviendra postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
- Afin de mettre en terme à l’interruption de l’instance et de solliciter sa reprise, il est nécessaire que les parties disposent de la faculté de déposer des conclusions.
- Or dans la mesure où l’ordonnance de clôture a déjà été rendu, le principe d’irrecevabilité des écritures tardives y fait obstacle ; d’où l’exception posée par l’article 802 du CPC.
- De nouvelles conclusions pourront ainsi être prises, mais uniquement aux fins de discuter de la reprise de l’instance.
Si la liste des exceptions au principe d’irrecevabilité des conclusions tardives est limitative, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 juin 2012 admis un cinquième cas justifiant qu’il soit dérogé à ce principe : la demande de rejet de conclusions ou de pièces déposées à la dernière heure.
Dans cette décision, la première chambre civile a considéré que « si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture »
C) La révocation de l’ordonnance de clôture ou le rabat de clôture
1. Les causes de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort des termes de l’article 803 du CPC que la révocation de l’ordonnance de clôture peut être prononcée dans trois cas :
- La cause grave
- La demande en intervention volontaire
- L’orientation des parties vers une audience de règlement amiable
🡺Premier cas : la cause grave
L’article 803, al. 1er du CPC dispose que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue »
Bien que la cause grave ne soit pas définie par les textes, l’article 803 du CPC exclut d’emblée la constitution d’avocat postérieurement à la clôture.
À l’examen, par cause grave, il ne peut s’agir que d’une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s’est révélée à lui postérieurement à l’ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
La combinaison de ces deux éléments réunis à conduit la jurisprudence :
- À admettre la cause grave
- En cas de communication d’une pièce dont dépend la solution du litige
- En cas de retard dans l’octroi de l’aide juridictionnel auquel était subordonnée l’intervention de l’avocat
- À exclure la cause grave
- En cas de délai suffisant pour répondre à des conclusions déposées à une date proche de la clôture
- En cas de succession d’avocat
🡺Deuxième cas : la demande en intervention volontaire
L’article 803, al. 2 du CPC prévoit que la demande en intervention volontaire peut justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, à la condition néanmoins que le Tribunal ne soit pas en mesure de statuer sur le tout de l’affaire, sans que cette nouvelle demande ne soit instruite.
Reste que la révocation de l’ordonnance de clôture par le juge dans cette circonstance n’est qu’une simple faculté.
🡺Troisième cas : l’orientation des parties vers une audience de règlement amiable
L’article 803, al. 4e du CPC prévoit que « l’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. »
Cette cause de révocation de l’ordonnance de clôture a été introduite par décret n°2023-686 du 29 juillet 2023.
Pour mémoire, « l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. »
L’objectif recherché ici est de laisser une dernière chance aux parties de trouver un compromis avant que leur litige ne soit tranché par la formation de jugement.
2. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803, al. 3 du CPC dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties ».
Dans le premier cas de figure, la Cour de cassation considère « qu’en application de l’article 783 [803 nouveau] du Code de procédure civile, les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions » (Cass. 2e civ. 1er avr. 2004, n°02-13.996).
3. La décision de révocation de l’ordonnance de clôture
🡺Pouvoirs du juge
L’article 803, al. 3 du CPC prévoit que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Il ressort de cette disposition que la décision de révocation de l’ordonnance de clôture peut intervenir dans trois cas :
- La juge peut révoquer d’office l’ordonnance de clôture sans que cette révocation ait été sollicitée par les parties
- Le juge peut révoquer l’ordonnance de clôture à la demande des parties, à la condition qu’elles justifient d’une cause grave
- L’ordonnance est révoquée par décision du Tribunal réuni dans sa formation de jugement, d’où il s’ensuit une réouverture les débats
Ainsi, l’ordonnance de clôture peut être révoquée :
- Soit par le Juge de la mise en état, lequel demeure saisi jusqu’à la date de l’audience
- Soit par le Tribunal lui-même même qui est saisi à compter de la date de l’audience
Dans cette dernière hypothèse, soit lorsque c’est le Tribunal qui est saisi, il convient de distinguer deux hypothèses :
- Le Tribunal prononce la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture
- Dans cette hypothèse, les parties disposent de la faculté de conclure sur tous les points du litige pendant devant la juridiction, y compris formuler de nouvelles demandes (V. en ce sens Cass. 3e civ. 13 nov. 1997, n°95-15.705).
- L’affaire est alors renvoyée devant le Juge de la mise en état
- La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la réouverture des débats n’emportait pas révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il appartient au Tribunal de le spécifier dans le dispositif de sa décision (Cass. 2e civ. 14 mai 1997, n°95-17.009)
- Seul le renvoi de l’affaire devant le Juge de la mise en état vaut révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ. 19 févr. 2009, n°07-19.504).
- Le Tribunal prononce la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture
- Dans cette hypothèse, la réouverture des débats intervient sur le fondement de l’article 444 du CPC
- Cette disposition prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
- La réouverture des débats n’est ici pas subordonnée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
- La conséquence est que les parties ne pourront conclure que sur le point de droit ou de fait soulevé par le juge
🡺Motivation de la décision de révocation
Bien que l’article 803 du CPC ne prévoit pas que l’ordonnance de révocation doive être motivée, la Cour de cassation l’exige, en particulier s’agissant de la caractérisation de la cause grave justifiant la décision prise.
4. Les effets de la révocation de l’ordonnance de clôture
La révocation de l’ordonnance de clôture a pour effet de rouvrir la phase d’instruction de l’affaire, de sorte que les parties sont autorisées à déposer de nouvelles conclusions et pièces.
La révocation de l’ordonnance est nécessairement totale, en ce sens que le Tribunal ne saurait limiter la réouverture des débats à la production de certaines conclusions ou pièces.
Les parties sont libres de conclure sur tous les points du litige qui leur sied, ce qui implique qu’ils soient autorisés à formuler de nouvelles demandes.