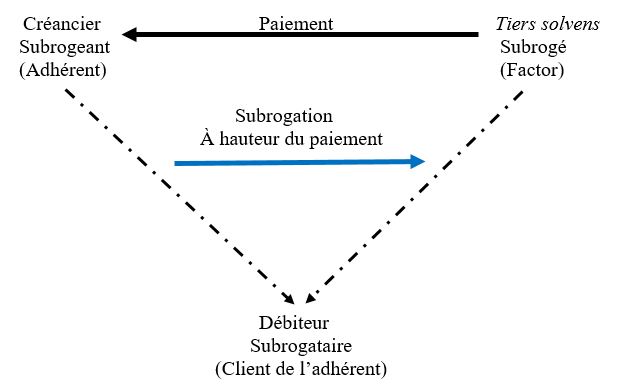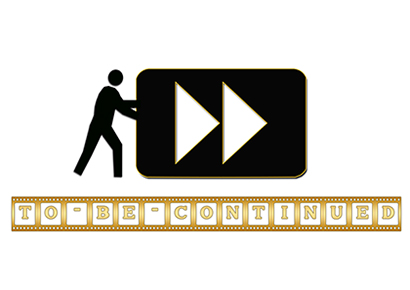Parce que les contrats sont pourvus de la force obligatoire (art. 1103 C. civ), lorsqu’une partie, qui s’est engagée à fournir une prestation ou une chose, ne s’exécute pas, elle devrait, en toute logique, pouvoir y être contrainte. C’est la raison pour laquelle la loi le lui permet.
Cette possibilité, pour le créancier, de contraindre le débiteur défaillant à honorer ses obligations vise à obtenir ce que l’on appelle l’exécution forcée.
Pratiquement, l’exécution forcée peut prendre deux formes :
- Elle peut avoir lieu en nature : le débiteur est contraint de fournir ce à quoi il s’est engagé
- Elle peut avoir lieu par équivalent : le débiteur verse au créancier une somme d’argent qui correspond à la valeur de la prestation promise initialement
Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient fait de l’exécution par équivalent le principe, pour les obligations de faire et de ne pas faire, l’ordonnance du 10 février 2016 a inversé ce principe en généralisant l’exécution forcée en nature dont le recours n’est plus limité, en simplifiant à l’extrême, aux obligations de donner.
?Droit antérieur
Pour mémoire, sous l’empire du droit antérieur, le Code civil distinguait trois sortes d’obligations :
- L’obligation de donner
- L’obligation de donner consiste pour le débiteur à transférer au créancier un droit réel dont il est titulaire
- Exemple: dans un contrat de vente, le vendeur a l’obligation de transférer la propriété de la chose vendue
- L’obligation de faire
- L’obligation de faire consiste pour le débiteur à fournir une prestation, un service autre que le transfert d’un droit réel
- Exemple: le menuisier s’engage, dans le cadre du contrat conclu avec son client, à fabriquer un meuble
- L’obligation de ne pas faire
- L’obligation de ne pas faire consiste pour le débiteur en une abstention. Il s’engage à s’abstenir d’une action.
- Exemple: le débiteur d’une clause de non-concurrence souscrite à la faveur de son employeur ou du cessionnaire de son fonds de commerce, s’engage à ne pas exercer l’activité visée par ladite clause dans un temps et sur espace géographique déterminé
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a abandonné la distinction entre ces obligations, à tout le moins elle n’y fait plus référence.
Le principal intérêt de la distinction entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire résidait dans les modalités de l’exécution forcée.
Pour le comprendre envisageons l’exécution forcée de chacune de ces obligations prises séparément.
- L’obligation de donner
- Lorsque l’engagement souscrit consiste en une obligation de donner, il y a lieu de distinguer selon qu’il s’agit de payer une somme d’argent ou selon qu’il s’agit de transférer la propriété d’un bien :
- Lorsqu’il s’agit d’une obligation de payer
- Dans cette hypothèse, seule l’exécution forcée en nature est envisageable.
- En pareil cas, il ne saurait y avoir d’exécution par équivalent, dans la mesure où, par hypothèse, il n’existe pas d’autre équivalent à l’argent que l’argent.
- Lorsqu’il s’agit de transférer la propriété d’un bien
- En cas de défaillance du débiteur, l’exécution forcée n’a pas lieu de jouer dans la mesure où la défaillance du débiteur intéresse l’effet translatif du contrat.
- Aussi, est-ce plutôt une action en revendication qui devra être engagée par le créancier aux fins de voir reconnaître son droit de propriété
- Quant à l’obligation de délivrance de la chose, elle relève de la catégorie, non pas des obligations de donner, mais de faire.
- L’obligation de faire
- Lorsque l’engagement pris consiste en une obligation de faire, les deux formes d’exécution forcée sont possibles.
- Reste que, dans certains cas, l’exécution forcée en nature d’une obligation de faire soulèvera des difficultés.
- En effet, forcer une personne à fournir la prestation promise pourrait être considéré comme trop attentatoire à la liberté individuelle.
- Ajouté à cela, contrainte une personne à fournir une prestation contre sa volonté, serait susceptible d’exposer le créancier à une exécution défectueuse de cette prestation qui, dès lors, ne répondrait pas aux attendus stipulés dans le contrat.
- L’obligation de ne pas faire
- Il n’est guère plus envisageable de faire respecter, par la force, une obligation de ne pas faire sauf à porter atteinte à la liberté individuelle.
- L’obligation de ne pas faire se prête ainsi difficilement à l’exécution forcée en nature.
Fort de ces constats, le législateur, en 1804, en avait tiré la conséquence à l’ancien article 1142 du Code civil qui disposait que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
Le principe posé par ce texte était donc que les obligations de faire et les obligations de ne pas faire ne pouvaient faire l’objet que d’une exécution forcée par équivalent, soit se traduire par le versement d’une somme d’argent au créancier.
Par exception, la loi avait néanmoins envisagé certains cas où l’exécution forcée en nature était possible pour les obligations de faire et de ne pas faire :
- L’ancien article 1143 prévoyait que « néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu »
- L’ancien article 1145 disposait encore que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».
Portée par une doctrine majoritairement favorable à une extension du domaine de l’exécution forcée, la jurisprudence a progressivement admis qu’elle puisse être envisagée pour les obligations de faire et de ne pas faire, dès lors qu’elles ne sont pas intimement liées à la personne du débiteur (V. en ce sens pour les obligations de faire Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n°03-21.136 ; pour les obligations de ne pas faire Cass. 1ère civ., 16 janv. 2007, n°06-13.983).
Pour ce faire, la Cour de cassation s’est notamment appuyée sur une lecture audacieuse de l’ancien article 1184 du Code civil, combinée à une lecture restrictive de l’ancien article 1142.
En effet, l’ancien article 1184 du code civil semblait ouvrir la possibilité, pour toutes les obligations, de quelque nature qu’elles soient, d’une exécution forcée en nature au choix du créancier en prévoyant que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Toutefois, la lettre du texte de l’ancien article 1142 paraissait limiter aux seules obligations de donner la possibilité d’une exécution forcée en nature : « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
Pour concilier ces deux textes, la Cour de cassation, suivant en cela la doctrine majoritaire, a inversé le principe posé par l’article 1142, pour revenir au fondement de la règle qu’il formule et considérer que seules sont exclues du champ d’application de l’exécution forcée en nature les atteintes directes à la liberté de la personne du débiteur.
D’ailleurs, les articles 1143 et 1144 nuançaient déjà l’affirmation posée par l’article 1142 en prévoyant des dérogations au principe de la condamnation à des dommages-intérêts.
Aussi, la jurisprudence a-t-elle fait une application très restrictive des termes de l’article 1142 du code civil, et paraît avoir reconnu, avec la majorité des auteurs, un véritable droit à l’exécution forcée en nature, en considérant que tout créancier peut exiger l’exécution de ce qui lui est dû lorsque cette exécution est possible (Cass. 3e civ., 19 février 1970, n°68-13.866 ; Cass. 3e civ., 3 novembre 2017, n°15-23.188). La possibilité d’obtenir l’exécution forcée en nature n’est donc exclue qu’en cas d’impossibilité matérielle, juridique ou morale.
Manifestement, les auteurs qui plaidaient pour un abandon de la soustraction des obligations de faire et de ne pas faire à l’exécution forcée en nature ont été entendus par le législateur qui n’a pas manqué l’occasion, lors de l’ordonnance du 10 février 2016, d’inverser le principe posé à l’ancien article 1142 du Code civil, conformément à la jurisprudence qui avait réduit à la portion congrue la portée de ce texte.
?L’ordonnance du 10 février 2016
L’ordonnance du 10 février 2016 dispose désormais à l’article 1221 du Code civil que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature.
Ainsi, ce texte rompt avec la lettre de l’ancien article 1142 du code civil, dont la Cour de cassation avait déjà retenu une interprétation contraire au texte et qui était également contredit par la procédure d’injonction de faire prévue par les articles 1425-1 à 1425-9 du code de procédure civile.
Le principe est donc dorénavant inversé. Il est indifférent que l’engagement souscrit consiste en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, le créancier est fondé, par principe, à solliciter l’exécution forcée en nature de son débiteur, sauf à ce que :
- Soit l’exécution est impossible
- Soit il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
À cet égard, le créancier dispose toujours d’une alternative prévue à l’article 1222 du Code civil qui consiste, « au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure du débiteur, et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées pour ce faire ».
Aussi, convient-il de distinguer deux sortes d’exécution forcée en nature :
- Celle qui intéresse l’intervention du débiteur
- Celle qui intéresse l’intervention d’un tiers
I) L’exécution forcée en nature qui intéresse l’intervention du débiteur
A) Principe
1. Contenu du principe
L’article 1221 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 autorise donc le créancier à solliciter l’exécution forcée en nature en cas de défaillance de son débiteur.
Le principe ainsi posé est repris, en des termes plus généraux, par l’article 1341 du Code civil qui dispose que « le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
?Indifférence de la nature des obligations en cause
Tandis que sous l’empire du droit antérieur, cette forme d’exécution forcée ne pouvait intervenir que pour les obligations de payer, désormais, le texte ne distingue plus selon que la prestation inexécutée consiste en une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.
Toutes les obligations, quelle que soit leur nature, sont susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée en nature.
Une interrogation demeure toutefois pour l’obligation de ne pas faire, dont on voit mal comment elle pourrait donner lieu à une exécution forcée en nature. En effet, contraindre le débiteur à s’abstenir de ne pas faire quelque chose que le contrat lui interdit, reviendrait, par hypothèse, à porter une atteinte excessive à sa liberté individuelle.
L’exécution forcée en nature est donc inenvisageable pour les obligations de ne pas faire, à l’exception du cas prévu à l’article 1222 du Code civil qui autorise le créancier à « détruire ce qui a été fait en violation » d’une obligation. Il pourra alors « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. »
En dehors du cas particulier de l’obligation de ne pas faire, l’exécution forcée en nature est à la portée du créancier.
?Absence de hiérarchisation des sanctions
À cet égard, elle figure en bonne place dans la liste des sanctions attachées à l’inexécution du contrat énoncées à l’article 1217 du Code civil puisqu’elle figure en deuxième place après l’exception d’inexécution.
Est-ce à dire que l’exécution forcée en nature prime les autres sanctions que sont la réduction du prix ou la résolution du contrat ?
Dans le silence du texte, il y a lieu de considérer que le principe posé est le libre choix de la sanction dont se prévaut le créancier.
Aussi, le créancier est-il libre de solliciter la résolution du contrat plutôt que l’exécution forcée en nature.
À cet égard le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise que l’ordre de l’énumération des sanctions énumérées à l’article 1217 du Code civil n’a aucune valeur hiérarchique, le créancier victime de l’inexécution étant libre de choisir la sanction la plus adaptée à la situation.
Au surplus, le choix fait par le créancier s’impose au juge dès lors que les conditions d’application de la sanction invoquée sont réunies.
?Possibilité de cumul des sanctions
Le dernier alinéa de l’article 1217 règle l’articulation entre les différentes sanctions qui, en application de ce texte, peuvent se cumuler, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles.
Que doit-on entendre par « sanctions incompatibles » ? L’article 1217 du Code civil ne le dit pas.
Il est néanmoins possible de conjecturer, au regard de la jurisprudence antérieure, que l’incompatibilité de sanctions se déduit des effets attachés à chacune d’elles.
Plusieurs combinaisons peuvent ainsi être envisagées :
- Exécution forcée en nature et résolution
- Tandis que l’exécution forcée en nature vise à contraindre le débiteur à fournir la prestation ou la chose convenue, la résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat, soit de faire comme s’il n’avait jamais exigé.
- Manifestement, les effets recherchés pour ces deux sortes de sanctions sont radicalement opposés.
- Il en résulte que, en cas de défaillance du débiteur, exécution forcée en nature et résolution ne sauraient se cumuler (V. en ce sens Cass. 3e civ. 7 juin 1989, n°87-14.083).
- Exécution forcée en nature et réduction du prix
- L’obtention d’une réduction de prix suppose que l’obligation dont se prévaut le créancier n’a été qu’imparfaitement exécutée.
- Aussi, cette sanction vise-t-elle à ramener le prix au niveau de la quotité ou de la qualité de la prestation qui a été effectivement fournie.
- De son côté, l’exécution forcée en nature vise plutôt à contraindre le débiteur à parfaire l’exécution de l’obligation souscrite.
- Il n’est donc pas question ici, pour le créancier, de renoncer à la quotité ou à la qualité de la prestation stipulée dans le contrat.
- Les objectifs recherchés pour les deux sanctions sont, là encore, opposés.
- Exécution forcée en nature et réduction de prix sont, dans ces conditions, incompatibles.
- Exécution forcée en nature et dommages et intérêts
- L’article 1217 du Code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent toujours être sollicités quelle que soit la sanction choisie par le créancier.
- Il en résulte que l’exécution forcée en nature peut être cumulée avec une demande d’octroi de dommages et intérêts.
- Ces derniers visent à indemniser le créancier pour le préjudice subi en raison de l’inexécution totale ou partielle du contrat.
2. Conditions de mise en oeuvre
Pour que l’exécution forcée en nature puisse être mise en œuvre, plusieurs conditions doivent être réunies :
- D’une part, la créance dont se prévaut le créancier doit être certaine, liquide et exigible
- D’autre part, le débiteur doit avoir préalablement été mis en demeure de s’exécuter
?Caractère certain, liquide et exigible de la créance
Bien que les articles 1221 et 1222 du Code civil ne le prévoient pas expressément, l’exécution forcée en nature ne se conçoit que si la créance dont se prévaut le créancier est certaine, liquide et exigible.
- Sur le caractère certain de la créance
- Une créance présente un caractère certain lorsqu’elle est fondée dans son principe.
- L’existence de la créance doit, autrement dit, être incontestable.
- C’est la une condition indispensable à la mise en œuvre de l’exécution forcée en nature, ne serait-ce que parce que, à défaut de certitude de la créance, le créancier échouera à obtenir un titre exécutoire et donc à s’attacher les services d’un huissier de justice aux fins qu’il instrumente une mesure d’exécution forcée.
- Sur le caractère exigible de la créance
- Une créance présente un caractère exigible lorsque le terme de l’obligation est arrivé à l’échéance.
- Pour que l’exécution forcée en nature puisse être invoquée, encore faut-il que la créance dont se prévaut le créancier soit exigible
- À défaut, il n’est pas fondé à en réclamer l’exécution et, par voie de conséquence, obtenir l’exécution forcée en nature de l’obligation en cause.
- Pour déterminer si une obligation est exigible, il convient de se reporter au terme stipulé dans le contrat.
- À défaut de stipulation d’un terme, l’article 1305-3 du Code civil dispose que « le terme profite au débiteur, s’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties ».
- Ainsi, le terme est-il toujours présumé être stipulé à la faveur du seul débiteur.
- L’instauration de cette présomption se justifie par les effets du terme.
- La stipulation d’un terme constitue effectivement un avantage consenti au débiteur, en ce qu’il suspend l’exigibilité de la dette.
- Le terme autorise donc le débiteur à ne pas exécuter la prestation prévue au contrat.
- Il s’agit là d’une présomption simple, de sorte qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.
- Les parties ou la loi peuvent encore prévoir que le terme est stipulé, soit à la faveur du seul créancier, soit à la faveur des deux parties au contrat.
- Sur le caractère liquide de la créance
- Une créance présente un caractère liquide lorsqu’elle est susceptible d’être évaluable en argent.
- À l’évidence, pour que l’exécution forcée en nature puisse être mise en œuvre, encore faut-il que la prestation ou la chose promise soit déterminée.
- À défaut, aucune exécution forcée ne saurait avoir lieu, faute de détermination de son objet.
?Mise en demeure
Les articles 1221 et 1222 du Code civil subordonnent la mise en œuvre de l’exécution forcée en nature à la mise en demeure préalable du débiteur.
Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
Au fond, l’exigence de mise en demeure préalable à toute demande d’exécution forcée en nature vise à laisser une ultime chance au débiteur de s’exécuter.
À cet égard, l’absence de mise en demeure pourrait être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond lequel est susceptible d’avoir pour effet de tenir en échec la demande d’exécution forcée en nature formulée par le créancier.
Quant au contenu de la mise en demeure, l’acte doit comporter :
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
En application de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut être notifiée au débiteur :
- Soit par voie de signification
- Soit au moyen d’une lettre missive
Par ailleurs, il ressort de l’article 1344 du Code civil que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations stipulées au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
Dans cette hypothèse, la mise en œuvre de l’exécution forcée en nature ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure.
?Titre exécutoire
Bien que les articles 1221 et 1222 du Code civil suggèrent qu’il suffit au créancier de remplir les conditions énoncées ses textes pour que l’exécution forcée en nature puisse être mise en œuvre, il n’en est rien.
Cette dernière est, en effet, subordonnée à l’obtention, par le créancier, d’un titre exécutoire. L’article 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en ce sens que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Pour rappel, par titre exécutoire, il faut entendre, au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
- Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
- Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
À défaut de titre exécutoire, le droit pour le créancier à l’exécution forcée en nature de sa créance n’est que purement théorique, en ce sens qu’il demeure privé de la possibilité de requérir le ministère d’un huissier de justice pour mise en œuvre de l’exécution proprement dite.
L’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit, en effet, que « les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour […] ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ».
Ainsi, les huissiers de justice ne sont autorisés à diligenter une procédure d’exécution forcée qu’à la condition qu’ils justifient d’un titre exécutoire.
B) Exceptions
L’article 1221 du Code civil assortit le principe de l’exécution forcée en nature de deux exceptions :
- L’existence d’une impossibilité d’exécution pour le débiteur
- L’existence d’une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier
1. L’impossibilité d’exécution pour le débiteur
L’article 1221 du Code civil pose que, dans l’hypothèse où il est avéré, que l’exécution de l’obligation en cause est impossible, le créancier ne peut en demander l’exécution forcée en nature.
Cette règle n’est pas sans faire écho à l’adage latin nullus tenetur ad impossibile qui signifie « à l’impossible nul n’est tenu ».
Surtout, elle ne fait que consacrer la jurisprudence antérieure qui, très tôt, avait admis que l’exécution forcée en nature soit exclue en cas d’impossibilité rencontrée par le débiteur.
Reste que la Cour de cassation a tours eu une approche pour le moins restrictive de cette exception dont le champ d’application était circonscrit à l’impossibilité :
- Matérielle : arrêt de la fabrication du modèle du véhicule vendu (Cass. com., 5 octobre 1993, n°90-21.146), empiétement, s’il est impossible, de démolir et reconstruire l’immeuble à l’emplacement prévu (Cass. 3e civ., 15 février 1978, n°76-13.532)
- Juridique : dans un arrêt du 27 novembre 2008, la première chambre civile a, par exemple, jugé que « viole l’article 1142 du code civil la cour d’appel qui ordonne sous astreinte au propriétaire d’un local à usage d’habitation de délivrer ce bien à celui avec qui il avait conclu un contrat de bail, alors qu’elle avait relevé que ce local avait été loué à un tiers » (Cass. 1ère civ., 27 novembre 2008, n°07-11.282)
- Morale : tel est le cas lorsque l’obligation étant éminemment personnelle, son exécution forcée porterait une atteinte trop forte aux droits et libertés fondamentaux de celui qui y est tenu. À cet égard, dans un célèbre arrêt Whistler du 14 mars 1900, la Cour de cassation, après avoir affirmé que le contrat par lequel un artiste s’était engagé à peindre un portrait était « d’une nature spéciale, en vertu duquel la propriété du tableau n’est définitivement acquise à la partie qui l’a commandé, que lorsque l’artiste a mis ce tableau à sa disposition, et qu’il a été agréé par elle », a approuvé la cour d’appel de n’avoir pas ordonné l’exécution forcée de ce contrat au peintre qui refusait de terminer son tableau, le condamnant uniquement à des dommages-intérêts (Cass. civ., 14 mars 1900)
En l’absence de précision de l’article 1221 du Code civil sur le domaine de l’exception tenant à l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter ses obligations, il est fort probable que les solutions adoptées par la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 soient reconduites.
Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter au Rapport au Président de la République qui précise que « l’exécution forcée en nature ne peut être ordonnée en cas d’impossibilité (matérielle, juridique ou morale, en particulier si elle porte atteinte aux libertés individuelles du débiteur) ».
2. L’existence d’une disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt du créancier
L’impossibilité pour le débiteur d’exécuter la prestation promise n’est pas la seule exception au principe d’exécution forcée en nature.
L’ordonnance du 10 février 2016 a ajouté une nouvelle exception : l’exécution en nature ne peut être poursuivie s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Cette nouvelle exception, selon le Rapport au Président de la République est directement inspirée des projets européens d’harmonisation du droit des contrats.
Au fond, elle vise à éviter certaines décisions jurisprudentielles très contestées : lorsque l’exécution forcée en nature est extrêmement onéreuse pour le débiteur sans que le créancier y ait vraiment intérêt, il apparaît en effet inéquitable et injustifié que celui-ci puisse l’exiger, alors qu’une condamnation à des dommages et intérêts pourrait lui fournir une compensation adéquate pour un prix beaucoup plus réduit.
Tel est le cas, lorsque par exemple, l’acquéreur d’une maison individuelle contraint le constructeur à la démolir pour la reconstruire, considérant que « le niveau de la construction présentait une insuffisance de 0,33 mètre par rapport aux stipulations contractuelles ». Nonobstant le coût des travaux à supporter par le constructeur, la Cour de cassation avait considéré que « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible » (Cass. 3e civ., 11 mai 2005, n° 03-21.136).
La nouvelle exception introduite à l’article 1221 du Code civil a été présentée par le législateur comme une déclinaison de l’abus de droit, formulée de façon plus précise, pour encadrer l’appréciation du juge et offrir une sécurité juridique accrue.
Aussi, commettrait un abus de droit le créancier qui exigerait cette exécution alors que l’intérêt qu’elle lui procurerait serait disproportionné au regard du coût qu’elle représenterait pour le débiteur et que des dommages et intérêts pourraient lui fournir une compensation adéquate à un prix inférieur pour le débiteur.
La Cour de cassation semble avoir elle-même ouvert la voie en censurant un arrêt qui avait ordonné la démolition d’un ouvrage au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché si cette démolition « constituait une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient » (Cass., 3ème civ., 15 octobre 2015, n° 14-23.612).
En inscrivant cette exception dans la loi, les rédacteurs de l’ordonnance ont entendu mettre fin à ces hésitations de la jurisprudence, tout en limitant au maximum le jeu de cette exception qui constitue une atteinte à la force obligatoire du contrat.
En tout état de cause, pour faire échec à la demande d’exécution forcée en nature du créancier le débiteur devra démontrer qu’il existe une disproportion entre le coût de l’exécution et l’intérêt pour le créancier de la mise en œuvre de cette exécution.
C’est donc à un test de proportionnalité que les juridictions vont devoir se livrer pour apprécier l’application de l’exception au principe de l’exécution forcée en nature dont ne priveront pas d’invoquer les débiteurs en délicatesse avec les stipulations contractuelles.
La rédaction retenue pour l’article 1221 soulève cependant plusieurs interrogations de la part de la doctrine et des praticiens du droit.
L’exigence d’une « disproportion manifeste » entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le créancier est certes plus précise et moins critiquée que la formule qui avait été retenue initialement dans le projet d’ordonnance, selon laquelle l’exécution en nature devait être écartée si son coût était « manifestement déraisonnable », cette appréciation ne prenant en considération que la situation du débiteur.
Toutefois, loin de priver la Cour de cassation de tout rôle normatif en ce domaine, la réforme soulève de nouvelles questions auxquelles elle devra répondre pour assurer l’unification de l’interprétation du nouveau droit des contrats.
La principale crainte exprimée est celle de voir dans l’article 1221 du Code civil une incitation pour le débiteur à exécuter son obligation de manière imparfaite toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution sera supérieur aux dommages et intérêts qu’il pourrait être amené à verser, c’est-à-dire permettre au débiteur de mauvaise foi de profiter de sa « faute lucrative ».
Sans aller jusqu’à évoquer de véritables gains pour le débiteur, n’est-il pas à craindre qu’un constructeur ne pouvant honorer tous les contrats qu’il a en cours choisisse de privilégier l’exécution parfaite de certains contrats au détriment d’autres contrats, n’encourant plus l’exécution forcée en nature, le cas échéant très coûteuse, mais seulement le versement de dommages et intérêts ?
Pour résoudre cette difficulté, et éviter ce genre de calculs du débiteur, il a été précisé dans le texte qu’en cas de disproportion manifeste du coût pour le débiteur au regard de l’intérêt pour le créancier, il ne pourrait être fait échec à la demande d’exécution forcée en nature qu’au bénéfice du débiteur de bonne foi.
La question se pose encore de savoir si l’intérêt pour le créancier doit s’apprécier objectivement ou subjectivement ? Autrement dit, doit-on tenir compte des conséquences matérielles et financières sur la situation du créancier (appréciation subjective) ou doit-on ne se focaliser que sur les conséquences de l’inexécution contractuelle sur l’économie de l’opération (appréciation objective) ?
Dans le même sens, le coût de l’exécution forcée doit-il s’apprécier au regard du prix de la prestation fixée contractuellement ou au regard de la situation financière du débiteur ?
Ce sont là, autant de questions auxquels la jurisprudence devra répondre, faute de précisions apportées par le législateur sur les critères d’application de l’exception ainsi posée.
II) L’exécution forcée en nature qui intéresse l’intervention d’un tiers
L’article 1222 du Code civil prévoit que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. »
À l’analyse, cette disposition octroie au créancier une alternative en lui permettant, au lieu de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation concernée, de faire exécuter lui-même l’obligation ou détruire ce qui a été mal exécuté après mise en demeure du débiteur, et de solliciter ensuite du débiteur le remboursement des sommes exposées pour ce faire.
Ce mécanisme, que l’on appelle la faculté de remplacement) n’est pas nouveau, puisqu’il reprend en substance les anciens articles 1143 et 1144 et ne fait, au fond.
L’ordonnance du 10 février 2016 innove néanmoins en abandonnant l’exigence d’obtention d’une autorisation judiciaire pour que puisse être exercée cette faculté, sauf à ce qu’il s’agisse de détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation contractuelle.
L’article 1222 du Code civil doit ainsi être lu comme posant un principe, lequel principe est assorti d’une exception.
A) Principe : la faculté discrétionnaire de remplacement
Grande nouveauté introduite par la réforme du droit des obligations, l’article 1222 du Code civil facilite la faculté de remplacement par le créancier lui-même, puisqu’il supprime l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour faire procéder à l’exécution de l’obligation, le contrôle du juge n’intervenant qu’a posteriori en cas de refus du débiteur de payer ou de contestation de celui-ci.
En somme la faculté de remplacement conféré au créancier lui permet de solliciter les services d’un tiers aux fins qu’il exécute lui-même l’obligation de faire ce qui incombait au débiteur défaillant.
L’article 1222 précise que, en pareille circonstance, le créancier peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
?Domaine
La faculté de remplacement dont est titulaire le créancier peut être exercée pour toutes les obligations de faire, dès lors que le résultat recherché et prévu dans le contrat peut être atteint.
Son domaine naturel d’élection est celui des obligations de fournir un bien mobilier. Ainsi, l’acheteur qui n’a pas été livré de la chose convenue, peut exiger qu’elle lui soit fournie par un tiers en cas de manquement par le vendeur à son obligation de délivrance.
L’exercice de la faculté de remplacement est également admis en matière de contrat d’entreprise.
La jurisprudence admet régulièrement en ce sens que le maître d’ouvrage puisse faire réaliser les travaux convenus par une entreprise autre que celle à qui le marché a initialement été confié.
Il en va de même pour le preneur qui, en cas d’inaction de son bailleur, peut faire solliciter les services d’un tiers pour que soient effectuées les réparations nécessaires à la jouissance paisible de la chose louée.
?Conditions
L’exercice de la faculté de remplacement conférée au créancier est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives :
- Première condition : la mise en demeure du débiteur
- La faculté de remplacement ne peut être exercée par le créancier qu’à la condition que le débiteur ait été mis en demeure de s’exécuter.
- Il convient de le prévenir sur le risque auquel il s’expose en cas d’inaction, soit de devoir supporter le coût de la prestation fournie par un tiers.
- La mise en demeure que le créancier adresse au débiteur doit répondre aux exigences énoncées aux articles 1344 et suivants du Code civil.
- Deuxième condition : l’observation d’un délai raisonnable
- La faculté de remplacement dont dispose le créancier ne pourra être envisagée qu’à la condition que ce dernier ait attendu un délai raisonnable entre la date d’échéance de l’obligation et la sollicitation d’un tiers, ne serait-ce que parce qu’il a l’obligation d’adresser, au préalable, une mise en demeure.
- Aussi, le débiteur doit-il disposer du temps nécessaire pour régulariser sa situation.
- Reste à déterminer ce que l’on doit entendre par délai raisonnable
- Sans doute doit-on considérer que le délai raisonnable commence à courir à compter de la mise en demeure du débiteur.
- Quant au quantum de ce délai, il conviendra de prendre en compte, tout autant les impératifs du créancier, que la situation du débiteur.
- Troisième condition : le respect d’un coût raisonnable
- Dernière condition devant être remplie pour que le créancier soit fondé à exercer la faculté de remplacement que lui octroie l’article 1222, le coût de l’intervention du tiers doit être raisonnable
- L’appréciation du caractère raisonnable de ce coût devra s’apprécier au regard du montant de la prestation stipulée dans le contrat.
- L’intervention du tiers ne devra pas, en d’autres termes, engendrer des frais disproportionnés eu égard l’obligation à laquelle s’était engagé initialement le débiteur
B) Exception : l’exigence d’une autorisation judiciaire
Dans le cadre de l’exercice de la faculté de remplacement, l’obtention d’une autorisation judiciaire est exigée dans deux cas :
?La destruction de ce qui a été fait en violation d’une obligation contractuelle
Si, l’ordonnance du 10 février 2016 a supprimé l’exigence d’une autorisation judiciaire préalable pour faire procéder à l’exécution de l’obligation inexécutée par un tiers, elle maintient, en revanche, la nécessité d’une autorisation pour obtenir la destruction de ce qui a été réalisé en contravention de l’obligation, compte tenu du caractère irrémédiable d’une telle destruction afin d’éviter les abus de la part du créancier.
Reprenant les termes de l’ancien article 1444 du Code civil, le second alinéa de l’article 1222 oblige ainsi le créancier à saisir le juge, lorsqu’il s’agit de faire détruire ce qui a été fait en violation d’une disposition contractuelle.
Le texte ajoute que le créancier peut « demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin »
Reste que c’est au juge, dans cette hypothèse, qu’il reviendra de trancher, soit d’autoriser ou de refuser l’intervention d’un tiers.
?Le versement d’une avance sur frais exposés
Le second alinéa de l’article 1222 du Code civil complète le dispositif encadrant la faculté de remplacement conférée au créancier en lui permettant de solliciter la condamnation du débiteur à faire l’avance des sommes nécessaires à l’exécution ou la destruction en cause.
Ainsi, lorsque le créancier ne souhaite pas supporter temporairement le coût de l’intervention du tiers dans l’attente d’être remboursé par le débiteur, il n’aura d’autre choix que de saisir le juge.
Cette obligation de saisir le juge vaut, tant lorsqu’il s’agit pour le créancier d’exercer sa faculté de remplacement, que lorsqu’il s’agit de faire détruire ce qui a été fait en violation d’une obligation contractuelle.