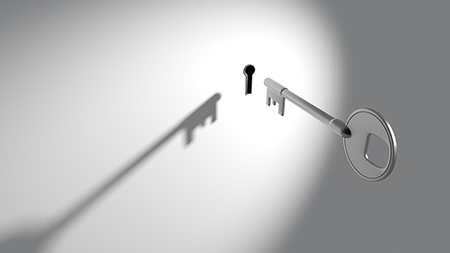Par un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation a considéré qu’une banque ne pouvait pas opposer au juge commercial le secret bancaire afin de se soustraire à l’injonction formulée par une ordonnance sur requête prise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
==> Faits
Une société (SICL) régie par le droit des Îles Caïmans, a ouvert un compte dans les livres de la banque BSI Ifabanque, devenue la société IFA
La société SICL a, le 22 mai 2009, effectué un virement bancaire de la somme de 50 000 000 de dollars américains (USD) à partir d’un compte dont elle était titulaire dans une banque à Zurich, vers un autre de ses comptes, ouvert dans les livres de la société BSI Ifabanque, puis, le même jour, a viré cette somme de ce compte sur celui dont une société Delmon Dana était titulaire dans la même banque
Par une décision du 18 septembre 2009, la juridiction compétente des Îles Caïmans a prononcé la liquidation judiciaire de la société SICL et nommé trois liquidateurs qui, agissant ès qualités, ont présenté le 26 juin 2013 au président du tribunal de commerce de Paris une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit désigné un huissier de justice chargé de rechercher des documents permettant d’établir :
- d’une part, la preuve que le virement fait au profit de la société Delmon Dana avait été réalisée en violation des obligations de la société BSI Ifabanque
- d’autre part, que cet établissement bancaire, en connaissance de cause, avait facilité la réalisation d’une opération visant à détourner les avoirs de la société SICL, à un moment où sa situation financière était précaire
Le Tribunal de commerce de Paris a accédé à la demande des requérants en rendant un ordonnance le 27 juin 2017 qui prévoyait :
- En premier lieu, la désignation d’un huissier de justice aux fins de rechercher et se faire remettre un certain nombre de documents et correspondances, y compris électroniques, relatifs aux relations entre les sociétés IFA et SICL, aux virements de 50 000 000 USD apparaissant sur le relevé du mois de mai 2009 du compte bancaire de la société SICL et aux opérations réalisées durant le mois de mai 2009 sur les comptes, autorisant l’huissier de justice à procéder à une copie complète, en deux exemplaires, des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtraient en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre devait servir de référentiel et ne pas être transmise à la partie requérante et l’autre permettre à l’huissier de justice de procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-avant
- En second lieu, que faute pour les requérants d’assigner en référé les parties visées par les mesures dans un délai de trente jours après l’exécution de celles-ci, le mandataire de justice remettrait les pièces et documents recueillis à la partie dont il les aurait obtenues.
==> Demande
Après que l’huissier de justice a accompli sa mission en juillet 2013, la société SICL a, le 1er août 2013, assigné sa banque par-devant le juge des référés pour qu’il soit ordonné à l’huissier de justice de lui remettre l’intégralité des documents recueillis au cours de l’exécution de la mesure ordonnée et placés sous séquestre
Reconventionnellement, la banque a demandé la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013
Par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge des référés a :
- D’abord, rejeté la demande de la banque tendant à la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013,
- Ensuite, ordonné la destruction des deux disques durs, de deux DVD et d’un fichier recueillis par l’huissier de justice
- Enfin, dit qu’un certain nombre de documents papier seraient conservés sous séquestre entre ses mains, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision de justice, ordonnant à l’huissier de justice de remettre à la société SICL les autres documents papier copiés
La banque a interjeté appel de cette décision
==> Procédure
Par un arrêt du 9 juin 2016, la Cour d’appel de paris a débouté la banque de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 201.
Les juges du fond estiment d’abord que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce permettent au liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur
Ils relèvent ensuite que la mission des liquidateurs de la société SICL était la même que celle dont ils auraient été investis s’ils avaient été désignés par une juridiction française
En outre, ils avancent que, en vertu de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité civile contre la banque, preuves que la société SICL ne pouvait se procurer par d’autres moyens
Le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires.
==> Solution
Par un arrêt du 29 novembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la banque.
Elle affirme, au soutien de sa décision, que « le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ».
Elle en déduit que le droit d’information des liquidateurs de la société SICL pouvait s’étendre à des éléments confidentiels dont la banque avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions relatives à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire.
Ainsi, pour la chambre commerciale, un établissement bancaire ne peut pas opposer le secret bancaire lorsque sa levée est sollicitée dans le cadre d’une action en justice dirigée contre lui.
==> Analyse
La solution adoptée par la Cour de cassation, en l’espèce, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure.
Pour mémoire, si conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financière les informations détenues par un établissement bancaire sur ses clients dans le cadre de l’exercice de son activité sont couvertes par le secret professionnel, il ne s’agit là en aucun cas d’un principe absolu.
Non seulement cette disposition prévoit un certain nombre de dérogations au secret bancaire, mais encore il faut compter sur d’autres exceptions énoncées en dehors du Code monétaire et financier.
La question s’est ainsi posée pour l’article 10, alinéa 1er du Code civil qui prévoit que « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité », sauf à justifier, précise l’alinéa 2, d’un « motif légitime ».
L’article 11, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aussi, la question qui se posait en l’espèce était de savoir si une demande fondée sur l’article 145 (mesure d’instruction in futurum) du Code de procédure civile constituait un motif légitime justifiant la levée du secret bancaire.
Deux situations doivent être distinguées :
- L’établissement bancaire à qui il est demandé de produire des pièces couvertes par le secret bancaire est un tiers à l’instance
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère de façon constante que le secret bancaire est opposable au juge civil ou commercial.
- Le secret bancaire est ainsi considéré comme constituant un motif légitime justifiant une neutralisation de l’application de l’article 10 du Code civil et de l’article 11 du Code de procédure civile.
- La Cour de cassation a statué en ce sens notamment dans un arrêt du 13 juin 1995 ( com., 13 juin 1995).
- L’établissement bancaire à qui il est demandé de produire des pièces couvertes par le secret bancaire est partie à l’instance
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a également considéré que le secret bancaire constituait un motif légitime susceptible d’être opposé au juge civil et commercial, quand bien même la banque était partie à l’instance.
- Dans un arrêt du 25 février 2003, la chambre commerciale a jugé en ce sens, au visa des articles L. 511 du Code monétaire et financier et 10 du Code civil, que « le pouvoir du juge civil d’ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu’il estime utile à la manifestation de la vérité, est limité par l’existence d’un motif légitime tenant notamment au secret professionnel»
- Ainsi, dans cette décision, la Cour de cassation estime-t-elle que l’établissement bancaire pouvait se prévaloir du secret bancaire pour ne pas déférer à la demande de production de pièces fût-ce-t-elle formulée par un juge.
Au regard de la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation semble retenir, en l’espèce, la solution inverse de celle qui avait été adoptée en 2003.
Est-ce à dire que la chambre commerciale opère un revirement de jurisprudence ? Une lecture attentive des décisions antérieures permet d’en douter.
En effet, lorsque la banque est partie à l’instance, il convient de distinguer selon que l’information couverte par le secret professionnel concerne un tiers ou selon qu’elle est nécessaire, soit à la résolution du litige, soit à sa propre défense :
- L’information couverte par le secret bancaire concerne un tiers
- Dans cette hypothèse, il n’est pas douteux que le secret bancaire demeure opposable au juge civil ou commercial, quand bien même la banque est partie à l’instance.
- La Cour de cassation a notamment statué en ce sens dans un arrêt du 25 janvier 2005 ( com., 25 janv. 2005).
- L’information couverte par le secret bancaire est nécessaire à la résolution du litige ou à la défense de la banque
- Dans cette hypothèse, la Cour de cassation a toujours considéré que le secret bancaire ne constituait pas un motif légitime susceptible de faire échec à une injonction du juge.
- Cette solution a été retenue notamment dans un arrêt du 19 juin 1990 ( com. 19 juin 1990).
- Plus récemment, elle a estimé que « dès lors qu’il appartient au banquier d’établir l’existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution ou à ses ayants droit, ceux-ci sont en droit d’obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal nécessaires à l’administration d’une telle preuve, sans que puisse leur être opposé le secret bancaire» ( com. 16 déc. 2008).
La solution adoptée, en l’espèce, par la chambre commerciale s’inscrit indéniablement dans le second cas de figure.
Les pièces sollicitées auprès de la banque étaient, en effet, nécessaires à la résolution du litige, d’où l’impossibilité pour cette dernière de se prévaloir du secret bancaire.
En conclusion, la présente décision ne constitue nullement un revirement de jurisprudence, mais seulement une confirmation des solutions antérieures.
| Cass. com. 29 nov. 2017 |
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2016), que la Société Saad Investments Company Limited (la société SICL), régie par le droit des Îles Caïmans, a ouvert un compte dans les livres de la société BSI Ifabanque, devenue la société IFA ; que la société SICL a, le 22 mai 2009, effectué un virement bancaire de la somme de 50 000 000 de dollars américains (USD) à partir d’un compte dont elle était titulaire dans une banque à Zurich, vers un autre de ses comptes, ouvert dans les livres de la société BSI Ifabanque, puis, le même jour, a viré cette somme de ce compte sur celui dont une société Delmon Dana était titulaire dans la même banque ; que la juridiction compétente des Îles Caïmans a, le 18 septembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SICL et nommé trois liquidateurs qui, agissant ès qualités, ont présenté le 26 juin 2013 au président du tribunal de commerce de Paris une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit désigné un huissier de justice chargé de rechercher des documents permettant d’établir la preuve que le virement fait au profit de la société Delmon Dana avait été réalisé en violation des obligations de la société BSI Ifabanque et que celle-ci, en connaissance de cause, avait facilité la réalisation d’une opération visant à détourner les avoirs de la société SICL, à un moment où sa situation financière était précaire ; qu’une ordonnance du 27 juin 2013 a désigné un huissier de justice, avec pour mission, notamment, de rechercher et se faire remettre un certain nombre de documents et correspondances, y compris électroniques, relatifs aux relations entre les sociétés IFA et SICL, aux virements de 50 000 000 USD apparaissant sur le relevé du mois de mai 2009 du compte bancaire de la société SICL et aux opérations réalisées durant le mois de mai 2009 sur les comptes, autorisant l’huissier de justice à procéder à une copie complète, en deux exemplaires, des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraîtraient en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre devait servir de référentiel et ne pas être transmise à la partie requérante et l’autre permettre à l’huissier de justice de procéder, de manière différée, avec l’aide du technicien choisi par lui, à l’ensemble des recherches et analyses visées ci-avant ; que l’ordonnance précisait, en outre, que faute pour les requérants d’assigner en référé les parties visées par les mesures dans un délai de trente jours après l’exécution de celles-ci, le mandataire de justice remettrait les pièces et documents recueillis à la partie dont il les aurait obtenues ; que l’huissier de justice ayant accompli sa mission en juillet 2013, la société SICL a, le 1er août 2013, assigné la société IFA devant le juge des référés pour qu’il soit ordonné à l’huissier de justice de lui remettre l’intégralité des documents recueillis au cours de l’exécution de la mesure ordonnée et placés sous séquestre ; que, reconventionnellement, la société IFA a demandé la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013 ; que, par ordonnance du 30 janvier 2014, le juge des référés a, notamment, rejeté la demande de la société IFA tendant à la rétractation de l’ordonnance du 27 juin 2013, en a modifié certains termes, a ordonné la destruction des deux disques durs, de deux DVD et d’un fichier recueillis par l’huissier de justice et dit qu’un certain nombre de documents papier seraient conservés sous séquestre entre ses mains, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par décision de justice, ordonnant à l’huissier de justice de remettre à la société SICL les autres documents papier copiés ; que la société IFA a formé appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société IFA fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2013, d’ordonner à la SCP Chevrier de Zitter et Asperti de remettre à la société SICL, représentée par ses liquidateurs, et à la société IFA un exemplaire du DVD-R dénommé « SAAD-20130711 » incluant le répertoire Export, le sous-répertoire 1 et le fichier « Filelist » de type “Excel”, et contenant 224 éléments, ainsi que la copie des 84 documents papiers, y compris ceux numérotés n° 3, 4, 5, 18, 20, 21, 38, 39, 40, 45, 46, 55, 59, 60, 79, 80, 81 et 82 alors, selon le moyen :
1°/ que le secret professionnel institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; que l’article L. 622-6, alinéa 3, du code de commerce, applicable en cas de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-4, alinéa 4, du même code, ne permet au liquidateur judiciaire d’une entreprise que d’obtenir les éléments permettant de connaître la situation patrimoniale du débiteur ; qu’en l’espèce, la société IFA faisait valoir que les mesures autorisées par l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 27 juin 2013 contrevenaient au secret bancaire dans la mesure où elles permettaient à un huissier d’avoir accès à des documents, sur divers supports, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, dans le but de connaître les conditions dans lesquelles avait été exécuté le transfert d’une somme de 50 millions de dollars, créditée le 22 mai 2009 sur le compte de la société SICL dans les livres de la société IFA, et virée le même jour sur un compte appartenant à une société Delmon Dana ; que, pour débouter la société IFA de sa demande de rétractation de cette ordonnance, la cour d’appel a considéré qu’en vertu des articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, qui permettent au liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication par les établissements de crédit des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, les liquidateurs de la société SICL étaient fondés à obtenir communication d’éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD, puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire ; qu’en statuant de la sorte, quand les articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce n’autorisent le liquidateur judiciaire d’une entreprise qu’à obtenir communication des éléments intéressant la situation patrimoniale du débiteur, non celle d’autres éléments couverts par le secret professionnel du banquier, la cour d’appel a violé ces dispositions, ensemble l’article L. 511-33 du code monétaire et financier et l’article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que la procédure collective d’une entreprise de droit étranger est régie par le droit de l’Etat dont dépend cette société ; qu’en jugeant, pour dire que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce pouvaient être invoqués par la société de droit des îles Caïmans SICL, que les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire, pour en déduire que les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l’Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret sont demandées, la cour d’appel a violé les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce, ensemble l’article 3 du code civil ;
3°/ que le secret professionnel institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu’il ne prive pas le titulaire d’un compte bancaire de la possibilité d’établir la preuve d’un fait intéressant le fonctionnement de son compte, mais fait obstacle à la divulgation de tous autres éléments couverts par le secret bancaire ; que pour valider les mesures autorisées par l’ordonnance du 27 juin 2013, la cour d’appel a retenu qu’en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société SICL avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité civile à l’encontre de la société IFA, et qu’elle ne disposait d’aucun autre moyen de se procurer les preuves de l’éventuelle exécution fautive du transfert de la somme de 50 millions de dollars au profit de la société Delmon Dana ; qu’en statuant de la sorte, quand le secret professionnel auquel était tenue la société IFA faisait obstacle à ce que des pièces couvertes par celui-ci soient divulguées à des tiers, la société SICL, en qualité de client de la banque, pouvant obtenir communication des informations intéressant le fonctionnement de son compte, la cour d’appel a violé l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l’article 145 du code de procédure civile ;
4°/ que le secret professionnel institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu’en jugeant, par motifs propres et éventuellement adoptés du premier juge, qu’en tout état de cause, le juge des référés ayant rendu l’ordonnance du 27 juin 2013 avait pris soin de prescrire des mesures permettant d’assurer le respect du secret professionnel auquel était astreinte la société IFA, puisqu’il avait prévu, dans un premier temps, la mise sous séquestre des pièces réunies par la SCP Chevrier de Zitter et Asperti et, dans un second temps, une procédure de référé pour qu’il soit statué sur la communication de ces pièces aux parties, la cour d’appel a violé l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ensemble l’article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ; qu’après avoir énoncé que les articles L. 622-6, alinéa 3, et L. 641-4, alinéa 4, du code de commerce permettent au liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, communication, notamment par les établissements de crédit, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur, c’est par une interprétation souveraine du droit des Îles Caïmans, non arguée de dénaturation, que l’arrêt retient que, si la procédure de liquidation de la société SICL était régie par la loi de cet Etat, les liquidateurs de cette société avaient une mission identique à celle accordée par le code de commerce français au liquidateur judiciaire et que, dès lors, les règles françaises dérogeant au secret bancaire étaient applicables, comme étant celles de l’Etat dans lequel est établie la banque à laquelle les informations couvertes par le secret étaient demandées ; que l’arrêt retient ensuite qu’en vertu de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société SICL, représentée par ses liquidateurs, avait le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter effectivement sa cause, y compris ses preuves, devant le juge du fond éventuellement saisi d’une action en responsabilité civile contre la société IFA, preuves que la société SICL ne pouvait se procurer par d’autres moyens ; que de ces énonciations et appréciations, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d’appel a exactement déduit que le droit d’information des liquidateurs de la société SICL s’étendait à des éléments confidentiels dont la société IFA avait pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions, relatifs à la société Delmon Dana ou à tout autre tiers ayant été mêlé au transfert de la somme de 50 000 000 USD puisque ces informations avaient pour objet de vérifier les conditions et la régularité de cette opération bancaire et que le juge des requêtes était, en conséquence, fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement litigieux et ses véritables bénéficiaires ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société IFA fait grief à l’arrêt d’infirmer l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle avait ordonné la destruction des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti, tout en ordonnant la restitution à la société des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d’une décision de justice équivaut à une absence de motifs ; qu’en l’espèce, aux termes des motifs de l’arrêt attaqué la cour d’appel a estimé que « le premier juge a[vait] excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l’huissier de justice au cours de sa mission, puisqu’aucune des parties n’avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication » ; qu’elle en a déduit que « ce seul motif suffit à justifier l’infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA » ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d’appel a toutefois « infirm[é], dans la limite de l’appel auquel M. X... et M. Y... ne sont pas parties, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle : (…) ordonne la destruction des deux disques durs » ; qu’en l’état de cette contradiction entre ses motifs et son dispositif, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu’est privée de tout fondement la décision de justice affectée d’une contradiction entre deux chefs de son dispositif ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a « infirm[é], dans la limite de l’appel auquel M. X... et M. Y... ne sont pas parties, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle : (…) ordonne la destruction des deux disques durs » ; qu’en statuant de la sorte, tout en ordonnant « la restitution à la société IFA des deux disques durs placés sous séquestre entre les mains de la SCP Chevrier de Zitter et Asperti », la cour d’appel s’est contredite, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d’une part, que c’est à la suite d’une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l’arrêt, que cette décision, dans son dispositif, a infirmé, dans la limite de l’appel auquel MM. X... et Y... n’étaient pas parties, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle (…) ordonne la destruction des deux disques durs, cependant que, dans les motifs de sa décision, la cour d’appel a retenu que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en ordonnant la destruction des deux disques durs appréhendés par l’huissier de justice au cours de sa mission, puisqu’aucune des parties n’avait demandé une telle mesure, la société IFA ayant sollicité la restitution de ces supports informatiques et les liquidateurs de la société SICL en ayant réclamé la communication ; que ce seul motif suffisait à justifier l’infirmation de cette disposition de la décision du juge des référés et que rien ne s’opposait à ce que les deux disques durs soient restitués à la société IFA, puisqu’ils ne contenaient pas d’informations correspondant à la mission de l’huissier de justice ;
Et attendu, d’autre part, que la rectification de cette erreur matérielle a pour conséquence de supprimer la contradiction interne au dispositif de l’arrêt et de rendre le grief de la seconde branche sans portée ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l’erreur matérielle affectant l’arrêt attaqué, dit que, dans le dispositif de celui-ci, au lieu de « infirme, dans la limite de l’appel auquel M. X... et M. Y... ne sont pas parties, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle déboute la société IFA de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2013, ordonne la destruction des deux disques durs », il faut lire « infirme, dans la limite de l’appel auquel M. X... et M. Y... ne sont pas parties, l’ordonnance rendue le 30 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle déboute la société IFA de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 juin 2013 » ;
|
| Cass. com. 25 févr. 2003 |
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ayant, dans l'ignorance du décès de Fetta X... survenu le 6 mars 1993, continué à virer jusqu'en décembre 1993 les arrérages de sa retraite sur le compte dont elle titulaire à la BNP-PARIBAS (la banque), a demandé à cette dernière de lui communiquer les coordonnées de la personne ayant procuration sur le compte, aux fins de restitution de l'indu ; que la banque lui ayant opposé le secret professionnel, la CNAV a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à ses prétentions ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a ordonné la communication sollicitée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que les mesures sollicitées par la CNAV l'étaient en vue de diligenter postérieurement une procédure en répétition de l'indu ; que de telles mesures relèvent du seul pouvoir du juge des référés ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de son analyse concernant l'étendue de ses propres prérogatives, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir au mépris de l'article 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de la BNP-PARIBAS que celle-ci avait demandé à la cour d'appel de faire application des dispositions de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et d'infirmer le jugement déféré, d'où il suit que le moyen qui repose sur une prétention contraire à celle exprimée dans les écritures d'appel et critique une disposition de l'arrêt qui a fait droit à la demande, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511 du Code monétaire et financier, et l'article 10 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le pouvoir du juge civil d'ordonner à une partie ou à un tiers de produire tout document qu'il estime utile à la manifestation de la vérité, est limité par l'existence d'un motif légitime tenant notamment au secret professionnel ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la CNAV, la cour d'appel retient que le secret professionnel institué par l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 ne constitue pas un empêchement légitime opposable à cet organisme dès lors que les seuls renseignements sollicités étaient relatifs à l'identité de la ou des personnes qui, après le décès de la titulaire du compte, l'avaient fait fonctionner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la production ordonnée se heurtait aux règles légales sur le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit, qui ne cesse pas avec la disparition de la personne qui en bénéficie et s'étend aux personnes qui ont eu le pouvoir de faire fonctionner le compte, et qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettant à la Cour de Cassation de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fait droit à la demande de communication de renseignements de la CNAV, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP-PARIBAS et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Dit que les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Métivet , conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
|
TEXTES
Code monétaire et financier
Article 511-33
I – Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d’une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d’autre part, aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs établissements de crédit ou sociétés de financement ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d’assurance destinées à la couverture d’un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une société de financement ;
4° Cessions d’actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l’étude ou l’élaboration de tout type de contrats ou d’opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l’auteur de la communication.
Lors d’opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu’une législation ou une réglementation d’un Etat qui n’est pas membre de l’Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s’effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
II – Le personnel des établissements de crédit, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement soumis au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes, peuvent signaler à l’Autorité les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre III du présent livre ou d’un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tout élément de nature à établir la réalité des faits signalés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.