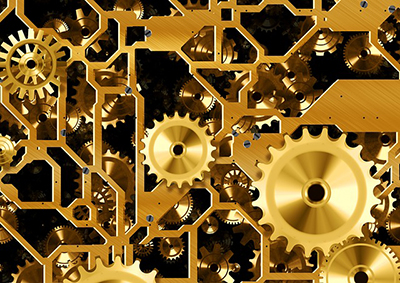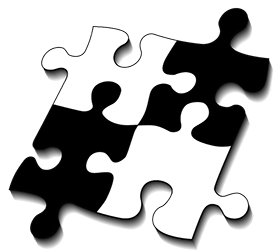En vertu de l’article 146 du Code civil « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».
Autrefois, c’était la seule condition qui était exigée pour se marier. Le simple échange des consentements suffisait à former les liens du mariage.
Aujourd’hui, bien que d’autres exigences aient été imposées aux époux par le législateur, le consentement a conservé une place centrale dans le processus de formation du mariage.
Son appréhension n’en est pas moins toujours source de difficultés.
==>La difficile appréhension de la notion de consentement
Simple en apparence, l’appréhension de la notion de consentement n’est pas sans soulever de nombreuses difficultés.
Que l’on doit exactement entendre par consentement ?
Le consentement est seulement défini de façon négative par le Code civil, l’article 180 du Code civil se bornant à énumérer les cas où le défaut de consentement constitue une cause de nullité du mariage.
L’altération de la volonté d’une partie est, en effet, susceptible de renvoyer à des situations très diverses :
- L’une des parties peut être atteinte d’un trouble mental
- Le consentement d’un contractant peut avoir été obtenu sous la contrainte physique ou morale
- Une partie peut encore avoir été conduite à s’engager sans que son consentement ait été donné en connaissance de cause, car une information déterminante lui a été dissimulée
- Une partie peut, en outre, avoir été contrainte de contracter en raison de la relation de dépendance économique qu’elle entretient avec son cocontractant
- Un contractant peut également s’être engagé par erreur
Il ressort de toutes ces situations que le défaut de consentement d’une partie peut être d’intensité variable et prendre différentes formes.
La question alors se pose de savoir dans quels cas le défaut de consentement fait-il obstacle à la formation du contrat ?
Autrement dit, le trouble mental dont est atteinte une partie doit-il être sanctionné de la même qu’une erreur commise par un consommateur compulsif ?
==> Existence du consentement et vice du consentement
Il ressort des dispositions relatives au consentement que la satisfaction de cette condition est subordonnée à la réunion de deux éléments :
- Le consentement doit exister
- À défaut, le mariage n’a pas pu valablement se former dans la mesure où l’une des parties n’a pas exprimé son consentement
- Or cela constitue un obstacle à la rencontre des volontés.
- Le consentement ne doit pas être vicié
- À la différence de l’hypothèse précédente, dans cette situation les parties ont toutes deux exprimé leurs volontés.
- Seulement, le consentement de l’une d’elles n’était pas libre et éclairé :
- soit qu’il n’a pas été donné librement
- soit qu’il n’a pas été donné en connaissance de cause
- En toutes hypothèses, le consentement de l’un des cocontractants est vicié, de sorte que le contrat, s’il existe bien, n’en est pas moins invalide, car entaché d’une irrégularité.
En résumé, pour ce qui est de la condition du consentement, deux choses doivent être vérifiées :
- Le consentement doit exister (il doit avoir été manifesté)
- Le consentement doit être intègre (lors de sa manifestation il ne doit pas avoir été vicié)
Dans un ancien arrêt rendu en date du 9 novembre 1887, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’article 146 portant qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement comprend tout à la fois le cas où le consentement est le résultat d’une volonté oblitérée par la démence et ceux où il n’est donné qu’à la suite de violences physiques ou morales exercées sur les époux ou l’un d’eux, ou d’une erreur sur la personne avec laquelle l’un des époux a déclaré vouloir s’unir, que dans aucune de ces circonstances, le consentement ne peut être réputé l’expression d’une volonté certaine et libre, capable d’engendrer un engagement formant un lien légal entre les parties. » (Cass. civ. 9 nov. 1887)
Il ne suffit donc pas que les futurs époux soient sains d’esprit pour que la condition tenant au consentement soit remplie.
Il faut encore que ledit consentement ne soit pas vicié, ce qui signifie qu’il doit être libre et éclairé :
- Libre signifie que le consentement ne doit pas avoir été sous la contrainte
- Éclairé signifie que le consentement doit avoir été donné en connaissance de cause
Manifestement, le Code civil fait une large place aux vices du consentement. Dès lors, en effet, que l’on fait de la volonté la condition centrale du mariage, il est nécessaire qu’elle présente certaines qualités.
Pour autant, les rédacteurs du Code civil ont eu conscience de ce que la prise en considération de la seule psychologie des contractants aurait conduit à une trop grande insécurité juridique.
Car en tenant compte de tout ce qui est susceptible d’altérer le consentement, cela aurait permis aux parties d’invoquer le moindre vice en vue d’obtenir l’annulation de leur union.
C’est la raison pour laquelle, tout en réservant une place importante aux vices du consentement, tant les rédacteurs du Code civil que le législateur contemporain n’ont admis qu’ils puissent entraîner la nullité du contrat qu’à des conditions très précises.
En droit commun du contrat, il résulte de l’article 1130, al. 1er du Code civil que les vices du consentement qui constituent des causes de nullité du contrat sont au nombre de trois :
- L’erreur
- Le dol
- La violence
En matière de mariage, le nombre des vices du consentement est réduit à deux.
L’article 180 du Code civil prévoit seulement que :
« Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage.
S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Il ressort de cette disposition que seules l’erreur et la violence sont des causes de nullité du mariage.
Le dol n’est pas visé par cette disposition, ce qui inévitablement conduit à l’exclure des vices du consentement susceptible d’anéantir le mariage.
I) L’exclusion du dol
A) En droit commun
Classiquement, le dol est défini comme le comportement malhonnête d’une partie qui vise à provoquer une erreur déterminante du consentement de son cocontractant.
Si, de la sorte, le dol est de nature à vicier le consentement d’une partie au contrat, il constitue, pour son auteur, un délit civil susceptible d’engager sa responsabilité.
Lorsqu’il constitue un vice du consentement, le dol doit être distingué de plusieurs autres notions :
- Dol et erreur
- Contrairement au vice du consentement que constitue l’erreur qui est nécessairement spontanée, le dol suppose l’établissement d’une erreur provoquée par le cocontractant.
- En matière de dol, le fait générateur de l’erreur ne réside donc pas dans la personne de l’errans, elle est, au contraire, le fait de son cocontractant.
- En somme, tandis que dans l’hypothèse de l’erreur, un contractant s’est trompé sur le contrat, dans l’hypothèse du dol ce dernier a été trompé.
- Dol au stade de la formation du contrat et dol au stade de l’exécution
- Au stade de la formation du contrat, le dol consiste en une tromperie qui vise à conduire l’autre partie à conclure le contrat sur une fausse conviction
- Au stade de l’exécution du contrat, le dol s’apparente à un manquement délibéré d’une partie à une ou plusieurs obligations qui lui échoient
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 une disposition unique était consacrée au dol : l’article 1116 du Code civil.
Cette disposition prévoyait à son alinéa 1er que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». L’alinéa 2 précisait qu’« il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Dorénavant, trois articles sont consacrés par le Code civil au dol : les articles 1137 à 1139. Le législateur s’est, toutefois, contenté d’entériner les solutions classiquement adoptées par la jurisprudence.
Aux termes de l’article 1137, alinéa 1er du Code civil « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
L’alinéa 2 ajoute que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. ».
Bien que, en droit commun des contrats, en ce qu’il constitue un vice du consentement, le dol est une cause de nullité, telle n’est pas la solution retenue en matière matrimoniale.
B) En droit matrimonial
Aucune des règles qui encadrent le consentement en matière matrimoniale ne vise le dol comme cause de nullité du mariage.
Il en résulte qu’il ne saurait fonder l’anéantissement de l’union conjugale, nonobstant l’exercice par l’un des époux de manœuvres dolosives.
La raison en est que, pas de nullité sans texte !
Au vrai, comme remarqué par les auteurs, « ce silence est intentionnel »[1]. Il a pris racine dans le célèbre adage énoncé par le jurisconsulte Antoine Loysel qui, au XIXe siècle, écrivait dans les Institutes Coutumières « en mariage trompe qui peut ».
L’exclusion du dol des causes de nullité du mariage se justifie par la nature de la relation entretenue entre les futurs époux qui, par essence, relève de la séduction.
Admettre le dol reviendrait à prendre le risque que le mariage puisse être annulé trop facilement, notamment au prétexte que l’un des époux aurait été séduit par le discours fallacieux de son conjoint.
Comme exprimé dans une vieille décision du Tribunal de grande instance du Mans rendue en date du 18 mars 1965 « le mariage est un acte solennel dont la stabilité est essentielle à la société ; qu’il faut fermer autant que faire se peut la porte au repentir tardif des époux ».
On relèvera néanmoins que, dans de nombreuses décisions, la jurisprudence admet le dol en ce qu’il a provoqué une erreur déterminante du consentement d’un époux.
Dans un arrêt rendu en date du 27 janvier 1998 la Cour de cassation a ainsi validé l’annulation d’un mariage après avoir relevé que « le pourvoi se heurte aux constatations des juges du fond qui, de l’ensemble des éléments de preuve soumis à leur appréciation, ont souverainement retenu que M. X… n’a jamais eu l’intention sincère de fonder un foyer avec Mme Y… qu’il avait trompée sur ses intentions véritables et dont il avait surpris le consentement » (Cass. 1ère civ. 27 janv. 1998).
Cette décision est somme toute contestable, en ce qu’elle se situe à la lisière entre le dol et l’erreur. Au fond, qu’est-ce que le dol, sinon une erreur provoquée ?
En toute hypothèse, dans bien des cas l’erreur déterminante d’un époux sur les qualités essentielles de son conjoint résultera de manœuvres dolosives
II) L’erreur
A) En droit commun
L’erreur peut se définir comme le fait pour une personne de se méprendre sur la réalité. Cette représentation inexacte de la réalité vient de ce que l’errans considère, soit comme vrai ce qui est faux, soit comme faux ce qui est vrai.
L’erreur consiste, en d’autres termes, en la discordance, le décalage entre la croyance de celui qui se trompe et la réalité.
Lorsqu’elle est commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, l’erreur consiste ainsi dans l’idée fausse que se fait le contractant sur tel ou tel autre élément du contrat.
Il peut donc exister de multiples erreurs :
- L’erreur sur la valeur des prestations: j’acquiers un tableau en pensant qu’il s’agit d’une toile de maître, alors que, en réalité, il n’en est rien. Je m’aperçois peu de temps après que le tableau a été mal expertisé.
- L’erreur sur la personne: je crois solliciter les services d’un avocat célèbre, alors qu’il est inconnu de tous
- Erreur sur les motifs de l’engagement : j’acquiers un appartement dans le VIe arrondissement de Paris car je crois y être muté. En réalité, je suis affecté dans la ville de Bordeaux
Manifestement, ces hypothèses ont toutes en commun de se rapporter à une représentation fausse que l’errans se fait de la réalité.
Cela justifie-t-il, pour autant, qu’elles entraînent la nullité du contrat ? Les rédacteurs du Code civil ont estimé que non.
Afin de concilier l’impératif de protection du consentement des parties au contrat avec la nécessité d’assurer la sécurité des transactions juridiques, le législateur, tant en 1804, qu’à l’occasion de la réforme du droit des obligations, a décidé que toutes les erreurs ne constituaient pas des causes de nullité.
Pour constituer une cause de nullité l’erreur doit, en toutes hypothèses, être, déterminante et excusable.
En outre, aux termes de l’article 1132 du Code civil « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Il ressort de cette disposition que seules deux catégories d’erreur sont constitutives d’une cause de nullité du contrat :
- L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due
- L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant
C’est là que s’opère la distinction entre le droit commun et le droit matrimonial.
À l’évidence, en matière de mariage, seule l’erreur sur les qualités essentielles de l’époux apparaît pertinente.
B) En droit matrimonial
L’article 180, al. 2 du Code civil dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. »
Ainsi, à l’instar du droit commun, l’erreur est une cause de nullité du mariage. Son champ d’application est toutefois plus restreint qu’en droit des contrats.
Pour justifier l’anéantissement du mariage, elle doit porter :
- Soit dans la personne de l’époux
- Soit sur des qualités essentielles de la personne de l’époux
Initialement, l’article 180 ne visait que l’erreur « dans la personne ». Ce n’est que tardivement que l’erreur « sur les qualités essentielles de la personne » a été envisagée par le législateur.
La modification de cette disposition résulte de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce qui, à l’inverse de l’effet recherché, a ajouté à la confusion initiale du texte.
==> L’ancien droit
Dans sa version en vigueur en 1804, l’article 180 du Code civil disposait que « lorsqu’il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur »
En application de cette disposition, la Cour de cassation a été conduite à se prononcer sur la notion d’erreur dans la personne dans un célèbre arrêt Berthon.
| Arrêt Berthon (Cass. ch. Runies, 24 avr. 1862) |
|
|---|---|
| REJET du pourvoi formé par Zoé-Marie-Louise Herbin contre un Arrêt rendu par la Cour impériale d'orléans, le 6 juillet 1861, en faveur du sieur X..., son mari. Du 24 Avril 1862. LA COUR, chambres réunies, Ouï M. Legagneur, conseiller, en son rapport ; Maître Ambroise A..., en ses observations, à l'audience publique du 22 avril ; Maître Z..., en ses observations, et M. le procureur général Dupin, en ses conclusions, à l'audience publique d'hier ; Vidant le délibéré en chambre du conseil ; Attendu que l'erreur dans la personne dont les articles 146 et 180 du Y... Napoléon ont fait une cause de nullité du mariage ne s'entend, sous la nouvelle comme sous l'ancienne législation, que d'une erreur portant sur la personne elle-même ; Attendu que si la nullité, ainsi établie, ne doit pas être restreinte au cas unique de l'erreur provenant d'une substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration ; Si elle peut également recevoir son application quand l'erreur procède de ce que l'un des époux s'est fait agréer en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne, et s'est attribué les conditions d'origine et la filiation qui appartiennent à un autre ; Le texte et l'esprit de l'article 180 écartent virtuellement de sa disposition les erreurs d'une autre nature, et n'admettent la nullité que pour l'erreur qui porte sur l'identité de la personne et par le résultat de laquelle l'une des parties a épousé une personne autre que celle à qui elle croyait s'unir ; Qu'ainsi la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu'elle aurait subies, et spécialement à l'erreur de l'époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s'en est suivie ; Que la déchéance établie par l'article 34 du Code pénal ne constitue par elle-même ni un empêchement au mariage ni une cause de nullité de l'union contractée ; Qu'elle ne touche non plus en rien à l'identité de la personne ; qu'elle ne peut donc motiver une action en nullité du mariage pour erreur dans la personne ; Qu'en le jugeant ainsi et en rejetant la demande en nullité de son mariage formée par Zoé Herbin, et motivée sur l'ignorance où elle avait été à l'époque du mariage de la condamnation à quinze ans de travaux forcés qu'avait antérieurement subie Berthon, son mari, et de la privation des droits civils et civiques qui en avait été la suite, l'arrêt attaqué n'a fait qu'une juste et saine application des articles 146 et 180 du Y... Napoléon. LA COUR REJETTE, Ainsi fait et prononcé, Chambres réunies. |
- Faits
- Mariage entre un ex-bagnard avec une fille de bonne famille
- Une fois seulement le mariage célébré, l’épouse apprend le passé de criminel de son mari
- Demande
- Action en nullité du mariage engagée par l’épouse
- Procédure
- Par un arrêt du 6 juillet 1861, la Cour d’appel d’Orléans déboute la requérante de sa demande
- Les juges du fond estiment que seule une erreur sur l’identité de la personne est susceptible de fonder une action en nullité du mariage
- Problème de droit
- Une épouse qui ignorait le passé criminel de son époux est-elle fondée à engager une action en nullité de son mariage ?
- Solution
- Par un arrêt du 24 avril 1862, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’épouse
- Au soutien de sa décision elle affirme que « l’erreur dans la personne dont les articles 146 et 180 du Y… Napoléon ont fait une cause de nullité du mariage ne s’entend, sous la nouvelle comme sous l’ancienne législation, que d’une erreur portant sur la personne elle-même»
- Elle en déduit que « la nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, sur des flétrissures qu’elle aurait subies, et spécialement à l’erreur de l’époux qui a ignoré la condamnation à des peines afflictives ou infamantes antérieurement prononcées contre son conjoint, et la privation des droits civils et civiques qui s’en est suivie»
- Au total, pour la Cour de cassation, seuls deux cas d’erreur constituent des causes de nullité du mariage :
- L’erreur sur l’identité physique de la personne
- Ce cas de figure correspond à la substitution frauduleuse de personne au moment de la célébration
- L’erreur sur l’identité civile de la personne
- Est ici envisagée l’hypothèse où l’un des époux s’est fait agréer en se présentant comme membre d’une famille qui n’est pas la sienne, et s’est attribué les conditions d’origine et la filiation qui appartiennent à un autre
- En l’espèce, l’erreur commise par Madame Berthon ne répondait à aucune de ces hypothèses, raison pour laquelle la haute juridiction a rejeté son pourvoi
- Pour la Cour de cassation, Madame Berthon s’est trompée, non pas sur la personne de son époux, mais sur sa qualité, soit celle d’ancien bagnard.
- Or l’erreur sur les qualités de la personne n’est pas une cause de nullité du mariage.
- Voilà une conception de l’erreur bien restrictive qui a été adoptée par la Cour de cassation dans cette décision.
- Cette conception a été jugée tellement restrictive par la doctrine, que le législateur est intervenu, en 1971, pour compléter l’article 180 du Code civil.
- L’erreur sur l’identité physique de la personne
En suite de l’arrêt Berthon, la jurisprudence a, dans l’ensemble, appliqué à la conception de l’erreur adoptée par la Cour de cassation en refusant d’annuler le mariage, toutes les fois que les époux invoquaient une erreur sur les qualités de la personne.
Les juridictions ont ainsi rejeté :
- L’erreur sur les aptitudes sexuelles du conjoint
- L’erreur sur le passé du conjoint
- L’erreur de la vertu de la femme
- L’erreur de la fortune du conjoint
- L’erreur sur la religion de l’époux
À compter des années 1960, les Tribunaux ont néanmoins assoupli leur position en admettant, en contradiction avec la solution retenue dans l’arrêt Berthon, de plus en plus facilement l’erreur sur les qualités de la personne.
Sous l’impulsion de ce mouvement de libéralisation de la jurisprudence, le législateur a pris conscience de la trop grande étroitesse de la conception de l’erreur en droit français, d’où son intervention en 1971.
==> Le droit positif
La loi du 11 juillet 1971 a mis un terme à la conception restrictive de l’erreur. Pour ce faire, elle a précisé l’article 180 du Code civil qui prévoit désormais que l’erreur peut porter, outre dans la personne de l’époux, sur ses « qualités essentielles »
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « qualités essentielles ».
Trois critères cumulatifs ont été posés par la jurisprudence :
- Un critère objectif
- Pour être prise en considération, la qualité de la personne doit être essentielle en vue du mariage : il s’agit d’apprécier la qualité de la personne eu égard à l’institution du mariage.
- Le juge va donc chercher à s’appuyer sur des critères objectifs.
- L’examen de la jurisprudence, permet d’établir un certain nombre de ces qualités essentielles ou accessoires.
- Exemples
- La santé physique et mentale
- Les aptitudes sexuelles
- Les croyances religieuses
- L’honorabilité du conjoint
- Un critère subjectif
- Pour que l’erreur soit prise en considération, il est nécessaire que la victime de l’erreur rapporte la preuve que l’absence de la qualité qu’elle reproche à son conjoint était antérieure au mariage.
- Cette exigence vaut, notamment pour ce qui concerne l’état mental ou l’aptitude aux rapports sexuels.
- Le caractère déterminant de l’erreur
- Pour être une cause de nullité du mariage, l’erreur doit avoir été déterminante du consentement de l’errans.
- Autrement dit, celui qui a commis l’erreur doit établir que s’il avait eu connaissance de l’absence de la qualité essentielle qui fait défaut chez son conjoint, il ne l’aurait pas épousé.
- À défaut de parvenir à rapporter la preuve du caractère déterminant de l’erreur, quand bien même elle porterait sur une qualité objectivement essentielle, elle ne constituera pas une cause de nullité.
III) La violence
Pour mémoire, l’article 180 du Code civil prévoit, en son alinéa 1er, que « le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d’eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
Il ressort de cette disposition que ce qui est cause de nullité c’est moins la violence qui est exercée à l’encontre d’un époux que l’absence de liberté de son consentement.
Toutefois, les juridictions ont très tôt assimilé le défaut de liberté à la violence. Il en a été déduit qu’il convenait de se reporter, pour apprécier la liberté de consentement d’un époux, aux règles qui connaissent de la violence en matière contractuelle.
Ces règles sont édictées aux articles 1140 à 1143 du Code civil.
==> Notion
Classiquement, la violence est définie comme la pression exercée sur une personne aux fins de le contraindre à consentir à la conclusion d’un acte.
Le nouvel article 1140 traduit cette idée en prévoyant qu’« il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. ».
Il ressort de cette définition que la violence doit être distinguée des autres vices du consentement pris dans leur globalité, d’une part et, plus spécifiquement du dol, d’autre part.
- Violence et vices du consentement
- La violence se distingue des autres vices du consentement, en ce que le consentement de la victime a été donné en connaissance de cause.
- Cependant, elle n’a pas contracté librement
- Autrement dit, en contractant, la victime avait pleinement conscience de la portée de son engagement, seulement elle s’est engagée sous l’empire de la menace
- Violence et dol
- Contrairement au dol, la violence ne vise pas à provoquer une erreur chez le cocontractant.
- La violence vise plutôt à susciter la crainte de la victime
- Ce qui donc vicie le consentement de cette dernière, ce n’est pas l’erreur qu’elle aurait commise sur la portée de son engagement, mais bien la crainte d’un mal qui pèse sur elle.
- Dit autrement, la crainte est à la violence ce que l’erreur est au dol.
- Ce qui dès lors devra être démontré par la victime, c’est que la crainte qu’elle éprouvait au moment de la conclusion de l’acte a été déterminante de son consentement
Antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, le Code civil consacrait cinq dispositions à la violence : les articles 1111 à 1115.
L’article 1112 prévoyait notamment que « il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».
Dorénavant, quatre articles sont consacrés par le Code civil au dol : les articles 1140 à 1143. Fondamentalement, le législateur n’a nullement modifié le droit positif, il s’est simplement contenté de remanier les dispositions existantes et d’entériner les solutions classiquement admises en jurisprudence.
Aussi, ressort-il de ces dispositions que la caractérisation de la violence suppose toujours la réunion de conditions qui tiennent :
- D’une part, à ses éléments constitutifs
- D’autre part, à son origine
A) Les conditions relatives aux éléments constitutifs de la violence
Il ressort de l’article 1140 du Code civil que la violence est une cause de nullité lorsque deux éléments constitutifs sont réunis :
- L’exercice d’une contrainte
- L’inspiration d’une crainte
- Une contrainte
==> L’objet de la contrainte : la volonté de l’époux
Tout d’abord, il peut être observé que la violence envisagée aux articles 180 et l’article 1140 du Code civil n’est autre que la violence morale, soit une contrainte exercée par la menace sur la volonté du contractant.
La contrainte exercée par l’auteur de la violence doit donc avoir pour seul effet que d’atteindre le consentement de la victime, à défaut de quoi, par hypothèse, on ne saurait parler de vice du consentement.
==> La consistance de la contrainte : une menace
La contrainte visée à l’article 1140 s’apparente, en réalité, à une menace qui peut prendre différentes formes.
Cette menace peut consister en tout ce qui est susceptible de susciter un sentiment de crainte chez la victime.
Ainsi, peut-il s’agir, indifféremment, d’un geste, de coups, d’une parole, d’un écrit, d’un contexte, soit tout ce qui est porteur de sens
==> Le caractère de la contrainte : une menace illégitime
La menace dont fait l’objet le contractant doit être illégitime, en ce sens que l’acte constitutif de la contrainte ne doit pas être autorisé par le droit positif.
A contrario, lorsque la pression exercée sur le contractant est légitime, quand bien même elle aurait pour effet de faire plier la volonté de ce dernier, elle sera insusceptible d’entraîner l’annulation du contrat.
La question alors se pose de savoir quelles sont les circonstances qui justifient qu’une contrainte puisse être exercée sur un contractant.
En quoi consiste, autrement dit, une menace légitime ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1141 qui prévoit que « la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
Cette disposition est, manifestement, directement inspirée de la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 17 janvier 1984 avait estimé que « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du code civil que s’il y a abus de cette voie de droit soit en la détournant de son but, soit en en usant pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l’engagement primitif» ( 3e civ. 17 janv. 1984).
Quel enseignement retenir de la règle énoncée par la jurisprudence, puis reprise sensiblement dans les mêmes termes par le législateur ?
Un principe assorti d’une limite
- Principe
- La menace exercée à l’encontre d’un contractant est toujours légitime lorsqu’elle consiste en l’exercice d’une voie de droit
- Ainsi, la menace d’une poursuite judiciaire ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne saurait constituer, en elle-même, une contrainte illégitime.
- Dans un arrêt du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a estimé en ce sens, au sujet d’un cautionnement qui aurait été conclu sous la contrainte, que « la violence morale ne pouvait résulter des appels même incessants d’un banquier, dès lors qu’il existait une raison légitime comme celle de finaliser un acte de cautionnement pour garantir un concours bancaire à la société, dont le gérant n’était autre que le fils de la caution, et ce, bien avant la procédure de redressement judiciaire qui n’était intervenue que quinze mois plus tard et qu’aucun élément médical personnel ne venait corroborer la détresse psychologique dont elle se prévalait, qui l’aurait conduite à un discernement suffisamment altéré pour remettre en cause la validité de son consentement» ( com. 22 janv. 2013).
- Limites
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
- Soit détournée de son but
- Il en va ainsi lorsque l’avantage procuré par l’exercice d’une voie de droit à l’auteur de la menace est sans rapport avec le droit dont il se prévaut
- La Cour de cassation a, de la sorte, approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé la nullité d’une reconnaissance de dette qui avait été « obtenue sous la menace d’une saisie immobilière relative au recouvrement d’une autre créance» ( 1ère civ. 25 mars 2003)
- Soit invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif
- La menace sera ainsi considérée comme illégitime lorsqu’elle est exercée en vue d’obtenir un avantage hors de proportion avec l’engagement primitif ou le droit invoqué
- La Cour de cassation a ainsi estimé que la contrainte consistant à menacer son cocontractant d’une procédure de faillite était illégitime, dans la mesure où elle avait conduit le créancier à obtenir de son débiteur des avantages manifestement excessifs ( com. 28 avr. 1953).
- Soit détournée de son but
- La légitimité de la menace cesse, nous dit l’article 1141, lorsque la voie de droit est :
2. Une crainte
La menace exercée à l’encontre d’un contractant ne sera constitutive d’une cause de nullité que si, conformément à l’article 1140, elle inspire chez la victime « la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »
Aussi, ressort-il de cette disposition que pour que la condition tenant à l’existence d’une crainte soit remplie, cela suppose :
- d’une part que cette crainte consiste en l’exposition d’un mal considérable
- d’autre part que ce mal considérable soit dirigé
- soit vers la personne même de la victime
- soit vers sa fortune
- soit vers ses proches
==> L’exposition à un mal considérable
- Reprise de l’ancien texte
- L’exigence tenant à l’établissement d’une crainte d’un mal considérable a été reprise de l’ancien article 1112 du Code civil qui prévoyait déjà cette condition.
- Ainsi, le législateur n’a-t-il nullement fait preuve d’innovation sur ce point-là.
- Notion
- Que doit-on entendre par l’exposition à un mal considérable ?
- Cette exigence signifie simplement que le mal en question doit être suffisamment grave pour que la violence dont est victime le contractant soit déterminante de son consentement.
- Autrement dit, sans cette violence, la victime n’aurait, soit pas contracté, soit conclu l’acte à des conditions différentes
- Le caractère déterminant de la violence sera apprécié in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
- La Cour de cassation prendra, en d’autres termes, en compte l’âge, les aptitudes, ou encore la qualité de la victime.
- Dans un arrêt du 13 janvier 1999, la Cour de cassation a par exemple approuvé une Cour d’appel pour avoir prononcé l’annulation d’une vente pour violence morale.
- La haute juridiction relève, pour ce faire que la victime avait «subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu’en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l’avaient conduite à conclure l’acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble» ( 3e civ. 13 janv. 1999).
- Il ressort manifestement de cet arrêt que la troisième chambre civile se livre à une appréciation in concreto.
- L’admission de la crainte révérencielle
- En droit commun des contrats, la crainte référentielle ne permet pas de retenir la violence contre un contractant.
- L’ancien article 1114 du Code civil prévoyait en ce sens que « la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. »
- Cette disposition signifiait simplement que la crainte de déplaire ou de contrarier ses parents ne peut jamais constituer en soi un cas de violence.
- En matière de droit matrimonial c’est la solution inverse qui a été retenue, et par la jurisprudence, et par le législateur.
- Ce dernier a consacré cette solution lors de l’adoption de la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs
- Ainsi, l’article 180 a-t-il été complété, la précision suivante ayant été ajoutée : « l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. »
- La crainte révérencielle est donc bien une cause de nullité du mariage.
==> L’objet de la crainte
Pour mémoire, l’ancien article 1113 du Code civil prévoyait que « la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. »
Dorénavant, la violence est caractérisée dès lors que la crainte qu’elle inspire chez la victime expose à un mal considérable :
- soit sa personne
- soit sa fortune
- soit celles de ses proches
Ainsi, le cercle des personnes visées l’ordonnance du 10 février 2016 est-il plus large que celui envisagé par les rédacteurs du Code civil.
B) Les conditions relatives à l’origine de la violence
Il ressort des articles 1142 et 1143 du Code civil que la violence est sanctionnée quel que soit son auteur.
L’article 1142 du Code civil prévoit expressément que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers. »
Les auteurs justifient cette règle par le fait que la violence n’a pas seulement pour effet de vicier le consentement de la victime : elle porte atteinte à sa liberté de contracter.
La personne qui fait l’objet de violences est donc privée de tout consentement, d’où la sévérité du législateur à son endroit.
En conséquence, peu importe que la violence soit exercé par un époux ou un tiers, ce qui importe c’est que le consentement du conjoint n’ait pas été donné librement.