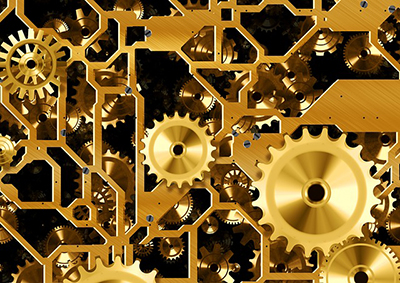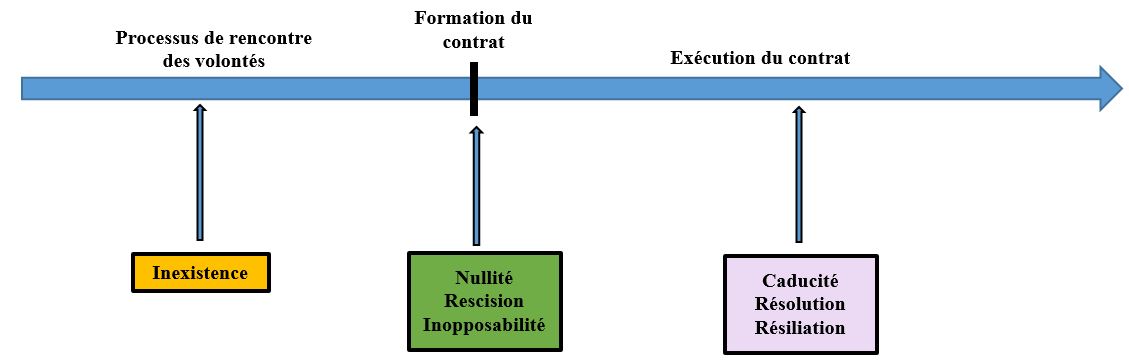L’acquisition dérivée est de loin le mode d’acquisition le plus répandue, à tout le moins le plus commun, dans la mesure où, le plus souvent, l’acquisition d’un bien procède d’un transfert du droit de propriété, lequel transfert se réalise par l’effet d’un acte juridique.
Aussi, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne que l’acquéreur, de sorte que celui-ci détient son droit d’autrui.
Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété.
L’article 711 du Code civil dispose en ce sens que « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. »
Ainsi, existe-t-il plusieurs sortes de modes de transferts de propriété auxquels sont attachés des régimes juridiques qui diffèrent d’un mode de transfert à l’autre.
I) Les modes de transfert de la propriété
Il existe donc plusieurs modes de transfert du droit de propriété que l’on est susceptible de classer selon différents critères.
- Classification selon l’étendue du transfert
- Transfert à titre universel
- Le transfert à titre universel consiste en une transmission de patrimoine ou d’une quote-part de biens.
- Il peut résulter d’une dévolution successorale, d’un testament ou encore d’une fusion de sociétés
- La particularité du transfert à titre universel est qu’il emporte également transmission des dettes attachées au patrimoine transmis
- Transfert à titre particulier
- Le transfert à titre particulier consiste, quant à lui, en une transmission de biens sans que l’acquéreur ne soit tenu aux dettes qui s’y attachent
- Ce mode de transfert peut résulter d’une vente, d’une donation ou encore d’un échange
- Classification selon la source du transfert
- Transfert volontaire
- Le transfert de propriété résulte le plus souvent d’une convention (vente) ou d’un acte unilatéral (testament)
- Dans cette hypothèse, la validité du transfert est subordonnée notamment à l’existence d’un consentement qui doit être libre et éclairé
- Transfert forcé
- Le transfert de propriété est susceptible d’intervenir, dans certains cas, en dehors de toute manifestation de volonté
- Tel est le cas lorsque la transmission du bien résulte du fait de la loi (succession) ou d’une décision judiciaire (liquidation judiciaire d’une entreprise en difficulté)
- Classification selon la cause du transfert
- Transfert à titre onéreux
- Le transfert du bien interviendra, le plus souvent, à titre onéreux, soit en considération de l’obtention d’une contrepartie
- Tel est le cas de la vente qui consiste en la délivrance d’une chose, moyennant le paiement d’un prix
- Transfert à titre gratuit
- Le transfert du bien peut également être réalisé à titre gratuit, soit sans que le cédant n’obtienne une contrepartie
- Tel est le cas le cas de la donation qui, par hypothèse, est toujours consentie à titre gratuit
Au bilan, il apparaît que, outre la diversité des modes de transfert de propriété, l’acquisition dérivée mobilise d’autres matières que le droit des biens, au nombre desquelles figurent, le droit des contrats, le droit des successions, le droit des entreprises en difficulté ou encore le droit des sociétés.
II) Le régime du transfert de la propriété
Le régime applicable au transfert de propriété d’un bien est donc différent selon la matière mobilisée.
Nous ne nous focaliserons néanmoins ici que sur le régime attaché au transfert de droit commun de la propriété, soit celui réalisé à titre particulier.
A) L’objet du transfert de propriété
Le transfert de propriété a pour effet d’installer celui qui acquiert le bien dans la même situation que celui qui lui a transmis.
Aussi, l’opération translative de propriété emporte plusieurs conséquences érigées en principe :
- Nemo dat quod non habet : « celui qui n’était pas propriétaire n’a rien pu transmettre »
- Dans cette hypothèse, on parle d’acquisition a non domino, en ce sens que bien a été acquis auprès d’une personne qui n’en était pas la propriétaire
- Le transfert de propriété n’a donc pas pu jouer, sauf à ce que l’acquéreur endosse la qualité de possesseur lorsqu’il s’agit d’un meuble ou, lorsqu’il s’agit d’un immeuble, que les conditions de l’usucapion soient réunies.
- Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : « nul ne peut transmettre à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même »
- Autrement dit, l’auteur transmet le bien à l’acquéreur le bien tel qu’il est, tant sur le plan matériel, que sur le plan juridique.
- Ainsi, l’acquéreur ne peut exercer que les seuls droits attachés au bien au moment du transfert, il ne saurait se prévaloir de prérogatives dont n’était pas titulaire le cédant.
- En application de ce principe, la Cour de cassation a, par exemple, jugé dans un arrêt du 28 novembre 2012 que l’acquéreur d’un moulin n’était pas fondé à revendiquer le droit d’usage de l’eau, alors même que l’ancien propriétaire avait valablement renoncé au droit d’usage de la force motrice du ruisseau moyennant l’octroi d’une indemnité (Cass. 3e civ. 28 nov. 2012, n°11-20156).
- Accessorium Principale Sequitur : « l’accessoire suit le principal »
- En application de ce principe général, le transfert de propriété du bien emporte également transfert à l’acquéreur de tous ses accessoires, c’est-à-dire de tous les droits et obligations qui y sont attachés.
- Ainsi, les droits réels qui grèvent le bien transmis ne sont pas affectés par le transfert de propriété
B) Les modalités du transfert de propriété
Le transfert de propriété d’un bien s’analyse fondamentalement en une cession de droits réels. Par cession, il faut entendre, selon les auteurs, de Pothier à Henri Desbois, en passant par le Doyen Carbonnier, le transfert de propriété de droits entre vifs.
En droit romain, ce transfert de propriété était dissocié du contrat stricto sensu, celui-ci n’étant créateur que d’obligations personnelles.
Cette dichotomie entre le contrat et le mécanisme de cession visait à permettre à l’acquéreur de se ménager une preuve du transfert de propriété à l’égard des tiers.
Si, aujourd’hui, cette approche du transfert de propriété a cédé sous l’émergence du consensualisme, elle n’a pas totalement disparu, à tout le moins se retrouve dans certaines règles qui autorisent la déconnexion du transfert de propriété de la conclusion du contrat.
?Droit romain
À l’examen, les techniques juridiques utilisées sous l’empire du droit romain pour transférer des droits réels sont directement liées à la preuve.
Les romains, partaient du principe que pour prouver la propriété d’un bien, l’acquéreur devait être en mesure de démontrer qu’il tenait son droit de quelqu’un, lequel endossait lui-même la qualité le propriétaire et ainsi de suite.
Cette preuve, qualifiée, au Moyen-Âge la probatio diabolica est, par hypothèse, impossible à rapporter. Etablir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien, revient, en effet, à exiger de l’acquéreur qu’il remonte la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, preuve que « seul le diable pourrait rapporter ».
Pour éviter ce régime compliqué de preuve, la Loi des XII Tables prévoyait déjà la règle « Usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto », ce qui signifiait que pendant deux ans pour les fonds de terre et un an pour les autres choses, le possesseur devait, en cas de contestation de sa propriété, faire appel au précédent propriétaire du bien pour qu’il atteste avoir consenti au transfert de propriété.
À l’expiration de ces délais, c’est la loi elle-même qui protégeait le possesseur en le rendant légalement propriétaire. Ainsi, la possession d’une chose pendant un ou deux ans constituait une preuve suffisante de la propriété.
Par suite, un formalisme plus complexe s’est développé autour du transfert de la propriété, afin que la preuve puisse être rapportée plus facilement. Cette évolution s’est traduite par l’introduction d’une dissociation de l’opération de transfert de la propriété, du contrat créateur d’obligations personnelles.
En droit romain, deux techniques abstraites permettaient le transfert de la propriété quiritaire : la mancipation et l’in jure cessio.
Dans la mancipation, le transfert de propriété résulte d’un rituel très précis, décrit par Gaïus. Il entraînant deux effets. D’une part, il assurait le transfert de propriété, même si pour Henri Lévy-Bruhl, « la chose qui vient d’être transférée est considérée comme acquise et non comme transmise ». D’autre part, la mancipation avait pour effet de faire naître une obligation de garantie à la charge du vendeur.
Ce formalisme archaïque s’est toutefois rapidement révélé inadapté aux nouvelles nécessités commerciales apparues au Bas-Empire. En réaction, le législateur instaura un mécanisme de publicité des transferts de propriété fondée sur l’enregistrement.
S’agissant de la cessio in jure, le transfert de propriété est réalisé au cours d’un procès fictif qui avait pour but d’opérer la cession de droits réels. Le transfert de propriété est ainsi prononcé par le juge, indépendamment de la conclusion du contrat.
Cette dissociation entre le contrat et l’effet translatif qui lui était attaché s’illustrait concrètement par le formalisme de la traditio qui subordonnait le transfert de la propriété à la remise effective de la chose aliénée par le vendeur à l’acquéreur.
Dès la fin de la République, la remise devient néanmoins une opération symbolique et abstraite, ce qui eut pour conséquence de resserrer les rapports de droit entre le contrat générateur d’obligations personnelles et le transfert de propriété proprement dit. Ce rapprochement fut de courte durée puisque la remise matérielle de la chose réapparut en Occident, notamment dans un Édit de Théodoric.
En tout état de cause, à Rome, le contrat est impuissant à assurer seul le transfert de la propriété. Il n’a qu’un effet obligatoire, non translatif. En somme, il fait naître à la charge de l’aliénateur l’obligation de transférer la chose, mais il ne réalise pas lui-même ce transfert.
Le transfert a lieu par un acte ultérieur, le modus acquirendi, acte à caractère abstrait ou matériel. Si ces principes étaient toujours en vigueur aux origines de l’Ancien droit, ils ont progressivement été abandonnés.
?Ancien droit
En droit franc, une évolution fondamentale s’est réalisée. Le transfert de la propriété était subordonné à l’investiture publique de l’acquéreur. L’acquéreur prend physiquement possession de la chose, tandis que le cédant s’en décharge. L’investiture publique réalise ainsi à la fois l’accord des volontés et le transfert de propriété.
Puis, à l’époque féodale, ni la convention préalable, ni même la remise matérielle de la chose, ne transfèrent la propriété en l’absence d’investiture. Ce principe est clairement formulé par Boutillier au XIVe siècle : « Celui qui vend tenure mais en retient encore la saisine par devers lui et n’en fait vest à l’acheteur, saches qu’il est encore sires de la chose ».
Par suite, ces règles archaïques sont apparues inadaptées au temps de la monarchie. Aussi, les Glossateurs reprirent les principes du droit romain de la tradition matérielle, mais en multipliant les exceptions.
De leur côté, les romanistes étaient de plus en plus hostiles à l’investiture publique ainsi qu’à l’intervention seigneuriale. Une nouvelle pratique s’est alors développée dans les pays de droit écrit. Il est devenu courant de stipuler dans l’acte d’aliénation une clause verdidit et tradidit, également qualifiée de clause de tradition feinte ou de saisine-désaisine.
Cette tradition feinte marqua le déclin de la dissociation entre le contrat et le transfert de propriété, ce dernier n’étant plus une condition de validité de l’opération de cession de droits réels.
La propriété est désormais transférée du seul fait de l’échange des consentements. Comme le constate Agnès Rabagny, une partie de la doctrine – et notamment Loisel et Ricard, consacra ces solutions aux XVIIème et XVIIIème siècles. Pour les théoriciens du droit naturel tel Grotius ou Pufendorf, la volonté doit toujours l’emporter sur les formes.
?Code civil
Les rédacteurs du Code civil ont consacré le principe du transfert solo consensu, soit du principe aux termes duquel le transfert de propriété procède, non pas de l’acte de tradition, mais de la conclusion du contrat lui-même.
Désormais, le contrat opère donc cession de droits réels, tout autant qu’il est créateur d’obligations personnelles.
Au nombre de ces obligations figure notamment, pour les contrats translatifs de propriété, l’obligation de délivrance de la chose.
L’article 1138 du Code civil disposait en ce sens que « l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. »
La règle ainsi posée a été reprise par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Elle est désormais énoncée aux articles 1196 à 1198 du Code civil. À cet égard, le législateur en a profité pour clarifier le régime juridique du transfert de propriété lorsqu’il résulte de la conclusion d’un contrat.
Conséquence de l’abandon de la distinction entre les obligations de donner, de faire, et de ne pas faire, le transfert de propriété est dorénavant érigé en effet légal du contrat, consécutif à l’échange des consentements et non plus comme l’exécution d’une obligation de donner, ce qui n’est pas sans avoir alimenté de nombreuses discussions en doctrine.
La majorité des auteurs critiquait, en effet, la formulation des anciens textes qui rattachaient le transfert de propriété avec l’obligation de donner, alors même qu’il se situe au même niveau que cette obligation en ce sens que, comme elle, il est un effet du contrat.
Dire que le transfert de propriété résulte directement de l’échange des consentements n’est pas la même chose que de le présenter comme un acte d’exécution de l’obligation de donner.
Tandis que dans la première approche, le transfert de propriété est concomitant à la conclusion du contrat et, ce, indépendant de toute action du cédant, dans la seconde le transfert de propriété est subordonné à l’exécution de l’obligation de délivrer la chose, de sorte qu’il serait à la main du débiteur.
Aussi pour la doctrine il est difficile, sinon incohérent, de faire cohabiter l’obligation de donner avec le principe de transfert solo consensu, d’aucun allant jusqu’à suggérer que les rédacteurs du Code civil auraient souhaité réintroduire l’exigence de tradition pour les contrats translatifs de propriété.
C’est dans ce contexte que, à l’occasion de la réforme du droit des contrats, le législateur a souhaité clarifier les choses en réaffirmant le principe du transfert solo consensu, ce qui implique que non seulement la conclusion du contrat opère le transfert de la propriété, mais encore elle emporte transfert des risques relatifs à la dégradation ou à la disparition de la chose.
1. Le transfert de la propriété
a. Principe
L’article 1196, al. 1er du Code civil dispose que « dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. »
Il ressort de cette disposition que le transfert de propriété du bien intervient, pour les contrats translatifs de droits réels, dès sa formation, soit au moment de l’échange des consentements.
C’est le principe de transfert solo consensu, principe qui est énoncé par d’autres textes spéciaux du Code civil.
L’article 1583 du Code civil prévoit, par exemple, que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
L’article 938 dispose encore que « la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit besoin d’autre tradition. »
Le transfert de propriété du bien aliéné se produit ainsi dès la conclusion du contrat, ce qui a pour conséquence d’opérer automatiquement et instantanément cession des droits réels, sans qu’il soit besoin pour le cédant de se dessaisir de la chose.
Le transfert de propriété ne consiste nullement en un acte d’exécution d’une obligation, mais bien en un effet légal du contrat.
En d’autres termes, ce n’est pas la délivrance de la chose qui opère le transfert de propriété, mais l’échange des consentements.
Au moment même où le contrat est formé, le cédant perd la qualité de propriétaire, ses prérogatives (usus, fructus et abusus) étant instantanément transférées à l’acquéreur.
S’il est des cas où il continuera à détenir le bien aliéné, il lui incombera d’exécuter dans les délais l’obligation de délivrance, sauf exercice de son droit de rétention en cas de non-paiement par l’acquéreur (art. 1612 C. civ.).
b. Exceptions
L’article 1196, al. 2e du Code civil prévoit que le transfert de propriété « peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi. »
Ainsi, est-il des cas où le transfert de propriété ne sera pas concomitant à la formation du contrat, il sera différé dans le temps. Ce sont là autant d’exceptions au principe de transfert solo consensu.
Trois hypothèses sont envisagées par l’article 1196 :
?La volonté des parties
Les règles qui régissent le transfert de propriété sont supplétives, ce qui implique qu’il peut y être dérogé par convention contraire.
Les parties sont ainsi libres de prévoir que le transfert de propriété du bien aliéné interviendra à une date ne correspondant pas à celle de conclusion du contrat.
Elles peuvent néanmoins prévoir que le transfert se produira seulement, soit après la survenant d’un événement déterminé, soit au moment du complet paiement du prix.
- La clause de réserve de propriété
- Il est courant, en matière commerciale, que le cédant souhaite se ménager le bénéfice d’une clause de réserve de propriété, clause consistant à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné au complet paiement du prix.
- L’article 2367 du Code civil prévoit en ce sens que « la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie »
- Ainsi, tant que l’acquéreur, qui est entré en possession du bien, n’a pas réglé le vendeur il n’est investi d’aucun droit réel sur celui-ci.
- La clause de réserve de propriété est un instrument juridique redoutable qui confère à son bénéficiaire une situation particulièrement privilégiée lorsque le débiteur fait l’objet, soit de mesures d’exécution forcée, soit d’une procédure collective.
- Pour être valable, la clause de réserve de propriété doit néanmoins être stipulée, par écrit, et, au plus tard, le jour de la livraison du bien.
- La clause de réitération par acte authentique
- Cette clause consiste à subordonner le transfert de propriété du bien aliéné à la réitération des consentements par acte authentique.
- Contrairement à ce qui a pu être décidé par certaines juridictions, la stipulation d’une telle clause diffère, non pas la formation du contrat qui est acquise dès l’échange des consentements, mais le transfert de la propriété du bien aliéné.
- Ce transfert interviendra au moment de la réitération des consentements devant notaire qui constatera l’opération par acte authentique.
- Dans un arrêt 20 décembre 1994, la haute juridiction a, de la sorte, refusé de suivre une Cour d’appel qui avait estimé que le contrat de vente, objet d’une promesse synallagmatique, n’était pas parfait, dès lors que ladite promesse était assortie d’une clause qui stipulait que « que l’acquéreur sera propriétaire des biens vendus à compter seulement de la réitération par acte authentique ».
?La nature des choses
Il est certaines catégories de choses qui se prêtent mal à ce que le transfert de propriété intervienne concomitamment à la formation du contrat
Tel est le cas des choses fongibles (de genre) et des choses futures :
- Les choses fongibles
- Par chose fongible, il faut entendre une chose qui ne possède pas une individualité propre.
- L’article 587 du Code civil désigne les choses fongibles comme celles qui sont « de même quantité et qualité » et l’article 1892 comme celles « de même espèce et qualité ».
- Selon la formule du Doyen Cornu, les choses fongibles sont « rigoureusement équivalentes comme instruments de paiement ou de restitution».
- Pour être des choses fongibles, elles doivent, autrement dit, être interchangeables, soit pouvoir indifféremment se remplacer les unes, les autres, faire fonction les unes les autres.
- Exemple: une tonne de blé, des boîtes de dolipranes, des tables produites en série etc…
- Les choses fongibles se caractérisent par leur espèce (nature, genre) et par leur quotité.
- Ainsi, pour individualiser la chose fongible, il est nécessaire d’accomplir une opération de mesure ou de compte.
- Lorsque des choses fongibles sont aliénées, dans la mesure où, par hypothèse, au moment de la formation du contrat, elles ne sont pas individualisées, le transfert de propriété ne peut pas s’opérer.
- Aussi, ce transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au moment de l’individualisation de la chose fongible, laquelle se produira postérieurement à la conclusion du contrat.
- Pratiquement, cette individualisation pourra se faire par pesée, compte ou mesure (art. 1585 C. civ.)
- Elle pourra également se traduire par une vente en bloc (art. 1586 C. civ.).
- Le plus souvent cette action sera réalisée le jour de la livraison de la chose.
- Les choses futures
- Les choses futures sont celles qui n’existent pas encore au moment de la formation du contrat.
- À cet égard, l’ancien article 1130 du Code civil disposait que « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation »
- Le nouvel article 1130, issu de la réforme des obligations prévoit désormais que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future ».
- Ce cas particulier est bien connu en droit de la vente. On vend bien sans difficulté des immeubles à construire (art. 1601-1 C.civ).
- Ce n’est pas à dire que la loi ne prohibe pas ponctuellement de tels contrats.
- L’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, par exemple, que « la cession globale des œuvres futures est nulle »
- Lorsque la vente de choses futures est permise, la loi aménage les conséquences de la vente si la chose devait ne jamais exister.
- En tout état de cause, lorsque le contrat a pour objet l’aliénation d’une chose future, le transfert de propriété ne pourra intervenir qu’au jour où elle existera et plus précisément au jour où elle sera livrée à l’acquéreur.
?L’effet de la loi
Il est des cas où le transfert de propriété du bien aliéné sera différé sous l’effet de la loi.
Il en va ainsi de la vente à terme définie à l’article 1601-2 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur s’engage à livrer l’immeuble à son achèvement, l’acheteur s’engage à en prendre livraison et à en payer le prix à la date de livraison. »
Le texte poursuit en précisant que « le transfert de propriété s’opère de plein droit par la constatation par acte authentique de l’achèvement de l’immeuble ; il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente. »
Le transfert de propriété du bien est également différé en matière de vente en l’état futur d’achèvement définie à l’article 1601-3 du Code civil comme « le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. »
À la différente de la vente à terme, ici les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, étant précisé que l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
2. Le transfert des risques
a. Principe
?La concomitance du transfert de propriété et du transfert de la charge des risques
L’article 1196, al. 3e du Code civil prévoit que « le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. »
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a ainsi maintenu la règle selon laquelle le propriétaire supporte la perte de la chose.
Cela signifie que, dès lors que le transfert de propriété a opéré, l’acquéreur reste tenu de payer l’intégralité du prix, bien que la chose soit perdue ou détériorée, pourvu que la perte ou détérioration ne puisse être imputée à la faute du vendeur.
Les risques sont ceux de la chose : ils sont « pour l’acheteur », créancier de l’obligation inexécutée. Cette règle est exprimée par l’adage « res perit domino ».
La raison en est que le créancier est déjà devenu propriétaire de la chose par le seul accord des volontés : solo consensu.
C’est là le sens du premier alinéa de l’article 1196 du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat ».
La règle qui fait intervenir le transfert de la charge des risques au moment du transfert de propriété, est reprise par plusieurs textes spéciaux.
L’article L. 132-7 du Code de commerce prévoit, par exemple, que « la marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l’expéditeur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. »
?L’obligation de conservation de la chose aliénée
À l’analyse, la concomitance du transfert de propriété et du transfert de la charge des risques se comprend aisément, dès lors que les risques dont il est question sont ceux attachés à la chose.
Il n’est, en effet, pas anormal d’envisager que le risque de disparition ou de dégradation de la chose doivent peser sur la tête de son propriétaire.
Lorsque toutefois celui-ci n’est pas encore entré en possession de son bien, par hypothèse, il n’en a pas la maîtrise de sorte qu’il est impuissant à prévenir la survenance du risque.
La bonne conservation de la chose dépend du cédant et plus précisément des mesures qu’il va mettre en place pour prévenir le risque de disparition ou de dégradation de la chose dont il n’est plus propriétaire.
Si la charge des risques ne pèse pas sur ce dernier, le législateur a néanmoins mis à sa charge l’obligation de conserver la chose « jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable. »
C’est là, en quelque sorte, une contrepartie à l’attribution de la charge des risques à l’acquéreur dès le transfert de propriété du bien.
Si, dès lors, le cédant n’accomplit pas toutes les diligences requises à la bonne conservation de la chose dans l’attente de sa délivrance, il engage sa responsabilité contractuelle à hauteur du préjudice causé.
À cet égard, il peut être observé que cette obligation de conservation de la chose qui pèse sur le cédant est attachée à son obligation de délivrance.
Par délivrance, il faut entendre la mise à disposition de la chose cédée à l’acquéreur, étant précisé que la délivrance ne se confond pas avec la livraison.
En effet, tandis que la délivrance de la chose se limite en l’acte de mettre à disposition, la livraison implique le transport de la chose.
En l’absence de convention contraire, les contrats translatifs de propriété ne mettent à la charge du cédant qu’une obligation de délivrance et non de livraison, ce qui n’est pas sans avoir alimenté de nombreuses discussions en doctrine, en raison de la maladresse de la formulation de certaines dispositions du Code civil qui associent la délivrance au transport, alors qu’il s’agit de deux obligations radicalement différentes.
L’article 1604 du Code civil définit, par exemple, la délivrance en matière de vente comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Il s’agit là, manifestement, d’une maladresse de rédaction à laquelle le législateur a tenté de remédier en associant expressément, à l’article 1197 du Code civil, l’obligation de conservation de la chose à l’obligation de délivrance.
b. Exceptions
Il est plusieurs situations où le transfert des risques est dissocié du transfert de propriété :
?La mise en demeure du débiteur de l’obligation de délivrer
Si, par principe, le transfert des risques est attaché au transfert de la propriété du bien aliéné, lorsque le cédant tarde à délivrer la chose la charge des risques passe sur sa tête.
L’alinéa 3e de l’article 1196 du Code civil précise, en effet, que « toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1. »
Ainsi, lorsque le vendeur la mise en demeure de délivrer une chose met les risques de la chose à la charge du débiteur non-propriétaire (le vendeur).
Seule solution pour ce dernier de s’exonérer de sa responsabilité :
- D’une part, l’impossibilité d’exécuter l’obligation de délivrance doit résulter de la perte de la chose due
- D’autre part, il doit être établi que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée.
Lorsque ces deux conditions cumulatives sont réunies, la charge des risques repasse sur la tête du propriétaire de la chose aliénée.
?Les contrats translatifs de propriété soumis au droit de la consommation
Les articles L. 216-1 à L. 216-6 du Code de la consommation régissent la livraison de la chose aliéné et le transfert de la charge des risques lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur
Par souci de protection du consommateur, le législateur a ainsi dérogé au principe posé par l’article 1196 al. 3e du Code civil en prévoyant à l’article L. 216-4 du Code de la consommation que « tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens. »
Le transfert de la charge des risques intervient, de la sorte, non pas au moment du transfert de propriété, mais au moment de la livraison du bien.
Cette règle étant d’ordre public, le professionnel ne peut pas s’y soustraire par convention contraire (art. L. 216-6 C. conso).
Seule exception à la règle, l’article L. 216-5 prévoit que « lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur ».
C) Les règles de conflit de propriétés
Le Code civil n’organise pas seulement le transfert de propriété des biens aliénés par voie de convention, il règle également les cas où plusieurs personnes se disputeraient la qualité de propriétaire d’un bien acquis auprès du même auteur.
Ce conflit de propriétés susceptibles de survenir consécutivement à l’aliénation conventionnelle d’un bien est réglé à l’article 1198 du Code civil.
Cette disposition envisage le conflit des droits d’acquéreurs successifs d’un même meuble en son alinéa 1er, reprenant ainsi l’ancien article 1141, et étend cette règle aux immeubles dans son alinéa second.
1. Le conflit des droits d’acquéreurs concurrents d’un même meuble
L’article 1198, al. 1er du Code civil prévoit que « lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi. »
Il ressort de cette disposition que, en cas de conflits de propriétés entre plusieurs acquéreurs, ce n’est pas nécessairement celui qui, le premier en date, a régularisé le contrat translatif de propriété avec le cédant qui est réputé sortir vainqueur de ce conflit.
Le texte désigne plutôt celui qui, le premier, est entré en possession de la chose aliénée. Bien que cette solution puisse apparaître surprenante en ce qu’elle permet de désigner comme acquéreur une personne qui tient son droit d’un cédant qui avait déjà cédé son droit à une autre personne, elle se justifie par l’effet acquisitif de la possession qui, en matière de meuble, est immédiat.
Ainsi, en cas de conflit de propriétés portant sur un bien meuble, c’est le possesseur qui est préféré à tous les autres acquéreurs.
Encore faut-il néanmoins qu’il remplisse deux conditions cumulatives :
- Première condition : une possession utile
- Pour se prévaloir de la qualité de possesseur encore faut-il que la possession
- D’une part, soit caractérisée dans tous ses éléments constitutifs que sont le corpus et l’animus
- D’autre part, qu’elle ne soit affectée d’aucun vice, ce qui implique qu’elle soit continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque
- Seconde condition : la bonne foi
- Pour que la possession d’un bien meuble produise son effet acquisitif, le possesseur doit être de bonne foi
- Dans la mesure où, en application de l’article 2274, la bonne foi est toujours présumée c’est à ceux qui revendiquent la propriété de la chose de prouver que le possesseur est de mauvaise foi.
- Pour mémoire, l’article 550 du Code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
- La bonne foi s’apprécie ainsi non pas au moment de l’entrée en possession, mais au moment l’acquisition qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple.
- Il appartiendra au demandeur d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.
- Plus précisément l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.
2. Le conflit des droits d’acquéreurs concurrents d’un même immeuble
L’article 1198, al. 2e du Code civil prévoit que « lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi. »
Il ressort de cette disposition que lorsque plusieurs acquéreurs se disputent la propriété d’un même bien immeuble, c’est la date de publication de l’acte translatif de propriété qui permettra de les départager.
La publicité foncière joue ainsi un rôle d’importance dans la mesure où elle est susceptible de faire échec à l’effet translatif d’un contrat de vente nonobstant sa régularisation antérieure à l’acte publié, en premier, à la conservation des hypothèques.
Ainsi, afin de résoudre un conflit de propriétés entre acquéreurs d’un même bien immobilier, il convient de se reporter, non pas à la date de régularisation de l’acte de vente, mais à sa date de publication aux services de la publicité foncière.
C’est donc celui qui a publié le premier qui sort victorieux de ce conflit, sauf à établir, ainsi que le prévoit l’article 1198, al. 2e du Code civil qu’il était de mauvaise foi au moment de la publication.
Cette précision quant à l’exigence de bonne foi de l’acquéreur a été introduite par le législateur à l’occasion de la réforme du droit des obligations afin de mettre un terme à une jurisprudence de la Cour de cassation qui conférait à la publicité une valeur que de nombreux auteurs jugeaient excessive.
?Position initiale
Dans un arrêt Vallet du 22 mars 1968 la Cour de cassation avait jugé que dans l’hypothèse où le second acquéreur d’un bien immobilier avait connaissance de la régularisation antérieure d’un premier acte de vente portant sur le même bien, il lui était fait défense de se prévaloir des règles de la publicité foncière afin de faire primer son droit (Cass. 3e civ. 22 mars 1968).
Autrement dit, en cas de mauvaise foi de l’acquéreur qui, le premier, avait accompli les formalités de publicité foncière, ces formalités étaient inopposables au premier acquéreur.
|
Cass. 3e civ. 22 mars 1968
Sur le moyen unique pris en ses divers griefs : vu l’article 1382 du code civil, attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt confirmatif attaque que Vallet a acquis un terrain des consorts de x… selon acte sous seing privé du 4 avril 1944, par l’intermédiaire de la société anonyme pétreaux ;
Que, tandis que Vallet réclamait la réitération de la vente par acte authentique, Roncari, administrateur de la société anonyme Patreaux, qui n’ignorait pas la première aliénation, a, par acte notarié du 9 février 1946, transcrit le 4 mai, acquis, pour lui, l’immeuble litigieux ;
Que Vallet, se voyant opposer cette transcription, a demandé qu’il soit dit que la seconde aliénation et sa transcription ayant été le résultat d’un concert frauduleux entre Roncari et le mandataire des vendeurs, lui soient déclarées inopposables ;
Attendu que les juges du fond ont rejeté cette demande, en précisant que si Roncari, qui connaissait les obligations contractées par le vendeur a l’égard de Vallet, parait avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité – il n’en résulte pas pour autant qu’il y ait lieu de prononcer la nullité de la vente de 1946 ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les motifs pour lesquels, constatant la faute de Roncari, et l’immeuble se trouvant encore entre ses mains, elle a écarté le mode d’exécution que constituait l’inopposabilité au premier acquéreur de la seconde vente et qui était réclamé par Vallet, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ;
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 27 janvier 1966 ;
|
?Revirement de jurisprudence
Dans un arrêt du 12 janvier 2011 la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en affirmant qu’il était indifférent que le second acquéreur ait connaissance de la régularisation antérieure d’un premier acte de vente (Cass. 3e civ. 12 janv. 2011, n°10-10.667).
Pour la troisième chambre civile, le seul critère permettant de résoudre le conflit de propriétés entre acquéreurs se disputant la propriété d’un même bien, c’est la date de publication de l’acte.
Au soutien de sa position elle affirmait « qu’aux termes de l’article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés »
Ainsi, pour la Cour de cassation, quand bien même le second acquéreur connaissait l’existence du premier acte de vente, seule compte la date d’accomplissement des formalités de publicité foncière.
|
Cass. 3e civ. 12 janv. 2011
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 29 octobre 2009) que suivant promesse sous seing privé du 22 avril 2002, la société civile immobilière Lacanau Clemenceau (la SCI) a vendu un immeuble à Mme X… ; que la réitération de l’acte authentique prévue au plus tard le 30 septembre 2002 n’est pas intervenue et que par assignation du 27 février 2003 Mme X… a fait assigner la venderesse en perfection de la vente ; que par acte authentique du 13 mars 2003, publié à la conservation des hypothèques de Bordeaux le 18 mars 2003, la SCI a vendu le bien aux époux Y… ; que par arrêt du 24 septembre 2007 la cour d’appel de Bordeaux, infirmant le jugement, a dit la vente parfaite au profit de Mme X… ; que le 30 octobre 2007 les époux Y… ont formé tierce opposition à l’arrêt du 24 septembre 2007 contre lequel aucun pourvoi en cassation n’a été formé et que par arrêt du 29 octobre 2009 la cour d’appel de Bordeaux a déclaré les époux Y… recevables en leur tierce opposition et constaté que l’immeuble litigieux était leur propriété ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de déclarer la tierce opposition des époux Y… recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que l’ayant cause à titre particulier est représenté par son auteur, pour tous les actes accomplis antérieurement à l’accomplissement de la formalité de la publicité foncière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui a décidé que la tierce opposition formée par M. et Mme Y… était recevable, car leur acte authentique avait été publié le 18 mars 2003, quand l’assignation en régularisation forcée de vente avait été délivrée dès le 27 février 2003, par Mme X… à la société civile immobilière Lacanau Clemenceau, ce dont il résultait que celle-ci avait représenté ses ayants-cause à titre particulier à la procédure, peut important que celle-ci ait abouti à un arrêt du 24 septembre 2007, a violé l’article 583 du code de procédure civile ;
2°/ qu’une tierce opposition n’est recevable que si le tiers concerné s’est trouvé dans l’impossibilité de faire valoir ses droits ; qu’en l’espèce, la cour qui a déclaré recevable la tierce opposition de M. et Mme Y…, sans rechercher si ceux-ci n’étaient pas, depuis le jour de la seconde vente dont ils avaient bénéficié, parfaitement informés de la vente précédemment consentie à Mme X… par la SCI Lacaneau Clemenceau, ainsi que de la procédure judiciaire les opposant et à laquelle ils avaient délibérément choisi de ne pas intervenir, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 583 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel retient à bon droit que si les ayants cause à titre particulier sont considérés comme représentés par leur auteur pour les actes accomplis par celui-ci avant la naissance de leurs droits, lorsqu’un acte est soumis à publicité foncière, la représentation prend fin à compter de l’accomplissement des formalités de publicité foncière ; qu’ayant constaté que les époux Y… avaient publié leur titre à la conservation des hypothèques le 18 mars 2003 et exactement retenu qu’ils n’étaient plus représentés à la date de l’arrêt, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a justement déduit que la tierce opposition formée par les époux Y… était recevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rétracter l’arrêt rendu le 24 septembre 2007, alors, selon le moyen, “que la connaissance, par un second acquéreur, de l’existence d’une première cession constatée par acte sous seing privé non soumis à publicité foncière, lui interdit de tirer avantage des règles de la publicité foncière, que la cour d’appel, qui a rétracté l’arrêt du 24 septembre 2007 constatant le caractère parfait de la vente consentie sous seing privé à Mme X…, en se fondant sur le simple fait que M. et Mme Y… avaient acquis le même immeuble de la société civile immobilière Lacanau Clémenceau par acte authentique du 13 mars 2003, publié dès le 18 mars suivant, sans rechercher si ces seconds acquéreurs n’avaient pas signé leur acte en toute connaissance de l’existence de la première vente intervenue au profit de Mme X…, ce qui les privait du bénéfice des règles de la publicité foncière, a privé sa décision de base légale au regard des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,ensemble l’article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’aux termes de l’article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers sont, s’ils n’ ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés et constaté que Mme X…, dont les droits étaient nés d’une promesse de vente sous seing privé, ne pouvait justifier d’une publication, la cour d’appel, en rétractant l’arrêt du 24 septembre 2007, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
Manifestement, en exigeant que l’acquéreur qui, le premier, a publié l’acte translatif de propriété du bien aliéné soit de bonne foi, le législateur a entendu briser la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation en 2011 et renouer avec sa position initiale dégagée dans l’arrêt Vallet.
Aussi, le second acquéreur d’un bien immobilier ne pourra sortir vainqueur d’un conflit de propriétés qu’à la condition qu’il soit de bonne foi, et plus précisément qu’il ignorait la régularisation a antérieure à l’accomplissement des formalités de publicité d’un premier acte de vente.