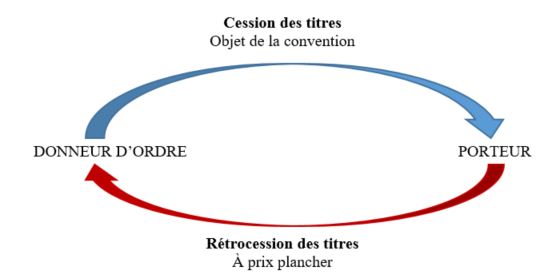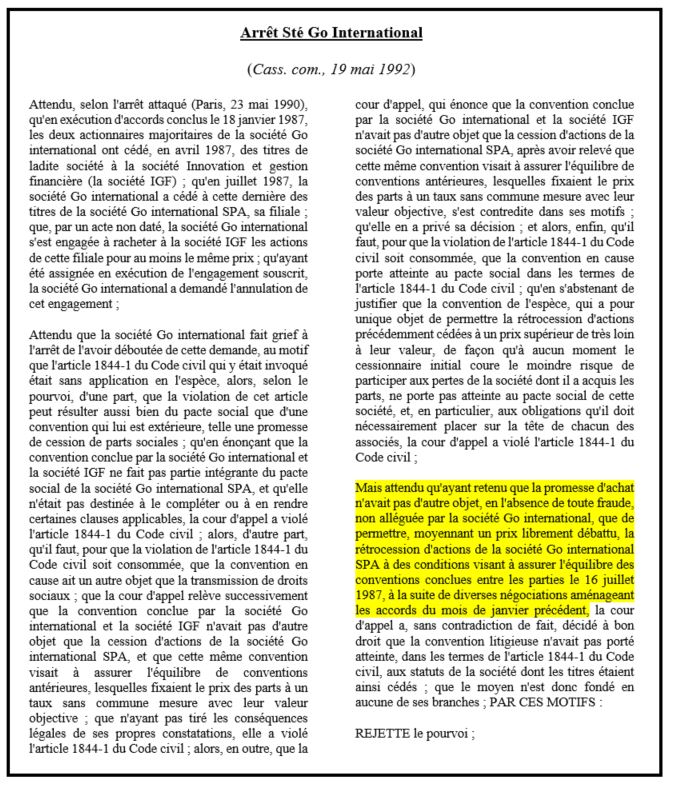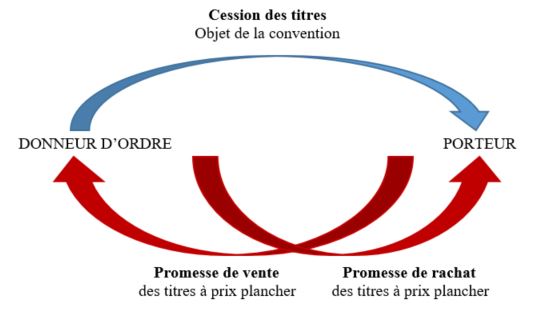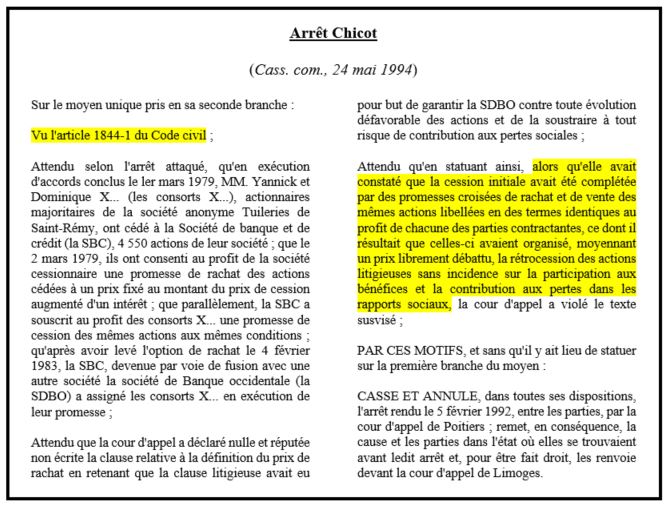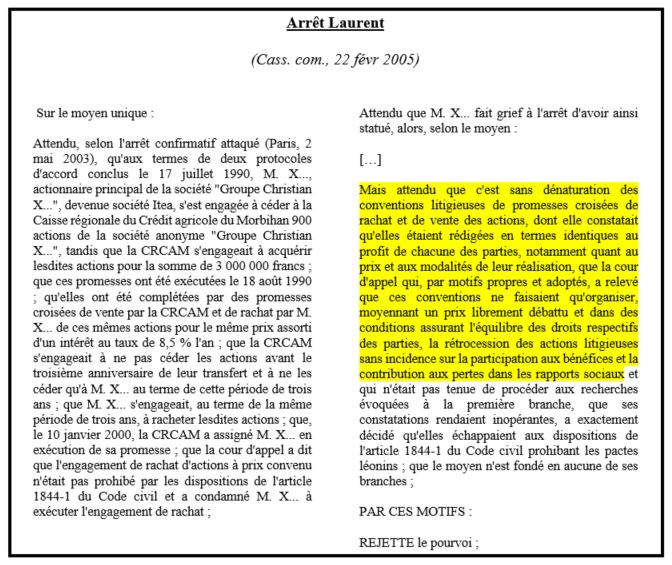C’est essentiellement à propos des accidents de la circulation que s’est développée la jurisprudence relative à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses.
?Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée plutôt hostile à l’application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, considérant que la voiture est une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme. Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute (Req., 22 mars 1911).
?Dans un second temps, la Cour de cassation admet l’application du principe général de responsabilité du fait des choses aux accidents de la circulation, estimant qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme, ou selon qu’elle est ou non dangereuse (Civ., 21 févr. 1927).
L’indemnisation de la victime ne s’en trouvait pas moins subordonnée à la satisfaction des conditions d’application :
- Soit de l’article 1382
- Il appartenait donc à la victime d’établir l’existence d’une faute du conducteur, soit, concrètement, la violation d’une règle du Code de la route
- Soit de l’article 1384, al. 1er
- Pour être indemnisée la victime devait démontrer le rôle actif du véhicule dans la production de son dommage, ce qui supposait de distinguer deux situations :
- Dans l’hypothèse où le véhicule était en mouvement et était entré en contact avec le siège du dommage, la victime bénéficiait d’une présomption de rôle actif
- Dans l’hypothèse où le véhicule était inerte au moment de la survenance du dommage, c’est alors à la victime qu’il revenait d’établir le rôle actif du véhicule
- Il lui fallait, autrement dit, démontrer, que le véhicule se trouvait dans une position anormale
En tout état de cause, quel que soit le fondement sur lequel la victime agissait, le conducteur du véhicule pouvait s’exonérer de sa responsabilité en établissant la survenance d’une cause étrangère telle que la faute de la victime, quand bien même elle n’était ni irrésistible, ni imprévisible.
Dans un arrêt du 19 juin 1981, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la production du dommage » (Cass. ass. plén. 19 juin 1981, n°78-91.827).
|
Cass., ass. plén., 19 juin 1981
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Attendu que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu’il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d’indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu’elle l’est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l’atteinte corporelle subie par celle-ci ; que, si l’action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l’héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances.
Attendu que Maurice Y… est décédé à la suite d’une collision entre la voiture qu’il conduisait et dans laquelle avaient pris place son épouse et sa fille Florence, et un camion appartenant à la Société des Transports Rochais-Bonnet et conduit par Luc Z… ; que, statuant sur la constitution de partie civile de Mme Y…, veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure Florence, qui demandait réparation du préjudice résultant tant des blessures reçues lors de l’accident que du décès de leur mari et père, et sur celle de Didier Y…, fils majeur de la victime, qui demandait réparation du préjudice moral résultant du décès de son père, l’arrêt attaqué a décidé qu’en l’absence de faute des parties civiles, aucun partage de responsabilité ne pouvait leur être opposé en raison de la faute éventuellement commise par Maurice Y…;
Attendu que, si cette décision est justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme Y… et Florence Y… du fait des blessures reçues par elles, préjudice dont elles pouvaient demander réparation pour le tout à chacun des responsables, il en est autrement en ce qui concerne le préjudice résultant, tant pour elles que pour Didier Y…, du décès de Maurice Y… ; qu’en faisant abstraction de la faute éventuellement commise par ce dernier, alors que les parties civiles demandaient réparation d’un préjudice qui résultait pour elles du décès de Maurice X…, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
|
?Annonciation d’une réforme législative : l’arrêt Desmares
Afin de cantonner à la portion congrue la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant causé un dommage de s’exonérer de sa responsabilité, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt Desmares du 21 juillet 1982, que seule la faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure pouvait exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité (Cass. 2e civ., 21 juill. 1982, n°81-12.850).
Ainsi, pour la Cour de cassation, dès lors que la faute de la victime n’a pas totalement rompu le rapport de causalité, le conducteur n’est pas fondé à se prévaloir d’une exonération, même partielle de sa responsabilité. La Cour de cassation instaure alors le système du tout ou rien.
|
Arrêt Desmares
(Cass. 2e civ., 21 juill. 1982)
Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches, telles qu’énoncées au mémoire ampliatif :
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’à la tombée de la nuit, dans une agglomération, la voiture automobile de Z… heurta et blessa les époux X… qui traversaient la chaussée à pied ; que lesdits époux ont réclamé à Z… et à son assureur “La Mutualité Industrielle”, la réparation de leur préjudice ; que la S.N.C.F., agissant comme caisse autonome de Sécurité sociale et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes sont intervenues ;
Sur le moyen pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas répondu aux conclusions soutenant que les victimes ne s’étaient pas conformées à l’article R. 219 du Code de la route qui les obligeait à ne traverser la chaussée qu’après s’être assurées qu’elles pouvaient le faire sans danger immédiat, et alors, d’autre part, que la Cour d’appel aurait omis de réfuter les motifs des premiers juges selon lesquels les époux X… avaient commis une seconde imprudence en entreprenant la traversée de la chaussée sans s’assurer qu’ils pouvaient le faire sans danger et sans tenir compte de la vitesse et de la distance du véhicule circulant ce moment, et également selon lesquels la distance à laquelle se trouvait la voiture de Z… était insuffisante pour permettre aux piétons de traverser sans danger et que ceux-ci n’auraient donc pu s’engager sur la chaussée dans de telles conditions d’autant que leur présence avait été masquée aux yeux de Z… par la voiture se trouvant à droite de celui-ci ;
Mais attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ;
Et attendu qu’après avoir relevé que l’accident s’était produit à une heure d’affluence, dans un passage réservé aux piétons ou à proximité de celui-ci, sur une avenue qui, dotée d’un éclairage public fonctionnant normalement, comprenait quatre voies de circulation, deux dans chaque sens, l’arrêt retient que, circulant sur la voie de gauche, la voiture de Z… avait heurté les époux X…, lesquels traversaient la chaussée de droite à gauche par rapport au sens de marche de l’automobiliste ;
Que, par ces énonciations d’où il résulte qu’à la supposer établie, la faute imputée aux victimes n’avait pas pour Z… le caractère d’un événement imprévisible et insurmontable, la cour d’appel, qui, par suite, n’était pas tenue de rechercher, en vue d’une exonération partielle du gardien, l’existence de ladite faute, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 15 janvier 1981 par la Cour d’appel de Reims ;
|
De toute évidence, cette jurisprudence était annonciatrice de l’intervention du législateur dont l’intervention a été mue par la volonté d’améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation.
?Adoption de la loi du 5 juillet 1985
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter du nom du célèbre Garde des sceaux, a été adoptée dans le dessin, comme indiqué dans son intitulé, de tendre « à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ».
Ainsi, le législateur a-t-il fait le choix d’un système d’indemnisation plus simple, plus souple et automatique à la faveur des victimes d’accident de la circulation.
L’idée sous-jacente était qu’il fallait déconnecter le droit à indemnisation du droit commun de la responsabilité, lequel demeurait très marqué, malgré les évolutions jurisprudentielles, par le fondement de la faute.
À la vérité, l’économie de la loi du 5 juillet 1985 est le résultat d’un compromis entre :
- D’une part, la poursuite d’un objectif d’indemnisation des victimes, ce qui s’est traduit par deux choses :
- Un assouplissement des conditions de mise en œuvre de la responsabilité
- Un durcissement des conditions d’exonération de la responsabilité
- D’autre part, le maintien du rôle de la faute de la victime, laquelle faute est susceptible de réduire, en certaines circonstances, son droit à indemnisation.
?Exclusivité de la loi du 5 juillet 1985
Immédiatement après l’adoption de la loi du 5 juillet 1985, une question s’est posée au sujet de son articulation avec l’article 1384, al. 1er du Code civil.
La loi Badinter n’a, en effet, pas été accompagnée par une abrogation de l’article 1384, al. 1er du Code civil, de sorte que cette disposition demeurait toujours en vigueur.
Aussi, certains auteurs se sont demandé si un cumul entre le principe général de responsabilité du fait des choses et le régime spécial instauré par le nouveau texte était envisageable.
Les victimes d’accident de la circulation pouvaient-elles agir en responsabilité sur les deux fondements textuels ?
Autrement dit, le régime spécial institué par la loi du 5 juillet 1985 était-il exclusif de tout autre régime de responsabilité et notamment du régime de responsabilité du fait des choses ou pouvait-il se cumuler avec lui ?
Rapidement saisie de la question, la Cour de cassation a affirmé, sans ambiguïté, par deux arrêts, que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident » (Cass. 2e civ., 19 nov. 1986, n°85-13.760).
|
Cass. 2e civ., 19 nov. 1986
Sur les deux moyens réunis ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X…, circulant en agglomération sur son cyclomoteur, a fait une chute et s’est blessé ; qu’imputant cet accident à la présence d’une tranchée mal remblayée creusée dans la chaussée par l’entreprise Rabineau pour le compte de M. Y…, il a assigné ceux-ci en réparation de ses dommages ; que les compagnies d’assurances Mutuelle Générale Française Accidents (MGFA) et la Zurich sont intervenues à l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… et la MGFA de leurs demandes, alors que, d’une part, le mauvais état de la tranchée étant établi, il n’était pas nécessaire de prouver un contact entre celle-ci et la victime, alors que, d’autre part, la cour d’appel n’aurait pas recherché si cette tranchée n’avait pas joué un rôle actif dans l’accident, et alors, enfin, que l’arrêt se serait contredit en déclarant le point de choc inconnu après avoir admis la présence de sang à côté de la tranchée ; qu’il est encore soutenu que M. X…, victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué son véhicule terrestre à moteur, n’aurait pu voir limiter son indemnisation qu’en considération de sa faute, et qu’en ne recherchant pas s’il avait commis une faute, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, victime d’un accident de la circulation, ne saurait invoquer la loi du 5 juillet 1985 lorsque seul son véhicule est impliqué dans l’accident ; que le moyen procède donc de ce chef d’une fausse interprétation des textes prétendument violés ;
Et attendu que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et hors de toute contradiction, relève que l’accident n’a eu aucun témoin et n’a donné lieu à aucun constat, que le point de chute de M. X… et les circonstances de l’accident sont demeurés inconnus, et qu’il n’est établi, ni que la victime ait heurté la tranchée, ni que sa chute ait été imputable au mauvais état de celle-ci ;
Qu’ayant ainsi admis que M. X… n’apportait pas la preuve, à sa charge, que la tranchée eût été de quelque manière l’instrument des dommages, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
Un an plus tard, la Cour de cassation précise que « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l’exclusion de celles des articles 1382 et suivants du Code civil » (Cass. 2e civ., 4 mai 1987, n°85-17.051).
Bien que le système instauré par loi du 5 juillet 1985 tende à améliorer le sort des victimes d’accidents de la circulation, elle ne dispense cependant pas ces dernières de remplir un certain nombre de conditions en plus du préjudice dont elles devront, avant toute chose, conformément au droit commun, établir le caractère réparable.
Aussi, l’étude du régime de la responsabilité du fait des accidents de la circulation suppose-elle d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’indemnisation qui doivent être satisfaites par les victimes (I), après quoi il conviendra de s’intéresser aux causes susceptibles de bénéficier aux personnes désignées comme responsables (II).
I) Les conditions d’indemnisation
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
Aussi, l’application de ce texte suppose-elle la satisfaction de cinq conditions cumulatives :
- Un véhicule terrestre à moteur (VTM)
- Un accident
- Un accident de la circulation
- L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
- L’imputation du dommage à l’accident
A) Un véhicule terrestre à moteur
L’article L. 110-1 du Code de la route définit le véhicule terrestre à moteur comme le véhicule « pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur des rails ».
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette définition :
- Principe
- Tout véhicule qui circule sur le sol et qui est mû par une force motrice quelconque entre dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.
- Ainsi, le véhicule doit-il répondre à deux critères cumulatifs :
- Circuler par voie terrestre
- Être pourvu d’un moteur à propulsion
- La Cour de cassation a précisé que « peu importe que le moteur du véhicule fonctionne ou non » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986)
- Ce qui compte, c’est que le véhicule soit muni d’un moteur, même de faible puissance
- Les catégories de véhicules concernées
- Les automobiles
- Les camions
- Les autobus
- Les motocyclettes
- Les cyclomoteurs
- Les engins agricoles
- Les véhicules de chantier
- Les remorques et semi-remorques
- Les trolleybus
- Les catégories de véhicules exclues
- Les chemins de fer
- Les tramways
- Principe
- La loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable aux tramways, lesquels sont présumés circuler sur une voie qui leur est propre
- Dans un arrêt du 18 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue, lorsque le tramway circule « sur une voie ferrée implantée sur la chaussée, dans un couloir de circulation qui lui est réservé et délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue » (Cass. 2e civ., 18 oct. 1995, n°93-19.146).
- Exception
- La Cour de cassation estime qu’un « tramway qui traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route ne circule pas sur une voie qui lui est propre » (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n°10-19.491)
- Autrement dit, dès lors que le tramway croise une voie de circulation ouverte aux véhicules terrestre à moteur, la loi du 5 juillet 1985 redevient applicable.
- Les jouets
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a estimé que les véhicules miniatures destinés à l’usage des enfants étaient exclus du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985, car « non soumis à l’assurance automobile obligatoire » (Cass. 2e civ., 4 mars 1998, n°96-12.242).
- Dans un second temps, la Cour de cassation a néanmoins adopté la position radicalement inverse en considérant que la loi du 5 juillet 1985 était applicable dès lors que, au moment de l’accident, le véhicule « se déplaçait sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération » de sorte qu’il « ne pouvait être considérée comme un simple jouet » (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n°14-13.994).
B) Un accident
?La notion d’accident
L’accident doit être compris comme tout événement fortuit ou imprévu. Aussi, cela suppose-t-il l’existence d’un aléa quant à la réalisation du fait dommageable.
A contrario, cela signifie que lorsque l’accident est le résultat d’une faute intentionnelle, la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable.
?La notion de faute intentionnelle
Que faut-il entendre par faute intentionnelle ?
Deux conceptions sont envisageables :
- Dans une conception stricte, la faute intentionnelle s’entend comme la volonté de causer l’accident et de produire le dommage
- Dans une conception large, la faute intentionnelle suppose seulement la volonté de causer l’accident.
À l’examen, il apparaît que la jurisprudence est plutôt encline à retenir une conception large de la faute intentionnelle, de sorte qu’elle écartera l’application de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu’est établie la seule volonté de causer l’accident (V. en ce sens Cass. 2e civ., 22 janv. 2004, n°01-11.665 ; Cass. 2e civ., 14 avr. 2005, n°03-13.792)
C) Un accident de la circulation
?Notion de circulation
La loi du 5 juillet 1985 n’est applicable qu’aux accidents de la circulation.
La notion de circulation est entendue largement par la jurisprudence, en ce sens qu’elle n’exige pas que le véhicule, instrument du dommage, soit en mouvement.
Peu importe que le véhicule soit :
- En position de stationnement (Cass. 2e civ., 22 nov. 1995, n°93-21.221)
- La Cour de cassation estime que « le stationnement d’une automobile sur la voie publique est un fait de circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 »
?Critère de la circulation
Le critère auquel la jurisprudence se référer pour déterminer si l’accident est susceptible d’être rattaché à la circulation du véhicule est un critère fonctionnel.
Autrement dit, pour que la loi du 5 juillet 1985 ait vocation à s’appliquer, le véhicule doit, être dans sa fonction de déplacement.
Dès lors que le dommage est étranger à la fonction de déplacement du véhicule, l’application de la loi est exclue.
L’application du régime spécial des accidents de la circulation est ainsi exclue lorsque le véhicule est utilisé :
- comme d’un outil (engin de chantier ou agricole)
- comme un instrument de travail (camion-restaurant, baraque à pizza, bibliobus).
Dans un arrêt du 13 janvier la Cour de cassation subordonne l’exclusion de l’application de la loi du 5 juillet 1985 au respect de deux conditions (Cass. 2e civ. 13 janv. 1988, n°86-16.234 et n°84-16.561) :
- le véhicule soit immobilisé
- seul l’usage étranger à la fonction de déplacement doit être à l’origine du dommage
La Cour de cassation a néanmoins précisé dans un arrêt du 21 novembre 2013 concernant un engin de chantier que l’article L. 211-1 du Code des assurances ne limitait pas « son champ d’application aux seuls véhicules en mouvement », et qu’il se déduit de l’article R. 211-5 du même code, « que les accidents causés par les accessoires ou la chute d’objets sont, depuis l’intervention du décret de 1986, garantis même si le véhicule ne circule pas et si l’accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 » (Cass. 2e civ., 21 nov. 2013, n°2-14.714)
Quid de l’application de la loi Badinter lorsque l’accident survient dans le cadre d’une opération de chargement ou de déchargement ?
Peut-on estimer que, dans pareille situation, l’usage du véhicule est étranger à sa fonction de déplacement ?
Telle est la question qu’a eue à trancher la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2001 (Cass. 2e civ. 25 janv. 2001, n°99-12.506).
|
Cass. 2e civ., 25 janv. 2001
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, passager transporté dans un autobus du Service de transport de l’agglomération rennaise (STAR), a fait une chute en se déplaçant à l’intérieur du véhicule en arrêt prolongé dans une station du centre de la ville ; qu’ayant été blessée, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, le STAR et son assureur, la société CPA assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;
Sur le second moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X…, l’arrêt énonce que l’autobus était, au moment de l’accident, arrêté, non pour un arrêt momentané, mais pour une station d’une certaine durée, sur un emplacement spécialement aménagé au parking Rennes-République, assimilable à un terminus et qu’il était dépourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation ; que Mme X…, qui se borne à indiquer qu’elle est tombée à l’intérieur de l’autobus, ne rapporte pas la preuve que sa chute est la conséquence de sa présence dans le véhicule, ni d’une perturbation quelconque due au fait qu’elle se trouvait dans l’autobus au moment de sa chute ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il desservait, était en circulation, et que la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constituait un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers.
|
?Faits
Alors qu’un autobus est à l’arrêt sur un emplacement spécialement aménagé à cet effet, une passagère, qui souhaitait se déplacer à l’intérieur du bus, chute et se blesse.
?Procédure
Dans un arrêt du 3 septembre 1997, la Cour d’appel de Rennes refuse d’appliquer la loi du 5 juillet 1985, estimant que « l’autobus était, au moment de l’accident, arrêté, non pour un arrêt momentané, mais pour une station d’une certaine durée, sur un emplacement spécialement aménagé au parking Rennes-République, assimilable à un terminus et qu’il était dépourvu de chauffeur ; qu’il ne s’agit donc pas d’un accident de la circulation »
?Solution
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel en affirmant que « L’autobus même en arrêt prolongé sur la ligne qu’il desservait était en circulation. Ainsi, la chute d’une passagère à l’intérieur de ce véhicule constituait un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué ».
?Analyse
Ainsi, ressort-il de cette décision que la Cour de cassation retient une conception relativement large de la notion déplacement.
Au total, peu importe que le véhicule ne se déplace pas au moment de l’accident. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il suffit qu’existe un lien entre l’accident et la fonction de déplacement du véhicule.
La Cour de cassation a estimé en ce sens que la loi Badinter avait vocation à s’appliquer s’agissant d’un dommage causé par la projection d’un tendeur et d’une plaque de contreplaqué arrimée au toit d’un véhicule pourtant régulièrement stationné (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n°04-15.418).
La haute juridiction a estimé que dans la mesure où « les blessures avaient été provoquées par la projection d’un objet transporté et d’un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, ce dont il résultait que M. X… avait été victime d’un accident de la circulation et que la garantie de l’assureur du véhicule était due ».
D) L’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident
Si la loi du 5 juillet 1985 devait être résumée en un seul mot, c’est sans aucun doute celui d’implication qu’il conviendrait de choisir.
La notion d’implication est l’élément central du système d’indemnisation mis en place par la loi Badinter à la faveur des victimes d’accidents de la circulation.
Sont débiteurs de l’obligation d’indemnisation les conducteurs ou gardiens d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par implication.
1. Notion d’implication
Dans un arrêt du 18 mai 2000, la Cour de cassation considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur que « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190).
Deux enseignements peuvent immédiatement être retirés de cette définition :
- L’exigence d’un rapport d’imputation entre le VTM et le dommage
- L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 n’exige pas que le VTM soit impliqué dans le dommage.
- Le VTM doit, en effet, être seulement impliqué dans l’accident
- Il ne s’agit donc pas de savoir si le VTM A a causé un dommage à la victime B, mais uniquement de constater que :
- Le VTM A est impliqué dans un accident de la circulation
- La victime B souffre d’un dommage résultant de l’accident de la circulation dans lequel est impliqué le VTM A
- Ainsi, l’accident fait-il écran entre le VTM et le dommage, ce qui signifie qu’il appartiendra à la victime d’établir que le dommage peut être rattaché à l’accident.
- L’exigence d’un rapport d’éventualité entre le VTM et l’accident de la circulation
- L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est plus large que la notion de causalité, en ce sens que la loi n’exige pas l’établissement d’un rapport causal entre le VTM et l’accident pour que la condition d’implication soit remplie.
- Deux théories se sont opposées quant à l’intensité du rattachement que suppose la notion d’implication :
- Rapport de nécessité : il faut que le véhicule ait été nécessaire à la production de l’accident.
- L’exigence d’implication se rapprocherait alors de la théorie de l’équivalent des conditions.
- Selon cette théorie, tous les faits qui ont concouru à la production du dommage doivent être retenus, de manière équivalente, comme les causes juridiques dudit dommage, sans qu’il y ait lieu de les distinguer, ni de les hiérarchiser.
- Rapport d’éventualité : il suffit que le véhicule ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident.
- L’exigence d’implication se rapprocherait alors d’une causalité hypothétique.
- En d’autres termes, cela reviendrait à admettre que l’on puisse rechercher la responsabilité de l’auteur d’un dommage, sans que soit établi le rapport causal entre le VTM et l’accident.
2. L’appréciation de la notion d’implication par la jurisprudence
L’examen de la jurisprudence révèle que la notion d’implication est appréciée différemment selon qu’il a eu implication du VTM par contact matériel ou non dans l’accident.
Deux situations doivent être distinguées :
?En présence d’une implication du VTM dans l’accident par contact matériel
- Première étape : critère du rôle perturbateur
- Dans trois arrêts du 21 juillet 1986 la Cour de cassation a d’abord estimé que dès lors qu’il y a eu contact et que le VTM a joué un rôle perturbateur il est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt, ou en stationnement.
- Les faits :
- Un piéton est contraint de traverser en dehors du passage protégé en raison de la présence d’un autobus qui était en stationnement sur ledit passage qu’il obstruait totalement.
- Il est heurté par un cyclomoteur.
- Une action est engagée contre a compagnie d’autobus sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation estime que « le véhicule de la R.A.T.V.M., dans les conditions où il stationnait, avait perturbé la circulation de Mme De Bono et s’était ainsi trouvé également impliqué dans l’accident » (Cass. 2e civ., 21 juill. 1986, n°84-10.393).
- Le critère du rôle perturbateur a fait l’objet de nombreuses critiques, certains auteurs reprochant à la Cour de cassation d’avoir restreint le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985.
- La solution retenue par la Cour de cassation revenait, en effet, à envisager qu’un VTM puisse ne pas être impliqué dans l’accident dès lors qu’il n’avait pas joué de rôle perturbateur, alors même qu’un contact matériel était établi.
- Deuxième étape : le critère du contact matériel
- Dans un arrêt du 23 mars 1994 la Cour de cassation abandonne le critère du rôle perturbateur à la faveur du critère du contact matériel
- Les faits
- Un cyclomoteur a heurté à l’arrière la camionnette arrêtée momentanément pour une livraison, à cheval sur la chaussée et l’accotement.
- Blessée, la victime engage la responsabilité du conducteur de la camionnette sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- La haute juridiction affirme en ce sens que « le fait qu’un véhicule terrestre à moteur soit en stationnement sans perturber la circulation n’exclut pas son implication dans un accident, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 » (Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n°92-14.296).
- Il résulte de cet arrêt que le seul contact matériel suffit à établir l’implication du VTM dans l’accident.
- Troisième étape : l’instauration d’une présomption irréfragable
- Dans un arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation instaure une présomption irréfragable d’implication du VTM dans l’accident dès lors qu’il y a eu contact matériel
- Les faits
- Un mineur qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion tombé en panne
- Il est mortellement blessé.
- Procédure
- Par un arrêt du 15 mai 1992, la Cour d’appel de Colmar déboute les ayants droit de la victime de leur demande
- Les juges du fond estiment que dans la mesure où le camion était régulièrement stationné, il n’a pas pu entraîner de perturbation dans la circulation du cycliste, de sorte qu’il n’était pas impliqué dan l’accident.
- La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Pour justifier sa solution, elle affirme « qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement » (Cass. 2e civ. 25 janv. 1995, n°92-17.164).
|
Cass. 2e civ., 25 janv. 1995
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu’est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par temps de pluie, le mineur Frédéric X…, qui circulait à bicyclette sur l’accotement bitumé d’une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d’un camion de la société DSB Poussier tombé en panne ; que, le cycliste ayant été mortellement blessé, ses parents ont demandé à M. Y…, à son employeur et à l’assureur, la Société d’assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), la réparation de leur dommage ;
Attendu que, pour débouter les époux X… de leurs demandes, l’arrêt retient que le stationnement du camion sur l’accotement bitumé était régulier, que les conditions de ce stationnement n’ont pu entraîner une perturbation dans la circulation du cycliste et que, dès lors, le camion n’était pas impliqué dans l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz.
|
-
- De toute évidence, l’évolution jurisprudentielle de l’appréciation de la notion d’implication constitue une rupture avec la causalité telle qu’elle est comprise dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.
- Lorsque la responsabilité de l’auteur d’un dommage est recherchée sur le fondement de l’article 1242, al. 1er, cela suppose pour la victime d’établir le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
- Lorsqu’il y a eu contact entre la chose et le siège du dommage, deux situations doivent être distinguées :
- Si contact + chose en mouvement alors présomption de rôle actif
- Si contact + chose inerte alors rôle actif si anormalité établie
- En matière de responsabilité du fait des choses, lorsqu’il y a eu contact, le gardien est susceptible de s’exonérer de sa responsabilité en démontrant que la chose n’a pas joué un rôle actif dans la production du dommage.
- Sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985, cette possibilité n’est pas offerte au conducteur ou gardien du véhicule : « est nécessairement impliqué dans l’accident, au sens de ce texte, tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement ».
- Deux conséquences peuvent être tirées de cette règle posée par la Cour de cassation :
- Dès lors qu’il y a eu contact, le véhicule est impliqué dans l’accident, peu importe qu’il ait été en mouvement, à l’arrêt ou en stationnement
- Tout contact signifie donc implication.
- Le conducteur ou gardien du véhicule ne peut pas combattre la présomption d’implication en rapportant la preuve contraire.
- Dans l’arrêt du 25 janvier 1995, la Cour de cassation emploie l’adverbe « nécessairement », ce qui signifie qu’il s’agit là d’une présomption irréfragable.
?En présence d’une implication du VTM dans l’accident sans contact matériel
Il ressort de la jurisprudence que l’implication n’exige pas nécessairement l’établissement d’un contact au moment de l’accident, peu importe que le véhicule ait été ou non en mouvement.
La Cour de cassation considère en ce sens qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190).
Dès lors, l’absence de contact ne postule pas l’absence d’implication. Il suffit que le véhicule soit intervenu « à quelque titre que ce soit » pour être impliqué dans l’accident.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir si, pour établir l’implication du VTM, il appartiendra à la victime de démontrer le rôle perturbateur de ce dernier où si cette circonstance est indifférente.
- Première étape : l’exigence du rôle perturbateur
- Comme dans l’hypothèse où il y a eu contact, la jurisprudence a d’abord exigé de la victime qu’elle démontre que le VTM a pu constituer une gêne susceptible d’avoir joué en rôle dans la survenance de l’accident.
- Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé qu’il y avait implication :
- Dans tous ces cas de figure, la haute juridiction a considéré que le véhicule impliqué avait joué un rôle perturbateur, de sorte qu’il n’était pas étranger à la survenance de l’accident.
- À la vérité, l’exigence du rôle perturbateur quant à l’établissement du VTM dans l’accident rappelle très étrangement la condition de rôle actif exigée en matière de responsabilité du fait des choses.
- Seconde étape : abandon du critère du rôle perturbateur
- Dans un arrêt du 4 juillet 2007, la Cour de cassation semble avoir abandonné l’exigence du rôle perturbateur quant à établir l’implication du VTM dans l’accident (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n°06-14.484).
|
Cass. 2e civ., 4 juill. 2007
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 17 février 1999, circulant de nuit, le véhicule de police de marque Renault conduit par M. X…, gardien de la paix, a engagé derrière un véhicule volé de marque Subaru une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d’une autoroute et s’est retourné ; que M. X… a été blessé, tandis que des deux passagers gardiens de la paix, l’un, Jean Y…, a été tué, l’autre, Benoît Z…, a été blessé et est décédé le 27 mars 2002 des suites de ses blessures ; que la société MACIF, assureur du véhicule poursuivi, ayant refusé la garantie de l’indemnisation des dommages, Mme A…, veuve Z…, en son nom personnel et en qualité d’administratrice légale des biens de son fils mineur Francis Z…, Mme Annie B…, épouse Z… et Mme Cécile Z…, mère et soeur du défunt (les consorts Z…), ont assigné l’agent judiciaire du Trésor public (l’AJT) et la Société mutualiste du personnel de la police nationale (la SMPPN) en réparation de leurs préjudices ; que l’AJT a assigné la MACIF en garantie ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MACIF fait grief à l’arrêt d’avoir jugé que le véhicule assuré par la MACIF était impliqué dans l’accident de la circulation ayant causé des blessures et le décès de Benoît Z…, alors, selon le moyen, que l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre véhicule, qu’il l’ait heurté, gêné ou surpris ; qu’il ne suffit pas que le conducteur d’un véhicule ait eu l’intention d’en poursuivre ou d’en rejoindre un autre pour que ce dernier véhicule puisse être déclaré impliqué dans l’accident dans lequel est impliqué le premier véhicule ; qu’en se fondant sur la seule circonstance que “c’est dans le cadre d’une course-poursuite du véhicule des malfaiteurs que le policier a perdu le contrôle du véhicule de service” pour déclarer que le véhicule Subaru était impliqué dans l’accident du véhicule de police, sans constater l’existence d’une manoeuvre perturbatrice imputable à son conducteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l’arrêt retient exactement qu’est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident et qu’en l’espèce, la MACIF ne saurait valablement contester l’implication du véhicule Subaru, dès lors que, malgré l’absence de contact, l’accident s’est produit durant la poursuite du véhicule des malfaiteurs ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé
|
Faits
- Un véhicule de police a engagé derrière un véhicule volé une poursuite au cours de laquelle il a heurté le muret d’une autoroute et s’est retourné
- Un gardien de la paix est tué
Procédure
Par un arrêt du 9 mars 2006 la cour d’appel de Lyon retient la responsabilité du conducteur du véhicule poursuivi au motif qu’il était impliqué dans l’accident.
Moyen
- L’auteur du pourvoi reproche notamment à l’arrêt rendu par les juges du fond d’avoir fait droit à la demande de la victime alors que « l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation suppose qu’il ait objectivement eu une influence sur le comportement de la victime ou du conducteur d’un autre véhicule, qu’il l’ait heurté, gêné ou surpris ».
Solution
La Cour de cassation de cassation rejette le pourvoi formé par le défendeur considérant que « est impliqué au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident ».
Manifestement, il apparaît que la formule utilisée ici par la Cour de cassation rappelle étrangement la motivation adoptée dans les arrêts précédents.
Pour mémoire, dans l’arrêt du 18 mai 2000, elle considère qu’il y a implication dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur « est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident » (Cass. 2e civ. 18 mai 2000, n°98-10.190).
Bien que les deux solutions retenues dans les deux arrêts semblent similaires, celle adoptée dans le présent arrêt se démarque de la jurisprudence antérieure dans la mesure où le véhicule impliqué dans l’accident n’avait joué, en l’espèce, aucun rôle perturbateur. Et pour cause, il ne poursuivait aucunement la victime au moment de la survenance du dommage : il était tout au contraire poursuivi par cette dernière.
Aussi, plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision :
- L’abandon du critère du rôle perturbateur
- En abandonnant le critère du rôle perturbateur, la Cour de cassation n’exige plus que le véhicule ait joué un rôle actif dans la survenance de l’accident.
- Il en résulte que, même en l’absence de contact, le non-établissement du rôle perturbateur du véhicule ne fait pas obstacle à son implication dans l’accident.
- L’abandon de l’exigence d’une causalité certaine
- Avec cette décision, la Cour de cassation achève la rupture déjà consommée avec l’exigence de causalité, en ce sens qu’il n’est plus nécessaire que soit établi un rapport causal entre le VTM et l’accident.
- Il suffit que le VTM ait pu jouer un rôle dans la survenance de l’accident pour que la condition tenant à l’implication soit remplie
- Autrement dit, pour savoir si le VTM est impliqué, cela suppose simplement de se demander si, sans la présence du véhicule, l’accident serait ou non survenu sans pour autant que ce véhicule ait eu un rôle perturbateur.
- Ainsi, dans l’arrêt en l’espèce, le raisonnement tenu par la Cour de cassation est le suivant :
- si les voleurs n’avaient ne s’étaient pas enfuis, les policiers ne l’auraient pas poursuivi
- Dès lors, l’accident ne serait pas survenu
- Le VTM des voleurs est donc bien intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident
- De toute évidence, il n’est pas certain, en l’espèce, que l’existence du véhicule poursuivi ait et la moindre incidence sur la réalisation de l’accident.
- Pour autant, la haute juridiction estime qu’il a pu jouer un rôle, ce qui suffit à établir son implication.
- La Cour de cassation raisonne ici en termes de causalité hypothétique, ce qui constitue une véritable rupture avec le droit commun de la responsabilité.
- La deuxième chambre civile a néanmoins précisé dans un arrêt du 13 décembre 2012 que « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens » de la loi du 5 juillet 1985 (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-19.696).
- Il échoit donc à la victime d’établir que le VTM a pu jouer un rôle, même hypothétique, dans la réalisation du fait dommageable.
|
Cass. 2e civ., 13 déc. 2012
Vu l’article 1er de la loi n° 85 – 677 du 5 juillet 1985;
Attendu que la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens du texte susvisé;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le véhicule conduit par M. C…, non assuré, a, au cours d’une manoeuvre de dépassement, successivement percuté la motocyclette pilotée par M. D…, le véhicule de M. E… et celui conduit par Franck Y…, circulant tous en sens inverse ; que ce dernier et son fils Francis Y… sont décédés, tandis que leur épouse et mère, Mme X…, a été blessée dans l’accident ; que Mme X… veuve Y…, en son nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Fabien, ainsi que Mme Reinette, F… veuve Y…, M. Charles, Denis Y…, Mme Muriel Y… épouse G…, Mme Marie-Paule, F… épouse A… et M. Max, Léandre, F… (les consorts Y…), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société L’Equité assurances, assureur du véhicule de Franck Y… ; qu’ont été appelés en la cause le GFA Caraïbes, assureur du véhicule de M. D…, la Mutuelle des Provinces de France, (MPF), assureur du véhicule de M. E…, ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), assureur du véhicule de M. H… circulant dans la file de véhicules dépassée par celui de M. I… ; que la société Areas dommages, venant aux droits de la société MPF, est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que, pour dire impliqué dans l’accident le véhicule conduit par M. H…, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’il se déduit du courrier adressé par M. H… à son assureur qu’il suivait une file de voitures quand il a été dépassé par le véhicule de M. I…, qui a heurté de plein fouet un véhicule circulant en sens inverse ; que le choc a projeté du liquide corrosif sur le capot et la calandre de la voiture de M. H… ; qu’il était donc dans la file des véhicules concernés par la manoeuvre de dépassement ; qu’ainsi M. H… a été directement victime d’un dommage matériel immédiatement consécutif aux collisions successives intervenues dans un même laps de temps entre les véhicules impliqués ; que dès lors, victime de cet accident, M. H… est nécessairement impliqué au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’implication de ce véhicule, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE
|
E) L’imputation du dommage à l’accident
L’implication d’un VTM dans l’accident ne suffit pas à engager la responsabilité de son conducteur ou de son gardien sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 : encore faut-il que le dommage puisse être rattaché à l’accident.
Cela signifie, autrement dit, que le conducteur ou le gardien du VTM impliqué n’est tenu d’indemniser la victime que pour les dommages que cette dernière est en mesure d’imputer à l’accident.
Cette condition se déduit de l’article 1er de la loi Badinter qui vise « les victimes d’un accident de la circulation ».
Le dommage causé par un événement autre que l’accident dans lequel est impliqué le VTM n’est donc pas indemnisable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
De prime abord, si cette affirmation peut paraître relever du truisme, la règle dont elle et porteuse n’en est pas moins source de quelques difficultés :
- Tout d’abord, rien exclut que le préjudice dont se plaint la victime soit imputable à un autre fait dommageable.
- Or si tel est le cas, il ne saurait être réparé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- Ensuite, quid dans l’hypothèse où le dommage subi par la victime ne se révèle que postérieurement à l’accident ?
- Plus le préjudice se révélera tard, plus la question de son imputation à l’accident se posera.
- Or la loi du 5 juillet 1985 exige un lien de causalité certain en la matière et non seulement hypothétique
Au regard de ces deux hypothèses, la condition d’imputabilité du dommage à l’accident prend alors tout son sens.
Cela conduit, en effet, à réintroduire l’exigence d’un rapport causal quant à l’appréciation de l’indemnisation de la victime.
Tandis que l’implication a remplacé la causalité quant au rapport entre le VTM et l’accident, l’exigence d’un lien de causalité reprend tous ses droits quant à l’appréciation du rapport entre le dommage et l’accident.
Est-ce à dire que l’on revient au point de départ en ce sens que la loi du 5 juillet 1985 ne parviendrait pas, in fine, à remplir son objectif premier, soit l’amélioration de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ?
Dans la mesure où la notion d’implication est une notion centrale dans le dispositif mis en place par le législateur en 1985, on est légitimement en droit de s’interroger.
Aussi, afin de ne pas priver la loi Badinter de son efficacité, la Cour de cassation est venue en aide aux victimes en instituant une présomption d’imputation du dommage à l’accident.
?La reconnaissance d’une présomption d’imputation du dommage à l’accident
Dans un arrêt du 16 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » (Cass. 2e civ. 16 oct. 1991, n°90-11.880).
|
Cass. 2e civ. 16 oct. 1991
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 5 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ;
Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’après la collision de la voiture de M. Z… et de celle de Mlle Y…, une passagère de celle-ci, Mlle Nathalie X…, étant décédée, les consorts X… ont demandé aux deux conducteurs et aux Assurances générales de France, assureur de Mlle Y…, la réparation de leur dommage ; que le Fonds de garantie est intervenu à l’instance ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir relevé que le décès était directement en relation avec l’inhalation d’un produit stupéfiant antérieurement à l’accident, retient qu’il n’est pas établi par les consorts X… que la jeune fille ait été victime de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, bien qu’il résultât de ses propres constatations et énonciations qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
|
?Faits
- La passagère d’un VTM est mortellement blessée à la suite d’une collision
- Ses ayants droit engagent la responsabilité du conducteur du VTM impliqué
?Procédure
Par un arrêt du 16 mai 1989, la Cour d’appel de Rennes déboute les requérant de leur demande estimant que « le décès était directement en relation avec l’inhalation d’un produit stupéfiant antérieurement à l’accident », de sorte que le préjudice de la victime était sans lien avec ledit accident.
?Solution
La Cour de cassation censure les juges du fond, estimant « qu’il n’était pas exclu que l’émotion provoquée par la collision eût joué un rôle dans le processus mortel ».
Autrement dit, pour la Cour de cassation, il appartenait au conducteur du véhicule impliqué d’établir que le décès de la victime n’était pas imputable à l’accident, ce qu’il n’avait pas démontré en l’espèce.
Ainsi, la Cour de cassation institue-t-elle, dans cette décision, une présomption d’imputation du dommage à l’accident que le conducteur du véhicule impliqué pourra combattre en rapportant la preuve contraire.
Dans un arrêt du 19 février 1997 la deuxième chambre civile a maintenu cette solution en reprenant mot pour mot la formule qu’elle avait employée dans son arrêt du 16 octobre 1991 : « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage » (Cass. 2e civ. 19 févr. 1997, n°95-14.034)
Il s’agissait en l’espèce du conducteur d’un VTM blessé à la jambe lors d’une collision qui quelque temps après décède d’une crise cardiaque.
?Le domaine de la présomption d’imputation du dommage à l’accident
L’examen de la jurisprudence révèle que la présomption d’imputation du dommage à l’accident ne jouera que dans deux hypothèses :
- Première hypothèse
- Le préjudice subi par la victime survient dans un temps voisin de l’accident.
- Si le dommage n’apparaît que dans un temps éloigné de l’accident, aucune présomption ne pourra jouer
- C’est donc à la victime qu’il appartiendra de prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident.
- Tel sera notamment le cas lorsque le dommage survient près de deux ans après l’accident (Cass. 2e civ. 24 janv. 1996, n°94-10.923).
- Seconde hypothèse
- Le préjudice subi par la victime est une suite prévisible de l’accident
- Dans le cas contraire, la présomption d’imputation du dommage à l’accident sera écartée.
- Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’une victime se suicide plus de deux mois après l’accident, alors qu’elle n’avait, sur le moment, subi aucun dommage (Cass. 2e civ. 13 nov. 1991, n°90-15.472).
|
Civ. 2e, 24 janv. 1996
Sur le premier moyen, pris en sa première et deuxième branche :
Vu l’article 1315 du Code civil, ensemble l’article 1382 du même Code ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en mars 1982, l’automobile de M. X… étant entrée en collision avec celle de Mlle A…, sa passagère à l’avant droit, Mme Y…, a été blessée ; qu’en octobre 1984, Mme Y… a assigné M. X… et son assureur la compagnie AXA assurances IARD, en réparation de son préjudice corporel résultant d’une polyarthrite rhumatoïde, consécutive, selon elle, au traumatisme cervical subi lors de l’accident ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir énoncé que la loi du 5 juillet 1985 a établi au profit des victimes d’un accident de la circulation une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident, retient que la dégradation de l’état de santé de Mme Y… a commencé peu de temps après l’accident et que Mme Y… est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité de son dommage à l’accident ;
Qu’en faisant ainsi supporter à M. X… la preuve de la non-imputabilité du dommage invoqué par Mlle A… à l’accident, alors que ce dommage s’était révélé postérieurement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
|
?Cas particulier des accidents complexes
Si la mise en œuvre de la condition tenant à l’imputation du dommage à l’accident ne soulève guère de difficulté lorsqu’un seul véhicule est impliqué, la problématique se complique considérablement lorsque l’on est en présence d’un accident complexe, soit de collisions en chaîne.
Exemple :
- Un carambolage se produit dans lequel sont impliqués une dizaine de VTM
- Comment appréhender la condition tenant l’imputation du dommage à l’accident lorsque le décès de la victime résulte du 2e choc ?
- Doit-on estimer que seuls les conducteurs des deux premiers chocs engagent leur responsabilité ?
- Doit-on considérer, au contraire, que la loi du 5 juillet 1985 s’applique au-delà du 2e choc, soit que l’obligation d’indemnisation pèse, indifféremment, sur tous les conducteurs des VTM y compris ceux impliqués dans les 3e et 4e chocs ?
Pour résoudre cette problématique, deux solutions sont envisageables :
- Soit l’on considère que l’accident complexe doit être découpé en plusieurs sous-accidents
- Il appartient dans ces conditions à la victime de déterminer à quel sous-accident son dommage est imputable.
- Cela revient à interpréter strictement de lettre de la loi du 5 juillet 1985.
- Soit l’on considère que l’accident complexe doit être apprécié dans sa globalité
- Il suffit alors à la victime d’établir que son dommage est imputable à l’accident complexe, pris dans son ensemble, sans qu’il lui soit besoin d’opérer un tri parmi les sous-accidents.
- Cela revient à adopter une interprétation audacieuse de la loi Badinter, dont l’objectif est de faciliter l’indemnisation des victimes.
Quelle solution a été retenue par la jurisprudence ? La position adoptée aujourd’hui par la Cour de cassation est le fruit d’une évolution jalonnée par de nombreuses hésitations.
- Première étape
- Dans un arrêt du 26 novembre 1986, la Cour de cassation a semblé se satisfaire de l’établissement de l’implication du VTM dans l’accident complexe, sans exiger de la victime qu’elle rapporte la preuve de l’imputation de son dommage à un choc en particulier (Cass. 2e civ. 26 nov. 1986, n°85-13.760).
- Autrement dit, selon la haute juridiction, dès lors que le VTM est impliqué, l’application de la loi du 5 juillet 1985 ne suppose pas pour la victime qu’elle établisse le rôle joué par chacune des collisions dans la réalisation de son dommage.
- Deuxième étape
- Dans un arrêt du 24 octobre 1990, la Cour de cassation a, par suite, admis que le conducteur du VTM impliqué dans un accident complexe puisse s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve que le dommage subi par la victime n’était pas imputable au fait de son véhicule (Cass. 2e civ., 24 oct. 1990, n°89-13.306).
- Aussi, cette solution revient-elle à abandonner l’approche globale de l’accident complexe, celui-ci devant être découpé en autant de sous-accidents qu’il y a eus de chocs, à charge pour le conducteur dont on engage la responsabilité de démontrer que le dommage subi par la victime n’est pas imputable à la collision dans laquelle son véhicule est impliqué.
- Troisième étape
- Dans un arrêt du 24 juin 1998, la Cour de cassation s’est, sous le feu des critiques, finalement ravisée en adoptant une approche globale de l’accident complexe (Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n°96-20.575).
- Dans cette décision, elle rappelle tout d’abord que « est impliqué au sens de l’article 1er de la loi de 1985 tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l’accident », après quoi elle en déduit que « les trois véhicules étant impliqués dans l’accident […] les trois conducteurs et leurs assureurs sont tenus à réparation »
- Ainsi, la Cour de cassation estime-t-elle que dès lors qu’un conducteur est impliqué dans un accident complexe, il est tenu à réparation sans qu’il soit besoin pour la victime d’établir l’imputation de son dommage à une ou plusieurs collisions en particulier.
- Le dommage est imputé à l’accident complexe, pris dans son ensemble si bien que tous les conducteurs impliqués sont tenus à réparation envers elle in solidum. Nul n’est besoin de déterminer leur degré d’implication dans le dommage.
|
Cass. 2e civ., 24 juin 1998
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996), et les productions, qu’un véhicule étant en panne sur une route nationale à 4 voies, en agglomération, de nuit, à un endroit où l’éclairage public ne fonctionnait pas, des fonctionnaires de police ont sollicité l’intervention d’un dépanneur ; que M. A…, préposé de la société Sada, est arrivé sur les lieux en sens inverse, et a entrepris de faire demi-tour, pour rejoindre le véhicule en panne ; que la dépanneuse immobilisée en travers de la chaussée a été heurtée par une voiture Peugeot 305 conduite par M. Y…, assuré par l’UAP ; que M. A… étant sorti de son véhicule pour constater les dégâts matériels a été heurté par une voiture Renault 4 de la société Brossolette automobile, assurée par la compagnie Nationale Suisse, et conduite par M. X… ; que M. A… gisait blessé sous la dépanneuse quand celle-ci a été heurtée, à l’arrière, par le véhicule Volkswagen de M. Z…, assuré par la Mutuelle générale d’assurances ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. Z… et son assureur, in solidum avec MM. Y…, X…, la société Brossolette automobiles et leurs assureurs, à réparer les dommages occasionnés à M. A… par l’accident, alors, selon le moyen, que la cour d’appel reconnaît dans l’exposé des faits que trois collisions successives et distinctes se sont produites, la première entre le camion et le véhicule Peugeot 305 conduit par M. Y… et entraînant des dégâts matériels, la deuxième entre M. A… descendu de son camion et le véhicule piloté par M. X… ayant notamment pour conséquence de projeter M. A… sous la dépanneuse et enfin la troisième au cours de laquelle M. Z…, au volant de son véhicule Volkswagen, a percuté légèrement l’arrière du camion de dépannage ; qu’en refusant au regard de ces constatations, et comme elle y était pourtant invitée, de rechercher si le véhicule de M. Z… avait pu jouer un rôle dans la réalisation des dégâts matériels résultant des deux premières collisions et des dommages corporels subis par M. A…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu’est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident ;
Et attendu qu’ayant retenu que 3 véhicules étaient impliqués dans l’accident dont M. A… a été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que ces trois conducteurs et leurs assureurs étaient tenus à réparation ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
?Confirmation jurisprudentielle et approbation doctrinale
Dans son dernier état, la Cour de cassation a confirmé sa position tendant à appréhender les accidents complexes de façon globale, sans opérer de tri parmi les collisions.
Ainsi, pour la haute juridiction, dès lors que plusieurs VTM sont impliqués dans un accident complexe unique, l’obligation de réparation pèse sur tous les conducteurs ou gardien des véhicules impliqués, sans distinctions.
Dans un arrêt du 11 juillet 2002, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « dans la survenance d’un accident complexe, sont impliqués au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tous les véhicules qui sont intervenus à quelque titre que ce soit » (Cass. 2e civ. 11 juill. 2002, n°01-01.666 V. également en ce sens Cass. 2e civ., 25 oct. 2007, n°05-21.807; Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n°10-19.960)
En d’autres termes, l’accident complexe ne doit plus être appréhendé comme une série de petites collisions successives qu’il convient d’isoler afin de déterminer à quel choc le dommage de la victime est imputable.
Désormais, l’accident complexe doit être envisagé globalement, ce qui revient à l’appréhender comme un accident unique.
Il en résulte que la victime peut engager la responsabilité de n’importe lequel des conducteurs ou gardiens dont le véhicule est impliqué, sans avoir à justifier ou identifier lequel des véhicules est directement la cause de son dommage
L’indemnisation des victimes s’en trouve alors facilitée et l’objectif de la loi du 5 juillet 1985 atteint. D’où l’approbation de cette jurisprudence par la doctrine, qui se félicite de la solution retenue.
II) Les causes d’exonérations
Dès lors que les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont satisfaites, la victime est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice.
La question qui alors se pose est de savoir si le conducteur ou le gardien du VTM impliqué peut s’exonérer de sa responsabilité ?
Deux enseignements peuvent être tirés de la lecture des articles 2 à 6 de la loi Badinter :
- Tout d’abord, il ressort de l’article 2 de cette loi que, contrairement au droit commun de la responsabilité du fait des choses, le conducteur ou le gardien du VTM impliqué dans l’accident ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les causes étrangères que sont « la force majeure ou le fait d’un tiers »
- Bien que cette exclusion de la force majeure et du fait d’un tiers comme cause d’exonération puisse apparaître sévère pour le responsable du dommage, elle doit être comprise à la lumière de l’obligation d’assurance qui pèse sur tout propriétaire d’un VTM.
- Ensuite, les articles 3 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 nous révèlent que la faute de la victime conserve une place dans le système d’indemnisation mis en place, dans la mesure où elle va avoir une incidence sur l’évaluation du montant de l’indemnisation voire sur le bien-fondé de l’obligation de réparation.
- L’établissement d’une faute de la victime ne conduira cependant pas à exonérer la responsabilité du conducteur ou du gardien du VTM en toute hypothèse.
- La loi distingue :
- Selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne
- Selon la personne de la victime
A) L’exonération du responsable selon que le dommage à réparer est un dommage aux biens ou à la personne
?Concernant les dommages aux biens
Aux termes de l’article 5, al. 1 de la loi du 5 juillet 1985, « la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis »
La solution retenue ici par la loi Badinter, ne déroge pas aux solutions classiques.
La faute de la victime, quelle que soit la victime, et sans que la faute ait à revêtir des caractères particuliers (force majeure), a pour effet de limiter ou d’exclure le droit à réparation.
Le choix d’une exonération totale ou partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond.
?Concernant les dommages aux personnes
La loi du 5 juillet 1985 a introduit des règles très spécifiques tendant, au moins s’agissant des victimes non-conducteurs, à restreindre les possibilités d’exonération par la preuve de la faute de la victime.
On remarque donc que le législateur, a opéré un jugement de valeur très clair :
- Pour les dommages aux biens, toute faute de la victime peut venir limiter son droit à indemnisation
- Pour les dommages aux personnes, seule une faute qualifiée de la victime peut exclure ou réduire son droit à indemnisation
Le législateur a opéré néanmoins une distinction entre les victimes conductrices et les victimes non-conductrices quant à leur droit à indemnisation.
L’esprit de la loi est animé par une certaine bienveillance à l’égard des non-conducteurs et une volonté de responsabilisation des conducteurs.
B) L’exonération du responsable selon la personne de la victime
Il peut être observé que la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil constitutionnel quant à la question de savoir si la différence de traitement réservée par la loi du 5 juillet 1985 aux victimes conductrices et non conductrices était ou non contraire à la Constitution.
La deuxième chambre civile a, en effet, estimé que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l’article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d’accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l’objet de la loi qui poursuit notamment un but d’intérêt général, de limiter ou d’exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l’existence d’une faute de leur part » (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n°10-12.732)
1. L’indemnisation des dommages à la personne : la faute de la victime non-conductrice
?Notion
Les victimes non-conductrices sont toutes les victimes directes de l’accident ainsi que les victimes par ricochet.
Parmi ces deux catégories de victimes, les victimes non-conductrices sont toutes celles qui n’avaient pas, au moment de l’accident, la qualité de conducteur, soit qui n’exerçaient pas sur le véhicule impliqué un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.
Il peut donc s’agit d’un piéton, d’un cycliste ou d’un passager y compris du véhicule du conducteur fautif
?Régime
Aux termes de l’article 3, al. 1 de la loi les victimes non-conducteurs sont insusceptibles de se voir opposer leur propre faute.
?Exception
La faute de la victime non-conducteur peut, par exception, être prise en compte.
Toutefois, les conditions d’invocation de cette exception sont plus en plus restrictives selon la qualité de la victime :
S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles peuvent se voir opposer deux types de fautes :
- leur faute inexcusable
- leur faute intentionnelle.
S’agissant des victimes non-conducteurs âgées de moins de 16 ans et de plus de 70 ans, sans incapacité permanente ou invalidité de plus de 80%, elles ne peuvent se voir opposer que leur faute intentionnelle.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se définissent les fautes inexcusables et intentionnelles :
- La faute inexcusable
- Définition
- Dans une série d’arrêts rendus en date du 20 juillet 1987, la cour de cassation a défini la faute inexcusable comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience » (Cass. 2e civ., 20 juill. 1987, n°86-11.582).
- Cette définition de la faute inexcusable a été confirmée par l’assemblée plénière dans un arrêt du 10 novembre 1995 où elle réaffirme, mot pour mot, la solution dégagée en 1987 (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n°94-13.912).
- Depuis lors, la définition de la faute inexcusable est régulièrement reprise par la haute juridiction (V. en ce sens Cass. 2e civ. 10 mars 2016, n°15-10.824).
- Conditions
- La caractérisation de la faute inexcusable suppose la satisfaction de quatre conditions cumulatives :
- Une faute volontaire
- D’une exceptionnelle gravité
- Absence de justification du comportement fautif
- Conscience du danger de la victime
|
Cass. ass. plén., 10 nov. 1995
Sur le moyen unique :
Vu l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X…, qui se trouvait sur la chaussée d’un chemin départemental, a été heurté par une voiture automobile conduite par M. Y…, laquelle a été elle-même percutée à l’arrière par une camionnette appartenant à la société Harscoat ; que, blessé, M. X… a assigné en réparation de son préjudice M. Y…, qui a appelé en garantie cette société ; que M. X… étant décédé, ses héritiers ont repris la procédure ;
Attendu que, pour retenir à la charge de M. X… une faute inexcusable et débouter ses ayants droit de leur demande, l’arrêt retient que M. X… a traversé la chaussée et s’est maintenu sensiblement au milieu de cette voie afin d’arrêter un automobiliste et de se faire prendre à son bord pour regagner son domicile, élément qui caractérise une démarche volontaire, qu’il a ainsi agi, hors agglomération, sur une route dépourvue d’éclairage, à une heure de fréquentation importante, habillé de sombre, de nuit et par temps pluvieux, élément qui caractérise l’exceptionnelle gravité de son comportement, sans raison valable, par simple commodité, et s’est exposé par son maintien sur l’axe médian de la chaussée à un danger dont il aurait dû avoir conscience, alors qu’il venait déjà précédemment d’éviter d’être renversé par un autocar, et que son imprégnation alcoolique n’était pas telle qu’elle ait pu le priver de tout discernement ;
Qu’en l’état de ces énonciations, d’où ne résulte pas l’existence d’une faute inexcusable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
|
- La faute intentionnelle
- Définition
- Aux termes de l’article 3, al. 3 de la loi du 5 juillet 1985, « dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ».
- Ainsi, la faute intentionnelle se distingue de la faute inexcusable en ce qu’elle suppose chez son auteur la volonté de produire le dommage.
- Il ne suffit donc pas que la victime se mette délibérément en danger, il faut qu’elle ait intentionnellement recherché le dommage (Cass. 2e civ. 31 mai 2000, n°98-16.707)
|
Cass. 2e civ. 31 mai 2000
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 1998), que le 21 novembre 1992, vers 19 heures 30 sur une route nationale, hors agglomération, M. Y…, piéton, a été heurté par le véhicule automobile conduit par M. X…, appartenant à son employeur la société SFPI ; que la victime étant décédée, Mme Y… agissant en son nom personnel et ès qualités d’administratice légale de ses enfants mineurs, a assigné devant le tribunal de grande instance M. X… et l’Union des assurances de Paris, assureur du véhicule, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Axa assurances, en réparation de leurs préjudices ; que la Caisse des dépôts et consignations et la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais ont été appelées dans l’instance ;
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, 1° que, seule la faute volontaire exclut toute indemnisation pour les victimes autres que les conducteurs ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever que M. Y… titubait, marchait comme s’il était ivre, doucement vers la voiture sans réagir, circonstances insusceptibles à elles seules de traduire un comportement suicidaire, la cour d’appel n’a pas caractérisé la recherche volontaire de son dommage par la victime et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ; 2° que, en toute hypothèse, la recherche volontaire du dommage doit traduire un comportement conscient, une volonté réfléchie ; qu’en retenant que le piéton titubait, marchait comme s’il avait bu, les bras ballants et avançait sans aucune réaction ” comme une personne qui n’était dans son état normal “, sans rechercher si ce comportement ne révélait pas l’absence de toute faculté de discernement de sorte que l’acte de M. Y… ne pouvait être retenu pour volontaire, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve que la cour d’appel, ayant analysé les déclarations de la veuve de la victime et des témoins et relevé qu’après une tentative de suicide la veille de l’accident, M. Y…, se trouvant sur le couloir de circulation du véhicule qui arrivait, continuait d’avancer tout en regardant la voiture jusqu’à l’impact, a retenu, justifiant légalement sa décision, que M. Y… avait volontairement recherché le dommage qu’il avait subi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
2. L’indemnisation des dommages à la personne : la faute de la victime conductrice
?Notion
Le conducteur est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le VTM impliqué dans l’accident
Autrement dit, il s’agit de celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite du VTM
?Régime
Aux termes de l’article 4 de la loi de 1985 « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il ressort de cette disposition qu’une faute quelconque peut être opposée à la victime conductrice pour limiter voire exclure son droit à indemnisation.
Par ailleurs, il peut être observé que l’on peut opposer à la victime conductrice :
- D’une part la faute à l’origine de l’accident
- D’autre part la faute à l’origine de son propre dommage
?Indemnisation
Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation a manifestement quelque peu évolué :
- Première étape
- Dans un arrêt du 24 novembre 1993, la Cour de cassation a d’abord estimé que « le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute »
- Autrement dit, la victime conductrice fautive serait déchue de son droit à indemnisation, dans l’hypothèse où le défendeur n’aurait commis aucune faute (Cass. 2e civ., 24 nov. 1993, n°92-12.350).
- Faits
- Collision frontale entre deux VTM, dont l’un d’eux s’apprêtait à tourner à gauche
- Les deux conducteurs sont blessés
- La victime fautive agit en réparation de son préjudice contre le conducteur non-fautif
- Procédure
- La Cour d’appel fait droit à la demande du conducteur fautif
- Solution
- La Cour de cassation censure les juges du fond estimant que le conducteur fautif est dépourvu d’action en réparation contre le conducteur non fautif.
|
Cass. 2e civ., 24 nov. 1993
Sur le moyen unique :
Vu l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation qui a commis une faute n’a pas d’action contre un autre conducteur qui n’a pas commis de faute ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision s’est produite entre l’automobile de Mme X… et celle de Mme Y… venant en sens inverse et s’apprêtant à tourner sur sa gauche ; que les deux conductrices ont été blessées ; que Mme Y… a demandé à Mme X… et à son assureur, la compagnie Elvia assurances, la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner Mme X… et son assureur à réparer pour partie le dommage de Mme Y…, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’empiétement du véhicule de Mme Y… sur la voie réservée aux véhicules venant en sens inverse constitue une faute à la charge de celle-ci et qu’aucun excès de vitesse n’était établi contre Mme X… qui n’avait pas commis de faute ;
En quoi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X… à indemniser Mme Y…, l’arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry
|
- Deuxième étape
- Dans un arrêt du 22 mai 1996, la Chambre criminelle prend le contre-pied de la deuxième chambre civile en considérant que qu’il résulte de la loi du 5 juillet 1985 « que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage » (Cass. crim., 22 mai 1996, n°94-85.607).
- Ainsi pour la chambre criminelle l’indemnisation de la victime conductrice fautive ne dépend pas de l’établissement d’une faute du défendeur mais seulement de l’existence d’un lien de causalité entre son préjudice et sa faute, conformément à l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
- La solution adoptée par la chambre criminelle est donc radicalement opposée à celle dégagée par la deuxième chambre civile
|
Cass. crim., 22 mai 1996
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’une collision s’est produite entre l’automobile de Claudette Y… et la motocyclette pilotée par Guillaume Z…, qui l’a heurtée à l’arrière ; que, ce dernier ayant été blessé dans l’accident, l’automobiliste a été poursuivie, notamment, pour blessures involontaires, et définitivement relaxée de ce chef ;
Attendu que, saisie d’une demande de Guillaume Z…, constitué partie civile, tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 470-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la cour d’appel énonce qu’il convient, en l’état de la procédure, de rechercher si la victime a commis une faute de nature à limiter ou à exclure son indemnisation ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation de Claudette Y…, qui soutenait que le motocycliste avait, en circulant à une allure excessive, par temps de pluie, commis une faute exclusive de toute indemnisation, les juges relèvent que son véhicule a, du fait d’un ralentissement inopiné, joué un rôle dans la survenance de l’accident ; qu’ils ajoutent que la faute du conducteur de la motocyclette, qui n’a pu maîtriser sa vitesse compte tenu des conditions climatiques, justifie qu’il soit ” privé à concurrence d’un quart de la réparation de son préjudice ” ;
Attendu qu’en l’état de ces seuls motifs, exempts de tout caractère hypothétique et caractérisant l’implication du véhicule de la demanderesse dans l’accident, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié dans quelle mesure la faute de la victime avait contribué à la réalisation de son dommage, a fait l’exacte application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en effet, il résulte de ce texte, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d’indemniser l’autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite de la faute commise par ce dernier ; qu’une telle faute, qui ne s’apprécie qu’en la personne du conducteur auquel on l’oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage ;
Que le moyen n’est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
|
- Troisième étape
- Saisie de la question qui oppose les deux chambres de la Cour de cassation, la chambre mixte tranchera dans un arrêt du 28 mars 1997 en faveur de la chambre criminelle (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, n°93-11.078)
- Elle affirme en ce sens que « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ».
- Ainsi, seule la faute de la victime conductrice n’est susceptible de limiter ou d’exclure son indemnisation qu’à la seule condition qu’existe un lien de causalité entre sa faute et son préjudice.
- Le comportement non-fautif du défendeur est donc indifférent : les juges du fond doivent focaliser leur appréciation sur les circonstances qui ont concouru à la production du dommage de la victime conducteur.
|
Cass. ch. mixte, 28 mars 1997
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen réunis :
Vu les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu’il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. De Meyer tendant à l’indemnisation des dommages qu’il avait subis personnellement et du fait du décès de son fils, l’arrêt retient qu’il a commis la contravention prévue à l’article R. 4 du Code de la route, que M. Yatimi Y… X… n’a commis aucune faute, et que, si la faute de M. De Meyer n’a pas été la cause exclusive de l’accident, qui ne se serait pas produit en l’absence de la manoeuvre intempestive du véhicule non identifié, elle a présenté pour M. Yatimi Y… X… un caractère imprévisible et irrésistible ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
|
?Le sort de la victime par ricochet
Aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985, « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages »
Il ressort de cette disposition que lorsque la victime principale se voit opposer une faute de nature à limiter voire exclure son indemnisation, la victime par ricochet verra son indemnisation verra son droit à réparation réduit dans les mêmes proportions.
Dans un arrêt du 15 mars 1995, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci » (Cass. crim., 15 mars 1995, n°93-80.695).
|
Cass. crim., 15 mars 1995
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi précitée que, si le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe, intégralement réparé lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci ;
Attendu qu’une collision entre deux véhicules automobiles, conduits respectivement par Sylvie Z… et Patrick X…, a provoqué la mort de l’épouse de ce dernier ; que, sur les poursuites exercées par le ministère public contre la première pour homicide involontaire et refus de priorité, et contre le second pour excès de vitesse, le tribunal correctionnel les a condamnés de ces chefs et a alloué à Patrick X…l’indemnisation de son préjudice moral et de celui de son fils mineur Gian-Carlo, outre le remboursement des frais d’obsèques ; que par le même jugement Patrick X…, cité directement par Sylvie Z… pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef au motif que son excès de vitesse était sans relation avec l’accident ;
Attendu que, saisie des seuls intérêts civils par les appels de Sylvie Z… et de Patrick X…, la juridiction du second degré limite à la moitié l’indemnisation de ce dernier et de son enfant, en relevant que sa vitesse excessive ” est à l’origine ” de leurs dommages ;
Attendu, certes, que la décision par laquelle le tribunal a, à tort, statué sur le bien-fondé de la citation délivrée à la requête de Sylvie Z… laquelle était sans qualité pour agir comme partie civile du chef d’homicide involontaire sur l’épouse de son coprévenu est devenue définitive quant à l’action publique ; que l’appel de l’intéressée était néanmoins recevable en ce qu’il tendait à faire juger que la contravention retenue à la charge de Patrick X…, constituait une faute de nature à limiter l’indemnisation de celui-ci ;
Mais attendu que si, après avoir souverainement estimé que la faute de ce dernier avait contribué à la réalisation de l’accident, les juges d’appel ont, à bon droit, limité son indemnisation, ils ont, en revanche, en appliquant cette limitation à son enfant Gian-Carlo, ayant droit de la victime, passagère transportée, méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 4 décembre 1992, mais en ses seules dispositions limitant à la moitié l’indemnisation de Gian-Carlo X…, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
|