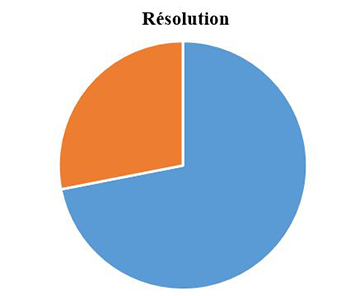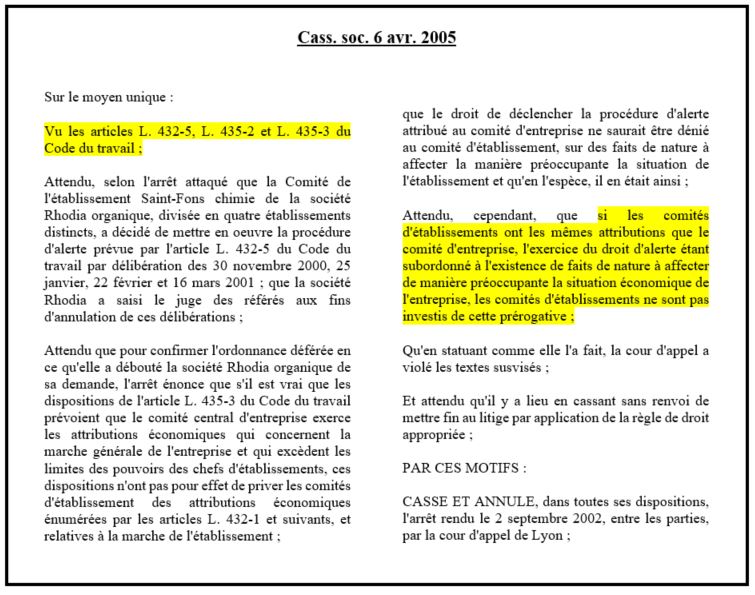Les qualités d’époux et d’associé peuvent-elles cohabiter ? Telle est la question que l’on est inévitablement conduit à se poser lorsque l’on s’interroge sur le statut des droits sociaux en régime de communauté. Tandis que le droit des régimes matrimoniaux commande à l’époux marié sous le régime légal de collaborer avec son conjoint sur un pied d’égalité pour toutes les décisions qui intéressent la communauté, le droit des affaires répugne à admettre que les « acteurs périphériques » d’une société, puissent, quelle que soit leur qualité (commissaire aux comptes, administration fiscale, juge), s’immiscer dans la gestion de l’entreprise[1].
Lorsque des droits sociaux sont acquis avant le mariage, ou en cours d’union à titre gratuit, ou encore par le biais d’un acte d’emploi ou de remploi, cette situation ne soulève guère de difficultés. Ils endossent la qualification de biens propres, de sorte que, conformément à l’article 1428 du Code civil, l’époux associé est seul investi du pouvoir d’en disposer et, à plus forte raison, d’en jouir et de les administrer. Une immixtion du conjoint dans la gestion de la société s’avère donc impossible, à tout le moins par l’entremise d’une voie de droit. Il en va de même lorsque les époux sont mariés sous un régime séparatiste, les patrimoines de chacun étant strictement cloisonnés[2].
Lorsque, en revanche, les titres sociaux, dont s’est porté acquéreur un époux, répondent à la qualification de biens communs, le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés ne peuvent plus s’ignorer. La raison en est l’existence d’interactions fortes entre la qualité d’époux et celle d’associé. Dans cette configuration, d’une part, l’article 1424 du Code civil impose à l’époux associé de se conformer au principe de cogestion s’agissant des actes de dispositions portant sur des droits sociaux non négociables. D’autre part, en vertu de l’article 1832-2, alinéa 1er, obligation lui est faite, lors de l’acquisition de parts sociales au moyen de biens communs, d’en informer son conjoint et de justifier, dans l’acte de souscription, l’accomplissement de cette démarche[3].
Ainsi, lorsque les droits sociaux constituent des acquêts, le droit des régimes matrimoniaux permet-il au conjoint de l’époux associé de s’ingérer dans la gestion de la société. Plus encore, au titre de l’article 1832-2, alinéa 3, ce dernier est fondé à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales souscrites en contrepartie de l’apport d’actifs communs[4].
Bien que les prérogatives dont est investi le conjoint de l’époux associé soient une projection fidèle de l’idée selon laquelle « la vocation communautaire du régime [légal] justifie le droit de regard du conjoint de l’associé sur les conséquences patrimoniales des prérogatives personnelles de celui-ci »[5], l’exercice desdites prérogatives n’en porte pas moins atteinte au principe général de non-immixtion qui gouverne le droit des sociétés. De surcroît, la possibilité pour le conjoint de l’époux titulaire des droits sociaux de revendiquer la qualité d’associé, vient heurter l’intuitu personae dont sont particulièrement empreintes les sociétés de personnes[6] et les sociétés à responsabilité limitée, alors mêmes que ces groupements sont censés constituer un « univers […] clos, rebelle à toute ingérence étrangère »[7].
Immédiatement, se pose alors la question de l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Pendant longtemps, les auteurs ont considéré ces deux corpus normatifs comme étant, par essence, peu compatibles en raison de l’opposition frontale qui existerait entre les modes de fonctionnement de la structure sociétaire et du couple marié sous le régime de communauté[8]. Françoise Dekeuwer-Défossez résume parfaitement cette idée en observant qu’il s’agit là « de deux structures antagonistes [qui] coexistent », mais dont « les règles qui gouvernement chacune d’entre elles tendent à intervenir dans le fonctionnement de l’autre »[9]. Est-ce à dire que ces règles qui, tantôt modifient les rapports entre associés, tantôt modifient les rapports entre époux, sont inconciliables ?
On ne saurait être aussi catégorique ne serait-ce que parce que le droit des régimes matrimoniaux a, depuis l’adoption du Code civil, considérablement évolué. La hiérarchie conjugale qui était difficilement compatible avec le principe d’égalité entre associés a, de la sorte, été abolie par la loi du 23 décembre 1985 instituant l’égalité entre époux. Le principe d’immutabilité des conventions matrimoniales qui contrevenait à la possibilité pour les époux de constituer une société entre eux[10] a subi le même sort, celui-ci ayant été considérablement assoupli[11]. Qu’en est-il de la problématique née de la possibilité pour le conjoint de l’époux associé de s’immiscer dans la gestion de la société ?
À titre de remarque liminaire, il peut être observé que le statut des parts d’intérêts émises par les sociétés de capitaux n’a jamais réellement été discuté dans la mesure où ces groupements sont dépourvus d’intuitu personae. Il s’ensuit que la titularité de la qualité d’associé est indifférente[12]. Aussi, le débat s’est-il exclusivement focalisé sur les droits sociaux que l’on qualifie de non-négociables[13]. Par droits sociaux non négociables, il faut entendre les parts d’intérêt qui représentent un droit dont la titularité est étroitement attachée à la personne de son détenteur. Selon Estelle Naudin, leur singularité réside dans l’impossibilité pour ces titres sociaux de faire l’objet d’une quelconque « transmission sur un marché financier »[14].
Pour appréhender cette catégorie de droits sociaux lorsqu’ils sont détenus par des époux mariés sous un régime communautaire, pendant longtemps, la jurisprudence leur a appliqué la distinction du titre et de la finance[15], mise au point au XIXe siècle, afin de surmonter le problème de patrimonialité qui se posait pour les offices ministériels[16].
À plusieurs reprises, le législateur a, de son côté, tenté de résoudre cette problématique notamment en cherchant à préciser le statut des droits sociaux[17] ainsi qu’en clarifiant l’attribution de la qualité d’associé[18]. Toutefois, de l’avis général des auteurs, par ses interventions successives, il a moins contribué à éclairer le débat qu’à l’obscurcir[19], « à tel point que les divergences doctrinales s’accrurent »[20]. Deux textes sont à l’origine de l’embrasement du débat : l’article 1404 et l’article 1424 du Code civil.
Relevant que le premier de ces textes confère la qualification de bien propre à « tous les droits exclusivement attachés à la personne », certains auteurs en ont déduit que les droits sociaux non négociables répondaient à cette qualification en raison du fort intuitu personae dont ils sont marqués[21].
À l’inverse, d’autres auteurs ont avancé qu’il convenait plutôt de retenir la qualification d’acquêts de communauté, l’article 1424 rangeant très explicitement les droits sociaux non négociables dans la catégorie des biens communs dont un époux ne peut disposer seul[22].
Rejetant les thèses monistes, une partie de la doctrine a plaidé pour un maintien de la distinction du titre et de la finance[23]. Les tenants de cette opinion ont argué que seule la conception dualiste permettrait d’opérer une conciliation entre les articles 1404 et 1424 du Code civil.
D’autres auteurs ont enfin proposé de renouveler la distinction du titre et de la finance qui, selon eux, serait « inutile et dépassée »[24]. Reprochant à cette distinction d’opposer les droits sociaux à leur valeur patrimoniale, ces auteurs préconisent de faire entrer les parts sociales dans la communauté, non seulement pour leur valeur, mais également en nature[25]. L’objectif poursuivi est de préserver aux mieux les intérêts de la communauté, tout en garantissant au titulaire des parts le monopole de la qualité d’associé.
Alors que la jurisprudence n’a jamais adopté de position suffisamment convaincante pour mettre en terme définitif au débat[26], le législateur est intervenu le 10 juillet 1982 dans le dessein de clarifier le statut du conjoint de l’époux associé. Aux termes de l’article 1832-2, celui-ci est désormais fondé à revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites, à condition qu’elles aient été acquises au moyen d’actifs communs.
Bien que cette disposition ne tranche pas directement la question de la qualification des droits sociaux non négociables, certains auteurs y ont vu néanmoins une consécration de la thèse dualiste. André Colomer n’hésite pas à affirmer que « l’article 1832-2 du Code civil […] consacre implicitement la doctrine de la distinction de la qualité d’associé (qui reste personnelle) et des parts sociales (qui sont des biens commun en nature) »[27]. Cet auteur est rejoint par Gérard Champenois pour qui il ne fait aucun doute que la loi du 10 juillet 1982 retient cette analyse. Pour lui, on saurait tout à la fois offrir la possibilité de revendiquer la qualité d’associé et admettre que les parts d’intérêt puissent endosser la qualification de biens propres, sauf à reconnaître au conjoint un droit à « expropriation »[28].
Qu’en est-il aujourd’hui ? La jurisprudence semble s’être prononcée en faveur du maintien de la distinction du titre et de la finance. Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 1991, la Cour de cassation a décidé que seule la valeur patrimoniale des parts sociales d’un groupement agricole d’exploitation (GAEC) était commune, les parts en elles-mêmes ne rentrant pas dans l’indivision post-communautaire[29]. Pour la haute juridiction, la qualité d’associé demeure propre au mari. Cette dernière a réitéré cette solution quelques années plus tard en considérant que la valeur des parts sociales d’une SCP constituait un bien dépendant de la communauté. Elle en a déduit que les fruits et revenus tirés de l’exercice des droits sociaux tombaient alors dans l’indivision post-communautaire[30]. Plus récemment, elle a affirmé de façon très explicite « qu’à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d’associé attaché à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision post-communautaire qui n’en recueille que leur valeur »[31]. Ainsi, la Cour de cassation apparaît-elle toujours très attachée à la distinction du titre et de la finance, malgré les difficultés pratiques que cette position soulève[32]. Selon Isabelle Dauriac néanmoins, « l’hésitation est toujours permise »[33].
Plus précisément, les auteurs ne s’entendent toujours pas sur la qualification à donner aux parts sociales acquises au moyen de deniers communs, l’intérêt pratique du débat résidant – il n’est pas inutile de le rappeler – dans la résolution des difficultés soulevées par le fonctionnement parallèle d’une société et d’un régime communautaire. Au vrai, le sentiment nous est laissé, au regard de l’abondante littérature consacrée au sujet, que le problème est peut-être insoluble. Face à ce constat, deux attitudes peuvent être adoptées.
On peut tout d’abord considérer que les deux branches du droit que l’on cherche à articuler sont fondamentalement si différentes l’une de l’autre qu’aucune conciliation n’est possible, si bien que la solution retenue in fine, ne pourra être qu’un pis-aller. On peut également refuser cette fatalité et se demander si l’insolubilité du problème ne viendrait pas de ce que la doctrine raisonne à partir d’un postulat erroné. Toutes les thèses avancées par les auteurs reposent sur l’idée que les droits sociaux sont des biens. Partant, la seule conséquence que l’on peut tirer de ce postulat, c’est que les parts d’intérêt viennent nécessairement alimenter, tantôt la masse commune, tantôt la masse propre de l’époux associé, tantôt simultanément les deux masses si l’on adhère à la thèse dualiste du titre et de la finance. C’est alors que l’on se retrouve dans une impasse dont la seule issue conduit, selon Jean Derruppé, « à ce qu’il y a de plus regrettable pour la pratique : l’incertitude du droit »[34].
Pour sortir de cette impasse, ne pourrait-on pas envisager que les droits sociaux puissent ne pas être rangés dans la catégorie des biens ? Une frange ancienne de la doctrine soutient, en effet, que les prérogatives dont est investi l’associé s’apparentent, non pas à des droits réels, mais à des droits de créance contre la société[35]. Plus récemment, reprochant à cette thèse de réduire l’associé à un simple créancier, alors que le droit de créance est insusceptible de rendre compte de toutes les prérogatives dont l’associé est titulaire[36], des auteurs ont avancé que les droits sociaux seraient, en réalité, « de nature hybride », en ce sens qu’ils traduiraient « la position contractuelle de l’associé, composée d’obligations actives et passives »[37]. Une appréhension des droits sociaux de l’époux associé comme résultante de la position sociétaire, serait donc possible (II). Cette approche permettrait ainsi d’abandonner le postulat consistant à assimiler systématiquement les parts d’intérêt à des biens, postulat qui est à l’origine de nombreuses difficultés quant à l’articulation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés (I).
I) La difficile appréhension des droits sociaux comme objet de droit de propriété
Le classement des droits sociaux dans la catégorie des biens soulève, tant des difficultés théoriques en droit des sociétés (A), que des difficultés pratiques en droit des régimes matrimoniaux (B).
A) Les difficultés théoriques soulevées par la qualification de bien en droit des sociétés
S’il est acquis en droit des régimes matrimoniaux que les droits sociaux doivent être classés dans la catégorie des biens, cette vision est loin de faire l’unanimité en droit des sociétés. L’admission de ce postulat suppose de considérer que les associés exerceraient un droit de propriété sur les titres auxquels ils ont souscrits et, corrélativement, de rejeter l’idée qu’ils puissent être regardés comme les titulaires d’une créance contre la société. L’adoption de l’une ou l’autre thèse demeure pourtant très discutée en doctrine. Cette question touche, en effet, au débat relatif à la nature de la société. Or indépendamment du caractère fondamental de la problématique à laquelle ce débat se rapporte, il connaît un fort regain d’intérêt depuis quelques années, notamment sous l’impulsion du « renouveau de la thèse contractuelle »[38] que l’on oppose, classiquement, à la conception institutionnelle[39].
Selon la première conception, directement héritée du droit romain[40], la société s’apparenterait à un contrat. Défendue par Pothier[41] et Domat[42], cette thèse a été consacrée par le Code Napoléon, qui naguère disposait, en son article 1832, que « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Des stigmates de cette définition se retrouvent, encore aujourd’hui, dans le Code civil. Le nouvel article 1832 convoque toujours la figure du contrat pour définir la notion de société. De nombreux autres arguments ont, par ailleurs, été avancés au soutien de la thèse contractuelle.
Tout d’abord, semblablement à un contrat, la société n’est autre que le produit d’une manifestation de volontés. Sa constitution ne s’impose donc pas aux associés. Aucune obligation ne leur commande de conclure un pacte social ou d’y adhérer. Ensuite, la validité de l’acte juridique que constitue la société est subordonnée au respect des conditions générales de formation exigées en matière de contrat. Enfin, l’autonomie de la volonté préside, pour une large part, à l’élaboration du pacte social, en ce sens que les associés sont libres d’adopter la forme sociale qui leur sied et de déterminer le contenu des statuts.
Bien qu’il soit incontestable que la société trouve sa source dans un acte juridique, de nombreuses critiques ont été adressées à la thèse contractuelle. Les auteurs relèvent notamment que la constitution d’une société peut résulter de l’accomplissement d’un acte unilatéral. Depuis 1985, le législateur reconnaît la possibilité d’instituer une société « par l’acte de volonté d’une seule personne »[43]. Par ailleurs, Philippe Merle observe que « la société n’accède à la vie juridique que par une formalité administrative, l’immatriculation et non par la volonté des associés »[44]. Il a encore été objecté que c’est la loi de la majorité qui régit l’adoption des délibérations sociales alors que la modification d’un contrat requiert l’unanimité des parties[45]. En outre, de nombreuses règles d’origine légale et réglementaire gouvernent le fonctionnement des sociétés, sans qu’il puisse y être dérogé dans les statuts, ce qui, pour certains, est de nature à disqualifier la thèse contractuelle. Finalement, le reproche général formulé par les contradicteurs de cette thèse est que le recours au concept de contrat ne permet pas d’appréhender dans sa globalité la notion de société[46].
C’est la raison pour laquelle, pour certains auteurs, la société s’apparenterait moins à un contrat qu’à une institution[47]. Par institution, il faut entendre, selon le doyen Hauriou, « une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressés à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures »[48]. La thèse institutionnelle revient alors à appréhender la société comme un ensemble de règles impératives qui organisent de façon durable le fonctionnement du groupement qu’elle constitue en vue de la réalisation d’un but social déterminé, distinct des intérêts privés poursuivis par chacun de ses membres. Aussi, cela expliquerait-il pourquoi la société est pourvue de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre. Cette thèse permet également de justifier la loi de la majorité qui préside à l’adoption des décisions sociales ainsi que l’important corpus normatif d’ordre public qui s’impose aux associés.
Bien qu’elle présente un certain nombre d’avantages, la conception institutionnelle n’échappe pas non plus à la critique, au premier rang desquelles figure le reproche consistant à dire qu’elle « s’apparente davantage à une idée ou à une image qu’à une véritable théorie car elle ne détermine aucun régime juridique précis »[49]. Qui plus est, elle néglige l’acte constitutif du groupement. Or cet élément est consubstantiel de la notion de société, spécialement lorsqu’il s’agit d’appréhender les sociétés dépourvues de personnalité morale où l’aspect contractuel est prépondérant. Au total, pour la doctrine majoritaire[50], ni la thèse institutionnelle, ni la thèse contractuelle ne semblent être en mesure de rendre compte du concept de société. Pour certains auteurs, une troisième voie serait néanmoins possible en revisitant la classification traditionnelle des contrats, soit en introduisant la distinction entre le contrat-échange et le contrat-organisation[51].
Selon Paul Didier« le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger »[52]. Autrement dit, tandis que le contrat-échange « réalise une permutation de biens ou de services », le contrat-organisation aménage « une agrégation de bien ou de services »[53]. Patrice Hoang définit en ce sens le contrat-organisation comme l’« acte juridique qui a pour objet d’établir dans la durée des règles susceptibles d’organiser une collectivité de personnes et d’ordonner leur activité autour du but qu’elle s’est proposée d’atteindre »[54].
Aussi, le recours au concept de contrat-organisation permet-il de réussir là où l’approche restrictive du contrat de société échoue : expliquer l’existence d’une communauté d’intérêts qui prime sur les intérêts particuliers de chacun des associés. Cela justifie, dès lors, la soumission de ces derniers à la loi de la majorité. Plus généralement, cela permet d’appréhender la dimension institutionnelle de la société, soit les règles de fonctionnement et de représentation du groupement. Au fond, comme le souligne Nicolas Mathey, le concept de contrat-organisation « est certainement la formulation la plus exacte de ce qu’est réellement cet acte qui se trouve si souvent au fondement des personnes morales »[55]. Cette nouvelle approche de la notion de société a d’ailleurs récemment inspiré certains civilistes qui y ont vu un moyen d’envisager le droit des obligations sous un nouvel angle[56]. Appliquée en droit des régimes matrimoniaux, cela permettrait d’appréhender l’époux associé comme une véritable partie à un contrat et non plus comme un propriétaire, ce qui n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés pratiques.
B) Les difficultés pratiques soulevées par la qualification de bien en droit des régimes matrimoniaux
S’il est indéniable que chacune des qualifications préconisées par la doctrine à la faveur des droits sociaux non négociables présentent de réels avantages, à l’examen, aucune d’elles ne permet de concilier pleinement le droit des régimes matrimoniaux avec le droit des sociétés, ce, en raison des nombreuses difficultés pratiques que soulèvent ces qualifications. Sans qu’il soit besoin de nous livrer à une analyse exhaustive de ces difficultés – l’exercice mériterait qu’on lui consacre une étude entière – arrêtons-nous sur certaines d’entre elles – les plus saillantes – afin de mieux cerner l’impasse à laquelle conduit inexorablement l’assimilation des droits sociaux à des biens.
S’agissant, tout d’abord, de la qualification de biens communs, cette thèse s’imbrique certes parfaitement dans le système communautaire mis en place par le régime légal. Toutefois, elle fait fi du caractère personnel des droits sociaux non-négociables. Comme le relèvent les auteurs, la qualité d’associé n’est pas un bien[57]. Il s’agit d’une « prérogative attachée à une personne »[58]. Il en résulte qu’elle ne saurait tomber en communauté, sauf à reconnaître à cette dernière la personnalité morale. Or la doctrine n’y est majoritairement pas favorable[59]. Dans ces conditions, l’application du statut communautaire aux droits sociaux apparaît difficilement envisageable. L’argument tendant à invoquer au soutien de cette thèse l’article 1424 du Code civil, lequel impose la cogestion pour certains biens communs parmi lesquels figurent les droits sociaux non négociables, n’y change rien. Cette disposition instaure une règle pouvoir et non de propriété, de sorte qu’on ne saurait en tirer une quelconque conséquence quant à la qualification des parts d’intérêt.
Concernant, ensuite, la qualification de biens propres, cette thèse a manifestement reçu un bien meilleur accueil que la précédente par la doctrine, notamment en ce qu’elle « rend inutile la distinction artificielle et dépassée du titre et de la finance »[60]. Cependant, elle n’échappe pas non plus à la critique. Le premier grief que l’on peut formuler à l’encontre de cette théorie est que la qualification de bien propre conduit à priver la communauté d’actifs économiques importants alors qu’ils ont été acquis au moyen de biens communs. En somme, comme le souligne Jean Derruppé « la communauté réduite aux acquêts devient une communauté réduite aux récompenses »[61], ce qui est contraire à l’esprit communautaire dont est animé le régime légal. La seconde critique – la principale – que l’on peut adresser à la qualification de bien propre est que, conformément à l’article 1404 du Code civil, elle repose exclusivement sur l’intuitu personae dont est susceptible d’être marquée la qualité d’associé. Or l’existence de cette intuitu personae est déterminée, soit par la forme sociale de la société, soit par l’insertion d’une clause d’agrément dans les statuts. Aussi, cela revient-il à faire dépendre le statut des droits sociaux non pas de la loi, mais, pour une large part, de la volonté de l’époux associé. Celui-ci peut, de la sorte, trouver dans l’écran de la personne morale un excellent moyen de soustraire certains biens de la communauté.
S’agissant, enfin, de la thèse qui préconise le maintien de la distinction du titre et de la finance, bien que, appliquée de façon constante par la jurisprudence, et défendue par la doctrine majoritaire[62], elle n’est pas sans faille. La théorie dualiste repose, tout d’abord, sur une distinction purement « arbitraire »[63], en ce sens qu’elle opère une dissociation du titre et de la finance, alors que la part sociale est une : la qualité d’associé est indissociable de la valeur du titre. La conséquence en est l’application de règles juridiques différentes – parfois contraires – à un même bien. D’où les difficultés que la doctrine rencontre à les concilier. Il en va ainsi du conflit qui naît, par exemple, à l’occasion d’une cession de parts sociales, entre l’article 1424 qui requiert le consentement du conjoint pour tout acte de disposition portant sur des droits sociaux non négociables, et les articles 225 qui confèrent aux époux une pleine indépendance quant à la gestion des biens qui revêtent un caractère personnel. Là ne s’arrêtent pas les difficultés pratiques que soulève la théorie dualiste. Cette théorie conduit à l’application de l’article 1424, soit à instaurer une cogestion pour les titres sociaux non négociables, alors que la qualité d’associé est exclusivement attachée à la personne du titulaire des titres. Cela a pour effet pervers de permettre au conjoint de s’ingérer dans le fonctionnement d’une société pourtant empreinte d’intuitu personae.
Surtout, dans le droit fil de cette critique, la mise en œuvre de la distinction du titre et de la finance est susceptible de porter grandement atteinte à l’autonomie professionnelle de l’époux titulaire des droits sociaux. Un époux peut, en effet, jouir de la qualité d’associé pour les besoins de son activité professionnelle. Dans cette hypothèse, les articles 223 et 1421, al. 2 devraient en toute logique lui garantir une pleine et entière indépendance quant à l’exercice de ses droits sociaux[64]. Tel n’est cependant pas le cas si l’on adhère à la thèse dualiste. En cours de régime, l’adoption de cette thèse conduit à soumettre l’époux associé à la cogestion, par application de l’article 1424[65]. De surcroît, lors de la dissolution de la communauté, il est un risque que sa participation même dans la société soit menacée. Si l’on estime que les parts sociales entrent seulement pour leur valeur en communauté, l’époux associé sera contraint, lors du partage de l’indivision post-communautaire, d’indemniser son conjoint à concurrence de la moitié de la valeur des titres qu’il détient, ce qui peut avoir pour conséquence fâcheuse de l’obliger, s’il ne dispose pas de liquidités suffisantes, de céder tout ou partie sa participation dans la société[66]. Si au contraire, l’on considère que les parts sociales intègrent la communauté en nature[67], l’époux associé se retrouvera dans une situation encore plus inconfortable : le partage des parts devra s’effectuer non pas en valeur, mais en nature, ce qui mécaniquement fera perdre à l’époux titulaire des titres la moitié de sa participation dans la société. Ainsi, que les parts d’intérêt entrent en communauté pour leur valeur ou en nature, dans les deux cas, la liberté d’exercice professionnel de l’époux associé s’en trouve entravée. C’est là, de toute évidence, une sérieuse critique que l’on peut formuler à l’encontre de la thèse dualiste.
Tout bien pesé, il apparaît qu’aucune des thèses suggérées quant à la qualification des droits sociaux n’est à l’abri des critiques. Toutes soulèvent des difficultés pratiques qui font obstacle à la conciliation entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des sociétés. Au vrai, des objectifs radicalement différents président au développement de ces deux branches du droit. Tandis que le droit des régimes matrimoniaux encadre l’autonomie des époux en considération de l’obligation à la dette qui leur échoit, le droit des sociétés est hermétique à toute ingérence des tiers dans le fonctionnement de l’entreprise. D’où la difficulté de les concilier. Le problème vient de ce que le statut de bien endossé par les droits sociaux ne permet pas la cohabitation de la qualité d’époux avec celle d’associé. Cela devient néanmoins possible si l’on envisage les droits sociaux, non plus comme des biens, mais comme le produit d’un contrat.
II) La possible appréhension des droits sociaux comme effet du contrat de société
La qualification de bien ne constitue, en aucune manière, l’alpha et l’oméga de la problématique relative au statut des droits sociaux. Non seulement une appréhension de ces derniers sous l’angle du contrat est envisageable (A), mais encore, elle est préférable à maints égards (B).
A) L’endossement par l’époux associé de la qualité de contractant substituable à la qualité de propriétaire
Afin de sortir du postulat selon lequel la titularité de droits sociaux conférerait nécessairement à l’époux associé la qualité de propriétaire, il convient de s’interroger sur la question de savoir si, véritablement, les droits sociaux sont appropriables. Cela revient à se demander s’ils peuvent être qualifiés de biens. Le Code civil ne donne aucune définition des biens. Il se contente d’en dresser une classification. C’est à la doctrine qu’est revenue la tâche de les définir. Si, pour certains auteurs, une définition s’avère impossible[68], tous s’accordent néanmoins à voir dans les biens des choses appropriables qui possèdent une valeur patrimoniale[69]. Un bien s’apparente, en d’autres termes, à une richesse économique susceptible de faire l’objet d’une circulation juridique. Est-ce à dire que tout ce qui est évaluable en argent revêt nécessairement la qualification de bien ?
Pour le déterminer, reportons-nous à la summa divisio établie par Code civil à l’article 516 entre les immeubles et les meubles. Tandis que les premiers sont les biens qui adhèrent au sol, en ce sens qu’ils sont inséparables de celui-ci, les seconds peuvent être physiquement déplacés. Les meubles se distinguent, par ailleurs, des immeubles en ce que, conformément à l’article 527, une entité peut être qualifiée de meuble « par la détermination de la loi », soit en dehors de toute application du critère de mobilité. Cette catégorie particulière de meubles est traitée à l’article 529 qui prévoit notamment que doivent être classés dans la catégorie des meubles « les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie ». Les droits sociaux, qu’ils émanent de sociétés de personnes ou de capitaux, sont de la sorte appréhendés par la loi comme des meubles. Si cette assimilation – légale – des droits sociaux à des biens ne souffre, en apparence, d’aucune contestation possible, elle peine pourtant à convaincre.
Il ressort, en effet, de l’article 1832 du Code civil que les droits sociaux conférés à l’associé ne sont autres que la contrepartie de l’apport qu’il effectue lors de la conclusion du pacte social ou de son entrée dans la société. Les droits sociaux représentent, dans cette perspective, le rapport que l’associé entretient avec la société. Or il s’agit là d’un rapport entre une personne physique et une personne morale. Conséquemment, le droit que l’associé exerce sur la société devrait, en toute logique, être qualifié de personnel et non de réel comme c’est le cas dans le cadre d’une relation entre le propriétaire et son bien[70]. C’est pourquoi, pour Jean Dabin, les droits sociaux sont assimilables à des créances[71]. Cette qualification de créance est certes contestée – à juste titre – par certains auteurs pour qui « l’originalité de la part sociale est qu’elle confère à l’associé ce qu’un créancier n’a jamais : un droit d’intervention, c’est-à-dire une vocation à la vie sociale, dans la personnalité interne de la société »[72]. Techniquement, les droits sociaux ne peuvent donc pas être qualifiés de droits de créances. L’adoption de cette qualification est trop réductrice[73]. En tout état de cause, bien que la qualification de créance ne permette pas de rendre totalement compte des droits et obligations que confère la qualité d’associé, le constat n’en demeure pas moins inchangé : les droits sociaux sont le produit de la relation contractuelle que leur titulaire entretient avec une personne morale. L’associé s’apparente, dans ces conditions, moins à un propriétaire de titres qu’à une partie à un contrat. D’où l’inopportunité de qualifier les droits sociaux de biens. Ils représentent, en réalité, « la position contractuelle »[74] de l’associé.
Immédiatement, une nouvelle question se pose : si les titres sociaux que l’associé détient ne lui confèrent pas la qualité de propriétaire de la société, lesdits titres peuvent-ils, malgré tout, faire l’objet d’un droit de propriété ? Il convient, en effet, de distinguer les droits sociaux que les parts d’intérêt ou les valeurs mobilières constatent, des droits dont les titres sociaux sont, en eux-mêmes, susceptibles de faire l’objet. C’est ainsi qu’un auteur a pu soutenir que « la position contractuelle de l’associé […] peut être qualifiée de bien »[75]. D’autres encore estiment que « la créance se matérialise dans le titre qui la constate, lequel, étant une chose corporelle, est susceptible de propriété »[76]. Indépendamment de la théorie de l’incorporation qui a fait l’objet de nombreuses critiques[77], des auteurs plaident, plus généralement, pour une reconnaissance de la propriété des créances[78]. En somme, pour les défendeurs de cette thèse, dans la mesure où les créances possèdent une valeur patrimoniale et que, au même titre que les biens, elles sont cessibles, transmissibles, saisissables et peuvent être données en garantie, pourquoi ne pas envisager qu’elles puissent faire l’objet d’un droit de propriété ? Qui plus est, la Cour européenne des droits de l’Homme[79] et, dans une moindre mesure, le Conseil constitutionnel[80] ont admis la propriété des créances. Pour séduisante que soit cette théorie, elle n’est cependant pas satisfaisante[81].
Comme le relèvent très justement d’éminents auteurs « un droit personnel ne peut être rationnellement l’objet d’un droit réel. En effet, puisque le droit réel s’analyse comme un pouvoir exercé directement sur une chose, un tel droit ne peut s’exercer sur une personne qui ne peut devenir objet de propriété »[82]. De surcroît, pour Gabriel Marty et Pierre Raynaud « la notion de propriété ainsi appliquée à tous les droits patrimoniaux (pourquoi pas les autres droits ?) perd toute signification précise : en réalité, elle se réduit à l’élément d’appartenance, de titularité, que l’on retrouve dans tout droit subjectif, voire dans toute compétence. À généraliser ainsi le concept de propriété, on le fait disparaître »[83]. Surtout, et c’est là, selon nous, l’argument décisif, la reconnaissance de la propriété des créances est difficilement admissible en théorie du droit.
À supposer que l’on puisse exercer un droit réel sur une créance, cela suppose que son titulaire soit fondé à en abuser. Cela signifie qu’il doit, notamment, pouvoir accomplir librement tous les actes qui en affectent la substance. Le créancier ne dispose cependant pas de pareille prérogative. Comme l’a démontré Kelsen, une créance s’apparente à une norme[84]. Or pour que la modification d’une norme soit valide, elle doit avoir été faite conformément à une norme d’habilitation supérieure. Cela implique, autrement dit, que le créancier ait été investi par la loi du pouvoir de redéfinir le contenu de la créance. En droit commun, les parties à un contrat ne sont, toutefois, jamais habilitées, sauf exception, à accomplir un tel acte[85]. La loi exige, tout au contraire, que les contractants satisfassent à l’exigence du mutuus dissensus. Aussi, dans la mesure où le créancier n’a pas le pouvoir de modifier, à sa guise, les stipulations du contrat auquel il est partie par une déclaration unilatérale de volonté, on ne saurait adhérer à l’idée qu’il exerce un droit de propriété sur la créance qu’il détient.
On peut en déduire, in fine, que l’époux associé ne saurait endosser la qualité de propriétaire. Au vrai, il s’agit d’une illusion qui conduit à faire abstraction de la position contractuelle dans laquelle le titulaire de droits sociaux est placé et qui, par bien des aspects, est préférable à celle de propriétaire.
B) L’endossement par l’époux associé de la qualité de contractant préférable à la qualité de propriétaire
Appréhender le statut des droits sociaux en s’émancipant de la qualification de biens présente de nombreux avantages. Le premier réside dans l’opportunité qu’offre cette démarche de sortir d’un débat qui n’a jamais été clos, nonobstant les nombreuses réformes législatives qui ont jalonné l’évolution du droit des régimes matrimoniaux et du droit des sociétés. Si l’on regarde l’époux associé, non plus comme un propriétaire, mais comme un contractant, il n’est plus besoin de se demander à quelle masse de biens les droits sociaux appartiennent. Leur titularité devient indissociable des prérogatives attachées à la qualité d’associé de sorte que la distinction entre le titre et la finance n’est plus envisageable. La question qui, néanmoins, est susceptible de se poser est de savoir à qui échoit la qualité de partie au contrat de société.
L’hésitation est difficilement permise. Si l’on se réfère au principe de relativité des conventions combiné à l’autonomie dont jouit le contractant marié, le champ des possibles se réduit : l’époux qui contracte a seul, par principe, la qualité de partie au contrat[86]. La qualité d’associé ne peut donc être attribuée qu’à l’époux qui a adhéré au contrat de société. Le conjoint de l’époux associé ne lui emprunte pas, de plein droit, cette qualité. Tout au plus, il lui est possible, conformément à l’article 1832-2, de revendiquer la qualité d’associé à concurrence de la moitié des droits sociaux dont l’acquisition a été réalisée au moyen de biens communs. Le succès de cette revendication est néanmoins susceptible de se heurter à l’existence d’une clause d’agrément, d’où il s’ensuit que la qualité d’associé est loin d’être acquise pour le conjoint revendiquant. À supposer qu’il mène son action à bien, la question de la titularité des droits sociaux ne soulève, là encore, guère de difficultés. Comme le relève André Colomer « faute d’être dotée de personnalité, la communauté n’est pas sujet de droit à proprement parler »[87]. Il en résulte que l’on peut d’emblée l’exclure du rang des prétendants. La qualité d’associé ne peut, en conséquence, être endossée que par l’un des époux, ou éventuellement les deux en cas de succès de l’action en revendication. La question de savoir si les parts sociales tombent en valeur ou en nature dans la communauté devient, en tout état de cause, caduque.
Le deuxième avantage que l’on peut retirer de l’appréhension de l’époux associé, non plus comme un propriétaire, mais comme un contractant, découle du premier. L’adhésion à cette idée revient, en effet, à écarter l’éventualité que les droits sociaux puissent être qualifiés de biens communs. Leur exercice n’est donc plus susceptible d’être régi par le principe de gestion concurrente ou de cogestion. Il n’est dès lors plus aucun risque que le conjoint de l’époux associé s’immisce dans la gestion de la société par le jeu des articles 1421 ou 1424 du Code civil. La question qui, de la sorte, s’était posée en jurisprudence de savoir si l’époux associé devait ou non obtenir l’autorisation de son conjoint pour céder sa participation dans une société n’a, elle aussi, plus lieu d’être[88]. Il est libre d’accomplir tous les actes d’administration et de disposition des parts d’intérêt dont il est titulaire. D’aucuns objecteront qu’il s’agit là d’une atteinte manifeste portée à l’esprit communautaire du régime légal, compte tenu de la grande valeur patrimoniale que les droits sociaux sont susceptibles de représenter, ce qui justifierait l’existence d’« un contrôle minimum » de la part du conjoint de l’époux associé[89]. Toutefois, comme le relève Gilles Plaisant on ne saurait « faire de l’importance économique du bien le seul critère de la cogestion »[90]. Surtout, on ne saurait occulter les effets négatifs de l’article 1424 dont l’application conduit, au même titre que l’article 1832-2, à introduire « un grain de sable dans les rouages de l’indépendance pourtant érigée en principe »[91] à l’article 223, composante essentielle du régime primaire impératif, lequel prime, en cas de conflit de règles, sur le statut matrimonial. L’approche strictement contractuelle des droits sociaux permet alors de préserver l’autonomie professionnelle de l’époux associé. Là ne s’arrête pas l’avantage d’abandonner la qualification de biens.
Cela permet également se sortir de la distinction « arbitraire »[92] entre les titres négociables et les titres non négociables, à tout le moins en partie. En l’état du droit positif, la non-négociabilité d’un titre est érigée par la loi en critère d’application de la cogestion (article 1424) et du régime de l’action en revendication de la qualité d’associé. La jurisprudence et la doctrine y ont également recours pour déterminer à quelle masse de biens appartiennent les droits sociaux acquis au moyen d’actifs communs. Dans l’hypothèse où ils sont négociables, la doctrine est unanime : ils tombent en communauté[93]. Dans le cas contraire, tandis que pour certains auteurs ils endossent la qualification de biens propres, pour d’autres il convient d’opérer une distinction entre le titre et la finance. Si, immédiatement, le critère de la négociabilité des titres renvoie à la distinction entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, comment appréhender les parts d’intérêt qui émanent de sociétés placées dans une situation intermédiaire ? La question s’est un temps posée pour la SARL qui est une société « de nature hybride »[94] : fallait-il appliquer aux parts sociales le régime juridique des titres non-négociables, soit une qualification mixte ou leur refuser cette qualification ? Si la jurisprudence s’est incontestablement prononcée en faveur de la première option, malgré quelques hésitations[95], l’interrogation est toujours permise s’agissant des sociétés de capitaux dont les statuts comportent une clause d’agrément[96]. Ainsi, la soustraction des droits sociaux à la catégorie des biens permettrait-elle de se départir de la distinction entre les titres négociables et non négociables comme le réclament certains auteurs pour qui « rien ne justifie une différence de traitement entre l’époux associé d’une société à responsabilité limitée et l’époux actionnaire d’une société par actions simplifiées »[97].
En conclusion, nombreux sont les avantages que présente l’adoption d’une approche purement contractuelle des droits sociaux. Le seul dommage notable que ce changement de paradigme occasionnerait est la neutralisation de l’article 1424 dont l’application repose exclusivement sur le critère de négociabilité des titres sociaux. Cette neutralisation aurait toutefois comme vertu salvatrice de désamorcer, pour une large part, la menace que l’article 1424 fait peser sur l’exercice de la liberté professionnelle de l’époux associé. Qui plus est, la mise à l’écart de cette disposition, dont certains réclament d’ailleurs une redéfinition[98], ne se ferait pas au détriment des intérêts de la communauté. Celle-ci conserverait son droit à récompense en cas d’acquisition de parts d’intérêts au moyen de biens communs[99], tout autant qu’elle serait toujours fondée à percevoir les revenus générés par l’exercice des droits sociaux. L’esprit communautaire du régime légal est sauf.
[1] C. Gerschel, « Le principe de la non-immixtion en droit des affaires », LPA 30 août 1995 ; V. également sur cette question M. Clet-Desdevises, L’immixion dans la gestion d’une société, Éco. et compta. 1980, p. 17.
[2] Les articles 1536 et 1569 du Code civil prévoient en ce sens, dans les mêmes termes, que lorsque les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou de la participation aux acquêts, « chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. ».
[3] Le non-respect de cette exigence est sanctionné par la nullité prescrite à l’article 1427 du Code civil. V. en ce sens CA Paris, 28 nov. 1995 : JCP G 1996, I, 3962, n° 10, obs. Ph. Simler ; Dr. sociétés 1996, comm. 75, obs. Y. Chaput.
[4] Il lui suffit, pour ce faire, de notifier à son conjoint son intention de devenir associé.
[5] J. revel, « Droit des sociétés et régime matrimonial : préséance et discrétion », D. 1993, chron. p. 35.
[6] On pense notamment aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple ou encore aux sociétés civiles.
[7] A. Colomer, Droit cvil : Régimes matrimoniaux, éd. Litec, 2004, coll. « Manuel », n°769, p. 348.
[8] V. en ce sens notamment R. Roblot, Traité de droit commercial, t. I, 17e éd., par M. Germain et L. Vogel, LGDJ, 1998, n° 1035 ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Droit civil, t. VII, Les régimes matrimoniaux, 3e éd., Cujas, 1994, n° 106.
[9] F. Dekeuwer-Défossez, « Mariage et sociétés », Études dédiées à René Roblot, Aspects actuels du droit commercial français, LGDJ 1984, p. 271.
[10] V. en ce sens Cass. crim., 9 août 1851 : DP 1852, 1, p. 160 ; S. 1852, 1, p. 281 ; Cass. civ., 7 mars 1888 : DP 1888, 1, p. 349 ; S. 1888, 1, p. 305.
[11] La loi du 13 juillet 1965 a mis fin au principe absolu de l’immutabilité des conventions matrimoniaux. Puis, la loi du 23 juin 2006 a modifié les articles 1396, alinéa 3, et 1397 du Code civil, lesquels n’exigent plus, lors d’un changement de régime matrimonial que ce changement soit soumis au juge pour être homologué.
[12] V. en ce sens J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2e éd. 2001, n°323.
[13] V. notamment M. Nast, « Des parts d’intérêt sous le régime de la communauté d’acquêts », Defrénois 1933, art. 23.584 ; R. Savatier, « Le statut en communauté des parts de sociétés de personnes », Defrénois 1960, art. 27.920 ; G. Chauveau, « La jurisprudence devant le conflit entre le droit matrimonial et le droit des sociétés », Gaz. Pal. 1958, I, Doct. 65.
[14] E. Naudin, « L’époux associé et le régime légal de la communauté réduite aux acquêts », in Mélanges Champenois, Defrénois, 2012, p. 617.
[15] Cass. Com. 19 mars 1957, D. 1958. 170, note Le Galcher-Baron ; JCP 1958.II.10517, note Bastian ; Cass. com., 23 déc. 1957, D. 1958, p. 267, note M. Le Galcher-Baron ; JCP G 1958, II, 10516, note J.R. ; Cass. 1re civ., 22 déc. 1969, D. 1970, p. 668, note G. Morin ; JCP G 1970, II, 16473, note J. Patarin.
[16] Cass. civ., 4 janv. 1853, DP 1853, I, p. 73 ; S. 1853, 1, p. 568.; Cass. req., 6 janv. 1880, DP 1880, I, p. 361 ; S. 1881, 1, p. 49, note Labbé. Cass. 1re civ., 27 avr. 1982, Bull. civ. 1982, I, n° 145 ; JCP G 1982, IV, 236.
[17] La loi du 13 juillet 1965 a de sorte modifié l’article 1404 du Code civil, laissant alors entrevoir l’idée que les droits sociaux non négociables pouvaient être qualifiés de biens propres par nature. Cette même loi précise, en parallèle, à l’article 1424, qu’un époux ne pouvait pas en disposer seul, ce qui fera dire à certains qu’ils doivent être rangés parmi les biens communs.
[18] Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d’artisans et de commerçants travaillant dans l’entreprise familiale.
[19] V. en ce sens J. Derruppé, « Régimes de communauté et Droit des sociétés », JCP 1971, I, 2403 ; E. Naudin, « L’époux associé et le régime légal de la communauté réduite aux acquêts », in Mélanges Champenois, Defrénois, 2012, p. 617 ; F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Précis Dalloz, 6e éd. 2011, n° 330, p.261.
[20] A. Colomer, « Les problèmes de gestion soulevés par le fonctionnement parallèle d’une société et d’un régime matrimonial », Defrénois 1983, art. 33102, p. 865.
[21] A. Ponsard, Les régimes matrimoniaux, in Ch. Aubry et Ch. Rau, Droit civil français, t. VIII, 7e éd. 1973, n° 167 ; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, Sirey, 2e éd. 1985, n° 181 et s.; G. Paisant, Des actions et parts de sociétés dans le droit patrimonial de la famille : thèse, Poitiers, 1978, p. 146 et s.
[22] J. Patarin et G. Morin, La réforme des régimes matrimoniaux, t. 1, 4e éd., 1977, Defrénois, n° 152 ; R. Savatier, « Le statut, en communauté, des parts de sociétés de personnes », Defrénois 1968, art. 29097, p. 421.
[23] H., L., et J. Mazeaud et de Juglart, Les régimes matrimoniaux, 5e éd. 1982, n° 156 ; G. Morin, D. 1970. 668, note sous Civ. 1ère, 22 déc. 1969.
[24] J. Derruppé, « Régime de communauté et droit des sociétés », JCP G 1971, I, 2403 ; du même auteur V. également « Les droits sociaux acquis avec des biens communs selon la loi du 10 juillet 1982 », Defrénois 1983, art. 33053, p. 521 et s.
[25]A. Colomer, « La nature juridique des parts de société au regard du régime matrimonial », Defrénois 1979, art. 32020, p. 817 et s. ; J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, Armand Colin, 2001, n°323, p. 315.
[26] V. en ce sens Cass. 1re civ., 8 janv. 1980, n° 78-15.902 : D. 1980, inf. rap. p. 397, obs. D. Martin ; Defrénois 1980, art. 32503, n° 118, p. 1555, obs. G. Champenois.
[27] A. Colomer, op. cit., n°780, p. 353-354.
[28] G. Champenois, op. cit., n°323, p. 315.
[29] Cass. 1re civ., 9 juill. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n° 232 ; JCP N 1992, II, 378, n° 11, obs. Ph. Simler.
[30] Cass. 1re civ., 10 févr. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 47 ; Defrénois 1998, art. 1119, note Milhac ; Gaz. Pal. 1999, 1, somm. p. 124, obs. S. Piedelièvre.
[31] Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309 : JCP G 2014, 1265, Ph. Simler ; D. 2014, p. 1908, obs. V. Brémond ; dans le même sens V. Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13.384 : JurisData n° 2012-014917 ; JCP G 2012, 1104, note Paisant ; JCP N 2012, 1382, note J.-D. Azincourt ; Dr. famille 2012, comm. 158, obs. Paisant.
[32] V. en ce sens Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12.503 : Bull. civ. 1991, I, n° 232 ; JCP G 1992, I, 3614, n° 8 ; Defrénois 1992, art. 35202, p. 236, obs. X. Savatier ; Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309 : D. 2014, p. 1908, obs. V. Brémond ; JCP G 2014, 1265, Ph. Simler ; Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265 : JCP G 2014, act. 1137, P. Hilt ; JCP G 2014, 1265, Ph. Simler.
[33] I. Dauriac, Les régimes matrimoniaux et le PACS, LGDJ-Lextenso éditions, 2e éd., 2010, coll. « Manuel », n°376, p. 229.
[34] J. Derruppé, art. précit.
[35]V. en ce sens J. Dabin, Le droit subjectif, Dalloz, 1952, p.209 ; G. Ripert, Traité élémentaire de droit commercial, 3e éd., 1954, n°665, p. 297 ; F.-X. Lucas, Les transferts temporaires de valeurs mobilières, Pour une fiducie de valeurs mobilières, préf. de L. Lorvellec, L.G.D.J., 1997, n°411 ; F. Nizard, Les titres négociables, préf. de H. Synvet, Economica, 2003, n°30, p. 17 ; A. Galla-Beauchesne, « Les clauses de garantie de passif dans les cessions d’actions et de parts sociales », Rev. sociétés 1980, p. 30-31.
[36] V. en ce sens R. Mortier, Le rachat par la société de ses droits sociaux, préf. de J.-J. Daigre, Dalloz, 2003, n°302.
[37] S. Lacroix-De Sousa, La cession de droits sociaux à la lumière de la cession de contrat, préf. M.-É. Ancel, LGDJ, 2010, n°101, p. 103.
[38] J.-P. Bertel, « Liberté contractuelle et sociétés, Essai d’une théorie du juste milieu en droit des sociétés », RTD com. 1996, p. 595.
[39] Pour une étude approfondie sur l’évolution de la notion de société V. C. Champaud, « Le contrat de société existe-t-il encore ? », in Le droit contemporain des contrats, Travaux de la faculté des sciences juridiques de Rennes, Economica, 1987, p. 125 et s.
[40] J.Ph. Lévy et A. Castaldo, Histoire du droit civil, éd. Dalloz, 2002, coll. « précis », n°474, p. 703 et s.
[41] R.-J. Pothier, Traité du contrat de société, éd. 1807.
[42] J. Domat, Lois civiles, Civ. 1ère, Titre VIII, in principio.
[43] Loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée.
[44] Ph. Merle, Sociétés commerciales, Dalloz, 19e éd. 2016, coll. « précis », n°31, p. 44.
[45] V. en ce sens M. Buchberger, Le contrat d’apport – Essai sur la relation entre la société et son associé, éd. Panthéon-Assas, 2011, préf. M. Germain, n° 193, p. 169.
[46] J.-P. Bertel, art. préc.
[47] V. en ce sens A. Gaillard, La société anonyme de demain, la théorie institutionnelle et le fonctionnement de la société anonyme, Sirey, 2e éd., 1933.
[48] M. Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation (essai de vitalisme social) », in Aux sources du droit, le pouvoir, l’ordre et la liberté, Les Cahiers de la nouvelle journée, n°23, p. 89-128.
[49] M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 29e éd., 2016, p. 5.
[50] V. en ce sens Ph. Merle, op. cit. n°33, p. 45 ; M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., p. 5.
[51] V. notamment en ce sens P. Didier, « Le consentement avec l’échange : le contrat de société », RJ com. nov. 1995, n° spéc., « L’échange des consentements », p. 74 ; K. Peglow, Le contrat de société en droit allemand et en droit français comparés, préf. de J.-B. Blaise, L.G.D.J., 2003, p. 403 et s. ; S. Lacroix-De Sousa, thèse préc., p. 149 et s.
[52] P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit – Mélanges en hommage à F. Terré, Dalloz-PUF-Juris-classeur, 1999, p. 636.
[53] P. Didier, « Le consentement avec l’échange : le contrat de société », art. préc., p. 75.
[54] P. Hoang, La protection des tiers face aux associations. Contribution à la notion de « contrat-organisation », préf. P. Didier, L.G.D.J., 2002, introduction.
[55] N. Mathey, Recherche sur la personnalité morale en droit privé, thèse Paris II, 2001, p. 212.
[56] F. Chénedé, Les commutations en droit privé – Contribution à la théorie générale des obligations, préf. A. Ghozi, Economica, 2008 ; V. également J.-F. Hamelin, Le contrat alliance, thèse dactyl. Paris II, 2010 ; S. Lequette, Le contrat-coopération – Contribution à la théorie générale du contrat, préf. C. Brenner, Economica, 2012.
[57] J. Derruppé, « Régimes de communauté et droit des sociétés », art. préc. ; G. Plaisant, « Peut-on abandonner la distinction du titre et de la finance en régime de communauté ? », JCP N 1984, I, p. 19» ; E. Naudin, « L’époux associé et le régime légal de la communauté réduite aux acquêts », art. préc.
[58] J. Derruppé, art. préc.
[59] V. en ce sens J. Flour et G. Champenois, op. cit., n°249, p. 240 ; A. Colomer, op. cit., n°403, p. 195.
[60] J. Derruppé, « La nécessaire distinction de la qualité d’associé et des droits sociaux », JCP N 1984, I, p. 251.
[61] J. Derruppé, « L’altération du régime de communauté avec l’extension des propres par nature », in Mélanges Colomer, Litec, 1993, p. 161.
[62] V. notamment J. Derruppé, « Régimes de communauté et droit des sociétés », art. préc. ; J. Flour et G. Champenois, op. cit., n°323, p. 314-315.
[63] G. Plaisant, art. préc.
[64] V. en ce sens F. Vialla, « Autonomie professionnelle en régime communautaire et droit des sociétés : des conflits d’intérêts ? », RTD civ. 1996, p. 864, n° 105.
[65] Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123 : JCP N 2012, note 1107, D. Boulanger ; JCP G 2012, 131, note G. Paisant ; JCP N 2012, 1376, obs. Ph. Simler.
[66] V. en ce sens L. Nurit-Pontier, « Conjoint d’associé : être ou ne pas être associé », in Mélanges R. Le Guidec, LexisNexis, 2014, p. 229 et s.
[67] V. notamment J. Derruppé, « Régime de communauté et droit des sociétés », art. préc.
[68] C. Grzegorczyk, « Le concept de bien juridique : l’impossible définition ? », in Les biens et les choses, Arch. phil. dr., Sirey 1979, t. 24, p. 259.
[69] V. en ce sens F. Zenati-Castaing et Th. Revet, Les biens, PUF, 3e éd. 2008, p. 15 et s. ; Ch. Atias, Droit civil, Les biens, LexisNexis, 2015, n°36, p. 21 et s.
[70] V. en ce sens F. Zenati-Castaing et Th. Revet, op. cit., n°88, p.113.
[71] J. Dabin, op. cit., p. 209.
[72] R. Mortier, op. cit., n°302.
[73] V. en ce sens R.T. Troplong, Le droit civil expliqué – Du contrat de société civile et commerciale, Paris 1843, n°140, p. 154, cité in M. Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, préf. de D. Bureau, Economica, 2009, n°398.
[74] S. Lacroix, op. cit., n°142, p. 124.
[75] P. Berlioz, La notion de bien, préf. de L. Aynès, L.G.D.J., 2007, n°1100.
[76] F. Chabas, H.-L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. II, Biens, droit de propriété et ses démembrements, Montchrétien, 8e éd., 1994, n°1301, p. 13.
[77] V. en ce sens H. Le Nabasque, « Les actions sont des droits de créance négociables », Aspects actuels de droit des affaires, in Mélanges en l’honneur de Y. Guyon, Dalloz, 2003, p. 673.
[78] V. en ce sens S. Ginosar, Droit réel, propriété et créance. Élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, thèse : Paris, 1960, n°12 ; F. Zenati, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 316 ; Y. EMERICH, La propriété des créances, approche comparative, préface F. Zenati-Castaing, L.G.D.J., t. 469, 2007 ; W. Dross, « Une approche structurale de la propriété », RTD civ., 2012, p. 419.
[79] CEDH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis andreadis c/ Grèce, n° 13427/87, RTD civ. 1995. 652, obs. F. Zenati; CEDH, 14 févr. 2006, n° 67847/01, Lecarpentier, D. 2006. 717, obs. C. RondeyDocument InterRevues ; RDI 2006. 458, obs. H. Heugas-Darraspen Document InterRevues ; RTD civ. 2006. 261, obs. J.-P. Marguénaud.
[80] Cons. const. 10 juin 2010, n° 2010-607 DC, Loi relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cons. 7-10, D. 2010. 2553, note S. MoutonDocument InterRevues ; ibid. 2011. 2298, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin.
[81] Pour une critique de la propriété des créances V. notamment J. Dabin, « Une nouvelle définition du droit réel », RTD civ., 1962, p. 20.
[82] J. Ghestin, M. Billau et G. Loiseau, Traité de droit civil, Le régime des créances et des dettes, L.G.D.J., 2005.
[83] G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, t. 2, Les biens, Sirey, 1980, p. 5, n° 6.
[84] H. Kelsen, Théorie pure du droit, éd. Bruylant-LGDJ, 1999, trad. Ch. Eisenmann, p. 257 ; V. également en ce sens G. Forest, Essai sur la notion d’obligation en droit privé, Préf. F. Leduc, Dalloz, coll. « Bibl. Thèses », 2012.
[85] On peut notamment penser à l’admission de la théorie de l’imprévision consacrée en droit civil par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
[86] Sur cette question V. notamment C. Bourdaire-Mignot, Le Contractant marié, préf. J. Revel, Defrénois, coll. « Doctorat & Notariat », 2009.
[87] A. Colomer, « les problèmes de gestion soulevés par le fonctionnement parallèle d’une société et d’un régime matrimonial », art. préc., p. 867.
[88] Sur cette question V. notamment Cass. 1re civ., 9 nov. 2011, n° 10-12.123 : JCP N 2012, note 1107, D. Boulanger ; JCP G 2012, 131, note G. Paisant ; D. 2012, p. 483, note V. Barabé-Bouchard ; contra V. Cass. 1re civ., 9 juill. 1991, n° 90-12.503 : Bull. civ. 1991, I, n° 232 ; JCP G 1992, I, 3614, n° 8 ; Defrénois 1991, art. 35152, p. 1333, note P. Le Cannu ; Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309 : D. 2014, p. 1908, obs. V. Brémond ; JCP G 2014, 1265, Ph. Simler ; Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265 : JCP G 2014, act. 1137, P. Hilt ; JCP N 2014, n° 45-46, act. 1154 ; JCP G 2014, 1265, Ph. Simler.
[89] J. Revel, art. préc.
[90] G. Plaisant, art. préc.
[91] F. Vialla, art. préc.
[92] J. Derruppé, « L’altération du régime de communauté avec l’extension des propres par nature », art. préc.
[93] G. Champenois, op. cit., n°323, p. 313 ; A. Colomer, op. cit., n°769, p.348.
[94] Ph. Merle, Sociétés commerciales, Dalloz, 19e éd. 2016, coll. « précis », n°209, p. 208.
[95] V. en ce sens Cass. com., 19 mars 1957 : JCP G 1958, 10517, note D. Bastian ; D. 1958, jurispr. p. 170, note M. Le Galcher Baron; Cass. 1re civ, 22 déc. 1969 : JCP 1970, II, 16473, note J. Patarin ; Bull. civ. 1969, I, n° 400; Cass. com., 20 janv. 1971 : JCP G 1971, II, 16795.
[96] Sur ce débat V. notamment E. Naudin, « L’époux associé et le régime légal de la communauté réduite aux acquêts », art. préc.
[97] Ibid.
[98] Ibid.
[99] L’article 1468 dispose en ce sens que : « il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté, d’après les règles prescrites aux sections précédentes ».