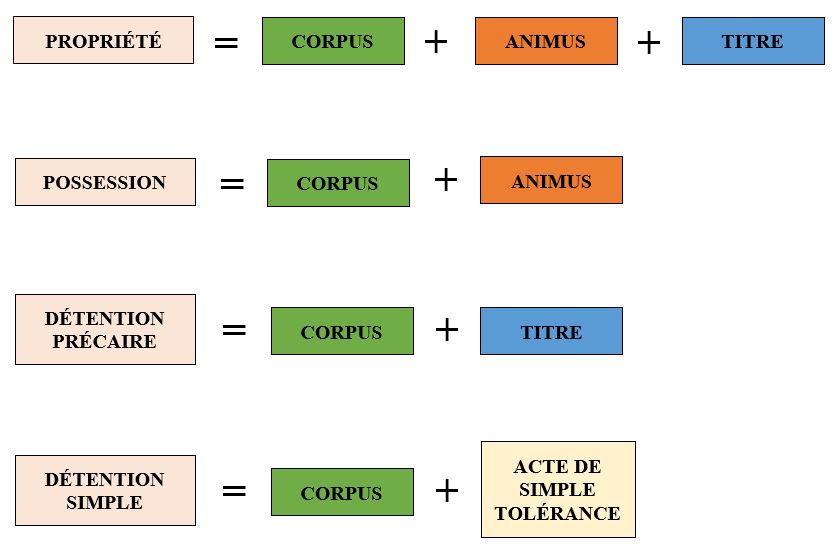Le droit de propriété confère un spectre de prérogatives des plus large à son titulaire regroupées en trois attributs.
Au nombre de ces attributs figurent, l’usus, le fructus et l’abusus, lesquels permettent respectivement d’utiliser, de jouir, et de disposer de la chose.
§1: le droit d’user de la chose: l’usus
I) Fondement
L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses ». Ainsi sont résumées les prérogatives qui sont conférées au propriétaire d’un bien.
Alors que le texte investi ce dernier du pouvoir de disposer de la chose (abusus) et de tirer profit des fruits qu’elle lui procure (fructus), étonnement il n’est nullement fait référence à la possibilité d’en user.
Est-ce à dire que l’usage de la chose ne compte pas parmi les prérogatives qui échoient au propriétaire ? Certainement pas. Il suffit pour s’en convaincre de se reporter à la dernière partie de l’article 544 du Code civil qui précise « pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La faculté d’user de la chose relève donc bien des prérogatives conférées au propriétaire au titre de son droit de propriété. La question qui alors se pose est de savoir ce que recouvre le droit « d’user de la chose ».
II) Signification
À l’examen, l’usus doit être envisagé sous ses deux aspects, positifs et négatifs :
==> Positivement
L’usus c’est d’abord le pouvoir de faire usage de la chose en exerçant sur elle une emprise matérielle.
Le Doyen Carbonnier définissait l’usus comme « cette sorte de jouissance qui consiste à retirer personnellement – individuellement ou par sa famille – l’utilité ou le plaisir que peut procurer par elle-même une chose non productive ou non exploitée (habiter sa maison, porter ses bijoux, c’est en user) ».
À cet égard, le droit d’user de la chose confère au propriétaire la liberté de choisir l’usage de la chose, soit de s’en servir selon ses propres besoins, convictions et intérêts.
Sous réserve de la réglementation applicable et des autorisations administratives requises, il est donc libre d’édifier un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire, tout autant qu’il peut choisir d’affecter ce terrain à de la cultivation ou à l’exploitation d’un camping.
==> Négativement
L’usus c’est aussi le pouvoir de ne pas faire usage de la chose dont on est propriétaire, nonobstant les conséquences matérielles ou économiques que ce non-usage est susceptible d’occasionner.
Ainsi, l’automobiliste est-il libre de ne pas utiliser sa voiture, tout autant que le propriétaire d’une maison est libre de ne pas l’habiter, quand bien même il est un risque que l’un et l’autre de ces biens se détériorent en cas d’absence d’utilisation prolongée.
§2: Le droit de jouir de la chose: le fructus
I) Notion
Le droit de propriété ce n’est pas seulement le droit d’user de la chose, c’est également le droit d’en jouir (fructus).
Par jouissance de la chose, il faut entendre le pouvoir conféré au propriétaire de percevoir les revenus que le bien lui procure.
Pour le propriétaire d’un immeuble, il s’agira de percevoir les loyers qui lui sont réglés par son locataire. Pour l’épargnant, il s’agira de percevoir les intérêts produits par les fonds placés sur un livret. Pour l’exploitant agricole, il s’agira de récolter le blé, le maïs ou encore le sésame qu’il a cultivé.
À l’instar de l’usus, le fructus comporte également un aspect négatif, en ce qu’il autorise le propriétaire à ne pas percevoir les revenus de son bien, soit de le laisser inexploité.
Immédiatement, il convient d’observer que le bien est susceptible de procurer deux sortes de revenus au propriétaire : des fruits et des produits
II) Distinction en les fruits et les produits
L’une des exploitations d’un bien peut consister à tirer profit de la création, à partir de celui-ci, d’un nouveau bien. Ainsi, un arbre procure-t-il des fruits, un immeuble donné à bail des loyers et une carrière de pierres.
La question qui alors se pose est de savoir si tous ces nouveaux biens créés dont tire profit le propriétaire sont appréhendés par le droit de la même manière.
La réponse est non, en raison d’une différence physique qu’il y a lieu de relever entre les différents revenus qu’un bien est susceptible de procurer à son propriétaire.
En effet, il est des cas où la création de biens dérivés supposera de porter atteinte à la substance du bien originaire (extraction de pierre d’une carrière), tandis que dans d’autres cas la substance de ce bien ne sera nullement altérée par la production d’un nouveau bien.
Ce constat a conduit à distinguer les fruits que procure la chose au propriétaire des produits, l’intérêt de la distinction étant réel, notamment en cas de démembrement du droit de propriété.
- Exposé de la distinction
- Les fruits
- Les fruits correspondent à tout ce que la chose produit périodiquement sans altération de sa substance.
- Tel est le cas des loyers produits par un immeuble loué, des fruits d’un arbre ou encore des bénéfices commerciaux tirés de l’exploitation d’une usine.
- Classiquement, on distingue trois catégories de fruits :
- Les fruits naturels
- Il s’agit des fruits produits par la chose spontanément sans le travail de l’homme
- Exemple : les champignons des prés, les fruits des arbres sauvages
- Les fruits industriels
- Il s’agit des fruits que l’on obtient par la culture, soit dont la production procède du travail de l’homme
- Exemple: les récoltes sur champs, les coupes de bois taillis, bénéfices réalisés par une entreprise
- Les fruits civils
- Il s’agit des revenus périodiques en argent dus par les tiers auxquels la jouissance de la chose a été concédée
- Exemple: les loyers d’un immeuble donné à bail ou encore les intérêts d’une somme argent prêtée
- Les fruits naturels
- Pour être un fruit, le bien créé à partir d’un bien originaire, il doit donc remplir deux critères : la périodicité (plus ou moins régulière) et la conservation de la substance de la chose dont ils dérivent.
- Ainsi que l’exprimait le Doyen Carbonnier, « c’est parce qu’il [le fruit] revient périodiquement et qu’il ne diminue pas la substance du capital que le fruit se distingue du produit».
- Les fruits
-
- Les produits
- Les produits correspondent à tout ce qui provient de la chose sans périodicité, mais dont la création en altère la substance
- Tel est le cas des pierres et du minerai que l’on extrait d’une carrière ou d’une mine
- Ainsi que l’ont fait remarquer des auteurs « quand on perçoit des fruits, on perçoit seulement des revenus, tandis que quand on perçoit les produits d’une chose, on perçoit une fraction du capital, qui se trouve ainsi entamé»[1].
- Lorsque la perception des revenus tirés de la chose ne procédera pas d’une altération de sa substance, il conviendra de déterminer si cette perception est périodique ou isolée.
- Tandis que dans le premier, il s’agira de fruits, dans le second, on sera en présence de produits.
- Ainsi, s’agissant d’une carrière exploitée sans discontinuité, les pierres extraites seront regardées comme des fruits et non comme des produits, la périodicité de la production couvrant l’altération de la substance.
- Il en va de même pour une forêt qui aurait été aménagée en couples réglées : les arbres abattus quittent leur état de produits pour devenir des fruits.
- Les produits
- Intérêt de la distinction
- La distinction entre les fruits et les produits n’est pas sans intérêt sur le plan juridique.
- En effet, alors que les fruits reviennent à celui qui a la jouissance de la chose, soit l’usufruitier, les produits, en ce qu’ils sont une composante du capital, appartiennent au nu-propriétaire.
III) Formes de la jouissance
En approfondissant l’analyse, il apparaît que le fructus peut se manifester sous deux formes différentes :
- L’accomplissement d’actes matériels
- La jouissance peut tout d’abord consister en la perception de revenus au moyen d’actes matériels
- Dans cette hypothèse le propriétaire récolte lui-même les fruits naturels ou industriels
- L’accomplissement d’actes juridiques
- La jouissance peut ensuite consister en la perception de revenus aux moyens d’actes juridiques
- Il s’agira ici d’accomplir des actes d’administration ou de disposition pour que le bien produise des fruits civils.
- Tel est le cas du propriétaire d’un immeuble qui doit conclure un contrat de bail pour percevoir des loyers
IV) Cas particulier du droit à l’image sur les biens
Le droit de jouissance octroie, en principe, au propriétaire la liberté d’exploiter son bien, mais également de ne rien en faire.
L’utilité conférée par la jouissance au propriétaire est très vaste, à telle enseigne que rien ne s’oppose à ce qu’elle permette d’appréhender des utilités nouvelles des biens, en particulier des utilités qui jusqu’à maintenant avaient échappé à l’appréhension du droit, parce que l’intérêt qui s’y attachait était moindre.
Sous le prisme de la jouissance, on s’est alors posé la question du droit du propriétaire à l’image de son bien, par transposition au droit à l’image des personnes.
Ainsi que le relève le Professeur Zénati, « l’intervention de la photographie, du cinématographe, et de la communication audiovisuelle ont mis au jour une utilité qui, jusqu’alors, demeurait discrète : la reproduction picturale. Comme d’habitude, le droit réagit avec quelque retard, mais peu importe. Il est patent que la vertu qu’ont tous les objets matériels de pouvoir être mis en image est une utilité qui tombe sous le champ de la propriété à l’instar des utilités classiques que l’on connaît et qu’en conséquence cet avantage échappe à la jouissance d’autrui ».
Première illustration de ce phénomène, dans un arrêt du 10 mars 1999, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 544 du Code civil, que « l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1999, n°96-18699).
| Cass. 1ère civ. 10 mars 1999 |
|---|
| Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y..., tendant à la saisie de cartes postales mises en vente par la société Editions Dubray, représentant le " Café Gondrée ", dont Mme Y... est propriétaire à Bénouville, l'arrêt attaqué énonce que la photographie, prise sans l'autorisation du propriétaire, d'un immeuble exposé à la vue du public et réalisée à partir du domaine public ainsi que sa reproduction, fût-ce à des fins commerciales, ne constituent pas une atteinte aux prérogatives reconnues au propriétaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen. |
Il ressort de cet arrêt que le droit à l’image sur les biens relève du monopole de jouissance dont est investi le propriétaire.
Le professeur Cornu analyse ce rattachement du droit à l’image au fructus en soutenant que « c’est parce qu’il est investi, sur son bien, non pas d’un droit à l’image, de celui-ci, mais du droit exclusif de l’exploiter (partie de sa jouissance), que le propriétaire est fondé à interdire aux tiers l’exploitation photographique et lucrative de son bien qui est tout simplement une part de son utilité économique »
Selon cette thèse la reproduction d’un bien meuble ou immeuble sous la forme d’une image, que les techniques modernes permettent de commercialiser à grande échelle, constitue une utilités susceptible d’être source de profit.
Dans notre société qui repose très largement sur la propriété privée, il n’y aurait donc aucune raison que les propriétaires qui ont la charge de l’entretien de leurs biens soient dépossédés des potentialités de leur exploitation au prétexte qu’ils sont accessibles au regard du public.
Pour s’en convaincre, il suffit d’observer que le droit de se clore prévu par l’article 647 du Code civil n’est pas seulement un moyen de protéger le propriétaire contre les incursions des tiers mais est aussi le signe que la vue de son bien est une utilité qui lui appartient. En témoignent également les dispositions des articles 675 à 680 de ce Code qui imposent aux propriétaires d’immeubles d’éloigner de la limite séparative de leurs fonds les murs comportant des vues sur le fonds voisin.
En réaction à cette jurisprudence, des spécialistes du droit d’auteur ont soutenu que si le législateur a limité la durée des droits patrimoniaux des auteurs, spécialement du droit de reproduction que leur accorde à titre exclusif l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, c’est parce que leurs œuvres doivent tomber dans le domaine public libres de toute entrave afin de développer la culture et la connaissance du patrimoine. En raison de son caractère perpétuel, le droit de propriété ferait obstacle à l’extension sans cesse régénérée du domaine public.
D’autres commentateurs ont avancé que la découverte de cette nouvelle utilité du bien (droit à l’image) au bénéfice de son propriétaire aboutirait à des solutions ingérables en pratique, trop contraignantes et trop coûteuses pour les professionnels de l’illustration. Ils ont encore dénoncé ainsi une “privatisation de l’espace public” au détriment de la liberté d’expression[2].
Attentive aux critiques à l’encontre de la position qu’elle avait adoptée en 1999, la Cour de cassation s’est à nouveau prononcée en 2001 en y apportant un tempérament.
Dans un arrêt du 2 mai 2001, la première chambre civile a, en effet, reproché aux juges de fond de n’avoir pas précisé « en quoi l’exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d’usage et de jouissance du propriétaire » (Cass. 1ère civ. 2 mai 2001, n°99-10709).
L’exploitation de l’image d’un bien par un tiers ne serait ainsi sanctionnée qu’à la condition que soit établie l’existence d’un « trouble certain du droit d’usage et de jouissance du propriétaire ».
| Cass. 1ère civ. 2 mai 2001 |
|---|
| Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 544 du Code civil ; Attendu que le Comité régional de tourisme de Bretagne (le CRT) a utilisé à des fins de publicité un cliché dont il avait acquis le droit de reproduction de M. X..., photographe professionnel ; que cette image représente l'estuaire du Trieux, avec, au premier plan, l'îlot de Roch Arhon, propriété de la société civile immobilière du même nom, et a été diffusée malgré l'opposition de celle-ci ; Attendu que pour accueillir la demande de la SCI en interdiction de cette reproduction, l'arrêt attaqué énonce que les droits invoqués par le CRT et M. X... trouvent leurs limites dans la protection du droit de propriété de la SCI, à la mesure des abus inhérents à l'exploitation d'une représentation de son bien à des fins commerciales et avec une publicité importante, que l'île est le sujet essentiel de l'image, et que la photographie est utilisée sous la forme d'une affiche à grande diffusion, au titre d'une campagne publicitaire destinée à la promotion du tourisme ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'exploitation de la photographie par les titulaires du droit incorporel de son auteur portait un trouble certain au droit d'usage ou de jouissance du propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; […] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; |
À l’analyse, il ressort de cette décision que la Cour de cassation s’est mise en quête de la recherche d’un équilibre entre les intérêts du propriétaire et la liberté de circulation de l’image du bien.
L’exigence de démontrer un trouble certain dans la jouissance du propriétaire conduit à autoriser l’utilisation de l’image du bien d’autrui, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une exploitation directe de cette image.
Cette protection nouvelle du droit à l’image de son bien a pour fondement l’article 544 du Code civil, et plus précisément le droit de jouissance dont est investi le propriétaire.
Cette appréhension du droit à l’image sur les biens comme une expression de l’usus et du fructus n’a manifestement pas perduré.
Dans un arrêt du 7 mai 2004, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a, en effet, jugé que « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal » (Cass. ass. plen. 7 mai 2004, n°02-10450).
Par cette formule, haute juridiction déconnecte le droit à l’image sur le bien dont est titulaire le propriétaire de l’article 544 du Code civil pour le rattacher aux principes de la responsabilité civile.
| Cass. ass. plen. 7 mai 2004 |
|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2001), que la Société de promotion immobilière SCIR Normandie (la société SCIR Normandie), a confié à la société Publicis Qualigraphie aux droits de laquelle se trouve la société Publicis Hourra (la société Publicis) la confection de dépliants publicitaires comportant, outre des informations relatives à l'implantation de la future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d'un immeuble historique de Rouen, l'Hôtel de Girancourt ; que se prévalant de sa qualité de propriétaire de cet hôtel, la SCP Hôtel de Girancourt, dont l'autorisation n'avait pas été sollicitée, a demandé judiciairement à la société SCIR Normandie la réparation du préjudice qu'elle disait avoir subi du fait de l'utilisation de l'image de son bien ; que cette dernière a appelé la société Publicis en garantie ; Attendu que la SCP Hôtel de Girancourt fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements" ; que le droit de jouir emporte celui d'user de la chose dont on est propriétaire et de l'exploiter personnellement ou par le truchement d'un tiers qui rémunère le propriétaire, ce droit ayant un caractère absolu et conduisant à reconnaître au propriétaire un monopole d'exploitation de son bien, sauf s'il y renonce volontairement ; qu'en énonçant que "le droit de propriété n'est pas absolu et illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien" pour en déduire qu'il lui appartenait de démontrer l'existence d'un préjudice car la seule reproduction de son bien immeuble sans son consentement ne suffit pas à caractériser ce préjudice, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ; 2 ) qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'utilisation à des fins commerciales de la reproduction de la façade de l'Hôtel de Girancourt sans aucune contrepartie financière pour elle, qui a supporté un effort financier considérable pour la restauration de l'hôtel particulier ainsi qu'en témoignent les photographies de l'immeuble avant et après les travaux, restauration qui a permis aux intimées de choisir une image de cet immeuble pour l'intégrer dans le dépliant publicitaire, est totalement abusive et lui cause un préjudice réel, le fait que les intimées aient acheté cette reproduction chez un photographe rouennais prouvant bien que la façade restaurée représente une valeur commerciale ; qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement pertinent qu'elle "ne démontre pas l'existence du préjudice invoqué par elle et d'une atteinte à son droit de propriété", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 544 du Code civil ; 3 ) qu'elle faisait également valoir dans ses conclusions d'appel en visant les cartes postales de la façade historique de l’Hôtel de Girancourt qu'elle édite et qu'elle avait régulièrement produites, que les mentions portées au verso de ces pièces confirment sa volonté de conserver à son usage exclusif le droit de reproduire la façade de l'hôtel ou de concéder une autorisation quand elle estime que les conditions sont réunies ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur la valeur de ces pièces qu'elle avait régulièrement versées aux débats à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt font apparaître qu'un tel trouble n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
C’est ainsi que la Cour de cassation nie désormais le pouvoir du propriétaire d’exercer un droit de propriété sur l’image de son bien. Il dispose seulement d’une action qui pourrait reposer, tant sur les principes du droit de la responsabilité, que sur le droit à la vie privée ou encore sur la diffamation envisagée par la loi du 29 juillet 1881.
La notion de trouble se retrouve dans de nombreux régimes de responsabilité, de sorte que cela offre une large palette d’actions au propriétaire incommodé.
Par trouble anormal, il faut entendre, selon un arrêt de la première chambre civile, une atteinte à la tranquillité ou à l’intimité de la personne (Cass. 1ère civ. 5 juil. 2005, n°02-21452).
Dans un arrêt du 31 mars 2015, la Chambre commerciale a précisé que l’exploitation commerciale en elle-même de l’image d’un bien n’est pas constitutive d’un trouble anormal (Cass. com. 31 mars 2015, n°13-21300).
§3: Le droit de disposer de la chose: l’abusus
==> Signification
L’article 544 du Code civil prévoit expressément que l’un des attributs du droit de propriété c’est le pouvoir de disposer de la chose (abusus).
Ce pouvoir dont est investi le propriétaire l’autorise à accomplir tous les actes susceptibles de conduire à la perte totale ou partielle de son bien.
À l’évidence, il s’agit là de l’expression du droit de propriété la plus extrême, celle qui emporte les conséquences les plus graves puisqu’il s’agit d’aliéner son droit sur la chose.
C’est la raison pour laquelle ce pouvoir n’appartient, ni à l’usufruitier (sauf exception du quasi usufruitier pour les choses consomptibles), ni au locataire.
Néanmoins, à l’instar de l’usus et du fructus, l’abusus comporte un aspect positif et négatif, en ce sens qu’il autorise le propriétaire à aliéner son bien, tout autant qu’il lui octroie la liberté de ne pas s’en déposséder.
Manifestement, le droit de disposer de la chose fait l’objet d’une protection particulièrement renforcée puisque, outre l’article 544 du Code civil qui le consacre, il est envisagé, et par l’article 545 du même Code et par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC).
- S’agissant de l’article 545 du Code civil, il prévoit que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.»
- S’agissant de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen, cette disposition prévoit que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »
Le droit de ne pas être exproprié est ainsi doublement protégé, et au niveau légal, et au niveau constitutionnel.
S’agissant du droit de disposer de son bien proprement dit son exercice peut se traduire de différentes manières. Reste que cet exercice n’est pas sans limite, en particulier lorsque le bien est frappé d’inaliénabilité
I) Les formes de disposition
Le droit de disposer de la chose peut se traduire, soit par l’accomplissement d’actes matériels, soit par l’accomplissement d’actes juridiques.
==> L’accomplissement d’actes matériels
L’exercice du droit de disposition peut, tout d’abord, se traduire par l’accomplissement d’actes matériels sur la chose tels que :
- Sa modification
- Sa destruction
- Son amélioration
- Son accroissement
- Sa transformation
- Sa consommation
En somme, le propriétaire est investi, au titre de l’abusus, d’un pouvoir d’affecter la substance de la chose.
Cette faculté d’accomplir des actes sur la substance de la chose qui est conférée par l’abusus est refusée aux autres droits réels, en ce que les droits de jouissance sur la chose d’autrui ne sont conférés à leur titulaire qu’à la charge d’en conserver la substance (art. 578 C. civ.).
==> L’accomplissement d’actes juridiques
L’exercice du droit de disposition peut, ensuite, se traduire par l’accomplissement d’actes juridiques qui auront pour effet de :
- Transférer le droit de propriété, soit par un contrat (vente, donation, apport en société), soit par un acte unilatéral (testament, déguerpissement conduisant à un abandon)
- Démembrer le droit de propriété, ce qui peut consister à constituer un droit réel d’usufruit, céder la nue-propriété, constituer une servitude sur le bien ou encore consentir une emphytéose
- Affecter le bien à la garantie du paiement d’une dette au moyen d’une hypothèse, d’un nantissement, d’un gage ou encore d’une fiducie
À la différence de l’acte matériel de disposition, l’acte juridique porte, non pas sur la chose, mais sur le droit de propriété qui fait l’objet d’une opération économique.
En certaines circonstances, le propriétaire peut n’être pas autorisé à accomplir des actes de disposition sur son bien en raison de son caractère inaliénable.
II) Les limites au droit de disposer
Bien que le droit de disposer de son bien soit l’expression suprême de la maîtrise du bien qui n’est reconnue qu’au seul propriétaire, il est des cas où ce pouvoir dont il est investi est limité.
Tantôt, le propriétaire peut n’être pas autorisé à aliéner son bien, tantôt il sera, au contraire, obligé de le céder.
A) Les clauses d’inaliénabilité du bien
Le droit de disposer d’un bien l’autorise-t-il le propriétaire à insérer dans un acte translatif de propriété une clause interdisant à l’acquéreur d’aliéner le bien ?
Si une telle clause se justifie difficilement en cas d’acte à titre onéreux, quid lorsque le propriétaire accomplit un acte à titre gratuit, tel un testament ou une donation ?
Pendant longtemps, le Code civil est resté silencieux sur cette question, ce type de clause n’ayant pas été envisagée par ses rédacteurs.
Aussi, est-ce à la jurisprudence qu’est revenue la tâche de se positionner sur la validité des clauses d’inaliénabilité stipulées dans un testament ou une donation.
==> Évolution jurisprudentielle
Dans un premier temps, la jurisprudence a prohibé les clauses d’inaliénabilité perpétuelle, qu’elle considérait comme contraires à l’ordre public, car portant entrave à la circulation des biens et à leur libre disposition par le propriétaire (V. en ce sens Cass. 6 juin 1853 — D. 1853).
Les auteurs justifiaient cette position en interprétant les articles 537, 544 et 1598 du Code civil comme admettant les clauses d’inaliénabilité que dans les cas expressément prévus par la loi.
Dans un second temps, la Cour de cassation a considérablement assoupli sa position. Dans un arrêt du 20 avril 1858, elle a ainsi jugé que « cette interdiction temporaire, imposée dans l’intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d’aliéner absolue et indéfinie qui aurait pour résultat de mettre les biens hors de circulation » (Cass. civ., 20 avr. 1858).
| Cass. civ., 20 avr. 1858 |
|---|
| LA COUR, Ouï M. le conseiller Laborie, en son rapport; Maître Petit, avocat du demandeur, en ses observations, et M. l'avocat général Sévin, en ses conclusions ; le tout à l'audience publique, après en avoir immédiatement délibéré ; Vu l'article 900 du X... Napoléon ; Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'aucune loi ne défend au père de famille, qui fait donation de ses biens à ses enfants, de s'en réserver l'usufruit, et, soit dans l'intérêt de son droit comme usufruitier, soit pour assurer l'exercice du droit de retour qui peut un jour lui appartenir, d'imposer à ses enfants la condition de ne pas aliéner ou hypothéquer de son vivant les biens donnés ; que cette interdiction temporaire, imposée dans l'intérêt du père donateur, ne peut être assimilée à une interdiction d'aliéner, absolue et indéfinie, qui aurait pour résultat de mettre pendant un long temps les biens hors de la circulation ; qu'en déclarant valable l'hypothèque consentie par la femme de Pons à Z..., par le motif unique que la condition imposée par le père donateur à ladite femme de Pons était nulle comme contraire aux lois, l'arrêt dénoncé a faussement appliqué et, par suite, formellement violé la disposition ci-dessus visée : Par ces motifs, donnant défaut contre les défendeurs, CASSE, Ainsi jugé et prononcé, Chambre civile. |
Il ressort de cet arrêt que les clauses d’inaliénabilité sont admises dès lorsque deux critères sont remplis : la limitation dans le temps de l’inaliénabilité du bien et la justification d’un intérêt sérieux et légitime.
==> Consécration légale
Alors même que la jurisprudence était constante s’agissant des critères de validité des clauses d’inaliénabilité, il est apparu nécessaire au législateur d’intervenir aux fins de les graver dans le marbre de la loi.
Ainsi, à partir des deux critères posés par la jurisprudence le législateur est-il venu entériner, par la loi du 3 juillet 1971, les solutions adoptées en insérant dans le Code civil un article 900-1.
Cette disposition prévoit que « les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
La validité des clauses d’inaliénabilité est donc soumise à deux conditions :
- S’agissant de la limitation dans le temps de l’inaliénabilité
- Lorsqu’une clause d’inaliénabilité est stipulée dans un testament ou une donation, elle ne peut donc produire que des effets temporaires.
- La perpétuité d’une telle clause serait, en effet, de nature à entraver la libre circulation des biens.
- Aussi, l’interdiction d’aliéner doit être limitée dans le temps.
- La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par temporaire
- Il a été jugé que la clause rendant inaliénable un bien durant toute la vie du donateur était temporaire.
- À l’inverse, une clause stipulant une inaliénabilité du bien pour toute la vie du donataire n’est pas temporaire (V. en ce sens 1ère civ. 8 janv. 2002)
- S’agissant de la justification d’un intérêt sérieux et légitime
- L’article 900-1 du Code civil admet la validité des clauses d’inaliénabilité à la condition qu’elles soient justifiées par un intérêt sérieux et légitime.
- Selon l’expression du Doyen Carbonnier, la jurisprudence a parfois admis la prise en considération de ce que l’on peut qualifier d’intérêt de confort.
- Pour exemple, l’intérêt pour un usufruitier ou le titulaire d’un droit d’usage ou d’habitation de conserver comme nu-propriétaire son fils plutôt qu’un étranger.
- À l’examen, cet intérêt exigé par l’article 900-1 du Code civil peut être soit celui du disposant, soit celui du bénéficiaire, soit celui d’un tiers.
- Dans le cas du disposant, on conçoit aisément qu’il ait intérêt à stipuler une clause d’inaliénabilité lui permettant, en cas de prédécès du donataire, d’exercer son droit de retour légal, ce droit ne pouvant être exercé que si les biens se retrouvent en nature dans la succession ( civ. 22 juillet 1896).
- Dans le cas du bénéficiaire, la clause d’inaliénabilité aura pour objet de le protéger contre son inexpérience ou sa prodigalité ( civ. 16 janvier 1923) .
- Dans le cas du tiers, il peut avoir un intérêt à ce qu’un bien demeure dans le patrimoine du bénéficiaire : c’est le cas, par exemple, lorsque ce dernier est tenu à verser à une tierce personne une rente prélevée sur les revenus dudit bien ( civ. 16 mars 1903)
- Il peut être observé que, dans l’hypothèse où l’intérêt disparaît, l’article 900-1 du Code civil prévoit que « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
==> L’exception des personnes morales
L’alinéa 2 de l’article 900-1 dispose que « les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales. »
Ainsi si les conditions restrictives de stipulation d’une clause d’inaliénabilité ne sont pas applicables aux personnes morales où aux personnes physiques qui supportent l’obligation de constituer une personne morale.
Cela signifie donc qu’une clause d’inaliénabilité qui présenterait un caractère perpétuel est pleinement valide.
Cette exception au principe posé à l’article 900-1, al. 1er du Code civil était déjà admise par la jurisprudence antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971.
La Chambre civile de la Cour de cassation avait de la sorte admis la validité d’une clause par laquelle le disposant affectait tout ou partie de ses biens à l’établissement d’une fondation présentant un caractère d’utilité générale, en l’occurrence un hôpital communal dont les frais d’entretien seraient assurés par le revenu de fermes déclarées inaliénables (Cass. civ. 1 . 19 oct. 1965).
Aussi, conformément aux termes de l’article 900-1 du Code civil seules les clauses d’inaliénabilité affectant des biens donnés ou légués à der personnes physiques sont assujetties à l’existence de limitation dans le temps.
==> Extension aux contrats à titre onéreux
Alors que l’article 900-1 du Code civil envisage les clauses d’inaliénabilité pour les seules libéralités, la jurisprudence a admis qu’elles puissent être stipulées dans un contrat à titre onéreux.
Dans un arrêt du 31 octobre 2007, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d’inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux » (Cass. 1ère civ. 31 oct. 2007, n°05-14238).
==> Effets de la clause d’inaliénabilité
La stipulation d’une clause d’inaliénabilité produit plusieurs effets. En effet, elle fait obstacle :
- D’une part, à l’aliénation du bien
- D’autre part, à la constitution de sûretés réelles sur le bien, telles qu’une hypothèque, un gage ou encore un nantissement
- Enfin, à la saisie du bien qui est alors isolé du patrimoine du gratifié (V. en ce sens req., 27 juill. 1863).
==> Sanction de la violation de la clause d’inaliénabilité
En cas de violation de la clause d’inaliénabilité, deux sanctions sont encourues par le gratifié :
- La révocation de la libéralité pour ingratitude
- En matière de donation entre vifs, l’article 953 du Code civil prévoit que la donation peut être révoquée « pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.»
- La stipulation d’une clause d’inaliénabilité s’analysant sans aucun doute en une condition d’exécution de la libéralité, la violation de la clause tombe sous le coup de la sanction énoncée par le texte : la révocation
- La jurisprudence exige néanmoins que l’inexécution reprochée au donataire présente une particulière gravité.
- Il est encore exigé que la stipulation de la clause ait été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
- La nullité de la clause d’inaliénabilité
- Très tôt la jurisprudence a amis que la violation de la clause d’inaliénabilité puisse être sanctionnée par la nullité, ce qui emporte réintégration du bien dans le patrimoine de l’auteur de la libéralité (V. en ce sens req., 9 mars 1868)
- La nullité est ici relative, de sorte qu’elle ne peut être invoquée que par la personne dans l’intérêt de laquelle la clause a été stipulée, ce qui pourra varier selon les circonstances.
==> La mainlevée de la clause d’inaliénabilité
L’article 900-1 « le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. »
Il ressort de cette disposition que le bénéficiaire peut être autorisé à solliciter en justice la mainlevée de la clause d’inaliénabilité.
Pour ce faire, il lui faudra remplir deux conditions :
- Première condition : obtention de l’autorisation du juge
- Ainsi que le prévoit l’article 900-1 du Code civil, la mainlevée de la clause d’inaliénabilité ne peut être prononcée que par un juge
- La juridiction compétence sera toujours le juge judiciaire, y compris dans les cas où le bénéficiaire de la libéralité est une personne de droit public (
- Seconde condition : disparition de l’intérêt qui avait justifié la cause ou survenance d’un intérêt plus important
- L’article 900-1 du Code civil conditionne la possibilité de solliciter la mainlevée de la clause d’inaliénabilité :
- Soit à la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause
- Dans cette hypothèse, la cause qui avait justifié la stipulation de la clause d’inaliénabilité a disparu, de sorte qu’elle est devenue sans objet ou n’est plus actuel
- Tel est le cas par exemple, lorsque le bien a été donné à une personne aux fins qu’elle réalise un projet particulier et que sa réalisation devient impossible
- Soit à la survenance d’un intérêt plus important
- Dans cette hypothèse, l’objectif recherché est d’éviter que la clause d’inaliénabilité puisse avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour le bénéficiaire de la libéralité
- Aussi, est-il permis au donataire ou légataire, personne physique, de se faire autoriser par le tribunal à disposer du bien s’il advient qu’un intérêt supérieur l’exige : notamment si le propriétaire ne peut plus entretenir le bien, ou s’il a impérieusement besoin de l’aliéner ou de l’hypothéquer, par exemple pour assurer le logement de sa famille et l’éducation de ses enfants, ou encore pour payer des droits de succession.
- Soit à la disparition de l’intérêt qui avait justifié la clause
- Il peut être observé que dans un arrêt du 23 janvier 2008, la Cour de cassation a exclu la possibilité pour les personnes morales bénéficiaires d’une libéralité de solliciter auprès du juge la mainlevée de clause d’inaliénabilité (V. en ce sens 1ère civ. 23 janv. 2008, n° 16-16120).
- L’alinéa 1er in fine de l’article 900-1 du Code civil ne peut ainsi être invoqué que par les personnes physiques bénéficiaires d’une libéralité
- L’article 900-1 du Code civil conditionne la possibilité de solliciter la mainlevée de la clause d’inaliénabilité :
| Cass. 1ère civ. 23 janv. 2008 |
|---|
| Attendu qu'aux termes de ce texte les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'annulation des constitutions d'hypothèques et des quatre ventes immobilières intervenues du chef de l'association entre 1995 et 1999, le premier arrêt retient que celles-ci avaient permis à l'association de continuer à fonctionner et qu'elles correspondaient à un intérêt plus important que celui pour lequel la clause d'inaliénabilité avait été prévue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; |
==> La prohibition des clauses pénales
Lors de l’adoption de la loi du 3 juillet 1971, s’est posée la question de la validité des clauses pénales par lesquelles un disposant priverait d’une libéralité celui qui attaquerait la validité de tout ou partie de celle-ci.
Manifestement la stipulation d’une telle clause serait de nature à dissuader le bénéficiaire de la libéralité de contester sa validité devant le juge car, s’il triomphe en faisant reconnaître par le juge l’illicéité de la clause d’inaliénabilité, il risque de perdre le bien ayant fait l’objet de la stipulation.
C’est la raison pour laquelle, afin de neutraliser toute velléité de contournement de la loi, a été inséré dans le Code civil un article 900-8 qui prévoit que « est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d’une clause d’inaliénabilité ou demanderait l’autorisation d’aliéner ».
B) L’obligation d’aliénation du bien
==> L’expropriation pour cause d’utilité publique
Si, en certaines circonstances, le propriétaire peut être privé de la faculté d’aliéner sont bien, il est un cas ou, à l’inverse, il peut être contraint de le céder. Cette situation se rencontre en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’article 545 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Cette règle est également énoncée à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (le code civil ayant substitué la cause d’utilité publique à la nécessité publique évoquée par la Déclaration).
Il ressort de ces textes que l’expropriation permet à une personne publique d’acquérir les biens qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions.
La raison en est que l’intérêt public prime sur l’intérêt privé du propriétaire du bien. C’est la raison pour laquelle le droit d’exproprier n’appartient qu’aux collectivités publiques, sous réserve du respect du principe de spécialité.
En pratique, dans l’immense majorité des cas, l’autorité expropriante est une collectivité locale, commune ou département. Il peut être mis en oeuvre par les établissements publics et par certaines personnes privées, concessionnaires qui exercent les droits de leur concédant.
L’objet en est au premier chef la réalisation d’équipements publics, mais aussi des opérations locales d’aménagement et la constitution de réserves foncières.
Il importe de préciser que seuls les immeubles et les droits réels les grevant, peuvent faire l’objet d’une expropriation. Les droits réels tels que l’usufruit peuvent être expropriés, indépendamment de l’immeuble. L’expropriation peut encore atteindre un droit personnel, celui de donner à bail.
==> Procédure
L’article 1 du Code de l’expropriation prévoit que « l’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. »
La procédure d’expropriation vise à déterminer les intérêts en présence et à garantir les intérêts pécuniaires des propriétaires expropriés.
Elle se décompose en deux phases :
- Première phase
- La première phase est administrative et conduit, à la suite d’une enquête, à une déclaration d’utilité publique.
- Le préfet, par l’arrêté de cessibilité, dresse alors la lite des immeubles ou des droits réels immobiliers à exproprier.
- Seconde phase
- Il s’agit d’une phase judiciaire au cours de laquelle est transférée la propriété du bien et fixée l’indemnité due au propriétaire exproprié.
- Mais on doit rappeler que 90 % des biens immobiliers faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique font l’objet d’une cession amiable et ne donnent pas lieu à un transfert de propriété par ordonnance d’expropriation.
L’ordonnance d’expropriation, à défaut d’accord amiable, opère le transfert de propriété et envoie l’expropriant en possession (art. L. 12-1 du code de l’expropriation).
==> Une juste et préalable indemnisation
L’expropriation fait naître un droit à indemnité au profit du propriétaire de l’immeuble et de tous les titulaires d’un droit réel ou personnel portant sur l’immeuble.
L’indemnité doit être juste, c’est-à-dire qu’elle doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la privation du droit de propriété (art. L. 13-13 du code de l’expropriation).
Son montant est fixé par rapport à la consistance du bien au jour de l’ordonnance portant transfert de propriété, c’est-à-dire en fonction de la valeur réelle du bien exproprié (CEDH, 11 avril 2002, Lallemant c. France).
[1] H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, Paris 1955, t.1, p. 253, n°228.
[2] M. Guérin et E. De Roux, “Pour le photographe, la rue n’est plus libre de droits”, Le Monde 27 mars 1999, p. 29 et M. Huet, Droit de l’architecture, Economica, 2001 3ème éd. p. 267.