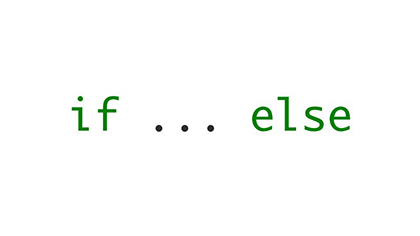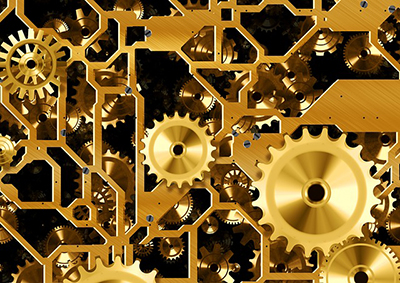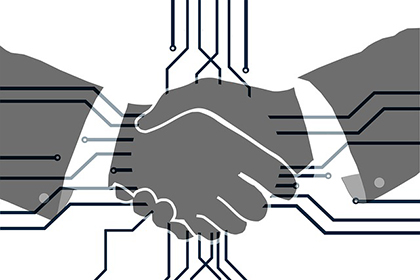?Notion
Conformément au principe de l’autonomie de la volonté, seules les personnes qui ont exprimé leur consentement sont susceptibles de s’obliger.
Lorsque dès lors, l’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », on peut en déduire que la loi contractuelle n’est applicable qu’aux seules parties.
Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a entendu poser ce principe à l’article 1199, al.1er qui désormais dispose : « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. »
A contrario, cela signifie que l’acte ne saurait créer aucune obligation à la charge des tiers. C’est ce qui est exprimé au second alinéa de l’article 1199 aux termes duquel « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV ».
Le nouvel article 1199 pose ce que l’on appelle le principe de l’effet relatif du contrat. Antérieurement à la réforme des obligations, ce principe était énoncé à l’article 1165.
Cette disposition prévoyait que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1121 » (stipulation pour autrui).
Ainsi, en 2016, le législateur a-t-il souhaité procéder à un véritable toilettage de ce texte.
La signification du principe demeure la même : nul ne peut devenir créancier ou débiteur d’une obligation s’il n’est pas partie au contrat.
Le principe de l’effet relatif, qui était perçu comme une évidence par les rédacteurs du Code civil dans la lignée de Pothier, n’est autre que la conséquence du principe de l’autonomie de la volonté couplé à la liberté contractuelle.
Le tiers qui, par définition, n’a pas consenti à l’acte ne saurait se voir imposer des obligations ou en bénéficier.
Est-ce à dire que le contrat ne produit aucun effet à l’égard des tiers ? C’est toute la question de son opposabilité.
Nous envisagerons donc dans un premier temps la question de l’effet relatif du contrat après quoi nous nous intéresserons, dans un second temps, à son opposabilité.
I) L’effet relatif du contrat
Si, conformément au principe de l’effet relatif, le contrat ne saurait créer aucune obligation à la charge des tiers, encore faut-il que l’on s’entende sur ce qu’est un tiers.
A priori, il s’agit de toutes les personnes qui n’ont pas exprimé leur volonté de contracter. Pour identifier les tiers, cela suppose dès lors de déterminer quelles sont les parties au contrat.
Quid, néanmoins, de la personne qui, sans avoir consenti à l’acte, qui donc ne peut pas être regardé comme partie au contrat, entretient malgré tout un lien de droit, contractuel, avec l’un des cocontractants ? C’est situation se présentera notamment en présence de groupes de contrats.
A) Principe : les parties au contrat
Doivent donc être considérées comme tiers toutes les personnes qui ne sont pas partie au contrat. La question qui dès lors se pose est de savoir ce que cette catégorie recoupe. Qu’est-ce qu’une partie au contrat ?
Deux catégories de parties doivent être distinguées :
- Les parties originaires
- Les parties subséquentes
1. Les parties originaires
Les parties originaires sont toutes celles qui ont concouru à la formation de l’acte. Autrement dit, il s’agit des personnes qui ont conclu le contrat, soit par elles-mêmes, soit par l’entreprise d’un représentant
1.1 Les personnes qui ont conclu le contrat par elles-mêmes
Les personnes qui ont conclu le contrat par elles-mêmes sont celles qui ont échangé, physiquement ou à distance, leurs consentements.
Cette catégorie de parties n’appelle pas de remarque particulière, sinon que la naissance du contrat procède de l’expression de leurs volontés respectives.
Aussi, ce sont elles qui ont déterminé le contenu du contrat.
1.2 Les personnes qui ont conclu le contrat par l’entremise d’un représentant
Il n’est pas nécessaire d’avoir été personnellement présent lors de la conclusion du contrat. Ce qui importe, c’est que la volonté des parties à l’acte ait été valablement exprimée. Or l’expression de cette volonté peut s’opérer par l’entremise d’un représentant.
Nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016, le législateur a édicté aux articles 1153 à 1161 du Code civil un droit commun de la représentation.
Jusqu’alors, le mécanisme de la représentation était abordé de façon éparse dans le Code civil. Si, la réforme des obligations remédie indubitablement à cette carence pointée par les auteurs, il n’est pas certain que le dispositif ainsi institué résolve toutes les difficultés que soulève la représentation.
Afin de bien comprendre en quoi consiste le mécanisme de représentation il convient, au préalable, de s’arrêter sur la distinction entre la capacité et le pouvoir.
a. Capacité et pouvoir
Il est courant que les notions de représentation, de pouvoir ou encore de capacité soient confondues, sinon mal comprises.
Aussi, convient-il de les distinguer afin d’être en mesure de bien en articuler le sens.
i. La capacité
Elle se définit comme la faculté pour une personne physique à être titulaire de droits et à les exercer
Classiquement on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice :
?La capacité de jouissance
C’est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs (droits réels et personnels)
S’agissant de la capacité de jouissance une nouvelle distinction s’opère entre les personnes physiques et les personnes morales.
- Les personnes physiques
- Elles jouissent toutes, sans exception, d’une capacité de jouissance générale
- Dès lors que le nouveau-né est doté de la personnalité juridique, soit lorsqu’il est vivant et viable, il dispose d’une capacité de jouissance générale, ce jusqu’à sa mort.
- Si, toutefois, les personnes physiques jouissent toutes d’une capacité de jouissance générale, elles peuvent, en certaines circonstances, être frappées d’une incapacité de jouissance spéciale
- C’est le cas du médecin qui ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir de la part de son patient des libéralités
- C’est encore le cas de l’étranger qui est privé du droit de voter
- Il en va également ainsi du mineur de moins de 16 ans à qui il est interdit de tester.
- Les personnes morales
- Elles jouissent seulement d’une capacité de jouissance spéciale
- Leur capacité de jouissance est déterminée par leur objet social, lequel doit être spécial
- Un objet social trop général est réputé inexistant
- La sanction encourue est la nullité de la personne morale.
?La capacité d’exercice
C’est l’aptitude pour une personne physique ou morale à exercer les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance
La capacité d’exercice renvoie à la distinction entre les personnes capables et les personnes incapables :
- Les personnes capables
- Ce sont celles qui jouissent d’une capacité d’exercice générale
- Seules les personnes majeures ou mineurs émancipés jouissent d’une capacité d’exercice générale
- Les personnes incapables
- Les personnes incapables se divisent en deux catégories
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Deux catégories de personnes sont frappées d’une incapacité d’exercice générale
- Les mineurs non émancipés
- Les majeurs sous tutelle
- L’incapacité d’exercice générale ne signifie pas qu’ils ne disposent pas de la faculté à être titulaire de droits
- Tant le mineur, que la personne placée sous tutelles jouissent d’une capacité de jouissance générale.
- Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
- Il leur faut être représentés
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale
- Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice spéciale sont les personnes qui font l’objet :
- Soit d’une sauvegarde de justice
- Soit d’une curatelle
- Soit d’un mandat de protection future
- En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
- Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent se faire représenter.
- L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles dont l’objet.
ii. Le pouvoir
Le pouvoir se définit comme l’aptitude pour celui qui en est investi à représenter une personne
Il s’agit, autrement dit, de la faculté d’agir au nom et pour le compte d’autrui, soit d’être son représentant.
Ainsi, tandis que la capacité correspond à l’aptitude à être titulaire de droits ou à les exercer, le pouvoir est attaché à la notion de représentation.
Le représentant est celui qui a le pouvoir d’exercer les droits dont est titulaire le représenté.
Celui qui est investi d’un pouvoir de représentation ne devient pas titulaire des droits du représenté.
Le représentant est seulement habilité à les exercer, étant précisé que cela n’ôte pas au représenté, sa capacité d’exercice.
Au fond, le pouvoir de représentation est une modalité d’exercice d’un droit.
Il est conféré au représentant, soit par la loi, soit par décision de justice, soit par convention, le pouvoir d’exercer le droit dont est seul titulaire le représenté.
b. La représentation
i. Notion de représentation
La représentation n’est pas définie dans le Code civil. Est-ce un oubli du législateur ? Certainement.
Par chance, sa définition s’infère de son régime juridique.
Par représentant, il faut entendre celui qui agit au nom et pour le compte d’une personne, le représentant.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette définition :
- Premier élément
- Il ne peut être recouru au mécanisme de la représentation que pour l’accomplissement d’actes juridiques
- La représentation ne pourra jamais jouer pour la réalisation de faits juridiques
- Second élément
- La représentation a pour effet de lier juridiquement le représenté à l’acte effectué par le représentant comme s’il l’avait personnellement accompli.
- La représentation est ainsi une fiction juridique, ce qui justifie qu’elle soit strictement encadrée
ii. La source de la représentation
La représentation doit être regardée comme une situation exceptionnelle.
Le principe c’est que chacun s’engage pour lui-même. On ne saurait agir au nom et pour le compte d’autrui par l’effet de sa propre volonté
C’est la raison pour laquelle, la représentation ne se présume pas, à tout le moins les hypothèses où elle se présume sont rares et strictement encadrées.
Aussi, pour qu’une personne puisse représenter quelqu’un, encore faut-il qu’elle en ait le pouvoir.
Or on ne peut se prévaloir du pouvoir de représentation qu’à la condition d’en avoir été investi soit par la loi, soit par décision de justice, soit par convention
La représentation peut, de sorte, avoir trois origines différentes :
?La représentation légale
- Les mineurs
- Les mineurs sont frappés de ce que l’on appelle une incapacité d’exercice générale
- Cela signifie que, s’ils peuvent être titulaires de droits et d’obligations, ils ne disposent pas, en revanche, de la faculté de les exercer.
- Pour accomplir des actes juridiques il est donc nécessaire que le mineur soit représenté
- Ce représentant, désigné par la loi, agira dès lors au nom et pour le compte du mineur jusqu’à sa majorité, événement à compter duquel il jouira de sa pleine de capacité, soit tant de jouissance que d’exercice.
- La représentation du mineur est assurée
- Soit par ses parents
- Soit par un tuteur
- Les personnes morales
- À l’instar des mineurs, les personnes morales sont frappées d’une incapacité d’exercice générale.
- Cette incapacité est permanente dans la mesure où par, par nature, une personne morale est un être fictif de sorte qu’elle ne sera jamais en mesure d’exprimer sa volonté.
- C’est la raison pour laquelle, les personnes morales ne peuvent accomplir des actes juridiques que par l’entremise d’un représentant
- La représentation des personnes morales est assurée par les dirigeants sociaux, lesquels ne doivent pas être confondus avec les associés.
- Les dirigeants sociaux sont investis du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la personne morale
- Les associés sont quant à eux investis du pouvoir, non pas de représenter la personne morale, mais d’exprimer directement sa volonté au moyen de leur droit vote
- Ainsi, tandis que les associés expriment en assemblée la volonté de la personne morale, les dirigeants sociaux représentent cette volonté qui a été exprimée par les associés.
- Selon la forme de la société, le représentant de la société pour être notamment :
- Un gérant
- Un président
- Un directeur général
- Un directeur général délégué
- Un mandataire
?La représentation judiciaire
Elle correspond à l’hypothèse où le pouvoir de représentation est conféré à une personne par le juge.
Cette situation peut intervenir dans plusieurs cas :
- Représentation d’une personne incapable
- Lorsqu’une personne est frappée d’une incapacité d’exercice générale ou spéciale, l’expression de sa volonté ne peut s’opérer que par l’entremise d’un représentant.
- Aussi, concomitamment à l’institution d’une mesure juridique de protection, le juge désignera, selon la mesure choisie (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), un représentant chargé d’agir au nom et pour le compte de la personne protégée.
- La représentation de l’époux hors d’état de manifester sa volonté
- Aux termes de l’article 219 du Code civil « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- Cette disposition vise l’hypothèse où un époux qui, sans être frappé d’incapacité, est inapte à exprimer sa volonté.
- C’est donc son conjoint qui est investi par le juge d’accomplir un certain nombre d’actes déterminés par ce dernier.
- La représentation d’un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté
- L’article 815-4 du Code civil prévoit que « si l’un des indivisaires se trouve hors d’état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- La règle est ici la même que celle énoncée à l’article 219 appliquée aux indivisaires.
- Elle permet ainsi aux coindivisaires de prendre les mesures nécessaires à l’administration du bien indivis.
- La représentation d’une personne présumée absente
- Aux termes de l’article 113 du Code civil « le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l’exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l’administration de ses biens sont alors soumises aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent. »
?La représentation conventionnelle
Le pouvoir de représentation dont est investi un représentant peut lui avoir été conféré au titre d’un contrat
Le pouvoir de représentation sera ainsi le produit d’un accord de volontés
Cette hypothèse correspond à la conclusion d’un contrat de mandat.
L’article 1984 du Code civil prévoit en ce sens que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Ainsi, tous les actes conclus par le mandataire sont réputés avoir été accomplis par le mandant en la personne de qui ils produisent directement leurs effets
Il existe cependant des mandats sans représentation.
Il en va ainsi du contrat conclu avec un intermédiaire, tel un agent d’affaires
L’intermédiaire se distingue du mandant classique, en ce qu’il agira certes pour le compte d’autrui, mais en son nom propre.
Il en résulte qu’il ne disposera pas du pouvoir d’accomplir des actes au nom de son client et donc de le représenter.
La représentation suppose la réunion de deux éléments cumulatifs :
- L’accomplissement d’actes pour le compte d’autrui
- L’accomplissement d’actes au nom d’autrui
Lorsque l’agent d’affaires (courtier, agent immobilier) est mandaté, il agit pour le compte de son client mais pas en son nom, sauf à être investi d’un pouvoir spécial de représentation.
iii. L’étendue de la représentation
Aux termes de l’article 1153 du code civil « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés »
Cela signifie que, quelle que soit la source du pouvoir dont il est investi, le représentant ne pourra jamais engager le représentant au-delà de la limite de ses pouvoirs.
Pour déterminer l’étendue du pouvoir du représenter l’article 1155 du Code civil invite à distinguer deux situations :
- Le pouvoir du représentant est défini en termes généraux
- Dans cette hypothèse le pouvoir de représentation ne couvre que les actes conservatoires et d’administration
- En somme, le représentant ne disposera pas du pouvoir d’accomplir des actes de disposition au nom et pour le compte du représenté
- Le pouvoir du représentant est spécialement déterminé
- Dans cette hypothèse, le représentant ne pourra accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire.
- Le représenté ne sera, en conséquence, engagé que pour les actes accomplis par le représentant en vertu de pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés
iv. Les effets de la représentation
Il ressort de l’article 1154 du Code civil que les effets attachés à la représentation varient, d’une part, selon que la représentation est parfaite ou imparfaite et, d’autre part, selon la source de la représentation
?Les effets tenant à la nature de la représentation
- La représentation parfaite
- La représentation parfaite correspond à l’hypothèse où le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté (art. 1154, al. 1er C. civ.)
- La conséquence en est que le représenté est seul tenu à l’engagement ainsi contracté.
- Autrement dit, il est réputé avoir accompli personnellement l’acte conclu par le représentant.
- Celui qui est considéré comme partie au contrat c’est donc le représenté
- En cas d’inexécution contractuelle, c’est donc la responsabilité de ce dernier qui sera recherché et non celle du représentant qui n’est pas tenu au contrat puisque considéré comme un tiers.
- La représentation imparfaite
- La représentation imparfaite correspond à l’hypothèse où le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom (art. 1154, al. 2e C. civ.)
- La conséquence en est qu’il devient seul engagé à l’égard du cocontractant.
- Celui qui est réputé être partie à l’acte ce n’est donc pas le représenté, comme en matière de représentation parfaite, mais le représentant qui endosse les qualités de créanciers et débiteurs.
- La question qui alors est de savoir dans quelle mesure l’acte accompli par le représentant produit des effets à l’égard du représenté ?
- L’opération se déroule en deux temps :
- Premier temps
- Le représentant agit pour le compte du représenté mais en son nom personnel
- Techniquement, seul le représentant est donc partie à l’acte ainsi conclu
- Le représenté n’a, a priori, pas vocation à l’être car l’opération se joue en deux temps
- Second temps
- Les effets du contrat conclu ne vont être répercutés sur le représenté par l’entremise du représentant en ce que celui-ci va, dans un second temps, lui céder le produit de l’opération
- Cette cession s’opérera le plus souvent moyennant le paiement d’une commission.
- Dans cette hypothèse on parle alors moins de représentant que de commissionnaire, lequel agit en vertu d’un contrat de commission
?Les effets tenant à la source de la représentation
Les effets que l’article 1159 attache à la représentation varient selon que la représentation est d’origine légale ou judiciaire ou selon qu’elle est conventionnelle.
- La représentation légale et judiciaire
- Dans cette hypothèse, l’article 1159 prévoit que le représenté est dessaisit pendant toute la durée de la représentation des pouvoirs transférés au représentant
- Cela signifie que pour tous les droits pour lesquels le représenté est frappé d’une incapacité, il ne peut y avoir d’exercice concurrent.
- Seul le représentant est habilité à accomplir les actes qui relèvent de son pouvoir de représentation.
- Lorsqu’une représentation légale ou judiciaire est instituée, il y a donc un véritable transfert de pouvoir qui s’opère à la faveur du représentant.
- Le représenté est dépouillé de sa faculté à exercer les droits dont il demeure toutefois titulaire
- La représentation conventionnelle
- L’article 1159, al. 2 du Code civil prévoit que « la représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits »
- À la différence de la représentation légale ou judiciaire, la représentation conventionnelle ne fait pas obstacle à un exercice concurrent des droits dont est titulaire le représenté.
- Ce sera notamment le cas lorsque le représentant sera investi d’un mandat non-exclusif.
- Rien n’empêche toutefois qu’il soit convenu avec le représenté que le mandat soit exclusif.
- Dans cette hypothèse, le mandat s’interdit d’exercer les droits qui relèvent du pouvoir du mandataire.
v. Les obstacles à la représentation
Les obstacles à la représentation sont au nombre de deux.
?Premier obstacle : la survenance d’une incapacité du représentant
Aux termes de l’article 1160 du Code civil « les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction ».
Cette disposition n’appelle pas de remarque particulière sinon que l’on peut s’interroger sur la question de savoir s’il est nécessaire de jouir, ab initio, d’une pleine capacité juridique pour représenter une personne.
Le texte est silencieux sur ce point, de sorte qu’il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer.
On peut toutefois relever qu’il n’y, a priori, aucune incompatibilité à ce que, dans le cadre d’une représentation parfaite, le représentant soit frappé d’une incapacité puisque, dans cette hypothèse, il sera un tiers au contrat.
Par conséquent, la validité de l’acte exige la seule capacité du représenté.
D’un autre côté, on peut opposer à cet argument qu’il est intellectuellement difficilement envisageable que celui désigné pour représenter une personne privée de sa capacité soit lui-même frappé d’une incapacité de même nature.
Pourquoi le représentant serait-il plus en capacité un acte pour autrui que pour lui-même ?
Cela n’a pas vraiment de sens, de sorte qu’il n’est pas à exclure que la jurisprudence exige, à l’avenir, que le représentant soit doté, ab initio, de sa pleine capacité juridique.
?Second obstacle : l’existence d’un conflit d’intérêts
- Principe
- L’article 1161 du Code civil prévoit que « un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté. »
- Le principe posé par cette disposition fait indéniablement partie des grandes nouveautés de l’ordonnance du 10 février 2016.
- Pour la première fois, l’interdiction du conflit d’intérêts est instituée en principe général.
- Certains textes avaient déjà posé cette interdiction, telle que notamment le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat.
- La commission Sauvé avait, dans cette perspective, effectué une tentative de définition du conflit d’intérêts dans le domaine public
- Il y était défini comme le « conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent public, dans lequel l’agent public possède à titre privé des intérêts qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités »
- La prohibition du conflit d’intérêts procède de l’idée que lorsqu’une même personne est chargée de représenter ou défendre des intérêts objectivement contradictoires, l’indépendance et l’impartialité que requiert sa mission s’en trouve atteinte
- Il en résulte alors un préjudice potentiel pour le représenté dont les intérêts ne seront pas aussi bien portés que si son représentant n’avait pas été en situation de conflits d’intérêts.
- Aussi, afin d’éviter cette situation, le législateur préfère-t-il poser un principe d’interdiction générale du conflit d’intérêts.
- C’est ce qu’il a fait à l’article 1160 du Code civil.
- Conditions
- La caractérisation d’un conflit d’intérêts suppose d’établir :
- Soit que le représentant a agi pour le compte des deux parties au contrat
- Soit que le représentant a contracté pour son propre compte avec le représenté
- Sanction
- En cas d’établissement d’un conflit d’intérêts, la sanction encourue est la nullité de l’acte
- La nullité est-elle relative ou absolue ? Le texte ne le dit pas.
- Dans la mesure toutefois où l’interdiction du conflit d’intérêts vise à protéger un contractant en particulier, on est légitimement en droit de penser qu’il s’agit d’une nullité relative.
- Elle ne pourra donc être invoquée que pour le contractant qui subit le conflit d’intérêts.
- Tempérament
- L’article 1161, al.2 du Code civil assortit l’interdiction du conflit d’intérêts de deux tempéraments
- La permission de la loi
- La ratification de l’acte par le représenté
vi. La sanction du dépassement et du détournement de pouvoir
Quid de la sanction dans l’hypothèse où le représentant a agi en dépassement de son pouvoir, voire en le détournant ?
Les articles 1156 et 1157 du Code civil invitent à distinguer le défaut ou dépassement de pouvoir de son détournement.
?: La sanction du défaut ou dépassement de pouvoir
?Exposé des sanctions
En cas de défaut ou de dépassement de pouvoir, l’article 1156 du Code civil envisage deux sanctions :
- L’inopposabilité de l’acte
- Principe
- Aux termes de l’article 1156, al. 1er « l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté »
- Par inopposable, il faut entendre que, tout en conservant sa validité, l’acte ne produira aucun effet à l’égard du représentant
- Cela signifie donc, concrètement, qu’il ne pourra pas être considéré comme partie à l’acte.
- En cas d’inexécution du contrat, la responsabilité du représenté ne pourra donc pas être recherchée.
- Seul le représentant qui a agi en dépassement de son pouvoir de représentation sera donc tenu à l’acte.
- Il endossera donc seul la qualité de débiteur ou créancier.
- Exception
- L’article 1156 pose une exception au principe d’inopposabilité de l’acte en cas de défaut ou de dépassement apparent : le mandat apparent
- L’alinéa 1 in fine de cette disposition prévoit, en effet, que si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
- Aussi, dans cette hypothèse l’acte accompli par le représentant, en dépassement de ses pouvoirs, demeura opposable au représenté.
- Le tiers contractant sera alors fondé à exiger de ce dernier qu’il exécute la prestation convenue.
- Le législateur a repris ici la solution dégagée par la Cour de cassation dans son célèbre arrêt d’assemblée plénière rendu en date du 13 décembre 1962 (Cass. ass. plén., 13 déc. 1962, n°57-11.569)
- Dans cette décision, la haute juridiction avait affirmé que « le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs »
- Pour établir l’existence d’un mandat apparent, l’article 1156 ne semble pas exiger, à l’instar de la Cour de cassation, que le représenté ait concouru, de manière fautive, à la croyance légitime du tiers.
- Le mandat apparent suppose seulement qu’existent des circonstances qui aient conduit le tiers contractant à se forger une croyance légitime.
|
Cass. ass. plén., 13 déc. 1962
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que C… président-directeur général de la Banque Canadienne société anonyme, a, sous sa seule signature, souscrit au nom de cette banque, envers l’Administration des Domaines, un cautionnement solidaire d’une société de récupération d’épaves, pour une somme de 700000 francs en mai 1953 ; que ladite administration ayant demandé l’exécution de cette obligation, la banque a soutenu que celle-ci ne lui était pas opposable, en déclarant que ses statuts exigeaient en ce cas la signature de deux mandataires sociaux habilités ;
Attendu que, pour condamner la banque, l’arrêt attaqué énonce qu’en l’espèce, l’Administration a pu légitimement penser qu’elle traitait avec un mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs normaux, et retient que la banque était en conséquence tenue à raison d’un mandat apparent ;
Attendu que, selon le moyen, le mandat apparent suppose une faute imputable au prétendu mandant et se trouvant à la base de l’erreur du tiers ; qu’il prétend que non seulement l’arrêt attaqué ne caractérise pas une telle faute, mais encore que, la nature même de l’engagement impliquant un pouvoir spécial que l’Administration aurait dû exiger, c’est elle qui s’est montrée imprudente en l’occurrence ;
Mais attendu, d’une part, que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Attendu, d’autre part, que le contrôle de l’imprudence alléguée à cet égard en l’espèce à l’encontre de l’Administration des Domaines nécessiterait une recherche d’éléments de fait à laquelle la Cour de Cassation ne peut procéder ;
D’où il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 mai 1957 par la Cour d’appel de Poitiers.
|
- La nullité de l’acte
- L’article 1156, al. 2e prévoit que « lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. »
- Cela signifie donc que le tiers contractant dispose d’un choix
- Soit il opte pour l’inopposabilité de l’acte, car il souhaite que le contrat conclu reçoive une exécution
- Soit il opte pour la nullité de l’acte, car préfère son anéantissement
- Cette option est laissée à la seule discrétion du tiers contractant, lequel a seul qualité à agir en nullité
- Le législateur a ainsi entendu mettre fin à la solution dégagée par la Cour de cassation sur cette question.
- Dans un arrêt du 2 novembre 2005, elle avait en effet estimé que « la nullité d’un contrat en raison de l’absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée » (Cass. 1ère civ. 2 nov. 2005, n°02-14.614).
- L’article 1156 du Code civil prévoit l’exact contraire.
|
Cass. 1ère civ. 2 nov. 2005
Vu l’article 1984 du Code civil ;
Attendu que la nullité d’un contrat en raison de l’absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ;
Attendu que se prévalant d’un contrat collectif de prévoyance souscrit par la société La and company auprès de la Fédération nationale de la mutualité française (la FNMF), M. X…, en sa qualité de bénéficiaire des garanties prévues par le contrat, a assigné la FNMF en paiement des indemnités journalières prévues pour le cas de maladie ; que celle-ci a fait valoir que le contrat d’assurance était nul pour avoir été conclu par M. X…, qui n’avait pas le pouvoir d’engager la société La and company dont il était alors salarié ;
Attendu que l’arrêt attaqué a accueilli cette exception et déclaré “le contrat de nul effet dans les rapports entre la Fédération nationale de la mutualité française et M. X…” ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
|
?La neutralisation des sanctions : la ratification de l’acte
En cas de ratification de l’acte par le représenté, l’article 1156, al. 3 prévoit que, tant l’inopposabilité que la nullité ne peuvent être invoquées.
Ainsi, la ratification vient-elle couvrir l’irrégularité dont l’acte est entaché.
Reste néanmoins à déterminer ce que l’on doit entendre par ratification
La ratification peut-elle s’apparenter à un commencement d’exécution de l’acte ou doit-elle être formalisée ?
Le législateur ne le dit pas.
C’est donc à la jurisprudence qu’il appartient de préciser le régime juridique de la ratification.
?: La sanction du détournement de pouvoir
Aux termes de l’article 1157 du Code civil, « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer. »
Le détournement de pouvoir correspond à l’hypothèse très précise où le représentant a agi dans la limite de ses pouvoirs, mais dans son intérêt personnel alors qu’il est censé agir dans les intérêts du représenté.
L’article 1157 en tire la conséquence logique que, dans la mesure où le représentant, a détourné les pouvoirs qui lui ont été confiés, le représenté est tout naturellement fondé à réclamer la nullité de l’acte.
À la différence du dépassement de pouvoir, le représenté a, dans cette situation, qualité à agir en nullité de l’acte.
Deux conditions cumulatives doivent toutefois être réunies :
- Première condition
- Le représenté doit établir, en cas de détournement de pouvoir, que l’acte a été accompli à son détriment
- Quid lorsque l’acte aura été accompli dans l’intérêt exclusif du représentant ?
- L’acte sera-t-il présumé avoir été nécessairement accompli au détriment du représenté.
- Plus délicate encore sera l’appréhension de l’hypothèse où l’acte aura été accompli au détriment seulement partiel du représenté.
- Seconde condition
- L’exercice par le représenté de l’action en nullité de l’acte accompli à son détriment est subordonné à la connaissance par le tiers, à tout le moins à son absence d’ignorance, du détournement de pouvoir.
- Afin de ne pas s’exposer à une action en nullité, l’article 1158 du Code civil ouvre au tiers contractant une action interrogatoire.
- Cette disposition prévoit en ce sens que :
- En premier lieu, le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
- En second lieu, l’écrit doit mentionner que, à défaut de réponse dans le délai imparti, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.
2. Les parties subséquentes
Il est des cas où certaines personnes qui étaient des tiers au moment de la formation du contrat vont endosser la qualité de partie à l’acte en cours d’exécution.
Au nombre de ces personnes on compte :
?Les ayants cause à titre universel
- Principe
- Toutes les personnes qui ont vocation à recueillir la totalité ou une quote-part d’une succession ont vocation à se substituer au défunt pour devenir partie au contrat.
- L’ouverture d’une succession opère, en effet, transfert de tous les droits réels et personnels dont était titulaire le de cujus vers les ayants cause
- Ces derniers acquièrent alors, tant la titularité des créances que des dettes du de cujus.
- Exception
- Il est certaines hypothèses où les ayants cause à titre universel ne pourraient pas devenir partie au contrat en lieu et plus du contractant défunt.
- Il en va notamment ainsi pour tous les contrats conclus « intuitus personae », soit en considération de la personne du de cujus.
- En cas de décès de l’un des contractants, le contrat devient alors caduc.
?Les sociétés absorbantes ou fusionnantes
Lorsqu’une société fait l’objet de ce que l’on appelle une absorption, cette opération opère une transmission universelle du patrimoine de la société absorbé vers la société absorbante.
L’opération de fusion consiste quant à elle en la création d’une nouvelle personne morale, laquelle a vocation à recueillir à titre universel le patrimoine de sociétés fusionnées.
Manifestement dans ces deux cas, qu’il s’agisse de la société absorbante ou de la personne morale née de la fusion, elles ont vocation à se substituer respectivement à la société absorbée et aux sociétés fusionnées
Par voie de conséquence, elles devraient également endosser la qualité de partie au contrat pour tous ceux conclus par la société absorbée ou les sociétés fusionnées.
La Cour de cassation a eu l’occasion de statuer plusieurs fois en ce sens (V. notamment Cass. com. 25 mai 1987, n°85-94.968 ; Cass. 1ère civ. 4 mars 1981, n°80-14.123).
Même limite que pour les ayants cause à titre universel : cette règle ne vaut qu’à la condition que le contrat qui fait l’objet d’une substitution de parties n’ait pas été conclu intuitus personae (V. en ce sens Cass. com. 3 juin 2007, n°06-18.007).
?Le cessionnaire d’un contrat
Nouveauté de l’ordonnance du 10 février 2016, la cession conventionnelle de contrat est consacrée.
L’article 1216 du Code civil prévoit, en ce sens que « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. »
Ainsi, le cessionnaire devient-il partie au contrat en lieu et place du cédant.
L’article 1216-2 dispose, dans cette perspective, que :
- Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
- Réciproquement, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
Est-ce à dire que le cédant est totalement déchargé de toutes ses obligations ?
En application de l’article 1216-1, cela suppose que le cédé y ait expressément consenti.
À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat.
B) Tempérament : les groupes de contrats
En vertu de l’effet relatif, chaque contrat doit, en principe, être regardé comme autonome de sorte qu’il ne peut produire d’effet sur les autres contrats.
Quid néanmoins, de l’hypothèse où, par exemple, un même bien fait l’objet de plusieurs contrats de vente successifs ? Le vendeur initial doit-il être regardé comme un véritable tiers pour le sous-acquéreur ? Ou peut-on estimer qu’existe un lien contractuel indirect entre eux ?
C’est toute la question de l’application du principe de l’effet relatif dans les groupes de contrats.
Deux groupes de contrats doivent être distingués :
- Les ensembles contractuels
- Ils regroupent des contrats qui concourent à la réalisation d’une même opération
- Les chaînes de contrats
- Elles regroupent des contrats qui portent sur un même objet
1. Les ensembles contractuels
Les ensembles contractuels se rencontrent lorsqu’une opération économique suppose, pour sa réalisation, la conclusion de plusieurs contrats.

La question qui alors se pose est de savoir si l’anéantissement de l’un des contrats est susceptible d’affecter l’existence des autres contrats ?
Schématiquement, deux approches peuvent être envisagées :
- L’approche stricte
- Au nom d’une application stricte du principe de l’effet relatif, chaque contrat de l’ensemble ne devrait produire d’effets qu’à l’égard de ses contractants
- Le sort de chacun des contrats ne devrait, en conséquence, être déterminé que par son propre contenu et non par les exceptions ou causes d’extinction susceptibles d’affecter les autres.
- L’approche souple
- Elle consiste à considérer que de la création d’un ensemble contractuel naît un lien d’indivisibilité entre les contrats, de sorte qu’ils seraient interdépendants
- En raison de cette interdépendance, le sort des uns serait alors lié au sort des autres.
Après s’être arc-boutés sur une position pour le moins orthodoxe pendant des années, les tribunaux ont finalement opté pour l’approche souple. Ce mouvement ne s’est cependant pas opéré sans tâtonnements.
L’ordonnance du 10 février 2016 est venue parachever cette lente évolution jurisprudentielle.
a. L’évolution de la jurisprudence
La position de la jurisprudence sur les ensembles contractuels a radicalement changé après l’adoption de la loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit.
a.1 La rigueur de la position retenue par la jurisprudence avant la loi du 10 janvier 1978
Pendant longtemps, la jurisprudence a refusé de reconnaître l’existence d’un lien d’indivisibilité entre contrats conclus en vue de la réalisation d’une même opération économique.
Pour la Cour de cassation, dès lors qu’un contrat a été conclu distinctement d’un ou plusieurs autres actes, il jouit, en application du principe de l’effet relatif, d’une autonomie propre. Son sort ne saurait, en conséquence, être lié à d’autres contrats, nonobstant leur appartenance respective à un même ensemble contractuel.
La cour de cassation a notamment fait application de cette position dans un arrêt du 21 mars 1972 (Cass. com. 21 mars 1972, n°70-12.836)
Dans cette décision elle a estimé que la nullité de deux contrats de vente conclus par une société qui souhaitait acquérir des semi-remorques était insusceptible de fonder l’anéantissement du contrat de prêt, souscrit corrélativement par l’acheteur pour financer l’opération.
Pour la chambre commerciale, quand bien même l’annulation du contrat principal faisait perdre au contrat de financement toute son utilité, cela était sans effet sur sa validité, de sorte qu’il devait, malgré tout, être maintenu.
Pour que l’interdépendance entre ces deux contrats soit admise, cela supposait donc que les parties aient expressément stipulé, dans le contrat de prêt, que l’emprunt était destiné à financer l’opération principale.
|
Cass. com. 21 mars 1972
Sur le premier moyen : attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaque, la société Venassier passa commande a x… de deux semi-remorques à construire à partir de châssis nus ;
Que ladite société sollicita deux prêts, que lui accorda la société crédit industriel et financier (CIFA) pour financer ces deux acquisitions ;
Que le CIFA remit le montant de ces prêts, non pas au vendeur, mais a l’acquéreur, société Venassier ;
Que celle-ci fut peu après déclarée en état de règlement judiciaire ;
Que x…, n’ayant jamais reçu de quiconque le prix des deux semi-remorques vendues, ne les livra pas ;
Attendu qu’il est reproche à la cour d’appel d’avoir refusé de déclarer nuls les gages pris par le CIFA sur les véhicules, et d’avoir condamne x… a remettre ceux-ci à cet établissement financier qui se les verrait attribuer, dans la limite de ses créances, après évaluation a dire d’expert, sans répondre, selon le pourvoi, aux conclusions dudit x… faisant valoir que les ventes des deux véhicules et les contrats de financement les concernant étaient atteints de nullité d’ordre public pour avoir été conclus en infraction aux dispositions de la législation sur les ventes a crédit relatives à la délivrance par le vendeur a l’acquéreur d’une attestation conforme a la réglementation en vigueur ;
Mais attendu qu’après avoir, a bon droit, énonce que le contrat de prêt en vue de financer l’acquisition d’un véhicule automobile est distinct du contrat de vente, la cour d’appel, qui a considéré qu’en l’espèce le CIFA avait ignoré la nullité des ventes alléguées par x…, a déclaré que ce dernier était d’autant moins fondé dans ses prétentions que le CIFA n’avait pu inscrire son gage que grâce aux documents régulièrement établis et transmis par lui ;
Qu’ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tire de l’absence de sanction civile frappant l’infraction aux règles concernant le plafond des prêts dans les ventes a crédit, l’arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
|
Jugeant la jurisprudence de la Cour de cassation dangereuse, le législateur est intervenu le 10 janvier 1978 pour y mettre un terme.
Pour ce faire, il a institué à l’ancien article L. 311-20, devenu L. 312-48 du Code de la consommation, la règle selon laquelle les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution complète de la fourniture de biens ou services convenue au titre d’un contrat principal.
La portée de cette règle était, cependant, pour le moins restreinte. Elle n’avait été envisagée que pour les seuls crédits à la consommation.
Très vite les juridictions ont toutefois cherché à s’émanciper de cette restriction en faisait application du concept d’interdépendance contractuelle au-delà de la sphère du droit de la consommation.
a.2 L’assouplissement de la position retenue par la jurisprudence après la loi du 10 janvier 1978
Après l’adoption de la loi du 10 janvier 1978, les tribunaux se sont donc mis en quête d’une solution juridique pour lier le sort de plusieurs contrats distincts conclus en vue de la réalisation d’une même opération économique.
La première chose qui leur fallait trouver pour y parvenir était un fondement juridique sur lequel asseoir le concept d’indivisibilité contractuelle.
Dans le même temps la question des critères et des effets de l’indivisibilité s’est posé au juge, ce qui a donné lieu à de nombreuses hésitations jurisprudentielles.
i. La recherche d’un fondement au concept d’indivisibilité contractuelle
Aux fins de justifier l’existence d’une indivisibilité ou interdépendance entre plusieurs contrats ayant concouru à la réalisation d’une même opération, plusieurs fondements juridiques ont été envisagés par la Cour de cassation.
?La règle de l’accessoire
- Exposé du fondement
- Selon l’adage latin accessorium sequitur principal, devenu principe général du droit, l’accessoire suit le principal.
- Cela signifie que l’on va regrouper différents actes ou faits juridiques autour d’un principal en leur appliquant à tous les régimes juridiques applicables à l’élément prépondérant.
- Appliquée à des contrats interdépendants, cette règle permet de considérer que dans l’hypothèse où le contrat principal disparaîtrait, il s’ensuit un anéantissement des contrats conclus à titre accessoire
- Tel est le fondement qui a été retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril. 1987 (Cass. com. 7 avr. 1987, n°84-16.254).
- Critique du fondement
- L’inconvénient de la règle de l’accessoire est qu’elle ne permet de rendre compte de la notion d’indivisibilité que pour moitié
- L’indivisibilité suggère, en effet, que le lien d’interdépendance qui unit plusieurs contrats est à double sens, soit qu’existe une certaine réciprocité entre contrats quant aux effets qu’ils produisent les uns sur les autres
- La règle de l’accessoire ne permet pas d’envisager cette réciprocité.
- L’anéantissement de l’un des contrats n’est susceptible de se répercuter sur les autres qu’à la condition que le fait générateur de cet anéantissement réside dans le contrat principal.
- Dans l’hypothèse où c’est un contrat accessoire qui serait touché en premier, cela serait sans effet sur le contrat principal.
- Ainsi, la règle de l’accessoire est-elle à sens unique.
- Sans doute est-ce la raison pour laquelle cette règle n’a pas été retenue par la jurisprudence comme fondement de la notion d’indivisibilité.
|
Cass. com. 7 avr. 1987
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1984) que l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a été admis au passif du règlement judiciaire de la société Compagnie de navigation fruitière et de la Société navale de transports de conteneurs, converti ensuite en liquidation des biens, pour une somme de 4 198 680,12 francs au titre du privilège spécial sur les navires prévus par l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967, en raison des cotisations qui lui restaient dues, que la société Scheepshypotheebank et la société nationale Nederlanden Scheepshypotheebank (les banques), créancières des deux sociétés en liquidation des biens, ont formé une réclamation en contestant le privilège de l’ENIM ;
Attendu que les banques font grief à l’arrêt d’avoir déclaré que les créances de cotisations sociales de l’ENIM sont privilégiées par application de l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 alors, selon le pourvoi, que, d’une part, il résulte des dispositions conjuguées des articles 31-3° et 36 de la loi du 3 janvier 1967, et les privilèges étant de droit étroit, que l’ENIM ne saurait invoquer le privilège défini par l’article 31-3° de la loi, violé par conséquent par la cour d’appel ; alors que, d’autre part, si l’ENIM pouvait invoquer ce privilège, celui-ci ne pourrait jouer pour les cotisations de la Caisse de prévoyance, la cour d’appel n’ayant pu dire le contraire sans violer l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 et l’article 41 du décret n° 68-292 du 21 mars 1968 ;
Mais attendu que c’est à bon droit que l’arrêt déclare qu’il existe entre le contrat d’engagement et les cotisations sociales un rapport étroit et nécessaire de cause à effet tel que ces cotisations, comme les autres créances résultant du contrat d’engagement, bénéficient du privilège établi par les dispositions de l’article 31-3° de la loi du 3 janvier 1967 ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
?La notion de condition
- Exposé du fondement
- Dans des arrêts Sedri du 4 avril 1995, la Cour de cassation a justifié l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats en considérant qu’ils constituaient les uns pour les autres « une condition de leur existence » (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 et 93-15.671).
- Autrement dit, l’efficacité de chaque contrat serait subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive laquelle consisterait en l’exécution complète des autres actes.
- Critique du fondement
- La principale critique que l’on peut formuler à l’encontre de ce fondement est que, là encore, la notion de condition ne permet pas de rendre compte du lien d’indivisibilité qui se noue entre contrats interdépendants.
- Conformément à l’article 1304 du Code civil « l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain »
- Selon cette définition, la condition s’apparente donc à un événement extérieur au contrat.
- Tel n’est cependant pas le cas de l’indivisibilité qui consiste toujours en un lien qui unit plusieurs actes.
- Or, l’existence de ce lien procède de leurs contenus respectifs et non de la réalisation d’un événement qui leur serait extérieur.
- Au surplus, tandis que l’absence de réalisation d’une condition affecte seulement la formation du contrat, l’établissement d’une indivisibilité lie le sort des contrats, tant au niveau de leur formation qu’au niveau de leur exécution.
- Pour toutes ces raisons, les notions de condition et d’indivisibilité ne se confondent pas.
?La notion d’obligation indivisible
- Exposé du fondement
- Dans certaines décisions, la Cour de cassation a cherché à justifier l’existence d’une indivisibilité contractuelle en se fondant sur la notion d’obligation indivisible.
- La Cour de cassation s’est notamment prononcée en ce sens dans un arrêt du 13 mars 2008 où elle vise expressément l’ancien article 1218 du Code civil, siège de l’obligation indivisible (Cass. 1ère civ. 13 mars 2008, n°06-19.339).
- Critique du fondement
- L’inconvénient du choix de ce fondement est qu’il repose sur une confusion entre les notions d’obligation indivisible et d’indivisibilité contractuelle
- L’obligation indivisible est celle qui comporte plusieurs débiteurs ou créanciers.
- L’indivisibilité contractuelle consiste, quant à elle, en l’existence de liens qui créent une interdépendance entre plusieurs contrats
- La notion d’obligation indivisible apparait de la sorte inadéquate pour rendre compte du phénomène de l’indivisibilité contractuelle.
?La notion de cause
- Exposé du fondement
- Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a fondé l’existence d’une invisibilité sur la notion de cause.
- Pour ce faire, elle a estimé que la cause d’un contrat appartenant à un ensemble contractuel résidait dans la conclusion des autres contrats auquel il était lié.
- L’anéantissement de d’un acte de l’ensemble emporterait dès lors disparition de la cause des autres et réciproquement.
- Telle a notamment été la solution retenue par la troisième chambre civile qui, dans un arrêt du 3 mars 1993, a approuvé une Cour d’appel pour avoir décidé que « la vente du terrain sur lequel était bâtie l’usine, pour le prix d’un franc, était une condition de réalisation de l’opération, cette vente ne pouvant être dissociée de celle des bâtiments et de la reprise des dettes de la société X… par la société Cerinco, l’ensemble concernant la vente de l’entreprise de briqueterie formant un tout indivisible, et que cette vente permettant l’apurement des dettes et la poursuite de l’activité, M. X… avait grand intérêt à sa réalisation, tant à titre personnel pour éviter les poursuites de ses créanciers, qu’à titre d’actionnaire de la société X… dont il détenait avec son épouse près de la moitié des parts sociales, la cour d’appel a pu en déduire que dans le cadre de l’économie générale du contrat, la vente du terrain était causée et avait une contrepartie réelle » (Cass. 3e cvi. 3 mars 1993, n°91-15.613)
- Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 1er juillet 1997 où la Cour de cassation valide l’anéantissement en cascade de deux contrats, après avoir relevé que « les deux actes de vente et de prêt, qui avaient été passés le même jour par-devant le même notaire, étaient intimement liés, et en a déduit que les parties avaient entendu subordonner l’existence du prêt à la réalisation de la vente en vue de laquelle il avait été conclu, de sorte que les deux contrats répondaient à une cause unique » (Cass. 1ère civ. 1er juill. 1997, n°95-15.642)
- Plus récemment, la Cour de cassation a, dans une décision du 15 février 2000, jugé s’agissant d’une opération de crédit-bail que « le crédit-bailleur était informé que le matériel pris à bail était destiné à être exploité par la société de publicité, qu’en tant que de besoin le crédit-bailleur autorisait cette exploitation, qu’il s’agissait d’un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de crédit-bail était constituée par le contrat de prestations d’images, ce dont il déduit que les deux contrats étaient interdépendants et, par suite, que l’exploitation devenant impossible du fait de la défaillance de la société de publicité, la résiliation du contrat de crédit-bail devait être prononcée » (Cass. com. 25 févr. 2000, n°97-19.793).
- Critique du fondement
- Le recours à la notion de cause pour justifier l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats n’a pas fait l’unanimité en doctrine.
- Le principal reproche formulé à l’encontre de cette solution consiste à dire que la cause, au sens de l’ancien article 1131 du Code civil, doit être entendue objectivement.
- Selon cette approche, la cause représente les motifs les plus proches qui ont animé les parties au moment de la formation du contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle elles se sont engagées
- Aussi, cette conception est-elle incompatible avec la notion de d’indivisibilité.
- La justification de l’existence d’une indivisibilité contractuelle au moyen de la notion de cause supposerait en effet que l’on admette qu’elle puisse être recherchée dans des motifs extrinsèques à l’acte : la conclusion d’un second contrat.
- Selon l’approche objective, la cause de l’engagement des parties réside toutefois dans un élément qui doit nécessairement avoir été intégré dans le champ contractuel.
- D’où la réticence de certains auteurs à fonder l’anéantissement en cascade de contrats qui appartiennent à un même ensemble sur la notion de cause.
ii. La recherche des critères du concept d’indivisibilité contractuelle
?Exposé des approches objectives et subjectives
Deux approches de la notion d’indivisibilité ont été envisagées par la jurisprudence : l’une objective, l’autre subjective :
- L’approche subjective
- Selon cette approche, l’indivisibilité contractuelle trouverait sa source dans la seule volonté des parties.
- Cela signifie que pour établir l’existence d’une invisibilité entre plusieurs contrats, cela suppose de déterminer si les contractants ont voulu cette indivisibilité.
- Si tel n’est pas le cas, quand bien même les contrats en cause auraient concouru à la réalisation d’une même opération économique, ils ne pourront pas être regardés comme formant un ensemble contractuel indivisible.
- L’approche objective
- Selon cette approche, l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats doit être appréciée, non pas au regard de la volonté des parties, mais en considération de la convergence de l’objet de chaque contrat
- Autrement dit, peu importe que les contractants n’aient pas voulu rendre les contrats auxquels ils sont partie interdépendants.
- L’indivisibilité desdits contrats est établie dès lors qu’ils participent à la réalisation d’une même opération économique.
?L’absence de position arrêtée de la jurisprudence
L’incertitude quant à l’adoption de l’approche subjective ou objective de l’indivisibilité résulte des arrêts Sedri rendu, le même jour, soit le 4 avril 1995 par la chambre commerciale.
- Premier arrêt Sedri
- Dans ce premier arrêt, la Cour de cassation approuve une Cour d’appel pour avoir « fondé sa décision relative à l’indivisibilité des conventions sur la considération de chacune d’entre elles par les parties comme une condition de l’existence des autres et non pas sur la nature spécifique de l’objet loué par rapport aux utilisations envisagées » (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-14.585 et n° 93-15.671).
- Ainsi, la haute juridiction retient-elle une approche subjective de la notion d’indivisibilité.
- Elle s’attache à rechercher l’intention des parties, lesquelles avait, en l’espèce, voulu rendre les contrats indivisibles.
- Second arrêt Sedri
- Dans cette décision, bien que rendue le même jour que le précédent arrêt, la Cour de cassation adopte une approche radicalement différente de la notion d’indivisibilité.
- Elle approuve une Cour d’appel pour avoir déduit l’existence d’une indivisibilité entre plusieurs contrats après avoir seulement relevé que « les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d’autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication » (Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029).
- Ainsi, pour la Cour de cassation, c’est parce que les contrats concourraient à la réalisation d’une même opération économique qu’ils devaient être regardés comme indivisibles.
- La haute juridiction ne semble pas vouloir faire, en l’espèce, de la volonté des parties le critère de l’indivisibilité.
- Seule importe l’économie générale de l’ensemble contractuel soumis à son examen.
|
Cass. com., 4 avr. 1995, n° 93-20.029
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993), que M. X… a conclu avec la société V Conseil application (société V Conseil) un contrat lui donnant accès, par l’intermédiaire d’un matériel et d’un logiciel spécifiques, au réseau télématique de la Société d’études, de développements et de recherches industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d’images d’information et de publicité dans son magasin ; que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, M. X… a souscrit un projet de contrat de location auprès de la Compagnie générale de location (société CGL), laquelle a ensuite donné son acceptation, avec la garantie d’une assurance à la charge de la société Sedri pour le cas de dommages au matériel ou d’interruption dans le paiement des loyers par le locataire ; que la prise en charge des loyers par la société Sedri a été proposée à M. X… en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires le concernant ; qu’en août et septembre 1990, la société Sedri, la société V Conseil et la compagnie d’assurances garantissant la société CGL ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés ; que la société CGL a réclamé à M. X… la poursuite du règlement des loyers ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, chacun étant pris en ses deux branches :
Attendu que la société CGL fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel, alors, selon le pourvoi, d’une part, que, devant la cour d’appel, le commerçant invoquait une indivisibilité objective liant le contrat de location du matériel télématique conclu entre la CGL et le commerçant, et le contrat d’adhésion souscrit par le commerçant auprès du centre serveur Sedri ; que la CGL, à l’inverse, faisait valoir l’absence de lien entre ces contrats ; qu’après avoir relevé qu’il n’existait pas d’indivisibilité subjective entre ces contrats, la cour d’appel a jugé qu’il existait en revanche, entre ceux-ci, des liens tels que la résiliation de l’un entraînait la résiliation de l’autre ; qu’en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ces deux contrats auraient été liés par l’identité de leur objet ou par un rapport de dépendance juridique nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, et 1184 du Code civil ; alors, d’autre part, qu’elle a, ainsi, également privé sa décision de base légale au regard de l’article 1165 du Code civil ; alors, en outre, que l’obligation d’assurer la maintenance incombait non pas au loueur mais au locataire ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu’en toute hypothèse, l’obligation de maintenance porte sur l’entretien du matériel loué et non sur la fourniture des images délivrées par le centre serveur ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les matériels et logiciels ne pouvaient avoir, sans modifications substantielles, d’autre usage que la communication par le réseau Sedri, que cette spécificité était connue de la société bailleresse et que celle-ci avait participé à l’élaboration de l’ensemble complexe ayant pour objet la mise en place et le financement du système de communication ; qu’en déduisant de ces constatations l’indivisibilité entre les contrats souscrits par M. X… tant avec la société V Conseil et la société Sedri qu’avec la société CGL, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs critiqués par le second moyen qui sont surabondants ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
|
Après les arrêts Sedri, l’incertitude quant à au critère de l’indivisibilité était de mise : quelle conception devait-on retenir ?
?L’adoption de l’approche objective
Dans une décision du 13 février 2007, la Cour de cassation a, par exemple, approuvé une Cour d’appel pour avoir décidé que « les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l’acquisition de ces licences par la société Faurecia n’ayant aucune raison d’être si le contrat de mise en œuvre n’était pas exécuté, la cour d’appel n’avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés » (Cass. com. 13 févr. 2007, n°05-17.407).
Dans un arrêt du 15 février 2015, la Cour de cassation a semblé abonder dans le même sens en décidant qu’une clause de divisibilité des contrats devait être réputée non-écrite, dès lors qu’elle contrevenait à l’économie générale du contrat (Cass. com., 15 févr. 2000, n°97-19.793).
Dans cette décision, la chambre commerciale fait ainsi primer, l’existence d’une interdépendance objective des actes en cause sur la volonté des parties.
On en a alors déduit que les contractants ne pouvaient pas écarter l’indivisibilité contractuelle par le jeu de leur seule volonté.
Cette solution a été réitérée par la chambre commerciale à plusieurs reprises.
Dans un arrêt du 23 octobre 2007 elle reproche encore à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « s’il existait une indivisibilité entre les contrats de location et les contrats de prestation de services, au regard de l’économie générale de l’opération pour laquelle ces deux contrats avaient été conclus et si, en conséquence, le texte de la clause n’était pas en contradiction avec la finalité de cette opération, telle que résultant de la commune intention des parties » (Cass. com., 23 oct. 2007, n°06-19.976).
|
Cass. com., 13 févr. 2007
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Faurecia sièges d’automobiles (la société Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhaité en 1997 déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseillée par la société Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu’un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont été conclus le 29 mai 1998 entre les sociétés Faurecia et Oracle, tandis qu’un contrat de mise en oeuvre du “programme Oracle applications” a été signé courant juillet 1998 entre les sociétés Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu’en attendant, les sites ibériques de la société Faurecia ayant besoin d’un changement de logiciel pour passer l’an 2000, une solution provisoire a été installée ; qu’aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficultés et que la version V 12 ne lui était pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances ; qu’assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ces redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière et la société Deloitte aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l’ensemble des contrats signés par les parties ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Oracle :
Attendu que la société Oracle fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résolution partielle du contrat de licences et la résiliation du contrat de formation en date du 29 mai 1998 aux torts de la société Oracle, constaté la résiliation des contrats de maintenance et de mise en oeuvre, et condamné en conséquence la société Oracle, d’une part, à garantir la société Faurecia de la condamnation de cette dernière à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 1er mars 2002, d’autre part, à payer à la société Franfinance la somme de 3 381 566,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2001 et capitalisation des intérêts échus à compter du 11 janvier 2005, alors, selon le moyen : […]
Mais attendu qu’ayant retenu que les quatre contrats litigieux étaient interdépendants, dans la mesure où ils poursuivaient tous le même but et n’avaient aucun sens indépendamment les uns des autres, les prestations de maintenance et de formation ne se concevant pas sans les licences sur lesquelles elles portaient et l’acquisition de ces licences par la société Faurecia n’ayant aucune raison d’être si le contrat de mise en oeuvre n’était pas exécuté, la cour d’appel n’avait pas à relever que la société Oracle en était informée, dès lors que cette société avait elle-même conclu les quatre contrats concernés ; qu’ainsi l’arrêt n’encourt aucun des griefs formulés au moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ;
|
?L’adoption de l’approche subjective
À l’inverse des décisions précédemment évoquées, dans un arrêt remarqué du 28 octobre 2010, la première chambre civile a approuvé une Cour d’appel pour avoir refusé de retenir l’existence d’une indivisibilité contractuelle après avoir relevé que « la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre » (Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2010, n°09-68.014).
|
Cass. civ. 1ère, 28 oct. 2010
Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat du 27 décembre 2001, Mme X… a commandé à la société Génération Online un produit appelé « Net in Pack », comprenant, pendant une durée de 36 mois, la création d’un site internet marchand, du matériel informatique, des services internet et des services d’assistance téléphonique et de maintenance de ce matériel dont le financement a été assuré par la souscription auprès de la société Factobail, le 7 janvier 2002, d’un contrat de location financière d’une durée de 36 mois stipulant un loyer mensuel de 196, 64 euros ; qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la société Génération Online, prononcée par jugement du 18 juin 2002, cette société a cessé d’exécuter ses obligations ; que Mme X… a alors interrompu le paiement des mensualités du contrat de location financière ; que la société Factobail l’a assignée en paiement des sommes dues jusqu’au terme de ce contrat et que Mme X… a reconventionnellement sollicité l’annulation du contrat pour absence de cause, à défaut la constatation de sa caducité du fait de la liquidation judiciaire de la société Génération Online et de l’indivisibilité de ces deux contrats ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), d’avoir accueilli la demande de la société Factobail et rejeté la sienne, alors, selon le moyen : […]
Mais attendu que la cour d’appel a constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l’encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l’immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n’entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité ; qu’elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre ; qu’aucun des griefs n’est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
Comment interpréter cette fluctuation de la position de la Cour de cassation ?
Tandis que la doctrine est pendant longtemps est demeurée partagée pendant longtemps sur cette question, ce n’est que tardivement que la Cour de cassation a finalement décidé de trancher la question.
?L’interprétation doctrinale des tergiversations de la Cour de cassation
- Pour certains auteurs, la position de la Cour de cassation serait assise sur la distinction entre :
- D’une part,
- Les contrats qui n’auraient pas de fonction économique propre lorsqu’ils sont envisagés séparément.
- Dans cette hypothèse, c’est la conception objective qui primerait.
- D’autre part,
- Les contrats qui rempliraient une fonction économique propre, en ce sens que, quand bien même ils seraient conclus seuls, leur exécution serait pourvue d’une utilité économique.
- Pour d’autres d’auteurs, l’absence de position bien arrêtée de la Cour de cassation sur la question du critère de la notion d’indivisibilité résulterait d’une divergence entre :
- La première chambre civile : favorable à l’approche subjective
- La chambre commerciale : partisane de l’approche objective
C’est dans ce contexte que, réunie en chambre mixte, la Cour de cassation a rendu simultanément deux arrêts en date du 17 mai 2013.
?La clarification de la position de la Cour de cassation
Deux interventions ont été nécessaires à la Cour de cassation pour clarifier sa position sur l’approche à adopter s’agissant de la notion d’indivisibilité.
- Première intervention : les arrêts du 17 mai 2013
- Dans deux décisions rendues le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a estimé que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » de sorte que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » (Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768)
- Ces deux arrêts ont été accompagnés par un communiqué de presse par lequel la Cour de cassation explique :
- Tout d’abord, que les deux espèces soumises portent chacune sur un ensemble de contrats comprenant un contrat de référence assorti d’un contrat de location financière nécessaire à son exécution :
- dans un cas, le contrat de référence était une convention de partenariat pour des diffusions publicitaires
- dans l’autre cas, le contrat de référence était un contrat de télésauvegarde informatique
- Ensuite, que dans chaque espèce, un cocontractant unique, pivot de l’opération, s’est engagé avec deux opérateurs distincts : le prestataire de service, d’une part, le bailleur financier, d’autre part de sorte que, à chaque fois, le contrat principal a été anéanti.
- Dans la première affaire, la cour d’appel de Paris, retenant l’interdépendance des contrats, a écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties et a prononcé la résiliation du contrat de location.
- Dans la seconde affaire, la cour d’appel de Lyon, statuant comme cour de renvoi après une première cassation, a écarté, au contraire, l’interdépendance des conventions.
- La Cour de cassation vient ici préciser les éléments caractérisant l’interdépendance contractuelle, en qualifiant d’interdépendants, qualification soumise à son contrôle, les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière.
- Aussi, s’inspirant de la jurisprudence de la chambre commerciale, elle juge que sont réputées non écrites les clauses de divisibilité contractuelle inconciliables avec cette interdépendance.
- La chambre mixte rejette en conséquence le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon.
- Il peut être observé que, si ces deux arrêts retiennent indubitablement une approche objective de la notion d’indivisibilité, leur portée doit être tempérée par la précision « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière »
- Ainsi, la Cour de cassation invite-t-elle à cantonner cette solution aux seuls ensembles contractuels au sein desquels figure un contrat de location financière.
- Dans les autres cas, la volonté des parties semble prévaloir sur l’économie générale du contrat.
|
Cass. ch. Mixte, 17 mai 2013
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que deux conventions de partenariat ont été signées, les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, entre la société Bar le Paris et la société Media vitrine, aux termes desquelles la seconde s’est engagée, d’une part, à installer chez la première un “réseau global de communication interactive”, par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo “avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique”, contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble, d’autre part, à lui verser une redevance de 900 euros hors taxes par mois, pendant une durée de quarante huit mois, la société Bar le Paris s’obligeant à garantir à la société Media vitrine l’exclusivité de l’exploitation du partenariat publicitaire, que, les 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005, la société Leaseo, qui avait acquis de la société Cybervitrine le matériel nécessaire, a consenti à la société Bar le Paris la location de ce matériel, avec effet au 1er janvier 2005, pour une durée identique et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 000 euros hors taxes, que, le 5 janvier 2005, la société Leaseo a cédé le matériel à la société Siemens lease services, qui a apposé sa signature sur le contrat de location en qualité de bailleur substitué, que le système n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante, que la société Siemens lease services a mis en demeure la société Bar le Paris de lui régler les loyers impayés, puis lui a notifié la résiliation du contrat faute de règlement des arriérés s’élevant à 10 166,60 euros et l’a assignée en paiement, que la société Bar le Paris a appelé en intervention forcée la société Cybervitrine et la société Techni force, anciennement dénommée la société Media vitrine, que la société Techni force et la société Cybervitrine ont été mises en liquidation judiciaire ;
Attendu que la société Siemens lease services fait grief à l’arrêt de prononcer, avec effet au 17 janvier 2007, la résiliation du contrat de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, ainsi que la résiliation du contrat de location, de condamner la société Bar le Paris à lui payer la somme de 3 588 euros, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’hormis le cas où la loi le prévoit, il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée ; qu’en énonçant, à partir des éléments qu’elle énumère, que le contrat de location des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005 est indivisible du contrat de partenariat des 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est « indépendant » du contrat de prestation de services (partenariat), la cour d’appel, qui refuse expressément d’appliquer cette clause et qui, par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ;
Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
- Seconde intervention : les arrêts du 10 septembre 2015
- Dans deux arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a précisé sa position en s’appuyant, tant sur l’économie générale de l’opération que sur la volonté des parties
- Dans le premier arrêt, elle a ainsi estimé que dans la mesure où « l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil » (Cass. 1ère civ.10 sept. 2015, n° 14-13.658)
- Dans le second arrêt, la première chambre civile approuve la Cour d’appel pour avoir retenu l’existence d’une indivisibilité contractuelle après avoir constaté « d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur » (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772).
- Ainsi, la Cour de cassation combine-t-elle dans ces deux décisions les approches objectives et subjectives de l’indivisibilité de qui témoigne de sa volonté d’adopter une approche mixte de la notion.
- Non sans hasard, la lecture de l’ordonnance du 10 février 2016 nous révèle que c’est précisément cette approche de la notion d’indivisibilité qui a été retenue par le législateur.
|
Cass. 1ère civ.10 sept. 2015, n° 14-13.658
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux X… qui avaient fait l’acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d’un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n’avait été ni intégralement livré ni installé ;
Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que le prêteur fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux X… les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l’accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l’opération de crédit dépassait 21 500 euros ;
Mais attendu qu’ayant constaté que l’offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l’article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ; […]
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
|
Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2007, la société Financo (la banque) a consenti à M. et Mme X…un prêt d’un montant de 32 000 euros destiné à financer l’acquisition et l’installation d’une éolienne vendue par la société France éoliennes ; que ceux-ci ont assigné la banque et Mme Y…, ès qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de constater la résolution du contrat de prêt après avoir prononcé celle du contrat de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d’un montant supérieur à 21 500 euros ; que la cour d’appel a constaté que l’offre préalable de crédit n’était pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé ; d’où il suit qu’en décidant que la résolution du contrat principal entraînait la résolution du contrat de crédit, quand la banque rappelait cependant dans ses conclusions qu’il ne saurait y avoir lieu à résolution du contrat faute de disposition analogue en droit commun à celle du droit consumériste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la cause de l’obligation de l’emprunteur résidant dans la mise à disposition du montant du prêt, viole l’article 1131 du code civil la cour d’appel qui constate la résolution du contrat de prêt, non soumis aux articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en conséquence de la résolution du contrat principal de vente, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l’achat d’un bien déterminé, dès lors qu’il n’était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
|
iii. La détermination des effets de l’indivisibilité contractuelle
En plus de s’être interrogé sur les fondements et les critères de la notion d’indivisibilité, la jurisprudence a éprouvé un certain nombre de difficultés à en déterminer les effets ?
Plusieurs sanctions ont été envisagées en cas de reconnaissance d’une indivisibilité contractuelle :
- La nullité
- Telle a été la solution retenue dans un arrêt du 18 juin 1991, la chambre commerciale ayant validé la décision d’une Cour d’appel pour avoir « souverainement, estimé que les commandes émanant de cette société, bien que passées distinctement en deux lots, n’en étaient pas moins, au su de la société BP Conseils, déterminée par des considérations globales de coûts et, comme telles, indivisibles ; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider que l’importante majoration de prix, que la société BP Conseils a tenté d’imposer à posteriori sur le dernier lot, remettait en cause les considérations communes sur le prix total et justifiait une annulation des deux commandes » (Cass. com. 18 juin 1991, n°89-18.691).
- La résolution
- Dans les arrêts du 10 septembre 2015, la Cour de cassation considère que la résolution de la vente emportait la résolution du contrat de prêt (Cass. 1ère civ., 10 sept. 2015, n° 14-17.772)
- À l’instar de la nullité la résolution d’un acte est assortie d’un effet rétroactif, de sorte que l’anéantissement en cascade des contrats appartenant à l’ensemble donnera lieu à des restitutions.
- La résiliation
- Dans d’autres décisions, la Cour de cassation a retenu comme sanction de l’anéantissement du contrat principal la résiliation des actes auxquels il était lié.
- Elle a notamment statué en ce sens dans les arrêts Sedri du 4 avril 1995.
- Dans l’un d’eux, elle a considéré par exemple que la cessation des services promis par la société Sedri entraînait résiliation du contrat de location du matériel et du logiciel souscrit concomitamment par son cocontractant (Cass. com. 4 avr. 1995, n°93-14.585 et 93-15.671).
- La caducité
- Dans plusieurs arrêts la Cour de cassation a retenu la caducité pour sanctionner l’anéantissement d’un contrat appartenant à un ensemble.
- Dans une décision du 1er juillet 1997 elle a décidé en ce sens que « l’annulation du contrat de vente avait entraîné la caducité du prêt » (Cass. 1ère civ. 1èr juill. 1997, n°95-15.642).
- Cette solution a été réitérée dans un arrêt du 4 avril 2006 à l’occasion duquel la première chambre civile a estimé « qu’ayant souverainement retenu que les deux conventions constituaient un ensemble contractuel indivisible, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la résiliation du contrat d’exploitation avait entraîné la caducité du contrat d’approvisionnement » (Cass. 1ère civ. 4 avr. 2006, n°02-18.277l).
- La chambre commerciale a abondé dans le même sens dans un arrêt du 5 juin 2007.
- Dans cette décision, elle a jugé que « alors que la résiliation des contrats de location et de maintenance n’entraîne pas, lorsque ces contrats constituent un ensemble contractuel complexe et indivisible, la résolution du contrat de vente mais seulement sa caducité » (Cass. com. 5 juin 2007, n°04-20.380).
La lecture de toutes ces décisions révèle que la Cour de cassation n’a jamais vraiment eu de position bien définie sur les effets de l’indivisibilité contractuelle.
Aussi, l’intervention du législateur se faisait-elle attendre. Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 il n’a pas manqué de se prononcer sur les effets de l’indivisibilité et plus généralement d’offrir aux ensembles contractuels le cadre juridique dont, jusqu’alors, ils étaient dépourvus.
b. L’intervention du législateur
La réforme des obligations engagée en 2016 a fourni l’occasion au législateur de faire rentrer dans le Code civil le concept d’ensemble contractuel.
Le nouvel article 1186 du Code civil prévoit ainsi à son alinéa 2 que « lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
La règle est désormais posée : l’anéantissement d’un acte qui appartient à un ensemble contractuel entraîne consécutivement la disparition des autres.
Quels enseignements tirer de l’édiction de cette nouvelle règle ? Ils sont au nombre de trois :
b.1 L’autonomie de la notion d’indivisibilité
Jusqu’alors, la jurisprudence s’était employée à trouver un fondement juridique au concept d’indivisibilité contractuelle, tantôt en le rattachant à la notion cause, tantôt à la notion de condition ou encore à la notion d’obligation indivisible.
Le législateur ayant consacré les ensembles contractuels, cette quête est devenue inutile.
Aussi, l’indivisibilité constitue-t-elle dorénavant une notion autonome qui dispose d’un fondement juridique qui lui propre : l’alinéa 2 de l’article 1186 du Code civil.
Nul n’est dès lors plus besoin de chercher à dévoyer les notions de cause – disparue – ou de conditions pour justifier l’anéantissement en cascade de plusieurs contrats en raison de leur appartenance à un même ensemble.
Il suffit désormais d’établir que lesdits contrats forment un tout indivisible.
b.2 Les critères de la notion d’indivisibilité
Il ressort de l’article 1186, al. 2 du code civil que, semblablement à la Cour de cassation dans ces dernières décisions, le législateur a combiné le critère objectif et le critère subjectif pour définir l’indivisibilité.
- Le critère objectif
- La reconnaissance d’une indivisibilité suppose :
- D’une part, que plusieurs contrats aient été « nécessaires à la réalisation d’une même opération »
- D’autre part, que l’un d’eux ait disparu
- Enfin, que l’exécution ait été « rendue impossible par cette disparition »
- Ces trois éléments doivent être établis pour que le premier critère objectif soit rempli, étant précisé qu’ils sont exigés cumulativement.
- Le critère subjectif
- Principe
- La deuxième partie de l’alinéa 2 de l’article 1186 précise que l’indivisibilité peut encore être établie dans l’hypothèse où les contrats « pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie »
- Ainsi l’indivisibilité contractuelle peut-elle résulter, en plus de l’économie générale de l’opération, de la volonté des parties.
- Dès lors, que les contractants ont voulu rendre plusieurs contrats indivisibles, le juge est tenu d’en tirer toutes les conséquences qu’en aux événements susceptibles d’affecter l’un des actes composant l’ensemble.
- Condition
- L’alinéa 3 de l’article 1186 du Code civil pose une condition à l’application du critère subjectif
- Aux termes de cette disposition, « la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
- L’anéantissement des contrats liés au contrat affecté par une cause de disparition est donc subordonné à la connaissance par les différents cocontractants de l’existence de l’ensemble, soit que les contrats auxquels ils sont partie concourraient à la réalisation d’une même opération économique.
b.3 Les effets de l’indivisibilité
Les effets de l’indivisibilité sont très clairement posés par l’article 1186 du Code civil : la caducité.
Plus précisément, la disparition de l’un des contrats de l’ensemble entraîne consécutivement la caducité des autres.
i. Absence de définition de la caducité
La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée.
Si, quelques études lui ont bien été consacrées, elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être.
Ainsi, pour certains, l’acte caduc s’apparenterait à « un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps ». Pour d’autres, la caducité évoque « l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur ». D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de « stérilité ».
L’idée générale qui ressort de ces descriptions est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc, de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet.
ii. Caducité et nullité
De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, qui a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non.
C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité.
Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence.
La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années.
iii. Origine
Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément, il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie, la capacité du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué.
Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit s’estompe peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse « alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution ». L’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend, dans ces conditions, tout son sens.
Aussi, cela s’est-il traduit par la consécration de la caducité dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
iv. Intervention du législateur
La lecture de l’article 1186 du Code civil révèle que le législateur a donc repris in extenso la définition de la caducité.
Aux termes de l’alinéa 1er de cette disposition « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »
Il ressort de cette définition que :
- D’une part, la caducité ne peut affecter qu’un acte qui a été régulièrement accompli
- D’autre part, elle suppose que l’acte anéanti ait perdu l’un des éléments essentiels à son existence
Telles sont les deux conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu’un contrat puisse être frappé de caducité.
v. Les conditions de la caducité
?L’exigence d’un acte valablement formé
Si l’article 1186 prévoit que pour encourir la caducité le contrat doit avoir été valablement formé.
Aussi, cela signifie-t-il qu’il ne doit, ni avoir été annulé, ni avoir fait l’objet d’une résolution.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir s’il est nécessaire que la nullité du contrat ou sa résolution aient été constatées en justice ou s’il suffit qu’il soit seulement annulable ou susceptible de faire l’objet d’une résolution.
L’article 1186 ne le dit pas, de sorte qu’il appartient à la jurisprudence de se prononcer sur ce point.
?L’exigence de disparition d’un élément essentiel de l’acte
L’article 1186 subordonne la caducité à la disparition de l’un de ses éléments essentiels du contrat.
À la lecture de cette condition, deux difficultés surviennent immédiatement :
- Première difficulté
- L’article 1186 se garde de bien de dire ce que l’on doit entendre par « éléments essentiels ».
- Faut-il limiter le périmètre de la notion d’« éléments essentiels » aux seules conditions de validité du contrat ou doit-on l’étendre aux éléments qui conditionnent son exécution ?
- Selon les auteurs, c’est vers une approche restrictive de la notion que l’on devrait se tourner.
- Au soutien de cet argument est notamment convoqué le nouvel article 1114 du Code civil qui associe la notion d’« éléments essentiels » à l’offre contractuelle, soit au contenu du contrat.
- Seconde difficulté
- Une seconde difficulté naît de la lecture de l’article 1186 en ce qu’il ne dit pas si la disparition de l’un des éléments essentiels du contrat doit être volontaire ou involontaire.
- Jusqu’alors, les auteurs ont toujours considéré qu’un acte ne pouvait être frappé de caducité qu’à la condition que la disparition de l’un de ses éléments essentiels soit indépendante de la volonté des parties.
- Admettre le contraire reviendrait, selon eux, à conférer aux contractants un pouvoir de rupture unilatérale du contrat
- Aussi, cela porterait-il directement atteinte au principe du mutus dissensus.
- Encore un point sur lequel il appartiendra à la jurisprudence de se prononcer.
vi. Les effets de la caducité
Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité produit deux effets : d’une part, elle met fin au contrat et, d’autre part, elle peut donner lieu à des restitutions
?L’anéantissement du contrat
En prévoyant que « la caducité met fin au contrat », l’article 1187 du Code civil soulève deux difficultés : la première tient à la prise d’effet de la caducité, la seconde à sa rétroactivité :
- La prise d’effet de la caducité
- Faut-il pour que la caducité prenne effet qu’elle soit constatée par un juge ou peut-elle être acquise de plein droit, soit par la seule prise d’initiative d’un des contractants ?
- L’article 1187 est silencieux sur ce point.
- Doit-on, sans ces conditions, se risquer à faire un parallèle avec la résolution ou la nullité ?
- Si l’on tourne vers la résolution, l’article 1224 dispose que cette sanction devient efficace
- Soit par l’application d’une clause résolutoire
- Soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur
- Soit d’une décision de justice
- Si l’on se tourne vers la nullité, l’article 1178 prévoit sensiblement la même chose puisqu’elle peut
- Soit être prononcée par le juge
- Soit être constatée d’un commun accord par les parties
- Manifestement, aucun texte ne paraît subordonner l’efficacité de la caducité à sa constatation par un juge
- Aussi, le silence de l’article 1187 combiné aux dispositions qui régissent la résolution et la nullité laisse à penser que la caducité pourrait être acquise par l’effet de la seule initiative de l’une des parties, ce, à plus forte raison si elles y ont consenti d’un commun accord.
- La rétroactivité de la caducité
- S’il ne fait aucun doute que la caducité anéantit le contrat qu’elle affecte pour l’avenir, l’article 1187 ne dit pas s’il en va de même pour ses effets passés.
- D’un côté, l’alinéa 1er de l’article 1187 prévoit que la caducité « met fin au contrat », de sorte que l’on pourrait être enclin à penser que seuls les effets futurs du contrat sont anéantis.
- D’un autre côté, l’alinéa 2 de cette même disposition envisage la possibilité pour les parties de solliciter un retour au statu quo ante par le jeu des restitutions, ce qui suggérerait dès lors que la caducité puisse être assortie d’un effet rétroactif.
- Comment comprendre l’articulation de ces deux alinéas dont il n’est pas illégitime de penser qu’ils sont porteurs du germe de la contradiction ?
- La caducité doit-elle être assortie d’un effet rétroactif ou cette possibilité doit-elle être exclue ?
- Pour le déterminer, revenons un instant sur la définition de la caducité.
- Selon Gérard Cornu la caducité consisterait en l’« état de non-valeur auquel se trouve réduit un acte ».
- Autrement dit, l’acte caduc est réduit à néant ; il est censé n’avoir jamais existé.
- S’il est incontestable que l’acte caduc doit être supprimé de l’ordonnancement juridique en raison de la perte d’un élément essentiel l’empêchant de prospérer utilement, rien ne justifie pour autant qu’il fasse l’objet d’un anéantissement rétroactif.
- Pourquoi vouloir anéantir l’acte caduc rétroactivement, soit faire comme s’il n’avait jamais existé, alors qu’il était parfaitement valable au moment de sa formation ? Cela n’a pas grand sens.
- Dès lors qu’un acte est valablement formé, il produit des effets sur lesquels on ne doit plus pouvoir revenir, sauf à nier une situation juridiquement établie.
- Au vrai, l’erreur commise par les partisans de la reconnaissance d’un effet rétroactif à la caducité vient de la confusion qui est faite entre la validité de l’acte juridique et son efficacité.
- Ces deux questions doivent cependant être distinguées.
- La seule condition qui doit être remplie pour qu’un acte soit valable, c’est que, tant son contenu, que ses modalités d’édiction soient conformes aux normes qui lui sont supérieures.
- On peut en déduire que la validité d’un acte ne se confond pas avec son efficacité.
- Si tel était le cas, cela reviendrait à remettre en cause sa validité à chaque fois que la norme dont il est porteur est violée.
- Or comme l’a démontré Denys de Béchillon « une norme juridique ne cesse pas d’être juridique lorsqu’elle n’est pas respectée ».
- L’inefficacité de l’acte caduc se distingue certes de l’hypothèse précitée en ce qu’elle est irréversible et n’a pas le même fait générateur.
- Elle s’en rapproche néanmoins dans la mesure où, d’une part, elle s’apprécie au niveau de l’exécution de l’acte et, d’autre part, elle consiste en une inopérance de ses effets.
- Ainsi, les conséquences que l’on peut tirer de la caducité d’un acte sont les mêmes que celles qui peuvent être déduites du non-respect d’une norme : l’inefficacité qui les atteint ne conditionne nullement leur validité.
- D’où l’impossibilité logique d’anéantir rétroactivement l’acte ou la norme qui font l’objet de pareille inefficacité.
- En conclusion, nous ne pensons pas qu’il faille envisager que la caducité d’un contrat puisse être assortie d’un effet rétroactif.
- L’alinéa 2 de l’article 1187 du Code civil peut être compris comme confirmant cette thèse.
- Il peut être déduit de l’utilisation, dans cet alinéa, du verbe « peut » et de non « doit » que le législateur a, en offrant la possibilité aux parties de solliciter des restitutions, posé une exception au principe de non-rétroactivité institué à l’alinéa 1er de l’article 1187 du Code civil.
- Aussi, dans l’hypothèse où l’une des parties à l’acte formulerait une demande de restitutions en justice, il n’est pas à exclure que le juge, alors même qu’il constatera la caducité du contrat, ne fasse pas droit à sa demande estimant qu’il ressort de la lettre de l’article 1187 que les restitutions sont facultatives.
?Les restitutions
Aux termes de l’article 1187 du Code civil la caducité « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En application de ces articles, plusieurs règles doivent être observées en matière de restitutions dont les principales sont les suivantes :
D’abord, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (art. 1352 C. civ.).
Ensuite, La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie (art. 1352-8 C. civ.).
Enfin, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée (art. 1352-3 C. civ.).
2. Les chaînes de contrats
Contrairement aux ensembles contractuels qui regroupent des actes qui concourent à la réalisation d’une même opération, les chaînes de contrats sont constituées d’actes qui portent sur un même objet.
Exemple : un contrat de vente est conclu entre A et B, puis entre B et C. La question qui immédiatement se pose est de savoir si, en cas de vice affectant la chose, le sous-acquéreur dispose d’une action contre le vendeur initial ?

A priori, le principe de l’effet relatif interdit au sous-acquéreur d’agir contre le vendeur initial dans la mesure où ils ne sont liés par aucun contrat. L’acquéreur fait écran entre ce que l’on appelle les « contractants extrêmes » lesquels sont des tiers l’un pour l’autre.
Aussi, une action du sous-acquéreur contre le vendeur initial ne semble pas envisageable, à plus forte raison si elle est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Tel n’est cependant pas ce qui a été décidé par la jurisprudence qui a connu une longue évolution.
2.1 Première étape : la distinction entre les chaînes de contrats homogènes et les chaînes hétérogènes
Pour déterminer si le, sous-acquéreur était fondé à agir contre le vendeur initial, la Cour de cassation a, dans un premier temps, distingué selon que l’on était en présence d’une chaîne de contrat homogène ou hétérogène.
a. Notion
- La chaîne de contrats homogène est celle qui est formée d’actes de même nature (plusieurs ventes successives)
- La chaîne de contrats hétérogène est celle qui est formée de plusieurs contrats de nature différente (vente et entreprise)
b. Application
i. Pour les chaînes de contrats homogènes
?Première étape : l’indifférence du fondement
La Cour de cassation a pendant longtemps estimé que le sous-acquéreur disposait d’une option en ce sens qu’il pouvait agir contre le vendeur initial, soit sur le terrain de la responsabilité contractuelle, soit sur le terrain de la responsabilité délictuelle (V. en ce sens Cass. civ. 25 janv. 1820).
L’idée était de permettre au sous-acquéreur de ne pas demeurer sans recours dans l’hypothèse où une stipulation contractuelle l’empêcherait d’agir contre son propre vendeur.
?Deuxième étape : la responsabilité contractuelle
Considérant que l’option laissée au sous-acquéreur quant au choix du fondement de l’action dirigée contre le vendeur initial constituait une atteinte au principe de non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans un arrêt Lamborghini du 9 octobre 1979
La première chambre civile a estimé dans cette décision que « l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979, n°78-12.502).
Cette solution repose sur l’idée que l’action dont dispose l’acquéreur contre le vendeur initial serait transmise au sous-acquéreur lors du transfert de propriété de la chose, ce qui justifie que ce dernier puisse agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En somme l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le vendeur initial est fondée sur la théorie de l’accessoire.
|
Cass. 1ère civ. 9 oct. 1979
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1648 du code civil;
Attendu que, selon les juges du fond, constant, ayant acquis le 5 septembre 1968, de Landrau, garagiste, une automobile d’occasion de marque Lamborghini, modèle <400 ct>, a provoqué le 15 septembre suivant un accident dont l’expertise a révélé qu’il était du a la rupture d’une pièce de la suspension arrière résultant d’un vice de construction, reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai 1967, adresse à ce sujet une note a tous ses agents en indiquant la manière de remédier au défaut constate sur ce modèle;
Que la société des voitures paris-monceau, importateur en France des véhicules de marque Lamborghini, qui avait assure l’entretien de l’automobile litigieuse pendant un certain temps, pour le compte d’un précèdent propriétaire, n’a pas méconnu avoir reçu les instructions de la société Lamborghini, mais n’a pas procédé a la réparation préconisée par le constructeur; que constant et son assureur, l’uap, ayant assigne la société Lamborghini, Landrau et la société des voitures paris-monceau sur le fondement des articles 1147 et 1582 et suivants du code civil, Landrau a appelé en garantie la société des voitures paris-monceau;
Que le tribunal a condamné in solidum les trois défendeurs envers constant et l’Uap, en précisant que dans leurs rapports, ils supporteraient cette condamnation a raison des 3/6 a la charge de la société Lamborghini, responsable du vice de fabrication, des 2/6 a la charge de la société des voitures paris-monceau, pour n’avoir pas fait la réparation demandée par le constructeur, et de 1/6 a la charge de Landrau, en sa qualité de vendeur professionnel;
Que la cour d’appel pour confirmer la condamnation prononcée contre les sociétés Lamborghini et paris-monceau et décider qu’elles seraient tenues chacune par moitié, s’est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle et a déclaré ces deux sociétés responsables a l’égard de constant et de son assureur, par application de l’article 1383 du code civil;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, est nécessairement de nature contractuelle, et qu’il appartenait des lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur était demandé, si l’action avait été intentée dans le bref délai prévu par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 20 décembre 1977 par la cour d’appel de paris; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
|
ii. Pour les chaînes de contrats hétérogènes
Un conflit s’est noué entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation lesquelles ne se sont pas entendues sur la nature de l’action dont disposait le contractant en bout de chaîne (maître d’ouvrage) contre le premier (fabricant).
Cette opposition entre les deux chambres a provoqué l’intervention, par la suite, de l’assemblée plénière.
?Position de la première chambre civile
Dans un arrêt du 29 mai 1984, la première chambre civile s’est prononcée en faveur de la nature contractuelle de l’action (Cass. 1ère civ. 29 mai 1984, n°82-14.875).
Elle a estimé en ce sens que le maître d’ouvrage « dispose contre le fabricant de matériaux posés par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ».
Il s’agissait en l’espèce d’un contrat de vente suivi d’un contrat d’entreprise.
La première chambre civile retient manifestement ici la même solution que celle qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Lamborghini qui portait sur une chaîne de contrats homogène.
|
Cass. 1ère civ. 29 mai 1984
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : vu les articles 1147 et 1648 du code civil ;
Attendu que Mme z… et Mlle Meyniel a… x… d’une maison, avaient fait recouvrir en 1966 la toiture de celle-ci de tuiles par un entrepreneur ;
Que lesdites tuiles s’étant révélées gélives, les copropriétaires ont assigne en réparation de leur préjudice le fabricant de ce matériau, la société Perrusson-Rhomer qui avait vendu les tuiles a l’entrepreneur ;
Que pour accueillir leur demande, la cour d’appel, qui s’est referee a son précèdent arrêt du 15 juin 1981, a fait application des principes relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le maitre de y… dispose contre le fabricant de matériaux poses par son entrepreneur d’une action directe pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue dès sa fabrication, laquelle action est nécessairement de nature contractuelle ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur les deux autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 19 avril 1982, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
|
?Position de la troisième chambre civile
Dans un arrêt rendu sensiblement à la même époque, soit le 19 juin 1984, la troisième chambre civile s’est radicalement opposée à la première chambre civile (Cass. 3e civ. 19 juin 1984, n°83-10.901).
Elle a, en effet, validé la décision d’une Cour d’appel qui après avoir relevé que « par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture […] par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, [elle] a pu retenir la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ».
Pour la troisième chambre civile, l’action dont dispose le maître de l’ouvrage contre le fabricant est de nature délictuelle, car « en dehors de tout contrat ».
|
Cass. 3e civ. 19 juin 1984
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 6 décembre 1982) M. Y… a fait réaliser la couverture de sa villa par l’entrepreneur M. X… qui a utilisé des tuiles, fournies par les établissements Grisard et fabriquées par la Tuilerie des Mureaux aux droits et obligations de laquelle vient la société Lambert Céramique ; qu’à la suite d’infiltrations d’eau, le maître de l’ouvrage a assigné le fabricant en réparation du dommage ; que l’Union fédérale des consommateurs de la Savoie est intervenue volontairement en cause d’appel ;
Attendu que le fabricant fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevables les demandes du maître de l’ouvrage et de l’intervenante tendant au paiement de dommages-intérêts et de sommes non comprises dans les dépens alors, selon le moyen, “que l’action en garantie des vices cachés contre le fabricant est de nature contractuelle, que le contrat d’entreprise n’étant pas un contrat de vente, le maître de l’ouvrage n’est pas acquéreur des matériaux et ne bénéficie pas, en tant que sous-acquéreur, de la garantie des vendeurs successifs ; que, dès lors, la Cour d’appel, qui a relevé l’absence d’un lien de droit direct entre la société Lambert Céramique et M. Y…, n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposent en déclarant recevable l’action en garantie de celui-ci et a ainsi violé l’article 1641 du Code civil” ;
Mais attendu que l’arrêt retient que par suite d’une conception défectueuse, les tuiles fabriquées par la société Lambert Céramique n’étaient pas horizontales dans le sens transversal, vice qui ne pouvait être décelé et qui était l’unique cause des désordres affectant la toiture ; que, par ces seuls motifs caractérisant, en dehors de tout contrat, la faute commise et sa relation de causalité avec le dommage, la Cour d’appel a pu retenu la responsabilité du fabricant même en l’absence de lien de droit direct avec le maître de l’ouvrage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 1982 par la Cour d’appel de Chambéry.
|
?Intervention de l’assemblée plénière
Cette opposition frontale entre la première et la troisième chambre civile a donné lieu à une intervention de l’assemblée plénière qui s’est prononcée sur la nature de l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage contre le fabricant dans un arrêt remarqué du 7 février 1986.
Dans cette décision, l’assemblée plénière a tranché en faveur de la solution retenue par la première chambre civile (Cass ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189).
Elle a, en effet, estimé que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ».
Pour l’assemblée plénière, peu importe donc que la chaîne de contrats soit homogène ou hétérogène : l’action en responsabilité dont est titulaire le maître d’ouvrage est de nature contractuelle.
Elle justifie cette solution en affirmant que « le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ».
L’assemblée plénière retient ainsi comme fondement de l’action en responsabilité contractuelle la théorie de l’accessoire : l’action est transmise concomitamment avec le transfert de propriété de la chose.
Autrement dit, tant le maître de l’ouvrage que le sous-acquéreur recueillent dans leur patrimoine avec la chose les accessoires juridiques qui y sont attachés.
|
Cass ass. plén. 7 févr. 1986
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1984), la société civile immobilière Résidence Brigitte, assurée par l’Union des Assurances de Paris (U.A.P.) a, en 1969, confié aux architectes C… et Z…, aux droits desquels se trouvent les consorts Z…, assistés des bureaux d’études OTH et BEPET, la construction d’un ensemble immobilier, que la société Petit, chargée du gros oeuvre, a sous traité à la société Samy l’ouverture de tranchées pour la pose de canalisations effectuée par la société Laurent X…, que la société Samy a procédé à l’application sur ces canalisations de Protexculate, produit destiné à en assurer l’isolation thermique, qui lui avait vendu par la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l’Isolation (MPI), fabricant, que des fuites d’eau s’étant produites, les experts désignés en référé ont conclu en 1977 à une corrosion des canalisations imputables au Protexculate et aggravée par un mauvais remblaiement des tranchées, que l’U.A.P. a assigné la société MPI, les sociétés Petit, Samy et Laurent X…, MM. C… et Z… ainsi que les bureaux d’études, pour obtenir le remboursement de l’indemnité versée aux copropriétaires suivant quittance subrogative du 30 octobre 1980 ;
Attendu que la société MPI fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1980 sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors, selon le moyen, d’une part, que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le fabricant de matériaux posés par un entrepreneur que d’une action directe pour la garantie du vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication et que cette action, nécessairement de nature contractuelle, doit être engagée dans un bref délai après la découverte du vice ; qu’en accueillant donc, en l’espèce, l’action engagée le 28 janvier 1980 par l’U.A.P., subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, pour obtenir garantie d’un vice découvert par les experts judiciaires le 4 février 1977 et indemnisé par l’U.A.P. le 30 octobre 1980, la Cour d’appel, qui s’est refusée à rechercher si l’action avait été exercée à bref délai, a violé, par fausse application, l’article 1382 du Code civil et, par défaut d’application, l’article 1648 du même Code ;
Mais attendu que le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu’il dispose donc à cet effet contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, en relevant que la Société Commerciale de Matériaux pour la Protection et l’Isolation (M.P.I.) avait fabriqué et vendu sous le nom de “Protexulate” un produit non conforme à l’usage auquel il était destiné et qui était à l’origine des dommages subis par la S.C.I. Résidence Brigitte, maître de l’ouvrage, la Cour d’appel qui a caractérisé un manquement contractuel dont l’U.A.P., substituée à la S.C.I., pouvait se prévaloir pour lui demander directement réparation dans le délai de droit commun, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; […]
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
|
?Portée de la décision d’assemblée plénière
Après l’intervention de l’assemblée plénière, la troisième chambre civile n’a eu d’autre choix que de se rallier à sa position.
C’est ce qu’elle a fait notamment dans un arrêt du 10 mai 1990 à l’occasion duquel elle a estimé que le maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposent « contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe » (Cass. 3e civ. 10 mai 1990, n°88-14.478).
|
Cass. 3e civ. 10 mai 1990
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1987), que la société civile immobilière du Domaine des Grands Prés (SCI) a fait édifier, un groupe de pavillons, par la société Balency-Briard, actuellement société Sogéa, entrepreneur général, qui a posé des chassis ouvrants achetés à la société Roto-Franck qui les a fabriqués ; que des désordres tenant à des phénomènes de condensation sur ces chassis s’étant manifestés après réception et la vente des pavillons intervenues en 1976-1977, plusieurs acquéreurs ont assigné en réparation la SCI, l’entrepreneur général et le fabricant, et qu’il s’en est suivi des appels en garantie ; […]
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Roto-Franck à indemniser les copropriétaires et à garantir la SCI, l’arrêt retient la responsabilité de la société Roto-Franck, en tant que fabricant et fournisseur des chassis affectés de désordres, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à l’égard des tiers que sont pour elle le maître de l’ouvrage et ses acquéreurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la SCI, maître de l’ouvrage, et les acquéreurs disposaient contre le fabricant ou le fournisseur d’une action contractuelle directe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré la société Roto-Franck responsable des désordres affectant les chassis et a prononcé condamnation contre elle, l’arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans
|
2.2 Seconde étape : la distinction entre les chaînes de contrats translatives de propriété et les chaînes non translatives de propriété
S’il ressort de la jurisprudence précédemment étudiée que la Cour de cassation a voulu étendre le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrats, ce, en refusant de distinguer selon que la chaîne était homogène ou hétérogène, ce mouvement extensif n’a pas été sans limite.
Un coup d’arrêt lui a été porté dans une décision rendue par l’assemblée plénière elle-même le 12 juillet 1991, plus connue sous le nom d’arrêt Besse, ce qui a conduit certains auteurs à se demander si cette dernière n’entendait pas revenir sur sa position initiale (Cass. ass. plén. 12 juill. 1991, n°90-13.602)
Les circonstances dans lesquelles l’assemblée plénière a été amenée à se prononcer cette fois-ci étaient toutefois sensiblement différentes de celles qui avaient entouré sa première décision.
Dans l’arrêt du 7 février 1986, il était, en effet, question d’une chaîne de contrats dite translative de propriété, en ce sens que la chose, objet des contrats successifs, est transférée d’un acquéreur à l’autre (Cass. ass. plén. 7 févr. 1986, n°84-15.189).
Tel n’était pas dans l’arrêt Besse, lequel portait sur une chaîne de contrats non-translative de propriété (contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance).
Il peut néanmoins être noté que l’intervention de l’assemblée plénière a une nouvelle fois été provoquée par un conflit né entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
a. L’opposition entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation
i. La position de la première chambre civile
?Première étape
Dans un arrêt du 8 mars 1988, la première chambre civile a considéré au visa des anciens articles 1147 et 1382 du Code civil que « dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué » (Cass. 1ère civ. 8 mars 1988, n°86-18.182).
Ainsi, pour cette chambre de la Cour de cassation en matière de sous-traitance, l’action dont dispose le maître de d’ouvrage contre le sous-traitant est de nature contractuelle, alors même que ces derniers ne sont liés par aucun contrat, à tout le moins de façon directe.
|
Cass. 1ère civ. 8 mars 1988
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué ;
Attendu que la société Clic Clac Photo, qui avait reçu de M. X… des diapositives en vue de leur agrandissement, a chargé de ce travail la société Photo Ciné Strittmatter ; que cette dernière société ayant perdu les diapositives, l’arrêt attaqué a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de M. X… ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1382 du Code civil, et par refus d’application l’article 1147 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
|
?Seconde étape
La première chambre civile ne s’est pas arrêtée à la solution qu’elle venait d’adopter le 8 mars 1988, dont la portée était circonscrite à la seule sphère des contrats de sous-traitance.
Dans une décision remarquée du 21 juin 1988 (arrêt Saxby), elle a estimé que cette solution était applicable à l’ensemble des groupes de contrats, sans distinction (Cass. 1ère civ. 21 juin 1988, n°85-12.609).
Elle a jugé en ce sens que « dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ».
Pour la première chambre civile, peu importe donc que l’on soit en présence d’une chaîne translative ou non de propriété : le principe de l’effet relatif ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation contractuelle entre deux cocontractants extrêmes, soit entre des parties qui n’ont pas échangé leurs consentements.
|
Cass. 1ère civ. 21 juin 1988
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la société Saxby Manutention, moyen étendu d’office par application de l’article 12 du nouveau Code de procédure civile au pourvoi de la société Soderep et au pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited, assureur de Saxby ;
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n’ont souffert du dommage que parce qu’ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu’en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle, même en l’absence de contrat entre eux ;
Attendu qu’un avion de la compagnie norvégienne Braathens South American and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé pendant l’opération destinée à l’éloigner à reculons du point d’embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger ensuite par ses propres moyens vers la piste d’envol ; qu’en effet, le tracteur d’Aéroports de Paris qui le refoulait s’étant brusquement décroché de la ” barre de repoussage ” attelée par son autre extrémité au train d’atterrissage, l’appareil et le tracteur sont entrés en collision ; que l’accident a eu pour origine une fuite d’air comprimé due à un défaut de l’intérieur du corps d’une vanne pneumatique fabriquée par la société Soderep et incorporée au système d’attelage de la barre au tracteur par la société Saxby, devenue depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l’engin à Aéroports de Paris ; que la compagnie Braathens SAFE ayant assigné en réparation Aéroports de Paris ainsi que les sociétés Saxby Manutention et Soderep, l’arrêt attaqué a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de la clause de non-recours insérée dans le contrat d’assistance aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroports de Paris ; qu’en revanche, il a déclaré les sociétés Saxby Manutention et Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour moitié, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité délictuelle à l’égard des sociétés Soderep et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu dans l’exécution de la convention d’assistance aéroportuaire au moyen d’une chose affectée d’un vice de fabrication imputable à la première et équipant le tracteur fourni par la seconde à Aéroports de Paris, l’action engagée contre elles par la compagnie Braathens SAFE ne pouvait être que de nature contractuelle, la cour d’appel, qui ne pouvait donc se dispenser d’interpréter la convention d’assistance aéroportuaire, a, par refus d’application du premier et fausse application du second, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois des sociétés Soderep et Saxby Manutention et du pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a déclaré responsables, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, les sociétés Saxby Manutention et Soderep des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 juillet 1979 à l’aéroport de Paris-Orly, l’arrêt rendu le 14 février 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
|
ii. La position de la troisième chambre civile
Comme elle l’avait fait en matière de chaîne de contrats hétérogène, la troisième chambre civile s’est vigoureusement opposée à la première chambre civile.
Pour ce faire, elle a rendu le 22 juin 1988 dans lequel elle a considéré que « l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance » (Cass. 3 civ. 22 juin 1988, n°86-16.263).
Pour la troisième chambre civile, dans les groupes de contrats, les cocontractants extrêmes doivent autrement dit être regardés comme des tiers l’un pour l’autre.
L’un ne saurait, en conséquence, engager contre l’autre une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Seul le fondement de la responsabilité délictuelle est susceptible d’être invoqué.
|
Cass. 3e civ. 22 juin 1988
Sur le moyen unique
Attendu qu’ayant chargé de l’édification d’une maison individuelle la Société Corelia-Constructions, mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. Guerin pour syndic, M. et Mme Jollivet font grief à l’arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1986) d’avoir rejeté, en se plaçant sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la demande en réparation de malfaçons, qu’ils avaient formée contre M. Dupeyrou, sous-traitant de l’entreprise pour les travaux de charpente-couverture, et de les avoir condamnés à payer à ce dernier une somme excessive en paiement de travaux qu’ils lui avaient directement commandés,
Alors, selon le moyen, que, « d’une part, le maître de l’ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, à cet effet, contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, qu’en l’espèce, les époux Jollivet ne pouvaient être privés de cette action contractuelle directe contre M. Dupeyrou, n’ayant pas livré un arbalétrier et des éléments de charpente ou menuiserie conformes aux spécifications du marché de construction de la maison, qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué, qui a méconnu l’obligation de résultat pesant sur M. Dupeyrou et les conséquences des malfaçons constatées, a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble et par fausse application l’article 1382 du même code, alors que, d’autre part, l’expert commis ayant retenu que les travaux concernant les solives, supports et pose de menuiserie, évaluées à 4.016,04 francs, étaient déjà compris dans le devis de M. Dupeyrou, l’arrêt attaqué ne pouvait lui accorder la même somme au titre d’un supplément de travaux à la charge des époux Jollivet, que le double emploi qui en résulte, au détriment des maîtres de l’ouvrage, aboutit à une violation de l’article 541 de l’ancien Code de procédure civile, encore en vigueur à la date de ces travaux » ;
Mais attendu, d’une part, que l’obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices, à laquelle le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal, a pour seul fondement les rapports contractuels et personnels existant entre eux et ne peut être invoquée par le maître de l’ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance ;
Attendu, d’autre part, que M. et Mme Jollivet n’ayant pas soutenu que la somme que leur réclamait M. Dupeyrou au titre des solives et support et de la pose des menuiseries se rapportaient à des travaux qui avaient été compris dans le devis, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; D’où il suit que le moyen, qui est, pour partie, mal fondé, est pour le surplus irrecevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
|
b. L’intervention de l’assemblée plénière : l’arrêt Besse
Dans l’arrêt Besse du 12 juillet 1991, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a, à nouveau, été appelée à trancher le conflit qui opposait la première chambre à la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Toutefois, cette fois-ci, c’est à la seconde de deux chambres qu’elle a donné raison. Elle a estimé, s’agissant d’un contrat de sous-traitance et au visa de l’article 1165 du Code civil, ancien siège du principe de l’effet relatif, que « le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage ».
|
Cass. ass. plén. 12 juill. 1991
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l’immeuble d’habitation, dont il avait confié la construction à M. X…, entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z… avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y… les a assignés, l’un et l’autre, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l’arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z… peut opposer à M. Y… tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Z…, l’arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
|
?Faits
Un maître d’ouvrage confie à un entrepreneur principal la construction d’un immeuble.
De son côté, l’entrepreneur principal délègue les travaux de plomberie à un sous-traitant
L’installation effectuée par ce dernier va toutefois se révéler défectueuse.

?Demande
Le maître d’ouvrage assigne en dommages et intérêts :
- L’entrepreneur principal
- Le sous-traitant
?Procédure
Par un arrêt du 16 janvier 1990, la Cour d’appel de Nancy déboute le maître d’ouvrage de son action formée contre le sous-traitant.
Les juges du fond estiment que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué
Or en l’espèce, le sous-traitant pouvait opposer à l’entrepreneur principal la forclusion décennale.
La Cour d’appel en déduit que ladite forclusion pouvait également être opposée au maître d’ouvrage en raison de la nature contractuelle de son action.
?Solution
Par un arrêt du 12 juillet 1991, l’assemblée plénière casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel au visa de l’ancien article 1165 du Code civil.
La Cour de cassation estime que, en l’espèce, le sous-traitant n’était pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, de sorte que la forclusion décennale ne lui était pas opposable.
Cela signifie, par conséquent, que l’action dont dispose le sous-traitant contre le maître d’ouvrage est de nature délictuelle.
La Cour de cassation fait ici une application stricte du principe de l’effet relatif.
Le maître d’ouvrage n’étant pas contractuellement lié au sous-traitant, les exceptions qui affectent le contrat conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal ne lui sont pas opposables.
?Analyse
Si, de toute évidence, le raisonnement adopté par la Cour de cassation dans cette décision est imparable, il n’en a pas moins été diversement apprécié par la doctrine.
Immédiatement après l’arrêt Besse la question s’est posée de savoir si la Cour de cassation entendait revenir sur sa position adoptée dans l’arrêt du 7 février 1986 ou si elle souhaitait seulement limiter le domaine de l’action contractuelle dans les chaînes de contrat en introduisant la distinction entre les chaînes translatives et non-translatives de propriété.
Ainsi, deux interprétations étaient envisageables :
- Première interprétation
- On pouvait d’abord voir dans cette nouvelle décision d’assemblée plénière un revirement de jurisprudence, dans la mesure où cinq ans plus tôt la même assemblée avait affirmé de manière fort explicite que le maître d’ouvrage « dispose […] contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée » ?
- Une lecture rapide de l’arrêt pouvait conduire à le penser.
- Toutefois, l’analyse des faits révèle que les circonstances de l’arrêt Besse n’étaient pas les mêmes que dans l’arrêt du 7 février 1986.
- Dans cette décision, on était, en effet, en présence d’une chaîne de contrat translative de propriété, en ce sens que les droits réels exercés sur la chose étaient transférés d’un acquéreur à l’autre.
- Tel n’était pas le cas dans l’arrêt Besse.
- Il s’agissait d’un contrat d’entreprise couplé à un contrat de sous-traitance.
- Aussi, cette chaîne de contrats n’était nullement translative de propriété
- Seconde interprétation
- L’assemblée plénière est simplement venue mettre un terme à l’opposition qui s’était instauré entre la première et la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les chaînes de contrats non-translatives de propriété.
- Dans cette perspective, certains auteurs ont suggéré qu’en matière de chaîne de contrats, il convenait dorénavant de distinguer selon que la chaîne était translative ou non translative de propriété.
- Les chaînes de contrats translatives de propriété
- Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose sont transférés d’acquéreur en acquéreur ce qui dès lors permettra à l’acquéreur final d’agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre le vendeur initial.
- En contrepartie, ce dernier sera fondé à opposer au sous-acquéreur les mêmes exceptions qu’il peut invoquer à l’encontre de son cocontractant.
- Les chaînes de contrats non-translatives de propriété
- Dans cette hypothèse, les accessoires attachés à la chose ne pourront pas, par définition, être transférés aux contractants subséquents, si bien qu’ils ne disposeront contre les contractants extrêmes que d’une action de nature délictuelle.
- Cette situation ne sera cependant pas sans avantage pour eux dans la mesure où ils ne pourront pas se voir opposer les exceptions affectant les contrats dont ils ne sont pas parties.
- Il ressort des arrêts rendus postérieurement à cet arrêt d’assemblée plénière que c’est la seconde interprétation qu’il fallait retenir.
- Dans un arrêt du 23 juin 1993, la première chambre civile a par exemple jugé que « le maître de l’ouvrage dispose contre le fabricant d’une action contractuelle » (Cass. 1ère civ. 23 juin 1993, n°91-18.132).
- Il s’agissait en l’espèce d’une chaîne translative de propriété (contrat de vente + contrat d’entreprise).
- À l’inverse, dans un arrêt du 16 février 1994, la même chambre a estimé que, en matière de chaîne non translative de propriété, l’action était nature délictuelle.
- Depuis ces arrêts, il convient donc de distinguer selon que la chaîne est translative ou non de propriété.
c. Le trouble semé par un arrêt du 22 mai 2002
Un arrêt rendu le 22 mai 2002 par la chambre commerciale est venu jeter le trouble sur la jurisprudence Besse (Cass. com. 22 mai 2002, n°99-11.113).
La Cour de cassation a, en effet, estimé dans cette décision que l’action dont disposait un maître d’ouvrage contre le sous-traitant était de nature contractuelle, alors même que c’est la solution inverse qui avait été adoptée dans l’arrêt Besse.
Si toutefois, l’on prête attention à la motivation de la Cour de cassation, celle-ci semble maintenir la distinction entre les chaînes translatives et non translatives de propriété.
Elle considère en ce sens que « si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ».
Aussi, cette solution ne doit, en aucune manière, être interprétée comme remettant en cause la solution dégagée dans l’arrêt Besse. La motivation retenue par la Cour de cassation est tout au plus maladroite.
Au, vrai, cet arrêt révèle la difficulté qu’il y a à déterminer si une chaîne de contrat réalise ou non un transfert de propriété, spécialement lorsqu’elle comporte un contrat d’entreprise ce qui était le cas en l’espèce.
|
Cass. com. 22 mai 2002
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998), que la société Qatar Petrochemical Cy Ltd (la société QAPCO) a confié, dans le courant de l’année 1977 à la société Technip la réalisation d’un complexe pétrochimique au Qatar ; que, suivant bon de commande du 28 novembre 1977 faisant expressément référence aux conditions particulières du contrat 5521 B datées du mois d’avril 1977, la société Technip a demandé à la société Alsthom la fourniture d’un turbo associé à un compresseur ; qu’à la suite de deux incidents survenus le 17 janvier 1984 et le 20 janvier 1986, la société Qapco et ses assureurs ont judiciairement demandé que la société Alsthom soit déclarée responsable des vices cachés affectant la turbine et condamnée à réparer le préjudice en résultant ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Alsthom fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle était tenue de réparer l’intégralité des dommages subis par la société Qapco et ses assureurs subrogés et de l’avoir condamnée à leur payer diverses sommes au titre des préjudices subis, alors, selon le moyen […]
Mais attendu, d’une part, qu’après avoir exposé que la société Alsthom avait reçu, de la société Technip, commande du turbo-compresseur le 28 novembre 1977, l’arrêt relève que seules les conditions particulières du contrat 5521 B étaient reprises dans cette commande du 28 novembre 1977 à l’exclusion des conditions générales du contrat principal liant Qapco à la société Technip ; que, dès lors, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel, en se fondant, pour condamner Alsthom au profit de la société Qapco, sur l’article 11-1 des conditions particulières du contrat 5521 B, n’a pas admis la société Qapco à se prévaloir à l’encontre d’Alsthom des stipulations liant la société Qapco à la société Technip ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, d’autre part, que, si le maître de l’ouvrage qui agit contre le sous-traitant exerce l’action que le vendeur intermédiaire lui a transmise avec la propriété de la chose livrée, le sous-traitant, qui n’est pas lié contractuellement au maître de l’ouvrage, ne peut invoquer les limitations éventuellement prévues dans le contrat principal passé entre le maître de l’ouvrage et le vendeur intermédiaire ; qu’ayant retenu que l’action du sous-acquéreur était celle de son auteur, à savoir celle du vendeur intermédiaire contre son vendeur originaire, la cour d’appel a justement décidé que la société Alsthom ne pouvait opposer que la clause limitative de responsabilité figurant dans le contrat qu’elle avait conclu avec la société Technip, vendeur intermédiaire ;
Et attendu, enfin, que l’arrêt retient que Qapco et ses assureurs subrogés étaient bien fondés à rechercher la garantie légale de l’entrepreneur et que, le contrat d’entreprise conclu par la société Alsthom ayant eu pour objet de transmettre la propriété de la chose, l’entrepreneur se trouvait tenu d’une obligation de résultat qui emportait présomption de faute et présomption de causalité ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas appliqué à la société Alsthom une clause relative à la garantie légale du vendeur ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
|
II) L’opposabilité du contrat
Conformément au principe de l’effet relatif le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge des parties. Est-ce qu’il ne produit aucun effet à l’égard des tiers ? C’est toute la question de l’opposabilité du contrat.
?Silence du Code civil
Bien que l’article 1199 du Code civil interdise de rendre les tiers créanciers ou débiteur d’une obligation stipulée par les contractants, l’exécution de l’acte n’en est pas moins susceptible d’avoir des répercussions sur leur situation personnelle.
Aussi, la question s’est-elle rapidement posée de savoir quel rapport les tiers entretiennent-ils avec le contrat.
Initialement, le Code civil était silencieux sur cette question. L’article 1165 se limitait à énoncer que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Pour une partie de la doctrine cette règle était incomplète. René Savatier a écrit en ce sens que « cette conception simpliste d’une liberté absolue de l’individu ne tient pas suffisamment compte des liens qui rattachent inévitablement les uns aux autres tous les membres d’une société [où] les affaires de chacun, auprès d’un côté individuel, ont aussi un côté social. Il faut donc reconnaître qu’elles ne concernent pas seulement celui qui y préside, mais à certains points de vue la société et, par conséquent, les tiers ».
D’autres auteurs ont encore affirmé que « se prévaloir de ce qu’une personne a passé un contrat et même de ce qu’elle ne l’a pas exécuté, c’est se prévaloir d’un pur fait, qui existe en tant que fait, donc à l’égard de tous ».
?Consécration jurisprudentielle
La Cour de cassation n’est pas, manifestement, demeurée indifférente à ces critiques puisqu’elle a affirmé le principe de l’opposabilité du contrat au tiers à de nombreuses reprises.
Dans un arrêt du 6 février 1952 la Cour de cassation a, de la sorte, considéré que « si, en principe, les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n’y ont pas été parties, il ne s’ensuit pas que le juge ne puisse pas rechercher dans les actes étrangers à l’une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, ni ne puisse considérer comme une situation de fait vis-à-vis des tiers les stipulations d’un contrat » (Cass. 1ère civ. 6 févr. 1952).
Cette solution a été réaffirmée, par exemple, dans un arrêt du 22 octobre 1991 où elle estime que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490).
|
Cass. com. 22 oct. 1991
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1165 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société industrielle et forestière en Afrique Centrale (Sifac) et la société Industries forestières Batalimo (IFB), dont M. Jacques X… présidait les conseils d’administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l’Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l’agence de la Banque internationale pour l’Afrique Occidentale à Pointe-Noire, en République populaire du Congo (BIAO) ; qu’à la suite de l’expropriation de ses avoirs au Congo, la BIAO a, le 14 août 1974, signé une convention aux termes de laquelle, notamment, la Banque commerciale congolaise (BCC) devait, dans un certain délai, lui signifier la liste des créances qu’elle ne reprenait pas, les autres créances étant, passé ce délai, considérées comme acquises par cette banque ; qu’après l’expiration du délai, la BIAO a inscrit au débit des comptes des sociétés Sifac et IFB ouverts à la BIAO Centrafrique, les montants des soldes débiteurs des comptes de ces sociétés dans les livres de son agence de Pointe-Noire ; que Jacques X… et Jeanine Y…, son épouse, se sont portés cautions, au profit de la BIAO, des dettes des deux sociétés ;
Attendu que, pour condamner les époux X… à payer diverses sommes à la BIAO en exécution de leurs engagements de cautions, l’arrêt, après avoir relevé que ceux-ci ” invoquent le protocole passé entre la Banque commerciale congolaise et la BIAO pour soutenir que la BCC n’ayant pas rejeté les créances dans le délai, seule cette dernière en est titulaire “, retient que, ” n’étant pas partie à cette convention qui n’a pas été faite dans leur intérêt, ils ne peuvent s’en prévaloir ” ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier
|
Ainsi, pour la Cour de cassation, le contrat est opposable aux tiers car il constitue une situation de fait qu’ils ne sauraient ignorer.
La conséquence est double :
- En premier lieu, les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat
- En second lieu, les tiers peuvent se prévaloir du contrat à l’encontre des parties
Appliquée régulièrement par la jurisprudence, cette règle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations.
?Intervention du législateur
Aux termes du nouvel article 1200 du Code civil, d’une part, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », d’autre part, « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Il ressort de cette disposition que, opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née du contrat l’est aussi par les tiers aux parties.
Deux principes sont ainsi posés par à l’article 1200 du Code civil.
A) L’opposabilité du contrat aux tiers
1. Principe
L’article 1200, al. 1er énonce le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat
Cela signifie que les parties peuvent se prévaloir de la convention à l’encontre de personnes qui, par définition, ne l’ont pas conclue.
Cette possibilité dont disposent les contractants d’opposer le contrat aux tiers est susceptible de se rencontrer dans plusieurs situations :
?L’acte porte sur un droit réel
Dans cette hypothèse, qu’il s’agisse d’une constitution de droit réel ou d’un transfert de droit réel, l’opération conclue par les parties est opposable erga omnes.
Dans un arrêt du 22 juin 1864 la Cour de cassation a affirmé en ce sens :
- D’une part, que « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations, et que les contrats qui lui servent de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur ».
- D’autre part, « que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers » (Cass. civ. 22 juin 1864).
Ainsi, le contrat pourra-t-il toujours être utilisé par les parties comme mode de preuve d’un droit réel.
|
Cass. civ. 22 juin 1864
Vu les articles 711 et 1165 du X… Napoléon ;
Attendu qu’il a été reconnu, en fait, par les deux jugements de première instance dont l’arrêt attaqué a adopté les motifs, qu’à consulter l’acte de partage du 15 octobre 1812 et l’adjudication du 25 novembre 1855, titres invoqués par Z…, la réclamation par laquelle il revendique cette portion de haie séparant sa propriété de celle de Y… se trouve clairement établie et devrait être accueillie ;
Attendu que, s’appuyant sur ce que le partage de 1812, étranger à Y… et à ses auteurs, ne ferait pas absolument foi contre eux, le jugement préparatoire a admis les parties à faire preuve des faits de possession et de prescription, respectivement invoqués par elles, et subsidiairement par le demandeur ;
Attendu que le jugement définitif, en reconnaissant des actes de jouissance de la part de l’une et l’autre partie, a déclaré insuffisante l’enquête du demandeur, préférable celle du défendeur, et a, en conséquence, rejeté comme mal fondée la demande en revendication formée par Z… ;
Attendu qu’il ne résulte, ni du dispositif, ni des motifs de ce jugement, que la possession de Y… ou de ses auteurs ait été, pendant une durée de trente années, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
Attendu que la possession de Y… n’aurait pu prévaloir sur les titres de Z… que si elle avait eu soit ce commencement, soit cette durée ; que ni l’un ni l’autre de ces caractères ne lui sont attribués par l’arrêt attaqué, et que, dans l’état des faits déclarés par cet arrêt, l’unique question qui reste à examiner est celle de savoir si les titres de Z…, quoique reconnus probants en eux-mêmes, ont à bon droit été écartés par le motif qu’ils étaient étrangers à Y… et à ses auteurs ;
Attendu qu’aux termes de l’article 711 du X… Napoléon, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations, et que les contrats qui lui servent de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur ;
Que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers ;
Attendu que, déclarer opposables aux tiers les titres réguliers de propriété, ce n’est aucunement prétendre qu’il peut résulter de ces titres une modification quelconque aux droits des tiers, et qu’ainsi la règle de l’article 1165, qui ne donne effet aux conventions qu’entre les contractants, est ici sans application ;
D’où il suit qu’en faisant prévaloir, sur les titres produits par Z…, les faits de possession tels qu’ils sont constatés dans l’espèce, et en rejetant ainsi la demande en revendication formée par Z…, l’arrêt attaqué a faussement appliqué l’article 1165 du X… Napoléon, et violé tant ledit article que l’article 711 du même code,
CASSE,
Ainsi jugé et prononcé
|
?L’acte porte sur une institution
Cette hypothèse vise les contrats qui créent une situation institutionnelle entre les parties à l’acte.
Tel est le cas du mariage, de l’adoption, du divorce ou encore de l’acte constitutif d’une société.
Dès lors que la situation créée entre les parties a fait l’objet des formalités de publicité requises, elle devient opposable à tous.
?L’acte porte sur un droit de créance
Le contrat ne crée, certes, d’obligations qu’à la charge des seules parties
Cette situation juridique ainsi créée n’en est pas moins opposable aux tiers.
Cela signifie, concrètement, que les tiers ne sauraient faire obstacle à l’exécution contrat.
Dans un arrêt du 26 janvier 1999, la Cour de cassation a, dans cette perspective, considéré que « le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1999, n°96-20.782).
|
Cass. 1ère civ. 26 janv. 1999
Attendu que M. Le Bourg, commissaire aux comptes, désirant prendre sa retraite, a, par un acte du 2 avril 1984, constitué avec MM. Bertrand et André X… ce dernier décédé en cours de procédure et aux droits de qui viennent M. Bertrand X… et les consorts X… une société civile professionnelle (la SCP) dont il a été nommé gérant et à laquelle il devait ” céder sa clientèle ” ; que le contrat de cession intervenu le 17 septembre 1984 n’a pu se réaliser en février 1985, comme il en avait été convenu, en raison des dissensions qui étaient apparues entre M. Le Bourg et M. Bertrand X…, son principal associé, quant aux conditions de mise en oeuvre de la convention ; que, conformément aux statuts de la SCP, les parties ont saisi la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer le litige et une sentence arbitrale du 13 février 1985 a prononcé la dissolution de la SCP ; que M. Le Bourg a alors agi pour faire constater la caducité du contrat de cession et ordonner la liquidation de la SCP ; que, statuant sur renvoi après cassation, un arrêt du 14 septembre 1994 a renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond, à la suite de quoi M. Le Bourg a soutenu que la rupture des relations contractuelles était exclusivement imputable à M. Bertrand X… et a demandé en conséquence, du fait de la ” caducité ” de la convention et des fautes de ce dernier, de le condamner à lui payer une somme de 100 000 francs, au titre de ” l’immobilisation de sa clientèle ” pendant plus de trois ans, et une autre somme de 100 000 francs, en réparation des divers inconvénients liés à l’échec de l’opération, ainsi qu’à lui rembourser des honoraires perçus sans contrepartie ; que M. X… a reconventionnellement demandé l’allocation de différentes sommes ; que l’arrêt attaqué, rendu en suite de celui du 14 septembre 1994, a dit que les frais de liquidation de la SCP seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et a déclaré les autres demandes des parties irrecevables […]
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. Le Bourg contre M. X…, l’arrêt énonce que c’est à la SCP et non à M. B. X… que M. Le Bourg a cédé la clientèle de son cabinet par acte du 17 septembre 1984 et que, même s’il est constant que la rupture de cette convention a bien été la conséquence de comportements personnels, il reste que les responsabilités encourues et les conséquences à en tirer ne sauraient être jugées qu’à l’encontre de la SCP, partie au contrat litigieux et représentée par son liquidateur, à charge par ce dernier de répercuter ultérieurement les condamnations éventuelles à intervenir dans le cadre de la liquidation des droits de chacun et sauf à soumettre au juge les litiges qui pourraient subsister ;
Attendu cependant que le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable […]
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les frais de cette liquidation seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. Le Bourg tendant à l’allocation de dommages-intérêts au titre de ” l’immobilisation de sa clientèle ” et des inconvénients divers liés à la non-réalisation de la cession, au remboursement d’une somme de 60 000 francs versée à M. X… à titre d’honoraires, ainsi qu’à celui d’une quote-part des frais de fonctionnement du cabinet de M. Le Bourg, l’arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.
|
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :
- Premier enseignement
- Lorsqu’un tiers compromet l’exécution d’un contrat, cette intervention est constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
- Cela suppose toutefois de démontrer l’existence, d’une part, d’un préjudice et, d’autre part, d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution contractuelle.
- Second enseignement
- La réparation du préjudice causé au cocontractant victime de l’inexécution du contrat devra être recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
- Cette solution se justifie par le fait que, par définition, le tiers n’est pas partie au contrat.
- Aussi, l’obligation qui lui échoit consiste, non pas à respecter les termes du contrat, mais à ne pas entraver sa bonne exécution.
- Il ressort de la jurisprudence qu’il importe peu que l’inexécution contractuelle soit le fait du seul tiers ou que celui-ci se soit rendu complice des agissements de l’un des contractants (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 janv. 1963).
- Dans cette dernière hypothèse, la victime pourra cumulativement agir :
- D’abord, contre le tiers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle
- Ensuite, contre son cocontractant sur le fondement de la responsabilité contractuelle
2. Exception : la simulation
a. La notion de simulation
La possibilité pour les parties d’opposer le contrat aux tiers n’est pas sans limite.
Dans le droit fil des règles édictées antérieurement à la réforme des obligations, le législateur a prévu à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 que l’acte conclu par les contractants était inopposable aux tiers en cas de simulation.
La notion de simulation est présentée à l’article 1201 du Code civil qui prévoit que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre ».
Par simulation, il faut donc entendre l’opération qui consiste pour les parties à conclure simultanément deux actes dont les contenus différèrent.
Tandis que le premier acte est apparent, soit qu’il a été conclu au vu et au su des tiers, le second est quant à lui occulte en ce sens qu’il a vocation à demeurer secret.
La véritable intention des parties résidant dans ce dernier acte, très tôt, tant le législateur que la jurisprudence a estimé que l’acte occulte devait faire l’objet d’une appréhension juridique particulière, à tout le moins qu’il ne pût pas produire les mêmes effets que l’acte apparent.
b. Les formes de simulation
?L’acte fictif
L’acte fictif consiste pour les parties à simuler la conclusion d’un acte qui, en réalité, n’existe pas.
Exemple : les parties concluent ostensiblement un contrat de vente et, dans le même temps, conviennent que cet acte n’opérera aucun transfert de propriété.
L’opération est ici purement fictive, dans la mesure où ses auteurs ont simplement voulu donner à l’acte qu’ils ont conclu l’apparence d’un contrat de vente, alors que, en réalité, il n’existe pas.
?L’acte déguisé
L’acte déguisé consiste pour les parties à conférer à un acte une fausse qualification.
Exemple : les parties concluent ostensiblement un contrat de vente immobilière et conviennent, dans le même temps, que le prix ne sera, soit jamais réclamé, soit sera dérisoire.
Dans cette hypothèse, les parties choisissent délibérément de déguiser sous une autre qualification (la vente) la véritable opération qu’elles entendent conclure (une donation).
?L’interposition de personnes
Il s’agit de la manœuvre qui consiste à dissimuler l’identité du véritable contractant derrière un prête-nom.
Exemple : un bailleur consent un bail à usage d’habitation à un preneur, qui concomitamment, convient avec tiers qu’il lui concédera la jouissance des lieux.
c. Les effets de la simulation
i. À l’égard des parties la validité de l’acte occulte
?Principe
Il a toujours été admis que dès lors que les parties ont échangé leurs consentements l’acte conclu doit être regardé comme valable, quand bien même il n’a fait l’objet d’aucune révélation aux tiers.
Cette règle est exprimée à l’article 1201 du Code civil qui énonce : « le contrat occulte […] produit effet entre les parties », à supposer qu’il remplisse les conditions prévues par la loi
?Conditions
- S’agissant des conditions de fond
- Pour être valable, le contrat occulte doit remplir
- Les conditions communes à tous les actes juridiques, notamment celles énoncées à l’article 1128 du Code civil.
- Les conditions propres à l’acte dont il endosse la qualification.
- Toutefois, pour être valable, il n’est pas nécessaire que l’acte occulte satisfasse aux conditions de validité de l’acte apparent
- S’agissant des conditions de forme
- Contrairement à l’acte apparent, l’acte occulte est dispensé de remplir des conditions de forme quand bien même elles seraient requises à peine de nullité.
- Il en va ainsi d’une donation fictive qui n’aurait pas été conclue en la forme authentique comme exigé par la loi.
?Exception : la fraude
Si, en principe, l’acte simulé est valide entre les parties, il n’en va pas lorsqu’il est l’instrument d’une fraude.
L’article 1202 du Code civil énumère deux sortes d’actes occultes qui sont irréfragablement présumés frauduleux :
- D’une part, « est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel. »
- D’autre part, « est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. »
En dehors de ces deux hypothèses, l’acte occulte demeure valide (V. en ce sens Cass. 3e civ. 20 mars 1996), sauf à établir l’existence d’une fraude.
Quant au contrat apparent il n’encourra jamais la nullité.
ii. À l’égard des tiers : l’inopposabilité de l’acte occulte
Parce que la véritable intention des parties a été cachée aux tiers, l’acte occulte leur est inopposable en ce sens qu’il ne saurait produire aucun effet à leur endroit.
L’article 1201 du Code civil prévoit en ce sens que l’acte occulte « n’est pas opposable aux tiers »
Ainsi cette règle constitue-t-elle une exception au principe général d’opposabilité des conventions.
Elle se justifie par l’apparence créée par l’acte ostensible qui a trompé les tiers sur la véritable intention des parties.
Quid dans l’hypothèse où les tiers connaissaient ou auraient dû connaître l’acte secret ?
En pareil cas, l’acte ne revêt plus aucun caractère occulte, de sorte qu’il leur redevient opposable.
B) L’opposabilité du contrat par les tiers
Dès lors qu’il est admis que le contrat est opposable aux tiers, il serait injuste de dénier une application de ce principe en sens inverse.
C’est la raison pour laquelle l’article 1200 du Code civil autorise les tiers à se prévaloir de l’acte conclu à l’encontre des parties.
L’exercice de cette prérogative conférée aux tiers se rencontrera dans deux situations distinctes :
1. L’invocation de l’acte aux fins de rapporter la preuve d’un fait
Cette possibilité est expressément envisagée par l’article 1200 du Code civil.
La Cour de cassation avait notamment exprimé cette règle dans un arrêt du 22 octobre 1991.
Dans cette décision elle considère que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490).
En défense, la partie contre qui est produit l’acte peut toutefois opposer au tiers sa nullité.
Elle a affirmé en ce sens dans un arrêt du 21 février 1995 que « la victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut de celui-ci » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°92-17.814).
2. L’invocation de l’acte aux fins d’engager la responsabilité des parties
a. Principe
Il est des situations où l’exécution d’un contrat occasionnera un préjudice aux tiers.
Exemples :
-
- Le vice de construction affectant une automobile a provoqué un accident dans lequel un tiers a été blessé
- Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de bail, le preneur dégrade les parties communes d’un immeuble
Très tôt, la jurisprudence a admis que le tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat.
Dans un arrêt du 22 juillet 1931, la Cour de cassation a considéré que « si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat » (Cass. civ. 22 juill. 1931)
Ainsi, l’opposabilité du contrat, en tant que situation de fait, induit la faculté pour les tiers, dans l’hypothèse de la méconnaissance de cette situation par ceux qui l’ont créée, d’en obtenir la sanction juridique en se plaçant sur le terrain délictuel.
b. Conditions
Si le bien-fondé de l’action en responsabilité délictuelle dont est titulaire le tiers à l’encontre de la partie au contrat auteur du dommage n’a jamais été discuté, il n’en a pas été de même pour ses conditions de mise en œuvre.
Un débat est né autour de la question de savoir si, en cas de préjudice occasionné aux tiers, la seule inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité du contractant fautif où s’il fallait, en outre, que caractériser de manière distinction l’existence d’une faute délictuelle.
Il ressort de la jurisprudence une opposition entre la chambre commerciale et la première chambre civile, ce qui a donné lieu à l’intervention de l’assemblée plénière.
?La position de la chambre commerciale : le refus d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
La chambre commerciale a estimé de manière constante que l’établissement de la seule inexécution du contrat ne suffisait pas à établir une faute de nature à engager la responsabilité de la partie au contrat qui, dans le cadre de l’exécution de ses obligations, a causé un dommage à un tiers.
Dans un arrêt du 5 avril 2005, elle a estimé en ce sens « qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com. 5 avr. 2005, n°03-19.370).
Ainsi, pour la chambre commerciale, pour que le tiers victime de la mauvaise exécution du contrat puisse rechercher la responsabilité du contractant fautif il est nécessaire qu’il rapporte la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
Cette solution repose sur l’idée que le principe de l’effet relatif des conventions fait obstacle à ce qu’un tiers au contrat puisse tirer profit d’une faute contractuelle laquelle ne peut être invoquée que par les seules parties à l’acte.
|
Cass. com. 5 avr. 2005
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d’exploitation française de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la société Lyonnaise pharmaceutique (la société Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques ; que la société Merck ayant pris le contrôle de la société Lipha, cette dernière s’est engagée à s’abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la société Bioderma, filiale de la société SEFRB, créée après l’intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la société Lipha, aux droits de laquelle est désormais la société Merck santé France, en réparation du préjudice causé par manquement à son engagement ; qu’après avoir ordonné une expertise par arrêt du 14 avril 2000, la cour d’appel a liquidé ce préjudice par arrêt du 16 janvier 2003 ;
Attendu que pour déclarer la société Bioderma fondée à engager la responsabilité de la société Merck santé France en raison de la violation du protocole d’accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif, l’arrêt du 14 avril 2000 retient que, s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat, et l’arrêt du 16 janvier 2003, que cette décision a reconnu l’intérêt d’un tiers à agir en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat auquel il n’est pas partie sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l’égard de la société Bioderma, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 2000 et 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
|
?La position de la première chambre civile : l’admission de l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
Dans plusieurs décisions, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis que la seule inexécution contractuelle suffisait à fonder l’action en responsabilité délictuelle engagée par le tiers victime à l’encontre du contractant fautif.
Dans un arrêt du 15 décembre 1998 elle a considéré par exemple que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage » (Cass. 1ère civ. 15 déc. 1998, n°96-21.905 et 96-22.440).
Nul n’est dès lors besoin de rapporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
Les deux fautes font ici l’objet d’une assimilation.
L’inexécution du contrat est, autrement dit, regardée comme une faute délictuelle, ce qui justifie que la responsabilité du contractant fautif puisse être recherchée.
La première chambre civile a réitéré cette solution dans un arrêt particulièrement remarqué du 13 février 2001 à l’occasion duquel elle a estimé que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001, n°99-13.589).
|
Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve ;
Attendu qu’en 1983 Claude X… a été contaminé par le virus de l’immuno déficience humaine à l’occasion d’une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes (le Centre) ; qu’il a été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles ; qu’après son décès, survenu en septembre 1992, consécutif à un SIDA déclaré, sa fille Christelle X…, alors âgée de 17 ans, a engagé devant les juridictions de droit commun une action contre le Centre et son assureur, la compagnie Axa, aux fins de réparation du préjudice par ricochet, moral et économique, qu’elle subissait du fait de la mort de son père ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de son action au motif qu’elle ne pouvait invoquer l’obligation contractuelle de sécurité de résultat pesant sur le Centre en l’absence de lien contractuel avec celui-ci et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute dudit centre ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’un centre de transfusion sanguine est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu’il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d’un dommage par ricochet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, en ce qui concerne le droit pour Mlle X… d’invoquer à l’encontre du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mlle Christelle X… tendant à la réparation de son préjudice par ricochet, l’arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
|
?L’intervention de l’assemblée plénière : l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
Afin de mettre un terme au conflit qui opposait la chambre commerciale à la première chambre civile, l’assemblée plénière a été contrainte d’intervenir.
Aussi dans un arrêt du 6 octobre 2006, c’est à la première chambre civile qu’elle a donné raison.
Elle a estimé en effet que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255).
|
Cass. ass. plén. 6 oct. 2006
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X… ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, “que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil” ;
Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
La solution adoptée par l’assemblée plénière en 2006 a, par la suite, été confirmée à plusieurs reprises, tant par la première chambre civile (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 2007 ; Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-69.129), que par la chambre commerciale.
Dans un arrêt du 2 mars 2007, cette dernière a ainsi considéré que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com. 2 mars 2007, n°04-13.689)
Elle reprend ici mot pour mot la solution dégagée par l’assemblée plénière ce qui marque l’abandon de sa position antérieure.
|
Cass. com. 2 mars 2007
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, que par contrat de licence conclu courant septembre 1991, la société Jean-Louis Scherrer a concédé à la société de droit néerlandais Elisabeth Arden international BV, aux droits de laquelle se trouve la société Unilever Cosmetics international BV (société E. Arden) le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers produits sous la dénomination et la marque Jean-Louis Scherrer ; que, par acte du 2 décembre 1992, la société Jean-Louis Scherrer a apporté à la société JLS marques la marque Jean-Louis Scherrer, ses déclinaisons et la branche d’activité relative à l’exploitation de la marque, laquelle comprenait les contrats de licence en cours, dans la mesure où ceux-ci étaient transmissibles, que la société E. Arden, arguant de la clause d’incessibilité du contrat de licence, un accord a été conclu le 10 octobre 1994 entre la société JLS marques, titulaire de la marque, la société Jean-Louis Scherrer, licencié de la société JLS marques depuis le 27 avril 1993, et la société E. Arden, aux termes duquel la convention de cession de marques signée entre les deux premières sociétés ne modifiait pas le contrat de licence conclu entre les sociétés Jean-Louis Scherrer et E. Arden ; que, le 17 mars 2000, la société E. Arden a régulièrement notifié à la société EK finances, venant aux droits de la société Jean-Louis Scherrer et à la société JLS marques sa décision de ne pas exercer l’option de renouvellement prévue au contrat de licence ; que la société JLS marques a poursuivi judiciairement la société E. Arden en responsabilité contractuelle puis en responsabilité délictuelle, la société EK finances intervenant volontairement à l’instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société JLS marques en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient que cette société, qui reprochait à la société E. Arden d’avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme, et faisait valoir que les mauvais résultats de la licence s’expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n’a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Scherrer fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
|
La position de la Cour de cassation a, manifestement, été accueillie pour le moins froidement par une frange de la doctrine, certains auteurs estimant qu’elle était bien trop favorable aux tiers.
Cette solution leur permet, en effet, de s’émanciper de la rigueur contractuelle à laquelle se sont astreintes les parties notamment par le jeu des obligations de résultat ou des clauses limitatives de responsabilité.
Aussi, peut-on regretter que le législateur soit resté silencieux sur ce point.
L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile laisse toutefois augurer une modification de ce point de droit.
Les auteurs de cet avant-projet envisagent d’introduire un nouvel article 1234 qui disposerait que :
- « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.
- Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »
Le débat n’est donc pas clos.
Il est fort à parier que la position adoptée par l’assemblée plénière en 2006 sera brisée par le législateur.