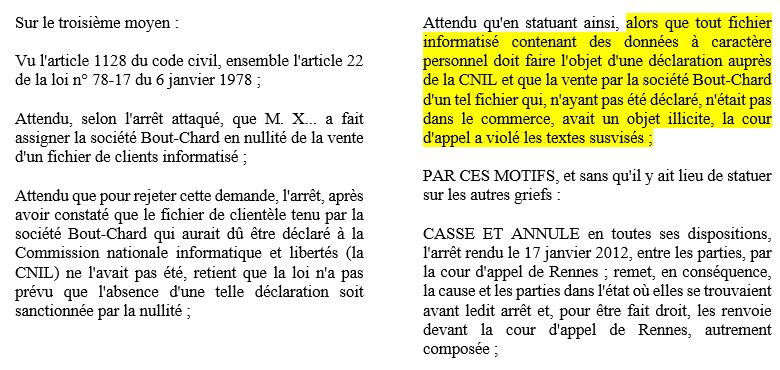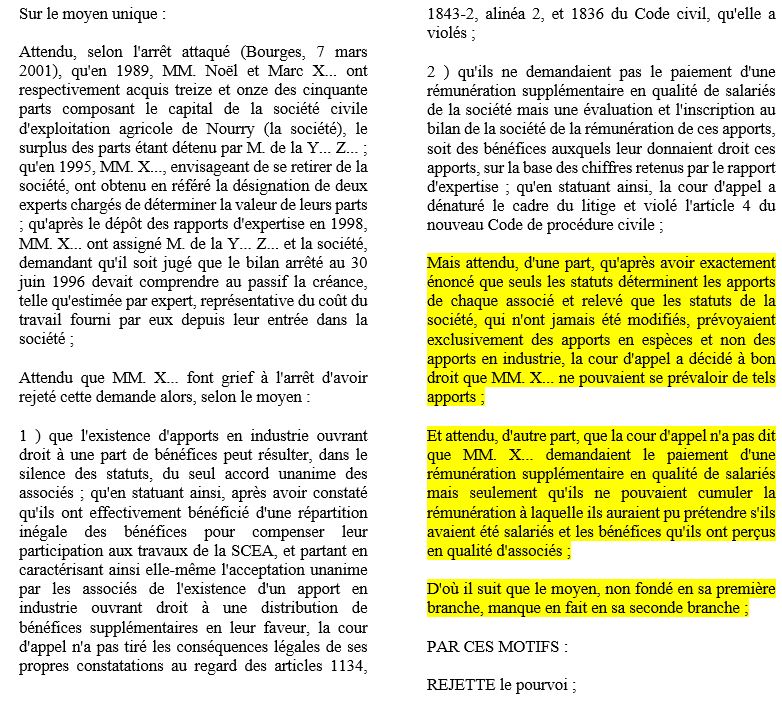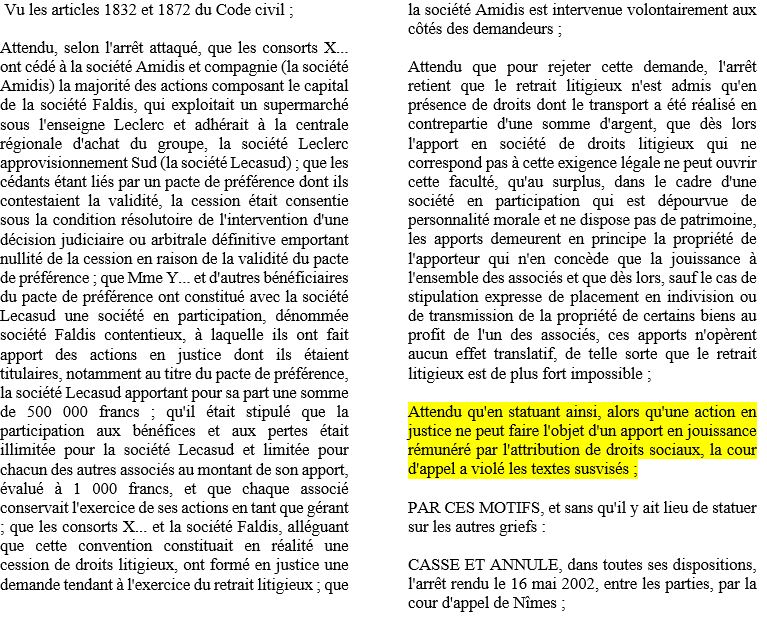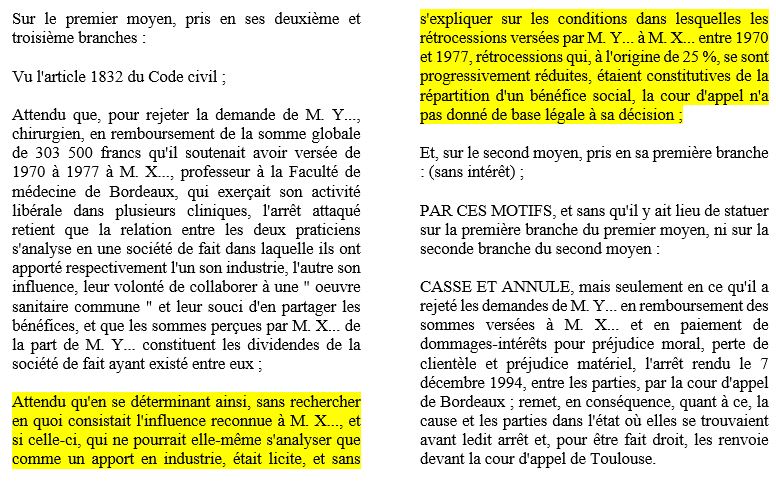Le régime juridique de la responsabilité du fait des choses tel qu’on le connaît aujourd’hui est le fruit d’une longue construction jurisprudentielle dont il convient de rappeler les grandes lignes, avant de s’intéresser à ses conditions de mise en œuvre.
I) La lente reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses
?La situation en 1804
Aux termes de l’article 1242, al. 1er du Code civil « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Lors de l’adoption du Code civil en 1804, ses rédacteurs n’avaient pour seule intention, en insérant cet alinéa, que d’annoncer les cas particuliers de responsabilité du fait des choses prévus aux articles 1243 (responsabilité du fait des animaux) et 1244 (responsabilité du fait des bâtiments en ruine).
Il s’agissait, en d’autres termes, d’un texte de transition entre la responsabilité du fait personnel des articles 1240 et 1241 et les cas spéciaux de responsabilité énumérés aux dispositions suivantes. L’article 1242, al. 1er était en ce sens dépourvu de toute valeur normative.
Pendant près d’un siècle, nul n’a envisagé l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses, pas plus d’ailleurs qu’un principe général de responsabilité du fait d’autrui.
Les seules choses dont l’intervention dans la production d’un dommage était susceptible d’engager la responsabilité du gardien, ne pouvaient être, selon la jurisprudence, que celles énumérées aux articles 1243 et 1244 du Code civil.
Dans l’hypothèse où la chose à l’origine d’un dommage n’était, ni un animal, ni un bâtiment en ruine, on estimait, dès lors, qu’elle devait être appréhendée comme un simple instrument de l’action humaine, de sorte qu’il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité du gardien sur le fondement de la responsabilité du fait personnel.
Cela supposait donc de rapporter la preuve d’une faute en relation avec le dommage (V. en ce sens Cass. civ., 19 juill. 1870 )
La liste des cas de responsabilité du fait des choses est demeurée limitative jusqu’à l’avènement de la Révolution industrielle.
Comme le souligne Philippe Brun, « si dans la société agraire du début du XIXe siècle, les animaux et les bâtiments ont pu apparaître comme les principales sources de dommages parmi les choses, ce schéma a volé en éclat avec la Révolution industrielle ».
Cette révolution a, en effet, été accompagnée par un accroissement considérable des accidents de personnes provoqués par l’explosion des techniques encore mal maîtrisées, liées notamment à l’exploitation des machines à vapeur.
La victime se retrouvait le plus souvent dans l’impossibilité de déterminer la cause exacte du dommage et, surtout, d’établir une faute à l’encontre du gardien.
Cela aboutissait alors à une situation particulièrement injuste. Les victimes étaient privées d’indemnisation en raison des conditions restrictives de mise en œuvre de la responsabilité du fait personnel : en l’absence de faute, la responsabilité du propriétaire de machine ne pouvait pas être engagée, quand bien même l’accident survenait dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail.
Aussi, faut-il attendre la fin du XIXe siècle pour que naisse une prise de conscience de la nécessité d’améliorer le sort des victimes du machinisme en jurisprudence.
À la vérité, deux étapes ont été nécessaires à la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses :
?Première étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Teffaine
Dans un arrêt du 16 juin 1896, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil.
|
Arrêt Teffaine
(Cass. civ, 16 juin 1896)
La Cour ; […]
Et statuant tant sur le moyen unique du pourvoi formé par Guissez et Cousin que sur le premier
moyen du pourvoi d’Oriolle:
Attendu que l’arrêt attaqué constate souverainement que l’explosion de la machine du remorqueur à vapeur Marie, qui a causé la mort de Teffaine, est due à un vice de construction ; qu’aux termes de l’art.1384 c. civ., cette constatation, qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ; D’où il suit qu’en condamnant Guissez et Cousin, propriétaires du Remorqueur Marie, à payer des dommages et intérêts à la veuve et aux enfants Teffaine, ledit arrêt, d’ailleurs motivé, n’a violé aucun des articles visés au pourvoi ;
Par ces motifs,
Rejette
|
Faits :
Explosion de la chaudière du remorqueur à vapeur « Marie », qui cause la mort de Monsieur Teffaine.
Procédure :
En l’espèce, comme le releva la Cour d’appel, aucune faute ne pouvait être imputée, ni à Monsieur Teffaine, ni à son employeur.
Aussi, les juges du fond ont-ils considéré que l’explosion était due à un défaut de soudure de la chaudière, de sorte qu’il s’agissait d’un vice de construction.
Guidée par un souci d’indemnisation de la veuve de la victime, la Cour d’appel n’en a pas moins condamné le propriétaire du remorqueur au paiement de dommages et intérêt en se fondant sur le cas spécial de responsabilité du fait des bâtiments en ruine.
Solution :
Malgré l’interprétation pour le moins extensive, sinon contestable de l’ancien article 1386 du Code civil à laquelle s’était livrée la Cour d’appel et dont on était légitimement en droit d’attendre, au regard de la jurisprudence antérieure, qu’elle encourt la cassation, la Chambre civile rejette le pourvoi formé par l’employeur de Monsieur Teffaine.
La Cour de cassation considère, en effet, que si l’article 1386 du Code civil n’avait certes pas vocation à s’appliquer en l’espèce, la responsabilité du propriétaire du remorqueur n’en pouvait pas moins être recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La Chambre civile affirme en ce sens que « aux termes de l’art.1384 c. civ., [l’explosion résultant d’un vice de construction de la chaudière ], qui exclut le cas fortuit et la force majeure, établit, vis-à-vis de la victime de l’accident, la responsabilité du propriétaire du remorqueur sans qu’il puisse s’y soustraire en prouvant soit la faute du constructeur de la machine, soit le caractère occulte du vice incriminé ».
Pour la matière fois elle confère donc à l’article 1384 al. 1er une valeur normative, sans considération de la simple fonction introductive que lui avaient assignée les rédacteurs du Code civil.
À partir de cette décision, l’article 1384 al. 1er va connaître un essor particulièrement important, en dépit d’une période de flottement jurisprudentiel, les tribunaux étant pour le moins hésitant quant à l’application du principe général de responsabilité du fait des choses qui venait d’être découvert.
?Période de flottement jurisprudentiel
Plusieurs incertitudes ont entouré l’arrêt Teffaine. La doctrine et la jurisprudence se sont, en effet, interrogées sur la question de savoir s’il ne convenait pas de réduire le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses.
Pour y parvenir, deux solutions ont été envisagées :
- L’adoption d’une conception restrictive de la notion de chose
- À la suite de l’arrêt Teffaine, il a été préconisé de limiter l’application de l’article 1384, al. 1er :
- aux meubles
- aux choses dangereuses
- aux choses présentant un vice interne
- aux choses non actionnées par la main de l’homme
- Dans un arrêt du 22 mars 1911, la Cour de cassation a, par exemple, estimé que dans l’hypothèse où la chose qui a causé le dommage est une automobile, l’article 1384, al. 1er n’a pas vocation à s’appliquer dans la mesure où il s’agit d’une chose actionnée par la main du conducteur, de sorte que le dommage est dû, en réalité, au seul fait de l’homme (Cass. req., 22 mars 1911).
- Elle en déduit alors que la responsabilité du conducteur ne peut être recherchée que le fondement de l’article 1382, ce qui suppose, pour la victime, de rapporter la preuve d’une faute.
- L’admission d’une présomption de faute
- Alors que dans l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation avait, a priori, exclu que le gardien de la chose qui a causé un dommage puisse s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, elle revint toutefois sur sa position dans un arrêt du 30 mars 1897.
- La chambre des requêtes considère, en effet, que l’article 1384, al. 1er du Code civil édicte une simple présomption de faute, laquelle peut, dès lors, être combattue par la preuve contraire (Cass. req., 30 mars 1897)
- Par la suite, la Cour de cassation renforça la présomption, en exigeant du gardien qu’il rapporte la preuve positive d’un fait extérieur générateur de dommage et pas seulement la preuve négative de l’absence d’imprudence ou de négligence.
- Aussi, cela revenait-il à instaurer une présomption quasi-irréfragable de responsabilité à l’encontre du gardien.
- Dans un arrêt du 16 décembre 1920, la chambre civile affirma en ce sens que « la présomption de faute édictée par l’article 1384, alinéa 1, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure, ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. Il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue » (Cass. civ., 16 déc. 1920).
|
Cass. civ., 16 déc. 1920
LA COUR:
– Sur le moyen unique : – Vu l’art. 1384, § 1er, C.civ.; – Attendu que la présomption de faute édictée par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé le dommage ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute, ni que la cause du dommage est demeurée inconnue; qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage, l’article rattachant la responsabilité à la garde de la chose, et non à la chose elle-même; – Attendu que, le 2 juill. 1906, un incendie a éclaté à Bordeaux dans la gare maritime de Brienne, dont la Compagnie des chemins de fer du Midi est concessionnaire; qu’alimenté par de nombreux fûts de résine (ou brai), entreposés dans cette gare, le feu gagna la voie publique contiguë et détruisit les rails, poteaux et appareils de transmission de la Comp. française des tramways électriques et omnibus de Bordeaux; – Attendu que l’arrêt attaqué reconnaît que les fûts de résine étaient sous la garde de la Comp. des chemins de fer du Midi, mais déclare que la cause du dommage doit résider dans la chose qu’on a sous garde, lui être intrinsèque, que le brai n’est pas susceptible de s’enflammer par suite d’un vice inhérent à sa nature, et, en conséquence, par confirmation du jugement, rejette la demande en dommages-intérêts formée par la Comp. des tramways; qu’en statuant ainsi, il a violé le texte susvisé; Par ces motifs : Casse et annule.
|
En réaction à ce flottement jurisprudentiel née à la suite de l’arrêt Teffaine, la Cour de cassation n’a eu d’autre choix que de préciser sa position.
?Seconde étape vers la reconnaissance d’un principe général de responsabilité du fait des choses : l’arrêt Jand’heur
Dans un arrêt Jand’heur du 13 février 1930, non seulement la Cour de cassation va réitérer la solution qu’elle avait adoptée dans l’arrêt Teffaine, mais encore elle va mettre fin aux incertitudes qui entouraient la découverte, en 1896, d’un principe général de responsabilité du fait des choses.
|
Arrêt Jand’heur
(Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930)
Statuant sur le moyen du pourvoi :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ;
Attendu que, le 22 avril 1926, un camion automobile appartenant à la Société “Aux Galeries Belfortaises” a renversé et blessé la mineure Lise X… ; que l’arrêt attaqué a refusé d’appliquer le texte susvisé par le motif que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’article 1384, alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ;
Mais attendu que la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ;
D’où il suit qu’en statuant comme il l’a fait l’arrêt attaqué a interverti l’ordre légal de la preuve et violé le texte de loi susvisé ;
Par ces motifs,
CASSE,
|
Fait :
Une adolescente, Lise Jand’heur, est renversée et blessée par un camion alors qu’elle traverse la chaussée.
Procédure :
Plusieurs étapes procédurales doivent être distinguées dans l’affaire Jand’heur afin de bien en saisir l’enjeu.
- Première étape
- Dans un arrêt du 29 décembre 1925, la Cour d’appel de Besançon refuse d’indemniser la victime.
- Les juges du fond estiment que, dans la mesure où la chose qui a causé le dommage (le camion) était actionnée par la main de l’homme, le dommage était imputable, non pas au fait d’une chose, mais au fait de l’homme.
- Aussi, pour la Cour d’appel, la responsabilité du conducteur du camion ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
- Il appartenait donc à la victime de rapporter la preuve d’une faute.
- Deuxième étape
- Dans un premier arrêt du 21 février 1927, la Cour de cassation censure la décision rendue par la juge du fond, estimant que l’article 1384, al. 1er avait bien vocation à s’appliquer, peu importe que la chose à l’origine du dommage ait été ou non actionnée par la main de l’homme (Cass. civ., 21 févr. 1927)
- La haute juridiction précisa néanmoins que « le gardien n’est responsable que s’il s’agit d’une chose soumise à la nécessité d’une garde en raison des dangers qu’elle peut faire courir à autrui ».
- Critique
- Bien que, par cette décision, la Cour de cassation soit revenue sur son refus de faire application de l’article 1384, al. 1er aux accidents de la circulation, sa position n’en a pas moins fait l’objet de critiques.
- Il a, en effet, été reproché à la haute juridiction d’avoir substitué à la distinction entre les choses actionnées par la main de l’homme et celles qui ne le sont pas une autre distinction : la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses.
- Or il s’agit là d’une distinction qui, comme la précédente, n’est pas très heureuse pour plusieurs raisons :
- Quel critère retenir pour distinguer les choses dangereuses des choses non dangereuses ?
- La distinction opérée par la Cour de cassation apparaît ici pour le moins arbitraire.
- Qui plus est, le fait qu’une chose ait commis un dommage n’établit-il pas d’emblée qu’elle est dangereuse ?
- Par ailleurs, l’instauration d’une distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses conduit à restreindre le domaine d’application de l’article 1384 al. 1er, alors que si l’on se rapporte à la lettre du texte, la loi n’opère aucune distinction parmi les choses.
- Enfin, la solution retenue par la Cour de cassation traduit un retour au système de la faute pourtant abandonné dans l’arrêt Teffaine, puis dans l’arrêt du 16 décembre 1920, en ce sens que la Cour de cassation considère, en creux, que lorsque le dommage est causé par une chose non dangereuse, seul l’établissement d’un comportement fautif du gardien est susceptible d’engager sa responsabilité.
- Troisième étape
- La Cour d’appel de renvoi refuse de s’incliner devant la décision adoptée par la Chambre civile le 21 février 1927
- Les juges du fond considèrent que la responsabilité du conducteur du camion ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, la chose à l’origine du dommage ayant été actionnée par la main de l’homme.
- Quatrième étape
- Dans un arrêt du 13 février 1930 qui fera date, les chambres réunies de Cour de cassation censurent une nouvelle fois la décision des juges du fond.
- La haute juridiction formule, dans cette décision, deux affirmations sur lesquelles est assis le droit positif de la responsabilité du fait des choses :
- En premier lieu, elle considère que « la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue »
- En second lieu, la Cour de cassation décide que « la loi, pour l’application de la présomption qu’elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme ; qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».
?Analyse de l’arrêt Jand’heur
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de l’arrêt Jand’heur :
- Réaffirmation du principe général de responsabilité du fait des choses
- La Cour de cassation ne manque pas de réaffirmer le principe général de responsabilité du fait des choses en retenant comme visa de sa décision l’article 1384, alinéa 1er du Code civil.
- Consécration d’une présomption de responsabilité
- Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation utilise l’expression « présomption de responsabilité » et non « présomption de faute ».
- Aussi, par cette expression, la haute juridiction entend-elle édicter la règle le gardien de la chose ayant causé un dommage ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue.
- La preuve de l’absence de faute est inopérante, de sorte que le seul moyen pour le gardien de s’exonérer de sa responsabilité est d’établir la survenance d’une cause étrangère dans la production du dommage (cas fortuit ou force majeure).
- En édictant, pour la première fois, une présomption de responsabilité, la Cour de cassation abandonne dès lors la faute comme fondement de la responsabilité du fait des choses.
- Il ne s’agit donc plus d’une responsabilité subjective, mais objective, dite encore responsabilité de plein droit.
- Extension du domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses
- La volonté de la Cour de cassation d’étendre le domaine d’application du principe général de responsabilité du fait des choses s’est traduite par :
- Le rejet de la distinction entre les choses dangereuses et les choses non dangereuses
- Le rejet de la distinction entre les meubles et les immeubles
- Le rejet de la distinction entre les choses actionnées ou non par la main de l’homme
- Le rejet de l’exigence d’un vice inhérent à la nature de la chose.
- Mise en avant du critère de la garde, comme condition de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses
- Dans l’arrêt Jand’heur, la Cour de cassation insiste particulièrement sur le fait que la mise en œuvre de l’article 1384, al. 1er est liée, pour l’essentiel, à la garde de la chose et non à sa nature.
- Autrement dit, pour que la responsabilité du gardien puisse être recherchée, seul compte que la chose à l’origine du dommage ait été placée sous sa garde, peu importe qu’il s’agisse ou non d’une chose dangereuse ou qu’elle présente un vice interne.
Au total, il ressort de l’arrêt Jand’heur que, par une construction purement prétorienne, la responsabilité du fait des choses est devenue une responsabilité de plein droit ou objective, en ce sens que l’obligation de réparation naît, désormais, indépendamment de l’établissement d’une faute.
Autrement dit, le gardien engage sa responsabilité, dès lors que la chose qu’il avait sous sa garde a concouru à la production du dommage.
Pour faire échec à l’action en réparation diligentée contre lui, il ne disposera que de deux options :
- Rapporter la preuve d’une cause étrangère dont la survenance a rompu le lien de causalité entre le dommage et le fait de la chose
- Démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies
II) Les conditions de mise en œuvre du principe général de responsabilité du fait des choses
Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses sont au nombre de quatre, parmi lesquels on dénombre deux constantes et deux conditions spéciales :
- Les constantes
- Le dommage
- Le lien de causalité
- Les conditions spéciales
- La garde de la chose
- Le fait de la chose
Les constantes ayant fait l’objet d’une étude dans des fiches séparées, nous ne nous focaliserons que sur les conditions spéciales de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses.
A) La garde de la chose
1. La définition de la garde
Que doit-on entendre par la notion de garde ?
A priori, seul le gardien de la chose est susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
Le plus souvent, la condition relative à la garde ne soulèvera guère de difficultés dans la mesure où le gardien sera tout à la fois le propriétaire et le détenteur de la chose lors de la production du dommage.
Quid néanmoins, dans l’hypothèse où le propriétaire et le détenteur de la chose sont deux personnes distinctes ?
Cette situation se rencontrera notamment lorsque la chose à l’origine du dommage aura été empruntée ou volée.
Dans pareille circonstance, qui doit être désigné gardien et supporter la charge de l’obligation de réparation ? Est-ce le propriétaire ou le détenteur de la chose ?
Deux théories sont envisageables :
- La théorie de la garde juridique de la chose : la garde incomberait à celui qui est propriétaire de la chose, car lui seul posséderait un véritable pouvoir sur la chose
- La théorie de la garde matérielle de la chose : La garde supposerait une maîtrise concrète et effective de la chose, de sorte que seul son détenteur effectif, qu’il en soit ou non le propriétaire, pourrait être qualifié de gardien
La question de la notion de garde a été tranchée dans un célèbre arrêt Franck du 2 décembre 1941, lequel vient clore une affaire dans le cadre de laquelle la Cour de cassation a été amenée à se prononcer par deux fois.
?Les faits
Le Docteur Franck prête sa voiture à son fils. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, la voiture est volée.
Le voleur, dont l’identité est demeurée inconnue, percute et blesse mortellement le facteur Connot.
Une action en responsabilité est alors engagée à l’encontre du propriétaire du véhicule.
?Enjeux
Dans l’affaire Franck le choix de la conception la garde n’était pas sans enjeux :
- Dans l’hypothèse, où les juges retiendraient une conception matérielle de la garde, ils priveraient, de facto, la victime du dommage d’indemnisation dans la mesure où elle ne pourrait obtenir réparation qu’en engageant une action en responsabilité contre le voleur de la voiture. Or celui-ci n’a pas été interpellé, si bien que son identité est demeurée inconnue.
- Dans l’hypothèse où les juges adopteraient la théorie de la garde juridique, cela reviendrait à engager la responsabilité du propriétaire du véhicule, alors qu’il n’en était pourtant pas le détenteur au moment de la production du dommage. Cette solution serait néanmoins favorable à la victime, puisqu’elle serait alors en mesure de diligenter des poursuites contre un débiteur identifié.
?Premier arrêt : l’adoption de la conception juridique de la garde
Dans un premier arrêt du 3 mars 1936, la Cour de cassation considère que le propriétaire de la voiture, instrument du dommage, en a conservé la garde, malgré le vol (Cass. civ., 3 mars 1936).
Ainsi, retient-elle une conception juridique de la garde : peu importe le pouvoir de fait sur la chose, seul compte le pouvoir de droit.
Bien que cette solution soit contraire à la jurisprudence des juges du fond qui s’étaient majoritairement prononcés en faveur de la théorie de la garde matérielle, elle s’inscrivait néanmoins dans le droit fil du mouvement d’objectivation de la responsabilité du fait des choses amorcée quarante ans plus tôt par l’arrêt Teffaine.
| Résistance des juges du fond |
L’objectif poursuivi par la Cour de cassation n’est, malgré tout, pas partagé par la Cour d’appel de renvoi qui résiste et déboute la victime de sa demande de réparation (CA Besançon, 25 févr. 1937).
Les juges du fond estiment que la responsabilité du propriétaire de la voiture ne saurait être engagée, la garde de la voiture ayant été transféré au conducteur par l’effet du vol.
Qui plus est, la Cour d’appel relève que, en raison des circonstances, aucune faute de surveillance ne saurait être reprochée au propriétaire de la voiture.
?Second arrêt : l’adoption de la conception matérielle de la garde
Dans un arrêt Franck du 2 décembre 1941, la Cour de cassation se range finalement derrière la position des juges du fond en adoptant la théorie de la garde matérielle.
|
Arrêt Franck
(Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941)
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, une voiture automobile, appartenant au docteur Y…, et que celui-ci avait confiée à son fils Claude, alors mineur, a été soustraite frauduleusement par un individu demeuré inconnu, dans une rue de Nancy où Claude Y… l’avait laissée en stationnement ;
Qu’au cours de la même nuit, cette voiture, sous la conduite du voleur, a, dans les environs de Nancy, renversé et blessé mortellement le facteur X… ;
Que les consorts X…, se fondant sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ont demandé au docteur Y… réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de X… ;
Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…, l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur ladite voiture aucune surveillance ;
Qu’en l’état de cette constatation, de laquelle il résulte que Y…, privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d’appel, en statuant ainsi qu’elle l’a fait, n’a point violé le texte précité
|
Dans l’arrêt Franck, la Cour de cassation estime que dès lors que le propriétaire est privé de l’usage, de la direction et du contrôle de la chose, il n’en a plus la garde, de sorte que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384, al. 1er du Code civil doit être écartée.
Autrement dit, le propriétaire de la chose peut combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en démontrant qu’il n’en était pas le gardien lors de la production du dommage, ce qui donc suppose qu’il établisse avoir perdu les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
La garde comporte ainsi trois éléments constitutifs qui déterminent la qualité de gardien :
- L’usage : maîtrise de la chose dans son propre intérêt
- La direction : décider de la finalité de l’usage
- Contrôle : capacité à prévenir le fonctionnement anormal de la chose
?Analyse de l’arrêt
La solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck appelle deux observations :
- Abandon de la conception juridique de la garde
- En validant la décision des juges du fond qui ont refusé de retenir la responsabilité du propriétaire du véhicule, la Cour de cassation abandonne la théorie de la garde juridique au profit d’une conception matérielle de la garde.
- La haute juridiction a, manifestement, entendu faire prédominer l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du dommage
- Résurgence de la faute
- L’adoption de la théorie de la garde matérielle par la Cour de cassation repose sur l’idée qu’il serait inconcevable que l’on condamne le propriétaire de la chose, alors qu’il n’avait aucun moyen d’empêcher la production du dommage.
- Autrement dit, celui à qui l’on vole sa chose n’est pour rien dans le fait que celle-ci ait causé un dommage
- Aussi, l’idée sous-jacente est que le propriétaire de la chose ne saurait engager sa responsabilité si sa conduite est totalement étrangère à la production du dommage.
- Dans la mesure où, il n’y est pour rien, il ne doit pas être condamné à payer
- Avec l’arrêt Franck, on assiste alors à une résurgence de la faute, dont on devine qu’elle justifie ici l’adoption par la Cour de cassation de la conception matérielle de la garde.
- La responsabilité aurait été beaucoup plus objective si elle avait fait application de la théorie de la garde juridique.
Au total, il apparaît que la solution adoptée par la Cour de cassation dans l’arrêt Franck est à contre-courant du mouvement d’objectivation de la responsabilité engagé par l’arrêt Teffaine d’abord, puis par l’arrêt Jand’heur.
?Confirmation de l’arrêt Franck
Malgré les critiques dont il a fait l’objet, l’arrêt Franck a été confirmé à de nombreuses reprises par la Cour de cassation, laquelle conserve, encore aujourd’hui, la même définition de la notion de garde.
- Dans un arrêt du 26 mars 1971, la chambre mixte a insisté sur le fait que « la responsabilité du dommage cause par le fait d’une chose inanimée est liée à l’usage qui en est fait ainsi qu’aux pouvoirs de direction et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde » (Cass. ch. mixte, 26 mars 1971, n°68-11.171).
- Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a, de nouveau, martelé la définition de la garde, en affirmant que « est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n°10-10.232).
2. L’aptitude du gardien
Comme en matière de responsabilité du fait personnel, la Cour de cassation a, pendant longtemps, refusé que le gardien privé de discernement (aliéné mental et enfant en bas âge) puisse engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.
Dans un arrêt du 28 avril 1947, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article 1384, alinéa 1er (…) impliquent la faculté de discernement ».
La Cour de cassation justifie sa solution en considérant que dès lors que le gardien est privé de discernement, il ne saurait, par définition, exercer un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle de la chose.
Or il s’agit là d’une condition de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses. D’où l’impossibilité de retenir la responsabilité des enfants en bas âge et des déments sur le fondement de l’article 1384, al. 1er.
|
Cass. civ., 28 avr. 1947
La Cour; — Donne défaut contre les défendeurs; — Sur le moyen unique : — Attendu que l’arrêt attaqué (Lyon, 28 juill. 1941) déclare qu’il est constant que Girel était en état de démence au moment où la balle du revolver qu’il tenait à la main a atteint et mortellement blessé Escoffier, et que cet état n’est pas la conséquence d’une faute antérieure de sa part; — Attendu que de ces constatations souveraines la cour d’appel a pu déduire que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, dont se prévalaient les ayants droit d’Escoffier, ne saurait être retenue à l’encontre de Girel; — Attendu, en effet, que tant l’usage et les pouvoirs de direction et de contrôle, fondement de l’obligation de garde au sens de l’article précité, que l’imputation d’une responsabilité présumée, impliquent la faculté de discernement; — D’où il suit que l’arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; — Par ces motifs, rejette…
|
?Première évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité du dément
Dans un arrêt Trichard du 18 décembre 1964, la Cour de cassation a estimé que « qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du Code pénal (C. pén., art. 122-1) ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien ».
Ainsi, la haute juridiction reconnaît-elle, pour la première fois, que la privation de discernement du gardien ne faisait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er du Code civil lorsque la chose qu’il avait sous sa garde a causé un dommage (Cass. 2e civ., 18 déc. 1964).
|
Arrêt Trichard
(Cass. 2e civ., 18 déc. 1964)
Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte de l’arrêt attaque, rendu après renvoi de cassation le 11 février 1959 d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix du 20 novembre 1956, que Trichard, conduisant sa voiture automobile, heurta, en la dépassant, une charrette menée par Piccino;
Que, projeté a terre et blesse, ce dernier assigna en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384, paragraphe 1, du code civil, Trichard, qui, sur le plan pénal, avait bénéficié d’une décision de relaxe au motif que, victime d’une crise d’épilepsie, il se trouvait, au moment des faits, en état de démence au sens de l’article 64 du code pénal;
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt d’avoir retenu la responsabilité de Trichard en sa qualité de gardien du véhicule ayant causé l’accident, alors que le dément se trouverait exonère de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1, du code civil;
Mais attendu que, pour décider que Trichard devrait, par application du texte susvisé, réparer l’intégralité du préjudice souffert par Piccino, l’arrêt relevé, à bon droit, qu’une obnubilation passagère des facultés intellectuelles, qu’elle soit qualifiée de démence au sens de l’article 64 du code pénal, ou qu’elle procède d’un quelconque malaise physique, n’est pas un événement susceptible de constituer une cause de dommage extérieure ou étrangère au gardien;
Attendu que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justement déduit que l’absence épileptique au cours de laquelle s’était produit l’accident, n’avait pas pour effet d’exonérer Trichard de la responsabilité qui pesait sur lui en sa qualité de gardien;
D’où il suit que le moyen n’est pas fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 13 mars 1961 par la cour d’appel de Nîmes.
|
La cour de cassation va réitérer plus nettement la solution retenue dans l’arrêt Trichard dans une décision du 1er mars 1967 où elle affirme, sans ambiguïté, que « celui qui exerce sur une chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, conserve la qualité de gardien, même s’il n’est pas en mesure d’exercer correctement lesdits pouvoirs » (Cass. 2e civ., 1er mars 1967)
?Deuxième évolution : admission légale de la responsabilité du dément
L’évolution jurisprudentielle engagée par l’arrêt Trichard fut consacrée par la loi du 3 janvier 1968 qui introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
Cette disposition prévoit que « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »
?Troisième évolution : admission jurisprudentielle de la responsabilité de l’infans
Tout comme en matière de responsabilité du fait personnel, le sort de l’infans a suivi celui du dément, ce, indépendamment de l’intervention du législateur.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle décidé dans un arrêt Gabillet du 9 mai 1984, soit le même jour que les arrêts Fullenwarth, Lemaire et Derguini que les juges du fond n’avaient pas à rechercher si le gardien de la chose ayant causé un dommage, un infans en l’occurrence dans l’arrêt en l’espèce, était doué de discernement.
|
Arrêt Gabillet
(Cass. ass. plén., 9 mai 1984)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 12 mai 1980), que le 30 juin 1975, l’enfant Eric X…, alors âgé de 3 ans, en tombant d’une balançoire improvisée constituée par une planche qui se rompit, éborgna son camarade Philippe Y… avec un bâton qu’il tenait à la main ; que M. Lucien Y…, agissant en qualité d’administrateur légal des biens de son fils, assigna ses parents, les époux X…, en tant qu’exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l’accident ainsi survenu ; Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Eric X… responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors, selon le moyen, que l’imputation d’une responsabilité présumée implique la faculté de discernement ; que la Cour d’appel a donc violé par fausse application l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil ; Mais attendu qu’en retenant que le jeune Eric avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton, la Cour d’appel qui n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 12 mai 1980 par la Cour d’appel d’Agen
|
Par cet arrêt, la Cour de cassation abandonne donc définitivement l’exigence de discernement du gardien.
La Cour de cassation n’opère plus aucune distinction entre le dément et l’enfant : les deux sont susceptibles d’engager leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384, al. 1er dès lors qu’est établie leur qualité de gardien.
?Observations
Si, cette solution est parfaitement cohérente avec l’évolution de la notion de faute, elle l’est moins avec le maintien par la Cour de cassation du recours à la théorie de la garde matérielle.
En effet, comment la Cour de cassation peut-elle justifier le fait qu’elle dénie au propriétaire d’une chose qui a causé un dommage la qualité de gardien dès lors qu’il n’avait pas sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle alors qu’elle admet, en parallèle, qu’un infans puisse posséder pareil pouvoir ?
Lorsqu’une personne est privée de discernement, peut-on raisonnablement affirmer qu’elle possède un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur les choses qu’elle détient ? On est légitimement en droit d’en douter.
C’est la raison pour laquelle on peut reprocher à la Cour de cassation le manque de cohérence de sa jurisprudence
Si donc elle voulait être cohérente, il faudrait qu’elle abandonne l’application de la théorie de la garde matérielle, pour consacrer la théorie de la garde juridique.
Car si le dément ou l’enfant en bas âge peut sans aucune difficulté endosser la qualité de propriétaire, on peut difficilement concevoir qu’il exerce un pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur une chose et donc être désigné comme gardien de la chose qui a causé un dommage.
3. La désignation du gardien
a. La présomption de garde
Bien que ce soit la définition matérielle de la garde qui ait cours, les rapports de droit qu’entretiennent les agents entre eux ne sont pas ignorés dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.
C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation ne rejette pas totalement la théorie de la garde juridique, ce pour une raison simple : elle fait peser sur le propriétaire de la chose qui a causé un dommage une présomption de garde.
Le propriétaire est présumé gardien dans deux hypothèses distinctes :
- Lorsqu’il exerce un pouvoir direct sur la chose
- Il s’agit de l’hypothèse où le propriétaire est aussi le détenteur de la chose
- Les trois éléments constitutifs de la garde sont ici réunis, de sorte que cette situation ne soulève, a priori, guère de difficulté
- Lorsqu’il exerce un pouvoir indirect sur la chose
- Il s’agit de l’hypothèse où la chose est détenue par un préposé
- En raison du lien de subordination, si le préposé à l’usage de la chose, le propriétaire conserve le pouvoir de direction et de contrôle.
- Ainsi, existe-t-il une incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé.
b. Le renversement de la présomption
La présomption de garde posée par la jurisprudence est une présomption simple, de sorte que le propriétaire de la chose qui a causé un dommage peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas de pouvoir d’usage de direction et de contrôle sur la chose au moment de la réalisation du dommage.
Il doit, en d’autres termes, prouver que la garde de la chose a été transférée à un autre gardien !
Toutefois, le combat de cette présomption pourra s’avérer difficile, celle-ci relevant, en certains cas, de la pure fiction.
Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle pu estimer que l’on pouvait être gardien de la chose qui a causé un dommage, sans le savoir.
Dans un arrêt rendu en date du 23 janvier 2003 où la haute juridiction a condamné en ce sens le propriétaire d’un immeuble sur le fondement de l’article 1384, al. 1er alors que celui-ci ignorait la présence d’un détonateur dans son immeuble qui avait installé pour extraire des pierres de construction et dont le déclenchement a occasionné de nombreuses lésions à un ouvrier qui se trouvait sur le chantier (Cass. 2e civ., 23 janv. 2003 n°01-11.043).
La cour de cassation a, en effet, considéré que « la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et [de sorte] que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ».
|
Cass. 2e civ., 23 janv. 2003
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 mars 2001), que M. Gérard X…, ouvrier carreleur de l’entreprise Sagne chargé d’exécuter des travaux de carrelage dans la maison appartenant à Mme Y… épouse Z…, alors en cours de rénovation, a été blessé par une explosion survenue après qu’il y eut jeté une chute de carrelage dans un tas de gravats ; que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne ayant versé à la victime des indemnités journalières et une rente d’invalidité d’accident du travail, a assigné Mme Z… et son assureur, le Groupama, en responsabilité et remboursement, en présence de M. X… ; qu’une expertise a établi que l’explosion provenait d’un détonateur de type ancien placé dans les gravats ;
Attendu que Mme Z… et son assureur font grief à l’arrêt d’avoir déclaré Mme Z… responsable de l’accident et de l’avoir condamnée in solidum avec le Groupama à verser des provisions à la CPAM et M. X…, alors, selon le moyen : […]
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l’arrêt relève que le détonateur, qui avait été transmis à Mme A… avec la propriété de l’immeuble par son père, appartenait à celle-ci ; qu’elle a reconnu que son père, ancien employé de la Manufacture d’armes de Tulle en 1936, utilisait, selon une pratique locale alors répandue, des détonateurs pour extraire des pierres de construction ; que Mme Z… ne démontrait pas que la garde de cet objet avait été transférée à l’entreprise, dès lors qu’il se trouvait dans les gravats entreposés dans la cour de son immeuble et provenant de la démolition récente d’un mur de la maison ; qu’enfin, l’expert ayant admis qu’un jet de carreau sur les gravats avait pu suffire au déclenchement de l’explosion, Mme Z… ne démontrait pas que M. X… eût commis une faute, alors que, s’agissant d’un matériel spécifique de type ancien, cet ouvrier, qui travaillait dans des conditions normales ne pouvait imaginer qu’il pût s’agir d’un détonateur dangereux ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, procédant d’une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d’appel a pu retenir que la seule présence du détonateur, quelqu’en fût l’origine, sur la propriété de Mme Z… la constituait gardienne de cette chose, et a pu décider que le transfert de la garde du détonateur à l’entreprise de carrelage n’était pas établi et que la victime n’avait pas commis de faute ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
c. Le transfert de la garde
Dans la mesure où le propriétaire de la chose est présumé être le gardien, cela signifie qu’on l’autorise à renverser cette présomption, ce qui suppose qu’il démontre qu’une autre personne que lui exerçait un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose au moment du dommage.
Autrement dit, le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu un transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs.
Deux situations doivent être distinguées :
?Le transfert de la garde est involontaire
L’examen de la jurisprudence révèle que le transfert involontaire de la garde fera toujours tomber la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose.
Il appartient, néanmoins, au propriétaire de démontrer que le transfert de la garde était bien involontaire.
?Le transfert de la garde est volontaire
- Effets variables
- Dans l’hypothèse où le propriétaire a exprimé la volonté de se déposséder de la chose qui a causé un dommage le transfert de la garde ne fera pas toujours tomber la présomption de garde
- Le propriétaire devra démontrer qu’il y a eu transfert de la garde dans tous ses éléments constitutifs (pouvoir de d’usage, de direction et de contrôle).
- Cas d’admission du transfert de la garde
- La Cour de cassation admet qu’il y a un transfert de la garde dans le cadre de la relation entre :
- Cas de non-admission du transfert de la garde
- La Cour de cassation estime ainsi qu’il y a une incompatibilité entre les qualités de :
- Critères d’appréciation
- Pour renverser la présomption de garde, le propriétaire doit établir qu’il a transféré :
- le pouvoir d’usage de la chose
- la maîtrise intellectuelle de la chose (direction et contrôle)
- Une illustration de cette exigence peut être trouvée dans un arrêt du 19 juin 2003.
- La Cour de cassation a estimé dans cette décision qu’il n’y avait pas transfert de garde dans le cadre d’une relation de courtoisie (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n°01-17.575)
- Il s’agissait en l’espèce du prêt d’une tondeuse entre voisins.
- La Cour de cassation valide la décision des juges du fonds qui ont refusé de reconnaître le transfert de garde, estimant que le propriétaire de la chose « n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété »
- Ainsi, ressort-il de cet arrêt que le prêt d’une chose n’entraîne pas le transfert de garde lorsque l’usage est :
- Circonscrit dans le temps
- Circonscrit dans l’espace
- Effectué dans l’intérêt exclusif du propriétaire
|
Cass. 2e civ., 19 juin 2003
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2001), que, le 16 avril 1998, M. X…, tondant la pelouse de M. Y…, s’est blessé aux doigts en voulant dégager de l’herbe coincée sous la lame de la tondeuse appartenant à ce dernier ; que M. X… a assigné M. Y… en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable du dommage subi par M. X… et de l’avoir condamné à réparer l’intégralité de son préjudice, alors, selon le moyen, qu’est gardien de la chose son utilisateur qui, en dehors de tout lien de subordination envers le propriétaire, en a l’usage, la direction et le contrôle ; qu’en se fondant pour considérer que M. X…, qui selon ses propres constatations tondait la pelouse de M. Y… avec la tondeuse de ce dernier, n’était pas gardien de la tondeuse, sur la circonstance exclusive de tout lien de subordination qu’il n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété, la cour d’appel a violé l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir énoncé que le propriétaire d’une chose est réputé en avoir la garde, que, bien que la confiant à un tiers, il ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de la chose, retient que M. Y… n’avait confié sa tondeuse à M. X… que pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt, que M. X… n’avait pas été autorisé à se servir de la tondeuse pour son usage personnel, ni à la sortir de la propriété ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que M. Y… était demeuré gardien de la tondeuse ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
|
Au total, il apparaît que la garde est alternative, en ce sens que deux personnes ne sauraient être qualifiées de gardiens dès lors qu’elles exercent des pouvoirs sur la chose à des titres différents.
Toutefois, comment faire lorsque des personnes auront une maîtrise commune de la chose, exerçant sur elle un pouvoir au même titre. Tel sera le cas des copropriétaires ou des coemprunteurs.
Dans cette situation, on parle de garde commue ou collective.
d. La garde collective
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose
- Plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs, tantôt de pouvoirs différents
i. Première hypothèse : Un groupe composé de personnes exerçant les mêmes pouvoirs sur la chose
?Admission de l’exercice d’une garde commune des membres d’un même groupe
Dans un arrêt du 20 novembre 1968, la Cour de cassation a admis que la garde pouvait être exercée en commun par les membres d’un même groupe (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
- Faits
- Il s’agissait en l’espèce d’un joueur de tennis qui, dans le cadre d’une compétition, sert deux balles d’essai dont la seconde atteint l’œil droit de l’autre joueur
- Action en réparation engagée à l’encontre de l’auteur du dommage.
- Procédure
- Dans un arrêt du 26 mai 1966, la Cour d’appel de Besançon déboute le demandeur de son action en responsabilité estimant que la victime avait accepté les risques inhérents au jeu.
- Solution
- Si la Cour de cassation valide la décision des juges du fond, elle justifie sa solution sur un fondement différent
- La deuxième chambre civile estime, en effet que :
- La Cour d’appel « ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas à Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa ».
- Analyse de l’arrêt
- Deux enseignements peuvent être retirés de la décision rendue par la Cour de cassation
- Définition de la garde
- L’intérêt de cet arrêt réside essentiellement dans la définition que la Cour de cassation donne de la garde commune.
- Pour la Cour de cassation il y a garde commune lorsque les mêmes du groupe exercent les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur la chose
- En l’espèce, on pouvait estimer qu’il y avait garde commune, dans la mesure où les joueurs de tennis jouent l’un avec l’autre : ils ont donc le même pouvoir sur la chose
- Incompatibilité entre les qualités de victimes et de gardien en cas de garde commune
- Il ressort de cette décision que dès lors que la victime exerçait une garde commune avec l’auteur du dommage, elle ne saurait obtenir réparation
- On ne peut donc pas cumuler, dans l’hypothèse de la garde commune, les qualités de victime et de gardien.
- Portée de l’arrêt
- La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 20 novembre 1968 a été confirmée à plusieurs reprises.
- Ainsi, la responsabilité commune des membres d’un même groupe a été retenue dans plusieurs situations :
- Partie de chasse où le tireur ayant blessé l’un de ses partenaires n’a pas pu être identifié (Cass. 2e civ., 15 déc. 1980, n°79-11.314)
- Réunion de d’un groupe de fumeurs dont l’un d’eux a provoqué un incendie un jetant sur le sol son mégot de cigarette non consumé (Cass. 2e civ., 14 juin 1984)
|
Cass. 2e civ. 20 nov. 1968
Sur le premier moyen : attendu que selon l’arrêt infirmatif attaque, sur un court de tennis, ou débutait une Competition sportive, le jeune Saugier, servit deux balles d’essai dont la seconde atteignit à l’œil droit Forestier Marechal, l’un des joueurs adverses ;
Que celui-ci a demandé la réparation du dommage subi a Saugier père, représentant légal de son fils mineur, sur le fondement des articles 1382 et 1384, 1er alinéa, du code civil ;
Que la caisse primaire de sécurité sociale du Jura est intervenue a l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande, alors qu’il résulterait de ses propres constatations que Saugier aurait commis une maladresse, en envoyant sa seconde balle d’essai, non pas dans la direction diagonale comme l’aurait commande la règle du jeu, mais du cote oppose ;
Mais attendu que l’arrêt, s’il a constaté que la balle litigieuse avait été envoyée non pas dans la direction du carré de service du relanceur mais dans celle du carré de son partenaire, observe qu’il s’agirait là tout au plus même si la balle n’avait pas été qu’une balle d’essai, d’une irrégularité de service, mais non d’une maladresse entrainant la responsabilité civile du joueur ;
Qu’il ajoute qu’aucun renseignement n’avait été donne sur la façon dont la balle avait été lancée ;
Qu’en déduisant de ces énonciations que la preuve n’avait pas été faite d’une faute du jeune Saugier et que celui-ci n’était pas responsable sur le fondement de l’article 1382, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la responsabilité de Saugier, fondée sur l’article 1384, 1er alinéa, aurait été écartée à tort, au motif que la victime avait accepté le risque inhérent au jeu, alors que cette acceptation ne pourrait constituer pour l’auteur du dommage, une cause d’exonération, que si elle avait été fautive ;
Mais attendu que l’arrêt constate que le service des balles d’essai autorise par l’arbitre et fait alors que les joueurs étaient tenus d’être à leur place, s’était inséré dans le match dont il avait constitué le préliminaire, destine à permettre aux joueurs d’étudier le jeu de leurs adversaires ;
Attendu qu’ayant constaté qu’au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle, la cour d’appel a pu déduire que cet usage commun de l’instrument du dommage ne permettait pas a Forestier Marechal de fonder son action sur l’article 1384, 1er alinéa, et sans encourir les critiques du pourvoi a donné une base légale a sa décision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 26 mai 1966 par la cour d’appel de Besançon.
|
ii. Seconde hypothèse : plusieurs groupes investis tantôt des mêmes pouvoirs dans chaque groupe, tantôt de pouvoirs différents
?Admission de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe
Dans un arrêt du 7 novembre 1988 la Cour de cassation a retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où deux groupes différents étaient investis des mêmes pouvoirs dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 7 nov. 1988, n°87-11.008 et 87-17.552).
- Faits
- Au cours d’un jeu collectif entre deux groupes d’enfants jouant aux Indiens, l’un d’eux qui appartenait au groupe des assiégeants est blessé à l’œil par une flèche de l’un des assiégés
- L’auteur du dommage n’ayant pas pu être identifié, action des parents à l’encontre du père de l’un des enfants de l’autre groupe.
- Procédure
- Par un arrêt du 5 décembre 1986, la Cour d’appel de Colmar déboute les parents de la victime de leur action en réparation.
- Les juges du fond estiment que la garde appartenait au groupe des assiégés, de sorte que « sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ».
- Solution
- La Cour de cassation censure la décision des juges du fond considérant que « lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage ».
- Autrement dit, pour la Cour de cassation les membres du groupe assiégé ont exercé une garde commune de la chose, de sorte que chacun d’eux engage sa responsabilité.
- Analyse de l’arrêt
- L’intérêt de l’arrêt est double
- Celui qui lance décoche une flèche n’a pas le même pouvoir que celui qui la reçoit
- Il ne saurait donc y avoir garde commune dans l’hypothèse où l’archer serait identifié (situation différente de la balle de tennis)
- Chaque membre du groupe-gardien pris isolément engage sa responsabilité à l’égard de la victime lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié
|
Cass. 2e civ., 7 nov. 1988
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-11. 008, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi n° 87-17.552 :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l’article 1203 de ce Code ;
Attendu que lorsque la garde d’une chose instrument d’un dommage est exercée en commun par plusieurs personnes, chacun des cogardiens est tenu, vis-à-vis de la victime, à la réparation intégrale du dommage;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’au cours d’un jeu collectif, le mineur X… qui, avec plusieurs enfants, attaquait une baraque défendue par un autre groupe, a été blessé à l’oeil par l’un des ” assiégés “, tous armés de flèches ; que l’auteur du jet de flèche n’ayant pu être identifié, les consorts X… ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Y…, père d’un des ” assiégés “, et à son assureur, la Mutuelle de la ville de Thann ; que la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse est intervenue à l’instance ;
Attendu que pour débouter les consorts X… de leurs demandes, l’arrêt, après avoir retenu que la garde de l’instrument du dommage appartenait au groupe des assiégés, énonce que, sur le fondement d’une responsabilité collective, la responsabilité d’un seul membre du groupe ne pouvait être retenue sans provoquer la mise en cause des autres ;
En quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
|
?Rejet de l’exercice d’une garde commune entre les membres de plusieurs groupes investis de pouvoirs différents dans chaque groupe
Dans un arrêt du 28 mars 2002, la Cour de cassation n’a pas retenu la qualification de garde commune dans l’hypothèse où les membres de deux groupes étaient investis de pouvoirs différents dans chaque groupe (Cass. 2e civ., 28 mars 2002, n°00-10.628).
- Faits
- Une jeune fille participant à une partie de base-ball improvisée est blessée à l’œil droit par une balle de tennis relancée en sa direction au moyen d’une raquette de tennis au lieu d’une batte de base-ball
- Action en réparation engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
- Procédure
- Par un arrêt du 11 janvier 1999, la Cour d’appel d’Orléans déboute la victime de sa demande de réparation
- Les juges du fond estiment que la victime exerçait la garde commune de la chose, instrument du dommage, de sorte qu’elle n’était pas fondée à obtenir réparation de son préjudice
- Solution
- La Cour de cassation rejette la qualification de garde commune, considérant que la chose, instrument du dommage, n’était pas la balle, comme soutenu par la Cour d’appel, mais la raquette.
- Or seul l’auteur du dommage exerçait sur elle un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle
- La Cour de cassation affirme en ce sens que « la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage »
- Analyse de l’arrêt
- De toute évidence, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce apparaît pour le moins surprenante si on la rapproche de l’arrêt du 20 novembre 1968 où la Cour de cassation avait retenu la qualification de garde commune s’agissant d’une partie de tennis (Cass. 2e civ. 20 nov. 1968).
- Est-ce à dire que la deuxième chambre civile a entendu revenir sur cette solution ?
- Deux analyses sont possibles :
- Première analyse
- Au tennis, chaque joueur est gardien de sa raquette, de sorte que l’on pourrait envisager de retenir la responsabilité des joueurs pris individuellement sur le fondement de l’article 1384, al. 1er
- Ils ne pourraient donc plus être considérés comme exerçant une garde commune.
- Seconde analyse
- Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait garde commune, il est nécessaire que chaque agent exerce les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’instrument du dommage.
- Or en l’espèce, les joueurs n’exercent pas le même pouvoir sur la balle, car l’un l’utilise à main nue alors que l’autre a en sa possession une raquette de tennis
- Dès lors, parce qu’ils n’utilisent pas le même type d’instrument, ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle
- Et comme ils n’exercent pas les mêmes pouvoirs sur la balle, il ne saurait y avoir de garde commune
- La solution adoptée dans l’arrêt du 20 novembre 1968 ne serait donc pas caduque.
|
Cass. 2e civ., 28 mars 2002
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la mineure Dounia X…, participant à un jeu collectif improvisé inspiré du base-ball, a été blessée à l’oeil droit par une balle de tennis relancée en sa direction par le jeune Mohamed Y… au moyen d’une raquette de tennis tenant lieu de batte de base-ball ;
Attendu que pour rejeter l’action en réparation de M. Omar X…, ès qualités d’administrateur légal des biens de sa fille Dounia, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que l’usage commun de la balle de tennis, instrument du dommage, n’autorisait pas la joueuse blessée à réclamer réparation sur le fondement du texte susvisé ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la balle de tennis avait été projetée vers la victime par le moyen d’une raquette de tennis dont le jeune Mohamed Y… avait alors l’usage, la direction et le contrôle, ce dont il résultait que la raquette avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
|
?Remise en cause de l’appréciation de la notion de garde commune ?
Dans un arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation a adopté une solution que certains auteurs ont interprétée comme annonciatrice d’un changement d’appréciation de la notion de garde commune (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884).
- Faits
- Au cours d’une partie de football, un joueur est blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par le gardien de but de l’équipe adverse
- Action en réparation engagée contre l’auteur du dommage sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
- Procédure
- Dans un arrêt du 13 janvier 2003, la Cour d’appel d’Angers déboute la victime de sa demande de réparation estimant que « lors d’un jeu collectif comme un match de football… les joueurs ont dans leur ensemble la garde collective du ballon et l’un des joueurs ne peut avoir au cours de l’action la qualité de gardien de la balle par rapport à un autre joueur” et que “celui qui le détient (le ballon)… est contraint de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires… (de sorte) qu’au cours d’un match de football, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction »
- Ainsi, pour les juges du fond, dans la mesure où les joueurs exerçaient une garde commune du ballon, la victime ne pouvait, obtenir réparation de son préjudice, en raison de l’incompatibilité qui existe entre les qualités de victime et de gardien.
- Solution
- La Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel, considérant qu’il y avait bien garde commun du ballon
- Elle affirme en ce sens que « au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé »
- Si de prime abord, la solution retenue par la Cour de cassation ne paraît pas contestable, dans la mesure où tous les joueurs exercent bien les mêmes pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur le ballon, la motivation de l’arrêt est pour le moins étonnante.
- Pour justifier l’absence d’indemnisation de la victime la Cour de cassation tient le raisonnement suivant :
- Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
- Comme il y a garde collective, aucun des joueurs ne donc être désigné comme gardien individuellement
- Dès lors, il n’y a pas de responsable ce qui prive la victime de toute action en réparation
- Tel n’est cependant pas le raisonnement qu’elle tient habituellement.
- Dans la jurisprudence antérieure, pour refuser à la victime son droit à indemnisation, elle raisonnait de la manière suivante :
- Tous les joueurs de football exercent les mêmes de pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur la chose, de sorte qu’il y a garde collective
- Dès lors qu’il y a garde collectif, alors tous les membres du groupe doivent être désignés comme gardiens
- Le joueur ayant subi le dommage ne pouvant pas cumuler les qualités de victime et de gardien, il ne peut donc prétendre à indemnisation.
- En résumé :
- Dans la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considère que garde collective implique que chacun des membres du groupe est gardien
- Dans l’arrêt en l’espèce, la haute juridiction estime que la garde collective implique que personne n’est gardien.
- Critiques
- Dans l’hypothèse où le groupe dont les membres exercent une garde commune de la chose, instrument du dommage, est une personne morale, la solution retenue en l’espèce permettrait éventuellement de rechercher la responsabilité du groupement
- Toutefois, dans l’hypothèse où le groupe n’est pas une personne morale, la victime ne peut se retourner contre personne, elle est sans débiteur, dans la mesure où aucun des membres des groupes n’est gardien.
- Cette hypothèse se rencontrera notamment lorsque la victime sera un spectateur, soit une personne étrangère au groupe et qui donc échappe à la qualification de gardien.
|
Cass. 2e civ., 13 janv. 2005
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 15 janvier 2003), que M. X…, alors qu’il participait à une rencontre amicale de football, a été blessé par le choc contre sa tête du ballon frappé du pied par M. Y…, gardien de but de l’équipe adverse ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y… et la Ligue du Maine de football, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (la CPAM) ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 03-18.918 et sur les trois autres branches du moyen unique du pourvoi n° S 03-12.884, réunis :
Attendu que M. X… et la CPAM font à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’au cours du jeu collectif comme le football, qu’il soit amical ou pratiqué dans une compétition officielle, tous les joueurs ont l’usage du ballon mais nul n’en a individuellement le contrôle et la direction ; que l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci ; que le joueur qui a le ballon est contraint en effet de le renvoyer immédiatement ou de subir les attaques de ses adversaires qui tentent de l’empêcher de le contrôler et de le diriger, en sorte qu’il ne dispose que d’un temps de détention très bref pour exercer sur le ballon un pouvoir sans cesse disputé ; qu’en l’espèce, M. Y… a dû sortir de la surface de réparation et ne pouvait donc se saisir du ballon sans commettre une faute ; que, sous la menace de M. X…, il a choisi de renvoyer immédiatement le ballon qu’il n’a pu contrôler et qu’il a frappé en “demie volée” ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit à bon droit qu’au moment de l’accident, M. Y… ne disposait pas sur le ballon des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde de la chose instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
|
B) Le fait de la chose
Que doit-on entendre par fait de la chose ? De quel fait parle-t-on ?
Faut-il un rôle actif de la chose dans la production du dommage ou une simple participation causale suffit ?
Autrement dit, est-il seulement nécessaire que la chose intervienne dans la réalisation du dommage ou faut-il qu’elle en soit la véritable cause ?
Manifestement, la nature du rapport entre le fait de la chose et le dommage a été source, pour la jurisprudence et la doctrine, de nombreuses interrogations.
Aussi, afin de dresser un état du droit positif en la matière, convient-il d’exposer les solutions traditionnelles rendues par la Cour de cassation, puis de s’interroger sur la possible remise en cause de ces solutions au regard de la jurisprudence récente.
1. Les solutions jurisprudentielles traditionnelles
Selon la jurisprudence classique, il est nécessaire que la chose ait été l’instrument du dommage pour que son gardien engage sa responsabilité.
Ainsi, estime-t-on qu’une chose parfaitement inerte, qui n’est pas dans une position anormale, dont le fonctionnement n’est pas anormal, dont l’état n’est pas non plus anormal ou qui n’est pas dans une position anormale, ne peut être considérée comme l’instrument du dommage.
?Exigence d’un rôle actif de la chose
Pour être l’instrument du dommage, il faut donc que la chose ait joué un rôle actif dans la production du dommage.
Telle est l’exigence posée par la Cour de cassation dans un célèbre arrêt Dame Cadé du 19 février 1941 (Cass. civ., 19 févr. 1941).
|
Arrêt Dame Cadé
(Cass. civ., 19 févr. 1941)
La Cour; — Sur le moyen additionnel, lequel est préalable… — (sans intérêt); — Et sur le premier moyen : — Attendu que la dame Cadé, prise d’un malaise dans une cabine de l’établissement de bains municipal de la ville de Colmar, s’est affaissée sur le sol et a été brûlée au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central; que les époux Cadé ont assigné la Ville de Colmar en se fondant notamment tant sur la faute de la surveillante des bains, préposée de la ville, qui, appelée par la malade, aurait eu le tort de ne pas demeurer un temps suffisant auprès d’elle, que sur l’article 1384, § 1er, du Code civil, en raison du dommage causé par la tuyauterie dont la ville avait la garde, ainsi que sur la responsabilité contractuelle de la ville; qu’ils ont été déboutés par la cour d’appel de Colmar (arrêt du 23 janv. 1937), motif pris, d’une part, de ce que la préposée n’avait commis aucune faute, d’autre part, de ce que l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte, et enfin de ce que, si le contrat intervenu entre l’établissement de bains et la dame Cadé comportait l’obligation de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de sa cliente, il n’impliquait pas celle de la garantir contre un état de santé défectueux que l’établissement ignorait; — Attendu que le pourvoi, abandonnant le terrain de la responsabilité contractuelle, fait en premier lieu grief à cette décision d’avoir écarté la présomption de responsabilité qui, en vertu de l’article 1384, § 1er, du Code civil, pesait sur la ville de Colmar, sans établir soit la force majeure, soit la faute exclusive de la victime; — Mais attendu que, pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage; qu’il résulte des constatations des juges du fond que tel a été le cas en l’espèce, la tuyauterie contre laquelle la dame Cadé s’est affaissée se trouvant installée dans des conditions normales et la cause génératrice du dommage résidant tout entière dans la syncope qui a fait tomber la dame Cadé de la chaise où elle était assise, et a permis qu’elle demeurât inanimée en contact avec un tube chaud assez longtemps pour être brûlée; — Attendu que les demandeurs reprochent encore à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu le caractère fautif des agissements de la surveillante de l’établissement de bains, préposée de la ville, mais que cette critique n’est pas mieux fondée que la première; qu’en effet, l’absence de faute de la femme de service résulte des constatations mêmes de la cour d’appel, qui relève qu’appelée par la dame Cadé, elle lui est venue en aide dans la mesure où cette dernière le lui a demandé; — Attendu qu’il suit de là que, loin de violer les textes visés au moyen, l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en a fait une exacte application; — Par ces motifs, rejette…
|
- Faits
- La cliente d’un établissement municipal de bains est prise d’un malaise.
- Il s’ensuit une chute
- La cliente se brûle alors au bras par le contact prolongé d’un tuyau du chauffage central.
- Elle engage une action en responsabilité contre l’établissement.
- Procédure
- Par un arrêt du 23 janvier 1937, la Cour d’appel de Colmar déboute la victime de sa demande de réparation.
- Les juges du fond estiment que « l’accident a eu pour cause le malaise de la dame Cadé, qui a provoqué sa chute au contact d’un tuyau du chauffage central, et non ce tuyau, qui n’a joué qu’un rôle purement inerte »
- Ils estiment, en d’autres termes, que ce n’est pas le fait de la chose qui a été l’instrument du dommage.
- Pour la Cour d’appel, seule la chute en est la cause
- Solution
- La Cour de cassation valide la solution retenue par les juges du fond.
- Elle estime en ce sens que « pour l’application de l’article 1384, § 1er, du Code civil, la chose incriminée doit être la cause du dommage; que si elle est présumée en être la cause génératrice dès lors qu’inerte ou non elle est intervenue dans sa réalisation, le gardien peut détruire cette présomption en prouvant que la chose n’a joué qu’un rôle purement passif, qu’elle a seulement subi l’action étrangère génératrice du dommage ».
- Autrement dit, la haute juridiction estime que pour que l’on puisse considérer que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
- La Cour de cassation précise qu’il importe peu que la chose ait été inerte ou en mouvement
- Ce qui compte c’est le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
- Or en l’espèce, le tuyau ne présentait aucune anormalité, ni dans sa position, ni dans son fonctionnement, ni dans son état.
- Le tuyau était parfaitement à sa place, d’où l’absence de rôle actif de la chose.
?Confirmation de l’exigence de rôle actif
Dans un arrêt du 11 janvier 1995, la Cour de cassation à réaffirmer l’exigence de rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n°92-20.162).
|
Cass. 2e civ., 11 janv. 1995
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état n’est pas rapportée ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, monté, à l’occasion d’une expertise, sur la toiture de l’immeuble de M. X…, constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d’éclairement, en matériau translucide, qui s’est brisée sous son poids ; qu’ayant été blessé dans sa chute, M. Y… a demandé réparation de son préjudice à M. X… et à son assureur la compagnie Groupama ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu’en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;
Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon.
|
- Faits
- Une plaque d’éclairement, en matériau translucide positionné sur la toiture d’un immeuble se prise sous le poids d’un ouvrier qui se blesse en chutant
- La victime engage une action en responsabilité contre le propriétaire de l’immeuble
- Procédure
- Par un arrêt du 15 septembre 1992, la Cour d’appel de Nancy fait droit à la demande d’indemnisation de la victime
- Les juges du fond estiment que « en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l’instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état »
- Solution
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel en rappelant que pour que la chose puisse être considérée comme l’instrument du dommage, il est nécessaire qu’elle ait joué un rôle actif.
- Aussi, cela suppose-t-il que la victime démontre que la chose qui était inerte présentait une anormalité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
- Dès lors, la responsabilité du gardien ne saurait être recherchée.
Bilan:
Il ressort de la jurisprudence que pour qu’il y ait rôle actif de la chose, il faut donc qu’elle soit la cause réelle du dommage et non qu’elle y ait simplement contribué.
La jurisprudence raisonne ici en termes de causalité adéquate :
- Si l’on retient l’équivalence des conditions :
- sans le tuyau pas de dommage
- sans la plaque de Plexiglas pas de dommage non plus.
- Si l’on retient la causalité adéquate
- On doit se demander si la chose a joué un rôle majeur dans la production du dommage
- Pour le déterminer cela suppose d’établir que la chose présentait une anormalité :
- Soit dans sa structure
- Soit dans son fonctionnement
- Soit dans sa position
- Soit dans son état
?Présomption de rôle actif
- Instauration d’une présomption de rôle actif
- Afin de faciliter la preuve du rôle actif de la chose pour la victime, la Cour de cassation a instauré une présomption de rôle actif dans un arrêt du 28 novembre 1984 (Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n°83-14.718)
- La haute juridiction a ainsi reproché à une Cour d’appel d’avoir débouté une victime de sa demande d’indemnisation, celle-ci n’étant pas parvenue à établir le rôle actif de la chose alors que, selon la Cour de cassation, il y avait en l’espèce présomption de rôle actif.
- Pour la Cour de cassation, la charge de la preuve reposait donc, non pas sur la victime, mais sur le gardien de la chose.
- Domaine limité de la présomption de rôle actif
- Bien que la Cour de cassation instaure dans cette décision une présomption de rôle actif à la faveur de la victime, elle en délimite cependant le domaine d’application de façon restrictive.
- En effet, la présomption de rôle actif n’a vocation à s’appliquer que si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec la victime.
- Dans le cas contraire il appartiendra à la victime d’établir le rôle actif de la chose.
|
Cass. 2e civ., 28 nov. 1984
Sur le moyen relevé d’office après observation des formalités prévues à l’article 1015 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’article 1384, alinéa 1er du code civil ;
Attendu que pour l’application de cette disposition il suffit que la preuve soit rapportée pour la victime que la chose a été et ne fut-ce que pour partie l’instrument du dommage ;
Attendu selon l’arrêt infirmatif attaque, que sur une voie d’autoroute m. x… qui circulait a motocyclette heurta l’automobile de m. y… z… au moment où il entreprenait de la dépasser ;
que blesse il a assigné en réparation, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, m. y… z… et son assureur la compagnie u.a.p. ;
attendu que pour débouter m. x… de sa demande, l’arrêt après avoir relevé que ce motocycliste disposait d’un espace suffisant pour effectuer sa manœuvre de dépassement et que le changement de direction à gauche qu’il reprochait a m. y… z… n’était pas établi, retient que l’automobile de celui-ci avait joué un rôle passif dans la réalisation du dommage ;
Qu’en se déterminant par un tel motif tout en constatant qu’au moment de la collision l’automobile de m. y… z… était en mouvement, d’où il résultait quelle avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule l’arrêt rendu le 2 juin 1983 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
|
En résumé:
Pour la victime, afin d’établir le rôle actif de la chose, deux situations doivent être distinguées :
- La chose en mouvement
- MOUVEMENT + CONTACT = PRÉSOMPTION DE RÔLE ACTIF
- Dans l’hypothèse, très rare, d’absence de contact entre la chose et le siège du dommage, la présomption de rôle actif est écartée
- Il appartiendra donc à la victime de prouver que la chose est la cause de son dommage
- Exemple : le skieur qui chute en étant surpris par un autre skieur qui lui coupe la route sans le heurter doit établir le rôle actif de la chose (Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n°76-14.819)
- Pour ce faire, il devra démontrer l’anormalité de la chose, soit dans sa structure ou son état, soit dans son positionnement, soit dans son comportement.
- La chose inerte
- Dès lors que la chose est inerte, il apparaît difficile de présumer le lien de causalité : il est vraisemblable que le dommage est dû plutôt à l’activité de la victime qu’à l’intervention de la chose.
- Aussi, afin d’engager la responsabilité du gardien, il reviendra à la victime de rapporter la preuve du rôle actif de la chose en démontrant qu’elle présentait une anormalité
- Soit dans sa structure
- Soit dans son fonctionnement
- Soit dans sa position
- Soit dans son état
2. La possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles
Afin, d’apprécier la possible remise en cause des solutions jurisprudentielles traditionnelles, il convient de se tourner vers plusieurs arrêts qui concernaient tous des accidents dans lesquels étaient impliqués, tantôt des parois vitrées, tantôt une boîte aux lettres, tantôt un plot de signalisation.
?Le cas des parois vitrées
- Les faits
- Une victime se blesse en heurtant à une paroi vitrée qu’elle n’avait pas vue, laquelle paroi se brise.
|
Cass. 2e civ., 15 juin 2000
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X…, qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa assurances ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;
Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l’instrument du dommage, l’arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M. X… n’établissait pas qu’elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu’elle était
affectée d’un vice ou d’un défaut d’entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de ” Tecmaver ” n’ayant été relevée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage ressortait de ses propres constatations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
|
|
Cass. 2e civ., 19 févr. 2004
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 30 avril 2002), rendu sur renvoi après cassation (CIV .2, 15 juin 2000, Bull. n° 103, P. 70), que M. X…, alors qu’il pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s’est brisée et l’a blessé ; qu’il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies ; que l’Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ; que la Cour de cassation a annulé la décision rendue le 29 juin 1998 par la cour d’appel de Chambéry qui avait rejeté les demandes de M. X… et de l’Etat néerlandais au motif que la victime ne démontrait pas que la paroi vitrée avait été l’instrument du dommage ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le GIE et son assureur n’étaient solidairement responsables du dommage qu’il avait subi que dans la proportion de deux tiers, alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que la cour d’appel, en retenant souverainement que M. X… avait connaissance des lieux, qu’il venait de quitter pour y pénétrer à nouveau, a par ce seul motif caractérisé la faute d’inattention commise par celui-ci en venant se heurter à la paroi vitrée, dont elle a pu décider qu’elle avait concouru à la réalisation de son dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|
?Le cas de la boîte aux lettres
- Faits
- Un piéton se blesse en heurtant une boîte aux lettres qui débordait sur le trottoir de 40 cm et à une hauteur de 1m43
- Solution
- Dans un arrêt du 25 octobre 2001, la Cour de cassation casse la décision rendue par la Cour d’appel qui avait refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, estimant que « la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “, qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident »
- Autrement dit, pour les juges du fond, le rôle actif de la chose n’était pas établi.
- Tel n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui, au contraire, considère que « la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ. 25 oct. 2001, n°99-21.616).
|
Cass. 2e civ., 25 oct. 2001
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X… s’est blessée en heurtant la boîte aux lettres de M. Y… qui débordait de 40 centimètres et à une hauteur de 1 mètre 43 sur un trottoir de 1 mètre 46 de large ; qu’elle a demandé à M. Y… réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement énonce que la boîte aux lettres, répondant aux prescriptions de ” l’administration des PTT “, qui occupait une position normale et ne présentait aucun débordement excessif susceptible de causer une gêne, n’a pu jouer un rôle causal dans la réalisation de l’accident ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations, que la boîte aux lettres avait été, de par sa position, l’instrument du dommage, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d’instance de Nogent-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Troyes
|
?Le cas du plot de signalisation
- Faits
- Le client d’une grande surface se blesse en heurtant un plot de ciment situé sur le côté du passage piéton
- Solution
- Comme dans les arrêts précédents, contrairement aux juges du fond qui avaient refusé de faire droit à la demande d’indemnisation de la victime, celle-ci ne démontrant pas le rôle actif de la chose, la Cour de cassation considère que le plot était bien l’instrument du dommage.
- La demande d’indemnisation de la victime était donc fondée.
|
Cass. 2e civ., 18 sept. 2003, n°02-14.204
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en sortant d’un magasin à grande surface à Soustons, Mme X… a heurté un plot en ciment situé sur le côté d’un passage pour piétons ; qu’elle a été blessée ; qu’elle a assigné la société Aquipyrdis, exploitante du magasin, ainsi que le cabinet Fillet-Allard, courtier en assurances, en responsabilité et indemnisation de ses divers préjudices, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Landes ;
Attendu que pour la débouter de sa demande, l’arrêt retient que la présence des deux blocs de ciment peints en rouge et délimitant un passage pour piétons peint en blanc ne constitue ni un obstacle ni un danger particulier pour les usagers et qu’elle ne peut être considérée comme anormale et que l’enlèvement de ces plots après l’accident n’est pas en soi signe d’une dangerosité particulière, ni la démonstration de leur rôle causal ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’un des plots en ciment délimitant le passage pour piétons avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;
|
?Analyse des solutions
Comment interpréter les solutions adoptées par la Cour de cassation dans les décisions sus-exposées ?
Dans toutes ces décisions, la chose impliquée dans le dommage était inerte et ne présentait, a priori, aucune anormalité.
Pourtant, la Cour de cassation considère que la chose a été l’instrument du dommage, alors que telle n’était pas sa position antérieurement.
Dès lors, comment comprendre ces différents arrêts ?
- Première explication.
- La Cour de cassation fait ce qu’elle veut, sans suivre aucune règle, ni aucun critère.
- Autrement dit, elle engage la responsabilité de qui elle veut en s’appuyant, tantôt sur la théorie de la causalité adéquate (jurisprudence traditionnelle), tantôt sur la théorie de l’équivalence des conditions (jurisprudence récente)
- Deuxième explication
- Désormais, la seule intervention causale de la chose dans le dommage suffirait à engager la responsabilité du gardien.
- Il n’y aurait donc plus besoin de rapporter la preuve du rôle actif de la chose, car un rôle tout court de la chose dans la production du dommage suffirait.
- Le critère du rôle actif serait donc remplacé par le critère de la simple participation causale au dommage.
- On passerait alors d’une causalité adéquate à une équivalence des conditions.
- Cependant, la réduction du fait des choses à une simple intervention causale ne se vérifie pas dans des arrêts plus récents
- Civ. 2ème, 25 novembre 2004 : le gardien de l’escalier est mis hors de cause faute d’anormalité
- Civ. 2ème, 24 février 2004 : même solution pour le gardien d’un tremplin
- Troisième explication
- Il y aurait présomption de rôle actif non seulement en cas de mouvement + contact mais également en cas de simple contact avec la chose.
- La présomption de rôle actif aurait donc été étendue.
- L’idée serait que, si dommage il y a eu,
- c’est nécessairement que la paroi du verre avait un vice car sinon elle n’aurait pas cédé.
- C’est nécessairement que la boîte aux lettres était mal placée sinon personne ne se serait cogné dedans.
- Cela impliquerait donc que l’on puisse rapporter la preuve contraire, car il ne s’agirait là que d’une simple présomption de rôle actif.
- Dès lors dans ces affaires, le gardien de la boîte aux lettres ou de la vitre en verre ne serait pas parvenu à démontrer la normalité de la chose
- Quatrième explication
- L’explication selon laquelle on assisterait à un assouplissement probatoire dans le domaine de la responsabilité du fait des choses ne saurait tenir si l’on se réfère à un arrêt rendu le 24 février 2005 (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005)
- Dans cet arrêt il s’agissait là encore d’une paroi vitrée dans laquelle une victime se heurte
- La Cour de cassation retient la responsabilité du gardien de la vitre en faisant référence à l’anormalité de la chose
- Aussi, cela signifierait que le gardien de la baie vitrée aurait pu s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’absence d’anormalité de la chose, ce qu’il n’est pas parvenu à faire.
- Pour la Cour de cassation on était donc en présence d’une chose, certes inertes, mais comportant une anormalité.
- D’où la responsabilité du gardien
- C’est donc, finalement, une solution somme toute classique car quand chose inerte + contact la présomption de rôle actif ne joue pas.
- Mais s’il y a anormalité alors on considère que le rôle actif de la chose est établi, ce qui était le cas en l’espèce.
|
Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n°03-13.536
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a heurté une baie vitrée coulissante qui ouvrait, de l’intérieur d’un appartement, sur une terrasse ; que la vitre s’est brisée et a blessé Mlle X… ; que cette dernière a assigné Mme Y…, propriétaire de l’appartement et son assureur, la compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mlle X… de ses demandes, l’arrêt retient que cette dernière s’est levée, a pivoté à 90 , s’est dirigée vers la terrasse, sans s’apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu’elle a percuté la porte vitrée qui s’est brisée ;
que la victime indique qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été ; qu’il n’est pas allégué un mauvais état de la baie vitrée, que, par ailleurs, le fait qu’elle ait été fermée, même si l’on se trouvait en période estivale, ne peut être assimilé à une position anormale ; que la chose n’a eu aucun rôle actif dans la production du dommage et que celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse
|
?Confirmation de l’exigence d’anormalité
Après une période de flottement jurisprudentielle où l’on était légitimement en droit de se demander si l’exigence d’anormalité n’avait pas été abandonnée à la faveur de l’établissement d’une simple intervention causale de la chose dans la production du dommage, les derniers arrêts de la Cour de cassation révèlent que cette dernière semble être revenue à une position plus traditionnelle.
En effet, la haute juridiction fait, de nouveau, explicitement référence à l’exigence d’anormalité afin d’apprécier le rôle ou non actif de la chose inerte.
Dans un arrêt du 10 novembre 2009 elle a ainsi validé la décision d’une Cour d’appel qui avait débouté une victime de sa demande d’indemnisation estimant qu’elle n’avait pas établi l’anormalité de la chose inerte impliquée dans le dommage (Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, n°08-18.781)
La même solution a été retenue dans un arrêt du 13 décembre 2012 (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n°11-22.582).
|
Cass. 2e civ., 10 nov. 2009, 08-18.781
Sur le moyen unique, pris en première et deuxième branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que le 7 août 1999 M. X…, invité chez M. et Mme Y…, en compagnie de son épouse et de ses enfants, a été blessé après avoir glissé sur la margelle de la piscine, alors qu’il effectuait des plongeons ; que le 15 février 2002, les époux X…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs (les consorts X…) ont assigné Mme Marie Antoinette Y…, Joseph et Christophe Y…, ayants droits de M. Y… (les consorts Y…) à la suite du décès de ce dernier, devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que l’arrêt retient que, selon ses conclusions, M. X… effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsqu’il a perdu l’équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l’eau s’est trouvé dans l’impossibilité de nager et de remonter à la surface ; qu’il est exclu, au vu des documents médicaux, que M. X… ait heurté la margelle mais qu’il est constant que M. X… a perdu l’équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle incombe à la victime ; que les projections d’eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d’un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ; qu’il n’est justifié par aucun élément que la margelle était composée d’un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d’utilisation normales ; que s’agissant de l’hypothèse selon laquelle la margelle était glissante car saturée d’eau, il résulte des attestations des personnes ayant assisté au plongeon malencontreux que M. X… a perdu l’équilibre ou glissé sur la margelle sans qu’il en ressorte que la margelle était composée d’un matériau inadapté, était saturée d’eau et anormalement glissante ; que la description de l’état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d’appel a pu déduire que la margelle mouillée de la piscine ne présentait aucun caractère d’anormalité et n’avait pas été l’instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
|
|
Cass. 2e civ., 13 déc. 2012
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 10 mai 2011), qu’invité par les enfants des époux X… à se baigner dans la piscine de leur propriété, Rolland Y…, alors âgé de 17 ans, a escaladé un muret pour atteindre la toiture de l’abri de piscine, d’où il voulait plonger ; qu’ il s’est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d’un bosquet situé au pied du muret ; qu’il est décédé des suites de ses blessures ; que ses père et mère, M. et Mme Y… ainsi que ses frères M. Simon Y…, M. Nathaniel Y… et M. Timothée Y… (les consorts Y…) ont assigné les époux X… en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
[…]
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tige de fer sur laquelle la victime s’est empalée a été installée pour servir de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était implantée ; qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06 mètre, d’une hauteur inférieure à celle de l’arbuste ; que par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d’une plante à soutenir, elle remplissait comme tuteur l’office attendu d’une tige métallique, ou en quelqu’autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n’était pas en position anormale et n’avait pas été l’instrument du dommage ;
D’où il suit que le moyen, qui s’attaque à des motifs surabondants en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
|