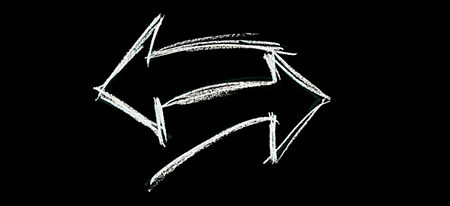Conformément au principe de l’effet relatif le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge des parties. Est-ce qu’il ne produit aucun effet à l’égard des tiers ? C’est toute la question de l’opposabilité du contrat.
?Silence du Code civil
Bien que l’article 1199 du Code civil interdise de rendre les tiers créanciers ou débiteur d’une obligation stipulée par les contractants, l’exécution de l’acte n’en est pas moins susceptible d’avoir des répercussions sur leur situation personnelle.
Aussi, la question s’est-elle rapidement posée de savoir quel rapport les tiers entretiennent-ils avec le contrat.
Initialement, le Code civil était silencieux sur cette question. L’article 1165 se limitait à énoncer que « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121. »
Pour une partie de la doctrine cette règle était incomplète. René Savatier a écrit en ce sens que « cette conception simpliste d’une liberté absolue de l’individu ne tient pas suffisamment compte des liens qui rattachent inévitablement les uns aux autres tous les membres d’une société [où] les affaires de chacun, auprès d’un côté individuel, ont aussi un côté social. Il faut donc reconnaître qu’elles ne concernent pas seulement celui qui y préside, mais à certains points de vue la société et, par conséquent, les tiers »[14].
D’autres auteurs ont encore affirmé que « se prévaloir de ce qu’une personne a passé un contrat et même de ce qu’elle ne l’a pas exécuté, c’est se prévaloir d’un pur fait, qui existe en tant que fait, donc à l’égard de tous ».
?Consécration jurisprudentielle
La Cour de cassation n’est pas, manifestement, demeurée indifférente à ces critiques puisqu’elle a affirmé le principe de l’opposabilité du contrat au tiers à de nombreuses reprises.
Dans un arrêt du 6 février 1952 la Cour de cassation a, de la sorte, considéré que « si, en principe, les conventions ne sont pas opposables à ceux qui n’y ont pas été parties, il ne s’ensuit pas que le juge ne puisse pas rechercher dans les actes étrangers à l’une des parties en cause des renseignements de nature à éclairer sa décision, ni ne puisse considérer comme une situation de fait vis-à-vis des tiers les stipulations d’un contrat » (Cass. 1ère civ. 6 févr. 1952).
Cette solution a été réaffirmée, par exemple, dans un arrêt du 22 octobre 1991 où elle estime que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490).
|
Cass. com. 22 oct. 1991 Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1165 du Code civil ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société industrielle et forestière en Afrique Centrale (Sifac) et la société Industries forestières Batalimo (IFB), dont M. Jacques X… présidait les conseils d’administration, étaient titulaires de comptes courants dans les livres de la Banque internationale pour l’Afrique Occidentale à Bangui (BIAO Centrafrique) et dans ceux de l’agence de la Banque internationale pour l’Afrique Occidentale à Pointe-Noire, en République populaire du Congo (BIAO) ; qu’à la suite de l’expropriation de ses avoirs au Congo, la BIAO a, le 14 août 1974, signé une convention aux termes de laquelle, notamment, la Banque commerciale congolaise (BCC) devait, dans un certain délai, lui signifier la liste des créances qu’elle ne reprenait pas, les autres créances étant, passé ce délai, considérées comme acquises par cette banque ; qu’après l’expiration du délai, la BIAO a inscrit au débit des comptes des sociétés Sifac et IFB ouverts à la BIAO Centrafrique, les montants des soldes débiteurs des comptes de ces sociétés dans les livres de son agence de Pointe-Noire ; que Jacques X… et Jeanine Y…, son épouse, se sont portés cautions, au profit de la BIAO, des dettes des deux sociétés ; Attendu que, pour condamner les époux X… à payer diverses sommes à la BIAO en exécution de leurs engagements de cautions, l’arrêt, après avoir relevé que ceux-ci ” invoquent le protocole passé entre la Banque commerciale congolaise et la BIAO pour soutenir que la BCC n’ayant pas rejeté les créances dans le délai, seule cette dernière en est titulaire “, retient que, ” n’étant pas partie à cette convention qui n’a pas été faite dans leur intérêt, ils ne peuvent s’en prévaloir ” ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 1989, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier |
Ainsi, pour la Cour de cassation, le contrat est opposable aux tiers car il constitue une situation de fait qu’ils ne sauraient ignorer.
La conséquence est double :
- En premier lieu, les tiers ne doivent pas faire obstacle à l’exécution du contrat
- En second lieu, les tiers peuvent se prévaloir du contrat à l’encontre des parties
Appliquée régulièrement par la jurisprudence, cette règle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme des obligations.
?Intervention du législateur
Aux termes du nouvel article 1200 du Code civil, d’une part, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat », d’autre part, « ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Il ressort de cette disposition que, opposable aux tiers par les parties, la situation juridique née du contrat l’est aussi par les tiers aux parties.
Deux principes sont ainsi posés par à l’article 1200 du Code civil.
I) L’opposabilité du contrat aux tiers
A) Principe
L’article 1200, al. 1er énonce le principe selon lequel les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat
Cela signifie que les parties peuvent se prévaloir de la convention à l’encontre de personnes qui, par définition, ne l’ont pas conclue.
Cette possibilité dont disposent les contractants d’opposer le contrat aux tiers est susceptible de se rencontrer dans plusieurs situations :
?L’acte porte sur un droit réel
Dans cette hypothèse, qu’il s’agisse d’une constitution de droit réel ou d’un transfert de droit réel, l’opération conclue par les parties est opposable erga omnes.
Dans un arrêt du 22 juin 1864 la Cour de cassation a affirmé en ce sens :
- D’une part, que « la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations, et que les contrats qui lui servent de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur ».
- D’autre part, « que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers » (Cass. civ. 22 juin 1864).
Ainsi, le contrat pourra-t-il toujours être utilisé par les parties comme mode de preuve d’un droit réel.
|
Cass. civ. 22 juin 1864 Vu les articles 711 et 1165 du X… Napoléon ; Attendu qu’il a été reconnu, en fait, par les deux jugements de première instance dont l’arrêt attaqué a adopté les motifs, qu’à consulter l’acte de partage du 15 octobre 1812 et l’adjudication du 25 novembre 1855, titres invoqués par Z…, la réclamation par laquelle il revendique cette portion de haie séparant sa propriété de celle de Y… se trouve clairement établie et devrait être accueillie ; Attendu que, s’appuyant sur ce que le partage de 1812, étranger à Y… et à ses auteurs, ne ferait pas absolument foi contre eux, le jugement préparatoire a admis les parties à faire preuve des faits de possession et de prescription, respectivement invoqués par elles, et subsidiairement par le demandeur ; Attendu que le jugement définitif, en reconnaissant des actes de jouissance de la part de l’une et l’autre partie, a déclaré insuffisante l’enquête du demandeur, préférable celle du défendeur, et a, en conséquence, rejeté comme mal fondée la demande en revendication formée par Z… ; Attendu qu’il ne résulte, ni du dispositif, ni des motifs de ce jugement, que la possession de Y… ou de ses auteurs ait été, pendant une durée de trente années, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Attendu que la possession de Y… n’aurait pu prévaloir sur les titres de Z… que si elle avait eu soit ce commencement, soit cette durée ; que ni l’un ni l’autre de ces caractères ne lui sont attribués par l’arrêt attaqué, et que, dans l’état des faits déclarés par cet arrêt, l’unique question qui reste à examiner est celle de savoir si les titres de Z…, quoique reconnus probants en eux-mêmes, ont à bon droit été écartés par le motif qu’ils étaient étrangers à Y… et à ses auteurs ; Attendu qu’aux termes de l’article 711 du X… Napoléon, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par l’effet des obligations, et que les contrats qui lui servent de titre et de preuve sont ceux qui sont passés entre l’acquéreur et le vendeur ; Que le droit de propriété serait perpétuellement ébranlé si les contrats destinés à l’établir n’avaient de valeur qu’à l’égard des personnes qui y auraient été parties, puisque, de l’impossibilité de faire concourir les tiers à des contrats ne les concernant pas, résulterait l’impossibilité d’obtenir des titres protégeant la propriété contre les tiers ; Attendu que, déclarer opposables aux tiers les titres réguliers de propriété, ce n’est aucunement prétendre qu’il peut résulter de ces titres une modification quelconque aux droits des tiers, et qu’ainsi la règle de l’article 1165, qui ne donne effet aux conventions qu’entre les contractants, est ici sans application ; D’où il suit qu’en faisant prévaloir, sur les titres produits par Z…, les faits de possession tels qu’ils sont constatés dans l’espèce, et en rejetant ainsi la demande en revendication formée par Z…, l’arrêt attaqué a faussement appliqué l’article 1165 du X… Napoléon, et violé tant ledit article que l’article 711 du même code, CASSE, Ainsi jugé et prononcé |
?L’acte porte sur une institution
Cette hypothèse vise les contrats qui créent une situation institutionnelle entre les parties à l’acte.
Tel est le cas du mariage, de l’adoption, du divorce ou encore de l’acte constitutif d’une société.
Dès lors que la situation créée entre les parties a fait l’objet des formalités de publicité requises, elle devient opposable à tous.
?L’acte porte sur un droit de créance
Le contrat ne crée, certes, d’obligations qu’à la charge des seules parties
Cette situation juridique ainsi créée n’en est pas moins opposable aux tiers.
Cela signifie, concrètement, que les tiers ne sauraient faire obstacle à l’exécution contrat.
Dans un arrêt du 26 janvier 1999, la Cour de cassation a, dans cette perspective, considéré que « le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1999, n°96-20.782).
|
Cass. 1ère civ. 26 janv. 1999 Attendu que M. Le Bourg, commissaire aux comptes, désirant prendre sa retraite, a, par un acte du 2 avril 1984, constitué avec MM. Bertrand et André X… ce dernier décédé en cours de procédure et aux droits de qui viennent M. Bertrand X… et les consorts X… une société civile professionnelle (la SCP) dont il a été nommé gérant et à laquelle il devait ” céder sa clientèle ” ; que le contrat de cession intervenu le 17 septembre 1984 n’a pu se réaliser en février 1985, comme il en avait été convenu, en raison des dissensions qui étaient apparues entre M. Le Bourg et M. Bertrand X…, son principal associé, quant aux conditions de mise en oeuvre de la convention ; que, conformément aux statuts de la SCP, les parties ont saisi la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer le litige et une sentence arbitrale du 13 février 1985 a prononcé la dissolution de la SCP ; que M. Le Bourg a alors agi pour faire constater la caducité du contrat de cession et ordonner la liquidation de la SCP ; que, statuant sur renvoi après cassation, un arrêt du 14 septembre 1994 a renvoyé l’affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond, à la suite de quoi M. Le Bourg a soutenu que la rupture des relations contractuelles était exclusivement imputable à M. Bertrand X… et a demandé en conséquence, du fait de la ” caducité ” de la convention et des fautes de ce dernier, de le condamner à lui payer une somme de 100 000 francs, au titre de ” l’immobilisation de sa clientèle ” pendant plus de trois ans, et une autre somme de 100 000 francs, en réparation des divers inconvénients liés à l’échec de l’opération, ainsi qu’à lui rembourser des honoraires perçus sans contrepartie ; que M. X… a reconventionnellement demandé l’allocation de différentes sommes ; que l’arrêt attaqué, rendu en suite de celui du 14 septembre 1994, a dit que les frais de liquidation de la SCP seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et a déclaré les autres demandes des parties irrecevables […] Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. Le Bourg contre M. X…, l’arrêt énonce que c’est à la SCP et non à M. B. X… que M. Le Bourg a cédé la clientèle de son cabinet par acte du 17 septembre 1984 et que, même s’il est constant que la rupture de cette convention a bien été la conséquence de comportements personnels, il reste que les responsabilités encourues et les conséquences à en tirer ne sauraient être jugées qu’à l’encontre de la SCP, partie au contrat litigieux et représentée par son liquidateur, à charge par ce dernier de répercuter ultérieurement les condamnations éventuelles à intervenir dans le cadre de la liquidation des droits de chacun et sauf à soumettre au juge les litiges qui pourraient subsister ; Attendu cependant que le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable […] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que les frais de cette liquidation seraient supportés par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. Le Bourg tendant à l’allocation de dommages-intérêts au titre de ” l’immobilisation de sa clientèle ” et des inconvénients divers liés à la non-réalisation de la cession, au remboursement d’une somme de 60 000 francs versée à M. X… à titre d’honoraires, ainsi qu’à celui d’une quote-part des frais de fonctionnement du cabinet de M. Le Bourg, l’arrêt rendu le 2 juillet 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles. |
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :
- Premier enseignement
- Lorsqu’un tiers compromet l’exécution d’un contrat, cette intervention est constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
- Cela suppose toutefois de démontrer l’existence, d’une part, d’un préjudice et, d’autre part, d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution contractuelle.
- Second enseignement
- La réparation du préjudice causé au cocontractant victime de l’inexécution du contrat devra être recherchée sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
- Cette solution se justifie par le fait que, par définition, le tiers n’est pas partie au contrat.
- Aussi, l’obligation qui lui échoit consiste, non pas à respecter les termes du contrat, mais à ne pas entraver sa bonne exécution.
- Il ressort de la jurisprudence qu’il importe peu que l’inexécution contractuelle soit le fait du seul tiers ou que celui-ci se soit rendu complice des agissements de l’un des contractants (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 janv. 1963).
- Dans cette dernière hypothèse, la victime pourra cumulativement agir :
- D’abord, contre le tiers, sur le fondement de la responsabilité délictuelle
- Ensuite, contre son cocontractant sur le fondement de la responsabilité contractuelle
B) Exception : la simulation
1. La notion de simulation
La possibilité pour les parties d’opposer le contrat aux tiers n’est pas sans limite.
Dans le droit fil des règles édictées antérieurement à la réforme des obligations, le législateur a prévu à l’occasion de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 que l’acte conclu par les contractants était inopposable aux tiers en cas de simulation.
La notion de simulation est présentée à l’article 1201 du Code civil qui prévoit que « lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre ».
Par simulation, il faut donc entendre l’opération qui consiste pour les parties à conclure simultanément deux actes dont les contenus différèrent.
Tandis que le premier acte est apparent, soit qu’il a été conclu au vu et au su des tiers, le second est quant à lui occulte en ce sens qu’il a vocation à demeurer secret.
La véritable intention des parties résidant dans ce dernier acte, très tôt, tant le législateur que la jurisprudence a estimé que l’acte occulte devait faire l’objet d’une appréhension juridique particulière, à tout le moins qu’il ne pût pas produire les mêmes effets que l’acte apparent.
2. Les formes de simulation
?L’acte fictif
L’acte fictif consiste pour les parties à simuler la conclusion d’un acte qui, en réalité, n’existe pas.
Exemple : les parties concluent ostensiblement un contrat de vente et, dans le même temps, conviennent que cet acte n’opérera aucun transfert de propriété.
L’opération est ici purement fictive, dans la mesure où ses auteurs ont simplement voulu donner à l’acte qu’ils ont conclu l’apparence d’un contrat de vente, alors que, en réalité, il n’existe pas.
?L’acte déguisé
L’acte déguisé consiste pour les parties à conférer à un acte une fausse qualification.
Exemple : les parties concluent ostensiblement un contrat de vente immobilière et conviennent, dans le même temps, que le prix ne sera, soit jamais réclamé, soit sera dérisoire.
Dans cette hypothèse, les parties choisissent délibérément de déguiser sous une autre qualification (la vente) la véritable opération qu’elles entendent conclure (une donation).
?L’interposition de personnes
Il s’agit de la manœuvre qui consiste à dissimuler l’identité du véritable contractant derrière un prête-nom.
Exemple : un bailleur consent un bail à usage d’habitation à un preneur, qui concomitamment, convient avec tiers qu’il lui concédera la jouissance des lieux.
3. Les effets de la simulation
a. À l’égard des parties la validité de l’acte occulte
?Principe
Il a toujours été admis que dès lors que les parties ont échangé leurs consentements l’acte conclu doit être regardé comme valable, quand bien même il n’a fait l’objet d’aucune révélation aux tiers.
Cette règle est exprimée à l’article 1201 du Code civil qui énonce : « le contrat occulte […] produit effet entre les parties », à supposer qu’il remplisse les conditions prévues par la loi
?Conditions
- S’agissant des conditions de fond
- Pour être valable, le contrat occulte doit remplir
- Les conditions communes à tous les actes juridiques, notamment celles énoncées à l’article 1128 du Code civil.
- Les conditions propres à l’acte dont il endosse la qualification.
- Toutefois, pour être valable, il n’est pas nécessaire que l’acte occulte satisfasse aux conditions de validité de l’acte apparent
- Pour être valable, le contrat occulte doit remplir
- S’agissant des conditions de forme
- Contrairement à l’acte apparent, l’acte occulte est dispensé de remplir des conditions de forme quand bien même elles seraient requises à peine de nullité.
- Il en va ainsi d’une donation fictive qui n’aurait pas été conclue en la forme authentique comme exigé par la loi.
?Exception : la fraude
Si, en principe, l’acte simulé est valide entre les parties, il n’en va pas lorsqu’il est l’instrument d’une fraude.
L’article 1202 du Code civil énumère deux sortes d’actes occultes qui sont irréfragablement présumés frauduleux :
- D’une part, « est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel. »
- D’autre part, « est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. »
En dehors de ces deux hypothèses, l’acte occulte demeure valide (V. en ce sens Cass. 3e civ. 20 mars 1996), sauf à établir l’existence d’une fraude.
Quant au contrat apparent il n’encourra jamais la nullité.
b. À l’égard des tiers : l’inopposabilité de l’acte occulte
Parce que la véritable intention des parties a été cachée aux tiers, l’acte occulte leur est inopposable en ce sens qu’il ne saurait produire aucun effet à leur endroit.
L’article 1201 du Code civil prévoit en ce sens que l’acte occulte « n’est pas opposable aux tiers »
Ainsi cette règle constitue-t-elle une exception au principe général d’opposabilité des conventions.
Elle se justifie par l’apparence créée par l’acte ostensible qui a trompé les tiers sur la véritable intention des parties.
Quid dans l’hypothèse où les tiers connaissaient ou auraient dû connaître l’acte secret ?
En pareil cas, l’acte ne revêt plus aucun caractère occulte, de sorte qu’il leur redevient opposable.
II) L’opposabilité du contrat par les tiers
Dès lors qu’il est admis que le contrat est opposable aux tiers, il serait injuste de dénier une application de ce principe en sens inverse.
C’est la raison pour laquelle l’article 1200 du Code civil autorise les tiers à se prévaloir de l’acte conclu à l’encontre des parties.
L’exercice de cette prérogative conférée aux tiers se rencontrera dans deux situations distinctes :
A) L’invocation de l’acte aux fins de rapporter la preuve d’un fait
Cette possibilité est expressément envisagée par l’article 1200 du Code civil.
La Cour de cassation avait notamment exprimé cette règle dans un arrêt du 22 octobre 1991.
Dans cette décision elle considère que « s’ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat » (Cass. com. 22 oct. 1991, n°89-20.490).
En défense, la partie contre qui est produit l’acte peut toutefois opposer au tiers sa nullité.
Elle a affirmé en ce sens dans un arrêt du 21 février 1995 que « la victime d’un dol est en droit d’invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut de celui-ci » (Cass. 1ère civ. 21 févr. 1995, n°92-17.814).
B) L’invocation de l’acte aux fins d’engager la responsabilité des parties
1. Principe
Il est des situations où l’exécution d’un contrat occasionnera un préjudice aux tiers.
Exemples :
-
- Le vice de construction affectant une automobile a provoqué un accident dans lequel un tiers a été blessé
- Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de bail, le preneur dégrade les parties communes d’un immeuble
Très tôt, la jurisprudence a admis que le tiers peut invoquer un contrat pour rechercher la responsabilité d’une partie, lorsqu’il subit un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat.
Dans un arrêt du 22 juillet 1931, la Cour de cassation a considéré que « si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l’exécution d’une obligation résultant d’un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat » (Cass. civ. 22 juill. 1931)
Ainsi, l’opposabilité du contrat, en tant que situation de fait, induit la faculté pour les tiers, dans l’hypothèse de la méconnaissance de cette situation par ceux qui l’ont créée, d’en obtenir la sanction juridique en se plaçant sur le terrain délictuel.
2. Conditions
Si le bien-fondé de l’action en responsabilité délictuelle dont est titulaire le tiers à l’encontre de la partie au contrat auteur du dommage n’a jamais été discuté, il n’en a pas été de même pour ses conditions de mise en œuvre.
Un débat est né autour de la question de savoir si, en cas de préjudice occasionné aux tiers, la seule inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité du contractant fautif où s’il fallait, en outre, que caractériser de manière distinction l’existence d’une faute délictuelle.
Il ressort de la jurisprudence une opposition entre la chambre commerciale et la première chambre civile, ce qui a donné lieu à l’intervention de l’assemblée plénière.
?La position de la chambre commerciale : le refus d’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
La chambre commerciale a estimé de manière constante que l’établissement de la seule inexécution du contrat ne suffisait pas à établir une faute de nature à engager la responsabilité de la partie au contrat qui, dans le cadre de l’exécution de ses obligations, a causé un dommage à un tiers.
Dans un arrêt du 5 avril 2005, elle a estimé en ce sens « qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui » (Cass. com. 5 avr. 2005, n°03-19.370).
Ainsi, pour la chambre commerciale, pour que le tiers victime de la mauvaise exécution du contrat puisse rechercher la responsabilité du contractant fautif il est nécessaire qu’il rapporte la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
Cette solution repose sur l’idée que le principe de l’effet relatif des conventions fait obstacle à ce qu’un tiers au contrat puisse tirer profit d’une faute contractuelle laquelle ne peut être invoquée que par les seules parties à l’acte.
|
Cass. com. 5 avr. 2005 Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société d’exploitation française de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la société Lyonnaise pharmaceutique (la société Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques ; que la société Merck ayant pris le contrôle de la société Lipha, cette dernière s’est engagée à s’abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la société Bioderma, filiale de la société SEFRB, créée après l’intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la société Lipha, aux droits de laquelle est désormais la société Merck santé France, en réparation du préjudice causé par manquement à son engagement ; qu’après avoir ordonné une expertise par arrêt du 14 avril 2000, la cour d’appel a liquidé ce préjudice par arrêt du 16 janvier 2003 ; Attendu que pour déclarer la société Bioderma fondée à engager la responsabilité de la société Merck santé France en raison de la violation du protocole d’accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice consécutif, l’arrêt du 14 avril 2000 retient que, s’ils ne peuvent être constitués débiteurs ou créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice résultant de la violation du contrat, et l’arrêt du 16 janvier 2003, que cette décision a reconnu l’intérêt d’un tiers à agir en réparation du préjudice résultant de la violation du contrat auquel il n’est pas partie sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de l’inexécution du contrat qu’à la condition que cette inexécution constitue un manquement à son égard au devoir général de ne pas nuire à autrui, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l’égard de la société Bioderma, n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 14 avril 2000 et 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ; |
?La position de la première chambre civile : l’admission de l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
Dans plusieurs décisions, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis que la seule inexécution contractuelle suffisait à fonder l’action en responsabilité délictuelle engagée par le tiers victime à l’encontre du contractant fautif.
Dans un arrêt du 15 décembre 1998 elle a considéré par exemple que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage » (Cass. 1ère civ. 15 déc. 1998, n°96-21.905 et 96-22.440).
Nul n’est dès lors besoin de rapporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle.
Les deux fautes font ici l’objet d’une assimilation.
L’inexécution du contrat est, autrement dit, regardée comme une faute délictuelle, ce qui justifie que la responsabilité du contractant fautif puisse être recherchée.
La première chambre civile a réitéré cette solution dans un arrêt particulièrement remarqué du 13 février 2001 à l’occasion duquel elle a estimé que « les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve » (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001, n°99-13.589).
|
Cass. 1ère civ. 13 févr. 2001 Sur le moyen unique : Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve ; Attendu qu’en 1983 Claude X… a été contaminé par le virus de l’immuno déficience humaine à l’occasion d’une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Rennes (le Centre) ; qu’il a été indemnisé de son préjudice spécifique de contamination par le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles ; qu’après son décès, survenu en septembre 1992, consécutif à un SIDA déclaré, sa fille Christelle X…, alors âgée de 17 ans, a engagé devant les juridictions de droit commun une action contre le Centre et son assureur, la compagnie Axa, aux fins de réparation du préjudice par ricochet, moral et économique, qu’elle subissait du fait de la mort de son père ; que l’arrêt attaqué l’a déboutée de son action au motif qu’elle ne pouvait invoquer l’obligation contractuelle de sécurité de résultat pesant sur le Centre en l’absence de lien contractuel avec celui-ci et qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une faute dudit centre ; Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’un centre de transfusion sanguine est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits sanguins qu’il cède et que le manquement à cette obligation peut être invoqué aussi bien par la victime immédiate que par le tiers victime d’un dommage par ricochet, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et attendu, en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, en ce qui concerne le droit pour Mlle X… d’invoquer à l’encontre du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de Mlle Christelle X… tendant à la réparation de son préjudice par ricochet, l’arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; |
?L’intervention de l’assemblée plénière : l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles
Afin de mettre un terme au conflit qui opposait la chambre commerciale à la première chambre civile, l’assemblée plénière a été contrainte d’intervenir.
Aussi dans un arrêt du 6 octobre 2006, c’est à la première chambre civile qu’elle a donné raison.
Elle a estimé en effet que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. ass. plén. 6 oct. 2006, n°05-13.255).
|
Cass. ass. plén. 6 oct. 2006 Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X… ont donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho qui a confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot Shop ; qu’imputant aux bailleurs un défaut d’entretien des locaux, cette dernière les a assignés en référé pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X… font grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Boot Shop, locataire-gérante, alors, selon le moyen, “que si l’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu’en l’espèce, il est constant que la société Myr’Ho, preneur, a donné les locaux commerciaux en gérance à la société Boot Shop sans en informer le bailleur ; qu’en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot Shop à l’encontre du bailleur était recevable, sans autrement caractériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1382 du code civil” ; Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’utiliser normalement les locaux loués, la cour d’appel, qui a ainsi caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
La solution adoptée par l’assemblée plénière en 2006 a, par la suite, été confirmée à plusieurs reprises, tant par la première chambre civile (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 4 juill. 2007 ; Cass. 1ère civ. 30 sept. 2010, n°09-69.129), que par la chambre commerciale.
Dans un arrêt du 2 mars 2007, cette dernière a ainsi considéré que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Cass. com. 2 mars 2007, n°04-13.689)
Elle reprend ici mot pour mot la solution dégagée par l’assemblée plénière ce qui marque l’abandon de sa position antérieure.
|
Cass. com. 2 mars 2007 Sur le moyen unique : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Attendu, selon l’arrêt déféré, que par contrat de licence conclu courant septembre 1991, la société Jean-Louis Scherrer a concédé à la société de droit néerlandais Elisabeth Arden international BV, aux droits de laquelle se trouve la société Unilever Cosmetics international BV (société E. Arden) le droit de fabriquer et de vendre dans le monde entier divers produits sous la dénomination et la marque Jean-Louis Scherrer ; que, par acte du 2 décembre 1992, la société Jean-Louis Scherrer a apporté à la société JLS marques la marque Jean-Louis Scherrer, ses déclinaisons et la branche d’activité relative à l’exploitation de la marque, laquelle comprenait les contrats de licence en cours, dans la mesure où ceux-ci étaient transmissibles, que la société E. Arden, arguant de la clause d’incessibilité du contrat de licence, un accord a été conclu le 10 octobre 1994 entre la société JLS marques, titulaire de la marque, la société Jean-Louis Scherrer, licencié de la société JLS marques depuis le 27 avril 1993, et la société E. Arden, aux termes duquel la convention de cession de marques signée entre les deux premières sociétés ne modifiait pas le contrat de licence conclu entre les sociétés Jean-Louis Scherrer et E. Arden ; que, le 17 mars 2000, la société E. Arden a régulièrement notifié à la société EK finances, venant aux droits de la société Jean-Louis Scherrer et à la société JLS marques sa décision de ne pas exercer l’option de renouvellement prévue au contrat de licence ; que la société JLS marques a poursuivi judiciairement la société E. Arden en responsabilité contractuelle puis en responsabilité délictuelle, la société EK finances intervenant volontairement à l’instance ; Attendu que pour rejeter la demande de la société JLS marques en responsabilité fondée sur l’article 1382 du code civil, l’arrêt retient que cette société, qui reprochait à la société E. Arden d’avoir manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à une diffusion géographique et à une commercialisation mondiale suffisante des produits et en ne lançant pas la ligne pour homme, et faisait valoir que les mauvais résultats de la licence s’expliquaient par la médiocrité des efforts publicitaires et promotionnels, n’a développé aucun moyen de nature à établir la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Scherrer fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, l’arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; |
La position de la Cour de cassation a, manifestement, été accueillie pour le moins froidement par une frange de la doctrine, certains auteurs estimant qu’elle était bien trop favorable aux tiers.
Cette solution leur permet, en effet, de s’émanciper de la rigueur contractuelle à laquelle se sont astreintes les parties notamment par le jeu des obligations de résultat ou des clauses limitatives de responsabilité.
Aussi, peut-on regretter que le législateur soit resté silencieux sur ce point.
L’avant-projet de réforme de la responsabilité civile laisse toutefois augurer une modification de ce point de droit.
Les auteurs de cet avant-projet envisagent d’introduire un nouvel article 1234 qui disposerait que :
- « Lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II.
- Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite. »
Le débat n’est donc pas clos.
Il est fort à parier que la position adoptée par l’assemblée plénière en 2006 sera brisée par le législateur.
- V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963 ; N. Fricero-Goujon, La caducité en droit judiciaire privé : thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L’Harmattan, coll. « logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducité des actes juridiques, LGDJ, 2006. ?
- R. Perrot, « Titre exécutoire : caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559. ?
- M.-C. Aubry, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625. ?
- H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. « Traités », 2002, n°02, p. 38. ?
- Article 1089 du Code civil. ?
- Article 1043 du Code civil. ?
- Article 1042, alinéa 1er du Code civil. ?
- V. Wester-Ouisse, « La caducité en matière contractuelle : une notion à réinventer », JCP G, n°, Janv. 2001, I 290. ?
- V. en ce sens F. Garron, La caducité du contrat : étude de droit privé, PU Aix-Marseille, 2000. ?
- Le régime juridique de la caducité contractuelle figure désormais aux nouveaux articles 1186 et 1187 du Code civil. ?
- G. Cornu, Vocabulaire juridique, Puf, 2014, V. Caducité. ?
- V. en ce sens A. Foriers, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur formation, Bruylant, 1998, n°54 et s. ?
- D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, éd. Odile Jacob, 1997, p. 61. V. également en ce sens F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit » in les usages sociaux du droit, Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, PUF, 1989, p. 130 ; P. Amselek, « Kelsen et les contradictions du positivisme », APD, 1983, n°28, p. 274. Pour la thèse opposée V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, éd. Bruylant-LGDJ, 1999, trad. Ch. Eisenmann, p. 19 et s. ?
-
R. Savatier, Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats, R.T.D. Civ., 1934, p. 544. ?