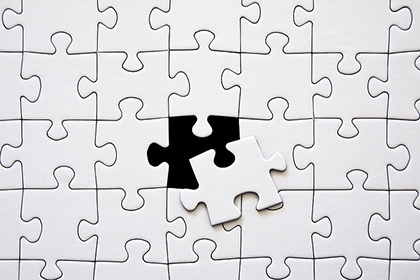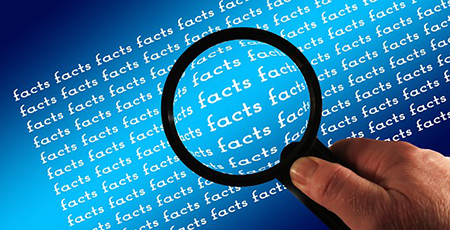Il ressort de la combinaison des articles 860-2 et 861 du CPC que, une fois saisie, la formation de jugement du Tribunal de commerce dispose de quatre options :
- Première option : la désignation d’un conciliateur de justice
- Lorsque la formation de jugement considère qu’une conciliation entre les parties est envisageable, elle dispose de la faculté de désigner un conciliateur de justice.
- Deuxième option : l’ouverture immédiate des débats
- Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire est en état d’être jugée, elle peut ordonner l’ouverture des débats et trancher le litige consécutivement.
- Troisième option : le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure
- Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, mais que la désignation d’un juge rapporteur n’est pas nécessaire, elle renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
- Quatrième option : la désignation d’un juge rapporteur
- Lorsque la formation de jugement considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, elle peut procéder à la désignation d’un juge rapporteur qui sera chargé d’instruire l’affaire
Nous nous focaliserons ici sur la quatrième option.
L’article 861 du CPC dispose que, en l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement peut confier à l’un de ses membres le soin de l’instruire.
I) Les pouvoirs du Juge rapporteur
Les pouvoirs dont est investi le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement sont régis aux articles 861-3 à 871 du CPC.
À l’examen, les pouvoirs d’instruction de ce juge sont sensiblement les mêmes que ceux conférés au Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire.
Au nombre des pouvoirs dont il est investi, figurent :
- Le pouvoir d’organiser les échanges entre les parties comparantes dans les conditions énoncées à l’article 446-2 du CPC
- L’organisation des échanges implique que le Juge rapporteur peut :
- Établir un calendrier procédural
- Fixer des délais
- L’organisation des échanges implique que le Juge rapporteur peut :
- Le pouvoir d’entendre les parties (art. 862, al. 1er CPC)
- En toute hypothèse, cette audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.
- Le juge rapporteur pourra être tenté d’auditionner les parties, soit pour obtenir des précisions orales sur un moyen de fait ou de droit qui a retenu son attention, soit lorsqu’il considérera qu’une conciliation est possible
- Le pouvoir d’inviter les parties, à tout moment, à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige (art. 862, al. 2e et art. 446-3 CPC)
- Cette prérogative dont est investi le juge rapporteur a vocation à lui permettre de faire avancer le débat
- Il pourra, en effet, attirer l’attention d’une partie sur la nécessité de répondre à un moyen de droit qui n’a pas été débattue, alors même qu’il pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.
- De la même manière, il peut suggérer à une partie d’apporter des précisions sur des éléments de fait qui sont demeurés sans réponse.
- Le pouvoir de mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer faute de quoi, la formation de jugement pourra passer outre et statuer, en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus (art. 862, al. 2e et art. 446-3 CPC)
- Ce pouvoir dont il est investi lui permet de s’assurer que la preuve des allégations des parties est rapportée
- À défaut, il pourra en tirer toutes les conséquences qui s’imposent.
- Le pouvoir de désigner un conciliateur ou de constater la conciliation, même partielle, des parties (art. 863 CPC).
- À l’instar de la formation de jugement, le Juge rapporteur peut chercher à concilier les parties, conformément au principe directeur du procès énoncé à l’article 21 du CPC qui prévoit que « il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
- L’article 128 précise que « les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. »
- À cet égard, la conciliation des parties peut intervenir, soit sous l’impulsion d’un conciliateur désigné par le juge rapporteur, soit de la propre initiative des parties.
- Dans cette dernière hypothèse, le juge rapporteur homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
- La teneur de l’accord, même partiel, est alors consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
- Les extraits du procès-verbal dressé par le juge qui sont délivrés aux parties valent titre exécutoire.
- Le pouvoir d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (art. 865, al. 1er CPC)
- De toute évidence, cette disposition fait directement écho aux articles 143 et suivants du CPC qui régissent les mesures d’instruction susceptible d’être prises dans le cadre du procès civil
- En particulier, l’article 143 du CPC dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
- L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
- En application de ces textes, le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction.
- Dans la mesure où la loi ne pose aucune limite, les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient légalement admissibles.
- Ces mesures peuvent consister en :
- La désignation d’un expert
- La désignation d’un huissier de justice
- La production forcée de pièces par une autre partie ou par un tiers
- L’article 147 du CPC l’autorise à conjuguer plusieurs mesures d’instruction.
- Il peut ainsi, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
- Le juge peut encore accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
- Bien qu’il dispose de toute latitude pour prescrire des mesures d’instruction, l’article 147 du CPC intime au Juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
- Le pouvoir de trancher les difficultés relatives à la communication des pièces (art. 865, al. 2e CPC)
- Il s’agit ici pour le Juge rapporteur de statuer sur les irrégularités susceptibles d’affecter la communication des pièces et, par voie de conséquence, de porter atteinte au principe du contradictoire.
- Le pouvoir de constater l’extinction de l’instance (art. 865, al. 3e CPC)
- Pour mémoire, les cas dans lesquels le juge constate l’extinction de l’instance sont ceux prévus par les articles 384 et 385 du CPC, qui distinguent l’extinction à titre accessoire (transaction, acquiescement, désistement d’action, décès d’une partie dans les actions non transmissibles) et principal (préemption, désistement d’instance, caducité de la citation).
- Le juge rapporteur statue en ce cas par ordonnance motivée (art. 866, al. 2e CPC).
- Le pouvoir de statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 dans le cadre des incidents susceptibles d’intervenir pendant la phase d’instruction de l’instance (art. 865, al. 3e CPC)
- Si la prérogative de statuer sur les dépens est ancienne, celle relative aux frais irrépétibles a été conférée au Juge rapporteur par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
- S’agissant des dépens ce sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire
- S’agissant des frais irrépétibles, ils se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du Code de procédure civile.
- Le pouvoir dont est investi le juge rapporteur, l’autorise à statuer sur les frais de l’instance dont il a pu constater l’extinction mais également sur les frais exposés par les parties aux fins de mettre en œuvre les mesures conservatoires, provisoires ou d’instruction prononcées.
- Si, par principe, lorsque le Juge rapporteur statue sur les dépens et les frais irrépétibles sa décision est seulement assortie de l’autorité de la chose jugée au provisoire, il en va autrement lorsqu’il statue sur des exceptions de procédure ou des incidents d’instance.
- Si la prérogative de statuer sur les dépens est ancienne, celle relative aux frais irrépétibles a été conférée au Juge rapporteur par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale
II) Les décisions du Juge rapporteur
A) Principe : la simple mention au dossier
L’article 866 du CPC dispose que « les mesures prises par le juge chargé d’instruire l’affaire sont l’objet d’une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties. »
Il ressort de cette disposition que les décisions du Juge rapporteur sont des mesures d’administration judiciaire, de sorte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours
Il en va notamment ainsi des mesures tenant à :
- La détermination du calendrier procédurale (octroi de délais, prorogation, injonctions etc..)
- L’invitation des parties à répondre à un moyen de fait ou de droit
- L’audition des parties
- L’instruction du dossier
- La jonction et la disjonction d’instance
L’impossibilité d’exercer une voie de recours contre une décision du Juge rapporteur signifie que ses mesures ne peuvent être déférées, ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation.
Quant à la voie de recours exercée, toutes sont concernées qu’il s’agisse de l’appel ou de l’opposition.
B) Exception : l’ordonnance
?Les cas visés
L’article 866, al. 2e prévoit que « dans les cas prévus à l’article précédent, le juge chargé d’instruire l’affaire statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction ».
À l’analyse, les cas visés par cette disposition qui exigent l’établissement d’une ordonnance motivée sont :
- L’adoption de toute mesure d’instruction utile
- L’adoption d’une décision visant à trancher une difficulté relative à la communication de pièces
- La constatation de l’extinction de l’instance
- L’adoption d’une décision visant à statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
?Autorité de la chose jugée
Lorsque le Juge rapporteur rend une ordonnance, l’article 867 du CPC précise qu’elle n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie que sa décision ne lie pas la décision de la formation de jugement, laquelle a vocation à se prononcer une fois l’instruction de l’affaire achevée.
?Voies de recours
- Principe
- S’agissant des voies de recours susceptibles d’être exercées contre les ordonnances du Juge rapporteur l’article 868 du CPC prévoit que ces dernières « ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment du jugement sur le fond. »
- Cela signifie que la voie de recours ne peut pas être exercée de manière autonome ; elle doit être exercée dans le cadre de l’appel interjeté contre la décision rendue au fond.
- Exception
- Le principe d’absence d’autonomie des voies de recours exercées contre les ordonnances rendues par le Juge rapporteur souffre de deux exceptions :
- Les décisions rendues en matière d’expertise
- Les décisions constatant l’extinction de l’instance
- Dans ces deux cas, la voie de recours peut être exercée de manière autonome :
- Soit dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise
- Soit dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles constatent l’extinction de l’instance.
- Le principe d’absence d’autonomie des voies de recours exercées contre les ordonnances rendues par le Juge rapporteur souffre de deux exceptions :
III) Le dénouement de l’instruction conduite par le Juge rapporteur
L’article 869 du CPC dispose que « le juge chargé d’instruire l’affaire la renvoie devant le tribunal dès que l’état de l’instruction le permet. »
Lorsque, ainsi, le Juge rapporteur considère que l’affaire est en état d’être jugée, il la renvoie devant la formation de jugement qui aura pour tâche de juger le fond du litige.
À la différence de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, la fin de l’instruction de l’affaire dans le cadre de la procédure commerciale n’est pas marquée par le prononcé d’une ordonnance de clôture.
Il en résulte que des conclusions et des pièces peuvent toujours être produites avant l’audience des plaidoiries, sous réserve de l’observance du principe de contradictoire.
Pour mémoire, en effet, l’article 446-2, al. 5e du CPC applicable aux procédures orales, dispose que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »