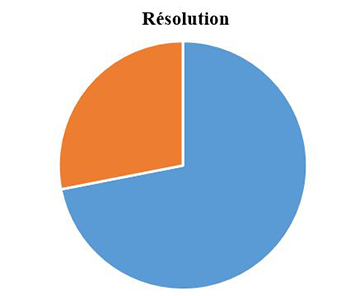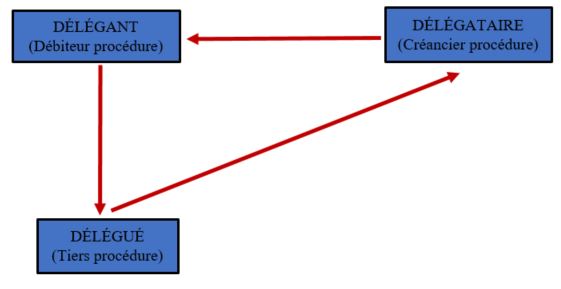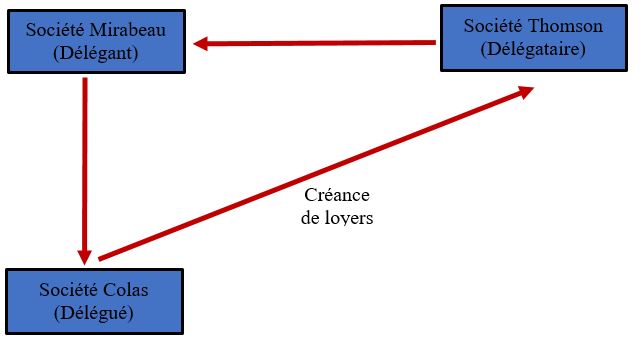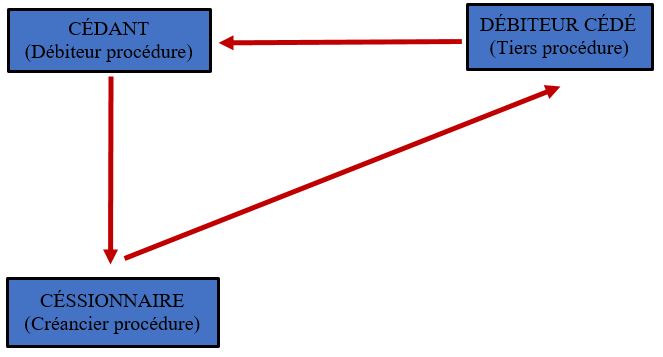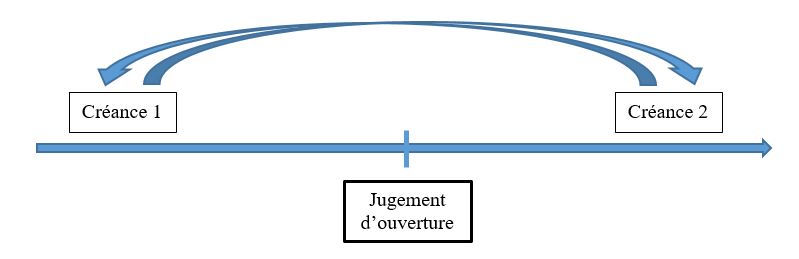La famille n’est pas une, mais multiple. Parce qu’elle est un phénomène sociologique[1], elle a vocation à évoluer à mesure que la société se transforme.
De la famille totémique, on est passé à la famille patriarcale, puis à la famille conjugale. De nos jours, la famille n’est plus seulement conjugale, elle repose, de plus en plus, sur le concubinage[2]. Mais elle peut, également, être recomposée, monoparentale ou unilinéaire.
Le droit opère-t-il une distinction entre ces différentes formes qu’est susceptible de revêtir la famille ? Indubitablement oui. Si, jadis, cela se traduisait par une réprobation, voire une sanction pénale, des couples qui ne répondaient pas au schéma préétabli par le droit canon[3], aujourd’hui, cette différence de traitement se traduit par le silence que le droit oppose aux familles qui n’adopteraient pas l’un des modèles prescrit par lui.
Quoi de plus explicite pour appuyer cette idée que la célèbre formule de Napoléon, qui déclara, lors de l’élaboration du Code civil, que « puisque les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéressera d’eux ». Cette phrase, qui sonne comme un avertissement à l’endroit des couples qui ont choisi de vivre en union libre, est encore valable.
La famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage. Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité »[4] et plus encore, comme son « acte fondateur »[5]. Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où le silence de la loi sur le statut des concubins.
Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre, mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles[6]. En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage[7]. Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins[8]. Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage[9]. Excepté quelques cas marginaux[10], leur situation n’est réglée que par le seul droit commun. Pour les couples qui choisissent de se tenir à l’écart de l’union conjugale, c’est donc un silence juridique qui les attend.
Chapitre 1: La définition du concubinage
Pendant très longtemps, le Concubinage était une situation de fait ignorée du Code civil.
Il a fallu attendre la loi du 15 novembre 1999 pour que la place faite par le droit dans l’ordonnancement juridique au concubinage – c’est-à-dire aucune – évolue.
Ainsi, cette loi a-t-elle introduit un article 515-8 dans le Code civil lequel dispose : « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Dans sa décision du n°99-419 DC du 9 novembre 1999, le Conseil constitutionnel a précisé que « cette définition a pour objet de préciser que la notion de concubinage peut s’appliquer indifféremment à un couple formé par des personnes de sexe différent ou de même sexe ; que, pour le surplus, la définition des éléments constitutifs du concubinage reprend celle donnée par la jurisprudence ; que le moyen manque donc en fait »
Au vrai, la définition par le Code civil n’a pas vraiment d’intérêt juridique dans la mesure où le législateur n’a fait produire aucun effet de droit au concubinage : il demeure une situation de fait.
Le régime juridique qui lui est applicable c’est le droit commun.
Aussi, le législateur n’a-t-il fait, en réalité, que reprendre l’essentiel des éléments constitutifs de la définition du concubinage dégagés antérieurement par la Cour de cassation à une exception près : avant 1999 la Cour de cassation déniait aux couples homosexuels le statut de concubins.
Il en résultait que ces derniers étaient systématiquement déboutés de leur demande tendant à bénéficier des mêmes droits que les couples de concubins hétérosexuels (notamment s’agissant des avantages octroyés par certaines sociétés à leurs salariés vivant en concubinage).
Ainsi, la jurisprudence affirmait-elle régulièrement que le concubinage ne pouvait se concevoir en dehors de l’union d’un homme et d’une femme.
Dans un arrêt du 11 juillet 1989, la chambre sociale a par exemple envisagé la vie maritale comme « une situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s’unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu’un couple constitué d’un homme et d’une femme » (Cass. soc. 11 juill. 1989, n°86-10.665).
| Cass. soc. 11 juill. 1989 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8e chambre, 27 novembre 1985) de lui avoir refusé la qualité d'ayant droit de Mme X..., qu'elle sollicitait sur le fondement de l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale qui dispose que la personne qui vit maritalement avec un assuré social et qui se trouve à sa charge effective totale et permanente, a la qualité d'ayant droit de l'assuré pour l'ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, alors tout d'abord, qu'il est constant qu'elle était depuis deux ans sous le toit de son amie, assurée sociale, et se trouvait à sa charge effective et alors surtout que la loi du 2 janvier 1978 portant généralisation de la sécurité sociale a posé le principe d'un droit de protection pour tous de sorte que ses dispositions doivent faire l'objet d'une interprétation extensive ; que la vie maritale prise en considération par l'article 13 de la loi précitée s'entend d'une existence commune et stable entre deux individus en sorte qu'en y ajoutant une condition d'hétérogénéité sexuelle, la cour d'appel lui a apporté une restriction qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'en se référant dans l'article 13 de la loi du 2 janvier 1978 à la notion de vie maritale, le législateur a par là même entendu limiter les effets de droit, au regard des assurances maladie et maternité à la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ; Qu'ils étaient fondés à en déduire que Mme Y... ne satisfaisait pas à la condition de vie maritale exigée par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
Dans un arrêt du 17 décembre 1997, elle a encore considéré que « le concubinage ne pouvait résulter que d’une relation stable et continue ayant l’apparence du mariage » (Cass. 3e civ. 17 déc. 1997, n° 95-20.779).
| Cass. 3e civ. 17 déc. 1997 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1995), que Mme Z... a donné un appartement à bail à M. X... ; qu'après le décès du locataire, son ami, M. Y..., qui vivait avec lui et était demeuré dans les lieux, a assigné la bailleresse en transfert du bail à son profit ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, publié par décret n° 81-76 du 29 janvier 1981, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe,... ou de toute autre situation ; qu'en estimant que l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que " lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré (...) au concubin notoire (...) qui vivait avec lui depuis au moins 1 an à la date du décès ", ne visait que le cas de concubinage entre un homme et une femme, alors que ce texte ne contient aucune restriction autre que celle tenant à la durée du concubinage, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le concubinage ne pouvait résulter que d'une relation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme, la cour d'appel n'a violé ni l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
Cette solution a été reprise par la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 17 février 1998.
Aux termes de cette décision, les juges luxembourgeois avaient estimé que « les relations stables entre deux personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre personnes de même sexe » (CJCE 17 févr. 1998, aff. C-249/96).
Il a donc fallu attendre l’adoption de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pour que l’on reconnaisse qu’un couple de personnes de même sexe puisse vivre en concubinage.
Chapitre II: La preuve du concubinage
Dans la mesure où le concubinage est constitutif d’une situation de fait, conformément à l’article 1358 du Code civil la preuve est libre.
Les concubins peuvent également au cours de leur vie commune demander l’établissement d’un document constatant leur union.
Au nombre de ces documents figurent :
- Le certificat de concubinage
- Il doit être demandé auprès de la Mairie
- Trois conditions sont classiquement exigées :
- La fourniture d’un justificatif d’identité
- L’existence d’une domiciliation commune des demandeurs
- La présence de témoins qui n’ont aucun lien de parenté doivent attester de la véracité du concubinage des demandeurs
- L’acte de notoriété
- L’acte de notoriété est un document dressé selon le cas par un juge d’instance ou un notaire, dans lequel des déclarants attestent qu’un fait est de notoriété publique, c’est-à-dire connu par un grand nombre de personnes, et à leur connaissance personnelle.
- Aussi, afin de prouver la réalité d’une vie maritale, les concubins peuvent solliciter auprès d’un notaire l’établissement d’un acte de notoriété constatant l’existence d’une vie commune
Chapitre 3: Les effets du concubinage
Le concubinage est une situation de fait. La conséquence en est que le droit n’attache aucun effet à cette forme d’union. Aussi, est-ce, par principe, le droit commun qui a vocation à régir les rapports entre concubins.
L’examen des textes et de la jurisprudence révèle toutefois que, ni le législateur, ni les juridictions ne sont restés totalement indifférents à leur sort.
Aussi, compte-on un certain nombre de règles qui régissent les rapports entre concubins.
I) Dans les rapports personnels
A) Principe
Les dispositions relatives au mariage et au pacs n’étant pas applicables aux concubins, dans leurs rapports personnels, aucune obligation ni devoir n’est mis à leur charge.
Ainsi, les concubins ne sont-ils nullement tenus d’observer un devoir de fidélité, de secours, d’assistance ou encore de respect comme ce peut être le cas pour les époux.
B) Exceptions
Par exception, le concubinage confère aux concubins un certain nombre de droits qui, au regard de ceux octroyés aux époux et aux partenaires, demeurent restreints.
- Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation
- L’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
- L’article 15 de cette même loi prévoit que le bailleur est autorisé à donner congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre le local à la faveur de son partenaire, conjoint ou concubin. Le délai de préavis applicable au congé est alors de six mois
- Droits conférés dans le cadre des relations avec les organismes sociaux
- L’article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale confère au concubin le droit de percevoir une pension de réversion en cas de décès de l’assuré à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
- L’article L. 361-4 du même code confère encore au concubin le droit de percevoir un capital décès attribué par la caisse primaire d’assurance maladie s’il était, au moment du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.
- L’article L. 3142-12 du Code du travail prévoit enfin que le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque son concubin présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité
- Droits conférés dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance
- L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que, en principe, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
- Toutefois, l’alinéa 3 de cette disposition précise que l’assureur n’a aucun recours contre notamment toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes
- Cette disposition permet ainsi d’inclure les concubins dans le champ d’application de l’exception.
- Droits conférés dans le cadre de poursuites pénales
- Le Code pénal confère une immunité aux concubins s’agissant de la poursuite de certaines infractions pénales.
- Il en va ainsi :
- pour non-dénonciation de crimes ( 434-1 C. pén.),
- pour recel de malfaiteur ( 434-6 C. pén.)
- pour non-témoignage en faveur d’un innocent ( 434-11 C. pén.)
- La jurisprudence pose toutefois comme condition que le concubinage soit notoire, ce qui implique l’existence d’une vie commune et que la relation de couple soit stable et durable.
- Droits conférés dans le cadre de l’obtention d’un titre de séjour
- L’article L. 313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la situation de concubinage constitue un motif d’obtention d’un titre de séjour
- Cette disposition dispose en ce sens que « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ” vie privée et familiale ” est délivrée de plein droit notamment A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée.»
- Droit conférés dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et prélèvement d’organes
- Sur l’assistance médicale à la procréation
- L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :
- vivants
- en âge de procréer
- mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.
- L’article L. 2141-2 du Code de la santé publique prévoit que pour accéder à l’assistance médicale à la procréation l’homme et la femme formant le couple doivent être :
- Sur le prélèvement d’organes
- L’article L. 1231-1 du code de la santé publique prévoit, s’agissant d’un prélèvement d’organes que, par principe, le donneur doit avoir la qualité de père ou mère du receveur.
- Toutefois, l’alinéa 2 dispose que peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d’organe dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur notamment « toute personne apportant la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans avec le receveur ainsi que toute personne pouvant apporter la preuve d’un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. »
- Sur l’assistance médicale à la procréation
II) Dans les rapports patrimoniaux
A) Les rapports entre concubins
Contrairement au couple marié, les concubins ne bénéficient d’aucun statut matrimonial, soit de règles qui régissent leurs rapports patrimoniaux.
Il en résulte que ces derniers sont insusceptibles de se prévaloir des règles qui régissent les rapports pécuniaires entre époux.
- Contribution aux charges du ménage
Bien que la vie en couple génère des dépenses communes dont chaque membre va tirer profit, les concubins, à la différence des époux, ne sont pas tenus de contribuer aux charges du ménage conformément à l’article 214 du Code civil.
Cette disposition prévoit pourtant que les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
Par charges du mariage, il faut entendre toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).
Il s’agit, en somme, de toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage.
Régulièrement, la jurisprudence rappelle que cette disposition n’est pas applicable au couple de concubins.
Dans un arrêt du 19 mars 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens « qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées » (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991).
| Cass. 1ère civ. 19 mars 1991 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel (Versailles, 18 juillet 1988) d'avoir rejeté sa demande, en vue de répartir, entre lui et Mme Y..., les dépenses de vie courante respectivement exposées, par chacun d'eux, durant la période de leur concubinage, en retenant qu'ils y avaient participé à proportion de leurs ressources personnelles et qu'il n'y avait donc pas lieu à comptes de ce chef, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ils se trouvaient dans une situation de fait non légalement réglementée, de sorte qu'en constituant entre eux une contribution aux charges de la vie commune, à proportion de leurs ressources, ainsi qu'il est dit à l'article 214 du Code civil, non applicable aux concubins, la cour d'appel a violé ce texte ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état d'un accord tacite entre les intéressés sans autrement justifier cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que sont demeurées sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que les acquisitions réalisées durant la communauté de vie avaient été réparties au profit de celui qui en était détenteur, ou par l'attribution faite lors du partage consécutif à la rupture ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que c'est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre aux conclusions invoquées par la troisième branche du moyen qui sont inopérantes, que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'établir, à ce sujet, un compte entre les parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
Dans un arrêt plus récent du 31 janvier 2006, la haute juridiction a encore estimé, bien qu’ayant relevé qu’un concubin avait participé au financement du bien indivis acquis par sa concubine dans des proportions supérieures à celle-ci que, dans la mesure où aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, ces derniers n’ont droit à aucune indemnité à ce titre.
| Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 214, 220 et 815 du Code civil ; Attendu que, pour fixer à égalité les parts respectives de M. X... et de Mme Y... dans l'actif de l'indivision ayant existé entre eux, liquidée après la vente du bien immobilier qu'ils avaient acquis indivisément, l'arrêt attaqué retient que la mention à l'acte d'achat de celui-ci suivant laquelle cette acquisition avait été faite "par égale parts entre eux" révélait leur commune intention d'être indivisaires à égalité, sans tenir compte de l'origine des fonds ayant servi à cette acquisition, la participation de Mme Y... à la vie du ménage pendant seize ans ayant constitué une contribution réelle, bien que non quantifiable en espèces, au financement de ce bien ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, il était établi que M. X... avait participé au financement du bien indivis dans des proportions supérieures à celles de Mme Y... et que, d'autre part, aucune disposition légale ne règle la contribution aux charges du ménage de la vie commune des concubins, lesquels n'ont droit à aucune indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; |
Il ressort de cette jurisprudence que, en l’absence de statut juridique, les concubins s’exposent à de grands risques en cas de rupture du couple, en particulier s’agissant du partage des biens qu’ils ont acquis au cours de la vie commune.
Aussi, afin de limiter ce risque, il leur est possible de conclure, par exemple, une convention de concubinage.
2. La convention de concubinage
La conclusion d’une convention de concubinage vise à régir les rapports patrimoniaux que les concubins entretiennent entre eux et donc à prévenir toute difficulté susceptible de survenir en cas de rupture de leur union.
Il leur est ainsi possible de prévoir une obligation de contribution aux charges de la vie commune à proportion de leurs facultés respectives, à l’instar de l’article 214 du Code civil. Il peut encore organiser les modalités d’administration de leurs biens.
Si en soi, les conventions de concubinage sont valables, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 juin 2006, que son caractère contraignant ne doit pas constituer « un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ».
Pour la première chambre civile, la conclusion d’une telle convention serait « contraire au principe de la liberté individuelle » (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006).
| Cass. 1ère civ. 20 juin 2006 | |
|---|---|
| Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1984 à 2002 ; que de leur union sont nés deux enfants en 1990 et 1996 ; qu'ils ont signé le 1er septembre 1984 une convention de concubinage prévoyant que le concubin qui n'a pas d'emploi ou qui renonce à son emploi pour élever les enfants pourra exiger de l'autre une indemnité égale au moins à la moitié des revenus du travail de son concubin à condition que les enfants soient élevés à son foyer; qu'après leur rupture, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004) d'avoir déclaré nulle la convention de concubinage conclue le 1er septembre 1984 et d'avoir réduit à 760 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors, selon le moyen, que les parents ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'une convention de concubinage ayant cet objet n'est pas contraire à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, ensemble l'article 373-2-7 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention signée par les concubins n'avait pas fixé le montant de la contribution à proportion des ressources de chacun des parents et des besoins des enfants mais à un montant forfaitaire, égal à la moitié des revenus du concubin, susceptible d'une part de placer l'intéressé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations à l'égard d'autres créanciers d'aliments, et, d'autre part, constituant par son caractère particulièrement contraignant un moyen de dissuader un concubin de toute velleité de rupture contraire au principe de la liberté individuelle, la cour d'appel en a justement déduit que cette stipulation, contraire aux dispositions d'ordre public qui régissent l'obligation alimentaire, était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; |
3. Actes à titre gratuit
==> L’exigence de conformité aux bonnes mœurs
Si, dans l’ancien droit, les libéralités entre concubins étaient prohibées, le silence du Code civil a conduit la jurisprudence à apprécier leur validité en considération du but poursuivi par leur auteur.
Plus précisément, dans l’hypothèse où la libéralité était assortie d’une cause immorale, elle encourait la nullité.
Dans un arrêt du 4 mars 1914, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les libéralités entre concubins ne sont pas interdites en principe ; elles sont nulles si elles n’ont été que l’exécution d’un pacte immoral » ( req. 4 mars 1914)
Dans un arrêt du 14 novembre 1961, elle a affirmé, dans le même sens, que « le seul fait que l’auteur d’une libéralité entretiendrait avec le bénéficiaire des relations illicites, même adultères ne suffit pas pour invalider l’acte, dès lors que le mobile du disposant, souverainement apprécié par les juges du fond, est étranger à ces relations» ( 1ère civ., 14 novembre 1961)
On peut encore citer une décision du 8 novembre 1982 aux termes de laquelle la Cour de cassation a estimé que devait être annulée une libéralité dont « la cause impulsive et déterminante était la formation, la continuation ou la reprise des relations immorales» ( 1ère civ., 8 nov. 1982).
Il ressort de cette jurisprudence que, pour être valide, la libéralité ne devait pas être consentie pour une cause immorale.
==> L’abandon de l’exigence de conformité aux bonnes mœurs
Dans un arrêt du 3 février 1999, la Cour de cassation a, semble-t-il, abandonné l’exigence de conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi par l’auteur d’une libéralité ( 1ère civ. 3 févr. 1999).
Elle a, en effet, jugé que « n’est pas contraire aux bonnes mœurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire».
Si l’adultère n’est pas contraire aux bonnes mœurs que reste-t-il de la notion ?
D’où la déduction de la doctrine que la Cour de cassation avait abandonné l’exigence passée, sans doute en raison de l’évolution…des mœurs.
| Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l'auteur entend maintenir la relation adultère qu'il entretient avec le bénéficiaire ; Attendu que le 26 octobre 1989, Roger Y... est décédé en laissant à sa succession son épouse et M. Christian Y... qu'il avait adopté ; que par testament authentique du 17 mars 1989, il a, d'une part, révoqué toute donation entre époux et exhérédé son épouse, et, d'autre part, gratifié Mme X... d'une somme de 500 000 francs ; que M. Christian Y... a soutenu que la cause de cette disposition était contraire aux bonnes moeurs ; Attendu que pour prononcer la nullité de la libéralité consentie à Mme X..., la cour d'appel a retenu que la disposition testamentaire n'avait été prise que pour poursuivre et maintenir une liaison encore très récente ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. |
Diversement accueillie par les auteurs, cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, dans un arrêt du 29 octobre 2014.
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a réaffirmé, au moyen d’une motivation quelque peu différente, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »
- Faits
- Dans le cadre d’une relation adultère qu’un époux entretien avec une concubine, il institue cette dernière légataire universelle par acte authentique du 4 octobre 1990
- Demande
- À la mort du testateur, ses héritiers engagent une action en nullité du legs
- Procédure
- En suite de la première décision rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 1996, la légataire universelle forme un pourvoi en cassation aux fins de délivrance du legs, les juges du fond n’ayant pas fait droit à sa demande
- Aussi, leur décision est cassée le 25 janvier 2000 par la première chambre civile de la Cour de cassation
- La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 9 janvier 2002 dans le même sens que les premiers juges d’appel par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l’arrêt de cassation.
- Les juges du fond estiment, en effet, que le legs dont était bénéficiaire la requérante était nul dans la mesure où il « n’avait vocation qu’à rémunérer les faveurs» de cette dernière, de sorte qu’il était « contraire aux bonnes mœurs »
- Un pourvoi est alors à nouveau formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, à la suite de quoi l’assemblée plénière
- Solution
- Par un arrêt du 29 octobre 2004, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
- La haute juridiction considère, dans une décision qui fera date, que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère »
- Ainsi pour l’assemblée plénière, quand bien même le legs avait été consenti à la concubine d’un époux dans le cadre d’une relation adultère, la libéralité en l’espèce ne portait pas atteinte aux bonnes mœurs.
- Depuis les arrêts du 3 février 1999 et du 29 octobre 2004, la validité des libéralités consenties entre concubins n’est donc plus appréciée en considération de la conformité aux bonnes mœurs du but poursuivi.
| Cass. ass. plén., 29 oct. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 900, 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que n'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Première Chambre civile, 25 janvier 2000, pourvoi n° D 97-19.458), que Jean X... est décédé le 15 janvier 1991 après avoir institué Mme Y... légataire universelle par testament authentique du 4 octobre 1990 ; que Mme Y... ayant introduit une action en délivrance du legs, la veuve du testateur et sa fille, Mme Micheline X..., ont sollicité reconventionnellement l'annulation de ce legs ; Attendu que, pour prononcer la nullité du legs universel, l'arrêt retient que celui-ci, qui n'avait "vocation" qu'à rémunérer les faveurs de Mme Y..., est ainsi contraire aux bonnes moeurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
B) Les rapports avec les tiers
- Principe : l’absence de solidarité
Dans leurs rapports avec les tiers, il est de jurisprudence constante que les actes accomplis par un concubin n’engagent pas l’autre.
Autrement dit, il n’existe aucune solidarité entre concubins à la différence des époux dont les rapports avec les tiers sont régis par l’article 220 du Code civil.
2. La justification du principe
L’absence de solidarité entre les concubins se justifie pour deux raisons.
==> L’inapplication du principe de solidarité des dettes ménagères aux concubins
Aux termes de l’article 220 du Code civil toute dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement dès lors que la dépense a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Cela signifie concrètement que lorsqu’un époux contracte avec un tiers, ce dernier peut réclamer le paiement du tout à son conjoint en application du principe de solidarité des dettes ménagères.
La question qui s’est alors posée a été de savoir si cette règle était applicable aux concubins.
Le créancier qui a contracté avec l’un peut-il se retourner contre l’autre en cas de non-paiement de sa créance ?
La jurisprudence a répondu, à plusieurs reprises, par la négative à cette question.
Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation a estimé en ce sens que l’article 220 du Code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage» ( 1ère civ. 2 mai 2001).
| Cass. 1ère civ. 2 mai 2001 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 220 du Code civil ; Attendu que ce texte, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en matière de concubinage ; Attendu que M. Y..., qui vivait en concubinage avec Mlle X..., a souscrit un contrat d'abonnement auprès d'EDF-GDF ; qu'il a laissé des factures impayées et a quitté sa concubine ; qu'après son départ, celle-ci a souscrit un nouvel abonnement à son nom, a régulièrement payé ses factures mais a refusé de régler l'arriéré qui avait été facturé à son ancien concubin ; Attendu que, pour condamner Mlle X... à payer à EDF-GDF la somme de 7 532,83 francs, montant de l'arriéré, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1995, l'arrêt attaqué affirme que, si l'union libre confère des droits de plus en plus nombreux qui rapprochent cette situation du statut du mariage, il convient alors de faire application aux concubins des mêmes obligations que celles des époux quant aux dépenses d'entretien au nombre desquelles figurent les factures de fourniture d'électricité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la seule identité du titulaire du contrat d'abonnement et que le concubin qui vit habituellement sous le même toit engage sa compagne ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans. |
La première chambre civile a réaffirmé sa position dans un arrêt du 27 avril 2004 aux termes duquel elle a considéré, au visa des articles 220 et 1202 du Code civil, « qu’aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu’il faut qu’elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage» ( 1ère civ. 27 avr. 2004).
La conséquence en est que la solidarité ne saurait jouer en cas de souscription par le seul concubin d’un prêt, quand bien même sa concubine serait à l’origine des demandes financières.
Il en va de même pour le concubin qui n’était pas signataire du contrat de bail conclu par sa concubine ( 1ère civ., 28 juin 2005).
| Cass. 1ère civ., 28 juin 2005 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation ; que, durant cette période, M. X... a supporté seul le paiement du loyer et des charges ; qu'il a assigné M. Y... en paiement de sa quote-part ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'un contrat moral, alors, selon le moyen, que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible, eu égard à la nature des relations existant entre les parties, d'être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que la preuve de cet engagement peut notamment résulter de tout écrit émanant de la personne à qui on l'oppose et qu'il importe peu à cet égard que les documents constatant l'existence d'un contrat moral aient été formalisés avant ou après le début de la vie commune, qu'en retenant au contraire, après avoir constaté que MM. X... et Y... avaient vécu ensemble pendant près de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations, que l'engagement de ce dernier à assumer une quote-part des dépenses afférentes à leur vie commune ne pouvait pas être déduit de courriers antérieurs au début de leur vie commune, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissaient pas l'engagement de M. Y... à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
==> L’absence de présomption de solidarité en droit commun
Aux termes de l’article 1310 du Code civil (anciennement 1202) « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas».
Il en résulte que la solidarité entre concubins ne peut jamais être présumée
Cela signifie-t-il qu’elle doit nécessairement être stipulée pour opérer.
Aussi, pour être fondé à se prévaloir de la solidarité entre concubins, il appartiendra au tiers de démontrer qu’elle procède
- Soit d’une règle légale
- Soit d’une stipulation contractuelle
Lorsque, de la sorte, un couple de concubins contracte un prêt, le banquier exigera systématiquement qu’ils s’engagent solidairement.
Il en va de même lorsque les concubins souscriront un contrat de bail.
Si le tiers ne prend pas la précaution de prévoir une clause de solidarité dans le contrat, il s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux.
Cette règle a notamment été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2012.
| Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1202 du code civil ; Attendu que, prétendant qu'elle avait consenti un crédit à M. X... et à Mme Y... que ceux-ci, qui vivaient en commun, s'étaient solidairement obligés à rembourser, la société Laser Cofinoga les a assignés en remboursement ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal, après avoir constaté que la signature de M. X..., qui contestait avoir souscrit le crédit litigieux, ne figurait pas sur l'acte le constatant, retient que si l'article 220 du code civil n'a pas vocation à recevoir application, M. X... est néanmoins solidairement tenu à remboursement dès lors qu'il avait connaissance du contrat établi à partir d'agissements constitutifs de faux imputables à Mme Y... et de l'utilisation du crédit pour financer des achats pendant la vie commune ; Qu'en se fondant sur de tels motifs impropres à caractériser un engagement solidaire de M. X..., le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition portant condamnation à l'encontre de M. X..., le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châtellerault ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; |
3. Tempérament : la théorie de l’apparence
La jurisprudence admet que dès lors que les concubins ont donné l’apparence d’un couple marié, les tiers sont fondés à se prévaloir de l’article 220 du Code civil, alors même que les concubins sont exclus de son champ d’application (Pour une application de la théorie de l’apparence V. notamment CA Paris, 30 juin 1981 ; CA Pau, 14 mai 2001)
L’invocation de la théorie de l’apparence est cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
- Une situation contraire à la réalité
- Une croyance légitime du tiers
- Une erreur excusable du tiers
- Une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable
Chapitre 4: La rupture du concubinage
L’appréhension juridique de la rupture du concubinage suppose d’envisager, d’une part, les modalités de la rupture et, d’autre part, les conséquences de la rupture.
Section 1: Les modalités de la rupture
§1: Le principe : la liberté de rompre
Tout autant que la formation du concubinage n’est subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité, ni à l’observation d’aucune règle, sa rupture est totalement libre.
Le concubinage se distingue ainsi du mariage qui, pour être dissous, suppose que les époux remplissent les conditions – strictes – édictées par la loi.
En dehors des cas de divorce prévus par l’article 229 du Code civil, les époux sont, en effet, privés de la possibilité de mettre un terme à leur union matrimoniale.
Il en va de même, dans une moindre mesure, pour les partenaires qui doivent satisfaire aux exigences posées par l’article 515-7 du Code civil pour dissoudre le pacs.
Le concubinage présente, dès lors, cet immense avantage de pouvoir être rompu librement.
Dans un arrêt du 28 octobre 1996, la Cour d’appel a jugé en ce sens que « l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties » (CA Rennes, 28 oct. 1996)
Philippe Malaurie résume parfaitement l’état du droit lorsqu’il écrit que « en dehors du mariage, chacun est libre de cesser d’aimer celle qu’il a aimée, et de l’abandonner. La règle de l’amour libre est la liberté, ce que, plus juridiquement énonce la règle connue : par lui-même, le concubinage ne fait naître aucune obligation. L’homme n’a point de responsabilité ni d’obligation civiles envers la délaissée »[1].
La conséquence en est que la rupture, en soi, du concubinage ne saurait donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Dans un arrêt du 30 juin 1992, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « la rupture du concubinage ne peut ouvrir droit à indemnité que si elle revêt un caractère fautif » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1992).
§2: Tempérament : la rupture fautive
Si, en soi, la rupture du concubinage est libre, les circonstances qui l’entourent sont susceptibles de fonder une action en responsabilité.
Pour que son action prospère, le concubin devra néanmoins rapporter la preuve d’une faute détachable de la rupture.
Dans un arrêt du 3 janvier 2006 la Cour de cassation a affirmé à cet égard que « si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l’allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu’il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » (Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006).
| Cass. 1ère civ. 3 janv. 2006 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 octobre 1943 ; que quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune ; que M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) de l'avoir déclaré responsable de la rupture et de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen : 1 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, alors que l'entourage ne s'y attendait nullement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de Mme X... vis-à-vis de M. Y..., dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, en profitant de l'absence de celle-ci, sur la foi d'attestations établies par les filles de l'exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s'assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y... et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / subsidiairement, la rupture d'un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n'est pas indemnisable ; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation ; qu'en évaluant le préjudice de Mme X... par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d'une rupture de concubinage même non fautive, et n'était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; que la cour d'appel relève, d'une part que M. Y..., en dépit du jugement de divorce dont il s'est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l'égard de son épouse que des tiers, d'autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
Ainsi, la jurisprudence est-elle venue au secours du concubin brutalement délaissé en lui permettant de réclamer l’octroi de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle.
Conformément à l’article 1240 du Code civil pour que la responsabilité civile de l’auteur d’un dommage puisse être recherchée, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
- L’existence d’un dommage
- La caractérisation d’une faute
- L’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute
![]()
En conséquence, il appartiendra au concubin délaissé d’établir que la rupture dont il est victime était fautive, à défaut de quoi aucune réparation ne peut lui être accordée, fût-ce après de très nombreuses années de vie commune.
L’engagement de la responsabilité civile de l’auteur de la rupture exige donc qu’une faute détachable de la rupture soit prouvée.
Cette faute résidera, le plus souvent, dans les circonstances particulières qui ont entouré la rupture.
Les juridictions ont admis que la rupture pouvait être qualifiée de fautive dans un certain nombre de situations :
- La concubine a été délaissée pendant sa grossesse
- La rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune
- La rupture procède de propos injurieux de la part du concubin
- La rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin
- Le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant, sans leur laisser de subsides
Il ressort de la jurisprudence que, en la matière, tout est affaire d’appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.
Il faudra par ailleurs que celui qui se dit victime d’une rupture fautive du concubinage établisse l’existence d’un préjudice. La Cour de cassation admet que ce préjudice peut être, tant matériel, que moral (V. en ce sens CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964).
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, soit sur celui qui engage l’action en responsabilité.
§3: Cas particulier du décès d’un concubin
La question s’est posée en jurisprudence de savoir si en cas de décès accidentel de l’un des concubins, l’autre était fondé à engager la responsabilité de l’auteur du dommage ?
Plus précisément, on s’est demandé si le préjudice du concubin survivant répondait à l’exigence de légitimité à laquelle est subordonnée la réparation du dommage.
- L’exigence de l’établissement d’un lien de droit
- Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 ( crim. 13 févr. 1937). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 27 juillet 1937 (Cass. civ. 27 juill. 1937)
- Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ».
- L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les concubins de leur demande de réparation, dans la mesure où ils ne justifiaient d’aucun d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate du dommage.
- L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux
- La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte ( ch. mixte, 27 févr. 1970).
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.
- La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
- Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.
- La restriction posée par l’arrêt Dangereux
- La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.
- Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
- Le concubinage doit être stable
- Le concubinage ne doit pas être délictueux
- Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice
- L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux
- La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet ( crim. 20 avr. 1972).
| Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que ce texte, ordonnant que l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui sera tenu de la réparer, n'exige pas, en cas de décès, l'existence d'un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation; attendu que l'arrêt attaque, statuant sur la demande de la dame x... en réparation du préjudice résultant pour elle de la mort de son concubin paillette, tue dans un accident de la circulation dont dangereux avait été juge responsable, a infirme le jugement de première instance qui avait fait droit à cette demande en retenant que ce concubinage offrait des garanties de stabilité et ne présentait pas de caractère délictueux, et a débouté ladite dame x... de son action au seul motif que le concubinage ne crée pas de droit entre les concubins ni à leur profit vis-à-vis des tiers; Qu'en subordonnant ainsi l'application de l'article 1382 a une condition qu'il ne contient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de paris, le 16 octobre 1967; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil. |
Section 2: Les conséquences de la rupture
En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.
Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.
La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.
En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas restées indifférentes.
Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.
Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.
Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.
Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter deux sortes de difficultés :
- Première difficulté: la preuve de la propriété des biens
- Seconde difficulté: la réalisation du partage des biens
Sous-section 1: La preuve de la propriété des biens
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.
Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.
C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
- Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété
- Deux situations doivent alors être distinguées
- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
- Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété
- Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire
- Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité
- Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte
- Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision
- Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété
- Principe
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance
- Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée» ( 1ère civ. 19 mars 2004).
- Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendiqué la propriété.
- La qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété.
- Exception
- Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a estimé que, en cas d’intention libérale, le concubin titulaire du titre de propriété n’est pas fondé à se prévaloir de la qualité de propriétaire
- Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause».
- Principe
- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
- Deux situations doivent alors être distinguées
- Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété
- En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.
- Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.
- L’inopérance de la présomption de possession
- Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre»
- Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.
- Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles
- La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.
- En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.
- D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.
- Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.
- Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien
- Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.
- Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale
- Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien
- L’absence de présomption d’indivision
- Principe
- Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.
- Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis» ( 1ère civ. 25 juin 2014).
- Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage» (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).
- Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.
- La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)
- Exception
- L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.
- Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).
- La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.
- Principe
- L’inopérance de la présomption de possession
Sous-section 2: La réalisation du partage des biens
L’identification du propriétaire d’un bien lors de la cessation du concubinage n’est pas la seule difficulté que les concubins doivent surmonter.
La question se posera également de savoir comment procéder à la réalisation du partage des biens.
Autrement dit, selon quelles règles la répartition des biens des concubins doit-elle s’opérer ?
La lecture du Code civil révèle qu’un seul bien a retenu l’attention du législateur : la bague de fiançailles dont le sort est réglé à l’article 1088.
§1: Le principe
En l’absence de règles de répartition des biens, le principe est que les biens acquis, reçus ou crées par un seul des concubins au cours de la vie commune demeurent sa propriété exclusive.
Il en résulte deux conséquences :
- Chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en rapporter la preuve
- Chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit
§2: Les correctifs
Bien qu’aucune règle ne régisse la répartition des biens lors de la cessation du concubinage, la jurisprudence autorise, parfois, non sans un brin de bienveillance, les concubins à piocher dans le droit commun, ce, dans le dessein de rétablir un équilibre injustement rompu.
Au nombre des correctifs admis classiquement par les juridictions figurent notamment :
- La société créée de fait
- L’enrichissement injustifié (sans cause)
Toutefois, pace que ces correctifs ne sauraient pallier totalement l’absence – voulu – de statut juridique applicable aux concubins, la jurisprudence demeure extrêmement vigilante quant au respect des conditions d’application des règles invoquées.
Depuis quelques années, d’aucuns s’accordent même à dire que l’on assiste à un resserrement des exigences posées par la Cour de cassation à l’endroit des concubins.
Cela témoigne d’un mouvement jurisprudentiel général qui tend à vouloir stopper toute velléité des concubins qui chercheraient à détourner la finalité des règles dont ils sollicitent l’application aux fins de se doter d’un statut para matrimonial.
I) La société créée de fait
Parfois, l’un des concubins a pu participer à l’activité professionnelle de l’autre sans avoir perçu de rémunération.
Dans cette hypothèse, afin d’obtenir la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail fournie, le concubin lésé est susceptible de se prévaloir de la théorie de la société créée de fait, l’intérêt résidant dans le partage des bénéfices en cas de liquidation de la société.
La technique de la société présente, en effet, cet avantage d’attribuer à chaque associé sa part de profit optionnellement à l’apport en numéraire, en nature ou en industrie qu’il a pu effectuer.
L’existence d’une société créée de fait suppose toutefois d’établir la réunion de trois éléments que sont :
- La constitution d’un apport de chaque associé
- L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes
- Un affectio societatis (la volonté de s’associer)
Dans un arrêt du 3 novembre 2004, la Cour de cassation a estimé en ce sens que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter » (Cass. com. 3 nov. 2004).
Il ressort de cette décision, que non seulement, les trois éléments constitutifs de toute société doivent être réunis pour que les concubins puissent se prévaloir de l’existence d’une société créée de fait, mais encore ces éléments doivent être établis de façon distincte, sans qu’ils puissent se déduire les uns des autres.
| Cass. com. 3 nov. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2001), que M. Septime X... et Mme Y... ont vécu ensemble de 1975 à 1993 ; qu'ils ont exploité sur un terrain dont Mme Y... était propriétaire diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant ; qu'en 1991, Mme Y... a fait construire sur ce terrain une maison d'habitation ; que le 4 mars 1998, M. X... a assigné Mme Y... en déclaration de propriété pour moitié de l'immeuble, montant de sa part dans la société de fait qui aurait existé entre eux ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence d'une société de fait et ordonné sa liquidation et son partage, alors, selon le moyen : 1 / que la volonté de s'associer est, outre la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes un des éléments essentiels du contrat de société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le bien litigieux avait été acquis au seul nom de Mme Y..., laquelle avait remboursé l'emprunt sur son livret du Crédit Artisanal au moyen des fonds versés en espèces sur ce livret ; que ces constatations excluaient par elles-mêmes la volonté des concubins de s'associer sur un pied d'égalité ; qu'en déduisant pourtant l'existence d'une société de fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la société de fait entre concubins suppose notamment la volonté, chez chacun d'entre eux de contribuer aux pertes, laquelle ne se confond pas avec la participation aux dépenses du ménage ; qu'en se bornant à relever le fait que M. X... se soit porté caution de l'emprunt et les retraits en espèces de Mme Y... sur le compte bancaire de M. X..., circonstances impropres à caractériser l'existence d'une société de fait pour la réalisation d'un projet immobilier commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'existence d'une société de fait suppose nécessairement l'existence d'apports réciproques, la volonté commune de participer aux bénéfices et aux pertes ainsi que la volonté de s'associer ; que la cour d'appel qui avait relevé que toutes les factures produites étaient au nom de Mme Y..., ne pouvait déduire l'existence de société de fait entre concubins de la seule considération de la poursuite d'une relation de confiance entre M. X... et Mme Y... au-delà de la date de rupture de leur relation ; qu'en statuant de la sorte, sans relever la volonté commune des concubins de s'associer, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; qu'ayant constaté que M. X... était locataire du terrain avant son acquisition par Mme Y..., que lors de l'achat, M. X... avait fait des démarches auprès de la SAFER et des organismes préteurs, qu'il avaient vendu des boeufs pour financer l'acquisition, qu'il s'était porté caution de l'emprunt réalisé par Mme Y..., que sa propre soeur avait participé à l'achat, que les concubins avaient exploité sur ce terrain diverses activités commerciales dont celle de bar restaurant et que Mme Y... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de M. X... qu'elle faisait fonctionner, la cour d'appel en déduisant de l'ensemble de ces éléments qu'une société de fait avait existé entre les concubins a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi |
A) La constitution d’un apport
Conformément à l’article 1832 du Code civil, les associés ont l’obligation « d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie », soit de constituer des apports à la faveur de la société.
La mise en commun d’apports par les associés traduit leur volonté de s’associer et plus encore d’œuvrer au développement d’une entreprise commune.
Aussi, cela explique-t-il pourquoi la constitution d’un apport est exigée dans toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés créées de fait (Cass. com. 8 janv. 1991) et les sociétés en participation (Cass. com. 7 juill. 1953).
L’article 1843-3 du Code civil distingue trois sortes d’apports :
- L’apport en numéraire
- Il consiste en la mise à disposition définitive par un associé d’une somme d’argent au profit de la société, soit lors de sa constitution, soit lors d’une augmentation de capital social
- L’apport en nature
- Il consiste en la mise à disposition par un associé d’un bien susceptible d’une évaluation pécuniaire autre qu’une somme d’argent
- L’apport en industrie
- L’apport en industrie consiste pour un associé à mettre à disposition de la société, sa force de travail, ses compétences, son expérience, son savoir-faire ou encore son influence et sa réputation
S’agissant d’une société créée de fait entre concubins, l’apport pourra consister en l’une de ces trois formes d’apport.
B) L’existence d’une participation aux bénéfices et aux pertes
Il ressort de l’article 1832 du Code civil que l’associé a vocation, soit à partager les bénéfices d’exploitation de la société ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter, soit à contribuer aux pertes :
- Le partage des bénéfices et des économies
- Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
- Le partage de bénéfices
- Le partage de l’économie qui pourra en résulter
- Dans un célèbre arrêt Caisse rurale de la commune de Manigod c/ Administration de l’enregistrement rendu en date du 11 mars 1914, la Cour de cassation définit les bénéfices comme « tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéressés ».
- Autrement dit, les concubins doivent avoir l’intention de partager les résultats de leur association.
- Le seul partage des bénéfices ne suffira toutefois pas pour établir l’existence d’une société créée de fait, il faudra encore démontrer la volonté de contribuer aux pertes.
- Deux objectifs sont été assignés par la loi à la société :
- La contribution aux pertes
- Aux termes de l’article 1832, al. 3 du Code civil, dans le cadre de la constitution d’une société « les associés s’engagent à contribuer aux pertes»
- Aussi, cela signifie-t-il que, en contrepartie de leur participation aux bénéfices et de l’économie réalisée, les associés sont tenus de contribuer aux pertes susceptibles d’être réalisées par la société.
- Le respect de cette exigence est une condition de validité de la société.
- L’obligation de contribution aux pertes pèse sur tous les associés quelle que soit la forme de la société.
C) L’affectio societatis
L’affectio societatis n’est défini par aucun texte, ni même visée à l’article 1832 du Code civil. Aussi, c’est à la doctrine et à la jurisprudence qu’est revenue la tâche d’en déterminer les contours.
Dans un arrêt du 9 avril 1996, la Cour de cassation a défini l’affectio societatis comme la « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. com. 9 avr. 1996).
Bien que le contenu de la notion diffère d’une forme de société à l’autre, deux éléments principaux ressortent de cette définition :
==> La volonté de collaborer
Cela implique que les associés doivent œuvrer, de concert, à la réalisation d’un intérêt commun : l’objet social
Ainsi le contrat de société constitue-t-il l’exact opposé du contrat synallagmatique.
Comme l’a relevé Paul Didier « le premier type de contrat établit entre les parties un jeu à somme nulle en ceci que l’un des contractants gagne nécessairement ce que l’autre perd, et les intérêts des parties y sont donc largement divergents, même s’ils peuvent ponctuellement converger. Le deuxième type de contrat, au contraire crée entre les parties les conditions d’un jeu de coopération où les deux parties peuvent gagner et perdre conjointement et leurs intérêts sont donc structurellement convergents même s’ils peuvent ponctuellement diverger»[1]
==> Une collaboration sur un pied d’égalité
Cela signifie qu’aucun lien de subordination ne doit exister entre associés bien qu’ils soient susceptibles d’être détenteurs de participations inégales dans le capital de la société (Cass. com., 1er mars 1971).
==> Position de la jurisprudence
- Première étape
- Dans un premier temps, les juridictions se sont livrées à une appréciation plutôt souple des éléments constitutifs du contrat de société, afin de reconnaître l’existence entre concubins d’une société créée de fait
- Les juges étaient animés par la volonté de préserver les droits de celui ou celle qui, soit s’était investi dans l’activité économique de l’autre, soit dans l’acquisition d’un immeuble construit sur le terrain de son concubin.
- Pour ce faire, les tribunaux déduisaient l’existence d’un affectio societatis de considérations qui tenaient au concubinage en lui-même ( req., 14 mars 1927).
- Seconde étape
- Rapidement, la Cour de cassation est néanmoins revenue sur la bienveillance dont elle faisait preuve à l’égard des concubins :
- Dans un arrêt du 25 juillet 1949, elle a, en effet, durci sa position en reprochant à une Cour d’appel de n’avoir pas « relevé de circonstances de fait d’où résulte l’intention qu’auraient eu les parties de mettre en commun tous les produits de leur activité et de participer aux bénéfices et aux pertes provenant du fonds social ainsi constitué, et alors que la seule cohabitation, même prolongée de personnes non mariées qui ont vécu en époux et se sont fait passer pour tels au regard du public, ne saurait donner naissance entre elles à une société» ( com., 25 juill. 1949)
- Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’affectio societatis ne saurait se déduire de la cohabitation prolongée des concubins.
- Pour la haute juridiction cet élément constitutif du contrat de société doit être caractérisé séparément.
- Dans des arrêts rendus le 12 mai 2004, la chambre commerciale a reformulé, encore plus nettement, cette exigence, en censurant une Cour d’appel pour n’avoir « relevé aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale» ( 1re civ., 12 mai 2004).
- Dans un autre arrêt du 23 juin 2004, la haute juridiction a plus généralement jugé que « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres» ( com., 23 juin 2004).
- Faits
- Un couple de concubins se sépare.
- Ces derniers se disputent alors l’occupation du domicile dans lequel ils ont vécu, domicile construit sur le terrain du concubin.
- Demande
- Le propriétaire du terrain demande l’expulsion de sa concubine.
- La concubine demande la reconnaissance de l’existence d’une société créée de fait entre eux.
- Procédure
- La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2000, déboute la concubine de sa demande.
- Les juges du fond estiment que la preuve de l’existence d’un affectio societatis entre les concubins n’a nullement été rapportée et que, par conséquent, aucune société créée de fait ne saurait avoir existé entre eux.
- Moyens des parties
- La concubine fait valoir que quand bien même le prêt de la maison a été souscrit par son seul concubin, elle a néanmoins participé au remboursement de ce prêt de sorte que cela témoignait de la volonté de s’associer en vue de la réalisation d’un projet commun : la construction d’un immeuble.
- Qui plus est, elle a réinvesti le don qui lui avait été fait par son concubin dans l’édification d’une piscine, de sorte que là encore cela témoigner de l’existence d’une volonté de s’associer.
- Problème de droit
- Une concubine qui contribue au remboursement du prêt souscrit par son concubin en vue de l’édification d’un immeuble sur le terrain dont il est propriétaire peut-elle être qualifiée, avec ce dernier, d’associé de fait ?
- Solution
- Par un arrêt du 23 juin 2004, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la concubine.
- La Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait entre concubins soit reconnue cela suppose la réunion cumulative de trois éléments :
- L’existence d’apports
- L’intention de collaborer sur un même pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun
- L’intention de participer aux bénéfices et aux pertes
- La Cour d’appel n’étant pas parvenue à établir souverainement l’existence d’un affectio societatis, alors il n’était pas besoin que les juges du fond se penchent sur l’existence d’une participation financière à la participation de la maison
- Analyse
- Ici, la décision de la Cour de cassation est somme toute logique
- la Cour de cassation estime que pour que l’existence d’une société créée de fait soit reconnue, il faut la réunion de trois éléments cumulatifs.
- Il faut que ces éléments soient établis séparément
- Par conséquent, si le premier d’entre eux fait défaut (l’affectio societatis), il n’est pas besoin de s’interroger sur la caractérisation des autres !
- Le défaut d’un seul suffit à faire obstacle à la qualification de société créée de fait.
- La Cour de cassation précise que ces éléments ne sauraient se déduire les uns des autres.
- Autrement dit, ce n’est pas parce qu’il est établi une participation aux bénéfices et aux pertes que l’on peut en déduire l’existence de l’affectio societatis.
- Ici, la Cour de cassation nous dit que les trois éléments doivent être établis séparément.
- Faits
| Cass. com., 23 juin 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1832 du Code civil ; Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; |
II) L’enrichissement injustifié ou sans cause
==> L’émergence du principe d’enrichissement sans cause
Avant l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, aucun texte ne sanctionnait l’enrichissement d’une personne au détriment d’autrui.
Si, l’accroissement d’un patrimoine implique nécessairement l’appauvrissement corrélatif d’un autre, ce mouvement de valeur peut parfaitement se justifier s’il repose sur une cause légitime.
Il peut, par exemple, procéder d’une vente ou d’une donation, ce qui, en pareille hypothèse, n’a rien d’injuste ou d’illégitime.
Il est toutefois des situations qu’un déplacement de valeur s’opère sans fondement juridique, sans cause légitime.
Afin de rétablir l’équilibre injustement rompu entre ces deux patrimoines, la question s’est très vite posée en jurisprudence de savoir s’il fallait octroyer à l’appauvri une créance contre l’enrichi.
Lors de sa rédaction initiale, le code civil ne comportait aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui.
- L’article 555 du Code civil prévoit, par exemple, une indemnisation en cas de construction sur le terrain d’autrui
- Les articles 1433 à 1438 prévoient, encore, que lors de la liquidation du régime matrimonial, la communauté doit récompense à l’époux qui s’est appauvri à son profit et inversement.
- Les articles 1372 à 1375 instituaient quant à eux des quasi-contrats que sont la gestion d’affaires et la répétition de l’indu dont la finalité est de rétablir un équilibre qui a été injustement rompu.
Le champ d’application de ces textes est, toutefois cantonné à des situations bien spécifiques, de sorte que la théorie de l’enrichissement sans cause peut difficilement être rattachée à l’un d’eux.
Aussi, est-il rapidement apparu à la jurisprudence qu’il convenait d’ériger l’enrichissement sans cause comme une source autonome d’obligation.
==> La reconnaissance jurisprudentielle de l’enrichissement sans cause
La théorie de l’enrichissement sans cause a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (Cass. req. 15 juin 1892, GAJC, t. 2, 12e éd., no 239)
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action de in rem verso, « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée »
Elle en déduit « qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit »
La théorie de l’enrichissement sans cause est ainsi instituée en principe général.
| Cass. req. 15 juin 1892 | |
|---|---|
| Vu la connexité, joint les causes et statuant par un seul et même arrêt sur les deux pourvois : Sur le premier moyen du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 1165 du Code civil, de l’article 2102 du même code et de la fausse application des principes de l’action de in rem verso; Sur la première et la deuxième branches tirées de la violation des articles 1165 et 2102 du Code civil : Attendu que s’il est de principe que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers, il est certain que ce principe n’a pas été méconnu par le jugement attaqué; qu’en effet, cette décision n’a point admis, comme le prétend le pourvoi, que le demandeur pouvait être obligé envers les défendeurs éventuels à raison d’une fourniture d’engrais chimiques faite par ces derniers à un tiers, mais seulement à raison du profit personnel et direct que ce même demandeur aurait retiré de l’emploi de ces engrais sur ses propres terres dans des circonstances déterminées; d’où il suit que, dans cette première branche, le moyen manque par le fait qui lui sert de base; Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la seconde branche prise de la violation de l’article 2102 du Code civil; Qu’en effet, la décision attaquée a eu soin de spécifier que la créance du vendeur d’engrais ne constituait qu’une simple créance chirographaire ne lui conférant aucun privilège sur le prix de la récolte, et que, dès lors, l’article susvisé n’a pas été violé; Sur la troisième branche, relative à la fausse application des principes de l’action de in rem verso : Attendu que cette action dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée; qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit; que dès lors, en admettant les défendeurs éventuels à prouver par témoins que les engrais par eux fournis à la date indiquée par le jugement avaient bien été employés sur le domaine du demandeur pour servir aux ensemencements dont ce dernier a profité, le jugement attaqué (T. civ. de Châteauroux, 2 déc. 1890) n’a fait des principes de la matière qu’une exacte application; Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 1341 et 1348 du Code civil : Attendu que le jugement attaqué déclare en fait qu’il n’a pas été possible aux défendeurs éventuels de se procurer une preuve écrite de l’engagement contracté à leur profit par le demandeur, devant les experts et à l’occasion du compte de sortie réglé par ces derniers entre le fermier et le propriétaire; qu’en admettant la preuve testimoniale dans ce cas excepté nommément par l’article 1348 du Code civil, ledit jugement a fait une juste application dudit article et, par suite, n’a pu violer l’article 1341 du même code; Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil et des règles de l’action de in rem verso : Attendu qu’il en est de même en ce qui concerne la première branche de ce deuxième moyen tirée de la violation et fausse application de l’article 548 du Code civil; Attendu, en effet, que le jugement attaqué déclare formellement que le droit des défendeurs éventuels n’est pas fondé sur cet article, lequel n’est mentionné qu’à titre d’exemple et comme constituant une des applications du principe consacré virtuellement par le code que nul ne peut s’enrichir au détriment d’autrui; Sur la deuxième branche tirée de la fausse application des règles de l’action de in rem verso : Attendu que la solution, précédemment donnée sur la troisième branche du premier moyen dans le premier pourvoi, rend inutile l’examen de celle-ci, qui n’en est que l’exacte reproduction; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 1165 du Code civil et de la règle res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest : Attendu que, par une série de constatations et d’appréciations souveraines résultant des enquêtes et des documents de la cause, le jugement arrive à déclarer que le demandeur a pris l’engagement implicite mais formel de payer la dette contractée envers les défendeurs éventuels; qu’une semblable déclaration, qui ne saurait d’ailleurs être révisée par la cour, n’implique aucune violation de l’article ni de la règle susvisée; […] Par ces motifs, rejette… |
La solution adoptée dans l’arrêt Boudier a été réitéré dans une décision du 12 mai 1914.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé « que l’action de in rem verso fondée sur le principe d’équité qui défend de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne, cette dernière ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune autre action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit » (Cass. civ. 12 mai 1914, S. 1918-1919. 1. 41, note Naquet.).
Postérieurement à cette décision, la haute juridiction visera régulièrement l’article 1371 du Code civil « et le principe de l’enrichissement sans cause », d’où il pourra se déduire sa volonté de rattacher l’action de in rem verso à la catégorie des quasi-contrats (Cass. 3e civ. 18 mai 1982 ; Cass. 1ère civ. 17 sept. 2003 ; Cass. 1ère civ. 11 mars 2014 ; Cass. 1ère civ. 31 janv. 2018)
==> La consécration légale de l’enrichissement sans cause
Relevant que le code civil actuel ne comporte aucun article consacré à l’enrichissement injustifié, bien qu’il connaisse des applications de ce principe, selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement au détriment d’autrui, le législateur en a tiré la conséquence qu’il convenait de lui donner une véritable assise légale.
C’est ce qu’il a fait en introduisant dans le Code civil une partie dédiée à « l’enrichissement injustifiée ».
Désormais envisagé comme un quasi-contrat, l’enrichissement sans cause, « rebaptisé « enrichissement injustifié », est régi aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil.
Après avoir rappelé le caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause par rapport aux autres quasi-contrats, l’article 1303 du Code civil en décrit l’objet : compenser un transfert de valeurs injustifié entre deux patrimoines, au moyen d’une indemnité que doit verser l’enrichi à l’appauvri.
Il consacre donc la jurisprudence bien établie aux termes de laquelle l’action ne tend à procurer à la personne appauvrie qu’une indemnité égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’enrichissement, l’autre de l’appauvrissement.
Ainsi, l’appauvri ne peut-il s’enrichir, à son tour, au détriment d’autrui en obtenant plus que la somme dont il s’était appauvri, tout autant qu’il ne peut réclamer davantage que l’enrichissement car une telle action constituerait en réalité une action en responsabilité qui, par hypothèse, lui est fermée, conformément à l’article 1303-3 de l’ordonnance.
À l’examen, il apparaît que les conditions et les effets de l’enrichissement injustifiées sont, pour l’essentiel, directement inspirés de ce qui avait été établi par la jurisprudence.
A) Les conditions de l’enrichissement injustifié
La mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est subordonnée à la satisfaction de conditions qui tiennent :
- D’une part, à des considérations d’ordre économique
- D’autre part, à des considérations d’ordre juridique
1) Les conditions économiques
Les conditions de mise en œuvre de l’action fondée sur l’enrichissement injustifiée sont au nombre de trois :
- L’enrichissement du défendeur
- L’appauvrissement du demandeur
- La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
1.1 L’enrichissement du défendeur
Il ressort de la jurisprudence que l’enrichissement s’entend comme tout avantage appréciable en argent.
Classiquement, la jurisprudence admet que l’enrichissement puisse résulter :
- Soit d’un accroissement de l’actif
- Acquisition d’un bien nouveau
- Plus-value d’un bien existant
- Soit d’une diminution du passif
- Paiement de la dette d’autrui
- Soit d’une dépense épargnée
- Usage de la chose d’autrui
- Bénéfice du travail non rémunéré d’autrui
1.2 L’appauvrissement du demandeur
À l’inverse de l’enrichissement, l’appauvrissement s’entend comme toute perte évaluable en argent.
Cette perte peut consister :
- Soit en une dépense exposée
- Perte d’un élément du patrimoine
- Paiement de la dette d’autrui
- Moins-value d’un bien
- Soit en un manque à gagner
- Réalisation d’un travail non rémunéré pour autrui
1.3 La corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié ne peut prospérer qu’à la condition qu’il soit démontré l’existence d’une corrélation entre l’enrichissement du défendeur et l’appauvrissement du demandeur.
Ce lien de connexité qui doit être établi entre les deux mouvements de valeurs peut prendre deux formes :
- La corrélation peut être directe
- Cette hypothèse se rencontre lorsqu’il n’y a pas de patrimoine interposé entre celui de l’appauvri et celui de l’enrichi.
- Elle correspond aux situations telles que :
- Le paiement de la dette d’autrui
- Le travail non rémunéré accompli pour autrui
- L’acquisition d’un bien pour autrui
- Dans ces situations, il y a bien une personne qui s’est enrichie tandis que, corrélativement, une autre s’est directement appauvrie.
- La corrélation peut être indirecte
- Cette hypothèse se rencontre lorsque la valeur sortie du patrimoine du demandeur est entrée dans celui du défendeur par l’entremise du patrimoine d’une personne interposée
- Tel est le cas lorsque par exemple :
- Une personne aidante s’occupe, à titre bénévole, d’une personne âgée, ce qui évite aux membres de sa famille d’exposer des dépenses aux fins de pourvoir à sa prise en charge
- Un marchand a vendu des engrais à un fermier qui les a utilisés sur des terres louées ; terres dont le propriétaire – en raison de la résiliation du bail – a recueilli la récolte. Dans cette hypothèse, le propriétaire foncier s’est enrichi aux dépens du marchand d’une valeur qui a transité dans le patrimoine du fermier
2) Les conditions juridiques
Deux conditions juridiques doivent être satisfaites pour que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié puisse être mise en œuvre :
- L’enrichissement du défendeur doit être injustifié
- L’action de in rem verso ne peut être engagée qu’à titre subsidiaire
2.1 L’exigence d’un enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil « l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. »
L’article 1303-2 précise que d’une part, « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel » et, d’autre part, que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri. »
Il ressort de ces deux dispositions, que le caractère injustifié de l’enrichissement doit s’entendre comme l’absence de cause, bien que cette terminologie n’ait pas été reprise par le législateur.
Comme exprimé par d’éminents auteurs « le mot cause désigne l’acte juridique et, de façon plus générale, le mode régulier d’acquisition d’un droit en conséquence duquel un avantage a pu être procuré à une personne »[1]
En d’autres termes, si l’enrichissement est la conséquence d’une disposition légale, réglementaire, conventionnelle et plus généralement de tout acte juridique accompli par l’enrichi, l’action de in rem versée ne saurait être engagée car pourvue d’une cause, soit d’une justification.
L’absence de cause doit concerner, tant l’enrichissement, que l’appauvrissement.
a) L’absence de cause de l’enrichissement
L’absence de cause de l’enrichissement est caractérisée dans deux cas:
i) L’enrichissement ne résulte pas de l’exécution d’une obligation par l’appauvri
Cette obligation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire
Dès lors que l’enrichissement du défendeur est la conséquence de l’exécution de pareille obligation, il devient justifié.
- Tel est le cas, par exemple, du débiteur qui, sans contester l’existence de sa dette envers le créancier, refuse de le payer en faisant valoir qu’il est libéré par le jeu de la prescription extinctive
- Tel est encore le cas lorsque l’enrichissement d’un contractant procède de l’exécution d’une stipulation contractuelle
Dans un arrêt du 10 mai 1984, la Cour de cassation a considéré que, de manière générale, « n’est pas sans cause l’enrichissement qui a son origine dans l’un des modes légaux d’acquisition des droits» ( 1ère civ. 10 mai 1984)
La question s’est toutefois posée à la haute juridiction si l’existence d’une obligation morale incombant à l’appauvri conférait un caractère justifié à l’enrichissement.
Par un arrêt du 12 juillet 1994, elle a répondu par la négative à cette question en estimant que l’obligation morale ne s’apparentait pas à une obligation juridique ( 1ère civ. 12 juill. 1994)
ii) L’enrichissement ne résulte pas de l’intention libérale de l’appauvri
Dès lors que l’enrichissement procède d’une intention libérale, soit de l’accomplissement d’une libéralité par l’appauvri à la faveur de l’enrichi, le mouvement valeur est justifié.
Toute la difficulté sera alors pour l’enrichi de prouver l’existence d’une intention libérale du demandeur à l’action.
C’est ainsi que la Cour de cassation se montre de plus en plus exigeante à l’égard des concubins estimant qu’il leur appartient de démontrer que lorsqu’un aide financière, professionnelle ou matérielle a été apporté à l’un, elle ne réside pas dans l’intention libérale de l’autre.
==> Participation financière à l’acquisition d’un bien
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé en ce sens que le concubin qui avait participé au remboursement contracté par sa concubine en vue d’acquérir son pavillon ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble n’était pas fondé à se prévaloir d’un enrichissement injustifié, dès lors que son concours financier trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne.
La Cour de cassation en déduit que ces circonstances faisaient ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu’il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause ( 1ère civ. 20 janv. 2010).
La Cour de cassation a statué également dans ce sens dans un arrêt du 2 avril 2014.
Dans cette affaire, il s’agissait d’un couple de concubins qui avaient acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d’un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par le seul concubin jusqu’à sa séparation avec sa concubine
Cette dernière assigne alors son concubin en liquidation et partage de l’indivision.
La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui avait accédé à la requête de la concubine, jugeant qu’il résultait « des circonstances de la cause l’intention de l’emprunteur de gratifier sa concubine » ( 1ère civ. 2 avr. 2014).
| Cass. 1ère civ. 2 avr. 2014 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont acquis en indivision un immeuble dont partie du prix a été payée au moyen d'un prêt souscrit solidairement, mais dont les échéances ont été supportées par M. X... seul jusqu'à la séparation des concubins le 31 août 2005 ; que Mme Y... a assigné M. X... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et pour voir ordonner la licitation et dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait gratifié Mme Y... d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er septembre 2005 ; Attendu que la cour d'appel a retenu que l'acquisition indivise faite par moitié, alors que Mme Y... était, aux termes de l'acte de vente, sans profession, et que le couple avait eu ensemble deux enfants à l'époque de l'acquisition, établit l'intention libérale de M. X... en faveur de celle-ci, indépendamment de toute notion de rémunération ; qu'une telle donation emportait nécessairement renonciation de M. X... à se prétendre créancier de l'indivision au titre des remboursements du prêt effectués par lui seul, jusqu'à la séparation du couple, comme le réclame Mme Y... ; qu'elle a en conséquence fait droit à la demande tendant à voir juger que M. X... l'a gratifiée d'une donation en ayant réglé seul les échéances du prêt jusqu'au 1er septembre 2005 ; Attendu que la cour d'appel a souverainement constaté dans les circonstances de la cause l'intention de l'emprunteur de gratifier sa concubine ; que par ailleurs, en privant le concubin de son droit de créance au titre de la part payée pour sa compagne, la cour d'appel n'a nullement porté atteinte au droit de propriété ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; |
En cas de contribution financière substantielle d’un concubin quant à l’acquisition d’un bien immobilier, tout n’est pas perdu pour lui s’il souhaite faire échec à l’action de in rem verso afin de conserver le bénéfice de son investissement.
Il ressort de la jurisprudence que, pour que l’absence d’intention libérale puisse être caractérisée, il est nécessaire de démontrer que les dépenses engagées sont sans lien avec celles engendrées par la vie en couple.
Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de cassation a considéré dans le même que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par un concubin dans l’immeuble appartenant à sa concubine excédaient, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie courante et ne pouvaient pas être considérés comme une contrepartie des avantages dont sa compagne avait profité pendant la période du concubinage.
Aussi, la première chambre civile en conclue-t-elle que le concubin n’avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ( 1ère civ. 24 sept. 2008)
| Cass. 1ère civ. 24 sept. 2008 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de 1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du code civil ; 2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y... se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnue que ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
==> Collaboration non rémunérée à l’activité professionnelle
Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Cour de cassation a estimé que la concubine qui avait apporté son assistance sur le plan administratif à la bonne marche de l’entreprise artisanale de maçonnerie qu’elle avait constituée avec son concubin, sans que cette assistance n’excède la simple entraide, n’était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l’enrichissement sans cause ( 1ère civ. 20 janv. 2010).
Il ressort de cette décision que pour que l’action de in rem verso engagée par un concubin puisse aboutir, il doit être en mesure de démontrer que l’aide apportée ne procède pas de la simple entraide inhérente à toute forme de vie conjugale.
Lorsque, toutefois, la participation de la concubine à l’exploitation de l’activité professionnelle de son concubin sera conséquente, soit lorsque, de par son ampleur, elle dépasse la contribution aux charges du ménage, la Cour de cassation retiendra l’enrichissement injustifié.
Tel a été le cas, par exemple, dans un arrêt du 15 octobre 1996, aux termes duquel la Cour de cassation a jugé que la collaboration d’une concubine à l’exploitation du fonds de commerce de son concubin sans que celle-ci ne perçoive de rétribution impliquait, par elle-même un appauvrissement et corrélativement un enrichissement injustifié ( 1ère civ., 15 oct. 1996)
Pour la Cour de cassation, la contribution de la concubine à l’activité professionnelle de son concubin se distinguait d’une simple participation aux dépenses communes des concubins.
| Cass. 1ère civ. 20 janv. 2010 | |
|---|---|
| Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2008) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait constituée avec son concubin, Salvatore Y..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la reconnaissance d'une société créée de fait, qu'elle ne démontrait pas que sa participation dans l'entreprise excédait la seule entraide familiale quand, d'après ses propres constatations, elle avait pourtant exercé une activité dans l'entreprise et s'était inscrite au registre des métiers comme chef d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, a considéré que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale, ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise ; qu'en statuant à l'aune de ces seules constatations matérielles qui n'excluaient pourtant en rien l'existence d'un apport en industrie, fût-il limité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ; 3°/ qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une société créée de fait s'agissant de l'entreprise de maçonnerie, que Mme X... ne démontrait pas avoir exercé une activité excédant une simple entraide familiale ni avoir investi des fonds personnels dans l'entreprise, sans rechercher si de tels éléments excluaient l'intention de Mme Y... et de Mme X... de collaborer ensemble sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun ainsi que l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies en résultant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du code civil ; 4°/ que Mme X... fait valoir dans ses conclusions, sans être contredite, qu'elle avait abandonné son activité salariée pour se consacrer à l'entreprise de maçonnerie et qu'elle administrait l'entreprise dans ses relations avec les administrations, les fournisseurs, les avocats et les clients, eu égard à l'illettrisme de son concubin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que Mme X..., inscrite au registre des métiers en qualité de chef d'entreprise, avait par ailleurs exercé une activité de secrétaire de direction dans diverses sociétés, incompatible avec le plein exercice des responsabilités de chef d'entreprise quand il n'était pourtant pas contesté que Mme X... avait rapidement abandonné son activité salariée pour s'impliquer totalement dans l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si elle était inscrite au registre des métiers comme chef de l'entreprise de maçonnerie, Mme X... avait exercé, dans le même temps, une activité de secrétaire de direction, d'abord auprès de la société Corege du 24 août 1978 au 15 août 1981 puis de la parfumerie Pagnon du 1er février 1985 au 31 mai 1989, difficilement compatible avec les responsabilités d'un chef d'entreprise qui apparaissaient avoir été assumées en réalité par M. Y... et que celui-ci avait acquis seul, le 26 juillet 1979, un bien immobilier alors que le couple vivait en concubinage depuis 1964, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée et n'a pas méconnu l'objet du litige, a estimé que l'intention des concubins de collaborer sur un pied d'égalité à un projet commun n'était pas établie ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, qu'en relevant cependant, pour considérer que l'enrichissement sans cause de M. Y... au détriment du patrimoine de Mme X... n'était pas démontré, que rien n'établissait que les emprunts de faibles montants avaient été utilisés, non pour les besoins de la famille, mais dans le seul intérêt de son concubin et qu'elle avait été hébergée dans l'immeuble acquis par celui-ci, autant de circonstances insusceptibles d'exclure un appauvrissement sans cause de Mme X..., né de la seule implication dans l'entreprise sans rétribution, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que l'assistance apportée sur le plan administratif par Mme X... à la bonne marche de l'entreprise artisanale de maçonnerie qu'elle avait constituée avec son concubin n'excédait pas une simple entraide, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci n'était pas fondée à réclamer une indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause et a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; |
b) L’absence de cause de l’appauvrissement
Pour que l’enrichissement puisse être considéré comme injustifié, il est nécessaire de démontrer, corrélativement, que l’appauvrissement l’est aussi, soit qu’il est « sans cause».
Pour y parvenir, cela suppose de s’attacher au comportement de l’appauvri, lequel ne doit avoir, ni agi dans son intérêt personnel, ni commis de faute.
i) L’absence d’intérêt personnel de l’appauvri
==> Principe
L’article 1303-2, al. 1 du Code civil prévoit que « il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel.»
Cela signifie, que l’appauvri ne peut invoquer l’action de in rem verso, alors même que son appauvrissement n’est la conséquence d’aucun contrat ou d’aucune disposition légale, s’il a agi en vue de se procurer en avantage personnel.
- Tel est le cas de celui qui a construit ou entretenu une digue qui profite à d’autres riverains ( req. 30 avr. 1828)
- Tel est encore le cas du propriétaire d’un moulin qui par des travaux destinés à lui fournir un supplément d’eau, en procure également au moulin qui se situe en aval ( req. 22 juin 1927)
- Il en va également ainsi de celui qui, demandant le raccordement de son domicile au réseau électrique, en fait profiter son voisin (1ère civ. 19 oct. 1976).
==> Conditions
Bien que l’article 1303-2 du Code civil ne le mentionne pas, pour que l’appauvri qui a agi dans son intérêt personnel ne puisse pas se prévaloir de l’action de in rem perso, des conditions doivent être remplies.
Ces conditions résultent de la jurisprudence antérieure dont on a des raisons de penser qu’elle demeure applicable.
Dans un arrêt du 8 février 1972, la Cour de cassation a par exemple affirmé que « les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies lorsque les impenses ont été effectuées par le demandeur dans son intérêt, a ses risques et périls et en recueillant le profit» ( 3e civ. 8 févr. 1972).
Plus récemment, la troisième chambre civile a jugé dans un arrêt du 20 mai 2009 que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être accueillie dès lors que l’appauvri a « agi de sa propre initiative et à ses risques et périls» ( 3e civ. 20 mai 2009).
Il ressort de cette jurisprudence pour que l’application de l’action de in rem verso soit écartée, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- L’appauvri doit avoir agi de sa propre initiative
- L’appauvri doit avoir agi à ses risques et périls
Si donc, les prévisions de l’appauvri sont démenties et qu’il a subi une perte, le tiers qu’il a pu enrichir ne lui devra rien.
ii) La faute personnelle de l’appauvri
==> Le droit antérieur
La question s’est ici posée de savoir si, lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri, celui-ci ne serait dès lors pas pourvu d’une cause, sa propre faute, en conséquence de quoi l’action de in rem verso ne saurait être exercée.
Quid, par exemple, du garagiste qui entreprend de faire des travaux sur un véhicule qui n’avaient pas été commandés par ses clients ?
Dans un arrêt du 8 juin 1968, la Cour de cassation a estimé que, en pareille hypothèse, le garagiste ne saurait réclamer une quelconque indemnité à son client à raison de son enrichissement, dans la mesure où l’appauvrissement procède d’une faute ( com. 8 juin 1968)
L’examen de la jurisprudence révèle toutefois que la Cour de cassation n’était pas aussi arrêtée.
Dans un arrêt du 3 juin 1997, la Cour de cassation a, par exemple, considéré que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause» ( 1ère civ. 3 juin 1997).
Dans un arrêt du 27 novembre 2008, elle a statué dans le même sens en jugeant que « le fait d’avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause celui qui, en s’appauvrissant, a enrichi autrui» ( 1ère civ. 27 nov. 2008).
Ainsi, ces arrêts invitaient-ils à opérer une distinction selon que la conduite de l’appauvri était constitutive d’une faute grave ou d’une simple négligence.
- En cas de faute grave, l’action de in rem verso était écartée
- En cas de faute de négligence, l’action de in rem verso pouvait toujours être exercée
Toutefois, dans une décision du 19 mars 2015 la Cour de cassation a estimé que « l’action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l’appauvrissement est dû à la faute de l’appauvri» ( 1ère civ. 19 mars 2015).
De par la généralité de la formule utilisée, d’aucuns en ont déduit que la haute juridiction avait abandonné la distinction entre la faute grave et la faute de simple négligence.
Aussi, le législateur est-il intervenu afin de clarifier la situation.
| Cass. 1ère civ. 3 juin 1997 | |
|---|---|
| Attendu que M. Maze Y... a acquis le 2 juin 1984, au cours d'une vente aux enchères publiques dirigée par Mme X..., commissaire-priseur à Dax, un bureau plat, appartenant à M. Z..., qu'elle a présenté comme étant d'époque Louis XV ; qu'ayant été informé lors de l'exécution de travaux de restauration en 1990 que ce meuble était un faux, M. Maze Y... a assigné Mme X... en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) a condamné Mme X..., assurée par la compagnie Préservatrice foncière, à lui payer la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts, et, sur la demande de Mme X..., condamné M. Z... à payer à cette dernière celle de 148 000 francs ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à payer à Mme X... la somme de 148 000 francs représentant la différence entre le prix d'adjudication et la valeur résiduelle du meuble litigieux alors que le demandeur à une action fondée sur l'enrichissement sans cause qui a commis une faute à l'origine de son propre appauvrissement ne peut obtenir le bénéfice de cette action ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a engagé par imprudence sa responsabilité vis-à-vis de l'adjudicataire dont elle doit réparer le préjudice sans pouvoir être garantie par M. Z... qui n'a commis aucune faute à son égard, et qu'en déclarant néanmoins Mme X... bien fondée à exercer l'action, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil précité et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; Mais attendu que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. |
| Cass. 1ère civ. 19 mars 2015 | |
|---|---|
| Vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause; Attendu que l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute de l'appauvri ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a émis au profit de M. Y..., sur son compte ouvert à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque), deux chèques qu'il a ensuite frappés d'opposition en prétendant qu'il les avait perdus ; qu'ayant honoré les deux chèques, et invoquant l'impossibilité d'obtenir remboursement par un débit du compte, faute de provision suffisante, la banque a assigné M. X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que, pour accueillir les prétentions de la banque, l'arrêt retient que l'erreur qu'elle a commise ne lui interdit pas de solliciter un remboursement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; |
==> La réforme des obligations
L’article 1303-2, al. 2 du Code civil prévoit que « l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri.»
Si, de prime abord, le texte semble avoir abandonné la distinction qui avait été introduite par la jurisprudence entre la faute grave et la faute de négligence, elle resurgit si l’on se tourne vers la sanction qui est attachée à la faute de l’appauvri.
En effet, le législateur a prévu que, en cas de faute, le juge peut « modérer» l’indemnité octroyée à l’appauvri.
Or de toute évidence ce pouvoir de modération conféré au juge sera exercé par lui considération de la gravité de la faute commise par l’appauvri.
Le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 précise, d’ailleurs, que la faute de l’appauvri peut être sanctionnée par une suppression pure et simple de l’indemnité due au titre de l’action de in rem verso.
C’est donc un retour à la solution jurisprudentielle adoptée antérieurement à l’arrêt du 19 mars 2015 qui a été opéré par le législateur.
2.2 La subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement injustifié
Aux termes de l’article 1303-3 du Code civil « l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. »
Cette disposition rappelle, conformément à la jurisprudence antérieure, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso.
Ainsi cette action ne peut :
- Ni servir à contourner les règles d’une action contractuelle, extracontractuelle ou légale dont l’appauvri dispose
- Dès lors que l’appauvri dispose d’une action sur l’un de ces fondements juridiques, il n’est pas autorisé à exercer l’action de in rem verso
- Il lui appartient d’engager des poursuites sur le fondement de la règle dont les conditions d’application sont remplies.
- Il est indifférent que cette action puisse être engagée à l’encontre de l’enrichi ou d’un tiers (V. en ce sens com. 10 oct. 2000).
- Ni suppléer une autre action qu’il ne pourrait plus intenter suite à un obstacle de droit
- Lorsque l’appauvri dispose d’une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, l’action de in rem verso ne peut pas être exercée.
- La Cour de cassation avait estimé en ce sens dans un arrêt du 29 avril 1971, que l’action de in rem verso ne pouvait pas être admise « notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige, ou par suite de tout autre obstacle de droit » ( 3e civ., 29 avr. 1971)
- Dès lors que l’un de ces obstacles de droit est caractérisé, l’action de in rem verso est neutralisée.
- Au nombre de ces obstacles de droit figurent notamment :
- La prescription
- La déchéance
- La forclusion
- L’autorité de chose jugée
- Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a, par exemple, considéré qu’un salarié ne saurait exercer l’action de in rem verso, pour contourner l’extinction de l’action en paiement de sommes de nature salariale par l’effet de la prescription ( soc. 12 janv. 2011).
- Dans un arrêt du 2 novembre 2005, la Cour de cassation a encore jugé que l’action de in rem verso ne saurait être exercée par une concubine du défunt dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’apporter la preuve d’une obligation de remboursement contractée par celui-ci, ce qui était constitutif d’un obstacle de droit ( 1ère civ. 9 déc. 2010).
B) Les effets de l’enrichissement injustifié
Lorsque toutes les conditions de l’action de in rem verso sont réunies, l’enrichi doit indemniser le demandeur.
La question qui alors se pose est de savoir comment déterminer le montant de l’indemnisation due à l’appauvri.
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 1303-4 du Code civil qui prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
1. Sur le principe de l’indemnisation
- Principe
- Il est de jurisprudence constante que l’indemnité ne peut excéder, ni l’enrichissement du défendeur, ni l’appauvrissement du demandeur
- Cette règle est exprimée à l’article 1303 du Code civil qui prévoit que l’appauvri perçoit « une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
- C’est donc un double plafond qui a été institué par la jurisprudence, puis par le législateur.
- Ainsi, lorsque des travaux ont été effectués par une personne sur l’immeuble d’autrui, l’indemnité est calculée
- Soit sur la base des dépenses exposées pour la réalisation des travaux
- Soit sur la base de la plus-value qui découle des travaux
- Cette règle se justifie par des considérations d’équité qui président à l’esprit de l’action de in rem verso.
- Si l’enrichi, après avoir bénéficié d’un avantage injustifié, devait restituer plus que ce qu’il a obtenu, il subirait à son tour un préjudice
- Si l’appauvri, à l’inverse, après avoir subi une perte injustifiée, percevait plus que ce qu’il a perdu, il profiterait à son tour d’un enrichissement injustifié
- Le législateur a toujours assorti cette règle d’une exception en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
- Exception
- L’article 1303-4 du Code civil prévoit que « en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »
- Ainsi, cette disposition apporte-t-elle une exception aux modalités de détermination de l’indemnité de l’appauvri en cas de mauvaise foi de l’enrichi.
- À titre de sanction, l’indemnité sera égale à la plus forte des deux valeurs entre l’enrichissement et l’appauvrissement.
2. La date d’appréciation du mouvement de valeur
Fixer un double plafond pour circonscrire le montant de l’indemnité due à l’appauvri ne suffit pas à résoudre toutes les difficultés
Il faut encore déterminer la date à laquelle il convient de se situer :
- D’une part, pour vérifier l’existence de l’enrichissement et de l’appauvrissement
- D’autre part, pour évaluer le montant des valeurs qui se sont déplacées d’un patrimoine à l’autre
À cet égard, l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. »
Ce sont donc à des dates différentes qu’il convient de se placer pour apprécier l’enrichissement et l’appauvrissement.
- S’agissant de l’appauvrissement
- Il doit être apprécié au jour de la dépense, soit à la date où le demandeur a subi une perte.
- S’agissant de l’enrichissement
- Son appréciation est somme toute différente dans la mesure où il est constaté « tel qu’il subsiste au jour de la demande»
- Cela signifie que l’enrichissement va être apprécié au jour de l’exercice de l’action de in rem verso et non à la date où le mouvement de valeur s’opère entre le patrimoine de l’enrichi et celui de l’appauvri
- Il en résulte que, l’enrichissement peut, entre-temps :
- Soit avoir augmenté,
- Soit avoir diminué
- Soit avoir disparu
- Sur ce point, le législateur a repris les solutions jurisprudentielles existantes (V. en ce sens 1ère civ. 1re, 18 janv. 1960).
3. La date d’évaluation de l’enrichissement et de l’appauvrissement
==> Problématique
La question n’est pas ici de savoir à quelle date constater le mouvement de valeur, mais de déterminer le jour auquel doit être appréciée l’évaluation de la consistance de l’appauvrissement et de l’enrichissement ?
Voilà une question qui n’est pas sans enjeu dans les périodes de dépréciation monétaire.
Faut-il évaluer l’enrichissement et l’appauvrissement aux dates où l’on apprécie leur existence respective ou convient-il plutôt de réévaluer ces sommes au jour de la décision qui fixe l’indemnité ?
==> Jurisprudence
Dans un arrêt du 18 mai 1982, la Cour de cassation avait abondé dans le sens de la première option ( 3e civ. 18 mai 1982).
Pour la haute juridiction, l’appauvrissement devait ainsi être évalué au jour où la dépense a été exposée.
Il en résultait que l’un des plafonds de l’indemnité correspondait à la somme nominale qui avait été dépensée ou à la valeur de la prestation au jour où elle avait été fournie.
Quant à l’évaluation de l’enrichissement, elle était bloquée au jour de l’exercice de l’action de in rem verso.
L’autre plafond de l’indemnité due à l’appauvri était en conséquence égale à la somme dont le patrimoine du défendeur s’était accru au jour de la demande.
Cette situation était, de toute évidence, fortement injuste pour l’appauvri, car en cas de dépréciation monétaire, il va percevoir une indemnité sans rapport avec la valeur actuelle de la perte qu’il a subie.
Aussi, de l’avis général des auteurs, l’appauvrissement et l’enrichissement devaient, impérativement, être évalués à la même date, soit au jour du calcul de l’indemnité.
| Cass. 3e civ. 18 mai 1982 | |
|---|---|
| Mais sur le premier moyen : vu l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'enrichi n'est tenu que dans la limite de son enrichissement et de l'appauvrissement du créancier ; Attendu que pour condamner les consorts e... à payer à Mme d..., aux droits de son mari, une somme de 50 000 francs au titre des améliorations utiles apportées par celui-ci en 1951, au bâtiment, l'arrêt, qui constate que l'expert x... chiffre les travaux a 750 000 anciens francs a l'époque ou ils ont été faits, énonce que selon les conclusions du rapport ces travaux de consolidation et d'amélioration utiles sont d'un montant actualise de 50 000 francs et ont apporté au fonds une plus-value de même montant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appauvrissement du possesseur évince a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'il a exposée, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; |
Dans un arrêt du 26 octobre 1982, la Cour de cassation a pu faire montre de souplesse en admettant que l’appauvrissement puisse être évalué au jour de la demande en divorce de l’épouse
Toutefois, la première chambre civile précise que, si cette date est retenue, c’est uniquement en raison de « l’impossibilité morale [de l’épouse] d’agir antérieurement» ( 1ère civ. 26 oct. 1982).
Ainsi, cette décision n’a-t-elle pas suffi à éteindre les critiques.
La solution antérieure semble, en effet, être maintenue.
Ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles que la Cour de cassation est susceptible d’admettre qu’il puisse être dérogé au principe d’évaluation de l’appauvrissement au jour de la réalisation de la dépense.
| Cass. 1ère civ. 26 oct. 1982 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Marie-Rose c., qui avait été mariée, sous le régime de la séparation de biens, a m Georges p., chirurgien, a, après leur divorce, réclame a celui-ci une indemnité, au titre de l'enrichissement sans cause, pour les services d'infirmière anesthésiste qu'elle lui avait rendus, pendant dix années, sans être rémunérée ; Attendu que m p. reproche à l'arrêt confirmatif attaque, qui a accueilli cette demande, d'avoir violé les règles gouvernant l'action de in rem verso, en vertu desquelles, selon le moyen, si l'enrichissement doit être évalué au jour de la demande d'indemnisation, l'appauvrissement doit, en revanche, l'être au jour de sa réalisation ; Mais attendu que, comme l'ont retenu les juges du fond, c'est le travail fourni sans rémunération qui a été générateur, à la fois, de l'appauvrissement, par manque à gagner, de Mme c., et de l'enrichissement de m p., qui n'avait pas eu a rétribuer les services d'une infirmière anesthésiste ; Que, pour évaluer l'appauvrissement de la demanderesse a l'indemnité de restitution et l'enrichissement du défendeur, la cour d'appel devait donc se placer, comme elle l'a fait, a la même date : celle de la demande en divorce, en raison de l'impossibilité morale pour la femme d'agir antérieurement contre son mari ; Que le moyen n'est donc pas fonde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 mai 1981 par la cour d'appel de Dijon |
==> La réforme des obligations
Afin de mettre un terme au débat jurisprudentiel portant sur la date d’évaluation du mouvement de valeur, le législateur n’a eu d’autre choix que de trancher la question.
C’est ce qu’il a fait à l’occasion de la réforme des obligations.
Manifestement, la doctrine a été entendue puisque l’article 1303-4 du Code civil prévoit que « l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement».
Cette solution, qui fait de l’indemnité de restitution une dette de valeur, prend de la sorte le contre-pied de la jurisprudence.
Par ailleurs, comme relevé dans le rapport au Président de la république relatif à l’ordonnance du 10 février 2016, elle est conforme à la solution retenue par le code civil dans les cas d’enrichissement injustifiés qu’il régit spécialement aux articles 549, 555, 566, 570, 571, 572, 574 et 576.
III) Le sort des donations entre concubins
Lorsque les concubins se séparent, il est fréquent qu’ils revendiquent la restitution des cadeaux qu’ils se sont mutuellement offerts.
Tandis que certains présents sont consentis à l’occasion d’une demande en mariage, telle la fameuse bague de fiançailles, d’autres ont une valeur plus modique. D’autres encore ont un caractère familial très marqué, en raison de leur transmission de génération en génération ou de leur appartenance à un proche.
Aussi, la question se pose du sort de ces cadeaux que les concubins se sont offert l’un à l’autre.
Lors de la rupture de leur union, sont-ils fondés à réclamer leur restitution, compte tenu, soit des circonstances dans lesquelles ils été offerts, soit de leur valeur, soit encore de leur origine ?
Pour le déterminer, il convient, tout d’abord, de se demander, s’ils ont ou non été consentis dans le cadre de fiançailles, soit en accompagnement d’une promesse de mariage.
A) Les donations consenties en dehors des fiançailles
Si, depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 3 février 1999 (Cass. 1ère civ. 3 févr. 1999), les libéralités entre concubins sont pleinement valables sans considération du but poursuivi par le donateur, les dispositions du Code civil relatives aux libéralités entre époux leur sont inapplicables.
Il en résulte que les donations faites entre concubins – lesquelles ne peuvent porter que sur des biens présents – sont irrévocables, sauf à justifier, conformément à l’article 953 du Code civil :
- Soit une cause d’ingratitude du donataire
- Soit une cause de survenance d’enfants
Dans un arrêt du 14 décembre 2004, la Cour de cassation a considéré en ce sens que « le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur », étant précisé que le possesseur du bien revendiqué est présumé avoir reçu le bien par voie de don manuel.
Il appartiendra donc au donateur de rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale.
| Cass. 1ère civ. 14 déc. 2004 | |
|---|---|
| Sur le moyen unique : Vu les articles 894 et 931 du Code civil ; Attendu que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur ; Attendu que M. X... et Mlle Y... ont vécu en concubinage ; qu'en 1997, M. X... a viré de son compte bancaire personnel sur celui que venait d'ouvrir Mlle Y..., sur lequel il avait procuration, une certaine somme ; qu'en avril 1999, à l'époque de la rupture entre les concubins, Mlle Y... a annulé la procuration en question et conservé ladite somme ; qu'en septembre suivant, M. X... l'a fait assigner en remboursement de cette somme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, après avoir relevé que, si ce dernier bénéficiait d'une procuration sur le compte de Mlle Y..., ce mandat dont il était investi n'était pas suffisant pour établir son absence de dépossession de la somme qu'il avait fait virer sur le compte de cette dernière, dans la mesure où il n'était pas contesté qu'il n'avait jamais prélevé de somme sur le compte en question pendant toute la durée de la vie commune, "démontrant par là qu'il n'avait pas l'intention de se ménager le moyen de reprendre ce qu'il avait donné", l'arrêt attaqué retient que le virement, dont s'agit, s'analysait comme un don manuel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le virement fait à un compte sur lequel le solvens avait procuration ne réalisait pas une dépossession irrévocable, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; |
B) Les donations consenties dans le cadre des fiançailles
Alors que, en 1804, le Code civil est totalement silencieux sur le statut des concubins, il comporte une disposition spéciale qui intéresse le sort des cadeaux offerts dans le cadre des fiançailles.
Pour mémoire, les fiançailles ne sont autres qu’une promesse de mariage. Aussi, était-ce là, pour le législateur, une différence fondamentale avec l’union libre insusceptible de conférer à la famille une quelconque légitimité, celle-ci ne pouvant être acquise qu’au moyen de la célébration du mariage.
Pour cette raison, les rédacteurs du Code civil ont entendu réserver un traitement de faveur aux fiancés lesquels, contrairement aux concubins, n’ont pas choisi de tourner le dos au mariage.
Ce traitement de faveur a, toutefois, été tempéré par la jurisprudence qui a assorti la règle édictée à l’article 1088 du Code civil d’un certain nombre d’exceptions.
==> Principe
Aux termes de l’article 1088 du Code civil « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas. »
Il s’évince de cette disposition que, en cas de rupture des fiançailles les cadeaux réciproques qui ont été consentis dans ce cadre doivent être restitués.
Si, en soi, la règle ne soulève pas de difficultés, il n’en va pas de même de la qualification même de donation, la jurisprudence ayant introduit une distinction à opérer avec les présents d’usage qui ne sont pas soumis au régime juridique des donations
==> Tempérament
Dans un arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952, la Cour de cassation a considère que le cadeau consenti par un mari à son épouse pouvait être qualifié, non pas de donation, mais de présent d’usage dès lors que deux conditions cumulatives étaient réunies :
- L’existence d’un usage d’offrir un cadeau dans le cadre d’une circonstance particulière
- La modicité du cadeau eu égard à la fortune et le train de vie du disposant
A contrario, cela signifie que dès lors que le cadeau offert atteint une grande valeur eu égard aux revenus du fiancé il s’agira, non plus d’un présent d’usage, mais d’une donation propter nuptias
L’article 852 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, précise que « le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti ».
La conséquence en est que, en cas de présents d’usage, il n’y a pas lieu à restitution des cadeaux que se sont mutuellement offert les fiancés.
Reste, que la jurisprudence a réservé un sort particulier à la bague de fiançailles.
==> Le sort particulier de la bague de fiançailles
La question s’est posée de savoir quelle qualification conférer à la bague de fiançailles ?
Tandis que pour certains elle s’apparente à un présent d’usage, de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture de la promesse de mariage, pour d’autres il s’agit d’une donation obéissant à la règle posée à l’article 1088 du Code civil qui prévoit la caducité.
A la vérité, pour déterminer le sort de la bague de fiançailles il convient, au préalable, de se demander s’il s’agit ou d’un bijou de famille :
- La bague de fiançailles est un bijou de famille
- Lorsque la bague de fiançailles est un bijou de famille, la jurisprudence considère qu’elle doit faire l’objet d’une restitution en cas de rupture des fiançailles.
- Peu importe qu’elle réponde aux critères du présent d’usage, la Cour de cassation estime que, dès lors qu’elle présente un caractère familial, elle doit être restituée à la famille dont elle provient ( 1ère civ., 20 juin 1961).
- Dans un arrêt du 23 mars 1983, la Cour de cassation a justifié cette solution en arguant que lorsqu’il s’agit d’un bijou de famille, celui-ci ne peut être consenti qu’au titre d’un prêt à usage dont la durée est adossée à celle de l’union du couple ( 1ère civ. 23 mars 1983).
- En cas de rupture, la bague de fiançailles a donc vocation à être restitué au donateur
- Il est indifférent que la bague ait été donné par un tiers (V. en ce sens 1ère civ. 30 oct. 2007)
- La bague de fiançailles n’est pas un bijou de famille
- Principe
- Lorsque la bague de fiançailles ne présente pas de caractère familial, dès lors qu’elle répond aux critères du présent d’usage, elle est insusceptible de faire l’objet d’une restitution.
- La Cour de cassation a estimé en ce sens dans un arrêt du 19 décembre 1979 que « justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d’appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l’espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d’usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution » ( 1ère civ. 19 déc. 1979)
- Ainsi, l’application de l’article 1088 du Code civil sera écartée.
- Exceptions
- La rupture fautive
- Par exception au principe, la jurisprudence admet que, en cas de rupture fautive imputable au donateur, la bague de fiançailles puisse être conservée par son bénéficiaire en guise de sanction (CA Paris, 3 déc. 1976).
- La mort du donateur
- A l’instar de la rupture fautive, la mort du donateur autorise également la fiancée à conserver la bague en souvenir de son défunt fiancé (CA Amiens, 2 mars 1979)
- La rupture fautive
- Principe
[1] V. en ce sens, notamment F. De Singly, Sociologie de la famille contemporaine, Armand Colin, 2010 ; J.-H. Déchaux, Sociologie de la famille, La Découverte, 2009 ; B. Bawin-Legros, Sociologie de la famille. Le lien familial sous questions, De Boeck, 1996.
[2] Il suffit d’observer la diminution, depuis la fin des années soixante, du nombre de mariages pour s’en convaincre. Selon les chiffres de l’INSEE, alors qu’en 1965 346300 mariages ont été célébrés, ils ne sont plus que 24100 à l’avoir été en 2012, étant entendu qu’en l’espace de trente ans la population a substantiellement augmentée.
[3] Le concile de Trente prévoit, par exemple, l’excommunication des concubins qui ne régulariseraient pas leur situation, mais encore, après trois avertissements, l’exil.
[4] F. Terré, op. préc., n°325, p. 299.
[5] Ph. Malaurie et H. Fulchiron, La famille, Defrénois, coll. « Droit civil », 2006, n°106, p. 53.
[6] En vertu de l’article 1088 du Code civil « toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ».
[7] L’article 515-8 du Code civil dispose que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
[8] Si, le législateur a inséré une définition du concubinage dans le Code civil c’est surtout pour mettre fin à la position de la Cour de cassation qui, de façon constante, refusait de qualifier l’union de deux personnes de même sexe de concubinage (Cass. soc., 11 juill. 1989, deux arrêts : Gaz. Pal. 1990, 1, p. 217, concl. Dorwling-Carter ; JCP G 1990, II, 21553, note Meunier ; Cass. Civ. 3e, 17 décembre 1997 : D. 1998, jurispr. p. 111, concl. J.-F. Weber et note J.-L. Aubert ; JCP G 1998, II, 10093, note A. Djigo).
[9] Cass. 1re civ., 19 mars 1991 : Defrénois 1991, p. 942, obs. J. Massip ; Cass. 1re civ., 17 oct. 2000 : Dr. famille 2000, comm. 139, note B. Beignier.
[10] En matière fiscale, pour ce qui concerne l’assiette de l’ISF, les concubins sont assimilés à des époux. Il en va de même en matière de protection sociale où le concubin est considéré comme un ayant du droit de celui qui bénéficie de l’affiliation à la sécurité sociale.
[11] V. RIPERT et BOULANGER, Traité de droit civil, t. 2, 1957, LGDJ, n° 1280
[12] .P. Didier, « Brèves notes sur le contrat-organisation », in L’avenir du droit – Mélanges en hommage à F. Terré, Dalloz-PUF-Juris-classeur, 1999, p. 636.
[13] Ph. Malaurie, note sous Civ. 1re, 6 oct. 1959 ; D. 1960. 515.