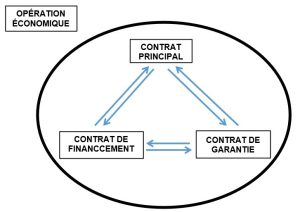Lorsqu’un contrat est anéanti, soit par voie de nullité, soit par voie de résolution, soit encore par voie de caducité, il y a lieu de liquider la situation contractuelle dans laquelle se trouvent les parties et à laquelle il a été mis fin.
Pour ce faire, a été mis en place le système des restitutions. Ces restitutions consistent, en somme, pour chaque partie à rendre à l’autre ce qu’elle a reçu.
Avant la réforme des obligations, le Code civil ne comportait aucune disposition propre aux restitutions après anéantissement du contrat. Tout au plus, il ne contenait que quelques règles éparses sur la mise en œuvre de ce mécanisme, telles que les dispositions relatives à la répétition de l’indu, dont la jurisprudence s’est inspirée pour régler le sort des restitutions en matière contractuelle.
La réforme du droit des obligations a été l’occasion pour le législateur de combler ce vide en consacrant, dans le Code civil, un chapitre propre aux restitutions.
Surtout, le but recherché était d’unifier la matière en rassemblant les règles dans un même corpus normatif et que celui-ci s’applique à toutes formes de restitutions, qu’elles soient consécutives à l’annulation, la résolution, la caducité ou encore la répétition de l’indu.
À l’examen, le régime juridique attaché aux restitutions s’articule autour de trois axes déterminés par l’objet desdites restitutions.
À cet égard, les règles applicables diffèrent selon que, la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, sur une somme d’argent ou sur une prestation de service.
En substance, il ressort des textes que :
- D’une part, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent se fait, par principe, en nature et lorsque cela est impossible, par équivalent monétaire
- D’autre part, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées
- Enfin, la restituons d’une prestation de service a lieu en valeur
Nous nous focaliserons sur la première forme de restitutions.
?Textes
La restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent est régie aux articles 1352 à 1352-3 du Code civil. L’article 1352-5 du Code civil en complète le régime.
?Domaine
Par chose, il faut entendre, tant les meubles que les immeubles, à l’exclusion des sommes d’argent.
La restitution de ces dernières fait l’objet d’un traitement spécifique à l’article 1352-6. Cette disposition a, en effet, vocation à s’appliquer lorsque l’exécution de l’obligation consiste en le paiement d’une valeur monétaire.
Quant aux contrats dont l’anéantissement conduit à la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, il peut s’agir, tout aussi bien de contrats translatifs de propriété (contrat de vente, contrat d’entreprise, donation, échange etc.), que de contrats qui ne font que mettre à la disposition du débiteur une chose sans lui en transférer la propriété (contrat de bail, contrat de dépôt, contrat de prêt, etc.).
?Régime
Lorsque la restitution porte sur une chose autre qu’une somme d’argent, le principe posé par l’article 1352 du Code civil, c’est la restitution en nature.
Par exception, soit lorsque la restitution en nature s’avère impossible, la restitution se fera en valeur, soit par équivalent monétaire.
I) Principe : la restitution en nature
A) Exposé du principe
L’article 1352 du Code civil pose donc le principe de restitution en nature des choses autres qu’une somme d’argent.
L’instauration de ce principe, d’abord reconnu par la jurisprudence, puis consacré par la loi, procède de l’objectif poursuivi par le législateur qui vise à remettre les parties dans la situation patrimoniale à laquelle elles se trouvaient au moment de la survenance de l’irrégularité entachant l’acte ou de son inexécution.
Aussi, le retour à ce statu quo ante suppose, avant toute chose, d’exiger des parties qu’elles restituent à l’autre ce qui se trouve encore entre dans leurs patrimoines respectifs.
Lorsqu’il s’agit de restituer en nature un corps certain, la partie qui le détient devra restituer à son cocontractant le même corps certain que celui qui lui a été remis lors de son entrée en possession.
Lorsque, en revanche, la restitution porte sur une chose de genre, la chose rendue devra être de même nature, être restituée dans la même quotité et présenter les mêmes qualités.
B) Mise en œuvre du principe
Si, en cas d’anéantissement d’un acte, la restitution, en nature, des choses qui se trouvaient dans les patrimoines respectifs des parties est une étape nécessaire vers un retour au statu quo ante, cette opération n’est, dans bien des cas, pas suffisante.
Entre le moment où la chose a été remise et la date de sa restitution, des événements sont, en effet, susceptibles d’avoir affecté l’état de la chose.
Elle peut, tout aussi bien avoir été détériorée ou s’être dégradée, qu’avoir fait l’objet d’améliorations ou de réparations.
Des dépenses auront, par ailleurs, pu être exposées pour assurer sa conservation. La chose peut encore avoir produit des fruits en même temps qu’il a été permis à son détenteur d’en jouir.
Aussi, afin de se rapprocher de la situation dans laquelle les parties se trouvaient au moment de la survenance de l’irrégularité ayant entaché l’acte ou de son inexécution, il est nécessaire de rétablir les équilibres qui ont pu être rompus en raison :
- Soit des dépenses exposées par détenteur de la chose pour assurer sa conservation
- Soit des circonstances qui ont affecté l’état de la chose (plus-values et moins-values)
- Soit de la jouissance que la chose a procurée et des fruits dont le détenteur a tiré profit
Pour ce faire, les articles 1352-1, 1352-3 et 1352-5 du Code civil prévoient un certain nombre de règlements accessoires à la restitution, en principal, de la chose qui visent, selon la doctrine, à tenir compte de l’écoulement du temps.
Plus précisément, ces règlements accessoires à la restitution de la chose ont été institués pour traiter :
- Les conséquences des dégradations et détériorations de la chose
- Le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose
- Le sort des dépenses exposées pour la conservation et le maintien de la chose
1. Les conséquences des dégradations et détériorations de la chose
L’article 1352-1 du Code civil dispose que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute. »
Il ressort de cette disposition que la restitution en nature de la chose suppose qu’elle soit rendue au créancier dans le même état que celui dans lequel elle se trouvait au moment de sa remise.
Aussi, dans l’hypothèse où la chose objet de la restitution est dégradée ou détériorée, pèse sur la partie qui détient la chose une obligation d’indemnisation du créancier, ainsi que le suggère l’emploi du terme « répond ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dégradation et détérioration.
Plus précisément, ces deux notions couvrent-elles seulement les altérations anormales affectant accidentellement ou intentionnellement l’état de la chose ou embrassent-elles également l’usure résultant de l’usure normale de la chose ?
Dans le silence des textes, les deux interprétations sont possibles. Reste que, par analogie avec les règles qui régissent le contrat de bail, il peut être postulé que l’usure normale de la chose restituée ne donne pas lieu à indemnisation, à l’instar du local restitué au bailleur en fin de bail.
À cet égard, dans un arrêt du 8 mars 2005 la Cour de cassation avait considéré que « l’effet rétroactif de la résolution d’une vente oblige l’acquéreur à indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’il en a faite, à l’exclusion de celle due à la vétusté » (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594).
Lorsque, en revanche, l’altération de l’état de la chose ne résulte pas de son usure normale, alors le débiteur de l’obligation de restituer doit indemniser le créancier.
Cette indemnisation est toutefois subordonnée à la réunion de deux conditions alternatives :
- Première condition : la mauvaise foi du débiteur de l’obligation de restituer
- L’article 1352-1 du Code civil prévoit que l’indemnisation ne peut avoir lieu en cas de dégradation ou de détérioration de la chose qu’à la condition que le débiteur de l’obligation de restituer soit de mauvaise foi.
- Ce dernier sera de mauvaise foi lorsqu’il connaissait la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose.
- Autrement dit, le débiteur savait qu’il ne pouvait pas valablement détenir et jouir de la chose.
- Il importe peu que la dégradation ou la détérioration de la chose soit de sa faute : dans les deux cas, dès lors que sa mauvaise foi est établie, il a l’obligation d’indemniser le créancier de la restitution.
- Seconde condition : la faute du débiteur de l’obligation de restituer
- Il s’infère de l’article 1352-1 du Code civil que, dans l’hypothèse où le débiteur serait de bonne foi, le créancier ne pourra solliciter une indemnisation que s’il démontre que les dégradations ou détériorations de la chose résultent de la faute du débiteur.
- À défaut, aucune indemnisation ne sera due, sauf à ce que le débiteur de l’obligation de restitution soit de mauvaise foi, ce qui sera suffisant pour l’obliger à réparer le préjudice résultant de l’altération de l’état de la chose.
2. Le sort des fruits et de la valeur de jouissance procurés par la chose
L’article 1352-3 du Code civil dispose que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. »
La règle ainsi posée vise tenir compte de l’utilisation de la chose par le débiteur entre le moment où il est en entrée en possession de cette chose et la date à laquelle il doit la restituer.
Pendant cette période, ce dernier a, tout d’abord, pu en jouir, soit tirer profit de sa possession. Tel est le cas de l’acquéreur d’un véhicule qui dispose de la possibilité de le conduire ou de l’acquéreur d’un immeuble qui peut l’habiter.
La possession d’une chose peut ensuite permettre à son détenteur d’en percevoir les fruits. Selon la définition donnée par Gérard Cornu, les fruits, s’entendent « des biens de toute sorte (sommes d’argent, biens en nature) que fournissent et rapportent périodiquement les biens frugifères (sans que la substance de ceux-ci soit entamée comme elle l’est par les produits au sens strict) ; espèce de revenus issus des capitaux, à la différence des revenus du travail. Ex. : récoltes, intérêts des fonds prêtés, loyers des maisons ou des terres louées, arrérages des rentes. ».
Si les avantages que procure la jouissance de la chose et, éventuellement, la perception de ses fruits sont sans incidence sur sa substance, en ce sens que cela ne lui apporte aucune moins-value, ni plus-value, sa seule restitution au créancier, en cas d’anéantissement du contrat au titre duquel elle avait été transférée, ne permet pas d’obtenir les effets recherchés par cet anéantissement, soit le retour des parties au statu quo ante.
Tandis que le débiteur de l’obligation de restituer s’est enrichi en tirant profit de la jouissance de la chose et en percevant les fruits, le créancier a, quant à lui, été privé de son utilisation.
Aussi, afin de rétablir l’équilibre qui a été rompu consécutivement à la disparition de l’acte, très tôt la question s’est posée de l’indemnisation de ce dernier.
La question est alors double. Elle tient à l’indemnisation du créancier de l’obligation de restituer résultant :
- D’une part, de la jouissance de la chose par le débiteur
- D’autre part, de la perception des fruits par le débiteur
Mettant fin à une jurisprudence fournie qui n’est pas sans avoir tergiversé, en particulier sur l’indemnisation de la jouissance de la chose, l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit que, tant la valeur de la jouissance de la chose que les fruits procurés par elle au débiteur donnent lieu à restitution.
L’article 1352-7 précise toutefois que l’étendue de cette restitution varie selon que le débiteur de l’obligation de restituer était de bonne ou de mauvaise foi au moment où il a perçu les fruits ou a commencé à jouir de la chose.
a. Le principe de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits
?) La restitution de la valeur de la jouissance de la chose
?Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence était fluctuante, s’agissant d’octroyer au créancier de l’obligation de restituer une indemnité visant à compenser la jouissance de la chose par le débiteur.
À l’analyse, deux positions s’affrontaient : celle de la première chambre civile qui refusait d’indemniser le créancier à raison de l’utilisation de la chose restituée par le débiteur et celle de la troisième chambre civile qui admettait que ce dernier puisse percevoir une indemnité.
Cette situation qui opposait les deux chambres a conduit la chambre mixte à se prononcer. Son intervention n’a toutefois pas suffi à mettre fin au débat.
- La position de la première chambre civile : le refus d’indemniser
- Dans un arrêt du 2 juin 1987, la première chambre civile a jugé que « dans le cas où un contrat nul a […] été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient auparavant, en raison de la nullité dont la vente est entachée dès l’origine ».
- Toutefois, elle a ajouté que « le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant au profit qu’a retiré l’acquéreur de l’utilisation de la machine » (Cass. 1ère civ. 1 juin 1987, n°84-16.624)
- La première chambre civile a précisé sa position dans un arrêt du 11 mars 2003, aux termes duquel elle a affirmé que « en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation du véhicule par l’acquéreur » (Cass. 1ère civ. 2003, 01-01.673)
- La première chambre civile fait ici manifestement une application stricte du principe de l’anéantissement rétroactif du contrat : si l’acquéreur doit remettre la chose, abstraction faite de l’évolution de sa valeur, au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient pas existé, le vendeur doit restituer le prix, le principe du nominalisme monétaire interdisant toute revalorisation.
- Cette position n’était toutefois pas partagée par la troisième chambre civile.
- La position de la troisième chambre civile : l’admission d’un droit à indemnisation
- Dans un arrêt du 12 janvier 1988, la troisième chambre civile a adopté une position radicalement inverse à celle retenue par la première chambre civile.
- Au visa de l’article 544 du Code civil, ensemble les articles 1644, 1645 et 1646 du même Code, elle a jugé que « lorsque la vente d’une chose est résolue par l’effet de l’action rédhibitoire, cette chose est remise au même état que si les obligations du contrat n’avaient pas existé »
- Elle en a tiré la conséquence que « l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire, sauf si celui-ci connaissait les vices de l’immeuble » (Cass. 3e civ. 12 janv. 1988, n°86-15.722).
- La troisième chambre civile a réitéré sa position dans un arrêt du 26 janvier 1994 aux termes duquel elle affirmait que « la résolution de la vente anéantit les stipulations du contrat et que l’acquéreur doit une indemnité d’occupation au vendeur de l’immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire » (Cass. 3e civ. 26 janv. 1994, n° 91-20.934).
- Elle a, à nouveau, retenu cette solution dans un arrêt du 12 mars 2003 (Cass. 3e civ. 12 mars 2003, n°01-17.207), soit le lendemain de l’arrêt rendu par la première chambre civile qui adoptait la position inverse (Cass. 1ère civ. 2003, n°01-01.673).
- L’intervention de la chambre mixte
- Dans un arrêt du 9 juillet 2004 la chambre mixte s’est finalement prononcée sur la question qui opposait la première civile à la troisième chambre civile.
- Dans cette décision elle a jugé que « le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble » (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302i).
- Ainsi la chambre mixte de la Cour de cassation a-t-elle opiné dans le sens de la position adoptée par la première chambre civile.
- Dans un arrêt du 9 novembre 2007 elle a toutefois semblé opérer un revirement de jurisprudence en retenant la solution inverse.
- Elle a, en effet, considéré dans cette décision que « c’est sans méconnaître les effets de l’annulation du contrat de bail et dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont évalué le montant de l’indemnité d’occupation due par l’EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux » (Cass. ch. mixte, 9 nov. 2007, n° 06-19.508).
- Les auteurs ont interprété cette décision comme opérant, non pas un revirement de jurisprudence, mais une distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail.
- Tandis que pour les premiers aucune indemnité ne serait due au vendeur, pour les seconds, le bailleur serait fondé à réclamer une indemnisation au preneur.
- Cette interprétation qui semblait avoir été validée par un arrêt rendu le 24 juin 2009 par la première chambre civile (Cass. 3e civ. 24 juin 2009, n° 08-12.251) a toutefois été remise en cause par une décision de la chambre commerciale du 3 décembre 2015.
- Cette dernière a, en effet, jugé que « la remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce dont il n’a pas la propriété » (Cass. com. 3 déc. 2015, n°14-22.692).
Au bilan, la jurisprudence était pour le moins incertaine quant au bien-fondé de l’octroi d’une indemnité au créancier correspondant à l’usage de la chose restituée.
Quant à la doctrine, les auteurs étaient partagés.
Planiol et Riper étaient favorable à la reconnaissance d’une indemnité de jouissance à la charge du débiteur de l’obligation de restituer. Pour eux « la liquidation comportera le paiement de la valeur de toute chose consommée, de toute jouissance, de tout service reçu, dont l’autre partie n’aurait pas eu, en exécution des conventions, la contrepartie effective ».
Dans le même sens, pour Marie Malaurie, dans certains cas, une indemnité de jouissance peut être versée. Les restitutions sont bilatérales et gouvernées par une « règle de corrélation », cette indemnité compensant l’utilisation du bien aurait pour « corollaire les intérêts légaux qui indemnisent forfaitairement la jouissance de l’argent à laquelle pourrait prétendre l’acheteur ».
Dans ces conditions une indemnité est due en l’absence de corrélation entre la jouissance du prix et celle de la chose. À ce titre, deux exemples d’indemnisation sont cités : la perception partielle ou la non-perception du prix par le vendeur et la jouissance de la chose conjuguée à la perception des fruits par l’acquéreur.
À l’inverse, pour Jean-Louis Aubert, « l’utilisation du bien faite par l’acheteur se situe indéniablement hors le champ des restitutions ».
Pour les tenants de cette thèse « seules sont restituables, en valeur, les prestations fournies en exécution du contrat annulé, c’est-à-dire mises, par le contrat, à la charge de celui qui les a exécutées ».Or, à la différence d’un bailleur tenu d’une obligation de faire, le vendeur n’a exécuté aucune obligation relative à la jouissance, il n’est donc tenu que d’une obligation de délivrance, en exécution de l’obligation de donner résultant du contrat de vente. Dès lors, l’octroi d’une indemnité d’utilisation « outrepasserait la restitution intégrale » puisque, dans un contrat de bail, l’indemnité d’occupation correspond à la restitution en valeur de la jouissance, tandis qu’en matière de vente, l’indemnité est réclamée en plus de la restitution en nature de la chose.
Si, à l’examen, la doctrine était plutôt défavorable au versement d’une indemnité de jouissance au créancier de l’obligation de restituer, le législateur a, lors de la réforme du droit des obligations, finalement tranché en faveur d’une indemnisation.
?Ordonnance du 10 février 2016
L’article 1352-3, al. 1re prévoit que la restitution de la chose donne lieu, corrélativement à la restitution de la valeur de la jouissance.
Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle renversé la position qui avait été adoptée antérieurement par la chambre mixte de la Cour de cassation en matière de contrat de vente.
Manifestement, le nouvel article 1352-3 du Code civil n’opère aucune distinction entre les contrats de vente et les contrats de bail. On peut en déduire que cette disposition a vocation à s’appliquer à tous les contrats.
Quelle que soit la nature du contrat anéanti, le créancier de l’obligation de restituer sera donc fondé à réclamer au débiteur le versement d’une indemnité de jouissance.
L’alinéa 2 de l’article 1352-3 précise que « la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. »
Quant à l’évaluation de la valeur en tant que telle de la jouissance, c’est vers le Rapport au Président de la République qu’il convient de se tourner pour comprendre ses modalités de calcul. Selon ce rapport, l’indemnité de jouissant doit être regardée « comme un équivalent économique des fruits que la chose aurait pu produire. »
En d’autres termes, si la chose objet de la restitution est un immeuble, la valeur de la jouissance doit être calculée sur la base des loyers qui auraient pu être perçus par le créancier de l’obligation de restituer.
L’application de cette méthode de calcul conduit immédiatement à s’interroger sur l’octroi d’une indemnité de jouissance en cas de restitution d’un bien non frugifère.
Le rapport au Président de la République semble s’y opposer. Toutefois, l’article 1352-3 du Code civil ne l’interdit pas, de sorte qu’il convient d’attendre que la jurisprudence se prononce avant de tirer des conséquences sur la portée de la règle.
?) La restitution des fruits produits par la chose
À l’instar de la valeur de la jouissance de la chose, le nouvel article 1352-3 du Code civil pose que les fruits qu’elle a procurés au débiteur ont vocation à être restitués au créancier en cas d’anéantissement du contrat.
Cette règle n’était toutefois pas d’application systématique ce qui a conduit le législateur lors de la réforme du droit des obligations à clarifier les choses.
?Droit antérieur
Sous l’empire du droit antérieur, pour déterminer si, en cas d’anéantissement d’un acte, il y avait lieu de restituer les fruits procurés par la chose, la jurisprudence distinguait selon que le débiteur était de bonne ou mauvaise foi.
Dans un arrêt du 5 juillet 1978, la Cour de cassation a jugé en ce sens, application de l’article 549 du Code civil, « le possesseur de bonne foi fait siens les fruits dans le cas où il possède de bonne foi » (Cass. 3e civ. 5 juill. 1978, n°77-11.157). Elle a eu l’occasion de préciser ensuite que le possesseur de bonne foi ne doit restituer les fruits au propriétaire qu’à compter de la demande qu’il en a fait (Cass. 3e civ. 28 juin 1983, n°81-14.889).
À l’inverse, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2013, considéré que « la circonstance que la restitution consécutive à l’annulation d’une cession de droits sociaux a lieu en valeur ne fait pas obstacle à la restitution au cédant des fruits produits par les parts sociales litigieuses et perçus en connaissance du vice affectant l’acte annulé par celui qui est tenu à restitution » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637). Ainsi, lorsque le débiteur est de mauvaise foi, pèse sur lui une obligation de restitution des fruits.
L’ordonnance du 10 février 2016 a mis fin à cette jurisprudence qui subordonnait la restitution des fruits à la mauvaise foi du débiteur.
?Ordonnance du 10 février 2016
En application de l’article 1352-3 du Code civil, les fruits doivent être restitués sans que cette restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution.
Il ressort du 3e alinéa de cette disposition que la restitution des fruits doit, par principe, avoir lieu en nature, ce qui n’est pas sans rappeler le principe général posé par l’article 1352 du Code civil qui impose cette modalité de restitution pour la chose elle-même.
Ce n’est que si la restitution des fruits en nature est impossible, qu’elle peut intervenir en valeur.
À cet égard, le texte précise que, en cas de restitution en valeur :
- D’une part, l’estimation doit se faire « à la date du remboursement des fruits par le débiteur », soit plus précisément à la date du jugement
- D’autre part, cette estimation doit être effectuée « suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation », ce qui signifie que le créancier ne peut réclamer la restitution que des seuls fruits que la chose était susceptible de produire dans l’état où elle se trouvait au moment de sa remise au débiteur. Le législateur a entendu ici consacrer la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 juin 1967 aux termes duquel elle avait jugé que « si le possesseur doit restituer les fruits au propriétaire, qui revendique la chose, à compter du jour de la demande, le propriétaire ne saurait prétendre qu’aux fruits qu’aurait produits la chose dans l’état où le possesseur en a pris possession » (Cass. 1ère civ., 20 juin 1967)
Il convient enfin de préciser que les règles qui gouvernent la restitution des fruits ne sont pas d’ordre public, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 1352-3 du Code civil. Les parties peuvent y déroger par convention contraire, ce qui implique qu’elles sont libres de prévoir que l’anéantissement du contrat ne donnera pas lieu à restitution des fruits.
Les contractants peuvent encore stipuler des modalités d’évaluation de la valeur des fruits différentes de celles fixées par l’article 1352-3.
b. L’étendue de la restitution de la valeur de la jouissance de la chose et de ses fruits
L’article 1352-7 du Code civil dispose que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande. »
Il ressort de cette disposition que, s’agissant de la restitution des fruits et de la valeur de la jouissance, l’étendue de cette restitution dépend de la bonne foi du débiteur.
Si, conformément à l’article 2268 du Code civil la bonne foi est toujours présumée, la mauvaise foi est, quant à elle, caractérisée lorsqu’il est établi que le débiteur de l’obligation de restituer avait connaissance et de la cause d’anéantissement du contrat et qu’il a malgré tout accepté de recevoir la chose.
Deux situations sont donc susceptibles de se présenter :
- Le débiteur est de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, soit à compter de la date à laquelle il est entré en possession de la chose.
- Le débiteur est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, le débiteur doit les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du jour de la demande, ou de la date d’introduction de l’action en justice.
3. Le sort des dépenses exposées pour la conservation et le maintien de la chose
L’article 1352-5 du Code civil dispose que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »
Il ressort de cette disposition que toutes les dépenses qui ont été exposées par le débiteur pour conserver ou pour améliorer à la chose donnent lieu à restitution.
Cette règle participe toujours de l’idée que si le débiteur ne doit pas s’être enrichi en jouissant de la chose ou en en percevant les fruits, il en va de même pour le créancier qui ne doit pas pouvoir tirer profit de la restitution de la chose lorsqu’elle a fait l’objet d’améliorations ou que des frais de conservation ont été exposés par son détenteur.
Pour cette raison, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que les frais et dépenses exposées par le débiteur de l’obligation de restituer durant l’exécution du contrat doivent être supportés par le créancier.
À l’examen, l’évaluation de la restitution est envisagée différemment selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou l’amélioration de la chose.
- S’agissant des dépenses de conservation de la chose
- L’article 1352-5 du Code civil prévoit que « les dépenses nécessaires à la conservation de la chose » doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer
- La question qui immédiatement se pose est de savoir quelles sont les dépenses de conservation visées par cette disposition.
- La lecture du texte révèle que seules les dépenses nécessaires à sa conservation donnent lieu à restituer.
- Autrement dit, ces dépenses doivent être indispensables, ce qui exclut, par hypothèse, les dépenses somptuaires au sens de l’article
- Concrètement, il s’agira ainsi des dépenses courantes, des frais d’entretien, ainsi que des frais attachés à la possession de la chose, tels que les impôts let autres taxes par exemple.
- Contrairement à ce que suggère la lettre de l’article 1352-5 du Code civil, afin de déterminer le montant de la restitution, il n’y a pas lieu de plafonner les dépenses de conservation à hauteur de « la plus-value estimée au jour de la restitution. »
- Et pour cause ce type de dépenses n’a pas vocation à apporter une plus-value à la chose, seulement à la maintenir dans son état initial.
- L’indemnisation du débiteur doit donc couvrir l’intégralité des dépenses de conservation exposées, sans limite de montant.
- Le plafonnement de l’indemnisation ne concerne, en réalité, que les dépenses d’amélioration.
- S’agissant des dépenses d’amélioration de la chose
- L’article 1352-5 du Code civil prévoit que « les dépenses qui ont augmenté la valeur de la chose » doivent être supportées par le créancier de l’obligation de restituer, ce « dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ».
- Il ressort de ce texte que l’indemnisation due au débiteur doit être calculée, non pas sur la plus-value intrinsèque apportée à la chose, mais sur la base des dépenses exposées.
- Ainsi, dans l’hypothèse où la plus-value serait de 200 et que les dépenses exposées par le débiteur représenteraient un coût de 100, la restitution ne pourrait pas être supérieure à 100.
- Seules les améliorations résultant de dépenses ne peuvent donc donner lieu à restitution.
- L’article 1352-5 précise que le montant de l’indemnisation est, en toute hypothèse, plafonné à hauteur de « la plus-value estimée au jour de la restitution ».
- Aussi, de deux choses l’une :
- Soit le montant le montant des dépenses exposées est inférieur à la plus-value apportée à la chose auquel cas le débiteur pourra être intégralement indemnisé
- Soit le montant des dépenses exposées est supérieur à la plus-value apportée à la chose auquel cas l’indemnisation du débiteur sera plafonnée à hauteur de cette plus-value.
- À cet égard, tandis que le montant des dépenses s’apprécie au jour où elles ont été exposées, le montant de la plus-value est, quant à lui, apprécié à la date de la restitution, soit du jugement.
II) Exception : la restitution en valeur
L’article 1352 du Code civil prévoit que, par exception au principe de restitution en nature de la chose, lorsque cette restitution est impossible, elle a lieu en valeur.
Ce texte envisage ainsi l’hypothèse du débiteur qui n’est plus en possession de la chose au jour où naît l’obligation de la restituer.
Seule alternative pour surmonter l’obstacle : obliger le débiteur à restituer la chose par équivalent, soit en valeur.
Bien que simple en apparence, cette solution n’est toutefois pas sans soulever plusieurs difficultés.
Ces difficultés tiennent :
- D’une part, à la délimitation du domaine de l’impossibilité
- D’autre part, aux modalités d’estimation de la valeur restituée
A) Le domaine de l’impossibilité
?L’étendue du domaine de l’impossibilité
La première question qui se pose est de savoir à partir de quand peut-on considérer que la restitution de la chose est impossible.
Lorsque la chose a disparu ou a péri, l’impossibilité de la restituer s’impose d’elle-même. Il en va de même pour les choses consomptibles.
Plus délicate est, en revanche, la question pour les choses dont le débiteur est toujours en possession mais pour lesquelles la restitution représenterait pour lui un coût si élevé qu’il serait déconnecté de l’économie initiale du contrat.
Dans un arrêt du 18 février 1992, la Cour de cassation a répondu à cette question en censurant une Cour d’appel pour avoir mis à la charge d’un débiteur une obligation de restituer en nature consécutivement à l’anéantissement d’un contrat considérant, au cas particulier, que « l’obligation de restitution en nature du matériel impose des travaux coûteux au revendeur de carburant, non justifiés par des nécessités techniques en raison de la durée de vie des cuves, et qu’elle est susceptible de le dissuader de traiter avec un autre fournisseur ; qu’elle est ainsi disproportionnée avec la fonction qui lui a été fixée de faire respecter l’exclusivité d’achat du carburant et constitue un frein à la concurrence d’autres fournisseurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com. 18 févr. 1992, n°87-12.844).
Ainsi, pour la Cour de cassation, lorsque la restitution en nature serait disproportionnée eu égard le résultat recherché par l’anéantissement de l’acte, soit un retour au statu quo, elle ne peut avoir lieu qu’en valeur.
Cette solution a été réaffirmée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel elle a cassé la décision d’une Cour d’appel à laquelle elle reprochait de n’avoir pas recherché « si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’opposait la société Trecobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectaient » (Cass. 3e civ. 15 oct. 2015, n°14-23.612).
Dans le silence de l’article 1352 du Code civil sur la notion d’impossibilité, peut-on considérer que cette jurisprudence a été reconduite par le législateur ?
D’aucuns postulent que la réponse à cette question résiderait dans la comparaison de l’article 1352 avec l’article 1221.
En effet, cette dernière disposition exige expressément la réalisation d’un contrôle de proportionnalité pour déterminer s’il y a lieu d’exclure l’exécution forcée en nature d’une obligation en cas d’inexécution du contrat.
Tel n’est pas le cas de l’article 1352 qui est silencieux sur ce point s’agissant de l’exclusion de la restitution de la chose en nature.
Pour l’heure la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée, de sorte qu’il est difficile de tirer des conclusions sur le maintien de la jurisprudence antérieure.
?Cas particulier de la revente de la chose
L’article 1352-2 du Code civil envisage le cas particulier de la revente de la chose qui devait être restituée au vendeur en suite de l’anéantissement du contrat.
Cette disposition prévoit, plus précisément, que lorsque l’acquéreur revend la chose qui lui a été délivrée, la restitution s’opère en valeur.
Selon le texte, il y a néanmoins lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi.
Si, de prime abord, l’on est tenté d’apprécier la bonne foi de l’acquéreur au moment de la délivrance de la chose, certains auteurs plaident pour que cette appréciation se fasse au stade de la revente.
Il peut, en effet, parfaitement être envisagé que l’acquéreur ignorât la cause d’anéantissement du contrat au moment de la délivrance de la chose, mais que, en revanche, il l’ait revendue en toute connaissance de cause.
L’objectif recherché par l’article 1352-2, al.2 étant de sanctionner l’acquéreur qui, sciemment, a cherché à tirer profit de la revente de la chose au préjudice du vendeur, il ne serait pas aberrant d’apprécier sa bonne foi au jour de la revente de la chose.
Dans le silence de l’article 1352-2, c’est à la jurisprudence qu’il reviendra de se prononcer sur cette question.
Reste que, en toute hypothèse, il y a lieu de distinguer selon que l’acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi.
- L’acquéreur est de bonne foi
- Dans cette hypothèse, l’article 1352-2 prévoit qu’il ne doit restituer que le prix de la vente de la chose
- Le prix à restituer est celui, non pas de l’acquisition initiale de la chose, mais celui de la revente.
- L’acquéreur ne peut ainsi tirer profit de la revente, ni s’appauvrir, l’objectif recherché étant une opération à somme nulle.
- L’acquéreur est de mauvaise foi
- Dans cette hypothèse, l’article 1352 dispose qu’il « en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix. »
- Autrement dit, pour déterminer le montant de la somme à restituer, il convient de se placer non pas au moment de la revente de la chose, mais à la date de sa restitution qui, concrètement, correspond à celle du jugement.
- À cet égard, le texte oblige l’acquéreur de mauvaise foi à restituer la plus forte des deux sommes entre le prix de revente de la chose et sa valeur au moment de la restitution
- Aussi, de deux choses l’une :
- Soit la valeur de la chose au moment de la restitution est inférieure au prix de revente auquel cas l’acquéreur ne devra restituer au vendeur que ce seul prix de revente
- Soit la valeur de la chose au moment de la restitution est supérieure au prix de revente auquel cas l’acquéreur devra restituer au vendeur non seulement ce seul prix de revente, mais encore la plus-value réalisée au jour du jugement
- Le sort réservé ici à l’acquéreur de mauvaise foi est manifestement pour le moins défavorable dans la mesure où il sera privé des profits réalisés en suite de la revente de la chose.
B) Les modalités d’estimation de la valeur restituée
Une fois admis que la restitution de la chose en nature est impossible, reste à estimer sa valeur afin que puisse être restituée au créancier une somme d’argent.
Deux questions alors se posent :
- D’une part, à quelle date la valeur de la chose doit-elle être estimée ?
- D’autre part, quel critère d’estimation retenir pour déterminer la valeur de la chose ?
?Sur la date d’estimation de la valeur de la chose
Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du droit des obligations, la jurisprudence avait posé, en l’absence de texte, que pour estimer la valeur de la chose restituée il y avait lieu de se situer à la date de remise de la chose.
Dans un arrêt du 14 juin 2005, la chambre commerciale a jugé en ce sens, s’agissant d’une annulation de cession de titres sociaux, que « l’annulation de la cession litigieuse confère au vendeur, dans la mesure où la remise des actions en nature n’est plus possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur au jour de l’acte annulé » (Cass. com. 15 juin 2005, n°03-12.339).
Cette solution a été reconduite dans une décision rendue le 14 mai 2013 aux termes de laquelle la Cour de cassation a considéré que « l’annulation d’une cession de parts sociales confère au vendeur, dans la mesure où leur restitution en nature n’est pas possible, le droit d’en obtenir la remise en valeur laquelle doit être appréciée au jour de l’acte annulé » (Cass. com. 14 mai 2013, n°12-17.637).
Prenant le contre-pied de cette jurisprudence, l’ordonnance du 10 février 2016 a retenu la solution inverse en prévoyant que lorsque la restitution de la chose a lieu en valeur, cette valeur est « estimée au jour de la restitution. »
Ce n’est donc plus à la date de la remise de la chose au débiteur que sa valeur doit être estimée, mais au jour du jugement qui ordonne sa restitution.
L’objectif recherché par le législateur était de calquer la restitution en valeur sur la restitution en nature.
Autrement dit, il a voulu que les plus-values et moins-values réalisées par le débiteur soient prises en compte dans l’évaluation du montant de la restitution. Il ne faudrait pas qu’une partie s’enrichisse au préjudice de l’autre, à raison de la survenance de circonstances postérieures à la conclusion du contrat anéanti.
Il peut être observé que, contrairement à la restitution de la valeur de la jouissance ou des fruits procurés par la chose, il est indifférent, ici, que le débiteur soit de bonne ou mauvaise foi : dans les deux cas, l’estimation de la valeur à restituer doit être effectuée au jour de la restitution de la chose.
?Sur le critère d’estimation de la valeur de la chose
Autre question qui se pose lorsque la restitution de la chose a lieu en valeur : quid du critère de son évaluation ? En d’autres termes, doit-on retenir le prix stipulé par les parties dans le contrat ou doit-on se référer au prix du marché ?
L’article 1352 est silencieux sur ce point. Reste que dans un arrêt du 8 mars 2005, la Cour de cassation avait considéré, au visa de l’ancien article 1184 du Code civil, que « la créance de restitution en valeur d’un bien, est égale, non pas au prix convenu, mais à la valeur effective, au jour de la vente, de la chose remise » (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11.594).
Ainsi, est-ce une approche objective qui avait été retenue par la première chambre civile, la position adoptée consistant à dire, en substance, que l’estimation de la chose doit être effectuée sur la base de sa valeur effective au moment de sa restitution et non en considération du prix initialement fixé par les parties.
Manifestement, cette solution se concilie parfaitement bien avec l’exigence d’estimation de la valeur de la chose au jour de sa restitution, de sorte qu’il est fort probable que la solution dégagée par la Cour de cassation en 2005 soit maintenue.