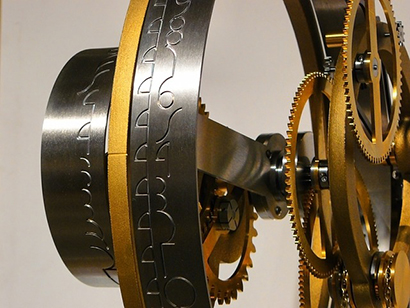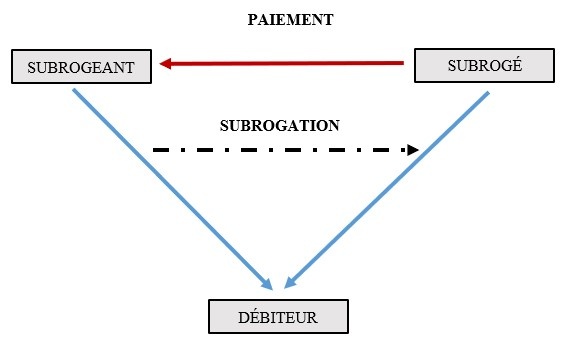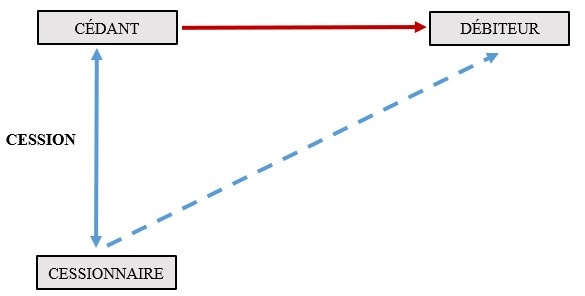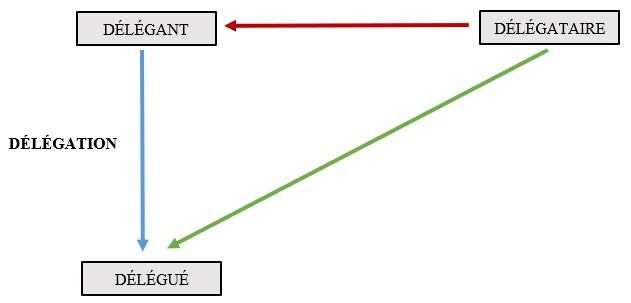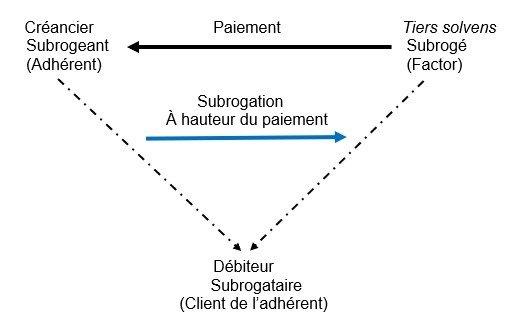I) La forme du jugement
==> Un écrit
Bien qu’aucun texte ne prévoit expressément que les jugements soient établis par écrit, cette exigence se déduit des articles 450 à 466 du CPC qui prescrivent un certain nombre de mentions qui doivent être reproduites.
Un jugement ne peut donc pas prendre une forme orale. L’original qui constate par écrit la décision des juges est qualifié de minute. Cette minute alors est conservée par le greffier, ce qui permet d’assurer la publicité du jugement et son exécution.
À cet égard, l’article R. 123-5 du COJ prévoit que le greffier « Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. »
==> Un écrit papier ou électronique
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012, il est indifférent que le jugement soit établi sous forme papier ou électronique.
L’article 456 du CPC prévoit en ce sens que « le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. »
Cette disposition précise néanmoins que « lorsque le jugement est établi sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. »
==> Le registre d’audience
L’établissement du jugement donne lieu à l’actualisation du registre d’audience dont la tenue est assurée par le greffier.
À cet égard, l’article 728 du CPC prévoit que le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier, ce qui lui confère la force probante d’un acte authentique au même titre que le jugement.
La fonction du registre d’audience est éminemment importante dans la mesure où, en application de l’article 459 du CPC, sa consultation permet de régulariser les omissions ou inexactitudes de mentions que comporte le jugement.
II) Le contenu du jugement
Les jugements rendus par le Tribunal de grande instance doivent comporter un certain nombre de mentions nécessaires. En outre, ils doivent être motivés.
La décision proprement dite en constitue le dispositif. Enfin, l’expédition du jugement doit être revêtue de la formule exécutoire.
A) Les mentions obligatoires
Le code de procédure civile prescrit que le jugement doit comporter des indications relatives à sa régularité formelle ainsi que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Enfin le jugement doit être signé.
==> Mentions relatives à la régularité formelle du jugement
L’article 454 du CPC prévoit que le jugement doit contenir l’indication :
- Rendu au nom du peuple français
- De la juridiction dont il émane ;
- Du nom des juges qui en ont délibéré, ou du juge s’il y a eu juge unique ;
- De sa date, qui est celle de son prononcé ;
- Du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
- Du nom du secrétaire ;
- De l’identité ainsi que du domicile ou du siège social des parties et, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
==> Énonciations relatives aux prétentions respectives des parties
L’article 455 du CPC prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Cet exposé succinct exigé par l’article 455 du CPC, outre qu’il peut être utile pour le rédacteur de la décision dans la mesure où il lui rappelle les points sur lesquels il doit se prononcer, est nécessaire, d’une part pour permettre aux parties de vérifier que le Tribunal a bien statué sur l’objet de la demande après avoir examiné les moyens qui la fondent, d’autre part pour permettre à la Cour d’appel, le cas échéant, de s’assurer que le Tribunal de première instance :
- D’une part, n’a pas modifié l’objet du litige ou n’est pas sortie de ses limites, ce qui entraînerait une réformation du jugement au visa de l’article 4 du CPC.
- Modifier l’objet du litige, c’est altérer les prétentions des parties, par exemple en déformant leurs demandes, en retenant pour principal ce qui n’était que subsidiaire.
- Toutefois les juges ne modifient pas l’objet du litige lorsque, après avertissement préalable donné aux parties pour respecter le principe de la contradiction, ils se bornent à donner leur exacte qualification aux faits et aux actes, ou bien lorsqu’ils ne font que changer le fondement juridique invoqué par les parties, ou encore lorsque les conclusions présentées étaient confuses, ambiguës ou inintelligibles, de telle sorte que le Tribunal s’est trouvé dans la nécessité de les interpréter ( com., 17 décembre 1996, n° 94-17.901).
- Les prétentions sont fixées dans les conclusions en demande ou en défense, peu important que les prétentions soient exprimées dans les motifs et non dans le dispositif des écritures ( com., 11 décembre 1990 ; Cass. 3e Civ., 26 mai 1992).
- D’autre part, a répondu aux moyens présentés par les parties, car, à défaut, le jugement encourt la censure, au visa de l’article 455 du CPC, pour absence de réponse à conclusions, qui constitue un défaut de motifs.
- Il convient donc que le jugement apporte une réponse aux moyens
- À cet égard, dans les procédures soumises à la représentation obligatoire, les moyens à prendre en considération sont seulement ceux qui sont exprimés dans les « dernières conclusions déposées».
- Il n’y a donc pas lieu de tenir compte, pour leur apporter une réponse, des moyens présentés dans les conclusions antérieures et non repris dans les dernières, étant observé que les parties ne peuvent pas procéder par voie de renvoi ou de référence à leurs précédentes écritures ( 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-19.898 ; Cass. 2e Civ., 28 juin 2001, n° 00-10.124).
- La Cour de cassation, si elle exige qu’il soit répondu aux moyens, n’oblige pas les juges du fond à suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
- Telle est également la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que « l’article 6.1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leur décision, mais il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à “chaque argument» (CEDH, 19 avril 1994, X…c/ Pays-Bas, requête n° 16034/90).
- Le moyen peut être décrit comme un raisonnement qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention (en demande ou en défense).
- S’il n’est évidemment pas demandé aux juges de s’expliquer sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits, ils doivent prendre en considération ceux de ces éléments qui, dans la mesure où ils sont constants et constatés, et ayant un caractère déterminant sur la solution du litige, sont de nature à fonder la déduction juridique envisagée.
- La frontière entre le moyen et l’argument est cependant imprécise.
- Si un doute existe sur le point de savoir si une allégation n’est qu’un simple argument, il convient de se prononcer sur elle.
- Une attention particulière doit être apportée au rapport à justice.
- Si une partie s’en rapporte à justice, elle élève une contestation.
- La Cour considère en ce sens que « le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci» ( 2e Civ., 10 nov. 1999, n° 98-13.957 ; Cass. 1ère civ., 24 oct. 2000, n° 98-19.606).
- Par suite, d’une part le Tribunal ne peut pas accueillir la prétention au motif qu’elle n’est pas contestée ; d’autre part la partie reste recevable à relever appel, bien qu’elle s’en fût rapportée à justice en première instance : elle élève à nouveau la contestation.
- Mais, à l’appui d’un pourvoi en cassation, la partie ne sera pas recevable à contester la solution retenue, car s’étant rapportée, le moyen de cassation serait nouveau et irrecevable ( 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-23347).
L’exposé succinct des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date sans qu’il soit nécessaire d’annexer à la décision une copie de ces écritures.
==> Omission ou inexactitude d’une mention
Le code de procédure civile précise les cas dans lesquels il y a lieu à nullité du fait de l’omission ou de l’inexactitude d’une des mentions.
Ainsi doivent être observées à peine de nullité les prescriptions concernant :
- La mention du nom des juges ;
- L’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
- La signature par le président et par le secrétaire ainsi que, le cas échéant, la mention de l’empêchement ( 458 CPC).
Toutefois, l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience, ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées (art. 459 CPC).
B) La motivation du jugement
==> Enjeux
Les enjeux de la motivation d’une décision sont cruciaux. Moralement la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte.
Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information.
Comme l’observe Michel Grimaldi, « ce peut être une simple information : la motivation vise à renseigner, mais n’appelle pas la discussion. […]. Ce peut être aussi une motivation en vue d’un contrôle. Souvent, le plus souvent même, l’obligation de motiver se prolonge par la soumission à un contrôle. Et l’on rejoint ici la première observation : le droit à la motivation, s’il existe, ce n’est pas seulement le droit de savoir, c’est aussi l’amorce du droit de contester ».
==> Finalité
En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité.
- En premier lieu, elle oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation du droit et des faits.
- En deuxième lieu, elle constitue pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés. En cela, elle est aussi un rempart contre l’arbitraire du juge ou sa partialité.
- En dernier lieu, elle permet à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et d’expliquer sa jurisprudence. En motivant sa décision, le juge s’explique, justifie sa décision, étymologiquement la met en mouvement en direction des parties et des juridictions supérieures pour la soumettre à leur critique et à leur contrôle. Il ne s’agit donc pas d’une exigence purement formelle mais d’une règle essentielle qui permet de vérifier que le juge a fait une correcte application de la loi dans le respect des principes directeurs du procès.
==> Textes
En droit positif, l’exigence de motivation résulte de l’article 455 du CPC qui énonce, on ne peut plus simplement, que « le jugement doit être motivé ».
Bien qu’issue d’un texte de nature réglementaire , l’obligation de motivation a sans aucun doute une valeur supérieure puisque, aussi bien, le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’homme, en ont consacré le principe.
Ainsi le Conseil a-t-il reconnu à l’exigence de motivation des jugements la valeur d’un principe fondamental en considérant notamment, en matière d’expropriation, que cette exigence relevait du domaine de la loi (Cons. const., décision du 3 novembre 1977, no 77-101 L.)
La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est plus fournie, puisque, alors que l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne fait pas expressément référence à la nécessité de motiver le jugement, la Cour a posé pour principe que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions et que la motivation ne peut être totalement absente (CEDH, Higgins et autres c. France, 19 février 1998, requête no 20124/92), même si ce texte n’exige pas une réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, requête no 16034/90) et si l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce.
On signalera aussi que, pour la première chambre civile de la Cour de cassation, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante (Cass. 1ère civ., 28 novembre 2006, n°04-19.031 ; Cass. 1ère civ., 22 octobre 2008, n° 06-15.577).
==> Domaine
- Principe
- Le domaine de la motivation est général. L’obligation s’applique indistinctement et, sauf exceptions, à toutes les décisions de justice.
- Doivent ainsi être motivés les jugements contentieux comme les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit et les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort comme ceux rendus en dernier ressort.
- Aucune distinction n’est opérée selon que le jugement est contradictoire ou réputé contradictoire ou qu’il a été prononcé par défaut. La comparution des parties est sans incidence sur l’exigence de motivation et la Cour de cassation censure régulièrement, au visa de l’article 472 du CPC, les jugements qui déduisent de l’absence du défendeur un acquiescement aux prétentions du demandeur, la solution valant aussi bien en première instance ( 2e civ., 8 juillet 2010, n°09-16.074), qu’en cause d’appel (Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n°01-12.289).
- On entend par motifs d’un jugement ce qui détermine chacune des dispositions dont il se compose ou encore les raisons données par le juge à l’appui de sa décision.
- Les motifs doivent être particuliers à chaque affaire et suffisamment précis et développés pour permettre leur contrôle, dans le cadre d’un éventuel recours.
- Exceptions
- Les exceptions prévues par les textes
- Les exceptions légales à l’obligation de motivation sont peu nombreuses.
- On cite souvent le jugement d’adoption ( 353 C. civ.) ou certaines décisions rendues en matière de divorce, comme le jugement sans énonciation des torts et griefs à la demande des parties (art. 245-1 C. civ. et art. 1128 CPC).
- On signalera aussi les dispositions de l’article 955 du CPC, selon lesquelles lorsqu’elle confirme un jugement, la cour d’appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
- Ce texte, qui renferme une présomption de motivation, permet à la Cour de cassation de s’emparer des motifs des premiers juges pour suppléer une motivation insuffisante ou défaillante d’un arrêt faisant l’objet d’un pourvoi ( 2e civ., 1er juill. 2010, n°09-66.712 et 09-68.869).
- Il ne doit néanmoins pas être compris comme instituant une dispense de motivation, c’est-à-dire de réexamen de l’affaire, qui est le propre de l’appel.
- Les exceptions prévues par la jurisprudence
- Plus fréquentes sont les hypothèses où c’est la jurisprudence qui exonère les juges de l’obligation de motivation.
- La Cour de cassation juge ainsi, en matière d’ordonnance portant injonction de payer, que l’article 1409 du code de procédure civile n’impose pas au juge l’obligation de motiver sa décision ( 2e civ., 16 mai 1990, n°88-20.377).
- Reste que le jugement statuant sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit, quant à lui, être motivé ( 2e civ., 22 juin 1988, n°87-13.970).
- Il existe par ailleurs un nombre significatif d’objets de demandes pour lesquelles le juge n’est pas tenu de s’expliquer.
- Ce qu’il est convenu de nommer la matière discrétionnaire, selon un qualificatif que certains jugeront aujourd’hui peu approprié, concerne des décisions aussi variées que celles ordonnant des mesures d’administration judiciaire ( 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-14.066) ou relatives à l’opportunité de prononcer un sursis pour une bonne administration de la justice (Cass. 2e Civ., 17 juin 2010, n°09-13.583), d’accorder ou refuser des délais de paiement (Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n°09-11.491) ou d’expulsion (Cass. 2e civ., 15 octobre 2009, n°08-14.380), de réduire une clause pénale (Cass. .3e civ., 8 juin 2010, n°09-65.502), d’assortir un jugement d’une astreinte (Cass. 2e civ., 23 novembre 2006, n°05-16.283), d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 10 octobre 2002, n°00-13.832) ou de mettre les dépens à la charge de la partie perdante (Cass. 1ère civ., 12 mai 1987, n°85-11.387)
==> Contenu de l’exigence de motivation
Motiver, c’est, pour le juge, fonder sa décision en fait et en droit. Cette obligation de motivation comporte deux aspects : quantitatif et qualitatif :
- Sur le plan quantitatif
- Il appartient au juge d’analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits.
- Il ne peut statuer par des considérations générales ( 1ère civ., 17 févr. 2004, Bull. 2004, I, no 50, n°02-10.755), ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas (Cass. soc., 1er févr. 1996, n°94-15.354), même si le juge n’est pas tenu de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’il décide d’écarter (Cass. 1ère civ., 3 juin 1998, n°96-15.833 ; Cass. com., 9 févr. 2010, n°08-18.067).
- La motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions.
- Le défaut de réponse à conclusions, qu’il importe de ne pas confondre avec l’omission de statuer, est sanctionné au titre d’une méconnaissance des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
- Enfin, on sait que la motivation doit être intrinsèque et que la jurisprudence proscrit toute motivation par référence aux motifs d’une décision rendue dans une autre instance ( 3e civ., 26 oct. 1983, n°81-14.861; Cass. 2e civ., 2 avril 1997, n 95-17.937), sauf naturellement lorsque cette motivation procède d’une adoption des motifs des premiers juges.
- La Cour de cassation ne fait ici que mettre en œuvre le principe de la prohibition des arrêts de règlement.
- Sur le plan qualitatif
- La motivation implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer.
- Il importe donc que ses motifs soient rigoureux et pertinents.
- La rigueur commande d’abord au juge de se prononcer par des motifs intelligibles, de se garder de formuler des hypothèses, d’émettre des doutes ou d’éviter de se contredire.
- Les arrêts de cassation ne sont pas rares qui censurent l’énoncé de motifs contradictoires, dubitatifs, hypothétiques, voire incompréhensibles.
- La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties.
- Cette exigence s’impose chaque fois que la Cour de cassation exerce un contrôle de la qualification des faits mais aussi, de façon plus inattendue, lorsque l’appréciation des éléments du litige est abandonnée aux juges du fond.
- En effet, même dans les matières où la jurisprudence consacre l’existence d’un pouvoir souverain, la Cour de cassation s’assure que les motifs des juges sont de nature à justifier la décision prise, qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue.
==> Sanction de l’exigence de motivation
Selon l’alinéa 1er de l’article 458 du CPC, ce qui est prescrit à l’article 455, en particulier l’obligation de motiver le jugement, doit être observé à peine de nullité.
Né de la décision attaquée, le vice de motivation n’est jamais un grief nouveau devant la Cour de cassation.
Le défaut de motif ou l’insuffisance des motifs se différencient du défaut de base légale, qui sanctionne un vice de fond, à savoir une motivation qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer son contrôle sur les conditions de fond d’application de la loi 36. Le vice de motivation est pour sa part un vice de forme du jugement.
C’est pourquoi le contrôle de la Cour de cassation présente en ce domaine un caractère essentiellement disciplinaire.
C) Le dispositif du jugement
- Limitation du champ de l’autorité de la chose jugée au dispositif formel
Le dispositif est la partie du jugement qui énonce la décision du tribunal (art. 455 CPC). Elle est la partie la plus importante de la décision, en ce qu’elle contient la solution du litige à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée.
L’article 455, al. 3e du CPC prévoit en ce sens que le jugement « énonce la décision sous forme de dispositif. »
Le dispositif des jugements varie avec chaque litige ; il doit répondre à tous les chefs de demande, mais il ne doit pas aller au-delà de ce qui a été demandé (ultra petita).
En outre, il ne peut apporter de modification, ni à l’objet, ni à la cause de la demande : le juge est en effet lié par le cadre du procès tracé par les parties.
L’autorité de la chose jugée, même positive, est limitée aux seules énonciations du dispositif (Cass. 3e civ., 4 janv. 1991 ; Cass. 1ère civ. 8 juill. 1994, Cass. com. 6 févr. 2001).
C’est donc à cette composante du jugement qu’il convient de se reporter pour déterminer l’étendue de l’autorité de la chose jugée.
Reste que des maladresses dans la rédaction de la décision peuvent conduire le juge à placer dans les motifs des dispositions relatives à la solution du litige, et la question se pose alors de savoir si ces motifs peuvent avoir autorité de la chose jugée.
2. Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée des motifs décisoires et décisifs
Classiquement on distingue les motifs décisoires des motifs décisifs :
- Les motifs décisoires
- Il s’agit des motifs qui statuent sur l’un des chefs des prétentions litigieuses, mais, par suite d’une erreur rédactionnelle, la décision n’est pas reprise dans le dispositif.
- Ce sont des éléments du dispositif qui se sont égarés dans les motifs.
- Ils résultent d’une rédaction défectueuse du jugement dont un élément n’est pas à sa place.
- Les motifs décisifs
- Ils sont le soutien nécessaire du dispositif, ou de certains des chefs de décision que l’on retrouve dans ce dernier.
- Un motif est dit décisif, lorsqu’il est un élément nécessaire du raisonnement qui a abouti à la décision.
En principe seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée.
La conséquence de ce principe est favorable au plaideur victime de l’oubli. Le jugement qui contient une omission de statuer sur un chef de demande n’ayant logiquement aucune autorité de la chose jugée sur le chef omis, l’intéressé peut saisir une nouvelle fois le juge sur ce chef.
La lecture de la jurisprudence qui s’est développée au sujet des jugements mixtes ou avant dire droit notamment, révèle que seul le dispositif stricto sensu de la décision concernée est pris en considération pour déterminer si l’autorité de la chose jugée s’y attache (Cass. 3e civ., 1er oct. 2008, n°07-17.051).
Désormais, motifs décisoires et motifs décisifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée, laquelle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui est tranché dans le dispositif.
Pour bien comprendre la position actuelle remémorons-nous l’évolution de la jurisprudence.
Trois périodes peuvent être distinguées : avant le nouveau code de procédure civile de 1975, entre le nouveau code de procédure civile et 1991, et depuis 1991.
==> Avant le nouveau code de procédure civile de 1975 : la conception non formaliste
Pendant très longtemps, et en l’absence de dispositions contraires, le parti a été implicitement retenu de considérer que le jugement était un acte de volonté du juge et qu’indépendamment de la forme, il fallait rechercher, en scrutant l’ensemble des éléments de sa décision, ce qu’il avait voulu décider et ce sur quoi il s’était fondé.
Peu importait donc que les chefs de décision aient été insérés dans les motifs ou dans le dispositif.
Ainsi, la jurisprudence a longtemps reconnu l’autorité de chose jugée des motifs décisoires pour la raison qu’il convenait de s’en tenir à ce que le juge avait effectivement jugé, sans s’arrêter à l’apparence formelle du jugement (V. en ce sens Cass. com., 29 octobre 1964).
Au demeurant, les constats de fait qui avaient été réalisés dans un procès, de même que les qualifications qui avaient été données à ces faits, pouvaient être repris, dans un autre procès opposant les mêmes parties et considérés comme couverts par l’autorité de la chose jugée, dès lors du moins que ces éléments, puisés dans les motifs de la précédente décision, constituaient le soutien nécessaire de celle-ci.
Les décisions anciennes qui reconnaissaient aux motifs décisifs l’autorité de chose jugée sont innombrables (Cass. 2e civ., 17 nov. 1971 ; Cass. 3e civ., 28 oct. 1974).
Ainsi, le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, parce que c’est lui qui contient les décisions du juge ; mais l’autorité s’étend à la motivation dans la mesure où celle-ci contient les éléments nécessaires à ces décisions ; les motifs ont également autorité de chose jugée si, en raison éventuellement d’un vice de rédaction du jugement, des décisions du juge y figurent.
En outre, la jurisprudence étendait l’autorité de chose jugée à des points non expressément jugés, en considérant qu’ils avaient été implicitement ou virtuellement jugés (Cass. soc., 24 mars 1971).
Le critère substantiel, qui s’attache à la volonté du juge, avait pour mérite de « tenir exactement compte de la réalité » et de ne pas faire dépendre l’autorité de la décision de sa forme.
Les maladresses rédactionnelles du juge étaient ainsi sans incidence. L’inconvénient était cependant, selon Jacques Normand, qu’« on ne pouvait toujours savoir au premier examen ce qui avait été effectivement décidé, déterminer sans hésitation la nature (avant dire droit ou mixte) de la décision rendue. Il fallait se livrer à une recherche délicate, aléatoire. Cette imprécision était source de contestations, de retards, elle était génératrice de manoeuvres dilatoires ».
==> Entre le nouveau code de procédure civile et 1991
Le nouveau code de procédure civile a substitué à ces solutions une conception beaucoup plus formaliste : les décisions prises par le juge n’ont l’autorité de chose jugée que si elles figurent dans le dispositif (V. art. 455, 480, 482, 544 et 606 CPC).
Ainsi, seul le dispositif du jugement devait renseigner sur ce qui avait été jugé. Seules ses énonciations avaient autorité de la chose jugée (art. 480 CPC). Seules elles permettaient de savoir si la décision contenant un avant dire droit était susceptible d’appel ou de pourvoi immédiat (art. 544 et 606 CPC).
Ce nouveau système « imposait au juge une très grande discipline dans la formulation de sa décision ».
C’est la raison pour laquelle comme le relevait Jean-Pierre Dintilhac, « Malgré la clarté de cette rédaction, la jurisprudence, confrontée à l’épreuve des situations concrètes souvent difficiles à enfermer dans une formulation juridique forcément abstraite et réductrice, a opéré une distinction entre les motifs décisoires et les motifs décisifs ».
En effet, la jurisprudence a eu quelque mal à se soumettre à ce formalisme. Longtemps, les textes du nouveau code de procédure civile n’ont guère été respectés en la matière. S’ensuivit alors « une longue période d’incertitude, marquée par les jurisprudences divergentes des différentes chambres de la Cour de cassation (…) un premier courant dont participaient la deuxième chambre civile et la chambre commerciale, appliquait strictement l’article 480 et déniait toute autorité aux motifs soutien nécessaire »[1]. Un courant contraire réunissait la première et la troisième chambre civile lesquelles continuaient à reconnaître l’autorité des motifs décisifs (Cass. 3e civ., 27 avr. 1982).
La jurisprudence semble s’être ralliée pour ce qui concerne les motifs décisoires, avec moins de résistance que pour les motifs décisifs, à la solution imposée par les dispositions du nouveau code de procédure civile.
Elle dénie l’autorité de chose jugée aux décisions qui ne figurent pas dans le dispositif, mais seulement dans les motifs (V. Cass. 2e civ. 16 nov. 1983).
==> Depuis 1991 : la consécration du critère formel
A partir de 1991, la jurisprudence de toutes les chambres de la Cour de cassation s’en tient strictement au seul critère formel de la distinction entre motifs et dispositif pour refuser toute autorité de la chose jugée aux premiers. Comme le souligne Jacques Normand « une harmonisation des jurisprudences s’est réalisée, les première et troisième chambres ayant rejoint la deuxième chambre et la chambre commerciale dans une application stricte de l’article 480 ».
À l’origine de la jurisprudence nouvelle, se situerait selon Jacques Ghestin, un article publié par Jacques Normand en 1988 en faveur du refus de l’autorité de la chose jugée des motifs.
Après avoir montré les conflits de jurisprudence opposant, deux par deux, la 2e chambre civile et la chambre commerciale refusant toute autorité aux motifs, d’une part, aux première et troisième chambre civile de la Cour de cassation qui admettaient l’autorité des motifs, d’autre part, J. Normand « à la recherche d’une issue » écrivait : « Deux chambres contre deux, et aucune n’ayant voix prépondérante…On ne saurait admettre longtemps une telle confusion. Elle discrédite l’institution judiciaire. Elle fonde chez le justiciable le sentiment d’être le jouet du hasard ».
La jurisprudence actuelle, par une interprétation plus littérale de l’article 480 du code de procédure civile, a donc abandonné les solutions qui avaient pu être dégagées antérieurement, à partir des années 1970/80.
Tout ce qui ne figure pas dans le dispositif n’a pas autorité de la chose jugée, même s’il s’agit de motifs « inséparables du dispositif » (Cass. 2e civ., 5 avril 1991).
Cette dernière position a le mérite de lever toute incertitude quant à l’étendue de l’autorité de la chose jugée, et devrait être préférée pour cette raison.
Dès lors, les arrêts rendus à partir de 1991 doivent être interprétés comme s’opposant à la reconnaissance d’une autorité positive de chose jugée, même s’il y a parfois, selon Jacques Normand, quelques « accrocs dans l’unanimité qu’on croyait restaurée ».
Désormais, les motifs, dits décisoires, qui se prononcent sur une question litigieuse sont, dans le silence du dispositif, clairement dépourvus de l’autorité de la chose jugée (Cass. 1ère civ., 7 octobre 1998, n° 97-10548 ; Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n°98-19.038) et il en est de même des motifs décisifs définis classiquement comme constituant le soutien nécessaire du dispositif (Cass. 2e civ., 10 juillet 2003 ; Cass. 1ère civ., 13 décembre 2005 ; Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-17.503.
Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour de cassation, au sujet de motifs décisoires, rappelle que seul le dispositif est doté de l’autorité de la chose jugée, mais en prenant le soin de préciser qu’il en est ainsi même lorsque la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif, formule qui marque, par la même occasion, l’abandon de la thèse des motifs décisifs (Cass. 2e civ., 10 juillet 2003 ; Cass. 2e civ., 22 janv. 2004).
Néanmoins, Jacques Normand soulignait en 2004 que « des disparités subsistent entre les chambres de la Cour de cassation, des réticences se manifestent chez les juges du fond (ce dont témoigne en particulier le nombre des arrêts de cassation). Tout ceci est pour le moins le signe d’un malaise ».
3. Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée du dispositif virtuel ou implicite
Pour interdire à la partie adverse de remettre en cause une question qui a été invoquée incidemment au cours d’une instance précédente, et pour s’assurer ainsi une position inattaquable, l’un des plaideurs peut chercher à étendre l’autorité de la chose jugée en s’efforçant d’établir que le tribunal a implicitement tranché cette question incidente.
Se pose alors la question de savoir dans quelle mesure il est permis d’étendre la chose jugée aux décisions implicites.
La problématique des décisions implicites doit être distinguée de celle des motifs décisoires ou décisifs.
En effet, il s’agit, non d’accorder une quelconque autorité aux motifs de la décision, mais de rechercher dans le dispositif ce qui est virtuellement compris, afin d’étendre l’autorité de la chose jugée à toutes les questions nécessairement engagées dans le litige. Tantôt il s’agit d’un préalable nécessaire de la décision.
Dans d’autres cas, la chose non exprimée est implicitement jugée parce qu’elle est une suite inéluctable de ce qui a été jugé.
Aux termes de la jurisprudence, seul ce qui est expressément jugé dans le dispositif a autorité de la chose jugée.
Il avait parfois été admis que l’autorité de la chose jugée devait être attachée, non seulement aux points litigieux qui ont été expressément résolus dans le dispositif, mais aussi qu’elle devait être reconnue aux questions implicitement résolues dans le dispositif, que le juge a dû obligatoirement trancher pour prendre sa décision, parce qu’elles constituent les antécédents nécessaires de cette décision.
Si ces questions implicitement résolues venaient à être démenties, le jugement serait privé de tout fondement logique : il faut donc éviter une remise en question de ces éléments, et leur conférer l’autorité de la chose jugée.
Cette solution, au demeurant peu rigoureuse et difficilement compatible avec le dispositif de rectification des omissions de statuer, présentait l’inconvénient majeur de heurter bien souvent le principe de la contradiction, considéré comme un des principes directeurs du procès civil, lorsque l’implicitement jugé n’a pas été débattu entre les parties.
En effet, comme l’a rappelé Jean-Pierre Dintilhac « la chose jugée ne peut traduire la vérité qu’autant que les parties en litige, sous le contrôle actif du juge, se sont attachées, tout au long du procès, à respecter avec loyauté le principe de la contradiction qui constitue l’élément fondamental du procès équitable ».
Pour l’ensemble de ces considérations, la thèse du dispositif virtuel ou implicite est désormais condamnée par la jurisprudence dominante (Cass. 1ère civ., 16 juill. 1997 ; Cass. 2e civ., 19 févr. 2004, n° 03-10.167).
Cette jurisprudence a été entérinée par un arrêt de la chambre mixte rendu en date du 13 mars 2009 (Cass. ch. mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670)
Une conclusion s’impose donc, seul le dispositif exprès est doté de l’autorité de la chose jugée.
Cette affirmation a pour corollaire un devoir pour le juge, lequel doit veiller à soigner la rédaction du dispositif de sa décision pour y inclure l’ensemble des questions tranchées.
4. Exclusion du champ de l’autorité de la chose jugée du dispositif réservé
Le dispositif qui comporte des réserves, même implicites, n’a pas, sur le point concerné, autorité de la chose jugée (Cass 3e civ., 9 octobre 1974).
Toutefois, l’expression « déboute en l’état », parfois utilisée pour permettre un réexamen de l’affaire en cas d’évolution de la situation ou après constitution d’un nouveau dossier plus étayé, est sans portée.
La décision ainsi rendue sur le fond dessaisit le juge et acquiert l’autorité de la chose jugée (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 16 mai 2006, n° 02-14.488). La formule est donc à proscrire.
À cet égard, selon Jean-Pierre Dintilhac « ce refus d’admettre une nouvelle action en cas de découverte de nouveaux éléments de preuve, au nom de la sécurité juridique, de la paix sociale et pour prévenir la saturation de l’institution judiciaire déjà passablement encombrée, illustre combien cette “vérité de la chose jugée” est une vérité bien particulière qui tient non à une certitude quant au caractère véridique des éléments sur lesquels repose la décision, mais à la volonté de mettre un terme à la contestation et au refus d’ouvrir à nouveau des débats à partir d’éléments qui existeraient lors de l’examen qui précédait la décision, alors même que l’une des parties n’en aurait pas eu connaissance »
D) La signature du jugement
L’article 456 du CPC prévoit que le jugement doit être « signé par le président et par le greffier ». À défaut, le jugement encourt la nullité.
- S’agissant du Président
- Selon une jurisprudence constante, seul le Président ayant assisté aux débats est habilité à signer le jugement (V. en ce sens 2e civ., 9 juill. 1997).
- À défaut, le jugement encourt la nullité
- Dans un arrêt du 18 juin 2003, la troisième chambre civile a précisé que « s’il résulte des mentions de l’arrêt que le magistrat qui l’a régulièrement prononcé était conseiller lors des débats et du délibéré, il est présumé, à défaut de preuve contraire et de mention d’un empêchement, que la signature qui y figure sous la mention de président est celle du magistrat ayant présidé l’audience et participé au délibéré en cette qualité » ( 3e civ. 18 juin 2003, n°01-12886).
- L’article 456 du CPC précise encore « en cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré»
- Seul un juge qui donc a participé au délibéré peut signer le jugement.
- S’agissant du Greffier
- Dans un arrêt du 6 octobre 2009, la Cour de cassation a jugé « qu’est seul qualifié pour signer le jugement le greffier qui a assisté à son prononcé» ( com., 6 oct. 2009)
- Afin de limiter les actions en nullité, la deuxième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 10 juin 2004 « qu’il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé» ( 2e civ. 10 juin 2004, n°03-13172).
III) La force probante du jugement
==> Principe
L’article 457 du CPC prévoit que « le jugement a la force probante d’un acte authentique ». Le caractère authentique dont est pourvu le jugement tient à la qualité d’officier public du juge signataire.
Une telle authenticité oblige à tenir pour vrai, sauf inscription de faux, ce que le jugement énonce comme ayant été personnellement constaté par ses deux signataires, président et greffier.
Et ce que constate le greffier signataire n’est autre que le prononcé de la décision et son contenu. Au nombre des conditions d’établissement de tout acte authentique figure d’évidence l’intervention, par sa signature, d’un agent public légalement compétent et habilité, tel pour un jugement, outre le président, le greffier assistant au prononcé.
L’absence ou l’insuffisance d’une telle intervention (ici elle doit être double) est incompatible avec l’authenticité. C’est donc la double signature qui donne au jugement la force probante d’un acte authentique.
==> Tempéraments
Bien que le jugement possède la force probante d’un acte authentique, trois tempéraments sont apportés à cette règle :
- Premier tempérament
- La force probante du jugement n’est attachée qu’aux seuls éléments que le juge a pu vérifier, soit qu’ils se sont produits en sa présence, soit parce qu’il en est à l’origine
- Les mentions relatives à la notification de la décision au ministère public ne bénéficient donc pas de la force probante du jugement
- Deuxième tempérament
- L’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
- Certaines irrégularités peuvent ainsi être réparées lorsqu’il est établi, notamment au moyen du registre légale, que les prescriptions légales ont été respectées.
- Troisième tempérament
- L’article 462 du CPC dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
- Les parties disposent ainsi toujours d’une action en rectification d’erreur matérielle.
- Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
- La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
[1] J. Normand, La chose jugée -L’étendue de la chose jugée au regard des motifs et du dispositif, Rencontres Université- Cour de cassation, 23 janvier 2004.