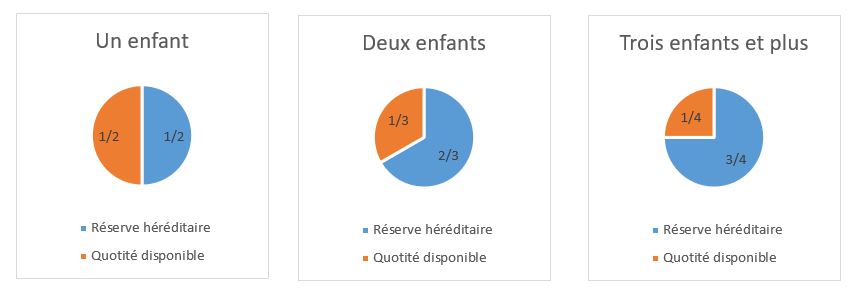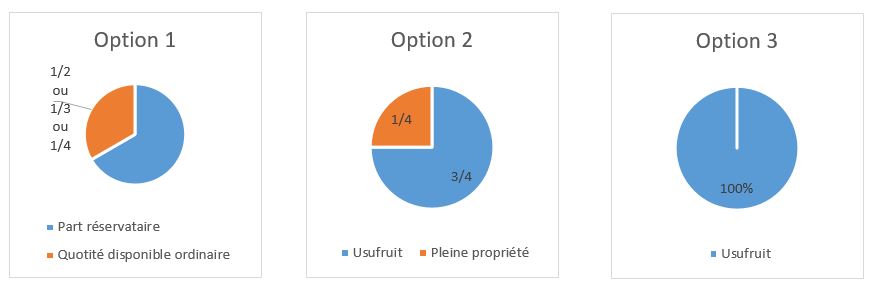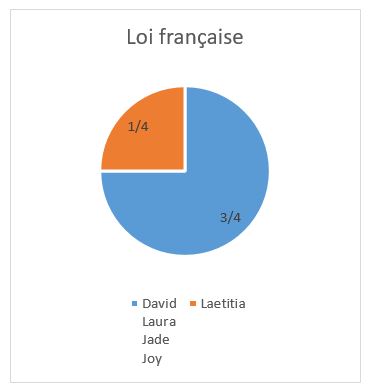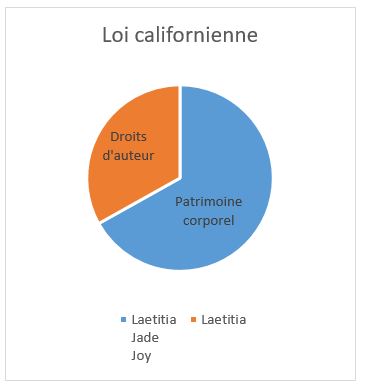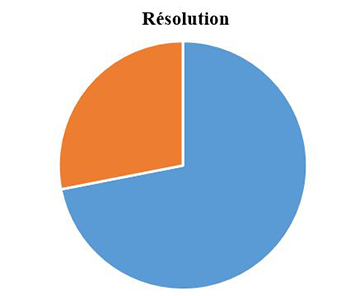Sauf à être frappée d’une incapacité d’exercice (minorité, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice etc.), il est de principe que toute personne qui jouit de la pleine capacité juridique est souveraine quant à assurer la gestion de ses intérêts.
Aussi est-il fait interdiction aux tiers de s’immiscer dans les affaires d’autrui, une intervention intempestive étant susceptible d’engager la responsabilité civile, voire pénale de son auteur.
Il est des cas néanmoins où une personne peut être empêchée d’agir, alors même que la gestion de ses affaires requerrait une intervention immédiate, intervention sans laquelle la préservation de ses intérêts s’en trouverait menacée.
L’exemple retenu classiquement pour illustrer la situation est celui d’une personne témoin d’un danger (incendie, fuite de gaz, affaissement etc) qui menace la maison de son voisin absent.
S’il n’intervient pas en urgence, il est un risque, sinon une certitude que le sinistre qui est sur le point de se produire n’endommage irrémédiablement l’immeuble.
Deux approches de la situation peuvent alors être envisagées :
- L’approche individualiste
- Si l’on retient une approche purement individualiste de la situation, il y a lieu de considérer que, en application du principe d’indépendance juridique des individus, il est fait interdiction à quiconque d’intervenir.
- Une intrusion délibérée dans les lieux s’apparenterait, au mieux à une immixtion fautive dans les affaires du propriétaire, au pire à une violation de domicile.
- L’approche sociale
- Si l’on adopte une approche sociale, l’initiative de la personne qui intervient spontanément doit être approuvée car visant à prévenir un dommage imminent.
- Son intervention doit ainsi être regardée comme un acte de bienveillance puisque procédant d’une volonté désintéressée de rendre service à son voisin dans la gestion de ses affaires.
À l’examen, le législateur a opté pour une approche intermédiaire en instituant le mécanisme de la gestion d’affaires.
Ainsi que le relève un Philippe le Tourneau « le droit positif n’a omis aucun de ces deux visages de la gestion d’affaires, en adoptant via media, c’est-à-dire un régime en demi-teinte, pour ne pas encourager les interventions intempestives, sans pour autant décourager les interventions utiles ».
Tout est affaire d’équilibre, celui-ci étant assuré, d’un côté, par l’instauration de conditions restrictives de mise en œuvre de la gestion d’affaires et, d’un autre côté, par la création d’obligations qui pèsent sur la tête de celui qui profite de l’intervention utile d’autrui.
Ceci étant posé, il convient d’aborder désormais la notion de gestion d’affaires, telle qu’envisagée par les textes.
?Notion
La gestion d’affaires est définie à l’article 1301 du Code civil comme le fait de « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire ».
Il s’agit autrement dit pour une personne, que l’on appelle le gérant d’affaires, d’intervenir spontanément dans les affaires d’autrui, le maître de l’affaire ou le géré, aux fins de lui rendre un service.
La particularité de la gestion d’affaires est qu’elle suppose qu’une personne ait agi pour le compte d’un tiers et dans son intérêt, ce, sans avoir été mandaté par celui-ci, ni qu’il en ait été tenu informé.
Ainsi qu’il l’a été dit, cette situation se rencontre, par exemple, lorsqu’une personne, souhaitant rendre un service à ami ou à un voisin absent, entreprend d’effectuer une réparation urgente sur ses biens.
Il peut encore s’agir d’organiser les obsèques d’une personne décédée sans héritier connu, de porter secours à la victime d’un accident prisonnier d’un véhicule en flamme ou encore de recueillir et de soigner un animal domestique égaré.
Schématiquement, la gestion d’affaires se décompose en deux temps :
- Premier temps
- Immixtion du gérant dans les affaires d’autrui, charge à lui d’accomplir, en bon père de famille, tous les actes utiles jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou ses ayants droits soit en capacité d’y pourvoir lui-même.
- Second temps
- Indemnisation du gérant par le maître des dépenses exposées pour la gestion, pourvu que l’affaire ait été utile et bien gérée
Cette configuration n’est pas sans rapprocher la gestion d’affaires d’autres figures juridiques.
?Distinctions
La gestion d’affaires doit être distinguée du mandat, de la stipulation pour autrui et de l’enrichissement injustifié.
- Gestion d’affaires et mandat
- Si la gestion d’affaires consiste, comme le mandat, à réaliser une action pour autrui, elle s’en distingue sur deux points.
- Première différence
- Tandis que le mandat est le produit d’un accord de volontés, la gestion d’affaires procède d’une initiative spontanée du gérant d’affaire qui va intervenir sans en avoir reçu l’ordre du maître de l’affaire.
- Aussi, tandis que les obligations qui échoient au mandataire naissent de l’accomplissement d’un acte juridique, celles qui pèsent sur le gérant de l’affaire prennent leur source dans un fait purement volontaire.
- Seconde différence
- Tandis que le mandat ne peut avoir pour objet que des actes juridiques (conservatoires, d’administration et de disposition), la gestion d’affaires peut donner lieu à l’accomplissement d’actes matériels.
- Ces actes matériels peuvent consister à surveiller une compétition sportive, conserver une chose égarée ou encore porter secours à une personne.
- Gestion d’affaires et stipulation pour autrui
- À l’instar de la stipulation pour autrui, la gestion d’affaires a pour effet de conférer des droits à autrui.
- Pour mémoire, la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une partie appelée le stipulant, obtient d’une autre, appelée le promettant, l’engagement qu’elle donnera ou fera, ou ne fera pas quelque chose au profit d’un tiers appelé le bénéficiaire.
- Bien que, assez proche, la gestion d’affaires se différencie de la stipulation pour autrui sur deux points :
- Première différence
- La stipulation pour autrui procède de la conclusion d’un contrat entre le stipulant et le promettant alors que la gestion d’affaires est une source autonome d’obligation.
- En effet, les droits conférés au maître de l’affaire procèdent, non pas d’un contrat, mais d’un fait volontaire consistant en l’intervention spontanée du gérant de l’affaire
- Seconde différence
- Tandis que la stipulation pour autrui ne peut conférer que des droits au bénéficiaire, la gestion d’affaire peut être source d’obligations pour le maître de l’affaire.
- Ce dernier devra notamment indemniser le gérant de l’affaire pour les frais exposés dans son intérêt.
- Gestion d’affaires et enrichissement injustifié
- Tant la gestion d’affaires que l’enrichissement injustifié (ou sans cause) visent à rétablir un équilibre injustement rompu entre deux patrimoines.
- Ces deux figurent juridiques reposent, au fond, sur l’idée que l’équité commande que la personne qui est intervenu spontanément dans l’intérêt d’autrui, puisse être indemnisé par ce dernier des dépenses qu’il a été amené à effectuer.
- Là encore la gestion d’affaires et l’enrichissement injustifiés, bien que poursuivant un objectif commun, se distinguent sur deux points :
- Première différence
- Le rétablissement de l’équilibre patrimonial injustement rompu n’a pas la même cause selon qu’il s’agit de la gestion d’affaire ou de l’enrichissement injustifié.
- La gestion d’affaires repose sur la caractérisation d’un élément subjectif, en ce sens qu’il s’agira d’établir la volonté du gérant d’intervenir dans les affaires d’autrui
- L’enrichissement injustifié repose, au contraire, sur la caractérisation d’un élément objectif, soit sur la démonstration d’une corrélation entre l’enrichissement d’un patrimoine au détriment d’un autre.
- En matière d’enrichissement injustifié, il est donc indifférent que l’enrichissement ait ou non pour origine une volonté d’agir, ce qui n’est pas le cas de la gestion d’affaires dont l’élément central est la volonté du maître d’intervenir sciemment dans les affaires d’autrui.
- Seconde différence
- En matière d’enrichissement injustifié, non seulement, l’indemnisation de la personne qui s’est appauvri est plafonnée par un double montant (plus forte des deux sommes entre l’enrichissement et l’appauvrissement), mais encore l’enrichissement doit avoir subsisté au moment où l’action de in rem verso est introduite.
- En matière de gestion d’affaires il échoit au maître de l’affaire de rembourser le gérant à hauteur de toutes les sommes utilement exposées, ce quand bien même il n’en aurait retiré aucun profit.
?Origine
La gestion d’affaire est loin d’être une création des rédacteurs du Code civil. Il s’agit là d’une figure juridique, comme beaucoup d’autres, héritée du droit romain.
Celui-ci était riche de deux actions susceptibles d’être exercées, soit par le gérant, soit par le maître de l’affaire. L’action negotiorum gestorum contrario était conférée au gérant, tandis que l’action negotiorum gestorum directa pouvait être exercée par le maître de l’affaire.
Ces deux actions étaient calquées sur les règles du mandat, raison pour laquelle la gestion d’affaires est parfois qualifiée de quasi-mandat.
L’analogie entre les deux dispositifs obligationnels explique le régime actuel de la gestion d’affaires. Elle se distingue néanmoins du mandat sur un point essentiel : elle procède, non pas d’un accord de volontés, mais d’un fait juridique purement volontaire, ce qui fait d’elle un quasi-contrat.
?Nature
La gestion d’affaires est envisagée dans une partie du Code civil consacrée « aux autres sources d’obligations ».
Ainsi que le précise le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette partie du Code napoléonien qui suit, un sous-titre Ier consacré au contrat et un sous-titre II qui traite de la responsabilité extracontractuelle ne porte pas, à proprement parler sur toutes les autres sources d’obligations (telles que la loi ou l’engagement unilatéral de volonté), mais seulement sur les quasi-contrats connus en droit positif.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par quasi-contrat, la gestion d’affaires relevant manifestement de cette catégorie d’obligations.
- Définition
- Les quasi-contrats sont définis à l’article 1300 C. civ (ancien art 1371 C. civ.) comme « des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
- Il s’agit autrement dit, du fait spontané d’une personne, d’où il résulte un avantage pour un tiers et un appauvrissement de celui qui agit.
- Au nom de l’équité, la loi rétablit l’équilibre injustement rompu en obligeant le tiers à indemniser celui qui, par son intervention, s’est appauvri.
- Différence avec le contrat
- Tandis que le contrat est le produit d’un accord de volontés, le quasi-contrat naît d’un fait volontaire licite
- Ainsi la formation d’un quasi-contrat, ne suppose pas la rencontre des volontés entre les deux « parties », comme tel est le cas en matière de contrat.
- Les obligations qui naissent d’un quasi-contrat sont un effet de la loi et non un produit de la volonté.
- Différence avec le délit et le quasi-délit
- Contrairement au délit ou au quasi-délit, le quasi-contrat est un fait volontaire non pas illicite mais licite, en ce sens qu’il ne constitue pas une faute civile.
- Le fait générateur d’un quasi-contrat ne permet donc pas d’engager la responsabilité de son auteur.
- Leur point commun est que les effets de droits attachés au quasi-contrat et au délit/quasi-délit procèdent de la loi et non d’un accord entre les personnes intéressées qui, par hypothèse, fait défaut.
La gestion d’affaires relève donc de la catégorie des quasi-contrats. Il en résulte deux conséquences immédiates :
- Tout d’abord, il ne peut être recouru à la figure juridique de la gestion d’affaires qu’à titre subsidiaire, soit dans l’hypothèse où aucun contrat n’a été conclu entre le maître de l’affaire et le gérant.
- Ensuite, parce que les obligations attachées à la gestion d’affaires ne procèdent pas de l’accomplissement d’un acte juridique, mais d’un fait, la preuve est libre et se rapporte donc par tous moyens, nonobstant l’accomplissement d’actes juridiques par le gérant dans le cadre de son intervention (V. en ce sens Cass. civ. 19 mars 1845).
?Réforme des obligations
Sous l’empire du droit antérieur, la gestion d’affaires était régie avec le paiement de l’indu, autre forme de quasi-contrat, par les articles 1371 à 1381 du code civil.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a transféré la gestion d’affaires aux articles 1301 à 1301-5.
À l’analyse, l’intervention du législateur s’est limitée à un toilettage des textes, la principale innovation consistant à étendre les obligations du gérant qui doit désormais « remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant », alors que, auparavant, il ne devait reprendre que les engagements « contractés en son nom ».
En tout état de cause, la gestion d’affaires ne peut être invoquée qu’à la condition de satisfaire à plusieurs conditions cumulatives. Une fois ces conditions remplies, elle produit un certain nombre d’effets spécifiques, tant à l’égard à l’égard du gérant et du maître, qu’à l’égard des tiers.
I) Les conditions de la gestion d’affaires
A) Les conditions relatives aux personnes
1. Les conditions relatives au gérant de l’affaire
Pour que celui qui a accompli des actes pour le compte d’autrui puisse se prévaloir de l’application des règles de la gestion d’affaires, il doit établir :
- D’une part, que son intervention était altruiste
- D’autre part, que son intervention était spontanée
a. Une intervention altruiste
La gestion d’affaires ne se conçoit que si elle procède d’une intervention altruiste du gérant, soit d’une intervention qui vise à accomplir un acte dans l’intérêt d’autrui.
Cette condition n’a toutefois pas toujours été exigée par la jurisprudence, sa position ayant évolué au début du XXe siècle.
i. Évolution jurisprudentielle
À l’origine la jurisprudence n’exigeait pas que la gestion d’affaires procède d’une intervention altruiste. Les tribunaux admettaient, en effet, qu’il puisse être fait application du dispositif, anciennement codifié à l’article 1372 du Code civil, alors même que le gérant n’avait pas agi dans l’intention de rendre service à autrui.
Cette position s’explique par l’absence de reconnaissance, à l’époque, de l’action in rem verso, ce qui avait conduit les juges à recourir à la gestion d’affaires pour ne pas laisser sans indemnité celui qui, même sans intention altruiste, s’était appauvri au bénéfice d’un tiers.
Pour mémoire, la théorie de l’enrichissement sans cause (rebaptisée en 2016 enrichissement injustifié) a, pour la première fois, été reconnue par la jurisprudence dans un arrêt Boudier rendu par la Cour de cassation le 15 juin 1892 (Cass. req. 15 juin 1892)
Aux termes de cette décision, la haute juridiction a jugé que, la théorie de l’enrichissement sans cause, qualifiée également d’action de in rem verso, « dérivant du principe d’équité qui défend de s’enrichir au détriment d’autrui et n’ayant été réglementée par aucun texte de nos lois, son exercice n’est soumis à aucune condition déterminée ».
Elle en déduit « qu’il suffit, pour la rendre recevable, que le demandeur allègue et offre d’établir l’existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit ».
Lorsque la Cour de cassation a institué, par cette décision, la théorie de l’enrichissement injustifié en principe général, il est apparu, par suite, inutile de se fonder sur la gestion d’affaires pour justifier l’obligation d’indemnisation pesant sur celui qui s’était enrichi aux dépens d’autrui.
La manœuvre était d’autant moins opportune qu’elle conduisait à dévoyer les conditions d’application de la gestion d’affaires qui avaient été envisagées de façon restrictive par les rédacteurs du Code civil. D’où le retour de la jurisprudence, au début du XXe siècle, à une position orthodoxe.
ii. Droit positif
?Principe
C’est dans un arrêt du 25 juin 1919 que la Cour de cassation est revenue à une interprétation stricte des conditions d’application de la gestion d’affaires.
Dans cette décision, est réintroduite l’exigence d’intention pour le gérant de gérer l’affaire d’autrui, considérant, au cas particulier, qu’un éditeur ne pouvait pas se voir allouer une rémunération pour l’exploitation utile qu’il avait faite d’ouvrages d’un tiers, alors que « loin d’avoir géré volontairement la chose d’autrui, [il] avait exploité les œuvres litigieuses parce qu’il s’en croyait propriétaire exclusif et uniquement dans l’intérêt de son commerce personnel » (Cass. civ. 25 juin 1919).
|
Cass. civ. 25 juin 1919
La Cour?;
Attendu que le pourvoi soutient que l’arrêt attaqué aurait, contrairement à la loi, refusé de reconnaître à Benoît la qualité de gérant d’affaires, et de lui allouer une rémunération pour l’exploitation utile qu’il avait faite des ouvrages sur lesquels portait le droit reconnu au profit de Biollay et consorts?;
Mais attendu que l’arrêt attaqué constate que Benoît, loin d’avoir géré volontairement la chose d’autrui, avait exploité les œuvres litigieuses parce qu’il s’en croyait propriétaire exclusif et uniquement dans l’intérêt de son commerce personnel?; qu’en cet état des faits souverainement constatés, c’est à bon droit que la cour de Paris a décidé que Benoît n’avait pas agi en qualité de gérant d’affaires et a confirmé le jugement ayant rejeté la demande d’allocation qu’il avait formée à ce titre…?;
Par ces motifs, casse
|
Pour la Cour de cassation, la gestion d’affaires ne peut ainsi jouer que s’il est établi que l’intervention du gérant a été guidée par une intention de rendre service à autrui, ce qui n’est pas le cas lorsque celui-ci croyait agir dans son seul intérêt personnel.
Elle a eu l’occasion de réaffirmer cette exigence à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 28 octobre 1942 aux termes duquel elle a affirmé que « le bénéfice de la gestion d’affaires peut être accordé à quiconque a volontairement agi au nom et pour le compte d’autrui, dès lors qu’il résulte des constatations des juges du fait de l’opportunité de l’intervention était telle que l’initiative était justifiée et que l’affaire a été utilement gérée » (Cass. civ. 28 oct. 1942).
Lors de l’adoption de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, le législateur a consacré l’exigence tenant à l’altruisme dont doit avoir fait montre celui qui s’est immiscé dans les affaires d’autrui en posant à l’article 1301 du Code civil qu’il devait être intervenu « sciemment » pour être autorisé à se prévaloir de la qualité de gérant d’affaires.
Cette précision exclut, de la sorte, l’application de la gestion d’affaire pour les cas où le gérant serait intervenu en ignorant qu’il accomplissait des actes dans l’intérêt d’autrui.
Dans un arrêt du 1er décembre 1959, il a, par exemple, été jugé que, une personne qui, croyant avoir hérité d’un immeuble, engage des travaux de réparation, puis découvre un testament qui finalement la déshérite, n’est pas fondée à agir contre le légataire sur le fondement de la gestion d’affaires pour obtenir le remboursement des frais exposés (Cass. civ. 1ère 1er déc. 1959).
?Mise en œuvre
S’il est désormais acquis que la gestion d’affaires ne se conçoit que si l’intervention du gérant a été guidée par une intention altruiste, la jurisprudence est venue préciser un certain nombre de points sur la mise en œuvre de cette exigence
- L’indifférence de la personne du maître de l’affaire
- La question s’est posée en jurisprudence de savoir si le gérant de l’affaire devait nécessairement savoir dans l’intérêt de qui il intervenait
- Cette problématique est particulièrement prégnante pour les actes de secours et de dévouement qui sont le plus souvent accomplis au profit de personnes inconnues de celui qui intervient.
- À cet égard, certains arrêts ont refusé de faire application des règles de la gestion d’affaires, considérant que celui qui était intervenu l’avait fait, moins dans l’intérêt de la personne secourue, que pour servir la collectivité et que, par voie de conséquence, c’est vers l’État qu’il lui appartenait de se tourner pour être indemnisé (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 7 janv. 1971, n°69-10.389 et 69-10.788).
- À l’analyse, ces décisions demeurent isolées, la jurisprudence n’attachant désormais plus aucune importante à la personne dans l’intérêt de laquelle le gérant de l’affaire est intervenu.
- Autrement dit, il n’est pas exigé que celui qui intervient ait agi intui personae.
- La seule exigence posée est que la personne dans l’intérêt de laquelle des actes ont été accomplis et qui sera donc tenu d’indemniser le gérant, soit celle qui aurait définitivement supporté l’incidence du dommage si aucune intervention n’avait eu lieu.
- Il est d’ailleurs indifférent que le maître de l’affaire soit une personne physique ou une personne morale (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955).
- Il a également admis qu’il puisse s’agir d’une personne future, telle qu’une société en cours de formation (Cass. com. 14 janv. 2003, n°00-12.557).
- L’admission d’une intervention partiellement altruiste
- Si pour être mises en œuvre, la gestion d’affaires suppose que la personne qui est intervenue ait été animée par une volonté altruiste, il n’est pas exigé que sa démarche soit totalement désintéressée.
- La jurisprudence admet, en effet, qu’il puisse être recouru à la gestion d’affaires lorsque le gérant est intervenu, à la fois dans son propre intérêt et dans celui d’autrui.
- Cette situation se rencontre notamment en matière d’indivision et plus précisément lorsqu’un indivisaire accompli des actes dans l’intérêt de tous en dehors de tout pouvoir légal de représentation, de mandat ou d’habilitation par justice.
- L’article 815-4 du Code civil prévoit que ces « actes faits par un indivisaire en représentation d’un autre ont effet à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires ».
- Cette même règle est posée dans les rapports entre époux, l’article 219 du Code civil prévoyant que « à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. »
- Elle a encore été appliquée dans les rapports entre nu-propriétaire et usufruitier (Cass. civ. 28 oct. 1942).
- Plus généralement, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 16 novembre 1976 que « la circonstance de l’intérêt conjoint des parties n’est pas, par elle-même, de nature à exclure la gestion d’affaires » (Cass. com. 16 nov. 1976, n°74-13.681).
- Dans un arrêt du 28 mai 1991, la première chambre civile a encore affirmé que « la circonstance que le généalogiste ou la personne jouant ce rôle ait œuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l’affaire n’est pas exclusive de l’existence d’une gestion d’affaires ».
- Cela signifie donc que l’intérêt personnel du gérant n’exclut pas la gestion d’affaires (Pour les rapports entre concubins Cass. 1re civ., 12 janv. 2012, nº 10-24.512).
- Cette solution a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme du droit des obligations.
- Le nouvel article 1301-4 du Code civil prévoit, en effet, que « l’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires. »
- L’alinéa 2 de ce texte précise que, en cas d’intérêt commun entre le gérant et le maître de l’affaire, « la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »
b. Une intervention spontanée
?Principe
L’ancien article 1372 du Code civil posait que, pour jouer, la gestion d’affaires devait procéder d’une intervention « purement volontaire » du gérant, soit qu’il n’ait agi au titre d’aucune obligation légale, ni d’aucune obligation contractuelle.
Le nouvel article 1301 du Code civil reprend cette exigence en prévoyant que pour se prévaloir de la qualité de gérant d’affaire, celui qui est intervenu doit avoir agi « sans y être tenu ».
Son intervention doit, autrement dit, avoir été spontanée, c’est-à-dire non provoquée par une quelconque obligation, autre que morale.
Dans un arrêt du 11 octobre 1984, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « les personnes qui légalement ou contractuellement sont tenues d’accomplir certains actes ne peuvent s’en prévaloir comme étant des actes de gestion d’affaires » (Cass. soc. 11 oct. 1984, n° 83-12.686).
Lorsque dès lors celui qui accomplit des actes dans l’intérêt d’autrui, agit parce qu’il est tenu par un contrat ou par la loi, il lui est fait interdiction de se prévaloir des règles de la gestion d’affaires.
La Cour de cassation a récemment jugé que « la gestion d’affaires, qui implique l’intention du gérant d’agir pour le compte et dans l’intérêt du maître de l’affaire, est incompatible avec l’exécution d’une obligation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2019, n° 18-15.379).
Il se déduit plus largement de cette décision que les fonctions de mandataire, tuteur, administrateur légal et plus généralement représentant sont incompatibles avec la qualité de gérant d’affaire.
Plus spécifiquement, la jurisprudence rappelle régulièrement que la gestion d’affaire est neutralisée lorsque pèse sur le gérant une obligation professionnelle (Cass. com. 14 oct. 1997, n°95-19.468).
La Cour de cassation a précisé qu’il était indifférent que l’intervention vise à palier un manquement à une obligation contractuelle ou légale la spontanéité étant insusceptible d’excuser la faute (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 29 mai 2001, n°99-21.144)
La jurisprudence adopte la même solution s’agissant des interventions qui résulteraient d’une obligation légale. En droit maritime, par exemple, une obligation d’assistance pèse sur quiconque rencontre « toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre ».
Plus généralement, l’exercice de toute fonction assujettie à une réglementation professionnelle est exclusif de la gestion d’affaires.
À l’analyse, cette exigence de spontanéité de l’intervention du gérant n’est autre qu’une déclinaison de la règle plus générale qui n’autorise le recours aux quasi-contrats qu’à titre subsidiaire, soit en l’absence d’obligation préexistante.
Il s’agit, en quelque sorte, d’un filet de sécurité dont la fonction est de permettre au juge de rétablir un équilibre injustement rompu.
?Tempéraments
Il est des cas où la jurisprudence admet que la gestion d’affaire puisse jouer, alors même que l’intervention du gérant n’est pas étrangère à l’existence d’une obligation contractuelle ou légale. On parle alors de gestion d’affaires imparfaite.
Tel est notamment le cas lorsqu’une partie à un contrat a agi en dépassement des prérogatives qui lui étaient conférées. Le locataire qui a engagé des travaux de reconstruction d’un immeuble sinistré peut, de la sorte, se prévaloir de la qualité de gérant d’affaire (Cass. civ. 1ère 17 déc. 1958).
Il en va de même pour le représentant légal d’un majeur incapable ou d’un mineur qui a accompli des actes en dehors de ses attributions (Cass. civ. 22 févr. 1888).
La jurisprudence admet encore que la gestion d’affaires puisse s’appliquer en cas de proximité de plusieurs patrimoines (copropriété, concubinage, succession etc.), l’un des titulaires agissant dans l’intérêt des autres (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 5 oct. 1960).
Dans ces hypothèses, la préexistence d’une obligation contractuelle ou légale interroge sur la spontanéité de l’intervention du gérant, sinon sur sa volonté d’agir dans l’intérêt du maître de l’affaire.
À l’analyse, son immixtion est moins commandée par son intention de rendre service à autrui, que par l’existence de rapports antérieurs qui ont déterminé son intervention.
L’accomplissement d’actes de gestion n’est donc pas concomitant à l’ingérence du gérant qui, finalement, a agi dans le prolongement de sa mission. Pour cette raison, la gestion d’affaires ne devrait pas pouvoir jouer, celle-ci supposant une intervention spontanée, soit détachée de toute obligation préexistante.
Reste que, dans le doute, la jurisprudence a tendance à reconnaître la gestion d’affaires en cas de dépassement d’un pouvoir contractuel ou légal, l’objectif recherché étant d’indemniser celui qui, malgré tout, est intervenu au profit d’autrui.
2. Les conditions relatives au maître de l’affaire
En application de l’article 1301 du Code civil, la gestion d’affaires ne se conçoit que si elle intervient « à l’insu ou sans opposition du maître ».
Autrement dit, le maître de l’affaire ne doit :
- Ni avoir consenti à la gestion
- Ni s’être opposé à la gestion
?Sur le consentement du maître de l’affaire à la gestion
Dans l’hypothèse où le maître de l’affaire a donné son consentement préalablement à l’intervention du gérant, l’opération s’analyse, non pas en une gestion d’affaires, mais en un contrat.
Pour rappel, l’article 1101 du Code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Dès lors qu’il y a échange des consentements, une relation de nature contractuelle se noue entre les parties. Or la qualification de gestion d’affaire est exclusive de celle de contrat.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 3 juin 1987 où il était question de la conclusion d’un mandat de syndic régi par la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e civ. 3 juin 1987, n°85-18.650).
Une difficulté pourra naître lorsque le consentement aura été donné tacitement par le maître de l’affaire à l’intervention du gérant. Quid notamment lorsque le maître a laissé intervenir, en toute connaissance de cause, le gérant dans la gestion de ses affaires ? Cette abstention suffit-elle à exclure la qualification de gestion d’affaires ?
À l’examen, l’article 1301 du Code civil ne répond que partiellement à cette difficulté en précisant que la gestion d’affaires ne pourra être retenue que dans l’hypothèse où l’immixtion du gérant est intervenue « à l’insu ou sans opposition » du maître.
Autrement dit, lorsque le gérant est intervenu au vu et au su du maître de l’affaire sans que celui-ci ne s’y oppose, son abstention ne suffirait pas à écarter la qualification de gestion d’affaires. Il ressort, en effet, du texte que l’ignorance n’est pas une condition de la gestion d’affaires.
Reste que lorsque le maître de l’affaire aura eu connaissance de l’acte de gestion réalisé à son profit et qu’il aura laissé faire le gérant, la qualification de gestion d’affaires sera en concurrence avec celle de contrat et plus précisément de contrat de mandat.
Pour que la qualification de mandat tacite soit retenue et que la gestion d’affaires soit corrélativement écartée, il conviendra néanmoins d’établir que l’approbation tacite du maître qui ne s’est pas opposé à l’intervention du gérant était dépourvue d’équivoque, le silence ne pouvant pas, à lui seul, valoir acception.
En pratique, l’exigence tenant à la preuve sera un obstacle insurmontable pour le maître de l’affaire, ce qui conduira alors le juge à retenir la qualification de gestion d’affaires.
Enfin, l’article 1301-3 du Code civil prévoit que lorsque le consentement du maître de l’affaire est donné postérieurement à l’intervention du gérant, l’opération quitte le domaine de la gestion d’affaires pour endosser la qualification de contrat et plus précisément de mandat. Ce consentement s’analyse en une ratification de l’acte de gestion, ratification qui opère rétroactivement.
?Sur l’opposition du maître de l’affaire à la gestion
- Principe
- L’article 1301 du Code civil dispose expressément que pour que la gestion d’affaires puisse jouer, il faut que le maître ne se soit pas opposé à l’intervention du tiers.
- Aussi, dans l’hypothèse où le gérant s’immisçait dans les affaires du maître alors même que celui-ci le lui a interdit, l’acte de gestion n’ouvrira aucun droit à indemnité (V. en ce sens Cass. com. 22 déc. 1969).
- Au contraire, il s’agira là d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, étant précisé que le principe demeure l’interdiction générale de s’immiscer dans les affaires d’autrui (Cass. 3e civ. 12 avr. 1972, n°70-13.154).
- Tempérament
- La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que pour que l’opposition à toute intervention du gérant formulée par le maître de l’affaire fasse obstacle à l’octroi d’une indemnité, encore faut-il qu’elle ne soit pas manifestement injustifiée
- Tel serait le cas lorsque le gérant pallie la carence du maître de l’affaire qui était tenu de se conformer à une obligation légale.
- Dans un arrêt du 11 février 1986, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que l’opposition faite par un père à son fils de régler les mensualités exigibles de son prêt n’était pas légitime.
- Elle en déduit que leur prise en charge par le fils ouvrait droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 11 févr. 1986, 84-10.756).
- Dans un arrêt du 26 janvier 1988, la Cour de cassation a encore été amenée à se prononcer sur la légitimité d’un cas d’opposition de gestion.
- Dans cette affaire, le client d’un établissement commercial s’est lancé, ainsi que quelques autres personnes, à la poursuite de malfaiteurs armés qui venaient de s’emparer de la recette du magasin. Alors qu’il était parvenu à faire lâcher son butin par un des voleurs, il a été blessé, au cours de son intervention, par un coup de feu tiré par un autre voleur.
- Se fondant sur les dispositions légales relatives à la gestion d’affaire, il a alors demandé à l’établissement commercial l’indemnisation des dommages subi, nonobstant les consignes de non-intervention qui lui avaient été adressées par cet établissement.
- La Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande du gérant, considérant que l’opposition qui lui avait été adressée quant à intervenir n’était pas justifiée (Cass. 1ère civ. 26 janv. 1988, n°86-10.742).
B) Les conditions relatives aux actes
1. Objet des actes de gestion
Pour que la gestion d’affaires puisse jouer, s’il est indifférent que l’acte de gestion accompli par le gérant soit matériel ou juridique, cet acte doit en revanche être licite, faute de quoi il n’ouvrira pas droit à indemnisation.
a. Un acte de gestion matérielle ou juridique
L’article 1301 du Code civil ne circonscrit pas la gestion d’affaires à un certain nombre d’actes, ainsi que la question s’était posée lors de l’adoption du Code civil.
Certains auteurs avaient, en effet, avancé que la gestion d’affaires ne pouvait être envisagée que pour l’accomplissement d’actes juridiques à l’exclusion de tout autre acte.
La raison en est que le régime de la gestion d’affaires s’apparente à une transposition des règles du mandat. Or le contrat de mandat n’autorise le mandataire qu’à accomplir des actes juridiques.
Très tôt, la jurisprudence a néanmoins désavoué cette position, considérant que le mécanisme de la gestion d’affaires visait à récompenser un geste altruiste, lequel pouvait prendre la forme, tout autant d’un acte juridique, que d’un acte matériel.
L’article 1301 du Code civil confirme cette interprétation en visant expressément ces deux catégories d’actes comme relevant du périmètre de la gestion d’affaires.
?S’agissant actes matériels
Ces actes relèvent de la catégorie des faits juridiques définis à l’article 1100-2 du Code civil comme des « agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. »
Au nombre des actes matériels figurent, par exemple, la fourniture d’aliments, la conservation d’un objet égaré, les soins prodigués à un animal domestique perdu, l’extinction d’un incendie ou encore la réparation d’un bâtiment abîmé.
Pour donner lieu à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaire, l’acte matériel doit, a priori, avoir pour effet d’assurer la conservation du patrimoine d’autrui, à tout le moins c’est ce que suggère la formule « gestion d’affaires ».
La question s’est néanmoins posée de savoir si cet acte pouvait consister à agir, non pas sur les « affaires » du maître, soit son patrimoine, mais sur sa personne.
Quid en particulier du sort des actes d’assistance et de sauvetage ? Peuvent-ils ouvrir droit à indemnisation en cas de préjudice subi par celui qui a porté secours à autrui au cours de son intervention. Leur inclusion dans le périmètre de la gestion d’affaires a, un temps, été discutée par les auteurs.
La jurisprudence a rapidement répondu à cette question en jugeant très tôt qu’il n’y avait pas lieu de distinguer selon l’objet de l’acte. Elle a ainsi admis qu’un acte d’assistance et de sauvetage d’une personne en péril ouvrait bien droit à indemnisation sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955).
La Cour de cassation considère, plus généralement, que, quand bien même l’acte de sauvetage pourrait être rattaché à l’obligation de porter secours dont le manquement est sanctionné par l’article 223-6, al. 2 du Code pénal, l’existence de cette obligation n’est nullement incompatible avec l’application des règles de la gestion d’affaires.
Au fond, s’il est fait obligation d’agir à quiconque est en situation de pouvoir porter secours à autrui, cette obligation s’arrête là où naît un risque de dommage, de sorte que l’agent dispose d’une certaine liberté d’action pour se déterminer. C’est l’existence de cette liberté d’action qui justifie que la gestion d’affaires puisse jouer en cas de préjudice résultant d’un acte de sauvetage
?S’agissant des actes juridiques
Les actes juridiques sont définis à l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit ». Le texte précise qu’ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Si, l’admission des actes juridiques au nombre des actes susceptibles d’être accomplis par le gérant d’affaire n’a jamais été discutée, puisque résultant d’une transposition du régime du mandat, s’est en revanche posée la question de la limitation de ces actes aux seuls actes d’administration.
Pour mémoire :
- Les actes d’administration sont les actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne dénués de risque anormal.
- Les actes de disposition sont les actes qui engagent le patrimoine de la personne, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.
S’agissant des actes d’administration, ils correspondent aux actes qui constituent l’essence même de la gestion d’affaires.
Aussi, la jurisprudence admet que le gérant puisse accomplir toute sorte d’acte d’administration et conservatoire dès lors qu’ils poursuivent un but de préservation du patrimoine du maître de l’affaire.
Il peut s’agir de conclure un contrat de prestation de travaux de réparation, de percevoir les fruits d’un bien, de régler une facture, d’assurer la gestion d’un bien immobilier etc.
S’agissant des actes de disposition, ils correspondent aux actes les plus graves qui ont pour effet de modifier le patrimoine du maître de l’affaire.
Si l’on se reporte aux règles du mandat, lorsque celui-ci est conclu en des termes généraux, conformément à l’article 1988 du Code civil, le mandataire n’est autorisé qu’à accomplir des actes d’administration.
Pour les actes de disposition, ce texte exige la régularisation d’un mandat exprès, soit un acte qui autorise spécifiquement le mandataire à accomplir l’acte envisagé.
Compte tenu de cette dichotomie instaurée en matière de mandat qui se justifie par le souci de limiter les pouvoirs conférés au mandataire et de préserver le patrimoine du mandant, la question de sa transposition à la gestion d’affaires s’est posée en jurisprudence, à tout le moins elle s’est montrée hésitante pour un certain nombre d’entre eux.
Reste qu’elle a finalement admis qu’un acte de disposition puisse être accompli par le gérant d’affaire.
Dans un arrêt du 28 octobre 1942, elle a par exemple jugé que la gestion d’affaires pouvait justifier l’aliénation de valeurs mobilières (Cass. 1ère civ. 28 oct. 1942).
La Cour de cassation a encore admis que le gérant puisse consentir un prêt d’argent avec les deniers du maître de l’affaire (Cass. 1ère civ. 13 janv. 1998, n°96-11.881) ou encore qu’il endosse un effet de commerce (Cass. com. 5 juill. 1970).
À l’examen, lorsque la Cour de cassation admet qu’un acte de disposition puisse relever la gestion d’affaires, c’est que des circonstances exceptionnelles étaient caractérisées, soit que le bien en jeu était périssable, soit que le contexte justifiait une intervention immédiate (guerre, catastrophe naturelle etc.).
En tout état cause, parce qu’il y a lieu, d’une part, de limiter autant que possible les incursions de tiers dans les affaires d’autrui et, d’autre part, de veiller à ce que ces incursions n’occasionnent pas des atteintes trop importantes au patrimoine du maître de l’affaire, les Tribunaux n’admettent qu’à titre exceptionnel que la gestion d’affaires puisse justifier l’accomplissement d’actes de disposition.
Les juges procéderont ainsi à un examen approfondi des actes qui leur sont soumis et répugneront à accéder à toute demande d’indemnisation formulée par un gérant s’il apparaît que l’acte est trop intrusif ou s’il engage de manière trop excessive les affaires d’autrui.
?Cas particulier de l’action en justice
Un tiers est-il autorisé à représenter autrui dans le cadre de la gestion d’affaires ? À cette question la jurisprudence répond par l’affirmative, tout en assortissant le principe ainsi posé d’un tempérament.
- Principe
- Dans un arrêt du 21 décembre 1981, la Cour de cassation a jugé qu’une personne dépourvue de la qualité de mandataire sociale, puisse, en raison de circonstances exceptionnelles, représenter une société en justice en agissant en tant que gérant d’affaires.
- Au soutien de sa décision, elle précise que « aucune disposition légale ne subordonne la validité de l’action intentée par le gérant d’affaires à l’acceptation des débats par le tiers contre lequel cette action est exercée » (Cass. 1ère civ. 21 déc. 1981, n° 80-15.854).
- Il ressort de cette décision que rien ne s’oppose donc à ce qu’une action en justice puisse être engagée par le gérant d’affaire pour le compte du maître, dès lors qu’il s’agit de représenter autrui et non d’agir en son nom propre, puisque nul ne plaide par procureur.
|
Cass. 1ère civ. 21 déc. 1981
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que la Société civile immobilière Normandie, ayant pour gérant Lacroix, a confié en juillet 1958 à la société à responsabilité limitée Taddei, dont le gérant était Taddei, la construction à Alger d’un immeuble ; que la réception définitive de cet immeuble a eu lieu le 4 juillet 1961, mais que la Société civile immobilière Normandie serait restée débitrice de la Société Taddei d’une somme de 101.970 francs ; que les membres des deux sociétés sont revenus en France après l’indépendance algérienne ; que la Société Taddei, se disant représentée par son gérant Taddei, a assigné, le 25 octobre 1976, la Société civile immobilière Normandie et Lacroix ès-qualités en paiement de la somme de 101.970 francs ; que la Société civile immobilière Normandie a fait valoir que les pouvoirs de gérant de Taddei, qui avait été nommé pour cinq ans à ces fonctions, étaient expirés depuis le 1er avril 1963 et qu’il ne pouvait agir au nom de la société à responsabilité limitée Taddei ; que la Cour d’appel a déclaré l’action recevable, avant d’ordonner une expertise sur le compte à faire entre les parties, en retenant que Taddei s’était comporté comme un gérant de fait postérieurement au 1er avril 1963 et agissait pour le compte de la société à responsabilité limitée Taddei conformément aux règles de la gestion d’affaires ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du second degré d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d’une part, après avoir constaté que le mandat de Taddei en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Taddei était expiré depuis le 1er avril 1963, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, admettre que ce même Taddei avait pu légalement représenter cette société, même en application des règles de la gestion d’affaires, dans une action engagée par acte introductif du 25 octobre 1976 ; et alors que, d’autre part, la partie adverse n’étant pas tenue d’accepter le débat judiciaire avec le gérant d’affaires et pouvant lui opposer son défaut de qualité, viole aussi les articles 1372 et suivants du Code civil l’arrêt attaqué qui admet la représentation d’une société par un gérant dont les pouvoirs étaient expirés, sur le fondement des règles de la gestion d’affaires, bien que ses adversaires aient sollicité la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient déclaré irrecevable la demande de la société du fait du défaut de pouvoir régulier du gérant ;
Mais attendu, en premier lieu, que si Taddei ne pouvait fonder son pouvoir de représentant de la société à responsabilité limitée Taddei sur la qualité de gérant, qu’il n’avait plus, c’est sans violer les dispositions de l’article 117 du nouveau Code de procédure civile que la Cour d’appel a admis que Taddei, agissant en tant que gérant d’affaires, avait pu représenter la société en justice en raison de circonstances exceptionnelles ; qu’en second lieu, aucune disposition légale ne subordonne la validité de l’action intentée par le gérant d’affaires à l’acceptation des débats par le tiers contre lequel cette action est exercée ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l’arrêt rendu, le 17 juin 1980, par la Cour d’appel de Bordeaux ;
|
- Tempérament
- Dans un arrêt du 9 mars 1982 est venue préciser la solution retenue un an plus tôt en affirmant que « les règles de la gestion d’affaires ne pouvaient avoir pour conséquence de contraindre le tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d’affaires » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1982, 80-16.163).
- Ainsi, le gérant n’est autorisé à représenter le maître de l’affaire en justice qu’à la condition que la partie adverse ne s’y oppose pas.
- La Cour de cassation a renouvelé sa position dans un arrêt du 27 octobre 2004 (Cass. 3e civ. 27 oct. 2004, n°03-15.029)
- Cette solution se justifie par le risque encouru par cette dernière qui, si elle obtenait gain de cause, pourrait voir la décision rendue à son profit remise en cause par le maître de l’affaire, celui-ci arguant, à juste titre, d’un défaut de qualité à agir du gérant.
- À cet égard, il peut être observé que l’article 125 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
- Si donc le juge dispose du pouvoir de relever d’office le défaut de qualité à agir, il s’agit là d’une simple faculté et non d’une obligation, comme c’est le cas pour les fins de non-recevoir qui présentent un caractère d’ordre public, soit lorsque notamment elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
- Pour cette raison, il n’est pas exclu qu’un tiers puisse représenter autrui en justice sous couvert de la gestion d’affaires.
|
Cass. 3e civ. 27 oct. 2004
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e (le syndicat) et divers copropriétaires dont Mme X…, qui se présente comme gérante d’affaires de son vendeur, les époux Y…,ont assigné en réparation de désordres causés à leur immeuble lors d’une opération de construction voisine, deux entreprises intervenantes la société Lanctuit et la société Solétanche, aux droits desquelles sont, respectivement, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Solétanche-Bachy ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1372 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions du contrat de vente de l’appartement aux époux Y…, soulevée par la société Lanctuit et condamner celle-ci à verser une certaine somme à Mme X…, l’arrêt retient qu’il n’y a pas de préjudice, les travaux de réfection de l’appartement ayant été réalisés par le vendeur, sans quoi Mme X… demanderait l’allocation de l’indemnité pour elle-même et non à titre de “somme devant être reversée aux vendeurs”, qu’en revanche, les conditions de la gestion d’affaires de l’article 1372 du Code civil sont réunies dès lors que la copropriétaire précitée ne réclame pas ces sommes en exécution d’une obligation contractuelle, agit volontairement pour le compte d’un tiers, ses vendeurs, et que sa gestion est utile puisqu’elle évite aux bénéficiaires de l’indemnité les désagréments d’un procès ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les règles de la gestion d’affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d’affaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Lanctuit, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à payer à Mme X… la somme de 7 743,69 euros et dit que le montant de cette condamnation est à reverser par celle-ci aux époux Y…, l’arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
|
b. Un acte de gestion licite
Pour que la gestion d’affaires puisse jouer, l’acte accompli par le générant au bénéfice d’autrui doit, a priori, être licite.
Dans un arrêt du 14 juin 1988, la Cour de cassation a, par exemple, jugé que la résiliation fautive d’un contrat d’assurance, alors même que cette résiliation profitait au maître, n’ouvrait pas droit à indemnisation du gérant pour les frais exposés sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 14 juin 1988, n°86-17.428).
Reste que la doctrine reste partagée sur cette question en l’absence de référence du Code civil à l’exigence de licéité de l’acte accompli par le gérant.
À cet égard, la jurisprudence ne répugnera pas à admettre qu’il puisse être recouru à la gestion d’affaires pour couvrir une opération de réparation urgente conduite par le gérant dans un immeuble dont est propriétaire le maître de l’affaire bien que cet acte implique une violation du domicile.
Aussi, l’exigence tenant à la licéité de l’acte de gestion pourra parfaitement être écartée par le juge s’il estime que l’utilité de cet acte justifiait qu’il soit porté atteinte à une règle légale ou contractuelle.
2. Utilité des actes de gestion
Pour que la gestion d’affaire puisse jouer, il ne suffit pas que celui qui est intervenu ait agi dans l’intérêt d’autrui, il faut encore que l’acte de gestion qu’il a accompli ait été utile.
À cet égard, l’article 1301 du Code civil précise que l’affaire doit avoir été gérée « utilement », condition qui était déjà posée par l’ancien article 1375 qui exigeait une bonne administration de l’affaire.
Cette exigence posée par le texte vise à dissuader les interventions intempestives. Plus précisément, elle vise à obliger le gérant à n’accomplir que des actes strictement nécessaires, soit ceux qui sont opportuns.
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « gestion utile ». Comment doit-on apprécier le respect de cette exigence ?
a. Les critères d’appréciation de l’utilité de la gestion
Plusieurs critères d’appréciation ont été posés par la jurisprudence :
?Premier critère : une appréciation au jour de l’intervention
Il est constant en jurisprudence que l’utilité de l’acte de gestion s’apprécie, non pas au moment où le gérant formule une demande d’indemnisation mais à la date de son intervention (V. en ce sens Cass. civ. 28 oct. 1942).
Autrement dit, il est indifférent que l’intervention se soit finalement avérée inutile lorsque le gérant sollicite à être remboursé des frais qu’il a exposés, pourvu que cette intervention ait été utile au moment où il a agi.
Si, par exemple, le gérant entreprend de porter secours à une personne en péril et que, finalement, cette personne décède des suites de ses blessures, il pourra malgré tout solliciter une indemnisation.
C’est là, manifestement, une différence avec l’enrichissement injustifié qui suppose un enrichissement définitif du débiteur de l’obligation d’indemnisation.
?Deuxième critère : une appréciation subjective
- Principe
- La question s’est posée de savoir si l’utilité de l’acte de gestion devait s’apprécier au regard de ce que l’individu moyen aurait estimé comme étant nécessaire ou si elle devait s’apprécier au regard de la croyance raisonnable de celui qui est intervenu.
- À cette question, la jurisprudence a répondu en optant pour la seconde option.
- Autrement dit, c’est une approche subjective qui a été retenue l’utilité de l’acte de gestion devant être appréciée en se reportant aux circonstances dans lesquelles se trouvaient le gérant et à ce qu’il était raisonnablement en droit de considérer comme utile au moment où il est intervenu (V. en ce sens Cass. com. 12 janv. 1999, n°96-11.026).
- Tempérament
- Par exception, l’utilité de l’acte de gestion s’apprécie de manière objective lorsque le gérant est intéressé à l’opération.
- Lorsque donc, sont intervention n’est pas totalement altruiste, son utilité sera appréciée en se reportant au modèle du bon père de famille.
- L’acte accompli était-il objectivement utile et nécessaire ? Tel est la question que se posera le juge pour déterminer si la condition d’utilité est bien remplie.
- La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 31 janvier 1995 en refusant à un généalogiste le bénéfice de la gestion d’affaires, au motif que les diligences accomplies n’étaient pas utiles.
- Dans cette affaire, la première chambre civile a jugé que si le généalogiste qui, dans le cadre de son activité professionnelle était parvenu à découvrir les héritiers d’une succession, a rendu service à l’héritier, il ne pouvait néanmoins pas prétendre, en l’absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux sur le fondement de la gestion d’affaires, dès lors que l’héritier auquel la succession a été révélée n’avait nullement besoin d’attendre la révélation que le généalogiste lui promettait pour s’adresser directement au notaire de la succession, même si ses liens avec le de cujus étaient distendus dans les derniers temps (Cass. 1ère civ. 31 janv. 1995, n° 93-11.974).
?Troisième critère
- Principe
- L’utilité de l’acte de gestion n’est pas subordonnée au résultat obtenu par le gérant, en ce sens qu’il est indifférent que son intervention aboutisse à un résultat positif.
- Si donc, il entreprend d’éteindre un incendie et qu’il n’y parvient pas, cette circonstance ne fera pas obstacle à l’exercice de son droit à indemnisation.
- Ce qui importe ce n’est pas le résultat obtenu, mais le résultat escompté pourvu que l’intervention ait été opportune (Cass. 1ère civ. 25 nov. 2003, n°02-14.545).
- Exception
- Lorsque l’intervention du gérant est intéressée, le juge retiendra pour apprécier l’utilité de l’acte de gestion, non plus le résultat recherché, mais le résultat obtenu.
- Si donc, l’intervention du gérant se traduit par un échec, il ne pourra pas solliciter une indemnisation au titre de la gestion d’affaires (Cass. 1ère civ. 15 mai 1974, n°72-11.417).
- Il devra supporter le coût de son intervention.
- En cas de préjudice causé à celui dans l’intérêt duquel il est intervenu, il est, en outre, susceptible d’engager sa responsabilité, son intervention pouvant être jugée comme intempestive.
- Seule option qui s’offre au gérant pour être indemnisé, faute de démontrer l’utilité de son intervention, obtenir du maître de l’affaire, conformément à l’article 1301-3 du Code civil, qu’il ratifie les actes accomplis dans son intérêt.
b. L’indifférence de l’urgence de l’accomplissement d’actes de gestion
Certains auteurs se sont demandé si, pour être utile, l’acte de gestion devait répondre à un impératif d’urgence.
Si, le plus souvent, l’urgence est l’élément déterminant qui guide la démarche du gérant, reste que, à l’examen, il ne s’agit pas d’une condition de la gestion d’affaires.
L’article 1301 du Code civil exige seulement que l’intervention du gérant soit utile, c’est-à-dire qu’elle soit opportune eu égard les circonstances.
Aussi, lorsque les juridictions se réfèrent à l’urgence pour apprécier l’utilité de l’acte de gestion, ils ne peuvent fonder leur décision sur ce seul critère. L’urgence ne se confond pas à l’utilité, elle est un élément parmi d’autres qui permet de la caractériser.
À cet égard, il est parfaitement possible d’envisager que l’intervention du gérant puisse être utile pour le maître de l’affaire, sans pour autant qu’elle soit urgente. En pareille hypothèse, la gestion d’affaires pourra jouer.
II) Les effets de la gestion d’affaires
À titre de remarque liminaire il peut être observé que la gestion d’affaires ne produit ses effets qu’à la condition que le maître de l’affaire n’ait pas ratifié les actes de gestion accomplis par le gérant.
En effet, l’article 1301-3 du Code civil prévoit que « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. ».
Aussi, en cas de ratification, l’intervention du gérant est régie par les règles du mandat qui se substituent à celles de la gestion d’affaires.
À l’instar des autres quasi-contrats, la gestion d’affaires n’a vocation à jouer qu’à titre subsidiaire, soit lorsqu’aucune autre règle n’est susceptible de jouer.
A) Les effets de la gestion d’affaires entre le gérant et le maître
Lorsque le maître recouvre la faculté de pourvoir lui-même à la conduite de ses affaires, deux situations sont susceptibles de se présenter :
- Première situation
- Il apparaît que les conditions de la gestion d’affaires ne sont pas réunies, de sorte qu’elle ne pourra pas produire ses effets
- Tout n’est cependant pas perdu pour le gérant.
- L’article 1301-5 du Code civil prévoit, en effet, que « si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. »
- C’est donc sur le terrain de l’enrichissement que le gérant devra se situer
- L’indemnisation qu’il pourra solliciter du maître sera toutefois moindre.
- En application de l’article 1303 du Code civil, l’appauvri ne peut percevoir qu’« une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
- C’est donc un double plafond qui est institué par la loi, double plafond qui n’est pas prévu en matière de gestion d’affaires.
- Seconde situation
- Les règles de la gestion d’affaires sont réunies, ce qui nous conduit à distinguer deux sous-hypothèses :
- Première sous-hypothèse
- Le maître de l’affaire prend acte des diligences accomplies par le gérant dans son intérêt, sans pour autant ratifier la gestion faite.
- Dans cette configuration, ce sont les règles de la gestion d’affaires qui ont vocation à régir les rapports entre les quasi-parties.
- Seconde sous-hypothèse
- Le maître de l’affaire prend la décision de ratifier la gestion effectuée par le gérant.
- Ce sont alors les règles du mandat qui vont régler les rapports entre les quasi-parties qui, sans devenir l’une pour l’autre des parties à un contrat, vont être assujettis aux mêmes effets
- Selon que l’on se trouve dans l’une ou l’autre situation, les obligations qui pèsent sur les quasi-parties ne sont pas les mêmes, à tout le moins diffèrent sur un certain nombre d’aspects.
1. Les obligations des quasi-parties en l’absence de ratification de la gestion
1.1. Les obligations du gérant
L’article 1301-1 du Code civil prévoit que le gérant « est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
Il ressort de cette disposition qu’il y a lieu de se reporter aux dispositions qui régissent le mandat pour déterminer les obligations qui pèsent sur le gérant de l’affaire.
Ce renvoi est précisé par l’article 1301-1 qui prévoit qu’« il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir. »
À l’examen, ce texte focalise les exigences auxquelles doit répondre le gérant sur les obligations de diligence et de persévérance.
À ces deux obligations, il convient d’en ajouter une dernière qui, si elle n’est pas envisagée par les règles de la gestion d’affaires, pèse néanmoins sur le gérant en application des règles du mandat : il lui échoit de rendre compte de sa gestion auprès du maître de l’affaire.
Au total, trois obligations principales incombent au gérant :
- L’obligation d’agir avec diligence
- L’obligation d’agir avec persévérance
- L’obligation de rendre des comptes
a. L’obligation d’agir avec diligence
i. Principe
L’article 1301-1 du Code civil prévoit que le gérant est tenu « d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ».
Il s’agit là d’une traduction de l’article 1992 du Code civil applicable en matière de mandat qui dispose que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
Ainsi, le gérant est-il tenu d’exécuter sa mission avec diligence, faute de quoi il engage sa responsabilité, y compris lorsqu’il commet une faute d’imprudence ou de négligence.
Le gérant a donc l’obligation de gérer l’affaire d’autrui comme une personne raisonnable, soit, selon l’expression retenue par l’ancien article 1374, al. 1er du Code civil, comme un « bon père de famille ».
Cette obligation de diligence qui pèse sur le gérant implique notamment, s’agissant des sommes d’argent détenues ou à percevoir, qu’il règle les dettes du maître de l’affaire et qu’il recouvre les créances devenues exigibles.
À cet égard, il devra lui restituer les intérêts perçus et, dans l’attente, procéder au placement utile des capitaux collectés.
ii. Tempéraments
Ainsi que le rappelle le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, si le gérant peut, au titre de son obligation de diligence, engager sa responsabilité à l’égard du maître de l’affaire en cas de faute, sa responsabilité peut néanmoins être atténuée.
Cette atténuation de la responsabilité du gérant est susceptible d’intervenir à deux stades :
?Au stade de l’appréciation de la faute
L’article 1992, al. 2e du Code civil prévoit que « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
Ainsi, parce que le gérant est animé par une intention altruiste et que le service rendu à autrui est gratuit, le législateur invite le juge à faire montre de tolérance à l’endroit du gérant quant à l’appréciation de la faute susceptible d’être retenue contre lui.
Elle devra donc être appréciée moins sévèrement que s’il intervenait en qualité de mandataire.
?Au stade de l’indemnisation du gérant
L’article 1301-1, al. 2e du Code civil prévoit que « le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. »
Le juge est ainsi investi d’un pouvoir de modération qui lui permettra d’atténuer les conséquences de la responsabilité du gérant.
À l’examen, il s’agit là d’une exception au principe de réparation intégrale du préjudice qui régit le droit de la responsabilité.
Cette exception se justifie là encore par l’altruisme qui a guidé, au moins pour partie, l’intervention du gérant, altruisme qui mérite a minima quelque indulgence de la part du juge.
La Cour de cassation a, par exemple, validé l’usage de cette faculté dans un arrêt du 3 janvier 1985.
- Faits
- Dans cette affaire la cliente d’un supermarché a oublié son sac à main, qui contenait des objets de valeur, dans le chariot qu’elle utilisait en faisant ses achats.
- Ce sac a été trouvé par deux inconnus qui l’ont remis à une préposée aux renseignements dans le magasin, laquelle l’a ouvert, a ainsi identifié sa propriétaire et l’a vainement appelée par haut-parleur, cette dernière ayant quitté les lieux.
- Peu après, s’étant ravisés, les inconnus qui avaient remis leur trouvaille à la préposée du magasin sont revenus auprès d’elle et, sans qu’elle ait même pu s’assurer de leur identité, ont repris d’autorité le sac à main en déclarant qu’ils se chargeaient de le remettre à son propriétaire.
- Ils ne lui ont toutefois jamais restitué son sac, ce qui a conduit la cliente à assigner le magasin en responsabilité.
- Procédure
- Par un arrêt du 3 janvier 1985, la Cour d’appel de Chambéry n’a retenu qu’une responsabilité partielle du magasin au motif que la demanderesse « n’avait pas apporté à son sac à main, dont elle n’ignorait ni la valeur, ni le contenu, toute l’attention qu’il méritait et que sa négligence est à l’origine du préjudice qu’elle a subi ».
- Moyens
- La propriétaire du sac a formé un pourvoi en cassation en soutenant notamment que l’intervention de la préposée du magasin s’inscrivait dans le cadre, non pas d’une gestion d’affaires, mais de la conclusion d’un contrat de dépôt.
- Or en la matière, l’obligation de restituer la chose, objet du dépôt, est de résultat.
- Décision
- Par un arrêt du 3 janvier 1985, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la cliente.
- Au soutien de sa décision elle affirme, après avoir validé la qualification de gestion d’affaires de l’intervention de la préposée du magasin, que si les juges du second degré ont accordé à la cliente des dommages et intérêts modérés en réparation de son préjudice « ils y étaient autorisés par l’article 1374, 2eme alinéa du code civil » (Cass. 1ère civ. 3 janv. 1985, n° 83-13.359)
b. L’obligation d’agir avec persévérance
L’article 1301-1 du Code civil prévoit que le gérant « doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ».
Ainsi pèse sur le gérant une obligation de persévérance en ce sens qu’il doit mener à bien jusqu’au bout les actions qu’il a entreprises dans l’intérêt du maître de l’affaire, à tout le moins tant que celui-ci n’est pas en capacité d’y pourvoir lui-même.
C’est là une différence fondamentale avec le mandat qui, en application de l’article 2007 du Code civil, autorise le mandataire à y renoncer à tout moment.
L’objectif recherché par le législateur, s’agissant de la gestion d’affaires, est de dissuader toute intervention du gérant qui serait appréhendée avec légèreté.
Lorsqu’il décide d’agir en s’immisçant dans les affaires d’autrui, il doit assumer les conséquences de ses agissements, ce qui suppose qu’il persévère dans son action.
Ce devoir de persévérance qui pèse sur le gérant implique deux obligations :
i. Une obligation d’assurer la prise en charge de toutes les dépendances de l’affaire
L’ancien article 1372 du Code civil prévoyait que le gérant devait se charger de toutes les dépendances de l’affaire.
Par dépendance, il faut entendre ses accessoires, soit tous les actes connexes et complémentaires que requiert la gestion de l’affaire.
Il pourra s’agir, par exemple, s’agissant du recouvrement d’une créance pour le gérant de s’occuper de la perception accessoire des intérêts produits par cette créance.
Bien que cette obligation ne soit pas expressément visée par les nouveaux textes adoptés dans le cadre de la réforme des obligations, les auteurs s’accordent à dire qu’elle n’a nullement été abandonnée par le législateur.
ii. Une obligation de conduire la gestion de l’affaire jusqu’à son terme
?Principe
Le devoir de persévérance implique que le gérant conduise la gestion de l’affaire jusqu’à son terme, lequel terme survient lorsque le maître de l’affaire est en capacité d’y pourvoir lui-même.
Tant que cette condition expressément posée par l’article 1301-1 du Code civil n’est pas remplie, le gérant doit poursuivre la gestion qu’il a engagée.
Il ne saurait y renoncer, y compris en cas de décès du maître de l’affaire.
L’ancien article 1373 prévoyait en ce sens que le gérant « il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l’affaire soit consommée, jusqu’à ce que l’héritier ait pu en prendre la direction. »
Le nouveau texte fait désormais référence au successeur du maître de l’affaire, étant précisé qu’il y a lieu d’assimiler au décès tous les cas où le maître de l’affaire se trouve dans l’incapacité juridique de pourvoir lui-même à son affaire (absence, disparition, tutelle, curatelle, procédure collective etc.).
C’est là une autre différence avec le mandat qui, en application de l’article 2003 du Code civil, prend immédiatement fin à la mort du mandant, sauf à ce que, comme le précise l’article 1991, al. 2e, il y ait « péril en la demeure ».
Tel n’est pas le cas de la gestion d’affaires qui se poursuit tant qu’aucun successeur du maître ne s’est manifesté.
La raison en est que le mandat procède de la conclusion d’un contrat et que la mort est une cause d’extinction de ce contrat et, par voie de conséquence, de toutes les obligations qui y sont attachées.
Parce que l’obligation qui incombe au gérant au titre de la gestion d’affaires ne peut pas peser sur lui indéfiniment, il pourra saisir le juge aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire, faute de manifestation d’un successeur au maître de l’affaire.
?Tempéraments
Le gérant d’affaire est autorisé à se soustraire à son obligation de persévérance dans deux cas :
- Premier cas
- L’exécution de son obligation de poursuite de la gestion serait de nature à lui causer un préjudice
- C’est là une application de l’article 2007 du Code civil qui prévoit, s’agissant de la renonciation du mandataire à son mandat que « si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable ».
- Dans cette hypothèse, le gérant n’est plus tenu de poursuivre la conduite de l’affaire.
- Il lui faudra néanmoins justifier de la menace d’un préjudice l’autorisant à s’exonérer de sa responsabilité.
- Second cas
- Le gérant est autorisé à renoncer à la gestion de l’affaire en cas de survenance d’un cas de force majeure.
- Il y a là une circonstance qui viendrait rompre la causalité entre la faute d’abstention susceptible de lui être reprochée et le préjudice causé au maître de l’affaire.
- En l’absence de lien de causalité entre ces deux éléments, la responsabilité du gérant ne pourrait donc pas être recherchée.
c. L’obligation de rendre des comptes
Bien qu’aucun texte n’envisage l’obligation pour le gérant de rendre des comptes sur son action au mandataire, cette obligation s’infère de l’article 1993 du Code civil applicable au mandat.
Ce texte prévoit, en effet, que « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Cette obligation se retrouve plus généralement pour tout contrat ou tout dispositif légal qui vise à organiser l’administration des affaires d’autrui et notamment en matière de tutelle, de curatelle ou encore de contrat de dépôt.
Si, la reddition des comptes est, en l’absence de forme particulière imposée par les textes, purement amiable, elle peut devenir judiciaire en cas de contestation d’actes de gestion accomplis par le gérant.
En toute hypothèse, sauf à ce que le gérant soit empêché de rendre des comptes par un cas de force majeure, le gérant engage sa responsabilité s’il se soustrait à son obligation.
Il est indifférent que le maître de l’affaire ait ratifié la gestion qui lui est présentée, la ratification ayant pour effet de transformer la gestion d’affaires en mandat et donc d’assujettir directement le gérant à l’article 1993 du Code civil.
?Les obligations tenant à la reddition des comptes
En application de l’article 1993 du Code civil, deux obligations pèsent sur le gérant de l’affaire au titre du devoir de rendre des comptes :
- Obligation pour le gérant de renseigner le maître sur la conduite de sa gestion
- Il s’agit ici pour le gérant de renseigner le maître de l’affaire sur tous les actes qu’il a accomplis dans son intérêt et de ceux qui doivent être réalisés dans le prolongement de son action.
- Autrement dit, il conviendra de dresser un état des lieux de la situation passée, présente et à venir et, éventuellement, d’alerter le maître sur les points de vigilance des opérations en cours.
- L’exécution de cette obligation pourra se traduire par la fourniture de notes, livres ou journaux relatifs à la conduite de la gestion.
- Obligation pour le gérant de restituer au maître tout ce qu’il a reçu
- L’article 1993 exige du mandataire qu’il restitue au mandant tout ce qu’il a reçu dans le cadre de sa mission, soit tous les droits et biens qui, s’il n’était pas intervenu, seraient revenus au mandant.
- Cette obligation vaut également pour le gérant auquel il appartient de restituer au maître de l’affaire toutes les valeurs perçues entre ses mains.
- A défaut, il engagerait sa responsabilité, étant précisé que toute contestation pourra donner lieu à une reddition judiciaire des comptes.
- Dans ce cadre, le juge pourra notamment exiger du gérant qu’il produise tous les justificatifs susceptibles d’éclairer le débat sur les actes de gestion contestés.
?L’indivisibilité de la gestion
Les opérations de reddition des comptes conduiront, pratiquement, à établir un compte qui fera état de ce qu’il y a lieu de mettre au crédit et au débit du gérant.
À cet égard, dans un arrêt du 28 février 1910, la Cour de cassation a précisé qu’« une fois l’utilité de la gestion établie et s’agissant d’une seule et même affaire, il n’est pas permis au maître de diviser la gestion, de manière à n’être obligé d’indemniser le gérant de ses dépenses que pour celles des opérations qui lui sont avantageuses et de n’avoir pas à lui rembourser les frais nécessités par celles qui ne le seraient point » (Cass. req. 28 févr. 1910).
Ainsi, n’est-il pas possible pour le maître de l’affaire de faire le tri dans ce qui est mis au crédit et au débit du compte du gérant. Soit il accepte la gestion qui lui est présentée dans son intégralité, ce qui implique qu’il indemnise le gérant pour le tout, soit il la refuse auquel cas il dénie à ce dernier tout droit à indemnisation.
En tout état de cause, il est fait interdiction au maître de l’affaire d’émettre des réserves sur le paiement de tel ou tel frais qui figurent au crédit du gérant. C’est le système du tout ou rien qui s’applique ici.
1.2. Les obligations du maître de l’affaire
L’article 1301-2 du Code civil prévoit que celui dont l’affaire a été utilement gérée « rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. »
Il ressort de cette disposition que, lorsque les conditions de la gestion d’affaires sont réunies, deux obligations pèsent sur le maître à l’égard du gérant :
- D’une part, il doit le rembourser des dépenses qu’il a exposées dans son intérêt
- D’autre part, il doit l’indemniser des pertes éventuellement subies
Ces deux obligations sont les éléments centraux de la gestion en ce qu’elles traduisent son objectif premier : rétablir un équilibre patrimonial rompu.
L’intervention du gérant est, effectivement, susceptible d’avoir eu pour effet de l’appauvrir, tandis que le maître de l’affaire s’est enrichi.
Aussi, y a-t-il lieu de rétablir l’équilibre en mettant à la charge de ce dernier ces deux obligations que sont celles de remboursement et d’indemnisation du gérant dont le patrimoine a été affecté par son intervention.
Lorsque néanmoins l’intervention du gérant n’était pas totalement altruiste et qu’il avait un intérêt personnel à agir, une ventilation du coût de cette intervention devra être faite à due proportion entre les quasi-parties.
a. L’obligation de remboursement
i. Sur le principe du remboursement
?Un remboursement limité aux dépenses effectuées dans l’intérêt du maître
L’article 1301-2 du Code civil prévoit que le maître de l’affaire doit rembourser au gérant « les dépenses faites dans son intérêt »
La formulation retenue par le législateur n’est pas neutre. Il s’infère, en effet, du texte que si le gérant doit être remboursé des dépenses qu’il a exposées à l’occasion de sa gestion, ce remboursement ne pourra porter que sur une catégorie spécifique de dépenses : celles réalisées dans l’intérêt du maître de l’affaire.
On doit, autrement dit, comprendre que les dépenses qui n’auraient pas été exposées dans l’intérêt de ce dernier n’ont pas vocation à être remboursées au gérant.
Toute la question est alors de savoir ce que l’on doit entendre par dépenses faites dans l’intérêt du gérant.
Sous l’empire du droit antérieur, l’article 1375 du Code civil visait les dépenses « utiles et nécessaires ». Le changement de vocable opéré par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations est sans incidence sur le périmètre des dépenses qui donnent lieu à remboursement.
Il s’agissait pour le législateur de lever une ambiguïté soulevée par l’interprétation de la conjonction de coordination « ou ». Devait-on inclure dans la catégorie des dépenses éligibles à un remboursement les dépenses utiles et nécessaires ou pouvait-on également y faire figurer celles qui étaient, soit seulement utiles, soit seulement nécessaire. La jurisprudence avait opté pour la seconde interprétation.
Quoi qu’il en soit, désormais, dès lors que la dépense est exposée dans l’intérêt du maître de l’affaire, elle doit donner lieu à remboursement. Il suffit donc qu’elle ait été utile pour faire partie de cette catégorie de dépenses.
A contrario, il est admis que les dépenses dites voluptuaires ou de pur agrément n’ouvrent pas droit à remboursement pour le gérant qui devra supporter le coût définitif de la dépense (V. en ce sens Cass. 3e civ. 17 janv. 1990, n°88-17.319).
?Un remboursement exclusif de toute rémunération
Il peut être observé que le droit au remboursement du gérant est exclusif de toute rémunération.
Cela signifie, autrement dit, qu’il est fait interdiction au gérant de facturer au maître de l’affaire le coût d’une prestation, y compris lorsque la gestion est assurée par un professionnel (V. en ce sens Cass. com. 15 déc. 1992, n°90-19.608)
La gestion d’affaires ne se conçoit que si le gérant soit animé d’une intention altruiste. Si, dès lors, l’on admettait qu’il soit fondé à solliciter une rémunération pour sa gestion, cela reviendrait à porter atteinte au principe même sur lequel repose ce mécanisme juridique.
Pis, cela serait de nature à favoriser les interventions intempestives de tiers dans les affaires d’autrui, car pouvant donner lieu à rémunération.
Pour l’heure, la position de la jurisprudence n’a pas changé : elle demeure hostile à toute rémunération du gérant.
Si cette règle était expressément formulée dans l’avant-projet Catala, elle n’a pas été reprise par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme des obligations.
Quel enseignement peut-on tirer de ce silence ? Difficile à dire tant que la Cour de cassation ne s’est pas prononcée. Reste qu’il serait difficilement compréhensible qu’elle opère, sur cette question, un revirement de jurisprudence, compte tenu de l’économie générale de l’institution qu’est la gestion d’affaires.
ii. Sur le montant du remboursement
Il ressort de l’article 1301-2 du Code civil que le maître de l’affaire doit rembourser, non seulement le montant en principal de la dépense, mais encore les intérêts produits
- Le remboursement de la dépense en principal
- La somme à rembourser au gérant correspond à la valeur nominale de la dépense exposée (Cass. com. 3 févr. 2011, n°10-30.093)
- Autrement dit, pour déterminer cette somme il convient de se situer, non pas au jour du remboursement, mais à la date de réalisation de la dépense.
- Le montant de la dépense ne donne donc pas lieu à actualisation, ce qui, en cas de fluctuation monétaire, est susceptible de préjudicier à l’une ou l’autre partie.
- Le remboursement des intérêts
- L’article 1301-2, al. 3e du Code civil prévoit que « les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. »
- Il s’agit là manifestement d’une codification de la jurisprudence qui, très tôt, s’était prononcée en ce sens en décidant que non seulement le gérant avait droit au paiement des intérêts produits par les avances consenties, mais encore que le point de départ du calcul de ces intérêts devait être, non pas comme le prévoit le droit commun le jour de la demande de remboursement, mais la date à laquelle la dépense a été exposée (Cass. civ. 20 mars 1900).
- C’est là une solution particulièrement avantageuse pour le gérant qui s’inspire de la règle posée à l’article 2001 du Code civil applicable en matière de mandat.
- Ce traitement de faveur du gérant vise ici encore à récompenser son altruisme
b. L’obligation d’indemnisation
En application de l’article 1301-2 du Code civil, la gestion d’affaires n’ouvre pas seulement droit pour le gérant au remboursement des dépenses exposées dans l’intérêt du maître de l’affaire, elle lui confère également le droit à être indemnisé « des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion ».
Là encore, cette règle s’inspire directement de celle qui existe en matière de mandat, l’article 2000 du Code civil prévoyant que « le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »
Pour ouvrir droit à indemnisation au titre de la gestion d’affaires, le dommage subi par le gérant peut consister, tout aussi bien en un préjudice matériel que corporel (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955), étant précisé que c’est à lui qu’il revient de rapporter la preuve de son préjudice.
Par analogie avec le mandat, seule l’imprudence grave du gérant est susceptible de faire échec à son droit à indemnisation.
Dans un arrêt du 25 juin 2002, la Cour de cassation a ainsi débouté un gérant d’affaire de sa demande d’indemnisation de son préjudice subi dans le cadre de son intervention au motif qu’il avait « commis une faute lourde d’imprudence à l’origine de ses blessures », faute qui « constituait la cause exclusive de son dommage » (Cass. 1ère civ. 25 juin 2002, n°00-14.332).
À cet égard, dans un arrêt du 16 novembre 1955, la Cour de cassation a admis que les ayants cause du gérant étaient fondés à solliciter la réparation d’un préjudice par ricochet (Cass. 1ère civ. 16 nov. 1955).
La question se pose néanmoins du fondement de leur action. Est-ce une action autonome fondée sur la responsabilité délictuelle et qui donc suppose la réunion des conditions propre à ce régime de responsabilité, ou est-ce une action fondée sur la gestion d’affaires, ce qui implique qu’elle soit caractérisée ?
À l’examen, cette question n’a pas encore été clairement tranchée par la Cour de cassation. Quant à la doctrine, d’aucuns plaident en faveur de la reconnaissance à la victime par ricochet d’un droit personnel à réparation.
c. La répartition du coût de l’intervention entre les quasi-parties
L’article 1301-4 du Code civil prévoit que si l’’intérêt personnel du gérant à se charger de l’affaire d’autrui n’exclut pas l’application des règles de la gestion d’affaires, il n’en reste pas moins que cette circonstance doit être prise en compte quant au droit du gérant à être remboursé et indemnisé.
Aussi, ce texte prévoit-il, en son second alinéa, que « dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l’affaire commune. »
Il ressort de cette disposition que lorsque l’intervention du gérant n’est pas totalement désintéressée, il devra supporter une partie du coût définitif des actions réalisées.
Cette réparation se fait à due proportion des intérêts de chaque quasi-partie dans l’affaire, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés d’évaluation lors du règlement des comptes.
2. Les obligations des quasi-parties en présence d’une ratification de la gestion
L’article 1301-3 du Code civil prévoit que « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. »
La ratification a ainsi pour effet de transformer, rétroactivement, la gestion d’affaires en mandat et, par voie de conséquence, d’assujettir les quasi-parties aux obligations attachées à ce type de contrat.
Classiquement, elle se définit comme l’acte par lequel le maître de l’affaire approuve, a posteriori, les actes accomplis dans son intérêt et pour son compte par un tiers.
L’intérêt de la ratification réside dans son effet réparatoire, sinon expiatoire en ce sens qu’elle permet de couvrir des irrégularités qui feraient obstacle à l’application des règles de la gestion d’affaires (V. en ce sens Cass. soc. 11 juill. 1946).
Lorsque, en revanche, les conditions de la gestion d’affaires sont réunies, la ratification ne présente guère d’intérêt dans la mesure où elle produit sensiblement les mêmes effets que le mandat.
Reste que pour que cette ratification opère, un certain nombre de conditions doivent être réunies.
?Les conditions de la ratification
L’efficacité de la ratification est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
- La capacité de contracter du maître
- Pour pouvoir ratifier la gestion réalisée par le gérant, encore faut-il que le maître de l’affaire soit en capacité – juridique – de contracter.
- Il ne doit donc pas être frappé d’une incapacité telle qu’une tutelle ou une curatelle.
- Le consentement du maître
- La ratification ne pourra opérer que si le maître a exprimé sa volonté de s’obliger.
- L’expression de son consentement peut être expresse ou tacite, pourvu qu’elle ne soit pas équivoque (V. en ce sens Cass. com. 13 mai 1980).
- En toute hypothèse, le consentement du maître doit avoir été donné en toute connaissance de cause, tel que rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 décembre 1981 (Cass. 1ère civ. 22 déc. 1981, n°80-15.451).
- L’accomplissement d’actes juridiques
- La ratification ne peut opérer que si les actes accomplis par le gérant sont juridiques.
- S’il n’a fait qu’accomplir des actes purement matériels, la ratification sera sans effets, le mandat ne pouvant porter que sur des actes juridiques.
- L’indifférence du caractère intéressé de l’intervention du gérant
- La jurisprudence considère que la ratification peut opérer nonobstant l’intervention intéressée du gérant.
- Seule condition posée par les juridictions dans cette hypothèse : il doit être établi que le gérant était animé par la volonté de gérer l’affaire d’autrui et que cette gestion n’est pas une conséquence secondaire de la conduite de ses propres affaires
- La ratification ne peut ainsi jamais couvrir l’absence de volonté du gérant de gérer les affaires du maître.
?Les effets de la ratification
Ainsi que le prévoit l’article 1301-3 du Code civil, « la ratification de la gestion par le maître vaut mandat. »
La règle n’est pas nouvelle, elle était déjà connue du droit romain, sous la formule « rathihabitio mandato comparatur ».
À l’examen, il ne s’agit pas là de transformer la gestion d’affaires en contrat, faute d’échange des consentements initial, mais seulement de lui faire produire les effets d’un contrat et plus particulièrement ceux du mandat.
Ce faisant, la ratification, et c’est là tout son intérêt, emporte couverture de toutes les irrégularités qui affectaient la gestion d’affaires.
Il est dès lors indifférent, en pareil cas, que ses conditions de mise en œuvre ne soient pas réunies, puisque la ratification pallie cette défaillance.
À cet égard, la ratification opère rétroactivement, de sorte que tous les actes accomplis par le gérant sont réputés avoir été accomplis par lui en qualité de mandataire (V. en ce sens Cass. civ. 2 févr. 1857).
Quant au maître de l’affaire il est réputé avoir donné mandat au gérant dès l’origine de son intervention.
La rétroactivité de la ratification demeure néanmoins à relativiser dans la mesure où elle est inopposable aux tiers, à tout le moins elle est insusceptible de porter atteinte à leurs droits.
B) Les effets de la gestion d’affaires à l’égard des tiers
Parce que le gérant peut, à l’occasion de sa gestion, avoir été amené à accomplir des actes impliquant des tiers, se pose la question des effets de la gestion d’affaires à leur endroit.
À cet égard, l’article 1301-2 du Code civil prévoit que « celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. »
Ainsi, dès lors que le gérant a agi dans l’intérêt du maître, ce dernier devient personnellement engagé à l’égard des tiers.
Cet engagement doit néanmoins être envisagé différemment, selon que le gérant a agi en représentation du maître ou en dehors de toute représentation.
1. Le gérant a agi en représentation du maître
Dans l’hypothèse où le gérant a agi en représentation du maître, celui-ci est seul engagé à l’égard des tiers.
Le nouvel article 1301-2 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 suggère qu’il est désormais indifférent que cette représentation soit parfaite ou imparfaite.
Pour mémoire :
- La représentation parfaite correspond à l’hypothèse où le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté (art. 1154, al. 1er C. civ.)
- Il en résulte que le représenté est seul tenu à l’engagement ainsi contracté.
- Autrement dit, il est réputé avoir accompli personnellement l’acte conclu par le représentant.
- Celui qui est considéré comme partie au contrat c’est donc le représenté
- En cas d’inexécution contractuelle, c’est la responsabilité de ce dernier qui sera recherchée et non celle du représentant qui n’est pas tenu au contrat puisque considéré comme un tiers.
- La représentation imparfaite correspond à l’hypothèse où le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom (art. 1154, al. 2e C. civ.)
- La conséquence en est qu’il devient seul engagé à l’égard du cocontractant.
- Celui qui est réputé être partie à l’acte ce n’est donc pas le représenté, comme en matière de représentation parfaite, mais le représentant qui endosse les qualités de créanciers et débiteurs.
En matière de gestion d’affaires, dès lors que le gérant a déclaré aux tiers qu’il agissait pour le compte du maître, celui-ci doit remplir les engagements contractés pour lui, peu importe que ces engagements aient été souscrits au nom du gérant.
Sous l’empire du droit antérieur, tel n’était pas le cas dans la mesure où seuls les engagements souscrits au nom du maître l’obligeaient envers les tiers.
Aujourd’hui, ce qui importe c’est que les engagements aient été souscrits dans l’intérêt du maître.
Du point de vue des tiers, deux situations doivent néanmoins être distinguées :
- Les engagements ont été souscrits au nom et pour le compte du maître
- Dans cette hypothèse, la représentation étant parfaite, ils ne disposeront d’un recours qu’à l’encontre du maître.
- Il s’agit là d’une application stricte de la règle posée à l’article 1154, al. 1er du Code civil.
- Aussi, les tiers ne pourront pas actionner en paiement le gérant qui est regardé comme un mandataire, soit comme une personne qui n’est débitrice d’aucune obligation envers eux
- À l’égard des tiers, le gérant est tout au plus tenu envers eux de répondre des préjudices qu’il est susceptible de leur causer dans le cadre de l’exercice de sa mission.
- Les engagements ont été souscrits au nom du gérant et pour le compte du maître
- Dans cette hypothèse, en application des règles de la représentation imparfaite, les tiers ne devraient pouvoir recourir qu’à l’encontre du gérant, conformément à l’article 1154, al. 2e du Code civil.
- L’article 1301-2 laisse néanmoins entrevoir la possibilité pour le tiers d’agir également contre le maître de l’affaire, dès lors que l’engagement pris a été souscrit dans son intérêt
- Sur cette question, la doctrine est partagée et la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’interprétation à donner au texte.
- Seule certitude, bien que l’engagement ait été contracté au nom du gérant, il devra être rempli, in fine, par le maître de l’affaire.
- Aussi en cas d’action en paiement engagée par un tiers à l’encontre du gérant, celui-ci disposera d’un recours contre le maître de l’affaire à qui il appartiendra de le rembourser des sommes versées aux tiers.
2. Le gérant a agi en dehors de toute représentation
Dans l’hypothèse où le gérant a agi en dehors de toute représentation, soit en son nom personnel sans informer les tiers qu’il traitait pour le compte d’autrui, les règles de la représentation légales ne peuvent pas s’appliquer.
Il en résulte que le gérant est seul tenu envers les tiers. Ces derniers ne pourront pas recourir contre le maître qui dont ne sera pas personnellement engagé.
Reste que le gérant disposera d’un recours contre le maitre au titre de la gestion d’affaires, à tout le moins si les conditions de l’article 1301-1 du Code civil sont réunies.
À défaut, l’article 1301-5 du Code civil prévoit que « si l’action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d’affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l’enrichissement injustifié. »
C’est donc sur le terrain de l’enrichissement que le gérant devra se situer. L’indemnisation qu’il pourra solliciter du maître sera toutefois moindre.
Il est, en effet, en application de l’article 1303 du Code civil, l’appauvri ne peut percevoir qu’« une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »
C’est donc un double plafond qui a été institué par le législateur, double plafond qui n’est pas prévu en matière de gestion d’affaires.