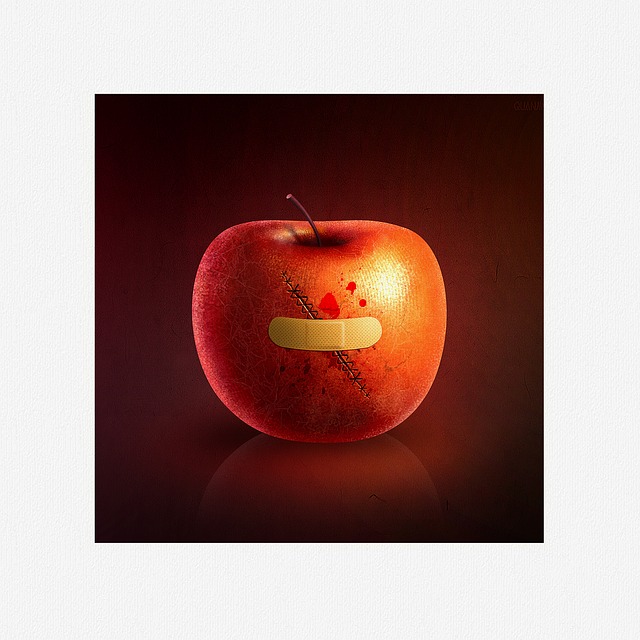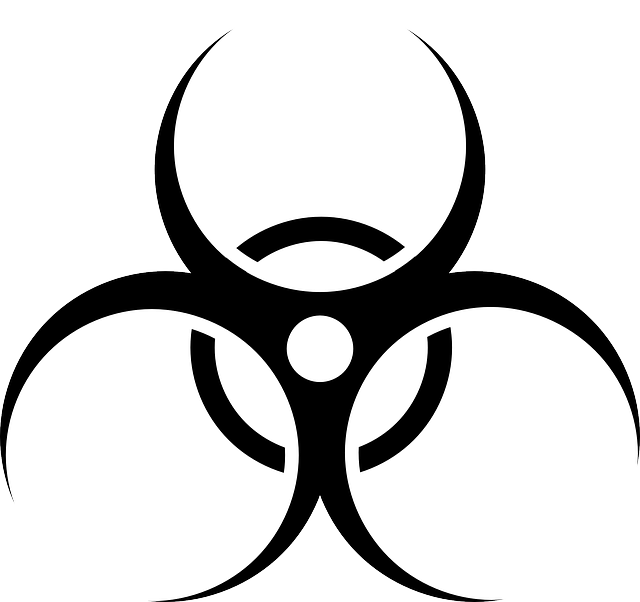Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats
L’éloignement du chef d’entreprise ou des dirigeants de l’association par rapport à l’activité quotidienne exercée par la personne morale a justifié l’aménagement de leur responsabilité pénale par l’article 121-3, al. 4. Elle a également justifié la reconnaissance par le droit pénal de la délégation de pouvoirs. Celle-ci est possible, et paraît même obligatoire[1].
Définition. La délégation de pouvoirs est l’acte juridique par lequel une personne (le délégant) se dessaisit d’une fraction de ses pouvoirs au profit d’une autre personne (le délégataire), le plus souvent l’un de ses subordonnés. Disposant désormais des pouvoirs du délégant, le délégataire encourt les mêmes responsabilités à l’occasion de leur exercice.
Présentation générale. Le mécanisme de la délégation de pouvoirs – et du transfert de responsabilité qu’il implique – est ancien. Il fut accueilli par la jurisprudence au début du XXème siècle[2], à propos de la sécurité au travail. Un salarié fut victime d’un accident du travail à la suite, notamment, d’une violation par l’employeur de ses obligations afférentes à la sécurité des salariés. L’employeur, en raison de son éloignement et de l’objet réel de son activité, était dans l’impossibilité de prévenir la violation des dispositions relatives à la sécurité et d’empêcher la réalisation du dommage. Il fut poursuivi mais prétendit échapper à sa responsabilité en reportant celle-ci sur le responsable du site où eut lieu l’accident.
Le transfert de responsabilité n’est pas évident à apprécier moralement. D’une part, la condamnation du chef d’entreprise semble inopportune ; celui-ci est étranger à l’accident. De l’autre, retenir la responsabilité du chef d’établissement revient à faire supporter par un salarié, subordonné, la responsabilité du dirigeant. La jurisprudence s’est peu à peu fixée de manière pragmatique sur une idée simple : la responsabilité pénale pèse sur celui qui est en mesure d’éviter la réalisation du dommage, pourvu qu’il soit effectivement en mesure d’observer la loi pénale. Le chef d’entreprise est donc responsable, sauf s’il a consenti une délégation de pouvoirs à une personne disposant des moyens intellectuels, juridiques et matériels propres à éviter la commission des infractions. La délégation de pouvoirs est licite mais strictement encadrée[3].
Le domaine de la délégation de pouvoirs
La délégation de pouvoirs ne produit ses effets qu’en matière de responsabilité pénale, mais s’applique à tous types d’infractions, pourvu que le dirigeant n’ait pas personnellement pris part à la commission de celles-ci et pourvu que les pouvoirs délégués ne relèvent pas de l’essence de la qualité de dirigeant.
Un domaine cantonné à la responsabilité pénale.
La délégation de pouvoirs n’a d’efficacité qu’en matière de responsabilité pénale, à l’exclusion de la responsabilité civile. Elle ne saurait avoir pour effet transférer la responsabilité civile du délégant sur la personne et le patrimoine du délégataire. La règle est de peu de portée pratique à l’égard du dirigeant puisque celui-ci n’est pas personnellement responsable civilement à l’égard de la victime, du moins lorsqu’il n’a pas causé lui-même directement le dommage[4].
Un domaine ouvert à tous types d’infractions.
Principe. La délégation de pouvoirs produit principalement ses effets à propos de la responsabilité pénale encourue à l’occasion d’un dommage corporel subi par un salarié. Rien n’interdit cependant qu’elle protège le dirigeant dans d’autres circonstances. Depuis 1993, elle s’étend à tous les domaines du droit pénal : « sauf si la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise, qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires »[5]. Aussi la délégation de pouvoirs – donc la délégation de responsabilité pénale – joue-t-elle par exemple en matière de publicité trompeuse[6] ou de vente à perte[7].
Exceptions. Il est cependant certaines situations dans lesquelles la délégation de pouvoirs ne peut être consentie ou, plus exactement, si elle est consentie, n’aura pas pour effet d’évincer la responsabilité pénale du dirigeant. Ces exceptions tiennent au comportement observé par le dirigeant après qu’a été donnée la délégation, ou à certaines compétences inhérentes à la fonction de dirigeant.
Quant au comportement du dirigeant, il convient de distinguer deux hypothèses : la délégation de pouvoirs n’emporte pas de transfert de responsabilité pénale lorsque le dirigeant a personnellement et directement participé à la commission de l’infraction, ou lorsque, sans commettre le fait délictueux, il a érigé celui-ci en politique d’entreprise.
Le premier cas de figure est simple. L’efficacité pénale de la délégation de pouvoirs est subordonnée à la condition que, une fois consentie la délégation, le délégant (le dirigeant) se désintéresse parfaitement de la matière déléguée. N’est pas de nature à exclure la responsabilité pénale du président-directeur général des chefs d’abus de faiblesse et d’escroquerie la délégation de pouvoirs consentie à un salarié de mener les campagnes publicitaires dès lors que le dirigeant « participait directement à la mise au point des campagnes publicitaires dont le lancement n’avait lieu qu’avec son accord et qu’il agissait directement sur leur organisation » et qu’il « revendique lui-même les concepts et les méthodes de la politique commerciale agressive mise en œuvre, sur ces directives, par des commerciaux encouragés par lui et motivés par un système d’intéressement »[8]. Le second est tout aussi limpide. Le dirigeant ne peut s’abriter derrière le transfert de sa responsabilité pénale organisé par une délégation dès lors qu’il a incité la commission, par le délégataire, de l’infraction pénale. Le président du directoire est personnellement coupable du délit de travail dissimulé, en dépit de la délégation de pouvoirs consentie à un salarié directeur régional, dès lors qu’il est établi que « ces pratiques illicites généralisées procèdent d’un « choix de stratégie (…) n’étant pas limité à la direction régionale [en cause] »[9].
Ces cas particuliers mis à part, il faut rappeler que la fonction de dirigeant ne peut être intégralement déléguée. Un noyau de compétences – et de responsabilités – demeure accolé au dirigeant en dépit de toute délégation de pouvoirs. Sont concernées à titre quasi-exclusif les relations du dirigeant avec les instances représentatives du personnel : « même s’il confie à un représentant le soin de présider le comité central d’entreprise, le chef d’entreprise engage sa responsabilité à l’égard de cet organisme, s’agissant des mesures ressortissant à son pouvoir propre de direction sans pouvoir opposer l’argumentation prise d’une délégation de pouvoirs »[10]. Il ne faut cependant pas tirer la conclusion que le dirigeant est, par principe, responsable, du délit d’entrave commis à l’endroit des représentants du personnel, sans qu’il puisse s’exonérer au moyen d’une délégation de pouvoirs. Il convient, en réalité, de distinguer selon le fait précis qui a constitué l’entrave. Ou bien le délit est constitué par des agissements directement rattachables à la direction générale de l’employeur (communication des informations sociales, octroi des moyens que la loi ou une convention collective accorde au comité d’entreprise, organisation des élections professionnelles[11]…) : alors le dirigeant ne peut se prévaloir de la délégation de pouvoirs. Ou bien le délit est constitué par la violation d’obligations purement procédurales ou formelles (établissement de l’ordre du jour, communication tardive d’informations…), alors la délégation de pouvoirs produit ses effets[12].
| Le délégataire peut-il être un tiers à la société dirigée par le délégant ? Assez curieusement, le mécanisme de la délégation de pouvoirs ne parvient pas à se détacher de la notion de subordination qui, traditionnellement, unit le chef d’entreprise à ses salariés. La finalité qu’elle poursuivait originellement – assurer des « relais fonctionnels dans le respect d’une unité de direction » (A. Coeuret, La délégation de pouvoirs, in Le pouvoir du chef d’entreprise, Dalloz 2001, p. 32) – comme le contrôle que doit conserver le délégant sur le délégataire (et la faculté, voire l’obligation, pesant sur celui-ci de révoquer la délégation consentie devant l’impuissance du délégataire) s’opposent à ce que la délégation de pouvoirs soit consentie efficacement à un tiers à l’entreprise : « peut-on concevoir que l’employeur transmette à un tiers suffisamment d’autorité, de compétences et de moyens pour qu’un juge reconnaisse que le tiers disposait d’une délégation de pouvoirs ? » (E. Dreyer, ouv. préc., n° 984). Ce classicisme devrait pouvoir être dépassé, et la Cour de cassation distingue. D’une part, l’employeur ne peut se prévaloir des relations contractuelles nouées avec un tiers parfaitement étranger à l’entreprise pour établir l’existence d’une délégation de pouvoir. Il s’agissait, en l’espèce, de savoir si le contrat d’entretien des pneumatiques des véhicules de la flotte automobile de l’entreprise valait délégation de pouvoirs emportant transfert de la responsabilité pénale en ce qui concerne les contraventions aux règles techniques de mise en circulation des véhicules. La Cour refuse ce transfert de responsabilité (Crim., 6 mai 1964, D. 1964.II.562). D’autre part, la Cour admet l’efficacité des délégations de pouvoirs consenties au sein d’un groupe de sociétés : « rien n’interdit au chef d’un groupe de sociétés, président de la société donneur d’ordre et dirigeant de la société sous-traitante, de déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité à un salarié d’une autre société du groupe, sur lequel il exerce un pouvoir hiérarchique » (Crim., 26 mai 1994, n° 93-83.213). |
Les conditions d’efficacité de la délégation de pouvoirs
L’efficacité pénale de la délégation de pouvoirs est subordonnée à plusieurs conditions tenant au contenu de la délégation, à la qualité du délégataire et aux circonstances de fait dans lesquelles le délégataire exerce les pouvoirs du délégant.
Les conditions tenant au contenu de la délégation de pouvoirs
À l’exclusion d’un noyau de prérogatives qui ne sauraient être déléguées par le chef d’entreprise, la délégation que consent ce dernier doit être précise, quant à son objet et quant aux pouvoirs qui sont transférés au délégataire.
Pouvoirs ne pouvant être délégués. Il est exclu, d’abord, que le chef d’entreprise délègue l’intégralité de ses pouvoirs au délégataire. Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, une fraction du pouvoir du chef d’entreprise relative aux compétences inhérentes à cette qualité, ne saurait être déléguée (à tout le moins la délégation serait-elle inefficace pénalement). Tel est le cas en ce qui concerne les relations institutionnelles avec les représentants du personnel[13]. Par le passé, les juges avaient pu se prononcer dans le même sens à chaque fois que l’évitement de la commission de l’infraction nécessitait une décision (celle d’engager des fonds) relevant de la seule compétence du chef d’entreprise[14]. Il ne s’agit, au demeurant, que du prolongement de l’idée selon laquelle la responsabilité pénale ne peut être déléguée qu’à la condition que soient donnés au délégataire les moyens d’exercer l’activité déléguée en conformité avec les dispositions légales et règlementaires. Il convient ensuite de préciser que la délégation de pouvoirs ne saurait dispenser le chef d’entreprise de toute obligation. Lui incombe en effet celle de contrôler les agissements du délégataire ; et les juges sanctionnent le délégant qui se métamorphose en autruche. Engage sa responsabilité pénale du chef de délit d’entrave le dirigeant qui, en dépit de la délégation de pouvoirs consentie, « n’a pu ignorer le caractère chronique des infractions commises » par le délégataire et n’a pas réagi en révoquant ce dernier : « par de telles omissions, commises volontairement, [le dirigeant] a engagé sa responsabilité pénale »[15].
Définition des pouvoirs délégués. La délégation de pouvoirs fixe de manière précise les pouvoirs remis au délégataire – et donc le domaine de la responsabilité. Les juges privent d’efficacité la délégation « en l’absence d’instructions précises données » au délégataire[16]. Demeure responsable du chef de l’infraction fiscale afférente, le président du conseil d’administration qui a consenti au directeur général une « délégation de ses pouvoirs afin de veiller au respect du Code du travail, de la législation et de la règlementation applicables aux transports » sans préciser si cette « délégation de pouvoirs […] s’étendait à la matière des contributions indirectes et de la circulation des alcools »[17]. Pour produire ses effets, la délimitation doit être réalisée en amont de la commission de l’infraction ; pour le dirigeant, il est vain d’espérer régulariser une délégation de pouvoirs trop vague, comme il est vain d’espérer que le juge prenne en considération a posteriori l’ « aveu » du délégataire[18].
Les conditions tenant à la qualité du délégataire
La délégation n’exonère le dirigeant de sa responsabilité pénale que si le délégataire est en mesure de supporter cette responsabilité. La capacité du délégataire est établie par la réunion de trois éléments : la compétence, l’autorité et l’indépendance.
Compétences. L’idée de compétence est double. Il s’agit, bien sûr, d’éviter que le dirigeant ne s’exonère de sa responsabilité au détriment d’un salarié qui, de toute évidence, n’est pas en mesure d’assurer le strict respect de la loi pénale car il ne maîtrise ni celle-ci, ni les normes techniques – notamment de sécurité – que son observation implique. Les juges rejettent la délégation « fantoche ». Mais il s’agit également d’inciter les dirigeants à choisir comme délégataire une personne parfaitement apte à remplir cet office. Le moment venu, les juges vérifient immanquablement la compétence du délégataire, c’est-à-dire à la fois sa maîtrise technique[19] et ses connaissances juridiques. Quant à la maîtrise technique, ils la contrôlent minutieusement. Il ne suffit pas que, en raison de sa qualification, le délégataire ait pu connaître les règles qu’il était chargé de faire respecter ; il faut encore qu’il soit établi qu’il connaissait précisément les modalités de mise en œuvre de ces règles[20]. Quant à la compréhension des règles juridiques, elle doit être certaine : est inefficace la délégation de pouvoirs consentie à un salarié dont les auditions, postérieures à la réalisation du dommage, révèlent « qu’il apprécie les travaux dangereux et les mesures de sécurité à prendre selon sa propre expérience et non par référence à la lettre ou à l’esprit desdites dispositions »[21].
Autorité. La condition d’autorité est satisfaite lorsque, d’une part, le délégataire est chargé par la délégation de donner les ordres nécessaires à l’accomplissement de la mission. Ceci implique que le délégataire ne soit pas uniquement affecté à l’exécution d’un travail technique[22]. Il importe, d’autre part, que le délégataire dispose du pouvoir de donner les ordres nécessaires, non seulement à ses éventuels subordonnés, mais encore à toute personne de l’entreprise susceptible d’interférer dans l’exécution des tâches déléguées. Est donc dépourvue d’effet la délégation de pouvoirs consentie en matière de règlementation économique au chef de secteur des produits frais dès lors que l’établissement des factures relevait du service comptable sur lequel il n’avait pas autorité[23]. Il n’en va pas différemment, en matière de sécurité, lorsque le délégataire, qui ne dispose pas du pouvoir de contraindre les salariés à cesser leur activité ou de celui de les sanctionner, est uniquement autorisé à rappeler aux salariés enfreignant les consignes de sécurité qu’ils s’exposent à un licenciement pour faute grave[24].
Indépendance. La condition tenant à l’indépendance du délégataire fait écho à l’impossibilité pour le dirigeant de se prévaloir d’une délégation de pouvoirs s’il a lui-même participé à la commission de l’infraction : le dirigeant qui s’immisce dans l’activité du délégataire est, au même titre que celui-ci, auteur des faits réprimés. La délégation de pouvoirs est privée d’effet lorsque le délégant se substitue au délégataire, privant celui-ci de ses pouvoirs[25]. Il en va de même si le délégataire est astreint à demander l’approbation de sa hiérarchie lorsqu’il exerce la délégation. Ne saurait échapper à sa responsabilité pénale découlant d’une fraude fiscale le dirigeant qui, après avoir délégué ses pouvoirs en la matière au directeur financier, s’était réservé la signature des chèques et exigeait un compte rendu hebdomadaire[26]. L’indépendance doit être entendue plus largement encore. Elle implique que la délégation de pouvoirs soit consentie à titre exclusif au délégataire et prive d’effet la délégation consentie, dans un même domaine, à plusieurs personnes. Le dirigeant « ne peut déléguer ses pouvoirs à plusieurs personnes pour l’exécution d’un même travail, un tel cumul étant de nature à restreindre l’autorité et à entraver les initiatives de chacun des prétendus délégataires »[27].
Enfin, la délégation n’est licite qu’à la condition que le délégataire l’ait préalablement acceptée. L’acceptation peut être formulée de manière expresse mais, dans la mesure où les juges n’exigent pas que la délégation de pouvoirs soit nécessairement constatée par écrit[28], ils tolèrent que l’acceptation soit inhérente à l’acceptation de ses fonctions générales par le délégataire (salarié qui accepte un poste de cadre-dirigeant) ou qu’elle soit constatée au regard du comportement adopté par ce dernier à la suite de l’information sur la délégation que lui a procurée le délégant.
Les conditions tenant aux circonstances de fait dans lesquelles le délégataire exerce les pouvoirs du délégant.
Moyens mis à la disposition du délégataire. L’autorité et l’indépendance du délégataire trouvent leur prolongement dans une ultime condition. La Cour de cassation réaffirme périodiquement que la mise à disposition des « moyens nécessaires » à l’accomplissement de sa mission est une condition d’efficacité de la délégation de pouvoirs[29]. Ce qui implique, notamment, que le délégataire puisse engager des dépenses à cette fin[30].
La subdélégation de pouvoirs
Admission des subdélégations. Après quelques hésitations, fut admise la validité des subdélégations par lesquelles le délégataire transfère à un subdélégataire les pouvoirs (et la responsabilité) qu’il tient du délégant.
La validité de la subdélégation n’est subordonnée à aucune condition particulière, mais il convient d’appliquer strictement les conditions inhérentes à toute délégation. D’une part, « l’autorisation du chef d’entreprise, dont émane la délégation de pouvoirs initiale, n’est pas nécessaire à la validité des subdélégations de pouvoirs »[31]. Mais, d’autre part, il est vraisemblable, en fait, que le subdélégataire pressenti ne disposera pas de toutes les qualités ni de toutes les prérogatives dont disposait le délégataire initial. Il convient donc d’apprécier à part, en tenant compte de la situation particulière du subdélégataire, les conditions d’efficacité de la subdélégation[32].
La preuve de la délégation de pouvoirs
En ce qui concerne la preuve de la délégation de pouvoirs, deux questions doivent être traitées. La première est celle de savoir s’il incombe au ministère public qui poursuit le dirigeant de prouver l’absence de délégation de pouvoirs ou, si à l’inverse, c’est au dirigeant poursuivi qu’il incombe d’établir l’existence d’une telle délégation. La seconde question – qui suppose la première résolue – est celle de savoir quels éléments de preuve apporter au soutien de l’existence de la délégation.
La charge de la preuve
Dirigeant. Il appartient au chef d’entreprise poursuivi d’établir l’existence et la perfection de la délégation de pouvoirs : « pour exonérer l’employeur [le dirigeant] de sa responsabilité personnelle, une délégation de pouvoirs […] doit être prouvée par celui qui en invoque l’existence »[33]. La preuve concerne à la fois la délégation de pouvoirs elle-même et l’ensemble des conditions d’efficacité de celle-ci.
Les moyens de preuve
Écrit non nécessaire et non suffisant. La preuve de la délégation de pouvoirs est « libre ». Celui qui s’en prévaut n’est pas tenu de rapporter un écrit au soutien de son affirmation : la délégation de pouvoirs peut être prouvée par tout moyen[34], et l’écrit, fut-il signé de la main du délégataire, ne suffit pas à établir l’existence de la délégation. Pour forger sa conviction, le juge recourt à la technique du « faisceau d’indices ». Les indices sont l’éventuel écrit passé entre le délégant et le délégataire, les fonctions occupées par ce dernier, l’autonomie et les pouvoirs (hiérarchiques et à l’égard des tiers) dont il jouissait. Réunis, ils caractérisent les éléments nécessaires à la délégation de pouvoirs. Il est donc vain d’espérer faire reconnaître cette dernière au seul moyen d’un organigramme[35], d’un règlement intérieur[36] ou de tout autre document d’ordre général[37].
Écrit utile. Aussi faut-il conseiller de prendre la précaution de traduire par écrit la délégation de pouvoirs. L’écrit sera aussi complet que possible. Il mentionnera non seulement l’identité et la qualité du délégant et du délégataire mais encore :
- Les raisons pour lesquelles la délégation est consentie,
- Le champ, précisément délimité, de la délégation,
- Les moyens hiérarchiques, juridiques et financiers octroyés au délégataire en vue de l’exécution de la délégation,
- La date d’effet de la délégation,
- L’acceptation de la délégation par le délégataire.
Dans la mesure où l’écrit, seul, ne suffit pas à prouver l’efficacité de la délégation, il faut encore conseiller au délégataire, au cours de l’exécution de celle-ci, de conserver les preuves de la mise en œuvre effective des moyens visés dans la délégation écrite.
Les effets de la délégation de pouvoirs
Lorsqu’elle produit ses effets, la délégation de pouvoirs emporte le transfert de la responsabilité pénale du dirigeant délégant vers le délégataire. Le principe est cependant limité.
Principes. La responsabilité pénale du délégant et du délégataire est alternative, non cumulative. Ou bien la délégation produit ses effets : alors le délégant est déchargé du risque pénal et le délégataire est la seule personne physique responsable pénalement. Ou bien la délégation de pouvoirs est imparfaite : le délégant seul est responsable[38]. Il est donc exclu de voir ensemble condamnés le délégant et le délégataire[39].
Limites. D’abord, le transfert de responsabilité est écarté lorsque le délégant s’est immiscé dans la gestion de l’activité déléguée (la délégation, initialement licite perd son efficacité) ou lorsqu’il a participé, en tant que co-auteur ou complice, aux fautes pénales commises par le délégataire[40]. Ensuite, le transfert de responsabilité n’impacte que la situation des personnes physiques. Le délégant comme le délégataire étant considérés comme des « représentants » de la personne morale qu’ils dirigent ou qui les emploie, celle-ci est tenue pénalement du comportement de l’un et de l’autre ; à ses yeux donc, l’efficacité de la délégation[41], voire de la subdélégation[42], est indifférente. Enfin, la délégation de pouvoirs joue un rôle modéré en matière de responsabilité civile. Son existence n’affecte pas la responsabilité civile de la société ou de l’association ; en revanche, elle transfère la responsabilité civile pesant sur le délégant vers le délégataire. D’une part, le délégant – notamment lorsqu’il est dirigeant – n’est pas tenu civilement de la faute commise par le délégataire[43], et d’autre part, le délégataire condamné pénalement à raison d’une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal engage sa propre responsabilité civile à l’endroit de la victime[44].
[1] Crim., 7 juin 2006, n° 05-86.804. En l’espèce, la Cour de cassation reconnait la responsabilité pénale du dirigeant, pourtant hospitalisé lors de la commission de l’infraction, qui n’avait pas délégué ses pouvoirs.
[2] Crim., 28 juin 2002, Bull. crim. n° 237, p. 425.
[3] Le MEDEF a publié en décembre 2004, un « vade-mecum » sur la délégation de pouvoirs qui, pour l’essentiel, est toujours d’actualité. Il est en accès libre sur internet à l’adresse : http://www.ssa974.com/IMG/pdf/la_delegation_de_pouvoir_vademecum_.pdf
[4] Lorsque le dirigeant (déléguant) n’a pas lui-même causé le dommage, il n’a vraisemblablement pas commis une faute séparable des fonctions (v. supra) susceptible d’engager sa propre responsabilité. C’est à la personne morale, société ou association (voire aux organismes sociaux telle l’assurance accident du travail) qu’il incombera d’indemniser la victime.
[5] Crim., 11 mars 1993, 5 décisions, Bull. crim. n° 112.
[6] Crim., 11 mars 1993, n° 91-83.655 : la décision rejette cependant, en l’espèce, l’existence d’une délégation de pouvoir, non par principe, mais à raison de l’absence de preuve de cette délégation (sur la preuve de la délégation, v. infra).
[7] Crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773.
[8] Crim., 17 septembre 2002, n° 01-85.891.
[9] Crim., 17 juin 2003, n° 02-84.244.
[10] Crim., 15 mai 2007, n° 06-84.318. Condamnation du président du directoire ayant délégué cette mission au salarié directeur adjoint des affaires sociales.
[11] Crim. ; 6 novembre 2007 n° 06-86.027.
[12] A. Coeuret, E. Fortis, Droit pénal du travail, LexisNexis 2012, n° 300.
[13] Crim. ; 6 novembre 2007 n° 06-86.027.
[14] M. Dreyer cite deux décisions anciennes mais toujours d’actualité : Crim., 21 janvier 1911, bull. crim. n° 54 : « il ne dépend pas du directeur spécial de l’atelier (délégataire) que les lavabos répondent aux prescriptions légales, le directeur gérant de la société pouvant seul ordonner la dépense et faire dresser les plans et installations exigés par la loi » ; CA Paris 4 mars 1963, JCP 1963.II.13259, note H. Guérin : où est retenue la responsabilité du chef d’entreprise, en dépit de la délégation consentie, dès lors que « la fixation de l’indemnité de congé [litigieuse] due aux salariés de l’entreprise à l’occasion des congés de 1959 était une décision d’ordre général concernant l’ensemble du personnel salarié et qu’il appartenait au seul PDG de prendre ».
[15] Crim., 15 février 1982. En l’espèce l’abstention du dirigeant était particulièrement grave : la violation répétée de l’obligation d’information et de consultation du comité d’entreprise avait préalablement été portée à sa connaissance par l’inspecteur du travail.
[16] Crim., 28 janvier 1975, n° 74-91.495.
[17] Crim., 7 novembre 1994, n° 93-85.286.
[18] Crim., 2 février 1993, n° 92-80.672 : où la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui « énonce notamment que le document en vigueur au moment des faits, (…), est trop général pour constituer une délégation de pouvoirs certaine et dépourvue d’ambiguïté ; que la délégation établie postérieurement à l’accident entre les mêmes parties, qui ne comporte aucune référence au document précédent, ne peut être considérée comme sa régularisation ; [et] que la reconnaissance de cette délégation, faite par le préposé au cours de l’enquête, “n’est pas déterminante comme émanant d’un salarié soumis à un lien de subordination ” ».
[19] Crim., 30 octobre 1996, 95-84.842 : où est déclarée inefficace la délégation de pouvoirs consentie à un salarié qui « n’avait pas les compétences techniques nécessaires ».
[20] Crim., 26 novembre 1991, n° 90-87.310 : est inefficace la délégation de pouvoirs consentie à un salarié « couvreur », certes habitué des chantiers, mais qui n’a jamais exercé les fonctions de conducteur de travaux et qui n’a pas bénéficié de la formation essentielle alors que, embauché en qualité de « commis de chantier », il n’est en poste que depuis onze jours dans l’entreprise.
[21] Crim., 8 février 1983, n° 82-92.644.
[22] Crim., 21 février 1968, n° 67-92.381.
[23] Crim., 6 mai 1996, n° 95-83.340.
[24] Crim., 15 octobre 1991, n° 89-86.633.
[25] Crim., 7 juin 2011, n° 10-84.283, où un dirigeant exerce lui-même, de manière répétée, le pouvoir disciplinaire à l’encontre de chauffeurs salariés, en dépit de la délégation de pouvoirs préalablement consentie.
[26] Crim., 19 août 1997, n° 96-83.944.
[27] Crim., 6 juin 1989, n° 88-82.266.
[28] V. infra.
[29] Crim., 7 novembre 1994, n° 93-85.286.
[30] CA. Grenoble, 29 avril 1999 où le délégataire ne disposait pas d’un pouvoir autonome dans la commande de matériel de sécurité ; Crim., 25 janvier 2000, n° 97-86.355 où le délégataire ne pouvait régler seul les factures d’entretien.
[31] Crim., 30 octobre 1996, n° 94-83.650.
[32] V., p. ex. : Crim : 2 février 2010, n° 09-84.250.
[33] Crim., 5 juillet 1983, Aspertti-Boursin.
[34] Crim., 17 février 1979, bull. crim. 1979, n° 88.
[35] Crim., 15 janvier 1980, Hiard.
[36] Crim., 11 janvier 1955, bull. crim. 1955, n° 21.
[37] V., pour d’autres exemples, A. Coeuret, E. Fortis, Droit pénal du travail, préc., n° 339.
[38] Sous la réserve de la responsabilité pénale de la personne morale.
[39] Crim., 23 janvier 1975, n° 73-92.615.
[40] Crim., 9 novembre 2010, n° 10-81.074.
[41] Crim., 9 novembre 1999, n° 98-81.746.
[42] Crim., 26 juin 2001, n° 00-83.466 : « ont la qualité de représentants, au sens de [l’article 121-1 du Code pénal], les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d’une personne ainsi déléguée ».
[43] Ce qui n’exclut pas que puisse être reproché au délégant une faute personnelle consistant dans le défaut de surveillance ou de contrôle de l’activité du délégataire.
[44] Crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975. En principe, les salariés, comme les dirigeants à l’égard des tiers, n’engagent pas leur propre responsabilité à raison des fautes qu’ils commettent dans l’exercice de leurs fonctions (C. civ., art. 1384, al. 5). Ce principe connaît une exception, comparable à celle appliquée aux dirigeants, lorsque les salariés ont commis une faute étrangère à l’exercice de leurs fonctions. Tel est le cas des fautes pénales intentionnelles : « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci » (Plén., 14 décembre 2001, n° 00-82-066). Cette solution est déclinée pour les délégataires, le plus souvent salariés, à propos des fautes visées à l’article 121-3 du Code pénal (v. supra).