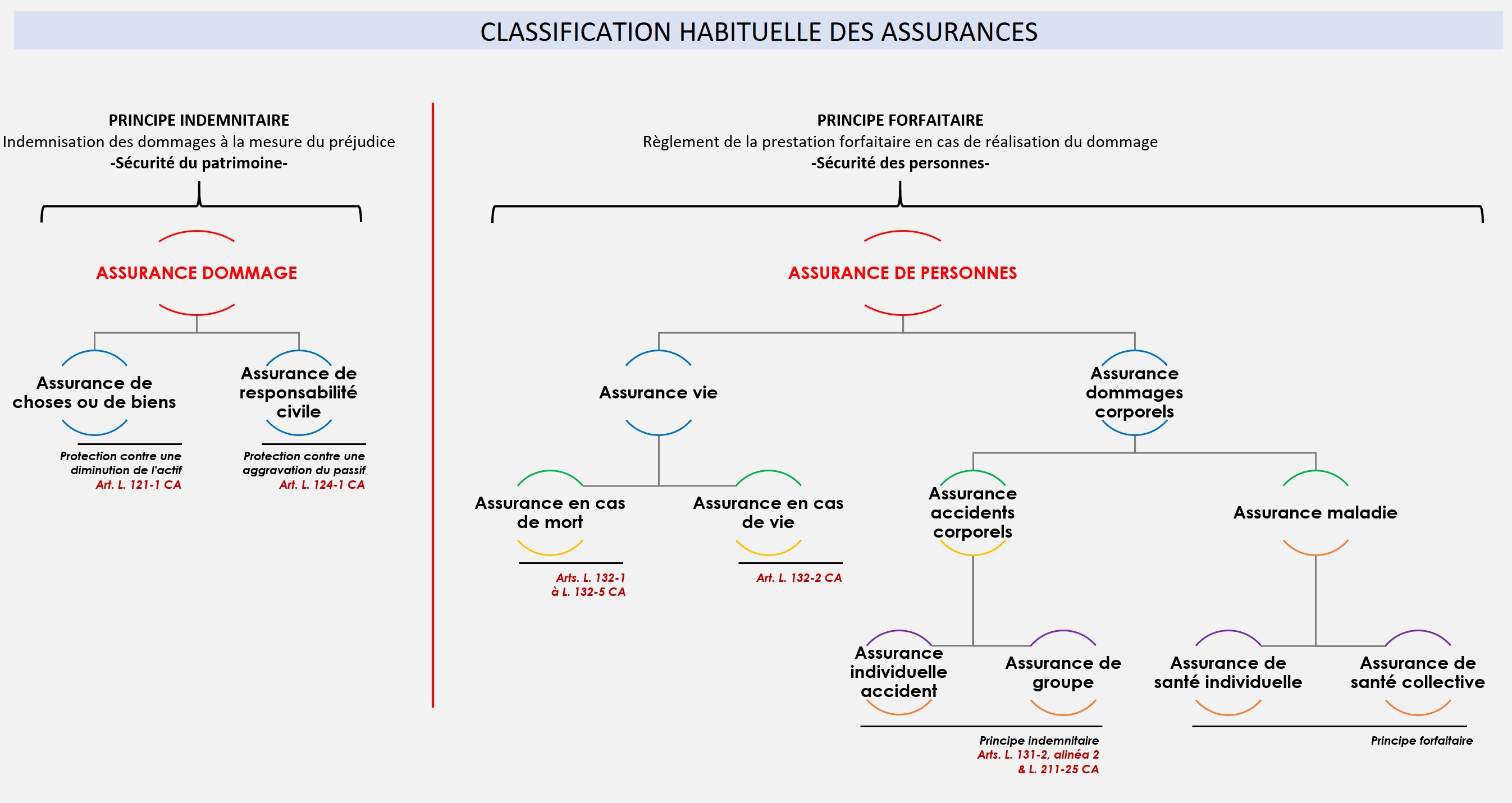Dette sociale[1]. À ce jour, la dette des administrations de sécurité sociale – ce qu’on appelle la dette sociale (qu’il ne faut pas confondre avec le déficit annuel des comptes sociaux, qui est familièrement appelé « trou de la sécu ») – se monte à près de 370 milliards d’euros. C’est une dette relativement importante en valeur qui est très difficile à juguler car les dépenses de santé (qui se chiffrent à plus de 200 milliards d’euros en 2020, soit 25 % de la richesse nationale)[2] ne peuvent être purement et simplement pas gelées. Les Français ne le toléreraient pas. Aucune personne en responsabilité politique (un tant soit peu sensée) ne s’aventurerait du reste. En même temps, il serait aventureux de ne pas chercher à les contenir, à en ralentir la progression. Sans quoi, ce seraient les marchés qui ne nous le pardonneraient pas. Pour mémoire, l’État français est l’un des plus gros émetteurs de titres financiers au monde. Même si, en vérité, la dette des organismes de sécurité sociale ne représente en valeur relative que 10 % de la dette publique (qui se monte au dernier trimestre 2021 à plus de 2800 milliards d’euros)[3], la confiance des investisseurs doit nécessairement être recherchée et continûment améliorée. Sans ce qu’on appelle la titrisation (qui est une technique financière de mobilisation des créances sur les marchés), les impositions et les cotisations ne suffiraient pas à assurer le financement de la consommation de soins et de biens médicaux. D’aucuns soutiendront qu’il est toujours loisible d’augmenter la cotisation sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, les cotisations sociales patronales ou les impôts et taxes affectés au financement de la sécurité sociale. Seulement, le consentement à l’impôt est bien trop émoussé[4]…
En bref, ce n’est malheureusement pas assez de regarder du côté des produits. Il importe tout autant sinon plus de s’enquérir des charges.
Consommation de soins et de biens médicaux. Précisément, le deuxième poste de dépenses renseigné dans la consommation de soins et de biens médicaux est composé des soins de ville, à savoir des honoraires payés aux médecins libéraux, ce qui représente un peu plus de 21 milliards d’euros en 2020 en arrondissant. Vous m’accorderez que cela pourrait suffire à fonder l’attention de la caisse nationale d’assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Mais il y a plus. Il faut aussi bien avoir à l’esprit que les usagers du système de santé n’ont aucun droit de tirage sur le trésor de l’assurance maladie. Seuls les professionnels de santé sont les ordonnateurs de la dépense. Rien de très surprenant par voie de conséquence que des relations étroites soient nouées entre les dispensateurs de soins et le régleur des soins de santé : maîtrise des dépenses médicales oblige (L. 162-5, 6° c. sécu. soc.).
Conventions médicales. Ces relations ont fini par être couchées sur le papier. Après quelques expérimentations, le véhicule normatif a été trouvé. Les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie sont désormais régis par des conventions médicales nationales (collectives et pluriannuelles). La première fut signée le 28 octobre 1971. La dernière en date a été signée le 25 août 2016. Arrivée à son terme le 24 octobre dernier, elle devait faire l’objet d’une réécriture dans la foulée. Hélas pour les syndicats représentatifs des médecins libéraux, qui étaient désireux entre autres revendications que les tarifs soient révisés et les honoraires concrètement majorés, le législateur a décidé de prolonger les effets de la convention médicale conclue en 2016 de quelques mois[5]. Prolongation qui, comme on peut l’imaginer, a été fort mal accueillie par les professionnels de santé légitimement désireux de voir leur activité mieux valorisée. MG France, qui est l’une des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes au sens de la loi (art. L. 162-5 c. sécu. soc.), demandait au printemps dernier un rehaussement de la consultation afin qu’elle soit portée à 30 euros et majorée à 60 euros à raison de la complexité de l’accueil et des soins prodigués aux patients polypathologiques. Voilà le juste prix à payer a-t-il été défendu de l’expertise des médecins, de l’accompagnement d’une population vieillissante, des virages ambulatoires et domiciliaires qui ont été pris ces dernières années[6].
Cette mauvaise valorisation participe très certainement des rapports compliqués qu’entretiennent les médecins libéraux et l’assurance maladie (entre autres sources de complication) et qui empêche d’une manière ou d’une autre toute réforme systémique des modalités de couverture du risque maladie en France. C’est ce qu’il importe de montrer.
Secteurs conventionnels. Le code de la sécurité sociale renferme toute une série de dispositions relatives aux relations contractuelles entre les médecins libéraux et l’assurance maladie (art. L. 162-5 et s.). La loi enjoint les partenaires conventionnels à déterminer (notamment) leurs rapports pécuniaires. Plus concrètement à déterminer les modes de rémunération et, bien plus sûrement, à fixer les droits à dépassement d’honoraires.
Disons tout de suite, pour ne plus y revenir, que le conventionnement n’est pas une obligation pour les médecins libéraux, qui sont libres de fixer les tarifs comme bon leur semble. Ceci étant, ils sont très peu nombreux à exercer en secteur 3. Il y a une bonne raison à cela : les patients sont très mal remboursés par l’assurance maladie, quelques euros tout au plus – pour ne pas dire quelques centimes – (70% du tarif d’autorité art. L. 162-5-10 c. sécu. soc.). La patientèle n’est donc pas grande du tout.
En bref, les médecins libéraux sont pour la quasi-totalité d’entre eux parties aux conventions médicales et à leurs avenants. Les uns relèvent du secteur à honoraires opposables (secteur 1). Les autres du secteur à honoraires libres (secteur 2). Les premiers n’ont pas le droit de pratiquer de dépassement d’honoraires (à tout le moins en principe)[7]. Les seconds peuvent procéder sauf à répondre de l’exercice abusif de leur liberté tarifaire (art. R. 4127-53 c. santé publ.). Les avantages accordés en contrepartie sont naturellement variables d’un secteur à l’autre, qui dépendent de toute une série de conditions qui forment un maillage juridique relativement complexe pour qui s’aventure et qui, par voie de conséquence, est de nature à rebuter les principaux intéressés. Fort heureusement, les agences régionales de santé se proposent d’accompagner les jeunes médecins dans leur installation ou bien encore dans leur remplacement. Le contrat de début d’exercice (CDE de 3 ans non renouvelable), qui a été inventé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020[8] est ainsi l’occasion pour les ARS de prêter leur concours et d’accorder des rémunérations de complément aux honoraires à la condition que le médecin, qui exerce en libéral, s’engage à pratiquer les tarifs opposables (secteur 1) ou bien qu’il adhère en secteur 2 à l’option pratique tarifaire maîtrisée…le tout dans une zone fragile en matière d’offre de soins même à temps partiel… Alors un accompagnement c’est certain, mais qui n’est pas complétement désintéressé : désertification médicale oblige !
Dépassements d’honoraires. L’assurance maladie et, avec elle l’État, redoutent que les médecins optent systématiquement pour le secteur 2 et opposent leur droit à dépassement. Il y a plusieurs raisons à cela.
D’abord, les dépassements d’honoraires, qui ne sont pas complétement solvabilisés, sont de nature à empêcher des personnes d’avoir recours aux actes de diagnostic, de prévention et de soins, qui doivent supporter alors un reste à charge trop important et souffrir un choix restreint de professionnels de santé, choix qui s’avère parfois même inexistant.
Ensuite, et d’un point de vue plus macroéconomique, lesdits dépassements d’honoraires renchérissent en définitive le coût de l’assurance pour tout un chacun.
Un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales renseigne en ce sens (et sur la période concernée) que sur 18 milliards d’euros d’honoraires totaux, les dépassements d’honoraires représentaient 2 milliards d’euros, les deux tiers pesant sur les ménages après interventions des organismes d’assurance complémentaire[9]. Le corps d’inspection d’ajouter que le montant des dépassements dans le secteur à honoraires libres a doublé en moins de quinze ans en valeur réelle, qu’il est une pratique devenue majoritaire chez les spécialistes.
En bref, s’est insidieusement creusé un écart entre les bases de remboursement de la sécurité sociale (BRSS ou TRSS : tarifs de responsabilité de la sécurité sociale) et les tarifs de consultation des médecins libéraux rendant bien incertaines les politiques de couverture a maxima des frais de soins de santé et les tentatives de restes à charge zéro (notamment à l’attention des patients pris en charge au titre des affectations de longue durée).
Police de la tarification. Les leviers de canalisation de la dépense sont bien connus. À l’expérience, ils ne sont pas aussi fructueux qu’on pouvait l’espérer. En la matière, il appartient aux caisses de sécurité sociale ainsi qu’aux institutions ordinales de faire la police de la tarification. Dans le cas particulier, le travail de contrôle consiste à instruire les signalements des usagers du système de santé et à tirer toutes les conséquences des vérifications qui sont faites par les organismes de sécurité sociale.
Le droit permanent à dépassement que le praticien se soit déclaré. À défaut, et parce qu’il est présumé exercer en secteur 1, tout honoraire perçu au-delà des tarifs opposables est (en principe) indu. Le praticien indélicat peut donc être condamné (entre autres peines) à rembourser à l’assuré le trop-perçu (art. L. 145-2, 4° c. sécu. soc.). C’est l’objet du contentieux du contrôle technique (art. L. 145-1 c. sécu. soc.) et la responsabilité de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (art. R. 145-4 c. sécu. soc.)[10]. Le tout sans préjudice d’éventuelles sanctions ordinales.
Ceci pour souligner qu’il existe tout un arsenal juridique dédié, à tout le moins en théorie. Car il semble à l’expérience que « les procédures destinées à réprimer les dépassements d’honoraires ne soient guère mises en œuvre jusqu’à leur terme »[11]. Et c’est sans compter, bien que l’affaire soit un peu technique, que les seuils de dépassement qui déclenchent contrôles et sanctions sont étroitement dépendants des pratiques constatées sur un territoire[12]. S’il est aussi courant que répandu ici ou là d’user du droit à dépassement, alors il y aura peu à redire. Je ne ferai pas plus de commentaire si ce n’est qu’il n’est pas très étonnant de constater une concentration de praticiens dans certaines localités dont il est difficile pour beaucoup d’usagers de prendre l’attache en raison des dépassements d’honoraires généralement pratiqués.
C’est dire combien il est douteux que toute l’ingénierie mise en place pour contenir les dépassements d’honoraires soit très satisfaisante. Voyons de quoi il retourne plus précisément.
Contrat d’accès et soins et option pratique tarifaire maîtrisée. Il y a tout juste une dizaine d’années, les partenaires conventionnels ont imaginé un contrat d’accès aux soins. Par un avenant n°8 à la convention médicale du 26 juillet 2011, il est convenu que les médecins du secteur 2 s’engagent à développer une offre de soins à tarifs opposables ainsi qu’à plafonner pour le reste de leur activité le montant de leurs dépassements. Et l’avenant de renfermer en outre des critères permettant pour ceux qui n’adhéreraient pas de déterminer le caractère excessif des honoraires pratiqués[13]. On pourrait s’étonner que des partenaires conventionnels, particulièrement ceux représentant les intérêts catégoriels des médecins libéraux, aient consenti à se lier dans ces termes à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Ce faisant, les intéressés ont toutefois évité que le législateur ne reprenne à son compte le sujet pour les raisons sus-évoquées. Ils ont en outre obtenu en contrepartie quelques compensations : à savoir (une fois l’accessoire mis de côté) l’augmentation du montant des actes à tarifs opposables et la promesse d’une revalorisation.
Les enjeux, il faut les redire tant l’exercice tient de la gageure : limitation des dépassements d’honoraires, augmentation de l’offre de soins spécialisés à tarifs opposables et lutte contre la désertification médicale. Parce que l’art est bien difficile et que le taux d’adhésion des médecins spécialistes de secteur 2 n’est pas jugé suffisant, les partenaires conventionnels remettent l’ouvrage sur le métier. La convention médicale du 25 août 2016 remplace le contrat d’accès par l’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) dont une déclinaison est réservée aux médecins spécialistes en chirurgie et en gynécologie-obstétrique (OPTAM-CO)[14]. Si les obligations des adhérents sont semblables, la nature des compensations conventionnelles accordées est modifiée (v. aussi art. L. 162-5-19 c. sécu. soc.). L’effort est notable, qui consiste toutes techniques confondues, à majorer la rémunération des médecins libéraux qui ont opté notamment sur objectifs de santé publique. Ceci étant, il n’est pas sûr du tout que le nouveau dispositif, qui est laissé à la discrétion des médecins et chirurgiens, ait pu produire les fruits escomptés.
Il se pourrait même qu’on doive bien plutôt la stabilisation des dépassements à l’économie du contrat d’assurance maladie complémentaire responsable.
Contrats responsables. Les dépassements d’honoraires ont pu se pratiquer sans trop cri d’orfraie tant que les patients ont pu les payer. Dans un passé récent, le paiement a été facilité par les remboursements des organismes d’assurance complémentaire auprès desquels de nombreuses personnes avaient souscrit. À mesure que les complémentaires santé se sont généralisées, les contrats d’assurance (qui sont assortis d’aides fiscales et sociales qui ont participé à leur commercialisation) ont été capés par le législateur notamment par le haut. Les opérateurs d’assurance ont ainsi été interdits de rembourser la franchise et le dépassement d’honoraire dus pour le cas où le patient aurait consulté un médecin spécialiste sans l’avis préalable du médecin traitant (L. 871-1, al. 3 c. sécu. soc. ensemble L. 162-5, 18° c. sécu. soc.). Quant aux dépassements d’honoraires en général (L. 871-1, al. 4 et R. 871-2 c. sécu. soc.), lesdits opérateurs ont été priés de discriminer les médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale et les autres.
Les rapports entretenus entre les médecins libéraux et l’assurance maladie sont d’autant moins simples que cette dernière assurance est une sorte de Janus bifront, un dispositif à deux visages bien complexes à savoir l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire. Autrement dit, la couverture du risque maladie est garantie par deux assureurs : un assureur public et un assureur privé.
Ticket modérateur et tiers payant. Historiquement, et ce bien avant l’ordonnance n° 45-2250 du 04 novembre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, on doit aux seconds et aux sociétés de secours mutuel d’avoir participé à réduire le non recours aux soins des travailleurs. En inventant la sécurité sociale, le Gouvernement provisoire de la République française n’a pour ainsi dire rien supprimé de l’existant. Une aubaine en définitive et à l’expérience. De proche en proche, une partie des frais de soins de santé s’est ainsi retrouvée externalisée (dispensant les pouvoirs publics d’augmenter les cotisations de sécurité sociale et les impôts affectés au financement de la sécurité sociale). L’externalisation a un autre nom : le ticket modérateur. C’est un dispositif technique qui sert à répartir les coûts engendrés par la consommation de soins et biens médicaux entre les caisses de sécurité sociale, les organismes d’assurance complémentaire et les patients. Aussi ingénieux soit le dispositif, il complique très sérieusement les choses. Rares sont les usagers du système de santé qui savent combien ils seront remboursés et par qui. C’est l’une des causes au renoncement aux soins contre laquelle lutte les pouvoirs publics. Rares sont encore les jeunes médecins qui ont été initiés au droit à l’économie de l’assurance maladie.
C’est pour faciliter la tâche des usagers du système de santé que le tiers payant généralisé a été inventé, invention contre laquelle les médecins libéraux pestent, qui réussirent à faire reculer la ministre Marisol Touraine et hésiter les ministres qui se sont suivis avenue de Ségur.
De loin, et du point de vue des personnes qui consultent, la résistance n’est pas frappée au coin du bon sens. Après tout, et par comparaison, on ne règle pour ainsi jamais le prix des médicaments qui sont délivrés en officine. Le tiers payant a fait ici ses preuves. De plus près, et du point de vue des médecins libéraux, il y a quelques raisons d’hésiter. D’abord, et la source de complication est de nature technique, il faut rappeler que le patient type n’est jamais remboursé à 100%. Sur une consultation à 25 euros, le patient n’est pris en charge qu’à hauteur de 24. Une participation de l’assuré social est attendue à la prise en charge des frais de santé (L. 160-13 et R. 160-19 c. sécu. soc.). En bref, la franchise d’un euro n’étant remboursée par aucun des assureurs qu’il soit public ou privé, il a été bien vu qu’il appartiendrait alors au médecin de prendre la pièce (si vous me passez l’expression) pour le compte de l’assurance maladie. Voilà qu’on aurait transformé les médecins en collecteurs d’impôt ! Encore qu’on nous dira que le problème n’est pas trop compliqué à régler… Il y a plus en vérité.
Articulation entre les assurances maladies. Le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie a publié il y a quelques jours un rapport remarquable sur l’articulation entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire. Force est de constater (et de regretter) qu’il n’intéresse pas beaucoup. La nationalisation des organismes privés d’assurance complémentaire entre autres scenarii est tout de même proposée[15]. Mais laissons. Il y est surtout question, quel que soit le scenario sur lequel on s’arrête, de la solvabilisation des frais des santé en général et, en filigranes, des dépassements d’honoraires.
Classification commune des actes médicaux. En bref, et peu important l’angle de vue qu’on choisit, la pratique des dépassements d’honoraires est l’une des sources de complication majeure qui, si elle est mal canalisée, participe invariablement du non recours aux soins de très nombreux usagers du système de santé. Remonter aux origines du mal, dont on s’est pour l’instant limité à montrer quelques manifestations, c’est d’une façon ou d’une autre braquer le projecteur sur la classification commune des actes médicaux (anciennement la nomenclature générale des actes professionnels) (art. L. 162-1-7 c. sécu. soc.). Cette classification est la liste des actes médicaux techniques, codée, et admis au remboursement. Commune aux secteurs privé et public, elle est arrêtée par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie[16]. Son utilisation n’est pas commode. C’est peu de le dire. Les lignes de codes et les zones de codage sont très nombreuses. Il se peut fort que la cotation des actes ne soit pas optimale et que la rémunération ne soit par voie de conséquence pas optimisée. Il faut bien voir aussi que le travail de codage est ancien (25 févr. 2005). Ce n’est pas à dire que ces quinze dernières années, les partenaires conventionnels ne se soient pas appliqués à améliorer l’existant. Le dernier avenant en date à la convention médicale de 2016 est typique de ce point de vue qui renferme (entre autres) la valorisation des activités psychiatrique, pédiatrique, de gynécologie médicale, de prise en charge sans délai des patients en général ou bien encore celle des personnes âgées à domicile (arr. 22 sept. 2021). Il reste qu’aucune refonte de la cotation n’ayant été faite, les dépassements d’honoraires sont, à la manière d’un palliatif, la meilleure manière qui a été trouvée par de très nombreux médecins libéraux pour mieux rémunérer leurs diligences.
En conclusion, tant que la cotation des actes médicaux n’aura pas été substantiellement révisée, les dépassements seront bien difficiles à refreiner sauf alors à imposer le tiers payant généralisé. Cette dernière mesure (qui a fait couler beaucoup d’encre tandis que Madame Touraine était en responsabilité) pourrait passer pour aussi paramétrique qu’anecdotique. En vérité, et plus fondamentalement, elle consisterait à supprimer l’un des piliers de la charte de la médecine libérale, à savoir le paiement direct des honoraires par le malade (art. L. 162-2 c. sécu. soc.). Rédigée en 1927 par le fondateur de la confédération des syndicats médicaux français (CSMF) – le Dr. Cibrié -, cette charte a jeté les bases de la collaboration des médecins aux assurances sociales. Si une telle réforme devait aboutir – ce qui n’est pas déraisonnable d’imaginer quand on songe aux dispenses de plus en plus nombreuses d’avance des frais de santé –, alors serait une fois encore vérifiée une loi immuable de l’économie de marché : à savoir que c’est celui qui paie qui est le patron ! Il resterait bien peu par voie de conséquence du caractère libéral de la médecine de ville…
[1] Colloque Université de Tours. Sos médecine libérale “Soigner les maux de la médecine libérale pour soulager notre système de santé”. Le style oral de la communication a été conservée.
[2] Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 2021
[3] Insee, 17 déc. 2021.
[4] Voy. not. F. Douet, Antimanuel de psychologie fiscale, Enrick éd., 2020.
[5] Loi n° 2021-1754 du 23 déc. 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, art. 37, VII : 31 mars 2022.
[6] MG France, conférence de presse, 18 mars 2021.
[7] Quelques médecins conventionnés en secteur 1 sont autorisés – sous certaines conditions (notoriété, titres, travaux) – à pratiquer de façon permanente des dépassements d’honoraires (DP). Tous les autres (i.e. quel que soit le secteur d’exercice) sont fondés – sous d’autres conditions (exigences du patient) – à pratiquer un dépassement exceptionnel (DE).
[8][8] Loi n° 2019-1446 du 24 déc. 2019 ; art. L. 1435-4-2 csp, D. n° 2020-1666 du 22 déc. 2020 ; art. R. 1435-9-1 et s. c. santé publ. ; arr. du 2 février 2021 relatif au contrat type du contrat de début d’exercice.
[9] IGAS, Les dépassements d’honoraires médicaux, avr. 2007, p. 3.
[10] Voy. not. R. Marié, Le dédale du contentieux des dépassements tarifaires des médecins libéraux, Rdss 2016.107.
[11] R. Marié, op. cit. Voy. encore Th. Tauran, L’assurance maladie et les anomalies de tarification, Rdss 2013.1086.
[12] Voy. égal. en ce sens, R. Marié, Dépassements d’honoraires et augmentation de l’offre à tarifs opposables : entre renoncements et timides avancées, Rdss 2013.101.
[13] Convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, 25 août 2016, art. 85.
[14] J. Bourdoiseau et V. Roulet, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 : aspects concernant les entreprises, Gaz. pal. 7 mars 2017.
[15] Voy. not. J. Bourdoiseau, La Grande sécu : une utopie constructive ?, Jcp G. 2022.50.
[16] https://www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php