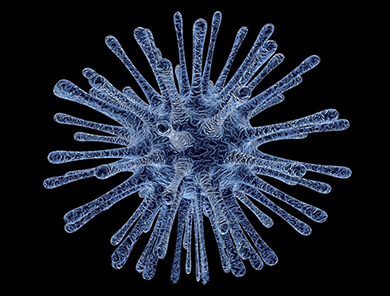1. – Mission de service public au singulier ?. – À notre connaissance, le service public de la réparation du dommage corporel sous étude, dont l’Office est une incarnation tout à fait remarquable, ne s’est jamais donné complètement à voir tant d’un point de vue conceptuel que fonctionnel. Aussi nous limiterons-nous dans cette première contribution à poser quelques premiers jalons.La question de savoir ce qu’est l’Oniam ne pose guère de difficulté. Institué par la loi, l’Office est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la Santé (CSP, art. L. 1142-22, al. 1er). À la question de savoir ce qui est attendu par la puissance publique de sa création, on répondra avec un éminent auteur : la réalisation d’« une mission […] définie, organisée et contrôlée par une personne publique en vue de délivrer des prestations d’intérêt général à tous ceux qui en ont besoin »Note 1. C’est limpide. Mais au fait : de quelle mission s’agit-il précisément ? C’est qu’il n’y a rien de très commun a priori entre la réparation des dommages corporels causés sans faute par un professionnel ou un établissement de santé et la compensation des atteintes cardio-pulmonaires causées par la faute d’un fabricant de médicaments, pour ne prendre que ces deux hypothèses de travail. Mais peut-être n’y a-t-il pas matière à commenter. Que dit le plan d’exposition systématique du Code de la santé publique ? Eh bien qu’il s’agit dans les deux cas de figure de compenser des risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé qui se sont malheureusement réalisés (CSP, art. L. 1142-1 et s.). Ce dernier système profitant à tout un chacun, c’est d’intérêt général dont il est question au fond. Il y a donc bien service publicNote 2. C’est ce que nous enseigne la science administrative. Il ne s’agirait pourtant pas qu’on cofondît réalisation d’un risque et commission d’une faute. Où l’on voit – en poussant d’un cran le problème – que la nature manifestement hybride de l’Office pourrait fort bien compliquer son régime juridique ; qu’il y a donc à craindre quelques contradictions internes.
2. – Lois du service public et gratuité. – Quelles que soient nos hésitations, il reste que le fonctionnement de l’Office obéit à quelques grandes lois du service public : continuité, mutabilité, égalitéNote 3. Lois auxquelles on pourrait ajouter dans le cas particulier « gratuité », laquelle n’est pas sans interroger. C’est que ce dernier principe de fonctionnement interdit à l’Office de recourir contre les éventuels débiteurs finaux de la réparation aux fins de remboursement des frais engagés tous azimuts. Que les personnes mises en cause soient fautives ou non : le sort réservé à l’Office par la loi est égal en pratique. Ce qui a fait écrire justement à un auteur qu’on privatise les profits ici mais qu’on socialise les pertes làNote 4…
3. – Maintien de la paix sociale. – On ne saurait discuter qu’en inventant collèges et commissions chargés d’instruire les demandes en réparation, le législateur ait été mû par la volonté de bien faire : opérations de maintien de la paix sociale obligeaient sûrement. Force d’intervention dont le déploiement, à l’expérience, est malheureusement à géométrie très variable. Tandis que la foule s’émouvait légitimement du sort de ces milliers de victimes du Médiator, elle réclamait peu dans le scandale des prothèses PIP. Dans les deux cas, la visée esthétique de la démarche (entre autres indications) n’était pourtant pas douteuse. Et de bien peu manifester son émotion du reste dans le scandale des pilules de troisième et quatrième génération (pour ne prendre que ces quelques exemples). En bref, il semble qu’il y ait matière à se demander si ce qu’a fait l’État l’a bien été.
4. – Efficience. – Service public de la réparation du dommage corporel, établissement public administratif, puissance publique, ces mots ont partie liée avec ce qu’on appelle l’étatisation. Dans son rapport d’activité pour 2005, le Conseil d’État écrit « notre société […] se caractérise par une exigence croissante de sécurité [qui] engendre la conviction que tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage doit être rapide et intégrale et que la société doit, à cet effet, pourvoir, non seulement à une indemnisation des dommages qu’elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux qu’elle n’a pas été en mesure d’empêcher, ou dont elle n’a pas su prévoir l’occurrence. » Voilà l’intention. C’est ce par quoi nous vous proposons de commencer, à savoir une approche conceptuelle de la notion de service public de la réparation du dommage corporel. Une fois que cette première approche aura été terminée, après que l’intention aura été explicitée, nous opterons pour une approche fonctionnelle de la notion sous étude. Le temps sera alors venu d’entamer la critique des règles de droit que l’Administration est priée d’observer pour réaliser l’étatisation de la réparation du dommage corporel.
1. La conceptualisation du service public de la réparation du dommage corporel (l’étatisation de la réparation)
5. – En première approche, plus volontiers conceptuelle du service public de la réparation du dommage corporel, l’étatisation est tout à la fois providence et stratégie.
A. – La providence
6. – Apaisement de la société. – Le développement de l’État providence s’est fait par la voie d’un transfert progressif, sous l’empire de la nécessité, mais aussi sous la pression d’une demande sociale de plus en plus insistante, de l’ensemble des problèmes que le jeu normal des mécanismes sociaux ne permettait plus de résoudre. Apaiser des tensions les plus vives : voilà quel était l’enjeu du transfert. Quant à la méthode, elle nous est familière en ce sens qu’elle a consisté pour l’État à prendre les mesures correctives et compensatoires indispensables pour préserver la cohésion sociale. Au fond, c’est vers un État protecteur (de chacun) que la société française a fini par se tourner en général. C’est donc assez naturellement que les victimes de dommages corporels sériels ou d’accidents collectifsNote 5 se sont tournées vers ce dernier, qui a été prié de les assister dans le cas particulier : garantie de la paix et de la cohésion sociales oblige.
7. – Volontarisme social. – Il faut se souvenir de l’émotion collective qui a été provoquée par les scandales sanitaires qui se sont succédé depuis les années 1990 et qui a commandé que des règles spéciales soient édictées pour organiser la juste compensation des blessures infligées au corps des victimes et à l’âme de nos concitoyens plus généralement. Il faut encore avoir à l’esprit qu’« on a assisté tout au long du XXe siècle à l’avènement patrimonial et juridique du corps humain, qui a porté en exécration toutes les atteintes à l’intégrité corporelle. La propriété n’a plus été seulement le pouvoir juridique d’un individu sur les biens, celle-là qui lui donne la mesure de l’exclusion des autres »Note 6. Elle est également devenue le pouvoir d’un individu sur sa personne, celle-là qui impose la correction des atteintes illicites portées par les autres, et ce quoi qu’il en coûte. C’est dans ce contexte très particulier que l’Office a été créé en 2002 et que (entre autres personnes intéressés) nos concitoyens, réunis en associations de patients et d’usagersNote 7, ont prié le législateur d’élargir son domaine d’applicationNote 8 à un point tel qu’on se prend à hésiter relativement à la mission de service public dévolue à cet établissement.En résumé : l’invention du service public de la réparation du dommage corporel est très certainement affaire de volontarisme social. Mais peut-être est-ce aussi (et surtout) de responsabilité politique dont il est question. L’État, qui est providence, nous l’avons dit, est aussi stratégieNote 9.
B. – La stratégie
8. – Scandales sanitaires. – Il faut bien voir que si des producteurs et fabricants de produits de santé ont manqué à leur obligation de vigilance et s’ils ont été priés de compenser les conséquences préjudiciables de leur manque de diligence, l’État a toujours eu sa part de responsabilité dans les scandales sanitairesNote 10. La vaccination contre la grippe A et la commercialisation du valproate de sodium ont été assurées avec le concours de la puissance publique. Dans le premier cas, la production a été vivement encouragée. Dans le second, elle n’a pas été suffisamment contrôléeNote 11.Conceptuellement donc, l’étatisation de la réparation du dommage corporel a commandé l’invention d’un nouveau service public répondant à un besoin d’intérêt général, qui a en horreur le risque et l’atteinte à l’intégrité physiqueNote 12 tandis qu’en toile de fond il était soutenu que la juridictionnalisation était inadaptée ou inopportuneNote 13.
9. – Force gouvernante. – Mais alors, relativement à notre objet d’étude, serait-ce qu’en dehors de l’intervention de l’Administration il n’y aurait point de salut pour les victimes ? De prime abord, la question a quelque chose de saugrenu. La saisine du juge de la réparation par des professionnels du droit rompus à l’exercice est de nature à assurer le rétablissement de l’équilibre détruit par le dommage. Ce n’est pourtant pas vers le service public de la justice, dont on dit pis que pendre, qu’on s’est tournéNote 14. L’étatisation sous étude donnerait donc à penser avec Duguit que la puissance publique serait la seule à même de remplir cette mission de réparation ; que, par voie de conséquence, « son accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complétement que par l’intervention de la force gouvernante »Note 15.
10. – Protection universelle maladie et accident. – Au fond, le service public sous étude ne serait-il pas la manifestation d’une nouvelle solidarité ? La protection universelle qui a été inventée pour la maladie – Puma – (C. assur., art. L. 160-1), et qui a détourné notre système de protection sociale de la logique strictement assurantielle qui l’a longtemps caractérisé, ne vaudrait-elle pas également pour l’accident ? Aussi anecdotique que cela puisse paraître, l’acronyme « Puma » fonctionnerait : « Protection universelle maladie et accidents ». Des risques de l’existence primaire ont été couverts hier par le Gouvernement provisoire de la république française. Le temps n’est-il pas venu de couvrir aujourd’hui des risques plus complexesNote 16 ? Ceci posé, et réflexion faite, ne serait-ce déjà pas le cas ? Si l’on doit à l’Office d’assurer la rémunération de nombreux collaborateurs, d’une foule d’experts médecins et juristes et d’assumer la gestion de leur activité respective ; si on lui doit mille et une avances sur recours et garanties ; c’est pour autant que son activité est financée. Or, ce sont précisément les cotisants et les contribuables qui, en fin de compte, et en première intention, solvabilisent l’action de ce dernier établissement public administratif. Pour mémoire, l’office est financé au principal par une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie (et non par les créateurs de risques) (CSP, art. L. 1142-23)Note 17.
11. – En guise de conclusion intermédiaire , ne serions-nous pas sur la voie de la synthèse des modèles archétypaux bismarkien et beveridgien qui sont bien connus en droit de la sécurité sociale ? Au premier, nous emprunterions l’intention. Ne pourrait-on pas considérer avec Bismark que « l’État a pour mission de promouvoir positivement par des institutions appropriées et en utilisant les moyens de la collectivité dont il dispose, le bien-être de tous ses membres […] »Note 18 ? Au second, Beveridge, nous prendrions la réalisation. Optant avec ce dernier pour une approche assistancielle ou universelle, la couverture sociale sous étude ne serait plus offerte aux seules personnes assurées mais à toutes les victimes pour la seule raison qu’elles ont été atteintes dans leur intégrité corporelle.Partant, la protection proposée par le service public de la réparation du dommage corporel serait tout à la fois universalité, unité et uniformité : universalité de la protection sociale en quelque sorte par la couverture de toutes les victimes concernées, uniformité des règles de la réparation construites petit à petit par des aréopages d’experts médecins et juristes (le tout en dehors du juge par hypothèse), unité de gestion administrative de l’ensemble du processus d’indemnisation. La fusion du Fiva et de l’Oniam, imaginée un temps par le ministère de la Santé, s’inscrivait, nous semble-t-il dans ce mouvementNote 19.Aussi stimulant pour l’esprit et nécessaire à la concorde soient l’invention du service public de la réparation du dommage corporel et l’étatisation sous étude, aussi importantes soient les considérations qui ont présidé à la construction de l’ensemble, il y a tout de même matière à douter méthodiquement qu’on ait bien fait. C’est qu’il est loin d’être indifférent de remplacer des juges par des administrateurs. C’est pourtant ce à quoi on aboutitNote 20. Loin de nous de soutenir que la puissance publique ait jamais été désireuse d’organiser un remplacement quelconque. Douter dans le cas particulier que l’étatisation soit la voie qu’il importait de choisir c’est vérifier si le fonctionnement du service public de la réparation du dommage corporel – ou, pour le dire autrement, l’administrativisation de la réparation – est gage d’une organisation optimale de notre État de droit.
2. Le fonctionnement du service public de la réparation du dommage corporel (l’administrativisation de la réparation)
12. – De prime abord, le fonctionnement du service public de la réparation du dommage corporel est plein de vertus. Elles seront mises en exergue pour commencer. Place sera laissée ensuite aux vices dont il n’est pas certain qu’on ait bien vu, nous semble-t-il, que nombre d’entre eux étaient tout bonnement rédhibitoires, ce qui par voie de conséquence interroge quant à la conceptualisation qu’il nous a été donné d’exposer à grands traits, qu’il s’agirait donc de reprendre le moment venu.
A. – Les vertus
13. – Théorie. – Le service public de la réparation du dommage corporel est vertueux entre autres raisons parce qu’il obéit à quelques principes organisationnels, qui ne souffrent pas la critique, qui imposent à l’Administration de répondre effectivement aux besoins collectifs. À l’aune de ces derniers, qui ont été rappelés, on peut défendre que l’existant est notablement amélioré en ce sens que la victime est épargnée des tracas (assez ordinaires du reste mais qui sont loin d’être négligeables) que supporte tout litigant dans un procès.Il est suffisant de renseigner un « formulaire de demande d’indemnisation », qui peut être téléchargé sur le site internet de l’Office, et d’adresser la série de pièces justificatives de son état (V. par ex. CSP, art. L. 1142-24-2) voire de compléter sa demande des pièces manquantes qui auront été réclamées par les « instructeurs gestionnaires indemnisation » (CSP, art. R. 1142-63-8), qui apportent une assistance tout à fait remarquable aux demandeurs. Ce n’est pas tout.Tandis que le procès civil est de type accusatoire en ce sens que la loi abandonne l’instruction de l’affaire à la diligence des parties, la procédure amiable est plus volontiers inquisitoire. Les commissions et les collèges placés auprès de l’Office procèdent à toute investigation utile à l’instruction dit le Code de santé publique. À ce titre, une expertise, dont le coût au passage est supporté par l’office (CSP, art. R. 1142-63-12), peut tout à fait être diligentée sans que le secret professionnel ou industriel ne puisse être opposé (CSP, art. L. 1142-24-4 et R. 1142-63-9, al. 4)Note 21. Il y a plus.Dans le cas particulier, l’étatisation de la réparation épargne la victime des affres du dualisme juridictionnel et simplifie par voie de conséquence son parcours indemnitaire. Le Conseil constitutionnel de relever pour sa part un triple avantage à cette modalité de la réparation : automaticité, rapidité et sécurité de la réparationNote 22.
Technique. – Sur un plan plus technique à présent, et qui prête tout autant à conséquence, l’étatisation de la réparation du dommage corporel est de nature à normaliser les suites de l’instruction. Les critères d’imputation des atteintes renseignées sont affinés au fur et à mesure des séances de travail, de l’évolution des connaissances médicales et de la conviction des uns et des autres qui se forge. Emporté dans son élan, le législateur s’est même aventuré à réformer le dispositif benfluorex en cours de route pour autoriser une auto-saisine du collège d’experts pour le cas où (entre autres cas de figure) des éléments nouveaux seraient susceptibles de justifier une modification d’un précédent avis (ou bien si les dommages constatés sont susceptibles, au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, d’être imputés au procédé actif du médicament incriminé) (CSP, art. L. 1142-45-5, al. 4)Note 23. Il y aurait beaucoup à dire sur cette saisine proprio moutu entre autres qu’il n’est pas certain du tout qu’elle résiste à un contrôle de constitutionnalité a posteriori de la loi qui l’a instituéeNote 24. Il reste que la quantification des atteintes objectivées est plus fine (que ce qui est renseigné dans les barémisations indicatives pratiquées) en raison de l’hyper-connaissance des lésions typiques acquise petit à petit par les experts au gré de l’analyse de centaines voire de milliers de dossiers (focus)Note 25. Pour preuve, tandis que le Code de la santé publique dispose qu’il importe d’avoir recours au barème indicatif du concours médical (CSP, art. L. 1142-1, II, al. 2 et D. 1142-2)Note 26 et que l’on pourrait craindre une application mécaniqueNote 27, à l’expérience les experts ont su se démarquer pour inventer autant que de besoin une barémisation indicative nettement plus aboutie par comparaison. Ce n’est pas tout : une telle concentration des demandes est de nature à recommander quelques inventions et/ou corrections du droit positifNote 28, l’effet loupe en quelque sorte étant de nature à mettre en évidence les silences et insuffisances de la loi tandis qu’il aurait très certainement fallu des années au service public de la justice pour prendre la mesure des nécessités impérieuses de modifier l’existant.Où l’on constate pour résumer que l’étatisation de la réparation du dommage corporel présente des vertus tout à fait remarquables. Une question reste en suspens : les quelques vertus renseignées compensent-elles les quelques vices sur lesquels il importe à présent de réserver l’attention ?
B. – Les vices
14. – La divergence des intérêts. – Au nombre des critiques que l’on peut faire dans le temps imparti, il n’est jamais de bonne méthode de donner à croire que l’on peut valablement formuler des demandes sans le ministère d’un avocat-conseil. Peu important au fond que les agents du service public de la réparation du dommage corporel soient les plus diligents. Là n’est pas la question. Car toute amiable que soit la procédure, elle se change inévitablement en combat. C’est que les intérêts finissent toujours par diverger. Il faut bien voir que l’intérêt de la victime – qui espère invariablement le paiement de dommages-intérêts compensatoires les plus grands – n’est pas nécessairement celui du régleur (l’Office en l’occurrence) – qui est comptable inévitablement des deniers publicsNote 29. D’aucuns répondront que l’Office n’est pas nécessairement le débiteur final de la réparation. Il suffit pourtant que la personne mise en cause dans un avis d’indemnisation ne formule aucune offre ou bien que cette offre soit rejetée en raison de sa petitesse et l’Office sera substitué. Ce dernier peut donc être peu disant à l’heure de formuler à son tour une offre d’indemnisation, le budget de fonctionnement alloué étant contraint et la créance de remboursement pouvant être douteuse. Le ministère d’un avocat prend donc tout son sens. Ceci dit, que l’assistance et la représentation soient rendues obligatoires et ce premier vice devrait tomber de lui-même.Il y a en revanche autrement plus compliqué ou fâcheux, c’est selon. C’est de la co-saisine des juges et des administrateurs dont il est question.
15. – L’articulation des procédures. – Le législateur n’a édicté aucune règle aux fins d’articulation des procédures judiciaire et amiableNote 30 qui auraient été engagées en parallèle. C’est regrettable, car l’invention de deux ordres de règlements des litiges exclusifs l’un l’autre est de nature, par hypothèse, à créer de sacrées divergences, partant de bien regrettables ruptures d’égalité de traitement. On nous opposera qu’il n’y a rien là que de très commun, le principe d’organisation territoriale des juridictions causant le même tracas. Certes, mais la concentration du contentieux en cause d’appel est de nature à lisser ces contingences. Or, le travail à visée indemnitaire de l’Office est réalisé en premier et dernier ressort en quelque sorte. Ceci mis à part, le problème reste entier. En bref : comment régler la contradiction éventuelle entre un jugement qui déboute la victime de ses prétentions et un avis qui fonde cette dernière à être indemnisée ?De prime abord, on n’a jamais vu que le judiciaire devait tenir l’administratif en l’état. Se pose alors la question de savoir à l’ordre de quel juge l’Office, en cas de substitution pour les raisons prescrites par la loi, devra déférer ? À l’ordre de celui qui préside la formation de jugement (incarnation du pouvoir judiciaire) ou bien à l’ordre de celui qui préside le collège ou la commission qui a rendu un avis d’indemnisation (incarnation du pouvoir exécutif) ? Pour mémoire, ces derniers aréopages sont présidés par des magistrats.Si le rejet de la demande d’indemnisation est le fait du juge administratif, on imagine mal que l’Administration ne se range pas sous sa bannière : tropisme obligerait. Mais si le rejet des prétentions du demandeur a été prononcé par un juge judiciaire, qu’il soit civil ou pénal, le problème pourrait rester entier. Aussi bien s’agirait-il d’imaginer une articulation entre les procédures judiciaire et amiable pour lever l’injonction contradictoire dans laquelle se trouve la direction de l’établissement et, ce qui n’est pas la moindre des considérations, garantir une cohérence décisionnelle.Pour ce faire, aussitôt l’Office informé de la saisine d’un juge, la procédure amiable gagnerait à être suspendue. Il faut voir dans cette règle une mesure purement conservatoire qui participe d’une bonne administration du service pendant que les moyens (limités de l’office) sont immédiatement remployés au profit de celles et ceux qui sont désireux que leurs différends soient réglés à l’amiable. Qu’on se rassure toutefois : le droit subjectif à la réparation amiable du demandeur ne saurait jamais être violé. C’est son exercice qui serait tout simplement différé dans le temps. À front renversé, il s’agirait que le législateur inventât une nouvelle cause de sursis à statuer à la manière de ce qui a été fait avec la création de la question prioritaire de constitutionnalitéNote 31. Le demandeur renseignant sa volonté d’entrer en voie de transaction, c’est l’extinction de l’instance dont il sera possiblement question en définitive. Quant au risque d’atteinte au droit au juge au sens de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est connu, il importera de veiller à ce que les délais d’instruction restent raisonnables.Ce n’est pas tout. Il s’agirait aussi de s’interroger sur la loyauté des rapports noués entre toutes les personnes intéressées.
16. – La loyauté des rapports. – En l’état de la législation, les commissions et collèges d’experts placés auprès de l’Oniam instruisent les demandes d’indemnisation et les mises en cause des professionnels de santé et fabricants sans que ces derniers n’en soient immédiatement avertis. Et d’avancer dans l’instruction ou la phase d’information préalable sans aviser plus avant les parties intéresséesNote 32. Ce n’est qu’une fois que le travail a été entamé et qu’un projet d’avis a été rédigé que les commissions et collèges informent les intéressés en les exhortant de conclure en réponse dans des délais extrêmement brefs (qui sont prorogés en pratique). Étude à visée conservatoire à la manière d’une consultation réalisée en cabinet d’avocat, nous rétorquera-t-on. Rien que de très ordinaire en somme à la différence près tout de même qu’en procédure civile il importe de formuler une demande introductive d’instance en bonne et due forme, laquelle une fois faite commande l’observance de toute une série de principes qui garantissent la loyauté des débats : celui de la contradiction et de l’égalité des justiciables dans le procès, qui ne souffrent aucun aménagement. Mais il y a autrement plus ennuyeux de notre point de vue. C’est que l’instruction est menée au vu de la documentation que le demandeur aura bien voulu communiquer à l’Office. Sans jamais faire aucune offense aux usagers du service public de la réparation du dommage corporel, la tentation de la sélection (voire d’une supposition) des pièces probantes est grande. Si donc l’Office ne demande pas qu’il lui soit communiqué tout le dossier médical (peu important dans les mains de quel professionnel il se trouve), le risque existe que l’information du collège ou de la commission soit en tout ou partie tronquée.Où l’on mesure les différences qui restent notables entre les deux services publics sous étude. Mais il est un dernier vice sur lequel nous souhaiterions attirer l’attention. Il a trait au défaut d’homologation de l’accord transactionnel, qu’il s’agirait pourtant de systématiser.
17. – L’homologation. – Tant que les intérêts du demandeur constitué en victime sont protégés, soit par le ministère d’avocat, soit par un régime tutélaire, au fond c’est un accord de bon aloi. L’ennui, c’est qu’il pourrait fort bien arriver que des protocoles transactionnels soient signés alors que la victime est juridiquement incapable pendant qu’elle n’est pas utilement représentée. Et si, par extraordinaire, le procureur de la république n’est pas averti par l’Office – éventuellement substitué – afin qu’une mesure de protection soit prise, l’acte juridique encourra la nullité. Quand sera-t-elle découverte ? Eh bien lorsque la gestion des dommages-intérêts (possiblement capitalisés) aura été si calamiteuse que la victime se retrouvera sans un sou. Alors, la nullité de la transaction ne manquera pas d’être excipée. Le retour au statut quo ante ne pouvant être fait au préjudice de l’incapable, à la fin de l’histoire, celui qui aura payé bien imprudemment sera prié de payer une seconde fois. On accordera toutefois que le risque est de moindre intensité depuis la réforme du droit commun des contrats, le nouvel article 1151 du Code civil renfermant un obstacle – non plus aux seules restitutions comme c’était le cas sous l’empire du droit ancien encore qu’il n’était que relatif(V. également C. civ., art. 1352-4 [art. 1312 ancien]) – mais bien à l’action en nullité. Il reste que, pour bien faire, l’homologation judiciaire nous semble-t-elle de nature à palier ce vice et refréner les velléités de contestation : service public n’obligerait-il pas ?
18. – Interrogation et ouverture. – On écrit que le système judiciaire français serait incapable de répondre aux besoins des victimes de sinistres sérielsNote 33 ; que les dommages de masse ne sauraient être son affaire. Qu’il nous soit tout même permis de rappeler que le service public de la justice, lorsqu’il a été saisi, n’a pas été ni moins vite ni plus lentement que le service public de la réparation du dommage corporel ; que le juge a su rendre à chacun de qui était dû dans des affaires qui ont échappé à l’Office.Aussi, pour conclure, et faute d’avoir épuisé le sujet, permettez-nous de poser une question. N’a-t-on jamais objectivé une carence si considérable du service public de la justice qu’il ait fallu prendre pour une habitude de substituer des administrateurs aux juges et, ce faisant, inventer une concurrence qui ne dit pas son nom et ne rend pas complètement justice à toutes les personnes concernées ?Une exhortation poétique pour terminer : vingt fois sur le métier remettez l’ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelques fois et souvent effacez. Vingt années se sont écoulées depuis que l’Office a été créé. Le temps de la réforme de l’existant ne serait-il pas venu ??
Note : Article qui est le fruit d’une participation au colloque organisé par l’Université de Paris et le professeur Guégan le 04 mars 2022 à la Sorbonne intitulé : “Responsabilité médicale – 2002-2022 :Vingt ans de coexistence de la responsabilité et de la solidarité en matière médicale” publié à la revue Responsabilité civile et assurance (avr. 2022).
Note 1 D. Truchet, Droit administratif : PUF, 9e éd., 2021, p. 50 et s.
Note 2 P.-L. Frier et J. Petit, Droit administratif : LGDJ, 15e éd., 2021, n° 375 et s.
Note 3 J. Morand-Devilier, P. Bourdon et F. Poulet, Droit administratif : 17e éd., 2021, p. 509. – Comp. D. Truchet, Droit administratif : PUF, 9e éd., 2021, p. 371, n° 1066 (solidarité, équité, efficacité).
Note 4 L. Bloch, Interrogation autour de la réforme du système d’indemnisation des victimes du valproate de sodium : Resp. civ. et assur. 2019, alerte 23. – Sur la dialectique justice corrective vs justice distributive aux fins de description du droit de la responsabilité civile français, V. Rivollier, Les fonctions de la responsabilité civile face à la socialisation des risques en matière de dommages corporels, mél. P. Ancel : Larcier, 2021, p. 541. Il importerait qu’on s’interrogeât aussi sur l’effet d’aubaine créé par le dispositif amiable, qui autorise les personnes contre lesquelles un avis d’indemnisation a été rendu de transiger à l’aune des pratiques et bases de couverture du risque de l’Office.
Note 5 A. Guégan, Dommage de masse et responsabilité civile, préf. P. Jourdain, t. 472 : LGDJ, 2006. – F. Bibal et Cl. Bernfeld, Les dommages sériels causés par des produits de santé : Gaz. Pal. 19 janv. 2021, p. 77.
Note 6 A.-M. Patault, Dictionnaire de la culture juridique : PUF, 2003, v° propriété.
Note 7 Ch. Saout, La démocratie sanitaire à travers l’action des associations de patients et d’usagers (entretien) : RJSP 2021.6, n° 21.
Note 8 V. not. E. Terrier et J. Penneau, Médecine : réparation des conséquences des risques sanitaires – organes de la procédure : Rép. civ. Dalloz, 2020, n° 415.
Note 9 J. Chevallier, Les configurations de l’État stratège : RFFP nov. 2020, p. 27.
Note 10 Igas, Enquête sur le Médiator, janv. 2011 (www.igas.gouv.fr/spip.php ? article162). – Igas, Enquête relative aux spécificités contenant du valproate de sodium, févr. 2016 (www.igas.gouv.fr/spip.php ? article522). – CE, 1re et 6e ch. réunies, 9 nov. 2016, n° 393902 et 393926 : Lebon. – J. Sorin, Médiator : partage des responsabilités entre l’État et Servier : AJDA 2017, p. 2140. – R. Pellet, La défiance, du sanitaire au social : RDSS 2021, p. 143. – O. Gout, L’Oniam, un établissement à multiples facettes : Gaz. Pal. 16 juin 2012, p. 37.
Note 11 Le législateur s’est d’ailleurs appliqué par la suite à améliorer l’existant (L. n° 2011-2012, 29 déc. 2011, relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé) tandis que le juge n’a pas manqué de sanctionner tous les protagonistes de l’affaire, l’agence nationale de santé et de sécurité du médicament comprise (T. corr. Paris, 31e ch., 29 mars 2021 : condamnation des laboratoires Servier des chefs de tromperie aggravée, d’homicides et blessures involontaires ; 180 millions de dommages et intérêts et plus de 2,7 millions d’ euros d’amende. Condamnation de l’agence – ex Afssaps à 303 000 € d’amende pour avoir tardé à suspendre l’autorisation de mise sur le marché).
Note 12 F. Ewald emploie pour sa part la notion de « services publics de responsabilité ». C’était il y a 35 ans. Et l’auteur d’esquisser « le schéma général du nouveau droit de la responsabilité articulé sur le principe d’un droit de l’accident [qui] ne met plus face à face deux sujets que sont l’auteur et la victime du dommage, mais trois acteurs : la victime, le responsable et une collectivité, représentée par un ou plusieurs organismes d’assurance » (Histoire de l’État providence. Les origines de la solidarité, Grasset, 1996). En bref, et pour présenter les choses autrement, préférez la socialisation du risque et l’Office à l’assurantialisation ; nous devrions alors rejoindre assez facilement la thèse de l’auteur. V. également G. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, préf. R. Rodière : LGDJ, 1965.
Note 13 F. Leduc, Solidarité et indemnisation in La solidarité, Travaux de l’association Henri Capitant, t. LXIX : Bruylant, 2019.
Note 14 V. not. S. Jouslin de Norray et Ch. Joseph-Oudin, Le dispositif spécifique d’instruction des demandes d’indemnisation concernant les préjudices imputables au valproate de sodium : un avantage pour les droits des victimes ? : RLDC 2017, n° 146.
Note 15 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. 2 : 3e éd., 1928, p. 61. – Cité par J. Petit et P.-L. Frier, Droit administratif : LGDJ, 13e éd., 2019, n° 363.
Note 16 F. Kessler, Complément ou substitution à la sécurité sociale ? Essai sur l’indemnisation sociale comme technique de protection sociale : Dr. soc. 2006, p. 191.
Note 17 Comp. le financement du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques qui est intéressant à cet égard (C. rur., art. L. 253-8-2).
Note 18 Reichstag, discours, 17 nov. 1881.
Note 19 V. Th. Leleu, Oniam. Vers la création d’un géant de l’indemnisation, à propos du rapport de l’Igas proposant la fusion de l’Oniam et du Fiva : Resp. civ. et assur. 2021, étude 12.
Note 20 V. également en ce sens, J. Knetsch, Le nouveau dispositif d’indemnisation des victimes du Médiator issu de la loi du 29 juill. 2011 : Resp. civ. et assur. 2011, étude 14, spéc. n° 9.
Note 21 V. not. J. Knetsch, Le nouveau dispositif d’indemnisation des victimes du Médiator issu de la loi du 29 juill. 2011 : Resp. civ. et assur. 2011, étude 14, spéc. n° 5 et s.
Note 22 Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, cons. 16.
Note 23 Créé par la L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, art. 187. – V. également CSP, art. L. 1142-24-12, al. 6 (saisine du collège valproate de sodium).
Note 24 V. not. et par comparaison : J. Bourdoiseau note ss Cons. const., 15 nov. 2013, n° 2013-352 QPC : LPA 30 mai 2014.
Note 25 V. également en ce sens, L. Bloch, Scandale de la dépakine : le « fonds » de la discorde : Resp. civ. et assur. 2016, alerte 24. – A. Guégan, Les nouvelles conditions d’expertise au sein du dispositif pour l’indemnisation des victimes du valproate de sodium : Gal. Pal. 19 janv. 2021, p. 83. – L. Friant, L’indemnisation extrajuridictionnelle des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés : bilan et perspectives : RLDC 2020, n° 183.
Note 26 Barème annexé au D. n° 2003-314, 4 avr. 2003, ann. 11-2.
Note 27 J. Bourdoiseau, La réparation algorithmique du dommage corporel : binaire ou ternaire ? : Resp. civ. et assur. 2021, étude 7.
Note 28 Il pourrait être soutenu qu’une telle initiative est douteuse faute pour les administrateurs, aussi experts soient-ils, d’être fondés à se départir des règles de droit applicable dans le cas particulier. Il se pourrait même qu’il y ait plus à dire encore. C’est qu’il n’est pas acquis du tout que lesdits administrateurs aient jamais été priés par le législateur de trancher en droit. C’est pourtant à l’aune du droit positif que les demandes sont appréciées : tropisme oblige (qui gagnerait à être interrogé).
Note 29 V. not. sur cette problématique à propos du Fiva, Ph. Brun, Droit de la responsabilité extracontractuelle : LexisNexis, 2018. À noter encore que la présence éventuelle du chef des services benfluorex et valproate de sodium dans les séances des collèges éponymes, ce dernier ayant la responsabilité de formuler une offre transactionnelle en cas de substitution de l’Office, donne-t-elle à penser : ordonner la dépense (à tout le moins participer même sans voix délibérative à la délibération) et payer ne font pas bon ménage en général.
Note 30 Le législateur a toutefois cherché à prévenir l’enrichissement injustifié du demandeur par une information circonstanciée (V. art. Knetsch, Le droit de la responsabilité et les fonds d’indemnisation : th. Paris 2, 2011, n° 338).
Note 31 Ord. n° 58-1067, 7 nov. 1958, art. 23-2.
Note 32 F. Bibal, La contradiction n’est pas respectée devant les CCI : Gaz. Pal. 15 févr. 2022.
Note 33 S. Jouslin de Noray et Ch. Joseph-Oudin, Le dispositif spécifique d’instruction des demandes d’indemnisation concernant les préjudices imputables au valproate de sodium : un avantage pour les droits des victimes ? : RLDC 2017, n° 146.