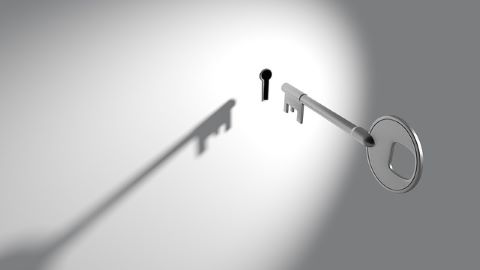« Bas les masques » ![1] Il me faut vous révéler un secret…de Polichinelle. Je suis un juriste, mais je ne suis ni processualiste, ni juge. Pire : la délibération est étrangère à mes préoccupations premières d’obligationniste, à tout le moins de prime abord. Quant au secret, je n’en suis pas dépositaire. On a connu des débuts plus encourageants. Ceci étant, et pour dire la vérité, le droit qui m’occupe au quotidien est le terrain d’élection des inventions les plus ingénieuses ou les plus folles du juge ; c’est selon. De fait, le secret de la délibération m’interroge.
Délibération. Entendue strictement comme le processus de décision juridictionnelle[2], la tentation est grande d’établir un lien très fort entre délibération – le donné – et motivation – le construit. – Bien qu’on nous ait exhortés ce matin de ne pas y succomber, j’ai cédé, pour ma part, à la tentation. Le sujet qui m’échoit de traiter a partie liée avec la justification rationnelle des décisions de justice. À l’expérience, le construit ne saurait jamais être complètement saisi sans que le juge ne s’expliquât sur le donné. Mais voilà, le juge – plus spécialement les conseillers des cours régulatrices – est bien souvent taisant sur la ou les raisons qui ont présidé à sa décision. Rien n’est dit des discussions pesées, des choix débattus, qui dépassent le strict syllogisme mais aussi le strict litige et encore le strict juridisme[3], et qui impriment pourtant au droit positif un mouvement vers le droit idéal. Exit les « motifs des motifs ». La délibération se tient sous le sceau du secret.
Le secret est exclusif. Connu d’un nombre limité de personnes, il est recherché avec inquisition : « tous les hommes ont, par nature, le désir de connaître » (Aristote)[4]. « Cette inspiration instinctive de l’être à combler le sentiment d’un manque, d’une incomplétude »[5], est une aspiration invincible de l’homme du siècle nouveau, qui est, peu ou prou, assouvie par les technologies de l’information et de la communication, mais non par la technique juridique, à tout le moins pas complètement. Le droit est encore pensé comme « une religion à mystères, un dogme révélé et inaccessible à la raison »[6]. Mais le droit a ses raisons…
Suggérer la levée du secret relève de la provocation, sinon de la subversion. On oppose classiquement « le respect d’un secret absolu du travail créatif du juge, la protection de son indépendance par l’effet de l’anonymat, la garantie de l’autorité de sa décision, considérée comme monolithique, en quelque sorte impériale et, en tant que telle, forçant le respect »[7]. Des quatre vertus cardinales (prudence, tempérance, courage) la justice présente cette particularité d’être un rapport aux autres, en l’occurrence un rapport d’autorité. Une fois les intérêts en conflits confrontés, le juge doit dire le droit (savoir) et trancher le litige (pouvoir)[8]. Œuvre humaine, l’œuvre du juge est imparfaite par nature[9]. Par crainte d’accuser un peu plus cet état, et d’empêcher la concordia discordantium, on tait le doute et/ou le dissentiment du juge, et ce religieusement[10].
À l’exception notable des membres de la juridiction administrative[11], tout juge – judiciaire et constitutionnel –, lors de sa nomination à son premier poste, prête serment « de garder religieusement le secret des délibérations »[12] (caractère inclusif du secret). Le sacrement est rappelé dans les saints codes de procédure[13] et sanctionné conjointement par le droit disciplinaire[14] et le droit pénal[15] (caractère exclusif du secret). La règle du secret est absolue, écrit le président Canivet[16]. C’est un « devoir sacré » écrivit, en son temps, le procureur général Dupin[17]. Notre tradition[18], a professé le Doyen Vedel, ne va pas dans le sens de la publicité du dissentiment et l’on ne peut pas savoir quelques dégâts produirait le changement, le temps qu’il prendrait à s’acclimater et les effets inattendus qu’il entraînerait »[19]. La messe paraît être dite. Et pourtant. Élevé au rang de principe général du droit public français par le Conseil d’État[20], le secret n’a pas été canonisé dans le tout récent Recueil des obligations déontologiques des magistrats, ni dans Les principes déontologiques rédigés par le Réseau européen des conseils de la justice, sinon de façon très incidente[21]. Réflexion faite, le secret paraît tenir désormais moins de la raison que de l’incantation.
Incantation. On écrit que « les juristes font usage d’un mélange bigarré d’habitudes intellectuelles qui sont admises comme des vérités premières et cachent ainsi le contenu politique de la recherche des vérités (…). »[22] Le secret de la délibération est topique. Les réactions épidermiques des cours régulatrices à la liberté, toute relative, prise par les juges du fond prouvent trop. En l’état du droit positif, toute décision du juge judiciaire ou du juge administratif, qui mentionne qu’elle a été prise à l’unanimité des voix ou qui indique avoir été rendue à la majorité de tant de voix, encourt la cassation pour violation de la loi du secret. Pareille jurisprudence donne à penser. Les décisions critiquées ne portent nullement atteinte à l’indépendance du juge. Bien mieux, elles manifestent un effort créatif du juge pour garantir l’autorité de sa décision : faire comprendre, par prétérition certes, non pas faire croire. En instituant la Cour européenne des droits de l’homme, les membres du Conseil de l’Europe n’ont du reste pas confondu secret de la délibération et mise au secret du juge. Avant d’entrer en fonction, le juge de Strasbourg jure d’observer le secret des délibérations[23]. En exercice, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’autorise à publier des opinions séparées[24].
Les dissensions, quant au secret de la délibération, sont rares : tradition oblige. La parution, dans le courant de l’année 2010, des essais de deux anciens membres du Conseil constitutionnel[25] placent le sujet au cœur de l’actualité littéraire, peut-être, juridique, certainement. Pierre Joxe prend position publique sur des questions ayant fait l’objet de décisions de la part du juge de la rue Montpensier[26]. Il regrette qu’on l’ait invité à taire ses opinions différentes.
Il ne s’agit nullement de porter atteinte, par goût de la dispute, à l’imperium du juge. Il ne s’agit pas plus de faire mien l’enseignement d’Aristote, qui écrit que la fonction de la Réthorique doit avoir pour tâche de gagner l’adhésion d’un auditoire non spécialisé, des « auditeurs qui n’ont pas la faculté d’inférer par de nombreux degré et de suivre un raisonnement depuis un point éloigné. »[27] L’art du juge est difficile et la critique facile. Je pense avec M. le professeur Mouly que « l’hésitation que suscite le secret du délibéré doit être surmontée car l’opinion [du juge sur la délibération et/ou la motivation] ne révèle pas le délibéré ; elle révèle l’opposition d’arguments fondés. »[28] « Certains peuvent préférer maintenir un voile pudique sur le processus de fabrication des décisions au motif que dévoiler tous les mystères désenchanterait le public ; d’autres, préférer rendre public la confrontation des opinions au motif que la connaissance des débats est une condition de l’acceptation de la rationalité de la décision. »[29] J’opine en ce dernier sens.
Sur cette pente, je défendrai, en premier lieu, que le secret de la délibération doit être levé (pourquoi). Je présenterai, en second lieu, les modalités de la levée du secret de la délibération (comment). Vous l’avez compris, pourquoi, comment seront les deux temps de ma communication.
I.- Un secret de la délibération à lever (pourquoi)
On dit ordinairement que la valeur d’un principe se compte au nombre de ses exceptions. Le principe du secret de la délibération comptant, d’une part, nombre de défloraisons (A), il n’est plus de raison, d’autre part, de le maintenir (B).
A.- La défloraison du secret
États de la défloraison. La défloraison du secret est d’intensité variable. Tantôt, on feint de ne pas parler de la délibération. Tantôt, on se plait à parler de la délibération. Pour faire état des différents états de la défloraison, je verrai, d’abord, la défloraison par prétérition (1), ensuite la défloraison par expédition (2).
1) La défloraison par prétérition
Défloraisons du fait du « normateur ». En élevant le secret du délibéré au rang de principe général du droit, le Conseil d’État a réservé le cas où une exception formelle consacrée par la loi viendrait s’opposer à l’interdiction de divulguer une opinion séparée. Et bien, le législateur a autorisé, pour sa part mais sans le dire, qu’on déflorât, le secret en droit de l’arbitrage. Le juge s’est autorisé, pour la sienne, à déflorer, par prétérition, le secret en droit tout court.
Défloraison du fait du législateur. En droit de l’arbitrage, l’arbitre minoritaire est autorisé par la loi à ne pas signer la sentence, et ce sans préjudice de sa validité (C. pr. civ., art. 1473, al. 2). La nullité serait dangereuse en la matière, considère-t-on[30]. Se faisant, la personne qui siège dans le tribunal arbitral manifeste qu’elle n’approuve pas la sentence rendue par la majorité de ses collègues ; l’arbitre se désolidarise de l’opinion majoritaire. Étonnement, la plupart des auteurs considère que l’opinion séparée d’un arbitre est prohibée par le Code de procédure civile, en l’occurrence par l’article 1469, qui dispose que « les délibérations des arbitres sont secrètes »[31]. Mais, « l’arbitre qui rend publique une opinion particulière est-il plus reprochable que celui qui refuse sa signature »[32]? Je ne le pense pas. Le premier a en revanche le mérite d’expliciter son opinion séparée. Voilà une heureuse contribution au droit, à l’art du juste et du bien : « jus est ars aequi et boni » (Ulpien et Celse).
Pragmatique, la Cour d’appel de Paris considère du reste que « le secret du délibéré, qui n’est pas plus une cause de nullité de la sentence en droit international qu’en droit interne, ne fait (…) pas obstacle à l’expression d’opinions dissidentes ou séparées. »[33] C’est une litote. La formule négative – l’énonciation juridique – ne trompe pas : il s’agit d’une défloraison du secret du fait du juge, par prétérition. Il en une autre qui doit retenir l’attention.
Défloraison du fait du juge. La Cour de cassation pratique depuis plusieurs années, un marquage de ses arrêts. Ce marquage doctrinal est étroitement fonction de l’intérêt normatif de l’arrêt rendu. Le lecteur est ainsi avisé de la composition de la chambre et de la portée de la décision. Il est également informé des noms du rapporteur et de l’avocat général, ainsi que des noms des avocats en demande et en défense[34]. À l’analyse, pareilles informations participent à déflorer le secret de la délibération. En raison de la sophistication croissante du contentieux (ex eo quod plerumque fit), on constate une spécialisation des conseillers, qui donne au rapporteur une autorité importante, trop a-t-on écrit[35]. Pour les spécialisations étroites, le rapporteur est unique. Au fil des arrêts, les initiés sont en mesure de connaître la doctrine du rapporteur et d’apprécier sa portée sur la décision rendue. C’est particulièrement vrai s’agissant des arrêts rendus en formation simple de trois magistrats en matière civile (C. pr. civ., art. L. 431-1, al. 1er). Consciemment ou non, il se développe entre le rapporteur et la matière, un rapport de type « responsabilité-appropriation », écrit Guy Canivet. Partant, « chacun d’eux est ainsi en mesure de suivre de près la réception des arrêts par la doctrine, elle aussi spécialisée, et d’engager avec les auteurs, de manière plus ou moins étroite, directe et suivie – ou simplement implicite par publication interposées – une relation dialogique sur la pertinence des solutions. »[36] Mais voilà, on réserve la forme dialogique, propre à toute vraie communication, pour expliquer les conceptions qui sont à la fois assez importantes et assez mûries.
Ce désir d’explicitation, qui est du reste satisfait par la communication du rapport à la demande du lecteur, est topique d’une seconde forme de levée du secret de la délibération : la défloraison par expédition.
2) La défloration par expédition
Droits d’ici et d’ailleurs. La défloraison par expédition, qui consiste à faire ouvertement état de la délibération, est pratiquée tant en droit interne qu’en droit comparé.
Droit interne. En droit interne, on doit la levée du secret de la délibération aux politiques de promotion des décisions juridictionnelles rendues par la Cour de cassation, le Conseil d’État ou le Conseil constitutionnel. Si elles sont heureuses parce qu’elles satisfont à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité du droit[37], elles s’avèrent être malheureuses pour les zélateurs du secret de la délibération. C’est que la ligne de fracture est ténue entre information et confession. Les communiqués de presse publiés (sur support papier ou électronique) par les cours régulatrices, en l’occurrence par le Service de documentation et d’études de la Cour de cassation (SDE) ou par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État, et les panoramas de jurisprudence rédigés par des conseillers référendaires prouvent trop. Certes, bon nombre ajoutent peu au texte de l’arrêt et s’assurent seulement de la bonne compréhension de la portée des arrêts rendus. De ce premier point de vue, ils ont une fonction pédagogique d’information et de vulgarisation[38]. Mais, il en est d’autres qui explicitent la motivation, voire y ajoutent, en signalant par exemple les raisons qui ont justifié le choix d’une interprétation[39]. De ce second point de vue, ils ont une fonction scientifique d’interprétation. À l’occasion de la publication de la première « chronique de la Cour de cassation » au Recueil Dalloz (2007, n° 13), il est écrit en propos liminaires que « l’objectif de cette chronique est d’éclairer le sens de certaines décisions, de révéler les influences extérieures qui ont pu éventuellement conduire à adopter telle ou telle solution, d’identifier à travers elles les lignes directrices de la jurisprudence de la Cour régulatrice. »[40] Le juge n’entend décidément pas être mis au secret. Dans le dessein de faire comprendre, et non de faire croire, il use à l’envie des supports de communication[41]. Le juge sait publier, consciemment ou non, des opinions dissidences dans les notes sous arrêts proposées dans le Bulletin d’information des arrêts de la Cour de cassation[42]. Le juge défend que la publication du rapport du conseiller, et dans une mesure moindre la publication des moyens de cassation, est un « élément précieux pour comprendre la ratio decidendi d’une jurisprudence », qu’il est « un moyen d’éclairer la solution finalement rendue et de comprendre le raisonnement suivi par l’arrêt dont la motivation cursive ne rend pas nécessairement compte (…)[43] Le juge s’évertue à commenter ses décisions, dans les revues et les mélanges[44], bravant, s’agissant à tout le moins des conseillers de la Cour de cassation, la défense itérative du président Truche[45]. Le juge fait œuvre de doctrine dans ses rapports annuels d’activité à l’occasion desquels les débats sont révélés ainsi que les influences juridiques et extra-juridiques[46] qui ont conduit à l’arrêt. Et il y a mieux ou pire, c’est selon. À l’expiration d’un délai de 25 ans, la loi autorise la publication du compte rendu des séances du Conseil constitutionnel, rédigées par son secrétaire général[47]. Qu’est-ce que cette pratique sinon une violation éclatante, mais à rebours, du secret de la délibération ?
Droit comparé. La pratique des opinions séparées est répandue en droit conventionnel et dans les droits étrangers. Et on n’entend aucun crie d’orfraie. L’idée ne viendrait à personne de soutenir que les juges de Strabourg ou que leurs homologues ordinaires de Santiago du Chili ne sont pas indépendants. Mais comparaison n’est pas raison. Aussi je n’en dirai pas plus. Et puisqu’il s’agit de raison. Il importe à présent, avec prudence, de faire état des déraisons du secret.
B.- Les déraisons du secret
Le secret ne me paraît pas être frappé au coin…de la raison, à tout le moins tel qu’on l’appréhende classiquement. En consacrant le secret de la délibération, il semble, à la réflexion, que le législateur ait eu pour intention première d’interdire aux juges et arbitres de délibérer en présence des parties ou des tiers et de proscrire que celui qui n’opine pas dans le sens de ses pairs ne révèle les positions prises en conscience par chacun d’eux. Au soutient de cette thèse, j’invoquerai l’absence de nullité textuelle de la décision en cas de défloraison du secret[48]. J’ai bien conscience en disant cela de réduire notablement la portée du secret, à tout le moins sa portée théorique. Car, en pratique, ladite portée est réduite à une portion congrue mais ramassée à sa quintessence.
L’exception du secret de la délibération n’emporte pas la conviction. Je ne suis ni convaincu que le silence observé sur les motifs des motifs garantisse l’autorité du jugement, ce que j’exposerai d’abord (1), ni qu’il participe de la sécurité juridique, ce que présenterai ensuite (2).
1) Autorité du jugement
On dit que l’autorité du jugement serait garantie par le secret de la délibération, lequel protégerait par ailleurs l’indépendance du juge[49]. En disant cela, il semble que l’on confonde autorité – auctoritas – et pouvoir – postestas. – Auctoritas vient d’augere, qui veut dire augmenter. « Elle est ce supplément d’âme qui anime et intensifie un pouvoir »[50], en l’occurrence le pouvoir du juge de trancher le litige (C. pr. civ., art. 12). En somme, l’autorité du jugement ne saurait être exclusivement organique ou institutionnelle. Le statut du locuteur ne confère pas ipso facto son autorité à un énoncé[51]. S’il importe au juge de déclarer publiquement, au nom du peuple français (C. pr. civ., art. 454), laquelle des prétentions en conflit est justifiée ; il importe tout autant qu’il expliquât au justiciable, quand même serait-il juge de cassation, les raisons de tous ordres pour lesquelles ce dernier subit, tant d’un point de psychologique et social qu’économique, les conséquences coûteuses de sa défaite[52]. Si l’on accorde qu’« une décision de justice ne puise sa rationalité que dans la confrontation des arguments qui l’a fait naître (…), alors on conviendra que la connaissance des débats est une condition de l’acceptation de la rationalité de la décision. »[53] En ce sens, un assistant à la Cour constitutionnelle d’Allemagne écrit que « l’opinion dissidente transfère les raisons de respecter une décision de justice de l’autorité institutionnelle à la qualité du raisonnement. »[54] Et un conseiller à la Cour de cassation d’affirmer que « l’opinion dissidente renforce l’indépendance du juge, en la rendant plus visible, plus éclatante. »[55]
La levée du secret concourt à l’acceptation par le justiciable de la décision. Elle renforce encore la motivation, laquelle est du reste un droit du justiciable[56].
En droit conventionnel, l’opinion séparée participe de la motivation des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Le titrage de l’article 45.2 de la convention est en ce sens (in « Motivations des arrêts et décisions »). On peut affirmer avec d’autres que : « la pression que représente l’éventualité de la publication d’opinions dénonçant l’insuffisance de l’argumentation de la majorité entraîne une motivation mieux étayée »[57] (fonction préventive de la « levée » du secret de la délibération). Pour cause : « pour contredire un adversaire ou un partenaire, il faut trouver un argument de rang plus élevé que les siens. »[58] Source vivifiante du droit, l’exposé et la critique du donné comme du construit promettent un foisonnement de concepts et de solutions juridiques inédites[59] (fonction curative de la « levée » du secret de la délibération). Ils sont annonceurs d’une ingénierie juridique au service du beau droit, « celui seul reçu (accipitur) par le bon peuple pour tenir lieu de vérité (pro veritate). »[60]
En disant cela, j’entends bien les critiques formulées par les opposants à la levée du secret de la délibération. Mais les prédictions de grands troubles dans la force de la jurisprudence ne convainquent pas. Je pense au contraire que l’exposé ou la critique de la délibération et/ou de la motivation participent de la sécurité juridique.
2) Sécurité juridique
Prévention. Si l’on s’accorde pour dire que la décision rendue par le juge est spéciale et relative, il est suffisamment su que quelques autres, rendues par la Cour de cassation et le Conseil d’État, voire par une cour administrative d’appel[61], ont une portée générale et absolue. Il est des circonstances dans lesquelles l’article 5 du Code civil est tacitement abrogé, sur le commandement exprès, au demeurant, de l’article 4 du Code civil. Ces décisions concourent à la formation d’une jurisprudence normative[62]. Comme le discours législatif, le discours juridictionnel comporte des énoncés[63]. On nombre des « normateurs », il importe donc de compter le législateur (interne et communautaire) et le juge[64]. Caractérisé par sa finitude, le droit est en perpétuel changement : vingt fois sur le métier, l’ouvrage doit être remis. L’encre de la loi de sauvegarde des entreprises est à peine sèche qu’elle a déjà été modifiée et vient de l’être une énième fois[65]. Aussi, l’on doit pouvoir préparer les revirements de jurisprudence comme on prépare les changements de législation[66]. La jurisprudence est la science des prudents. Mais l’invention d’un droit transitoire prétorien, à laquelle on songe spontanément, n’est pas sage[67]. Si l’on ne saurait discuter qu’un pareil droit assure la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l’impréparation, de règles nouvelles de procédure, il n’en reste pas moins que l’application dans le temps de la jurisprudence prive le demandeur au pourvoi, qui seul a porté le poids de l’aléa judiciaire, du bénéfice des efforts intellectuels et matériels déployés pour corriger le droit positif[68]. Aussi bien la sentence populaire, qui commande de prévenir plutôt que de guérir, a-t-elle tout son sens en la matière. La levée du secret du délibéré a une fonction prophylactique. Elle évite, au moins pour partie, ce qui n’est pas rien, les heurts et malheurs de la modulation dans le temps de la jurisprudence[69]. Et ce n’est pas là sa seule qualité. Je crois qu’elle est de nature à endiguer la processivité.
Processivité. « Moins on est apte à maîtriser la ratio decidendi, et donc à présenter les grandes articulations d’une question, plus les plaideurs sont invités à tenter leur chance »[70]. La partie qui défaille doit recevoir une explication de nature à panser ses blessures. Des arrêts peu argumentés manquent à leur objectif fondamental d’apaisement des conflits. Les cours régulatrices le savent bien. C’est la raison pour laquelle elles intensifient leurs efforts pour expliciter le sens de leurs décisions. C’est louable mais peu profitable, car la motivation est à rebours, en dehors de l’arrêt. Or, « les échanges entre magistrats [écrit le président Tricot] enseignent que, dans les juridictions d’autres pays ou les juridictions internationales qui publient les opinions dissidentes, cette pratique n’a pas pour effet d’affaiblir la décision ou de provoquer des tentations de remise en cause de la règle retenue : elle constitue davantage une manière commode de faire savoir que tous les points en débat ont été examinés. »[71]
Pour toutes les raisons précédemment évoquées, et je ne prétends aucunement à l’exhaustivité, le secret de la délibération doit être levé. Mais défendre que la connaissance du donné est parée de mille atours est une chose. Évoquer les modalités de la levée du secret de la délibération en est une autre. C’est ce qu’il importe à présent d’envisager.
II.- La levée du secret de la délibération (comment)
Deux séries de considération président à la levée du secret de la délibération. Ce sont, d’une part, les moyens d’agir (A). C’est, d’autre part, la qualité pour agir (B).
A.- Les moyens d’agir
Le possible. L’exposé critique des moyens d’agir commande que les champs du possible soient, d’abord, explorer (1). Chose faite, il s’agira, ensuite, de préciser les conditions du possible (2).
1) Les champs du possible
Les champs du possible sont riches, ils n’attendent qu’à être cultivés. Le juge en a, du reste, pleinement conscience. On l’a dit de façon incidente. Le secret de la délibération peut être levé a minima ou/et a maxima.
A minima, la formation collégiale de jugement pourrait faire mention du partage des voix. Le lecteur, au nombre desquels on compte, primus inter partes, le perdant, pourrait tirer enseignement de ce que l’arrêt a été rendu à l’unanimité ou à une majorité qualifiée. La processivité découragée, par hypothèse, on pourrait augurer un endiguement du contentieux, par voie de conséquence. A minima, encore, la juridiction pourrait expliciter davantage les principes posés et les justifications des choix opérés[72]. En l’état, la brièveté des décisions de la Cour de cassation, laquelle, au passage, est un marqueur structurel critiquable de souveraineté[73], brouille le signal. On pourrait ainsi satisfaire pleinement aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, qui, par le passé, a attiré l’attention de la France sur les modalités d’exécution de l’obligation de motivation[74]. A minima, enfin, la cour pourrait systématiser la publication des rapports des conseillers, conclusions des avocats généraux et moyens des parties. On pourrait ainsi mettre un terme à une diffusion erratique des travaux préparatoires de la décision.
A maxima, il s’agit de consacrer la pratique des opinions séparées[75]. J’entends bien les réserves qu’inspire ce dispositif. Mais je ne pense pas qu’en les pratiquants le juge minoritaire sombre du côté obscure de la force[76]. On aura garde de noter que l’opinion n’est pas nécessairement divergente. Elle peut tout à fait être concordante. En cette occurrence, le juge minoritaire partage la solution retenue mais pas le fondement[77]. L’opinion séparée est un discours sur le droit. À ce titre, elle relève de l’ordre du descriptif et n’a, par voie de conséquence, aucun degré de normativité. Autrement dit, ce métalangage (langage qui porte sur un langage) n’est pas performatif ; il ne comporte aucun énoncé déontique[78]. Il n’y a pas lieu de craindre une confusion de genres et une déqualification de la décision. Mutatis mutandis, la loi ne perd pas de son prestige pour la seule raison que des opinions minoritaires ont été émises publiquement à l’occasion de la délibération parlementaire (examen en commission puis discussion publique)[79]. Dans le mesure où les cours régulatrices interprètent la loi, voire la réécrivent, et je songe tout particulièrement à la réforme du recours des tiers payeurs[80], je ne vois pas de raison dirimante d’interdire à la Cour de cassation, au Conseil d’État ou au Conseil constitutionnel d’émettre une opinion minoritaire. Une décision de justice « n’est pas l’énoncé d’une vérité, mais l’expression d’un choix qui a donné lieu à des échanges argumentatifs[81]. » Il ne me paraît pas scandaleux que le juge s’en justifiât[82].
Dans sa dénonciation, en toute ou partie de l’opinion majoritaire, l’opinion séparée peut être rapprochée de la réthorique arisotélicienne qui est l’art de rechercher, dans toute situation, les moyens de persuasion disponibles[83], encore que l’exercice de cet art suppose réunies un certain nombre de conditions.
2) Les conditions du possible
Les conditions du possible sont de deux ordres. La levée du secret de la délibération suppose satisfaites une condition organique et une condition fonctionnelle, d’importance inégale.
Condition organique. La pratique des opinions séparées suppose nécessairement l’existence d’un organe pluridisciplinaire et l’absence d’un consensus. c’est un truisme que de l’affirmer. Si l’on considère que dans bien des cas le juge unique tend à supplanter la formation collégiale[84], et le nombre limité de places offertes aux derniers concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature est topique, les réserves traditionnellement formulées peuvent raisonnablement être tempérées[85].
Condition fonctionnelle. Si la levée du secret du délibéré présente nombre de vertus, elle est porteuse de vices apparents et de vices cachés. À peine d’empêcher matériellement le juge de tirer profit des moyens d’agir envisagés, il importe de les garantir.
Au nombre des vices apparents, on songe spontanément au coût que représente pour les chefs de cours la politique de promotion des décisions juridictionnelles. Mais ceci n’est peut-être pas insurmontable en raison des possibilités de diffusion en ligne. Le coût est plutôt d’une toute autre nature. Il participe du reste des vices cachés. Les moyens listés, à l’exception notable de la mention du partage des voix, sont chronophages. Or le temps c’est de l’argent. Les diligences supplémentaires observées par les juridictions allongeront nécessairement le délai de traitement des saisines. Partant, elles risquent de rendre l’État justiciable d’une action en responsabilité pour organisation défectueuse de son service public de la justice. Mais, ce vice n’est peut-être pas rédhibitoire, à tout le moins je ne veux pas le croire. Il en est un autre, en revanche, dont il faut se garder.
Une étude quantitative des opinions dissidentes au Canada fait état d’opinions exprimées en plus de 80 pages[86]. Au vu du contentieux que les juridictions françaises sont amenées à connaître, et du droit qu’a le justiciable à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, c’est proprement impraticable. On pourrait alors songer à autoriser le juge minoritaire à faire publiquement part de sa dissidence, mais à la double condition qu’il publie une courte note, et qu’il la soumette, aux fins de contrôle formel, au président de chambre ou du conseiller-doyen.
Cette dernière considération doit à présent retenir l’attention ; elle a partie liée avec la qualité pour agir.
B.- La qualité pour agir
La qualité pour agir c’est, d’abord, le droit d’agir (1), ensuite, la faculté d’agir (2).
1) Le droit d’agir
S’agissant du droit d’agir, on peut avoir deux dispositions d’esprit : être libertaire ou liberticide.
Libertaire, on autorise n’importe quel juge, quel que soit son grade ou son rang, à déflorer le secret de la délibération. En théorie, le risque est grand, pour reprendre les mots du Doyen Vedel, que « la lente élaboration du consensus, qui préside à un grand nombre de décisions, soit sacrifiée au désir sportif bien humain, et bien français, de signer de son nom l’exploit du jour (…). »[87] En pratique, le risque est faible. Les magistrats, en sous-nombre, me paraissent bien trop occupés par leurs dossiers, en surnombre, et préoccupés par leurs conditions de travail, pour prendre le temps de pratiquer ledit sport.
Liberticide, primo, on réserve la publication d’opinions séparées aux conseillers des cours régulatrices ; secundo, on la limite aux pourvois posant une question juridique majeure (dans son principe et/ou ses effets) ou une question de société ; tertio, on réserve la pratique d’un pareil dispositif aux décisions rendues en plénière de chambre ou en formation solennelle.[88]
Le choix entre les deux branches de l’alternative n’est pas binaire ; il est étroitement dépendant du moyen d’agir mis en œuvre. Si l’on peut autoriser une défloraison à large spectre (ratione personae), mais a minima (ratione materiae) du secret de la délibération, il paraît plus prudent d’interdire une défloraison a maxima (ratione materiae) et tous azimuts (ratione personae) dudit secret. Au nombre des raisons sus-évoquées, il faut ajouter, entre autres, l’utilité discutable de ce dernier dispositif pour les justiciables des juridictions du fond. En raison du contrôle de légalité exercé par les cours régulatrices, les tribunaux et cours d’appel sont invités à soigner la motivation de leurs décisions respectives. Partant, le perdant est généralement en mesure de mieux saisir la ou les raisons qui justifient qu’il ait été débouté.
2) La faculté d’agir
Quant à la faculté d’agir, si l’on ne saurait contraindre un juge à pratiquer a maxima la levée du secret de la délibération, on doit pouvoir imposer aux cours régulatrices de lever a minima le secret de la délibération. La communication du rapport du conseiller-rapporteur aux parties y participe d’ores et déjà.
Vox clamantis in deserto? J’ai un doute légitime. Il peut pour partie être levé si l’on veut bien considérer la fonction duale des cours régulatrices. La Cour de cassation et le Conseil d’État ont une fonction de censeur et de normateur. En qualité de censeurs, le juge du Quai de l’Horloge et son homologue de la place du Palais Royal contrôlent la légalité des décisions prises par les juridictions inférieures. En qualité de « normateurs », ils inventent le droit. Si l’on peut opposer quelques arguments à la levée du secret de la délibération en contemplation de la fonction correctrice exercée par nos hautes juridictions, je ne vois plus d’empêchement à la levée du secret de la délibération en raison de l’exercice de leur fonction créatrice[89], sauf alors à la nier…
Voix de celui qui crie dans le désert ? Peut-être. Je reste en tout état de cause soulagé d’avoir pu faire part du secret de ma délibération.
[1] Contribution au colloque “La délibération” publiée à la Revue Procédures, 2010/3, étude n° 6.[2] V. N. Cayrol, La notion de délibération, rapport introductif.
[3] En ce sens, P. Deumier, Les « motifs des motifs » des arrêts de la Cour de cassation. Étude des travaux préparatoires, mél. J.-F. Burgelin, Dalloz 2008, p. 125. V. égal. F. Zénati-Castaing, Les motivation des décisions de justice et les sources du droit, D. 2007, p. 1553.
[4] V. égal. J.-M. Varaud, Secret et transparence, Gaz. Pal. 14 sept. 2002, n° 252.
[5] Trésor de la langue française informatisée, v° Désir.
[6] D. Rousseau, Une opinion dissidente en faveur des opinions dissidentes, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 8, 2000, p. 113, spéc. p. 114.
[7] J.-P. Ancel, L’officieux et le non-dit dans le jugement in Les méthodes de jugement, 3ème conférences, mars 2005, www.courdecassation.fr V. égal. en ce sens, S. Daël, Contentieux administratif, 2ème éd., PUF, 2008, p. 206 : « Tabernacle qui protège l’indépendance du juge » ; J.-P. Dumas, Dictionnaire de la justice, ss. dir. L. Cadiet, PUF, 2004, v° Délibéré. Cmp J.-P. Dumas, Secret de juges, mél. P. Catala, Litec, 2001, p. 179.
[8] G. Wiederkehr, Qu’est-ce qu’un juge, mél. R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 575, spec. p. 584.
[9] V. not. en ce sens, J.-L. Aubert, De quelques risques d’une image troublée de la jurisprudence de la Cour de cassation, mél. P. Drai, Dalloz, 2000, p. 7, spéc. p. 8.
[10] V. la mise en garde de Faustin Hélie (Traité de l’instruction criminelle) sur les conséquences qui découleraient d’une divulgation du contenu des délibérations : « Ne serait-ce pas (…) dépouiller à la fois le juge de sa dignité et le jugement de sa force ? » (cité par W. Mastor, Opiner à voix basse…et se taire : réflexions critiques sur le secret des délibérés, mél. B. Genevois, Dalloz, 2009, p. 736. V. égal. en ce sens, F. Luchaire et G. Vedel, Contre la transposition des opinions dissidentes en France, Le point de vue de deux anciens membres du Conseil constitutionnel, Cahiers du Conseil constitutionnel, 2000, n° 8, pp. 111, 112.
[11] En ce sens, R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13ème éd., Montchrestien, 2008, n° 1170.
[12] Serment des juges professionnels : Ord. 22 déc. 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, art. 6. Serment des juges non professionnels : v. not. C. com., art. L. 722-7, al. 1er (juges consulaires) ; C. trav., art. D. 1442-12 (conseillers prud’homaux) ; C. sécu. soc., art. L. 143-2-1, al. 2 (assesseurs des tribunaux du contentieux de l’incapacité) C. sécu. soc., art. L. 143-7 et R. 143-17, al. 3 (assesseurs de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail) ; C. rur., art. L. 492-4, al. 2 (assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux) ; C. proc. pén., art. 304 (jurés d’assises). Serment des « juges » constitutionnels : ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 3, al. 1er.
[13] C. pr. civ., art. 448 : « Les délibérations des juges sont secrètes » ; C. justice adm., art. 8 : « Le délibéré des juges est secret ». Cmp D. n° 59-1292 du 13 nov. 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel, art. 1 : « Les membres du Conseil constitutionnel ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. »
[14] Ord. 22 déc. 1958, art. 6.
[15] C. pén., art. 226-13.
[16] G. Canivet, Comprendre le délibéré ou les mystères de la chambre du conseil, mél. S. Guinchard, Dalloz, 2010, p. 217
[17] Cass. Crim., 9 juin 1843, D. 1843, p. 718.
[18] Seule entorse relevée à cette tradition : Constitution 24 juin 1793 (inappliquée), art. 94, in limine : « Ils (les arbitres publics et les juges de paix – juges élus tous les ans –) délibèrent en public. – Ils opinent à haute-voix. – (…) ». Le constituant entendait, dans le droit intermédiaire, organiser un contrôle politique sur le fonctionnement des juridictions. Pour ce faire, la propriété des offices de judicature est supprimée (loi 16-24 août 1790 ; v. not. E. Garsonnet, Traité théorique et pratique de la procédure, t. 1, 2ème éd., Paris, 1898, §103, p. 187). En raison des « altercations scandaleuses » qui se produisirent entre le public et les juges (É. Glasson, Précis théorique et pratique de procédure civile, t.1, Paris, 1902, pp. 348-359), le secret sera rétabli par l’article 208 de la Constitution du V fructidor an III (22 août 1795) : « Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée ». V. not. sur l’histoire du secret du délibéré, Cl. Bouglé, Au cœur des traditions mystérieuses de la Cour de cassation, D. 2006, p. 1991 ; W. Mastor, opinions séparées des juges constitutionnels, préf. M. Troper, Économisa, 2005, nos 199 et s. – Opiner à voix basse…et se taire : réflexions critiques sur le secret des délibérés, op. cit., pp. 728-730 ;
[19] Neuf ans au Conseil constitutionnel, Le débat, 1982, n° 55 cité par W. Mastor, Opiner à voix basse…et se taire : réflexions critiques sur le secret des délibérés, op. cit., p. 735.
[20] CE, 17 nov. 1922, Léguillon, Rec. p. 849 ; J.-C. Bonichot, P. Cassia et B. Poujade, Grands arrêts du contentieux administratif, 2ème éd., Dalloz, 2009, n° 63, p. 1051.
[21] Recueil, art. e.11 in La dignité de la personne : « En audience collégiale, le président anime le délibéré ; chaque magistrat dispose d’une voix et se plie à la décision de la majorité. L’anonymat que confère le secret du délibéré et qui interdit toute recherche de responsabilité individuelle, n’autorise pas d’abus d’autorité de la part d’un magistrat ». Principes, art. 2.2 in La dignité et l’honneur : « Le juge s’abstient de formuler des commentaires sur ses décisions, même si celles-ci sont désapprouvées par les médias ou la doctrine, ou encore si elles sont réformées. Son mode d’expression est la motivation de ses décisions. »
[22] A.-J. Arnaud, Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2ème éd., L.G.D.J., 1993, p. 551. V. égal. V. Lasserre-Kiesow, La vérité en droit civil, D. 2010, p. 907.
[23] Cour EDH, règlement, art. 3.1 (article inchangé depuis 18 sept. 1959) : « je jure – ou je déclare solennellement – que j’exercerai mes fonctions de juge avec honneur, indépendance et impartialité et que j’observerai le secret des délibérations. »
[24] Conv. EDH, règlement, art. 45, al. 2 (in de la motivation) : « Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion séparée. » À noter toutefois que l’argument prouve peu. La nature internationale de cette juridiction limite la pertinence du raisonnement par analogie, voire l’interdit ; la Conv. EDH est irréductible aux juridictions de droit interne.
[25] D. Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Gallimard, NRF Essais, 2010, spéc. pp. 298 et s. ; P. Joxe, Cas de conscience, éditions Labor et Fides, 2010.
[26] D. n° 59-1292 du 13 nov. 1959 sur les obligations du Conseil constitutionnel, art. 2, al. 1er : « Les membres du Conseil constitutionnel s’interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions : De prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du Conseil. »
[27] Rhétorique, Gallimard, 2003, Livre I, 1-Définition de la rhétorique, spéc. n° 1357 a, p. 25.
[28] Ch. Mouly, Comment rendre les revirements de jurisprudence davantage prévisibles, Petites affiches, 18 mars 1994, n° 33, spéc. n° 18.
[29] D. Rousseau, Une opinion dissidente en faveur des opinions dissidentes, op. cit., p. 114.
[30] CA Paris, 1ère ch. suppl., 19 mars 1981, Rev. arb. 1982, p. 84, note J. Viatte, cité par J.-D. Bredin, Le secret du délibéré arbitral, mél. P. Bellet, Litec, 1991, p. 71, spéc. n° 9.
[31] En ce sens, J.-D. Bredin, Le secret du délibéré arbitral, op. cit., n° 10. V. égal.. Loquin, JurisClasseur Procédure civile, fasc. 1042 : Arbitrage, Sentence arbitrale, 1996, n° 24 ; fasc. 1015 : Arbitrage, L’arbitre, mars 2009, n° 97.
[32] J.-D. Bredin, Le secret du délibéré arbitral, op. cit., n° 12, p. 80.
[33] CA Paris, 9 oct. 1998, Rev. arb. 2008, p. 843, cité par É. Loquin, JurisClasseur Procédure civile, fasc. 1015 : Arbitrage, L’arbitre, op. cit., n° 97.
[34] Cette dernière mention, qui associe en quelque sorte les avocats aux Conseils à la décision ou à l’arrêt rendu, atteste également que les conditions de la loi sur la représentation en justice ont été observées.
[35] En ce sens, M.-N. Jobard-Bachelier et X. Bachelier, La technique de cassation, 7ème éd., Dalloz, 2010, n° 5. V. égal. É. Baraduc, L’organisation interne de la Cour de cassation favorise-t-elle l’élaboration de sa jurisprudence ? in La Cour de cassation et l’élaboration du droit, ss. dir. N. Molfessis, Economica, 2004, p. 33, spéc. nos 5, 6.
[36] Le mécanisme de décision de la Cour de cassation. Pour une ethnographie à écrire d’une autre fabrique du droit, mél. B. genevois, Dalloz, 2009, p. 149, spéc. n° 29.
[37] Cons. const., décision n° 99-421 DC du 16 déc. 1999 ; directive 2003/98/CE du 17 déc. 2003 (au nombre des instruments essentiels pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie, on doit compter la jurisprudence).
[38] P. Deumier, Les communiqués de la Cour de cassation : d’une source d’information à une source d’interprétation, RTD Civ. 2006, p. 510.
[39] P. Deumier, Les communiqués de la Cour de cassation, op. cit., eod. loc. V. égal. R. Encinas de Munagorri, Faut-il annoncer un revirement de jurisprudence par voie de presse ? Propos sur l’autorité du président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, RTD Civ. 2004, p. 590.
[40] A. Lacabarats, Chronique de la Cour de cassation, D. 2007, pp. 889-891. À ce jour, 17 chroniques ont été publiées. Ledit propos liminaire donne à penser. On ne sait pas bien à qui l’imputer : au directeur du SDE ou au rédacteur en chef du Recueil. Si c’est le fait de la rédaction, et si l’on considère que, en toute hypothèse, le premier a donné son imprimatur au second, il est permis d’inférer que les vues du rédacteur sont partagées par le directeur.
[41] V. not. A. Perdriau, Les publications de la Cour de cassation, Gaz. Pal. 04 janv. 2003, p. 2.
[42] P. Deumier, Les notes au BICC : d’une source d’information à une source d’interprétation pouvant devenir source de confusion (note sous Cass. Ass. plén., 6 oct. 2006), RTD Civ. 2007, p. 61.
[43] G. Canivet, Le mécanisme de décision de la Cour de cassation. Pour une ethnographie à écrire d’une autre fabrique du droit, op. cit., spéc. n° 41.
[44] C’est particulièrement le cas des conseillers d’État, dont les arrêts sont par ailleurs moins lapidaires que ceux de la Cour de cassation (v. L. Teresi, Remarques sur la lecture des arrêts de cassation du Conseil d’État, RFDA 2010, p. 99). V. not en ce sens les commentaires publiés aux mélanges en l’honneur de B. Genevois.
[45] Dans une circulaire datée de 1998, le premier président Truche rappelle les membres de la Cour de cassation à leurs obligations déontologiques dans le dessein de faire cesser les commentaires publiés par certains hauts magistrats dans les revues juridiques laissant apparaître leur avis (citée par G. Canivet, Le mécanisme de décision de la Cour de cassation. Pour une ethnographie à écrire d’une autre fabrique du droit, op. cit., spéc. n° 20).
[46] C. Charbonneau, Le rapport annuel de la Cour de cassation a 40 ans, Lamy Droit civil 2008. 49 ; Y Aguila et Ph. Waquet, L’officieux et le non-dit dans le jugement in Les méthodes de jugement, 3ème conférence, mars 2005, www.courdecassation.fr
[47] C. patrim., art. L. 213-2 sur renvoi D. 2009-1123 du 17 sept. 2009 rel. aux archives du Conseil constitutionnel, art. 3, al. 2 (60 ans à l’origine). V. Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2009. À noter que le Conseil d’État fait établir un compte rendu des délibérations. Consultable par les seuls membres de la cour administrative suprême. Pour l’heure, il est encore confidentiel.
[48] L’article 448 C. pr. civ. ne mentionne pas parmi les cas de nullité du jugement la violation du secret du délibéré (v. égal. C. pr. civ., art. 1480 s’agissant de la nullité de la sentence arbitrale). Pour autant, la doctrine processualiste la plus autorisée professe que la nullité pourra toujours être prononcée si l’on admet qu’il puisse exister des causes de nullité fondées sur les principes généraux (v. not. en ce sens S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure civile, 30ème éd., Dalloz, 2010, n° 1044).
[49] V. supra n° 4.
[50]S. Kernéis, Dictionnaire de la culture juridique, ss. dir. D. Alland et S. Rials, Lamy-PUF, 2003, v° Autorité.
[51] Contra D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit, O. Jacob, 1997, p. 168. L’auteur précise : « en valeur absolue, il faut également prendre en compte que cette autorité dépend aussi de la prétention du locuteur de l’exercer » (p. 168, note 8).
[52] En ce sens, G. Canivet, Comprendre le délibéré, op. cit., n° 26. Cela s’impose avec d’autant de force plus lorsque la Cour de cassation rend un arrêt de rejet. Mais, ce faisant, elle s’expose aux critiques de la Cour européenne des droits de l’homme.
[53] D. Rousseau, Une opinion dissidente en faveur des opinions dissidentes, op. cit. Cmp. P. Drai, Le délibéré et l’imagination du juge, mél. R. Perrot, Dalloz, 1996, p. 107, spéc. 118 : « [le juge] ne doit plus se considérer comme satisfait s’il a pu motiver sa décision de façon acceptable. Il lui faut se surpasser et rechercher si cette décision sera tenue pour juste ou, du moins, raisonnable et, en plus, acceptable pour les parties. »
[54] Ch. Walter, La pratique des opinions dissidentes en Allemagne in Contributions au débat sur les opinions dissidentes dans les juridictions constitutionnelles, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 8, 2000, p. 81. V. égal. W. Mastor, Opiner à voix basse…et se taire : réflexions critiques sur le secret des délibérés, op. cit., p. 738.
[55] J.-P. Ancel, L’officieux et le non-dit dans le jugement, op. cit.
[56] S. Gjidara, La motivation des décisions de justice : impératifs anciens et exigences nouvelles, Petites affiches 26 mai 2004, n° 105, p. 3.
[57] W. Mastor, Opiner à voix basse…et se taire : réflexions critiques sur le secret des délibérés, op. cit., p. 740.
[58] M. Troper, Faut-il réformer le Conseil constitutionnel (table ronde) in Le Conseil constitutionnel a 40 ans, Journées des 27- 28 oct. 1998, L.G.D.J., 1999, p. 191.
[59] Cl. L’heureux-Dubé in Contributions au débat sur les opinions dissidentes dans les juridictions constitutionnelles, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 8, 2000, p. 85 ; W. Mastor Les opinions séparées des juges constitutionnels, op. cit., nos 597 et s.
[60] J. Carbonnier, Droit civil, Introduction, 27ème éd., 2002, PUF, n° 192. À noter que le Doyen Carbonnier parle formellement de la chose jugée.
[61] V. en ce sens, O. Sabard, La hiérarchisation de la jurisprudence, Revue Lamy droit civil, 2009, p. 61. V. égal. Ph. Théry, La jurisprudence des cours d’appel et l’élaboration de la norme in La Cour de cassation et l’élaboration du droit, ss. dir. N. Molfessis, Économisa, 2004, p. 129.
[62] F. Zénati, La nature de la Cour de cassation, BICC n° 575, 15 avr. 2003. Adde Th. Rrevet, La légisprudence, mél. Ph. Malaurie, Defrénois, 2005, p. 377.
[63] W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, op. cit., n° 86.
[64] V. égal. en ce sens, J. Monéger, La maîtrise de l’inévitable revirement de jurisprudence : libres propos et images marines, RTD Civ. 2005, p. 323). L’auteur préfère l’expression de « jurislateur ».
[65] La loi n° 2010-1249 du 22 oct. 2010 de régulation bancaire et financière introduit dans notre droit des procédures collective une variante de la procédure de sauvegarde : la procédure de « sauvegarde financière accélérée » (art. 57 et 58 de la loi ; C.com., art. L. 628-1 à L. 628-7 en vigueur à compter du 1er mars 2011).
[66] V. égal. en ce sens, Ch. Mouly, Comment limiter la rétroactivité des arrêts de principe et de revirement ?, Petites affiches 04 mai 1994, n° 53, spéc. nos 4, 7.
[67] V. sur cette question, Les revirements de jurisprudence, rapport ss. dir. N. Molfessis, Litec, 2005 ; B. Seiller, La modulation des effets dans le temps de la règle prétorienne. Tentative iconoclaste de systématisation, mél. B. Genevois, Dalloz, 2009, p. 977.
[68] V. topiquement Cass. crim., 19 oct. 2010 (3 arrêts), FP, à paraître au bulletin. En l’espèce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dénonce la non conventionalité de la garde à vue (sur le fondement de l’article 6§1 Conv. EDH), mais reporte dans le temps l’application de sa jurisprudence au 1er juillet 2011 et s’en explique dans un communiqué publié sur son site Internet.
[69] J. Monéger, La maîtrise de l’inévitable revirement de jurisprudence : libres propos et images marines, op. cit.
[70] R. Libchaber, Retour sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation et le rôle de la doctrine, RTD Civ. 2000, p. 679.
[71] D. Tricot, L’élaboration d’un arrêt de la Cour de cassation, JCP G. 2004, I, 108, n° 23.
[72] Mais ce n’est pas à l’ordre du jour, dixit l’ancien président du SDE (D. 2007, p. 891).
[73] V. not. J. Ghestin, L’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation, D. 2004, p. 2239, spéc. nos 7-19. Cmp supra n° 19.
[74] V. not. J. Ghestin, L’interprétation d’un arrêt de la Cour de cassation, ibid., n° 14. Cmp. S. Gjidara, La motivation des décisions de justice : impératifs anciens et exigences nouvelles, Petites affiches 26 mai 2004, p. 3, spéc. nos 43-51.
[75] V. sur l’objet de la réforme, W. Mastor, Les opinions séparées des juges constitutionnels, op. cit., nos 366 et s. Il n’est que de songer aux divergences de jurisprudence au sein même de la Cour de cassation.
[76] V. not. en ce sens, J.-F. Burgelin, Les petits et les grands secrets du délibéré, D. 2001, p. 2755 ; P. Truche, Juger, être jugé. Le magistrat face aux autres et à lui-même, éd. Fayard, 2001, p. 156.
[77] W. Mastor, , Les opinions séparées des juges constitutionnels, op. cit., nos 8 et s.
[78] W. Mastor, , Les opinions séparées des juges constitutionnels, op. cit., nos 58 et s. ; 92 – Point de vue scientifique sur les opinions séparées des juges constitutionnels, D. 2010, p. 714. La logique déontique (du grec déon, déontos : devoir, ce qu’il faut, ce qui convient) tente de formaliser les rapports qui existent entre les quatre alternatives d’une loi : l’obligation, l’interdiction, la permission et le facultatif.
[79] En ce sens P. Jan, Le procès constitutionnel, 2ème éd., L.G.D.J., 2010, p. 191.
[80] V. not. J. Bourdoiseau, De l’objet du recours des tiers payeurs in Le préjudice. Regards croisés privatistes et publicistes, Resp. civ. et assur., mars 2010.
[81] M. Troper, Faut-il réformer le Conseil constitutionnel, op. cit., p. 192.
[82] V. égal. en ce sens, A. Tunc, La Cour de cassation en crise in La jurisprudence, APD, t. 30, Sirey, 1985, p. 157, spéc. p. 165.
[83] Aristote, Réthorique, op. cit., Livre I, 1355 b (1-préambule), 1356 a (2-définition de la rhétorique).
[84] V. spéc., J.-F. Burgelin, Les petits et grands secrets du délibéré, op. cit., p. 2755.
[85] V. not. sur ces réserves, Ph. Waquet, L’officieux et le non-dit dans le jugement, op. cit. : « les dommages qu’occasionnerait une telle pratique seraient considérables. Des clans se formeraient inévitablement : les libéraux, les répressifs, les rigoristes, les laxistes…que sais-je encore ! »
[86] M.-Cl Belleau, R. Johnson, Les opinions dissidentes au Canada in Les méthodes de jugement, 5ème conférences, oct. 2005, www.courdecassation.fr
[87] In préf. à l’ouvrage de D. Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 5ème éd., Montchrestien, 1999, p. 7).
[88] En ce sens, P. Truche, Juger, être jugé, op. cit., pp. 156, 157. Difficilement praticables, en raison de leur caractère fuyant, ces critères ont toutefois le mérite de donner au dispositif une certaine souplesse, sans laquelle il serait voué aux gémonies.
[89] V. spéc. La création du droit par le juge, APD, t. 50, Dalloz, 2007.