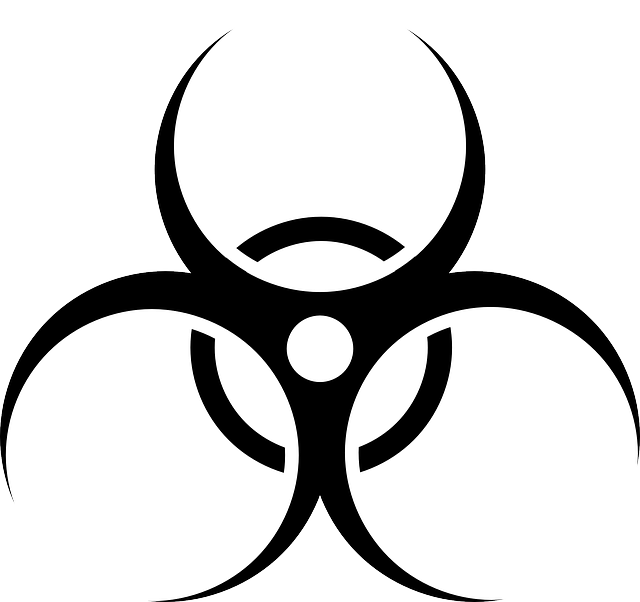A priori, tout a été écrit sur la notion de conducteur. Que dire par voie de conséquence à ce sujet qui ne l’ait déjà été et mieux qu’on ne pourrait le faire ? Eh bien : rien du tout, sauf à parler pour ne rien dire (Raymond Devos, https://www.youtube.com/watch?v=hz5xWgjSUlk) et de faire perdre son temps au lecteur. On a connu accroche un tantinet meilleure.
Il faut bien convenir que la consultation conjointe des dictionnaires de langue française et du Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant (des amis de la culture juridique) atteste que tout a été dit. Le Littré renseigne que le conducteur est celui qui conduit. Et le Cornu de préciser que c’est la personne qui est aux commandes d’un véhicule terrestre à moteur. C’est l’évidence. L’accident éditorial menace…
Ceci étant : que peut bien signifier « être aux commandes » ?
Songeons à l’accident d’un véhicule auto-école conduit, le temps de la leçon, par un élève : on peut hésiter sur qui de l’élève ou du moniteur est conducteur en raison précisément de l’existence d’un dispositif de double commande. Comprenons bien : dans l’instant qui a précédé l’accident, le moniteur a dû tenter de prendre le contrôle du véhicule, tournant le volant ou le guidon – c’est selon –, freinant ou accélérant – c’est fonction. – Et voilà qu’on ne sait plus trop qui de l’élève ou du moniteur était aux commandes. Décidément : « rien ne prouve a priori qu’il existe (au sens logique) des propositions jouissant du caractère d’évidence » (A. Lalande). La définition de la notion sous étude l’atteste. Il y a donc bien matière à disserter sur la notion de conducteur en droit français des accidents de la circulation. Cela est d’autant moins incongru que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est proprement taisante (1). Quant à la jurisprudence, qui a dû palier le silence confondant du législateur, elle est pour sa part hésitante (2).
1.- Le silence du législateur est confondant. La loi ne prend pas soin de définir une notion-clef du dispositif. Une série de considérations, d’inégale valeur, atteste pourtant l’importance de la notion.
Matériellement, elle est employée à sept reprises, en l’espace de quatre articles rapprochés (en l’occurrence les articles 2 à 5) dans une section première intitulée « Dispositions relatives au droit à indemnisation » (c’est nous qui soulignons). Exaltation des droits subjectifs : alors que la jurisprudence avait utilisé la responsabilité du fait des choses pour réparer les accidents de la circulation (art. 1384, al. 1 anc. c.civ.), le législateur a préféré assurer cette réparation en posant en exergue un « droit à » [1]. Un linguiste repérerait dans la répétition du mot “conducteur” une figure de rhétorique, qui consiste à employer plusieurs fois le même terme pour mettre en relief une idée. Quant au juriste-linguiste, il ne manquerait pas de relever l’insistance.
Juridiquement, c’est çà l’idée, le conducteur désigne le débiteur de l’indemnisation. La notion discrimine les victimes d’accidents de la circulation. Considérant que les conducteurs concourent (au premier chef) au risque de la circulation routière, parce qu’ils sont les créateurs d’une énergie cinétique possiblement mortifère [2] déployée par le véhicule terrestre à moteur, le législateur les a sacrifiés sur l’autel de l’indemnisation des piétons, des cyclistes et des passagers du véhicule impliqué. La représentation nationale était en effet soucieuse de ne pas alourdir à l’excès le poids des indemnités dues par les assureurs et, par contrecoup, le montant des primes d’assurance [3]. Pour le dire autrement, le conducteur-victime a été privé du droit subjectif à l’indemnisation des dommages soufferts consécutivement à l’accident. En ce sens, l’article 3 de la loi dispose expressis verbis : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
Il est décidément pour le moins étonnant que le législateur français se soit gardé de définir la notion de conducteur alors pourtant que la sanction de ce dernier peut être présentée, avec la protection de la victime, comme l’une des causes adéquates de la loi précitée du 5 juillet 1985.
L’absence de définition de la notion de conducteur est fâcheuse, car elle rend bien peu praticable le droit des accidents de la circulation. Le législateur en a pleinement conscience. Dans son rapport d’information sur la responsabilité civile, la commission des lois du Sénat fait état des hésitations de la jurisprudence [4]. On sait pourtant qu’un droit insuffisamment défini donne immanquablement lieu à des hésitations et des controverses, qui sont autant de sources d’insécurité juridique. Si la définition de cette seule notion de conducteur était sujette à débat, il n’y aurait pas lieu de redouter outre mesure que la loi soit bien peu praticable. Mais voilà, les notions de circulation, d’accident de la circulation et d’implication n’ont pas été définies non plus. Malgré la glose des premiers articles de la loi, qui a donné lieu à une littérature juridique abondante, la jurisprudence a eu grand peine à se passer d’un appareil conceptuel suffisant. Au reste, s’agissant plus spécialement de la notion de conducteur, les incertitudes sont encore de mise.
Une question vient alors à l’esprit. Pour quelle raison le législateur français ne s’est-il pas appliqué à définir les notions contenues dans la loi du 5 juillet 1985, en l’occurrence le conducteur, alors que l’on sait depuis Aristote que la définition est la formule qui exprime l’essence d’une chose ? On pourrait répondre, avec les jurisconsultes romains, que toute définition en droit civil est dangereuse (Digeste : omni definitio in jure civili periculosa est) parce qu’elles figent les concepts évolutifs et finissent par les dénaturer [5]. Mais l’antienne convainc peu : « de bonnes définitions peuvent résister longtemps à l’évolution sociale » [6]. Pour preuve, « Nous avons, dans nos lois, un trésor de définitions : (…) plus d’une centaine dans le Code civil (…) et une trentaine dans le [Code de procédure civile] à ne compter que les définitions qui, en la forme, se donne évidemment pour telles. Il en existe d’innombrables dans les autres codes et les textes spéciaux » [7]. En droit comparé, le procédé est également connu. Les législations étrangères, plus spécifiquement celles de type anglo-saxon, comme la plupart des conventions internationales du reste, font un emploi systématique, en tête de chaque loi, de définitions générales [8]. Fort de ce constat, il a semblé de bonne méthode de rechercher dans quelques droits étrangers une définition de la notion de conducteur. Le résultat s’est révélé pour ainsi dire nul. Les droits interrogés n’ont rien appris. Silence de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, silence du droit anglais[9]. Silence de la loi belge relative à l’assurance obligatoire de responsabilité en matière de véhicule automoteurs, qui prend pourtant le soin de définir, au titre des dispositions préliminaires, ce qu’elle entend par véhicule automoteur, cyclomoteur, assuré et personne lésée (loi du 21 nov. 1989, art. 1er). Silence du Code des assurances annexé au « Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains »[10], auquel sont parties quatorze états. Last but not least, silence du Code des assurances tunisien (art. 110 et s.).
L’oxymore est tentant (nous cédons à la tentation) : c’est un silence assourdissant. Voilà un droit qui entend discriminer le conducteur-victime en le privant, ainsi que ses ayant-cause au passage (loi 5 juill. 1985, art. 6), en tout ou partie du droit à indemnisation des dommages dont il est le siège (loi 5 juill. 1985, art. 4), mais qui n’estime pas impérieux de dire au juge ce qu’est un conducteur. Que la terminologie juridique soit un art subtil et chronophage, un luxe que le législateur moderne ne se paie que rarement ou que les justiciables ne savent pas lui accorder : très bien. Mais tout de même, l’office du juge est avant toute chose de dire le droit ; c’est-à-dire de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, non pas, en première intention, de les inventer au gré des circonstances de l’espèce. Car, à ce compte, ni le principe de la sécurité juridique, ni celui de l’égalité des justiciables devant la loi ne sont observés. Quant aux espoirs placés dans l’œuvre unificatrice de la Cour de cassation, ils sont vains : la définition de la notion de conducteur se fait toujours désirer, plus de trente cinq années après le vote de la loi Badinter. Il importe de circonscrire, autant que faire se peut, l’aléa judiciaire. Quand bien même la définition de ladite notion se révèlerait-elle un exercice par trop hasardeux, il aurait été hautement souhaitable que le législateur ne se déchargeât pas complètement sur le juge. Employant une jolie formule, le Doyen Cornu a montré qu’une distinction majeure s’impose « entre les définitions qui portent sur le grain des choses et celles qui portent sur la paille des mots ; ou, si l’on préfère, entre la définition directe des choses et celle des mots »[11]. À défaut de parvenir à arrêter une définition directe (si tant est que cela fût possible et souhaitable), qui aurait consisté en une détermination substantielle des éléments et attributs spécifiques de la notion « conducteur », pour ce qui nous intéresse ; en somme, à défaut de parvenir à constituer une règle de droit, le législateur aurait pu valablement tenter une définition du mot, autrement dit, une définition terminologique. En cette seconde occurrence, la définition de la notion de conducteur n’aurait été qu’une indication de son sens déterminé. Certes, c’eût été moins ambitieux, mais ce fût déjà beaucoup. Le juge aurait ainsi eu à sa disposition des directives d’interprétation, un « guide-âne » aurait écrit le Doyen Carbonnier. Partant, il n’aurait pas eu à s’aventurer ex nihilo dans la définition de la notion.
Sur le plan de la méthode, il n’est pas saugrenu pour le législateur d’encadrer le travail du juge, moins en définitive en précisant au fond ce qu’est un conducteur, qu’en lui indiquant les éléments dont il doit tenir compte au cas par cas pour décider [12]. Cette manière de procéder est directement inspiré du « bewegliches system » (système mobile, ou, selon une traduction moins littérale mais peut-être plus exacte, du « système flexible » développée à partir des années 1940 par plusieurs juristes autrichiens spécialistes du droit de la responsabilité civile). C’est très précisément le système qui a été retenu dans les projets d’harmonisation du droit de la responsabilité en Europe (projet du groupe de Vienne et de Tilburg – Draft common frame of reference – et le projet du Study group – Principles of european tort law). Si le législateur français de 1985 avait procédé de la sorte, il aurait pu disposer, par exemple, que « la qualité de conducteur doit être écartée en raison de l’âge de la victime conductrice, d’un handicap ou lorsqu’en raison de circonstances extraordinaires, il n’est pas équitable de la priver de son droit à indemnisation ». Ce faisant, les enfants, les infirmes, les vieillards et les ayants-cause n’auraient pas été privés, en tout ou partie, de l’indemnisation de leurs préjudices, directs ou réfléchis, comme c’est malheureusement le cas en droit positif français (notamment) pour la seule raison qu’ils ont commis une faute de conduite dommageable.
Cette méthodologie gagnerait à l’avenir à être préférée. Les propositions de réforme de la responsabilité civile faites par l’Académie des sciences morales et politiques sont en ce sens [13]. C’est que confronté au silence du législateur, le juge est plein d’hésitations.
2.- Les hésitations du juge interdisent de dégager une définition de la notion de conducteur. Malgré l’exhortation de l’article 4 du Code civil, qui fonde le juge à définir la notion sous étude, le dernier état de la jurisprudence atteste que la notion de conducteur est rétive à la définition. Ceci étant, et si l’on raisonne de lege ferenda, il se peut fort bien que la notion de conducteur soit en définitive dispensée de définition…
La notion de conducteur est rétive à une définition réelle, c’est-à-dire à une définition générale et abstraite, susceptible d’embrasser tous les champs du possible. À l’expérience, les efforts de conceptualisation sont vains. Ceci étant, il n’est pas complètement satisfaisant d’affirmer, par exemple, que la qualité de conducteur se déduit de la présence aux commandes du véhicule. C’est certes nécessaire, mais pas suffisant. Il n’est que de songer à un cas ordinaire : une voiture est stationnée, bien mal au demeurant, en double file par exemple, moteur éteint ou non c’est égal, son conducteur en est sorti quelques instants, l’enfant passager s’assoit sur le siège du conducteur, un accident survient, le véhicule est impliqué. Matériellement, l’enfant est aux commandes (encore qu’il s’agirait de vérifier que notre jeune conducteur avait les moyens d’actionner les pédales). Raisonnablement, on ne devrait pas lui reconnaître la qualité de conducteur. C’est pourtant la solution arrêtée en jurisprudence. La raison tient à ceci que la désignation d’un « responsable » est la condition sine qua non de la mise en cause de l’assureur de responsabilité. Et voilà comment une victime de moins de seize ans, qu’on qualifie volontiers de « super-privilégiée », c’est-à-dire contre laquelle la loi interdit qu’on oppose ordinairement une faute (loi 5 juill. 1985, art. 3, al. 2), à l’exception de la faute intentionnelle (al. 3), se voit privée en tout ou partie de son droit à indemnisation pour la seule raison qu’elle était, en apparence, aux commandes du véhicule terrestre à moteur.
Arrêter une définition opératoire du conducteur est des plus hasardeux. Il existe toutefois une technique éprouvée de contournement de la difficulté. Elle consiste à sérier, par opposition, les non-conducteurs. Au nombre de ceux-ci, on compte, primus inter partes, les piétons, mais aussi les cyclistes, les skieurs, et les passagers du véhicule. Pour éclairante qu’elle soit, l’appréhension négative de la notion ne donne toutefois pas entière satisfaction. Il n’est absolument pas certain que le piéton ou le passager soit nécessairement un non-conducteur. L’évidence est une nouvelle fois trompeuse. La jurisprudence de la Cour de cassation l’atteste. Il est des circonstances où la Haute juridiction estime que la personne aux commandes n’est pas le conducteur. Il en est d’autres où elle considère la personne qui n’est pas ou plus aux commandes est le conducteur. Jean Giraudoux a raison : « Le droit est [décidément] la plus puissante des écoles de l’imagination (…)» [14]. En atteste le droit appliqué respectivement au piéton et au passager.
Le piéton. Littéralement, le piéton est la personne qui circule à pied. Victime en puissance de l’énergie cinétique propre aux véhicules terrestres à moteurs en mouvement, le législateur a désiré le protéger. Mais, il n’a pas vu que l’on pouvait se déplacer à pied de bien des manières, en l’occurrence parfois contraint et forcé, en courant, en marchant voire en glissant.
C’est ainsi qu’une cour d’appel avait cru, à tort, pouvoir considérer que la victime qui courait sur la chaussée en poussant son cyclomoteur pour tenter de provoquer l’allumage du moteur était un conducteur qui, un doigt sur la manette des gaz et les mains sur le guidon, pilotait l’engin. Il eût fallu pour la Cour de cassation qu’elle ait pris place sur le cyclomoteur [15]. Pareil critère, géographique en quelque sorte, qui définit le conducteur comme la personne qui est installée dans le véhicule ou sur le véhicule, n’emporte pas pleinement la conviction.
On peut aussi prendre place sur ledit véhicule et, pourtant, marcher (oxymore). C’est la situation rencontrée par de très nombreux motocyclistes, assis sur la selle de leur machine en panne, qui la font avancer sur le bord de la chaussée à l’aide de leurs jambes. Et bien, la Cour de cassation les qualifie de conducteurs [16]. Et pour cause, pourrait-on dire avec la Cour régulatrice : les intéressés sont installés sur le véhicule, ils sont aux commandes et, de surcroît, ils sont occupés à une activité de conduite. C’est l’évidence : ils sont conducteurs. Mais une fois encore, la pertinence de la qualification juridique est douteuse. À la réflexion, ces conducteurs sont certes juchés sur leur machine, mais ils sont aux commandes et occupés à « conduire » des motocyclettes…à pédales. Ils sont en somme les pilotes d’un bien encombrant vélo, qui ne dit pas son nom.
On peut encore avoir pris place dans un véhicule, en avoir été éjecté dans l’accident (cas de l’automobiliste projeté hors de son véhicule ou du motocycliste ayant chuté à la suite d’une collision), puis renversé. La victime glissant sur la route, la question de sa qualité juridique interroge. Considérant qu’elle est en dehors du véhicule, la solution paraît s’imposer : c’est un piéton. Un raisonnement par analogie corrobore l’affirmation. La Cour de cassation estime que ne sont pas conducteurs les personnes heurtées alors qu’elles étaient à l’extérieur du véhicule, qu’elles étaient occupées à y prendre place ou en train d’en sortir au moment de l’accident, pour quelque motif que ce soit, pour effectuer une réparation ou porter secours, par exemple [17]. Au vu de cette jurisprudence, on peut se demander avec d’autres si la victime heurtée par un second choc, alors qu’elle gît sur le sol ou qu’elle est en train de se relever, ne pourrait pas aspirer au statut de victime non conductrice [18]. Intuitivement, on peut le penser. Elle n’est plus installés dans ou sur le véhicule, elle n’est plus aux commandes, elle n’est plus du tout occupée par une activité de conduite. Pour le dire autrement : l’intéressée n’a plus la maîtrise effective du véhicule. La solution aurait pour elle le mérite de la simplicité. On a cru un temps la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation séduite[19], mais la chose était sûrement trop simple (ou simpliste). Pour l’essentiel, il résulte des solutions arrêtées par la Cour de cassation que le conducteur éjecté conserve cette qualité dès lors qu’il continuait, au moment du second choc, de subir les effets de l’énergie dégagée par le premier [20]. Et une fois l’énergie cinétique épuisée, en bref, une fois le « roulé-boulé » terminé (pour reprendre l’expression imagée de la Cour de cassation [21]), la victime est considérée comme un non-conducteur au moment du second choc. Il ressort de tout ceci que la jurisprudence prive la victime éjectée du véhicule d’un droit subjectif à l’indemnisation pour la seule raison qu’elle subit les lois de la physique, alors pourtant qu’elle a perdu la maîtrise de l’engin. En définitive, le conducteur éjecté est dans une situation pire que le piéton accidenté par un automobiliste à qui le juge ne reproche aucune faute inexcusable alors pourtant “qu’il se trouvait en complet état d’ivresse, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, accroupi sur la chaussée d’un chemin départemental, hors agglomération, de nuit par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres, au milieu du couloir de marche de l’automobile” [22] ! Et la Cour de cassation d’augmenter la sévérité de sa jurisprudence en cas précisément d’accidents complexes, c’est-à-dire d’accidents formés de « carambolages et de collisions en chaînes dans lesquels plusieurs véhicules interviennent, à titres divers »[23], en considérant que « la qualité de conducteur ou piéton de la victime ne pouvait changer au cours d’un accident de la circulation reconnu comme un accident unique et indivisible »[24]. Pourtant, en l’espèce la victime mortellement blessée était sortie de son véhicule accidenté et se trouvait debout contre la portière arrière [25]. À l’évidence, la victime était un piéton. Si, sur le plan de la logique, on peut saluer l’effort fourni par la cour régulatrice pour uniformiser le droit des accidents complexes [26], c’est, de notre point de vue, en contradiction avec la ratio legis du dispositif voté par le Parlement.
Ces illustrations montrent combien le juge est hésitant quant à la définition de la notion de conducteur. Il y a vingt cinq ans déjà, un auteur regrettait les contradictions, repentir et revirements de la Cour de cassation [27]. Le sort réservé au passager prête tout autant le flan à la critique.
Le passager. Littéralement, le passager est la personne transportée à bord du véhicule terrestre à moteur. C’est autrement dit, celui qui ne conduit pas et qui, tel le piéton, est la victime potentielle d’une énergie cinétique qu’il ne participe pas à créer. C’est la raison pour laquelle, il est titulaire (créancier) d’un droit à indemnisation. Et bien jamais poète n’aura interprété la nature aussi librement que le juge la réalité. La Cour de cassation considère que l’élève d’une auto-école (v. la conduite accompagnée), dont il a été quelques mots en introduction, n’est pas le conducteur du véhicule. Il s’agit, par voie de conséquence, d’un drôle de passager qui se trouvait au volant (ou au guidon, mais dans ce cas l’explication donnée ne tient plus) [28] lorsque l’accident s’est produit, qui était aux commandes du véhicule et qui se trouvait occupé par une activité de conduite. En son temps, Esmein disait ceci de la faute : « Les juristes, pour satisfaire certaines aspirations sans rompre les cadres du droit établi, ont détourné de leur sens les mots ou les institutions, ou créé des fictions. [Et] quand on vide les mots de leur sens usuel, on n’est pas compris et on n’est plus soi-même maître de sa pensée » [29]. On doit pouvoir dire la même chose du conducteur. Au gré des circonstances de l’espèce, des mérites de la victime, le juge instrumentalise la notion. Comme l’a relevé un auteur : « lorsque la victime ne mérite pas la même sollicitude à raison du comportement malencontreux qu’elle a adopté, le juge n’éprouve aucun scrupule à lui attribuer promptement la qualité de conducteur : acquiert par exemple [cette qualité] le passager qui, dans le but de détecter une anomalie mécanique présumée, provoque une accélération en appuyant sur la jambe droite du conducteur et donne simultanément une impulsion au volant »[30].
L’état du droit positif a de quoi laisser interdit. C’est en toute vraisemblance la rançon du choix politique fait en 1985. Plutôt que de conditionner le paiement de la dette d’indemnité à la désignation d’un responsable – le fameux conducteur (ou gardien) –, il eût mieux fallu reporter la dette d’indemnisation vers la solidarité nationale ou la collectivité des détenteurs d’un véhicule terrestre à moteur. Dans les faits, c’est précisément ce qui se passe. De plus en plus de conducteurs souscrivent une assurance facultative de personne. Les assureurs ne manquent pas d’exécuter là leur obligation de conseil. Par voie de conséquence, le conducteur-victime est pratiquement assuré. En définitive, la dette d’indemnisation des accidents de la circulation est supportée par la communauté des conducteurs. Encore que pour être tout à fait précis, il s’agirait plutôt de dire que la dette est supportée par une communauté de conducteurs, car cette assurance complémentaire n’étant pas imposée par la loi, certains ne la souscrivent pas. Sous cette réserve, on pourrait s’en contenter et laisser libre cours au juge. Il y a pourtant un moyen qui dispenserait que l’on s’interrogeât sur la notion de conducteur.
La notion de conducteur peut être dispensée de définition. Alors que l’on venait tout juste de célébrer les vingt années de la loi tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et que des voix dissidentes et autorisées se faisaient entendre sur la disparité de traitement injuste [31], de savants collègues remettaient au garde des Sceaux, quelques semaines plus tard, un avant-projet de réforme du droit des obligations (22 sept. 2005). Au nombre des modifications proposées, les auteurs assimilent le conducteur aux autres victimes (avant-projet, art. 1385). En réponse, la Cour de cassation publie un rapport (15 juin 2007). Ses propositions de réforme sont identiques (cons. 84). Elle s’était par ailleurs prononcée en ce sens dans son rapport d’information pour 2005 [32]. Dans la foulée, un rapport d’information du sénat recommande d’assimiler le conducteur aux autres victimes d’accidents de la circulation [33]. L’année qui suit, une proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile est enregistrée à la présidence du Sénat (proposition de loi n° 657 du 9 juillet 2010). La responsabilité du fait des accidents de la circulation est intégrée dans le Code civil. La discrimination d’antan est abrogée (art. 1386-56 et s.). Quant aux dernières propositions de réforme formulées par l’Académie des Sciences morales et politique, elles sont égales : la faute de la victime est sans incidence sur le droit à réparation à moins qu’il ne s’agisse une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident (art. 26) [34]. Le débat paraît clos. Les victimes, tout spécialement celles qui sont atteintes dans leur intégrité corporelle, ont vocation à être indemnisées. L’histoire du droit de la responsabilité est en ce sens. Si le législateur devait se ranger à l’avis unanime des rapporteurs, et qu’il décidait d’abroger l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, siège de la discrimination entre les victimes des accidents de la circulation, il n’y aurait plus lieu de regretter les hésitations de la jurisprudence. Mais voilà, rien n’est moins certain que, dans la foulée de ces doctes travaux, le parlement soit désireux de légiférer. Pour preuve : le législateur a réussi le tour de force de réformer le droit commun des contrats, le régime général et la preuve des obligations en laissant de côté un pan antier de la théorie générale des obligations, à savoir le droit de la responsabilité extracontractuelle et quelques régimes spéciaux. Quant à la Cour de cassation, qui a su faire preuve d’audace par le passé, il semble, contre toute attente, que ses hésitations aient l’heur de lui plaire. Qu’est-ce à dire ? Et bien, qu’il est fort regrettable que notre cour régulatrice n’ait pas saisi l’opportunité de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de savoir si l’article 4 de la loi précitée ne serait pas contraire à notre Charte fondamentale. Cela étant, c’était peut-être prendre le risque que les sages de la rue Montpensier, juges de la constitutionnalité de nos lois, ne considèrent, que, que pour des motifs d’intérêt général, notamment de sécurité routière, seule la propre faute de la victime conductrice est de nature, sous le contrôle du juge, à limiter ou à exclure son droit à indemnisation [35]. Partant, c’était prendre le risque de confirmer le législateur dans son inertie.
Conclusion. Un auteur qui s’interrogeait sur quel droit civil enseigner écrivit qu’« Il peut être très formateur pour un jeune juriste qui étudie la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, d’apprendre – et de comprendre – les différences entre la causalité et l’implication, c’est lui pervertir le sens, en revanche, que de lui exposer par le menu (…) les plaisantes divagations de la Cour de cassation à propos de la notion de conducteur. Dans le premier cas, on l’aura initié à la logique juridique abstraite, dans le second, on l’aura méthodiquement assommé, sans profit aucun, d’une suite de décisions qui, de correctifs en précisions, ont abouti à une succession de solutions dont le seul intérêt est qu’elles ont, pour l’instant, la faveur des juges » [36]. À l’analyse, la sentence est sévère. Ce sujet, peu exotique ni prometteur de prime abord a, en vérité, partie liée avec l’art législatif.
[1] J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Flammarion, 1996, p. 123.
[2] L’énergie cinétique est l’énergie que possède un corps du fait de son mouvement réel. Au vu de cette définition, un contradicteur ne manquerait pas de faire remarquer que les lois de la physique sont têtues : le piéton et le cycliste sont créateurs d’énergie cinétique. C’est la raison pour laquelle, le qualificatif « mortifère » a été employé s’agissant de l’énergie déployée par les véhicules terrestres à moteur, qui sont, ex eo quod plerumque fit, sans aucune mesure.
[3] Flour, Aubert, É. Savaux, Le fait juridique, 11ème éd., Sirey, 2005, n° 341.
[4] A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, rapp. inf. n° 558, 15 juill. 2009, p. 49.
[5] J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 4ème éd., Dalloz, 2003, n° 186.
[6] Ibid.
[7] G. Cornu, Les définitions dans la loi in mél. Vincent, Dalloz, 1981, p. 77, n° 1. L’auteur indique que le Digeste en a regroupé 246 in De verborum significacione, Livre L, Titre XVI).
[8] Ibid.
[9] J.-A. Jolowicz, L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation en droit anglais, RIDC 2-1985, pp. 275 et s.
[10] Traité signé à Yaoudé, 10 juill. 1992.
[11] G. Cornu, Les définitions dans la loi, op. cit., n° 8.
[12] Cmp P. Ancel, Rôle respectif de la loi et du juge dans les projets européens in GRERCA, journées chambériennes, mars 2009, p. 23.
[13] V. not. l’article 26, al. 2 : « En cas d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, ou de dommage causé à des fournitures ou appareils délivrés sur prescription médicale, la faute de la victime, autre que le conducteur ou une personne dont cette victime doit répondre, est sans incidence sur le droit à réparation, à moins qu’il ne s’agisse d’une faute inexcusable ayant été la cause exclusive de l’accident. Dans l’appréciation de la faute inexcusable, le juge aura égard à l’âge et à l’état physique ou psychique de la victime. Dans tous les autres cas, la faute de la victime ou d’une personne dont la victime doit répondre est partiellement exonératoire lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage. »
[14] Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu, 1935. p. 111.
[15] Cass. 2ème civ., 7 oct. 2004, Bull. civ. II, n° 437.
[16] Cass. crim., 10 janv. 2001, n° 00-82.422, Bull. crim. n° 1.
[17] V. not. sur cette jurisprudence abondante, P. Jourdain et G. Viney, Les conditions de la responsabilité, 3ème éd., L.G.D.J., 2006, n° 1025.
[18] F. Leduc, Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation Resp. civ. et assur. mars 2009, dossier n° 4, spéc.n° 10.
[19] Cass. 2ème civ., 11 déc. 1991, Resp. civ. et assur. 1992, comm. 95 et chron. 10, H. Groutel.
[20] Ph. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz-Action, 2010-11, n° 8135.
[21] Cass. 2ème civ., 8 oct. 2009, n° 08-16.915 et 08.16-943, BICC 15 mars 2010, n° 322 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. n° 351, obs. H. Groutel : « conducteur ou non conducteur ? »
[22] Cass. 2ème civ., 6 nov. 1996, n° 95-12.428, Bull. civ. II, n° 240.
[23] Flour, Aubert et É. Savaux, Le fait juridique, op. cit., n° 337.
[24] Cass. 2ème civ., 1er juill. 2010, n° 09-67.627 ; Bull. civ. II, n° 127 ; D. 2011, p. 35, spéc. p. , note Ph. Brun et p. 632, note H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin (conseillers référendaires à la Cour de cassation) ; RTD civ. 2010, p. 792, obs. P. Jourdain. À noter que les moyens annexés sont publiés.
[25] Note : arrêts cités censurés sont ceux de la CA Rennes !
[26] V. sur ce droit en mal de logique, F. Leduc, Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation op. cit., n° 11.
[27] F. Chabas, Les accidents de la circulation, Dalloz, 1995, p. 91.
[28] Cass. 2ème civ., 29 juin 2000, n° 98-18847, Bull. civ. II, n° 105 : « Mais attendu que l’arrêt retient que, d’une part, l’équipement du véhicule par un dispositif de double commande permettait au moniteur d’intervenir à tout moment pour l’immobiliser ou pour agir sur le volant tenu par l’élève soumis à ses directives, dont il lui appartenait de surveiller les gestes, de prévoir les maladresses, de les éviter et d’y remédier en tant que de besoin, d’autre part, que la marche du véhicule ne se faisait que sous le contrôle de ce moniteur, seul titulaire du permis de conduire, qui pouvait à tout moment retirer à l’élève la maîtrise du véhicule en intervenant directement et personnellement dans la conduite. »
[29] P. Esmein, La faute et sa place dans la responsabilité civile, RTD civ. 1949, p. 481, spéc. n° 1.
[30] F. Leduc, art. préc., spéc. n° 16.
[31] V. not. G. Viney, Conclusion prospective in La loi Badinter, le bilan de 20 ans d’application, ss. dir. Ph. Brun et P. Jourdain, bibl. A. Tunc, t. 10, L.G.D.J., 2006, p. 137.
[32] L’innovation technologique, La documentation française, 2006, pp. 15, 16.
[33]A. Anziani et L. Béteille, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, op. cit., recommandation n° 12, p. 48.
[34] Proposition de textes pour une réforme du droit de la responsabilité civile transmise au ministre de la justice et des libertés le 09 juill. 2010, art. 26, al. 2 (v. supra).
[35] Cass., qpc, 10 novembre 2010, n° 10-30.175 – 16 déc. 2010, n° 10-17.096.
[36] Ph. Conte, Quel droit civil enseigner ?, RTD civ. 1998, p. 292.