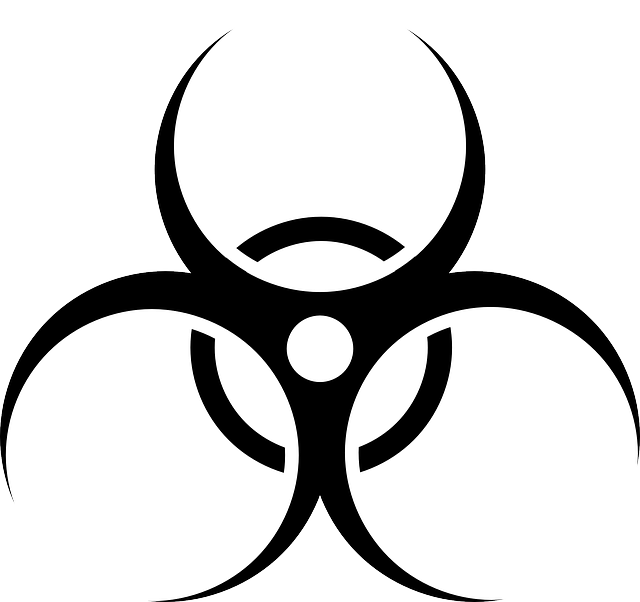Par Vincent Roulet, Maître de conférences Hdr à l’Université de Tours, Avocat au barreau de Paris, Edgar Avocats
Le salarié bénéficie, alors qu’il est en poste, de garanties collectives : garanties frais de santé (appelées parfois improprement « mutuelles d’entreprises ») et prévoyance (incapacité, invalidité, décès).
Cette couverture peut prendre fin, soit parce que le contrat d’assurance collectif afférent à ces garanties est rompu, soit parce que le salarié quitte (ou perd) son emploi.
De façon à éviter que des salariés couverts se trouvent ainsi privés brutalement de couverture, le législateur aménage un certain nombre de maintiens de prestations (1) et de garanties (2) obligatoires et organise leur revalorisation (3).
Synthèse
| Situation | Maintien de prestations | Maintien de garantie |
| Rupture du contrat de travail | 1. C.civ., art. 1103 (adde : Civ.2, 17 avril 2008, n° 07-12.064). Transposition, sur ce fondement, des décisions rendues en application de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989. Maintien des prestations incapacités invalidités en cours de service au jour de la rupture. | 1. C. séc. soc., art. L. 911-8 : Portabilité des garanties frais de santé et prévoyance dans la limite d’une année et sous condition de prise en charge par l’assurance chômage. 2. Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 4. Accès à une garantie frais de santé identique à celle dont l’ancien salarié profitait dans l’entreprise, à des conditions tarifaires encadrées. Les garanties sont proposées par l’organisme assureur aussi longtemps que l’ancien salarié perçoit un revenu de remplacement. |
| Résiliation ou non renouvellement des garanties | 1. Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989, art. 7 Maintien des prestations incapacités invalidités en cours de service au jour de la rupture. | 2. Loi n° 89-1009 du 31 déc. 1989, art. 7-1 Maintien de la garantie décès aussi longtemps que des prestations sont maintenues au profit des salariés. |
1.- Maintien des prestations
Le maintien des prestations est l’obligation dans laquelle se trouve l’organisme assureur – et, par extension, s’il était conduit à garantir le salarié à raison d’une absence de couverture, l’employeur – de continuer de payer les prestations en cours de service au jour de la résiliation de l’opération d’assurance ou de la rupture du contrat de travail. Par essence, le champ d’application du maintien des prestations est limité. Il ne comprend pas les prestations qui sont dues ou versées ponctuellement, mais seulement celles qui s’étendent dans le temps : de maintien de prestations, il n’y en a guère en matière de frais de santé – la dépense de santé est instantanée – mais seulement en prévoyance : incapacité et invalidité (v. infra pour ce qui intéresse le décès).
Quoique le maintien des prestations est aujourd’hui une obligation de l’organisme assureur qui aille d’elle-même en dépit des débats ponctuels auxquels elle peut donner lieu quant à son périmètre exact, il n’en fut pas toujours ainsi. Jusqu’à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les systèmes de prévoyance étaient gérés en pure répartition : les cotisations prélevées à l’année N servaient au payement des prestations au cours de l’année N. Au terme du contrat ou de l’adhésion, l’organisme assureur ne percevait plus de cotisations, et ne pouvait continuer le service des prestations. Le droit en tirait la conséquence : la résiliation ou le non renouvellement déliait l’assureur de toute obligation. La solution soulevait deux difficultés. La protection des salariés indemnisés était précaire ; elle reposait uniquement sur la pérennité de la relation contractuelle entre leur employeur et l’organisme assureur. L’employeur était dissuadé de changer d’organisme assureur : il eut fallu qu’il versât à celui-ci des sommes dédiées à la reprise des sinistres en cours. Pour ces raisons, la création de la règle imposant le maintien des prestations par-delà l’extinction du contrat ou de l’adhésion exigea que fut organisé le financement de ce maintien : au cours de la période de couverture, l’organisme assureur collecte, en plus des sommes nécessaires au payement des prestations immédiates, les fonds utiles au payement des prestations futures. Au premier alinéa l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixant les obligations de l’assureur à l’endroit des salariés répondent le second alinéa de l’article 7 et le V de l’article 29 de la même loi organisant le fonctionnement technique de ce type d’assurances. L’histoire (ancienne) de ce dispositif n’a pas perdu son actualité. D’une part, des difficultés similaires se présentèrent (se présenteront) lorsque fut reculé (sera reculé) l’âge de départ en retraite : l’engagement fut reporté de deux ans (la plupart des prestations sont servies jusqu’à la liquidation de la pension de retraite) ; il fallut organiser le financement de l’engagement supplémentaire. D’autre part, ce « pré » financement des prestations permit d’étendre la solution retenue à la seule hypothèse de résiliation de l’opération d’assurance à celle de la résiliation du contrat de travail.
1.1.- Principe
Le principe du maintien des prestations est posé à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le texte est imprécis ; la Cour de cassation en restitue toute la finesse.
L’article 7 prévoit que « lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ». La règle peut être résumée : l’organisme assureur servant des prestations lors de la résiliation du contrat ou de l’adhésion doit maintenir ces prestations au-delà de la période de couverture. L’énoncé est pourtant imparfait tant les manques ou les imprécisions sont nombreux : le texte ne dit rien de la rupture du contrat de travail, il ne définit pas les « prestations immédiates ou différées », il est incertain quant aux opérations couvertes. La jurisprudence se chargea de l’affiner.
1.2.- Conditions d’application
Les conditions d’application du texte sont au nombre de trois. Elles tiennent à la nature de l’opération d’assurance concernée, à la résiliation de l’assurance ou de l’adhésion et à l’existence, au jour de cette dernière, d’une prestation en cours de service.
Opérations d’assurances concernées.- Sont visées l’ensemble des opérations d’assurance collective, peu important qu’elles se déploient dans le cadre de l’entreprise. La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 distingue fréquemment le régime juridique des opérations obligatoires (celles où les salariés sont tenus d’adhérer) et celui des opérations facultatives (celles où les salariés ne sont pas tenus d’adhérer), mais non à propos du maintien de garanties (Civ. 2ème, 21 mars 2015, n° 14-16.742).
En revanche, ne sont pas comprises dans le champ d’application du texte les opérations d’assurance résultant d’un contrat souscrit par une collectivité territoriale. Peu importe : les « principes applicables aux contrats administratifs passés en matière d’assurance » commandent une solution identique à celle fixée à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (CE, 28 janvier 2013, n° 357272) : différence de fondement, non de solution, laquelle est générale : « les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de celle-ci » (Civ., 2ème, 13 janvier 2012, n° 11-10.047).
Résiliation ou non reconduction du contrat ou de l’adhésion et rupture du contrat de travail.– La lettre de l’article 7 de la loi n° 89-1009 réserve son application aux cas de résiliation ou de non reconduction de l’assurance ou de l’adhésion. Elle exclut donc la seconde hypothèse à laquelle le bénéficiaire peut se heurter : la rupture du contrat de travail. Qu’importe. La règle posée par l’article 7 n’étant qu’une déclinaison particulière d’un principe général, la Cour de cassation, sur le fondement du droit commun mais en reprenant les termes de l’article 7, juge pareillement que « lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation » (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892 ; Civ. 2ème, 16 avril 2015, n° 14-16.743 ; Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 07-12.064).
Prestations en cours de service.- Le droit fixé à l’article 7 de la loi n° 89-1009 est réservé aux salariés qui perçoivent effectivement des prestations au jour de la résiliation du contrat ou de l’adhésion (ou, par analogie, au jour de la rupture du contrat de travail). La condition ne va pas sans poser des difficultés pratiques ; l’accident et la maladie sont des phénomènes complexes, a fortiori lorsqu’ils confrontés à l’assurance : il y a la naissance du mal, l’arrêt de travail, le début de prise en charge, le passage d’un état (incapacité) à un autre (invalidité). Il faut, dans ces étapes-là, identifier celle qui fait naître le droit à prestations avant de décider du maintien.
La Cour de cassation refuse d’imposer une solution uniforme ; elle renvoie aux dispositions contractuelles : celles-ci fixent le jour d’acquisition du droit à prestations à charge, le cas échéant, aux juges du fond d’interpréter le contrat à cet égard (Civ. 2ème, 13 janvier 2011, n° 09-16.275). C’est ainsi que :
- Un contrat garantissant l’invalidité permanente totale, le salarié, quoique malade puis victime d’un accident, ne peut prétendre disposer d’un droit acquis dès lors que sa situation d’invalidité a été reconnue postérieurement à la résiliation (Civ. 2ème, 21 octobre 2004, n° 03-15.695 ; et Civ. 2ème, 27 mars 2014, n° 13-14.202, rendu à propos de la rupture du contrat de travail),
- Mais, l’invalidité ayant été reconnue conformément aux dispositions du contrat avant la résiliation de celui-ci, le salarié a acquis un droit à prestations, peu important que la demande d’indemnisation a été présentée postérieurement à la résiliation (Civ. 2ème, 16 avril 2015, n° 14-16.743, rendu à propos de la résiliation du contrat de travail).
1.3.- Effets du texte
Lorsque les conditions d’application sont remplies (ou en cas de rupture du contrat de travail), l’organisme assureur est tenu du maintien des « prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 7). L’expression manque d’élégance et de clarté ; elle a toutefois le mérite d’embrasser toutes les rédactions contractuelles, et de permettre une synthèse : toutes les prestations au contrat, à l’exception des prestations décès (sur celles-ci, v. infra), doivent être maintenues jusqu’à leur terme contractuel
Sont maintenues, nonobstant le terme effectivement employé par le contrat :
- Les prestations incapacité ou, plus largement, les prestations afférentes à un arrêt de travail temporaire (ex. prestations « inaptitude »), dès lors que le droit à prestations a été acquis ;
- Les prestations invalidité ou, plus largement, les prestations afférentes à un arrêt de travail ou à une situation de santé pérenne, dès lors qu’elles sont liées à un arrêt de travail ayant donné lieu à prise en charge par l’assureur, peu important que la reconnaissance de l’invalidité soit postérieure à la résiliation ou à la disparition du contrat de travail (Soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434 ; Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 06-45.137 ; Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892) ;
- Les dispositions afférentes aux modalités de revalorisation des prestations en cours de service (Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 18-14.351 ; Civ. 2ème, 8 mars 2006, n° 04-16.854).
Dans le cadre du maintien de ces prestations :
- La dénomination donnée par le contrat à la situation du salarié (ex. : « incapacité », « inaptitude », « invalidité »), ainsi que les segmentations opérées au sein de ces différents états (ex : « 1ère catégorie », « 2ème catégorie »…) sont indifférentes. La décision du 16 janvier 2007 vise le passage d’un état contractuel d’incapacité à un état d’inaptitude ; celle du 17 avril 2008 vise le passage d’un taux donné d’incapacité permanente à autre taux d’incapacité permanente.
- La nature des prestations est indifférente. Le maintien, applicable à coup sûr aux rentes en cours de service peu important qu’elles aient vocation à se transformer à la suite d’un changement d’état de l’assuré, s’étend aux prestations de nature différente : le passage, postérieur à la résiliation du contrat ou de l’adhésion ou à la rupture du contrat de travail, à un état d’invalidité 2ème catégorie donne droit au versement anticipé du capital décès (Civ. 2ème, 17 avril 2008, n° 06-45.137).
Le principe du maintien des prestation connaît cependant quelques tempéraments.
D’abord, s’agissant d’un maintien de prestations (et non de garanties), le maintien n’est dû qu’autant que l’évènement postérieur à la résiliation du contrat ou de l’adhésion ou à la rupture du contrat de travail est en lien avec l’évènement qui a justifié la prise en charge initiale par l’organisme assureur. Il incombe aux juges du fond de caractériser ce lien (Civ. 2ème, 14 janvier 2010, n° 09-10.237 ; Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892). Bénéficient donc du maintien des prestations les salariés victimes de rechutes (Civ. 2ème, 12 avril 2012, n° 11-17.355) ou ceux victimes d’une aggravation de leur état (Civ. 2ème, 21 mars 2015, n° 14-13.223), mais non ceux victimes d’un nouveau dommage.
Ensuite, la dette de l’organisme assureur suppose que le contrat ou l’adhésion prévoie effectivement des prestations : un contrat ne garantissant que l’invalidité, le salarié, quoiqu’en situation d’incapacité avant la résiliation, ne peut prétendre à l’indemnisation de l’invalidité constatée postérieurement (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-14.989).
Enfin, est exclu le maintien des prestations décès, celui-ci étant considéré comme un risque distinct de la maladie ou de l’arrêt de travail (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 98-17.935). Le législateur a atténué la portée de cette exclusion. Il prévoit, à propos du décès, un maintien de « garantie » (la différence de terme – « prestation » / « garantie » – n’étant pas neutre puisqu’elle offre une protection à l’assuré y compris lorsqu’aucun lien n’existe entre le sinistre originellement pris en charge et le décès – v. infra).
1.4.- Portée du texte
Portée juridique : caractère d’ordre public.- Les dispositions de l’article 7 de la loi n° 89-1009 sont d’ordre public (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 10), comme l’est la règle dégagée par la Cour de cassation au profit des salariés en cours d’indemnisation dont le contrat de travail est rompu (Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 13-26.892). Aucune disposition contractuelle ne saurait y faire obstacle.
Portée financière : provisionnement des engagements et indemnité de résiliation.- La réalisation économique de l’obligation de maintien des prestations suppose que l’organisme assureur dispose effectivement des fonds utiles alors même que le contrat ou l’adhésion ont pris fin et que, partant, au jour de l’exécution, il ne perçoit plus de ressources. C’est la raison pour laquelle, d’une part, le second alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit que « l’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents », et, d’autre part, l’article 29 de la loi prévoyait un délai pour que les organismes assureurs constituent ces provisions. Ces solutions, décidées en 1989, ne sont pas neutres aujourd’hui encore.
D’une part, elles expliquent la solution retenue par la Cour de cassation en cas de conflit positif de couverture, dans la situation de successions d’organismes assureurs : alors que l’assureur entrant est tenu de prendre en charge les salariés en cours d’indemnisation au titre de l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (v. supra), l’assureur sortant est tenu d’une obligation similaire au titre de l’article 7. Le juge dut décider lequel des assureurs successifs supporterait en définitive la charge de l’indemnisation (v. § suivant).
D’autre part, elles eurent des échos récents. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 reporta de deux années l’âge légal de départ en retraite et, mécaniquement, l’âge de départ à taux plein. Or, contractuellement, les garanties invalidités des organismes assureurs sont servies jusqu’à la liquidation de la pension de retraite de base. Le report de l’âge de départ en retraite eut donc pour effet indirect d’accroître les engagements des organismes. Le législateur saisit la difficulté et ajouta à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 un article 31 imposant à l’organisme assureur l’obligation de constituer les provisions supplémentaires nécessaires dans une période de six années « à compter des comptes établis au titre de l’année 2010 ».
Au cours de cette période, en cas de résiliation du contrat d’assurance ou de l’adhésion, l’organisme assureur put réclamer à l’entreprise couverte « une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées (…) au titre des incapacités et invalidités en cours ». L’entreprise ne pouvait échapper au payement de cette indemnité qu’à la condition qu’un nouveau contrat ou une nouvelle adhésion soit souscrit et prévoie une reprise intégrale des engagements par le nouvel organisme assureur.
Le principe comme les modalités de cette indemnité de résiliation furent contestés. Sur le principe, il fut prétendu que la disposition légale mettait à la charge de l’entreprise couverte « une indemnité non prévue par le contrat qu’[elle] n’était pas en mesure d’anticiper [ce dont il résultait] une méconnaissance de la garantie des droits et une atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ». Le Conseil Constitutionnel écarta l’argument ; il retînt certes l’atteinte à ces principes mais constata que celle-ci était justifiée par des motifs d’intérêt général (Cons. Const., décision n° 2018-728 QPC du 13 juillet 2018). Quant aux modalités, et à l’identification exacte de la période couverte par l’indemnité de résiliation (l’expression « à compter des comptes établis au titre de l’année 2010 » laissant penser que la date à prendre en considération étant la date de clôture des comptes 2010), la Cour de cassation jugea, à la suite du Conseil Constitutionnel, que le législateur fixait le point de départ de la période de six années au 1er janvier 2010 : partant, l’entreprise ayant résilié son adhésion à effet du 1er janvier 2011 est tenue de l’indemnité de résiliation (Civ. 2ème, 7 février 2019, n° 17-27.099).
Portée économique : succession d’organismes assureurs.- L’organisme assureur étant tenu de constituer les provisions afférentes à son engagement de servir les prestations au-delà de la résiliation ou de la rupture du contrat de travail, il dispose, au jour de la résiliation, des sommes utiles. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation, en cas de successions d’organismes assureurs, décide que c’est à l’assureur sortant, et non à l’assureur entrant, de supporter le coût financier du maintien de prestations (Soc., 16 janvier 2007, n° 05-43.434). Il ne faut toutefois pas se méprendre sur la portée de cette solution à l’égard de l’assureur entrant : tenu de couvrir tous les salariés, y compris ceux en arrêt de travail au jour du début de la couverture, il doit servir à ces derniers les prestations éventuellement promises au-delà de la couverture précédemment offerte par l’assureur sortant. Plus simplement : si le second contrat est meilleur que le premier, le second assureur doit verser la différence aux salariés en cours d’indemnisation au jour du changement d’assureur.
En pratique, il n’est pas rare que l’assureur sortant transfère à l’assureur entrant les provisions constituées au titre des salariés en cours d’indemnisation. L’assureur entrant se charge alors du maintien des prestations.
2.- Maintien des garanties
Aux côtés du maintien des prestations bénéficiant aux seuls salariés recevant des prestations au jour de la résiliation du contrat ou de l’adhésion ou au jour de la rupture du contrat de travail, la loi prévoit des maintiens de garanties : d’abord, le maintien de la garantie décès au profit de ces mêmes salariés, ensuite, le dispositif général dit de « portabilité » bénéficiant aux salariés dont le contrat de travail est rompu (C. séc. soc., art. L. 911-8), enfin un dispositif spécial de maintien des garanties frais de santé au profit des salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (chômage, retraite) et des ayants droit d’un salarié décédé (Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, art. 4).
2.1.- Maintien de la garantie décès
Après que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le maintien des prestations organisé à l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n’embrassait pas le service des prestations servies au titre du décès (Civ. 1ère, 22 mai 2001, n° 98-17.935 ; Civ. 1ère, 8 juillet 2003, n° 00-17.584), le législateur intervint (loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, article 34) et, à cette loi, ajouta un article 7-1, aux termes duquel, lorsque le décès est couvert, le contrat ou l’adhésion « doit inclure une clause de maintien de la garantie décès » en cas de résiliation ou de non renouvellement.
Les conditions d’application du texte sont similaires à celles exposées plus haut, à propos du maintien des prestations incapacité et invalidité, à ceci près que la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion d’étendre la solution législative posée à propos de la résiliation ou du non renouvellement du contrat ou de l’adhésion à l’hypothèse de la rupture du contrat de travail.
Quant aux effets du texte, ils sont également similaires : en cas de décès postérieur à la disparition du contrat ou de l’adhésion, le salarié assuré bénéficie des prestations décès prévues contractuellement s’il percevait les prestations au jour de cette disparition. Une différence doit toutefois être notée qui découle de la qualification de maintien de garanties prévu par la loi : « l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, n’exige [pas] que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint » (Civ. 2ème, 11 décembre 2014, n° 13-25.777).
Par ailleurs, la nécessité de réaliser concrètement ce maintien de garantie exigea que soient mises à la charge des organismes assureurs les mêmes obligations de provisionnement que celles prévues au titre de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Sans surprise, l’article 7-1, à l’instar de l’article 7, prévoit donc l’obligation de provisionner : l’article 30, pris en 2001, créa une période transitoire de dix années pour couvrir par des actifs ces provisions et, à la suite de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, l’article 31 institua un système identique à celui posé à propos du maintien des prestations (lequel système appelle les mêmes commentaires).
2.2.- Dispositifs de portabilité
Dans le prolongement de la volonté des pouvoirs publics de faire bénéficier tous les résidents français de couvertures complémentaires, par deux accords nationaux interprofessionnels, respectivement des 11 janvier 2008 et 11 janvier 2013, les partenaires sociaux créèrent un système de « portabilité » des garanties collectives par-delà la rupture du contrat de travail. Inspirés par la doctrine de la « flexi-securité » – déclinée dans le même temps à propos des droits à formation – les partenaires sociaux travaillèrent à déconnecter le bénéfice de la couverture complémentaire de l’emploi du travailleur. L’idée fut la suivante : permettre au salarié perdant son emploi de conserver pendant un temps raisonnable (comprendre un temps rendant possible l’entrée dans un nouvel emploi) les garanties collectives dont il bénéficiait en tant que salarié.
L’organisation définie en 2008 par les partenaires sociaux présentait toutefois quelques limites, tenant d’abord à son champ d’application – un accord collectif interprofessionnel ne couvre pas tous les secteurs d’activité – et, ensuite, à son organisation – le salarié perdant son emploi était tenu du payement des primes ou des cotisations en contrepartie du maintien de garantie. Elle fut donc remaniée en 2013, avant que le législateur se l’approprie par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et l’intègre à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale à effet du 1er juin 2014 pour les garanties frais de santé et du 1er juin 2015 pour les garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. La ligne est claire : maintenir dans l’assurance à titre gratuit le salarié perdant involontairement son emploi pendant une durée d’une année au plus. L’énoncé du texte est toutefois plus alambiqué et appelle une série de commentaires, tant en ce qui concerne ses conditions que ses effets et ses modalités.
2.2.1.- Conditions d’application
L’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale fixe des conditions tenant à la couverture dont bénéficie le salarié, aux modalités de rupture du contrat de travail et à la situation dans laquelle le salarié se trouve à la suite de la rupture du contrat.
Conditions tenant à la couverture dont bénéficie le salarié.- La portabilité bénéficie « aux salariés garantis collectivement (…) contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité » (C. séc. soc., art. L. 911-8). Il faut comprendre :
- que sont visées par la portabilité les couvertures frais de santé et prévoyance (incapacité, invalidité et décès) ;
- que sont visées par la portabilité les couvertures obligatoires comme les couvertures facultatives (celles auxquelles le salarié n’est pas tenu d’adhérer).
Encore faut-il que le salarié ait effectivement bénéficié d’une telle couverture au cours de sa période d’emploi. Le législateur est maladroit – il ne souligne cette exigence qu’à propos des garanties frais de santé : « le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur » – mais son intention est claire : quoiqu’existât une couverture dans l’entreprise, il faut que le salarié y ait été effectivement affilié pour qu’il puisse valablement se prévaloir du droit à portabilité. Ainsi, en dépit du fait qu’une couverture ait existé dans l’entreprise, ne sont pas éligibles :
- Les salariés qui, au cours de leur emploi, n’ont pu être affiliés faute de satisfaire une condition d’éligibilité (appartenance à la catégorie salariés couverts, atteinte d’une certaine d’ancienneté) ;
- Les salariés qui, lorsque le choix leur était donné, ont refusé l’adhésion, soit parce que les garanties étaient facultatives, soit parce que, en présence de garanties obligatoires, ils décidèrent de se prévaloir de l’une ou l’autre des dispenses d’affiliation d’ordre public (C. séc. soc., art. D. 911-1 et s.) ou prévues dans l’acte de mise en place (C. séc. soc., art. R. 242-1-6).
Conditions tenant à la rupture du contrat de travail.- Le texte n’évoque dans un premier temps, comme condition du maintien de la garantie, que la « cessation du contrat de travail », sans s’attarder sur le mode juridique de rupture : sont donc visés a priori le licenciement, la rupture conventionnelle, la démission (sous les réserves exposées ci-après), la prise d’acte, la résiliation judiciaire et, pourquoi pas ?, la rupture pour cas de force majeure. Seule réserve fixée par le législateur à la suite des partenaires sociaux, la rupture qui interviendrait à raison de la « faute lourde » du salarié. L’exception est d’interprétation stricte : elle ne s’étend pas aux licenciements pour faute grave.
Encore faut-il, précise peu après l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, que la rupture du contrat de travail ouvre droit à l’assurance chômage. De la portée de cette exigence, il convient de préciser plusieurs points :
- Elle exclut que la démission non légitime, au sens de l’assurance chômage, ouvre droit à la portabilité ;
- Il faut et il suffit que la démission ouvre droit à la prise en charge par l’assurance chômage et non que l’ancien salarié profite effectivement, dès la sortie de l’emploi, de ladite assurance chômage. Ont donc vocation à profiter immédiatement de la portabilité les salariés subissant un délai de carence de prise en charge par Pôle emploi ou ceux en arrêt de travail au jour de la rupture.
2.2.2.- Effets
Des la portabilité, il faut indiquer le débiteur, les bénéficiaires, l’objet et la durée, avant d’évoquer le financement.
Débiteur.- Seul l’organisme assureur est débiteur de la portabilité. L’employeur n’est tenu, à l’endroit des bénéficiaires, que d’obligations accessoires au premier rang desquelles figure l’obligation d’information (v. infra n°…).
Bénéficiaires.- La portabilité profite à l’ancien salarié et, le dernier alinéa de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale le précise expressément, aux ayants droit du salarié dès lors que, avant la rupture du contrat de travail, ils en bénéficiaient effectivement. Il est donc exclu qu’un salarié couvert en « isolé » affilie sa famille au titre de la portabilité une fois rompu le contrat de travail.
Objet.- Au profit de l’ancien salarié bénéficiaire, sont maintenues les garanties « en vigueur dans l’entreprise ». L’expression – qui prend l’exact contre-pied de la solution rendue par la Cour de cassation à propos de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 applicable au maintien de la couverture frais de santé – signifie que les modifications apportées par l’employeur après le départ du salarié bénéficiaire sont opposables à ce dernier : la modification des garanties dans l’entreprise voire leurs suppressions, y compris la résiliation du contrat ou de l’adhésion, produisent leurs effets sur les salariés présents dans l’entreprise et sur les salariés portés.
De cette disposition, d’aucuns crurent devoir tirer des conséquences spéciales dans l’hypothèse particulière où l’employeur se trouve acculé à la liquidation judiciaire. Il y avait là une opportunité économique : la portabilité étant octroyée à titre gratuit aux anciens salariés, la disparition de l’employeur interdit à l’organisme assureur, en contrepartie de sa garantie puis de ses prestations, de prélever des cotisations. Demeurait à traduire juridiquement l’argument économique : la liquidation de l’employeur emporte la disparition juridique de celui-ci et, partant, celle du contrat d’assurance ou de l’adhésion souscrit auparavant : dès lors, en l’absence de garanties « en vigueur dans l’entreprise » (puisqu’il n’y a plus ni « entreprise » ni « garantie en vigueur »), le droit à portabilité s’éteint. Le raisonnement était particulièrement spécieux. Il occultait le principe selon lequel la personnalité juridique survit pour les besoins des opérations de liquidation ; surtout, il méprisait l’impératif social : assurer la continuité de la couverture complémentaire dont bénéficiaient les salariés. La Cour de cassation fut néanmoins saisie, d’abord pour avis, ensuite à l’occasion d’affaires particulières et, sur le fondement du principe ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, affirma le principe du droit des salariés dont l’entreprise est placée en liquidation judiciaire à bénéficier de la portabilité : les dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale « qui revêtent un caractère d’ordre public en application de l’article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance » (Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n° 19-17.164 ; Civ. 2ème, 5 novembre 2020, n° 19-17.062 et, auparavant, Cass. Avis, 6 novembre 2017, n° 17013 – à noter toutefois que la Cour de cassation avait entretemps rejeté la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile pour ordonner à l’organisme assureur le maintien effectif de la portabilité en cas de liquidation judiciaire de l’employeur aux motifs que le droit au maintien dans de telles circonstances « n’apparaissait pas avec l’évidence requise » et que le « trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé » (Civ. 2ème, 18 janvier 2018, n° 17-10.636)).
La liquidation judiciaire ne saurait, à elle seule, éteindre le droit à portabilité des anciens salariés, mais elle ne saurait y faire obstacle. Si la résiliation ou le non renouvellement du contrat intervient au cours de la procédure, alors celle-ci produit ses effets, y compris à l’égard des personnes portées : « l’article L. 911-8, 3, du code de la sécurité sociale précisant que les garanties maintenues au bénéfice des anciens salariés sont celles en vigueur dans l’entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié », Cass. Avis, 6 novembre 2017, n° 17013). Encore faut-il que le droit des procédures collectives laisse à l’organisme assureur l’opportunité de procéder à la résiliation ; et encore faut-il que l’organisme assureur saisisse cette opportunité.
Modalités contractuelles.- Les anciens salariés bénéficiaires de la portabilité demeurent dans le groupe assuré, à l’instar des salariés actifs. La portabilité ne donne pas lieu à la souscription d’un nouveau contrat, collectif ou individuel, qui aurait une vie propre au regard du contrat couvrant les actifs (il n’en va pas de même pour la portabilité servie au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, v. infra).
Durée.- La durée de la portabilité, décomptée à la date de cessation du contrat de travail – expression dont il faut comprendre qu’elle vise non la date de notification de la rupture mais la fin de la période de préavis rémunéré puisque des cotisations sont précomptées sur les rémunérations afférentes – est égale à la plus petite des périodes suivantes :
- La durée effective d’indemnisation par l’assurance chômage, étant entendu que la perte du droit à indemnisation, notamment en cas de reprise d’emploi, met fin au droit à la portabilité. Il en va ainsi même si le nouvel employeur n’offre pas les garanties faisant l’objet de la portabilité (ex. absence de garanties incapacité, invalidité ou décès chez le nouvel employeur).
- La durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsque ceux-ci sont consécutifs chez le même employeur. En ce cas, la durée du ou desdits contrats est appréciée en mois et, le cas échéant, est arrondie au nombre supérieur : un salarié ayant été employé durant un mois et demi chez un même employeur peut prétendre (pour autant qu’il demeure couvert par l’assurance chômage) à deux mois de portabilité ;
- Douze mois.
Au terme de la période de portabilité, l’ancien salarié n’est pas nécessairement privé de toute aide au maintien dans l’assurance : le cas échéant lui est ouvert le dispositif prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (v. infra n°…).
Montant des prestations.- En dépit de la présentation communément faite, les garanties dont bénéficie l’ancien salarié ne sont pas strictement identiques à celles dont il bénéficiait en tant que salarié. Certes, aucune altération n’est décidée en matière de frais de santé et de décès ; toutefois, en ce qui concerne les garanties arrêts de travail, le législateur, déclinant le principe indemnitaire, prévoit que « le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômages qu’il aurait perçues » (C. séc. soc., art. L. 911-8, 4°). Peu importe, à cet égard, que les règles de calcul des prestations prévues au contrat conduisent à un montant supérieur : un salarié auquel était garanti 100% de son salaire net ne bénéficiera que d’une prestation égale à son indemnisation chômage.
Financement.- La portabilité est assurée à titre gratuit aux anciens salariés, ainsi qu’à leurs ayants droit. À charge pour l’organisme assureur d’en répercuter le coût sur l’ensemble de la collectivité d’actifs.
2.2.3.- Mise en œuvre
À l’employeur de mettre l’ancien salarié en mesure d’exercer son droit ; à l’ancien salarié de justifier de son droit.
Obligations de l’employeur.- L’employeur est d’abord tenu d’une obligation d’information du salarié quant au dispositif de portabilité. L’article L. 911-8, 6°, prévoit que le certificat de travail « signale » le maintien de garantie. En pratique :
- Il n’est pas rare que la lettre de licenciement elle-même – par hypothèse délivrée en amont de la date d’effet de la portabilité, contrairement au certificat de travail – contienne cette information ;
- Il sera recommandé de faire davantage que de « signaler » la portabilité et d’en indiquer les aspects essentiels : objet, durée et gratuité du maintien.
Ensuite, « l’employeur informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail » (C. séc. soc., art. L. 911-8, 6°)
Obligations du salarié.- Le salarié est tenu de justifier auprès de l’organisme assureur son éligibilité au dispositif (C. séc. soc., art. L. 911-8, 5°). Il prouve son droit au bénéfice de l’assurance chômage et, le cas échéant, fait part de sa radiation.
2.3.- Maintien des garanties frais de santé
L’idée d’un maintien des garanties n’est pas une pure création des partenaires sociaux en 2008 reprise à son compte par le législateur en 2013. Elle se manifestait déjà à l’article 4 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Le dispositif, toujours en vigueur quoiqu’aménagé depuis lors, présentait toutefois quelques carences au premier rang desquelles figurait – et figure encore – le fait que l’ancien salarié devait supporter une hausse sensible, quoique contrôlée, du coût des garanties, ce qui était de nature à dissuader les populations les plus précaires désormais privées d’emploi de demeurer dans l’assurance. En revanche, ce dispositif était – est encore – plus large, par certains aspects, que celui fixé à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : il embrasse non seulement les salariés inscrits au chômage, mais encore les retraités et les ayants droit d’un assuré décédé.
2.3.1.- Organisation du maintien des garanties
L’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre a pour finalité le maintien dans l’assurance des anciens salariés et des ayants droit des salariés décédés par-delà la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, l’épuisement de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction toutefois, le texte ne crée pas expressément un tel droit ; il se présente comme une obligation pesant sur les auteurs du contrat ou de l’adhésion d’organiser, au sein de celui-ci ou de celle-ci, un mécanisme de portabilité qui satisfait un certain nombre de conditions. Le texte prévoit ainsi que « le contrat ou la convention [applicable aux actifs] doit prévoir (…) les modalités et les conditions tarifaires » de la couverture ». En pratique, il arrive que « le contrat ou la convention » applicable aux actifs n’organise pas le maintien de garantie. Les parties au contrat ou à la convention, chacune pour sa part et, tenant compte de l’information qu’elles auraient par ailleurs communiquée à la personne assurée, engageraient leur responsabilité s’il était établi que le dispositif n’a pas été porté à la connaissance de cette dernière.
Toutefois, nul ne conteste qu’il faut aussi comprendre l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 3& décembre 1989 comme faisant obligation à l’organisme assureur de fournir effectivement la couverture, l’ancien salarié pouvant exiger l’exécution en nature – c’est-à-dire son adhésion – et non seulement des dommages et intérêts. Aussi, plutôt que de lire le texte comme une contrainte pesant sur les auteurs du contrat ou de l’adhésion applicable aux actifs, il est tout à fait permis de le lire directement comme l’obligation incombant à l’organisme assureur d’offrir une couverture à l’ancien salarié ou à l’ayant droit du salarié décédé, et, réciproquement, comme une créance propre des uns et des autres contre l’organisme assureur.
2.3.2.- Conditions d’application
Débiteur.- L’organisme assureur ayant couvert l’intéressé alors que celui-ci était salarié est le seul débiteur du maintien de garantie – l’employeur n’est tenu à rien (outre les obligations accessoires d’information).
Bénéficiaires.- L’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fixe les conditions tenant à la définition des bénéficiaires : une condition générale afférente à la nature des opérations concernées et des conditions particulières tenant à la personne éligible.
Nature de l’opération :Le maintien de garantie au profit des anciens salariés ou des ayants droit des salariés décédés est réservé à ceux couverts dans les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, c’est-à-dire à titre obligatoire : les opérations collectives mises en œuvre à titre facultatif, quoique donnant lieu à la portabilité fixée à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, n’ouvrent pas droit au maintien au titre de l’article 4.
Anciens salariés bénéficiant d’un revenu de remplacement : Parmi les anciens salariés, seuls sont éligibles ceux qui bénéficient d’un revenu de remplacement :
- rente d’incapacité ou d’invalidité,
- pension de retraite,
- allocation chômage.
En pratique, et a fortiori depuis l’entrée en vigueur de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, sont principalement bénéficiaires du dispositif prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 les anciens salariés retraités.
L’obligation de couvrir l’ancien salarié ne s’étend pas à l’obligation de couvrir les ayants droit de celui-ci : « Le maintien de la couverture ne peut profiter aux ayants droit puisque l’article 4 de la loi 31 décembre 1989 ne vise que les anciens salariés, et que le maintien au profit des ayants droit n’est prévu qu’en cas de décès (CA Lyon, 13 janvier 2009, n° 08/2875 ».
Ayants droit de l’assuré décédé :Bénéficient également du droit au maintien, quoique dans des conditions différentes, les « personnes garanties du chef de l’assuré décédé », comprendre les ayants droit du salarié lorsque celui-ci est mort au cours de la période de couverture.
Absence de sélection médicale.– L’utilité sociale du dispositif serait anéantie si, à l’occasion de la rupture du contrat de travail (voire du décès de l’assuré), l’organisme assureur pouvait opérer une sélection médicale quelconque. Du reste, un garde-fou protégeant l’assureur existe déjà : le maintien de garantie n’est dû que pour les personnes assurées dans le cadre d’un contrat obligatoire (v. supra), ce qui limite le risque d’antisélection, sans le faire disparaître tout à fait : les anciens salariés et les ayants droit des salariés décédés sont libres de profiter ou non du maintien de garantie ; dès lors il n’est pas exclu que seules les personnes les plus exposées seulement se prévaudront de ce dernier.
Toujours est-il que l’interdiction de sélection médicale est expressément prévue par le texte :
- d’une part, tous les anciens salariés qui étaient couverts et qui bénéficient d’un revenu de remplacement sont créanciers du droit au maintien de garantie ;
- d’autre part, la mise en œuvre de ce maintien doit se faire, selon la lettre du texte, « sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux ».
2.3.3.- Effets
Objet.- L’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, se référant à la couverture dont bénéficiait le salarié lorsqu’il était encore dans l’emploi, prévoit que l’organisme est tenu de maintenir « cette » couverture.
L’adjectif démonstratif est important ; par le passé, il donna lieu à un feuilleton judiciaire opposant, d’une part, un ancien salarié retraité qui prétendait que la couverture devant être maintenue était précisément celle dont il avait joui avant son départ de l’entreprise et, d’autre part, un organisme assureur interprétant le texte comme l’obligeant à maintenir une couverture similaire, proche, semblable, sans être parfaitement identique. En toile de fond, et telle était d’ailleurs la thèse soutenue par l’organisme assureur, se posait la question de savoir si la modification du contrat ou de l’adhésion profitant aux actifs est opposable à l’ancien salarié bénéficiaire du maintien de garantie. La Cour de cassation rendit une décision de principe : le droit dont dispose l’ancien salarié ou l’ayant droit du salarié décédé a pour objet le maintien de l’exacte garantie dont il jouissait au jour de son départ de l’entreprise ou, depuis, au jour de la fin du droit à portabilité (Civ. 2ème, 7 février 2008, n° 06-15.006). En cela, le maintien de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 se distingue de la portabilité prévue à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : durant la période de la portabilité, les modifications apportées au contrat ou à l’adhésion des actifs – voire la disparition de ce contrat ou de cette adhésion – sont opposable aux anciens salariés portés. Du coup, et quoique la décision soit fidèle au texte (et au démonstratif « cette »), ses implications pratiques ne sont pas négligeables. L’organisme assureur qui souhaite se plier à cette exigence – il n’est pas dit que de tels organismes assureurs soient si fréquents sur le marché – doit, pour une même population d’anciens salariés, offrir des garanties différenciées, au rythme des modifications apportées par le passé aux garanties collectives offertes aux actifs, tandis que les bénéficiaires quittaient le souscripteur.
Dans cette même affaire ayant donné lieu à la décision du 7 février 2008, la cour d’appel de renvoi affina la solution. Certes, les garanties devant être maintenues sont identiques à celles dont bénéficiait l’intéressé au jour de son départ mais le droit au maintien ne s’étend pas à la couverture des ayants droit de l’ancien salarié bénéficiaire d’un revenu de remplacement (v. supra).
Modalités contractuelles.- Alors que la portabilité réalisée dans le cadre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale organise un maintien des anciens salariés au sein du contrat ou de l’adhésion dont profitent les salariés, l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 prévoit la création de « nouveaux contrats ou conventions ». Il faut comprendre que, le moment venu, l’organisme assureur propose au bénéficiaire du maintien :
- un contrat individuel ;
- ou une adhésion à une opération collective dont le souscripteur peut être l’employeur voire, si les liens avec ledit employeur ont disparu (par exemple à la suite de la résiliation du contrat obligatoire au titre duquel est offert le maintien de garantie), une association d’assurés.
L’obligation de l’employeur étant de « proposer » un nouveau contrat ou une nouvelle adhésion, le maintien effectif de garanties exige, pour exister, le consentement de l’ancien salarié ou de l’ayant droit. À défaut de cet accord, aucun contrat, aucune adhésion ne saurait exister.
L’acte juridique servant de support au maintien de garanties est parfaitement distinct de l’acte sur lequel reposait la couverture offerte aux actifs. Chacun des actes vivra ensuite sa vie de son côté. Il peut arriver néanmoins que l’employeur et l’organisme assureur organisent une « solidarité » entre le contrat ou l’adhésion des actifs et le contrat ou l’adhésion collectif accueillant les inactifs : d’une manière ou d’une autre, une fraction de la cotisation payée par les premiers sert au financement des garanties proposées aux seconds. Rien ne paraît interdire une telle pratique, mais la rupture de cette solidarité – par exemple à la suite de la résiliation du contrat ou de l’adhésion des salariés – ne saurait priver les anciens salariés ou les ayants droit du salarié décédé du droit propre qu’ils tirent de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 contre l’organisme assureur.
Durée.- Le droit au maintien de garantie est ouvert à compter de la rupture du contrat de travail – y compris la rupture résultant du décès en ce qui concerne les ayants droit de l’assuré décédé – ou, le cas échéant, à compter « de la fin de la période du maintien des garanties temporaires », comprendre la fin de la période de portabilité due au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
À ce propos – et une nouvelle fois – le texte est maladroit :
- d’une part, il ne vise pas directement l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, mais emploie l’expression « fin de la période du maintien des garanties » : il n’en faut pas moins entendre qu’il est renvoyé ici à cet article L. 911-8 et au dispositif que celui-ci organise ;
- d’autre part, une lecture littérale du texte laisse entendre qu’un temps de latence puisse exister entre l’évènement ouvrant le droit au maintien au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et l’entrée effective du bénéficiaire dans cette nouvelle assurance. Prévoyant que l’organisme assureur adresse les documents utiles « dans un délai de deux mois à compter » de la rupture du contrat, de la fin de la période de portabilité ou du décès, la lettre du texte laisse en suspens la question de la couverture entre cet évènement et le jour où l’organisme assureur reçoit effectivement l’acceptation du bénéficiaire. Selon toute vraisemblance le juge, s’il était saisi de cette anecdotique difficulté, retiendrait la rétroactivité de l’acceptation et, partant, la continuité de la couverture.
Le temps pendant lequel l’organisme assureur doit conserver au sein du nouveau contrat ou de la nouvelle convention le bénéficiaire est fixé différemment selon qu’il est question des anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement ou des ayants droit d’un salarié décédé.
Dans le premier cas, le texte ne prévoit expressément aucune durée. Il se déduit de la condition fixée pour jouir du maintien de garantie – bénéficier d’une rente incapacité ou invalidité, d’une pension de retraite ou des allocations chômage – que l’ancien salarié peut profiter du dispositif jusqu’à ce qu’il soit privé de tout revenu de remplacement. La chose n’arrivant qu’à l’occasion du décès lorsque le salarié est titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une pension de retraite, le maintien de garantie prévu à l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, est bien viager.
Dans le second cas, à propos des ayants droit de l’assuré décédé, l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prévoit que le maintien est offert « pendant une durée minimale de douze mois ».
Financement.- Au contraire de la portabilité fixée à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, la portabilité assise sur l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 n’est pas offerte gratuitement. Le bénéficiaire doit s’acquitter de son coût. Cette différence est substantielle et il ne faut pas en mépriser l’importance pratique pour l’assuré : non seulement, à la suite de son départ de l’emploi, celui-ci a subi un perte de rémunération, mais encore il a perdu l’aide que fournissait l’employeur. Dès 1989, le législateur tint compte de ces circonstances. Il renvoya au pouvoir règlementaire le soin d’encadrer les conditions tarifaires proposées par l’organisme assureur aux bénéficiaires.
En dernier lieu, ces conditions firent l’objet de l’article 1er du décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 modifiant l’article 1er du décret n° 90-769 du 30 août 1990 et applicable aux contrats et adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017 (Décret n° 2017-372, art. 2). Le texte prévoit désormais que :
- La première année d’adhésion au nouveau contrat ou à la nouvelle adhésion, les tarifs appliqués ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
- La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
- La troisième année, les tarifs ne peuvent ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
Cette rédaction fut prise pour pallier les critiques émises contre l’ancienne version du texte, elle-même issue du décret n° 90-769 du 30 août 1989, qui prévoyait laconiquement que : « Les tarifs applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ne peuvent être supérieurs de plus de 50 p. 100 aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ». Outre la discussion tenant à l’opportunité d’un tel seuil, c’était l’expression même de celui-ci qui était débattue à raison de l’imprécision de l’énoncé ; l’article 1er du décret 2017-372 ne marque aucune avancée et les questions sont nombreuses. Faisant référence aux « tarifs globaux applicables aux salariés actifs », le règlement ne dit rien :
- ni de la façon dont sont appréciés ces tarifs lorsque la couverture des salariés actifs n’existe plus,
- ni de ce qu’il convient d’entendre par « tarif global » dès lors que la structure de cotisation du contrat ou de l’adhésion des actifs n’isolait pas la fraction de cotisation dédiée à la couverture des actifs (garanties dites « famille »).
À cela s’ajoutent :
- le doute quant au moment exact où l’organisme assureur peut décider de la réévaluation des cotisations : rien n’indique que le passage de la première à la seconde année, puis celui du passage de la seconde à la troisième, correspondent à l’échéance du nouveau contrat ou de la nouvelle adhésion autorisant la réévaluation : rien n’interdit néanmoins à l’organisme assureur d’organiser contractuellement, en amont cette revalorisation.
- le doute quant au sort des cotisations au-delà de la troisième année. La version initiale du texte prévoyait un plafonnement dont il y avait tout lieu de penser qu’il était pérenne, c’est-à-dire que l’assuré pouvait s’en prévaloir sans limite de durée (jugé en ce sens : TGI Paris, 13 septembre 2012, n° 10/07060 ; TGI Paris 31 mai 2011, n° 09/03627). La nouvelle rédaction laisse entendre qu’aucune protection tarifaire spécifique ne bénéficie à l’assuré à compter de la quatrième année. Dès lors, et selon toute vraisemblance, l’organisme assureur est tenu par les dispositions de l’article 6 de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, applicable à tous les contrats couvrant le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident : « la hausse doit être uniforme pour l’ensemble des assurés ou des adhérents souscrivant ce type de contrat ».
2.4. Maintien de couverture en cas de résiliation du contrat ou de l’adhésion
L’article 5 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fait obligation aux parties au contrat ou à l’adhésion couvrant les actifs à titre obligatoire, peu important que ledit contrat ait pour objet le remboursement des frais de santé ou le service de prestations de prévoyance, de prévoir le préavis applicable à sa résiliation et, encore, « les conditions tarifaires selon lesquelles l’organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire médicaux, au profit des salariés concernés, sous réserve qu’ils en fassent la demande avant la fin du délai de préavis ». Les salariés portés au titre de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale doivent bénéficier de cette disposition.
Le texte a le mérite d’exister ; sa portée pratique est cependant limitée :
- d’une part, il est rare que la résiliation ou le non renouvellement d’un contrat ou d’une adhésion dans le cadre d’une entreprise ne s’accompagne pas de l’entrée en vigueur immédiate d’un nouveau contrat ou d’une nouvelle adhésion : du reste, la loi contraint ce « maintien » en matière de frais de santé (C. séc. soc., art. L. 911-7) ;
- d’autre part, le législateur n’offre aucun avantage supplémentaire au bénéficiaire – stabilité des garanties, encadrement tarifaire – qui pousserait celui-ci à s’en prévaloir.
3. Revalorisation
À raison de la spécificité du risque qu’elle vise à couvrir – l’inflation – la revalorisation des prestations et des garanties obéit à des mécanismes particuliers.
Spécificité de l’inflation.- L’utilité sociale des maintiens de prestations ou de garantie n’est réelle qu’à la condition que soit domestiqués un facteur lancinant, l’écoulement du temps, et l’inflation que celui-ci héberge. Les prestations invalidité – et, de nos jours dans une moindre mesure, les prestations incapacité – ont vocation à être servies sur de très longues périodes ; à défaut de revalorisation, le bénéficiaire verrait peu à peu diminuer ses ressources. De même, la garantie décès doit être maintenue aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières et les prestations invalidité. Or, elle est exprimée en valeur absolue ou en multiple des derniers salaires d’activité et, partant, sa valeur réelle s’effrite à mesure que passent les années. L’inflation a toutefois ceci de particulier qu’elle est un risque inassurable. Son anticipation exposerait trop fortement le débiteur et, menaçant sa solvabilité, menacerait l’équilibre financier global de la protection sociale complémentaire.
Organisation de la revalorisation.- Sans surprise, confronté à ces deux exigences – utilité sociale des garanties et prestations et sécurité financière des organismes assureurs – le législateur a opté pour une voie médiane. L’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale prévoit l’obligation de principe de procéder à la revalorisation, mais les conditions de celle-ci seront décidées année après année.
D’une part, lorsque la convention, l’accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l’article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l’incapacité de travail ou de l’invalidité, ils organisent également, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. La loi n’interdit nullement à l’employeur de s’engager au-delà d’une simple « organisation » des modalités de revalorisation en prévoyant, par exemple, une indexation sur une indice extérieure (pourvu que l’indexation elle-même soit licite) mais, en tout état de cause, il demeurera libre de se défaire de cet engagement, y compris à l’égard des salariés qui auraient liquidé leurs droits (comp., Soc., 17 mai 2005, n° 02-46.581). Quoiqu’il en soit, l’organisation ainsi décidée ne saurait priver l’assuré de la protection qu’il tire de l’article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Or la Cour de cassation, élargissant la lettre du texte, juge que l’organisme assureur est tenu non seulement du maintien des prestations mais encore de la revalorisation telle qu’elle est prévue au contrat ou dans l’adhésion. Partant, est nulle la clause qui prévoirait que la revalorisation cesse de produire ses effets » à la suite de la résiliation de l’adhésion (Civ. 2ème, 16 juillet 2020, n° 18-14.351 ; v. déjà Civ. 2ème, 8 mars 2006, n° 04-16.854).
D’autre part, lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur ou d’une institution mentionnée à l’article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l’objet d’une résiliation.