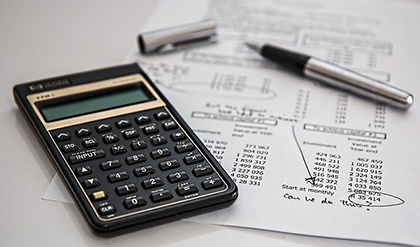Article rédigé par Martin Oudin, Maître de conférences hdr – directeur honoraire du Master Juriste d’entreprise – Université de Tours
Au plan purement théorique, il est possible de conclure oralement un accord de médiation[1]. Accord de volontés destiné à créer des effets de droit, l’accord de médiation est avant tout un contrat[2]. Or, en matière de contrats, l’écrit est l’exception. Lorsqu’aucune règle spéciale ne l’impose, les parties sont libres d’y recourir ou non. Comme tout contrat de droit commun, l’accord de médiation peut donc être purement verbal.
Cependant, dans une relation qui, par hypothèse, a été par le passé source de conflit, il est prudent de constater par écrit l’accord de médiation. En pratique, la forme écrite est fréquente. Certaines législations nationales l’imposent[3]. D’autres font de l’écrit une condition sans laquelle l’accord ne peut produire certains effets. Ainsi, en droit français, l’homologation de l’accord de médiation est impossible si aucun écrit n’existe. L’article 131-12 du code de procédure civile est sans ambiguïté pour ce qui concerne la médiation judiciaire, puisqu’il énonce que « les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. » L’article 1565 al. 1er est moins clair pour l’accord de médiation conventionnelle[4], mais on voit mal comment un accord non écrit pourrait être soumis au juge. On peut enfin souligner que si les parties veulent conférer à l’accord de médiation la valeur d’une transaction, elles devront le rédiger par écrit, conformément à l’article 2044 du code civil[5].
Compte tenu de sa nature très particulière, l’accord de médiation doit être rédigé avec prudence. De nombreuses précautions doivent être prises, dès avant que les premiers mots soient couchés sur le papier.
1.- Les rédacteurs
La question même de savoir qui va rédiger l’accord soulève des interrogations. Bien souvent, les parties n’ont pas la compétence technique nécessaire. Quand bien même elles auraient cette compétence, le risque est grand de voir le conflit ressurgir dans la phase rédactionnelle, soit que les parties ne s’entendent pas sur la façon de transcrire leurs échanges, soit que l’une d’elles saisisse cette occasion pour revenir sur les propos qu’elle a tenus. L’accompagnement d’un tiers paraît donc indispensable, sous peine de compromettre tout le processus.
Ce tiers est parfois tout désigné par l’objet même du litige. Ainsi, si celui-ci porte sur des droits immobiliers, la nécessité de recourir à la forme authentique imposera la sollicitation d’un notaire. Rien de tel en matière de conflits individuels de travail : aucune règle ou contrainte particulière ne désigne un rédacteur spécifique.
1.1.- Rédaction par le médiateur ?
Il est naturel de songer que le tiers rédacteur peut – ou doit – être le médiateur qui a aidé les parties à parvenir à un accord. La solution est pourtant loin d’être évidente pour les médiateurs eux-mêmes.
Certains doutent tout d’abord que le médiateur soit habilité à rédiger l’accord. Il n’existe pourtant aucune prohibition expresse en ce sens. On cite souvent l’article 60 de la loi du 31 décembre 1971[6]. Selon ce texte, « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité. » Il est vrai que tous les médiateurs ne sont pas tenus de justifier d’une « qualification » au sens de l’article 60 de la loi de 1971[7]. Mais nombreux sont ceux qui sont titulaires d’un diplôme universitaire ou délivré par un organisme de formation agréé. Ne s’agit-il pas alors d’une qualification « attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé » ? Par ailleurs, ne peut-on pas considérer que l’accord de médiation constitue « l’accessoire nécessaire » de l’activité de médiation ?
Quoi qu’il en soit, l’obstacle majeur à la rédaction de l’accord par le médiateur est d’une autre nature. Il tient à la crainte, pour les médiateurs, de voir leur responsabilité engagée en leur qualité de rédacteurs d’acte. Les rédacteurs d’actes sont tenus d’une obligation de conseil envers les parties en présence et doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent, comme l’affirment certains textes[8] et une jurisprudence constante. C’est surtout à propos des professionnels du droit – notaires[9], avocats[10] et huissiers de justice[11] – que la Cour de cassation a régulièrement l’occasion de rappeler ce principe[12]. Mais elle l’a également étendu à d’autres professionnels, tels les agents immobiliers[13] ou les experts comptables[14]. Il semble qu’en fait le principe puisse être généralisé à tous les professionnels rédacteurs d’acte, comme le suggèrent certaines formules utilisées par la Cour de cassation : « les rédacteurs d’actes sont tenus d’une obligation de conseil envers toutes les parties en présence et doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent »[15] ; « les rédacteurs d’actes doivent s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’ils confectionnent ; à défaut, ils engagent leur responsabilité envers toutes les parties en présence »[16]. On ne voit pas pour quelle raison cette responsabilité ne devrait pas être appliquée au médiateur. Bien sûr, il n’est pas a priori un spécialiste de la rédaction d’actes. Mais il est un professionnel rémunéré pour sa prestation de médiation. S’il décide d’étendre celle-ci à la rédaction d’un accord, il doit s’acquitter de cette tâche en bon professionnel. Ce qui implique, nous semble-t-il, qu’il prenne connaissance a minima des conditions de validité et d’efficacité de l’accord. Si par exemple il acceptait de rédiger un accord par lequel les parties renonceraient à des droits indisponibles, il est probable que celles-ci pourraient ensuite mettre en cause sa responsabilité.
La loi de 1971 exige que les rédacteurs d’acte soient couverts par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et qu’ils justifient d’une garantie financière[17]. Or, les assurances souscrites par les médiateurs ne couvrent pas toujours ce type de risques. C’est pourquoi, en pratique, de nombreux médiateurs s’abstiennent purement et simplement de rédiger eux-mêmes des accords de médiation. D’autres ont recours à des stratégies de contournement : ils se limitent à rédiger de simples « projets d’accord » ou indiquent expressément que la rédaction a été faite sous la dictée des parties. Il n’est pas certain que ces expédients leur permettent d’échapper à une éventuelle responsabilité. Deux affaires portées devant la Cour de cassation témoignent en effet de la sévérité de celle-ci.
Dans la première, un avocat avait établi un projet d’acte de cession de fonds de commerce à la demande du propriétaire du fonds, l’acte de vente n’étant dressé que quelques jours plus tard hors la présence de l’avocat. Un litige était ensuite survenu avec le propriétaire du local dans lequel le fonds était exploité, au sujet d’une clause du contrat de bail que l’acte de vente n’avait pas prise en considération. Pour retenir la responsabilité de l’avocat, les juges relèvent que le projet d’acte établi par lui « était si complet et si détaillé [qu’il] ne pouvait ignorer qu’il serait utilisé comme modèle par les parties »[18].
La seconde affaire concerne un acte de cession de parts sociales établi, à la demande du cédant, par un avocat et signé hors la présence de ce dernier. Le cessionnaire ayant été poursuivi en paiement de dettes de la société dont il avait acquis des parts, il se retourna contre l’avocat. Pour la Cour de cassation, dès lors que l’avocat « avait remis [au cédant], non un simple modèle, mais un projet finalisé entièrement rédigé par ses soins, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en qualité d’unique rédacteur d’un acte sous seing privé, l’avocat était tenu de veiller à assurer l’équilibre de l’ensemble des intérêts en présence et de prendre l’initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d’autre, peu important le fait que l’acte a été signé en son absence après avoir été établi à la demande d’un seul des contractants »[19].
Il n’est pas certain que la jurisprudence se montrerait aussi sévère à l’encontre du médiateur qu’elle l’est avec l’avocat, professionnel du droit. La prudence devrait néanmoins inciter le médiateur, sinon à renoncer à tout acte rédactionnel, du moins à souscrire une solide assurance s’il souhaitait prêter son concours à la rédaction de l’accord final.
1.2.- Rédaction par les avocats ?
Les choses se présentent différemment lorsque les parties sont assistées par des avocats au cours de la médiation. En ce cas, les avocats peuvent prendre en charge la rédaction de l’accord. Ils sont rompus à la rédaction d’actes. Celle-ci constitue une part importante de leur activité et elle est à ce titre couverte par leurs assurances de responsabilité civile. De deux choses l’une :
Soit les avocats ont assisté à l’ensemble du processus de médiation. Il leur est alors aisé de transcrire l’accord auquel sont parvenues les parties en un document que celles-ci seront disposées à signer. Ce cas de figure n’est sans doute pas le plus fréquent, au moins parmi les médiations conventionnelles.
Soit les avocats n’ont pas assisté aux échanges entre les parties. Le risque est alors que leur intervention marque une rupture dans le processus ; que les parties, spontanément ou sous l’impulsion de leurs avocats, revoient leurs positions et reviennent sur des concessions faites.
La meilleure solution réside sans doute dans une collaboration entre médiateur et avocats des parties. Le médiateur, qui a tenu la plume pour les parties tout au long de leurs échanges, peut fournir aux avocats la matière brute de l’accord (un simple relevé de décisions). Il peut ensuite assister ces derniers dans leur travail rédactionnel, mais seulement dans la mesure nécessaire au respect des intentions formulées par les parties.
1.3.- Signature
Reste la délicate question de la signature de l’accord par le médiateur. Certains droits nationaux l’imposent, à l’instar du droit belge[20]. La signature du médiateur peut alors apparaître comme la garantie que l’accord est issu d’un processus de médiation conduit par un médiateur accrédité ou assermenté[21]. Mais en France, où l’accréditation n’est pas une condition d’exercice, quel sens aurait cette signature ? Serait-elle de nature à rassurer les parties sur la solidité de l’accord ? Encouragerait-elle le médiateur à faire preuve de plus de diligence dans la conduite du processus (voire dans la relecture de l’accord) ? Cela reste à démontrer. Il existe en revanche un danger : celui que cette signature soit analysée (notamment par les tribunaux) comme la marque d’une approbation par le médiateur de la licéité de l’accord, voire de l’équilibre des dispositions qu’il recèle. En ce cas, le médiateur s’exposerait à nouveau à un risque élevé de responsabilité. En tout état de cause, de nombreux médiateurs évitent de signer l’accord de médiation, essentiellement par crainte de voir leur responsabilité engagée. En l’absence de certitude à cet égard, cette posture paraît sage.
2.- Le contenu de l’accord
Parce qu’il est un contrat, l’accord de médiation est gouverné par un principe général de liberté : liberté de contracter ou non, mais aussi de « déterminer le contenu et la forme du contrat », ainsi que l’affirme l’article 1102 du code civil. Cette liberté n’est toutefois pas sans limite, comme l’annonce le second alinéa du même article[22], ainsi que, de façon plus précise, l’article 1162[23]. Ces textes énoncent tous deux une même limite à la liberté contractuelle : le respect de l’ordre public. Les accords de médiation n’y échappent pas. Comment, pour ce qui les concerne, ce principe général de respect de l’ordre public se traduit-il ?
2.1.- Médiation, ordre public et droits indisponibles
En matière de modes alternatifs de règlement des conflits, l’ordre public est surtout sollicité pour préserver les prérogatives de la justice étatique ; plus exactement, pour encadrer la liberté de renoncer à la justice étatique et à la protection que celle-ci assure aux justiciables.
En ce sens, l’article 2060 du code civil énonce, s’agissant de l’arbitrage : « On ne peut compromettre sur les questions d’état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l’ordre public. » La formulation est malheureuse, car elle donne à croire qu’il est interdit de compromettre dès lors que le litige touche à l’ordre public. En réalité, il est permis de compromettre, mais dans le respect de l’ordre public[24]. L’article 2060 vise l’ordre public juridictionnel, en ce sens qu’il interdit de porter atteinte aux règles qui attribuent compétence aux juridictions étatiques[25]. Cet ordre public juridictionnel se double parfois d’un ordre public de protection, destiné à préserver les droits subjectifs des parties au litige lorsque celles-ci renoncent à la protection du juge étatique.[26] C’est souvent à travers la notion de droits indisponibles que s’exprime cet ordre public de protection : les parties ne peuvent se soustraire à la protection du juge étatique que pour les droits dont elles ont la libre disposition. C’est ce qu’énonce l’article 2059 du code civil[27].
La réaction de l’ordre public à l’arbitrage s’explique par le fait que celui-ci substitue une justice privée à la justice étatique. Cette question est particulièrement sensible en droit du travail[28] et passablement compliquée par la compétence exclusive attribuée aux conseils de prud’hommes par l’article 1411-4 du code du travail[29]. La médiation, quant à elle, n’opère aucune substitution ; elle complète volontiers la justice étatique et peut être préconisée par le juge lui-même. L’ordre public juridictionnel n’a donc pas lieu d’être sollicité. En revanche, si les parties parviennent à un accord à l’issue de la médiation, le juge ne sera pas à leurs côtés pour veiller à la préservation de leurs droits. Cette affirmation doit bien sûr être nuancée, car le juge pourra toujours contrôler a posteriori le respect des droits indisponibles si une demande d’homologation lui est présentée[30]. Il n’en reste pas moins que l’accord se formera hors la présence du juge et qu’il échappera parfois totalement à son contrôle. L’ordre public de protection doit donc pleinement jouer son rôle. Voilà pourquoi la loi du 8 février 1995, tandis qu’elle est silencieuse sur « l’ordre public » (judiciaire), énonce à l’article 21-4 que « l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition »[31]. De façon similaire et pour les mêmes raisons, on retrouvera la réserve des droits indisponibles, sans référence plus générale à l’ordre public, en matière de transaction[32] ou de procédure participative.[33]
2.2.- Contenu des droits disponibles
Quels sont les droits dont les parties peuvent disposer par un accord de médiation ? Il n’est pas simple de répondre à cette question, qui justifie pour partie la réticence des médiateurs à rédiger eux-mêmes les accords de médiation. La doctrine approfondit peu la question, qui n’est guère alimentée par la jurisprudence. On cherchera en vain des décisions de la Cour de cassation interprétant l’article 21-4 de la loi de 1995. On trouvera en revanche des éléments de réponse ou de réflexion dans les sources relatives à d’autres modes alternatifs : arbitrage et transaction, voire procédure participative.
Il apparaît tout d’abord que les droits extrapatrimoniaux, dont les droits de la personnalité, sont frappés d’une indisponibilité permanente.[34] Ces droits sont exclus de tout commerce juridique et ne peuvent faire l’objet d’aucune convention, ce qui inclut les accords de médiation. Mais en réalité, ne sont prohibés que les accords remettant en cause le droit lui-même, dans son principe ou son étendue. Il est possible en revanche de conclure des contrats portant sur certains usages de ces droits – par exemple sur l’utilisation de l’image ou du nom d’un salarié. Dans les cas où cette patrimonialisation est admise, il n’y a pas de raison que les droits en cause ne puissent faire l’objet d’un accord de médiation.[35] Mais peut-être la question est-elle assez théorique : il est peu probable que les droits de la personnalité soient l’enjeu d’une médiation en entreprise.
La question des droits patrimoniaux est plus délicate. Il est admis qu’en principe, ils sont indisponibles tant qu’ils ne sont pas acquis. Des droits à venir ne peuvent faire l’objet ni d’un arbitrage[36] ni d’une transaction[37]. A nouveau, il n’y a pas de raison de traiter différemment les accords de médiation. Mais suffit-il qu’un droit soit acquis pour que l’on puisse en disposer ? C’est avec cette question que commencent les difficultés. Il faut ici distinguer entre les droits du salarié à l’égard de son employeur et les droits du salarié à l’égard d’autres salariés.
Dans la relation entre le salarié et son employeur, il est certain que les droits relevant de l’ordre public absolu – qui regroupe les règles insusceptibles de quelque dérogation que ce soit, même en faveur des salariés[38] – sont indisponibles. S’agissant des droits relevant de l’ordre public social – règles protectrices du salarié et auxquelles il ne peut être dérogé qu’en faveur de celui-ci – il est souvent admis que le lien de subordination fait obstacle à leur libre disposition. Pour de nombreux auteurs, la situation d’infériorité du salarié justifie une protection particulière pendant toute la durée du contrat. En conséquence, les droits spécifiquement protégés par le code du travail seraient temporairement insusceptibles de renonciation, donc indisponibles[39]. Il en va sans doute de même des droits protégés par une convention collective. Cette indisponibilité cesserait au jour de l’extinction du lien contractuel. Le droit de l’arbitrage évoque parfois une inarbitrabilité temporaire liée à la subordination[40]. Au sujet de la transaction, on a surtout discuté de la validité de principe d’une transaction antérieure à la rupture (dans les faits, la grande majorité des transactions sont postérieures à la rupture et portent sur les conséquences de celle-ci). Certains ont affirmé que le lien de subordination l’interdisait, mais la Cour de cassation les a démentis à plusieurs reprises[41]. Dès lors qu’elle a pour objet de mettre fin à un différend portant sur l’exécution du contrat, la transaction survenue pendant la durée du contrat est donc admise. On ignore en revanche quels sont les droits dont on peut disposer, la Cour de cassation n’ayant eu que trop rarement l’occasion de se prononcer[42].
Qu’en est-il de la médiation ? Il faut d’abord souligner que le médiateur, du fait de sa neutralité, n’a pas pour mission ou objectif de veiller à la protection des droits du salarié. Un accord de médiation conclu avant la rupture n’apporterait donc aucune garantie particulière quant à la préservation de ces droits. Ceci explique d’ailleurs que la médiation soit parfois présentée comme dangereuse pour les salariés[43]. Faut-il pour autant être plus suspicieux envers l’accord de médiation qu’à l’égard de la transaction[44] ? Rien ne le justifie. Au contraire, la présence d’un médiateur garantit que les parties ne s’engagent pas à la légère. Certes, il n’est pas leur conseil juridique, mais il les aide par sa posture éthique et le cadre dont il est le garant à évaluer pleinement leur situation, dans son entièreté. La protection de leur consentement est donc renforcée – plus encore si l’accord est ensuite constaté par écrit, ce qui devrait être la norme. Il nous semble donc qu’à tout le moins, l’accord de médiation peut porter sur les mêmes droits qu’une transaction.
Par ailleurs, avant comme après la rupture, il n’y pas d’obstacle à ce que le salarié dispose de droits qui n’auraient pas leur origine dans les dispositions protectrices du code du travail ou d’une convention collective. Il peut s’agir en particulier de conditions ou d’avantages particuliers prévus au contrat. Plus généralement, le conflit porté en médiation porte très souvent sur des propos, des comportements, qui ne font pas l’objet de dispositions contractuelles ou légales. Peut-être ne relèvent-ils même pas du droit et il est probable qu’ils ne pourraient pas faire l’objet d’une action en justice, faute d’intérêt sérieux et légitime à agir[45]. La question de leur disponibilité ne se pose pas.
Il en va de même, bien souvent, des conflits entre salariés. Le droit s’en désintéresse largement, aussi longtemps du moins qu’aucune infraction n’est commise. Mais c’est alors le droit pénal du travail qui entre en scène. Quant au droit du travail, « droit du pouvoir »[46], il est tout entier tourné vers la situation de subordination. Un conflit horizontal, opposant deux salariés sans lien de subordination, ne se règlera pas par le recours au code du travail. Partant, l’accord de médiation est peu susceptible de porter atteinte aux droits indisponibles consacrés par ce code.
2.3.- Contrôle du respect de l’ordre public et des droits indisponibles
La question est importante pour le médiateur : doit-il, au cours de la médiation puis lors de l’établissement de l’accord, veiller au respect de l’ordre public et des droits indisponibles ? La loi ne l’y oblige pas expressément. Certains en déduisent que « si l’accord conclu comporte des dispositions illégales ou contraires à l’ordre public, on ne peut le reprocher au médiateur puisqu’il ne participe pas à l’accord final qui est trouvé par les parties elles-mêmes »[47]. Mais cette affirmation ne se justifie que si l’on admet que le médiateur, lorsqu’il accepte de mettre en forme l’accord des parties, n’en devient pas rédacteur d’acte pour autant, avec la responsabilité qui en découle[48]. Or, cela ne paraît pas évident à la lumière de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation[49]. La prudence devrait conduire le médiateur à refuser de prêter concours à la rédaction d’un accord en cas de doute sur le respect des droits indisponibles des parties, d’autant que ceux-ci restent très mal délimités. On a pu écrire que l’ordonnance de 2011 lui faisait même obligation de s’abstenir[50].
Selon le Code national de déontologie des médiateurs, si le médiateur « a un doute sur la faisabilité et/ou l’équité d’un accord, connaissance d’un risque d’une atteinte à l’ordre public… il invite expressément les personnes à prendre conseil auprès du professionnel compétent avant tout engagement ». C’est dire qu’il ne lui appartient pas de déterminer lui-même s’il y a ou non atteinte à l’ordre public. Quelle est la valeur de cette sage recommandation, contenue dans une codification privée ? Peut-être les juges accepteraient-ils, si cette recommandation n’était pas respectée, d’y voir l’indice d’un comportement fautif, comme ils le font volontiers lorsqu’un professionnel n’a pas respecté un code d’éthique ou de déontologie[51].
Article initialement publié dans « La médiation en entreprise, affirmation d’un modèle », ouvrage collectif dirigé par F. et M. Oudin, paru en septembre 2022 aux éditions Médias & Médiations
[1] Je tiens à remercier chaleureusement Bertrand Delcourt pour son aimable et bienveillante relecture.
[2] V. N. Fricero, « Médiation et contrat », AJ contrat 2017, p. 356.
[3] Par exemple, l’article 1732 du Code judiciaire belge énonce que « Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par elles et le médiateur. »
[4] « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
[5] L’écrit n’est toutefois pas dans ce cas une condition de validité du contrat, mais une simple exigence de preuve : Cass. 1ère civ., 18 mars 1986, n° 84-16817, Bull. civ. I, n° 74, p. 71.
[6] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
[7] Le code de procédure civile est assez contraignant pour les médiateurs judiciaires, qui doivent posséder « la qualification requise eu égard à la nature du litige » et « justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (art. 131-5). Il l’est moins à l’égard des médiateurs conventionnels, qui doivent posséder « la qualification requise eu égard à la nature du différend » ou « justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation » (art. 1533).
[8] V. p. ex. art. 7.2 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat.
[9] V. p. ex. Cass. 1ère civ., 7 févr. 1989, °86-18559 ; Cass. 1ère civ., 9 nov. 1999, n° 97-14521 ; Cass. 1ère civ., 12 févr. 2002, n° 99-11106 ; Cass. 1ère civ., 11 juill. 2006, n° 03-18.528.
[10] V. p. ex. Cass. 1ère civ., 12 janv. 1982, n° 80-16456 ; Cass. 1ère civ., 14 janv. 1997, n° 94-16769 ; Cass. 1ère civ., 27 nov. 2008, n° 07-18142.
[11] V. Civ. 1ère, 15 décembre 1998, n° 96-15321.
[12] V. P. Cassuto-Teytaud, « La responsabilité des professions juridiques devant la première chambre civile », in Rapport de la Cour de cassation 2002.
[13] Cass. 1ère civ., 25 nov. 1997, n° 96-12325.
[14] Cass. com., 4 déc. 2012, n° 11-27454.
[15] Civ. 1ère, 14 janvier 1997, précité, arrêt rendu au visa des articles 1991 et 1992 du code civil relatifs aux obligations du mandataire.
[16] Cass. com., 16 nov. 1999, n° 97-14280.
[17] Art. 55.
[18] Cass. 1ère civ., 12 janv. 1982, n° 80-16456.
[19] Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 07-18142.
[20] Code judiciaire, art. 1732 : « Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par elles et le médiateur. »
[21] J. Mirimanoff et alii, Dictionnaire de la médiation et d’autres modes amiables, Bruylant, 2019, p. 44.
[22] « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
[23] « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
[24] Sur le sens aujourd’hui donné à cette disposition, v. E. Loquin, « Arbitrage. Conventions d’arbitrage. Conditions de fond. Litige arbitrable », JCl. Procédure civile, Fasc. 1024.
[25] E. Loquin, op. cit. n° 8 et s.
[26] Op. cit., n° 24.
[27] « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. »
[28] V. J.-F. Cesaro, « Contentieux du travail – Les alternatives aux contentieux », JCP S 2019-164.
[29] V. sur cette délicate question et les hésitations de la Cour de cassation G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, 33ème éd., Dalloz, 2019, p. 151. Pour une lecture très favorable à l’arbitrabilité, v. T. Clay, « L’arbitrage des conflits du travail », Bull. Joly Travail 2019/2, p. 35.
[30] Sur ce contrôle, v. notamment X. Vuitton, « Quelques réflexions sur l’office du juge de l’homologation dans le livre V du code de procédure civile », RTD Civ. 2019 p.771 ; B. Gorchs, « Le contrôle judiciaire des accords de règlement amiable », Revue de l’arbitrage 2008-1, p. 33.
[31] Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. La référence aux droits indisponibles a été introduite par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, transposant la directive européenne du 21 mai 2008.
[32] C. civ., art. 2045.
[33] C. civ., art. 2064.
[34] V. L.-F. Pignarre, Rép. de droit civil, V° Convention d’arbitrage, n° 65.
[35] Sur l’arbitrabilité de ces questions, v. E. Loquin, op. cit., n° 87.
[36] V. p. ex. E Loquin, op. cit., n° 89.
[37] V. p. ex. F. Julienne, J.-Cl. Civil Code, Art. 2044 à 2052, Fasc. 20 : Transaction, n° 57 ; P. Chauvel, Rép. de droit civil, V° Transaction – Domaine de la transaction, n° 173.
[38] Relèvent par exemple de l’ordre public absolu les règles relatives à la compétence de la juridiction prud’homale ou les incriminations pénales. Sur cette notion et sa distinction d’avec l’ordre public social, v. A. Pinson et D. Soukpraseuth, « Retour sur l’ordre public en droit du travail et son application par la Cour de cassation », BICC n° 740, avr. 2011, p. 6.
[39] V. F. Guiomard, « Que faire de la médiation conventionnelle et de la procédure participative en droit du travail ? », Revue du travail 2015, p. 628.
[40] E. Loquin, op. cit., n° 89 et n° 106 s. ; L.-F. Pignarre, op. cit., n° 68.
[41] V. Cass. soc., 10 mars 1998, n° 95-43094 ; Cass. Soc., 16 oct. 2019, n° 18-18287.
[42] V. toutefois Cass. soc., 10 mars 1998, précité : « la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement décidé que la transaction n’emportait pas renonciation aux dispositions d’un accord collectif et, que, partant, elle avait été valablement conclue » ; l’arrêt précité du 16 octobre 2019 ne traite pour sa part que de la portée d’une transaction relative à l’exécution du contrat de travail.
[43] V. G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, op. cit., n°103 et références citées en note 3 p. 129.
[44] Cette question n’a de sens que pour les accords de médiation auxquels les parties n’ont pas voulu conférer la valeur d’une transaction.
[45] Soit que la prétention soit jugée dérisoire, soit qu’elle apparaisse insuffisamment juridique. Sur les prétentions indignes d’un examen au fond, v. N. Cayrol, Rép. de procédure civile, V° Action en justice – Intérêt sérieux et légitime, n° 241 s.
[46] G. Auzero, D. Baugard et E. Dockès, Droit du travail, op. cit., n° 3.
[47] B. Gorchs, « La responsabilité civile du médiateur civil », Droit et procédures, 2014, p. 194.
[48] Id.
[49] Supra, 1.1.
[50] N. Nevejans, « L’ordonnance du 16 novembre 2011 – Un encouragement au développement de la médiation ? », JCP G 2012.148.
[51] V. L. Maurin, « Le droit souple de la responsabilité civile », RTD civ. 2015, p. 517.