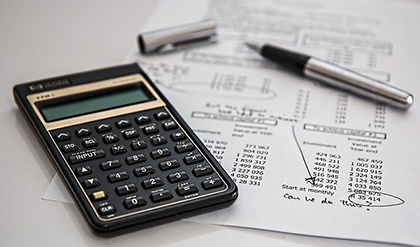Maître VACCARO
Avocat spécialisé en droit du travail
L’employeur, s’il s’oppose à la rupture conventionnelle qui lui est demandée par un salarié qui souhaite quitter de son propre gré son emploi mais souhaite bénéficier des indemnités de Pôle Emploi, parce qu’il n’a aucun motif d’accepter une rupture conventionnelle n’étant en aucun cas demandeur au départ du salarié, s’expose en cas de refus à une stratégie qui se développe considérablement : l’abandon de poste pour forcer l’employeur à rompre le contrat.
La question se pose de savoir comment gérer cette situation qui laisse souvent l’employeur désarmé face à une situation qu’il vit comme l’inversement ultime du lien de subordination (phénomène contemporain considérable en matière de droit du travail quel que soit le sujet), et laisse l’entreprise souffrir différents préjudices dans le cadre d’une désorganisation manifeste, et de l’impossibilité d’organiser le départ du salarié dans le cadre d’un préavis notamment.
I – Il est légitime pour l’une des parties de refuser la rupture conventionnelle :
Il peut paraître curieux de rappeler qu’il est légitime de refuser une rupture conventionnelle pour l’une ou l’autre des parties et dans le cas de figure qui nous intéresse pour l’employeur, contrairement à ce que certains pourraient penser.
En effet, la rupture conventionnelle est un contrat et l’une des conditions essentielles de validité de ce dernier est la liberté du consentement, aucune partie ne devant être forcée à accepter.
Un vice du consentement notamment au titre d’une pression qui pourrait s’assimiler à une violence est susceptible d’ailleurs de permettre dans le délai de recours de la loi (un an à compter de l’homologation) de solliciter du Juge la nullité de la rupture conventionnelle.
Il est donc possible et légitime de refuser la rupture conventionnelle demandée par le salarié, si telle est la volonté de l’employeur dans ce cas de figure.
La Cour de Cassation a d’ailleurs admis qu’un salarié qui exerce des pressions pour obtenir la rupture de son contrat de travail de la part de son employeur commet une faute grave (cas. Soc. 19 mars 2014 – n°12-28.822).
Reste à savoir si dans les faits, la position de principe de l’employeur de refus ne va pas l’entraîner dans des conséquences plus préjudiciables encore que la rupture financée (indemnité de rupture conventionnelle obligatoire), lorsque le salarié ne démissionnera pas contrairement à la logique de la situation (refus de rupture conventionnelle à la demande du salarié qui veut quitter son emploi, laquelle devrait provoquer alors la démission du salarié).
En effet, dans la mesure où le salarié recherche à la fois la liberté de quitter son emploi mais également les indemnités Pôle Emploi, des stratégies pour forcer la main de l’employeur dans le sens d’une rupture sont susceptibles d’intervenir et deviennent de plus en plus fréquentes dans cette hypothèse.
II – L’abandon de poste : comment forcer son employeur à licencier :
La méthode la plus couramment utilisée en pratique consiste pour le salarié à abandonner son poste pour forcer l’employeur à constater cet abandon et à licencier certes pour faute grave, mais avec le bénéfice de Pôle Emploi ensuite.
Dans cette hypothèse, l’employeur est censé mettre en demeure le salarié de reprendre son emploi ou de justifier d’un motif légitime d’absence et à défaut d’obtempérer, le salarié est en principe l’objet d’une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement qui donnera lieu à la notification d’un licenciement pour faute grave, le préavis par définition même ne pouvant pas être exécuté compte tenu de l’absence du salarié.
III – Comment lutter pour l’employeur contre une telle stratégie ?
Il est en premier lieu envisageable de maintenir le salarié en absence injustifiée sans rémunération même si cette situation est difficilement tenable à terme.
En effet, c’est sur le fondement du principe de l’exception d’inexécution (« non adimpleti contractus » pour les initiés en droit des contrats) que l’une des parties peut retenir son engagement (paiement du salaire) à compter du moment où l’autre n’accompli pas le sien (le travail).
Le problème est qu’il reste interdit de se faire justice à soi-même et que si la situation reste bloquée, le recours au Juge est nécessaire pour trancher les conséquences de la situation.
En droit du travail qui constitue un droit spécial des contrats, une telle position de l’employeur peut assez rapidement dégénérer en abus de droit au sens de l’article L.1222-1 du Code du Travail qui précise « Le contrat de travail s’exécute de bonne foi ».
Rapidement donc l’employeur devra saisir le Juge, les solutions sans jurisprudence à l’heure actuelle étant très incertaines, l’employeur n’ayant en principe pas la possibilité de demander la résiliation judiciaire du contrat aux torts du salarié, puisqu’il détient le pouvoir de licencier.
Une autre solution consiste à dénoncer le procédé dans le cadre de la lettre de mise en demeure adressée au salarié d’avoir à reprendre son travail ou de justifier son absence en invoquant d’ores et déjà les préjudices causés à l’entreprise : brusque désorganisation, exécution déloyale du contrat de travail par le salarié, préjudices économiques divers.
Par la suite, en cas de maintien de sa position par le salarié et d’absence de démission qui emporterait alors l’exécution d’un préavis, l’employeur peut envisager la rupture pour faute lourde du contrat de travail et non plus simplement pour faute grave, car le comportement du salarié s’assimile à l’intention de nuire, cette position étant éclairée par le contenu de la mise en demeure évoquée ci-avant.
Dans cette hypothèse et après convocation, le licenciement notifié pour faute lourde pourrait s’accompagner d’une demande d’indemnisation de la part de l’employeur à l’égard du salarié tant au titre de l’absence d’un préavis pourtant dû en cas de démission qui constituerait la véritable situation juridique (cette indemnisation pourrait être du montant du salaire qu’aurait touché le salarié durant cette période), qu’au titre des préjudices économiques et moraux subis par l’employeur (abandon d’une mission en cours et difficulté avec le client etc…).
Il est rappelé que la seule hypothèse où l’employeur est habilité à demander des indemnités au salarié est précisément celle de la faute lourde.
Dans cette hypothèse, l’employeur pourrait avec une chance très raisonnable de succès envisager de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.