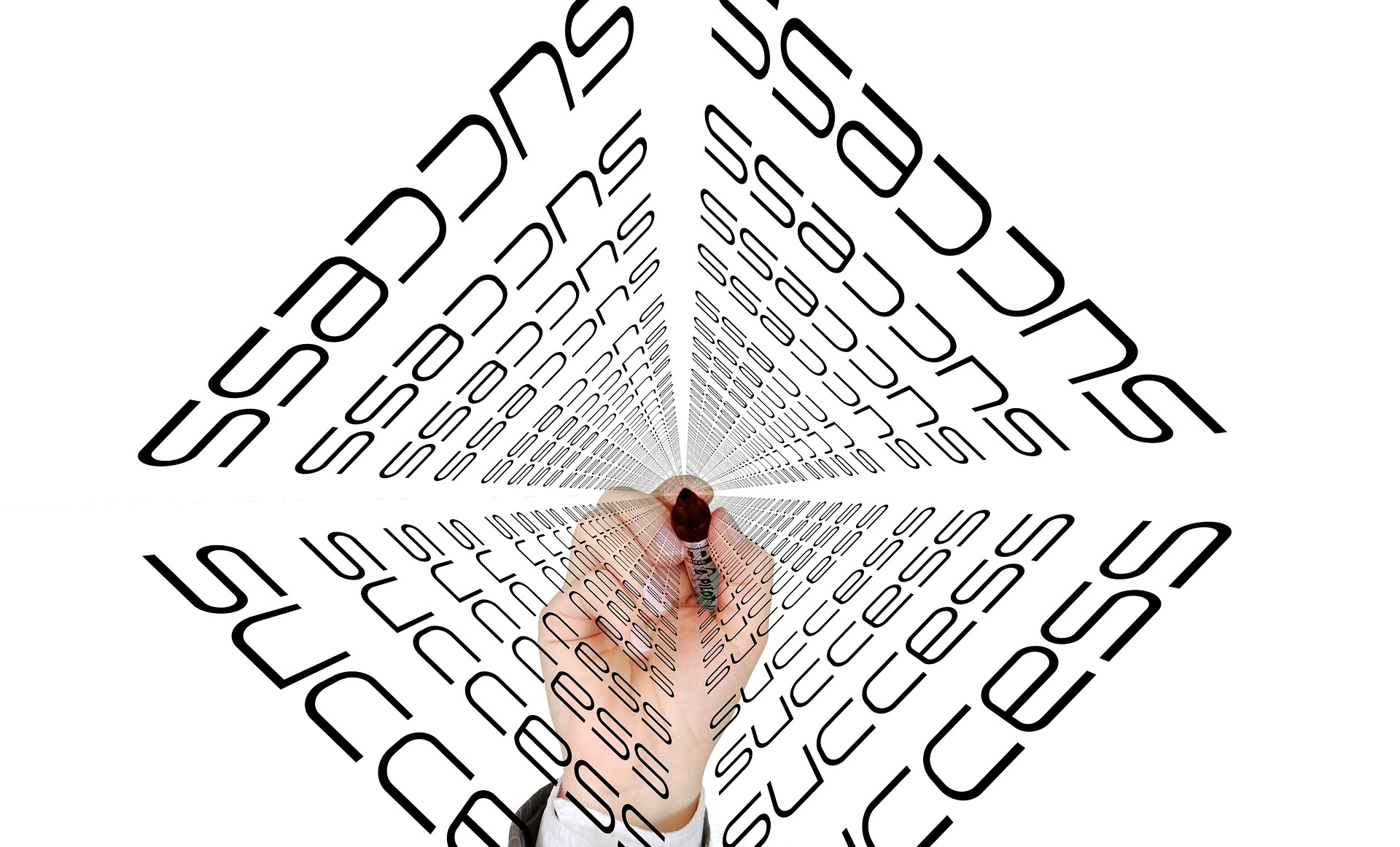par Federica Rongeat-Oudin (Directrice du DU médiation – Université de Tours) et Martin Oudin (Maître de conférences Hdr – Université de Tours)
Une médiation intra entreprise, dite aussi médiation en entreprise, est une médiation qui intervient au service d’une relation de travail fragilisée. Le médiateur en entreprise est sollicité pour aider des salariés qui, confrontés à des difficultés relationnelles qui se mêlent souvent à des difficultés liées à l’organisation du travail, voient leur motivation entamée et parfois même leur santé mentale et physique atteinte. Leur relation de travail est ainsi mise à mal par des malentendus, des incompréhensions, des difficultés de communication qui peuvent nourrir un sentiment de stress, susciter un comportement d’évitement ou provoquer un conflit ouvert. L’ambition de la médiation en entreprise est précisément la restauration et l’amélioration de la qualité de cette relation de travail.
Dans ce contexte, les entreprises qui ont recours à la médiation la choisissent rarement comme une alternative à une procédure judiciaire. Elles recherchent plus souvent une voie pour aider des salariés à renouer un dialogue rompu. En effet, si le médiateur en entreprise est parfois appelé à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, la plupart de ses interventions se déroulent en amont, lorsque l’enjeu est de sauver et de poursuivre la relation de travail dans un climat de confiance et de coopération.
Par ailleurs, les relations de travail à propos desquelles le médiateur en entreprise est sollicité sont le plus souvent les relations dites individuelles. La médiation en entreprise va réunir une équipe, un service, deux ou plusieurs collaborateurs, avec ou sans lien hiérarchique. Nous n’envisagerons donc pas dans ces quelques lignes la médiation dans les relations collectives de travail, d’autant plus que le médiateur qui intervient dans ce cadre a un rôle qui le distingue beaucoup des autres médiateurs[1].
Depuis quelques années, la médiation en entreprise s’est imposée peu à peu dans le panorama des interventions sollicitées par les entreprises. Elle est aujourd’hui reconnue comme un outil original de gestion des relations de travail.
Pour dresser son portrait, nous avons choisi deux angles de vue selon qu’on observe la médiation en entreprise au regard des autres types de médiations ou au regard de l’entreprise. Aussi, le premier angle présentera les traits du médiateur en entreprise, tantôt singuliers, tantôt communs aux autres médiateurs. Le second, propre à l’entreprise, dessinera la médiation en entreprise dans le contexte de la protection de la santé au travail.
I – Le médiateur en entreprise : singularités et points communs avec les autres médiateurs
Comme tout médiateur, la posture du médiateur en entreprise et le cadre d’intervention qu’il propose sont des garanties indispensables pour susciter la confiance des personnes reçues. Ce n’est que dans un climat de confiance – si ce n’est dans l’autre personne, du moins dans le médiateur et le processus – que les personnes pourront parvenir à coopérer en vue de surmonter leurs difficultés.
Les règles de droit qui définissent sa posture et régissent son intervention sont donc les mêmes que celles qui régissent les autres médiateurs dits de droit commun. Il existe bien un texte singulier dans le code du travail consacré à la médiation dans le cas de harcèlement moral (art. L. 1152-6 C. trav., v. infra) mais les modalités qu’il propose sont facultatives, si bien que le médiateur en entreprise reste avant tout au regard de la loi un médiateur de droit commun.
Cependant, lorsque l’on observe dans le détail la mise en œuvre de ces règles, on constate quelques singularités qu’il conviendra de souligner.
A – La posture du médiateur en entreprise
Indépendance – Le médiateur en entreprise, comme tout médiateur, mène sa mission de façon indépendante, sans recevoir d’instructions de la part de la direction de l’entreprise ou de quiconque. Une fois menée, il ne rend pas non plus compte du contenu précis de celle-ci, à moins que les parties ne lui aient demandé de le faire (V. infra sur la confidentialité).
L’indépendance n’est cependant pas inscrite dans le code de procédure civile pour ce médiateur (elle ne l’est que pour le médiateur judiciaire). La source de cette règle réside dans le code national de déontologie des médiateurs de 2009 auquel le médiateur peut choisir d’adhérer.
L’indépendance concerne aussi bien le médiateur en entreprise qui exerce son activité à titre libéral que le médiateur salarié de l’entreprise qui lui confie cette mission. En pratique, le médiateur en entreprise est sollicité et choisi par la direction de l’entreprise. Le médiateur contractualise alors son intervention avec la direction en prévoyant le respect par celle-ci de son indépendance ainsi que du cadre d’intervention propre à la médiation (et notamment les principes de liberté et de confidentialité vus infra). Cette contractualisation se fera pour le médiateur salarié au moment de la définition de sa mission et, pour le médiateur en exercice libéral, à l’occasion de la signature du contrat de prestation de services. Ce contrat qui lie le médiateur à la direction prescriptrice ne doit pas être confondu avec l’engagement à la médiation (dit aussi protocole d’entrée en médiation) que prennent les personnes qui acceptent de participer à une médiation. Ainsi, là où dans d’autres contextes, un seul acte regroupe les engagements du médiateur, ses conditions d’intervention et l’engagement des parties à la médiation, ici il faut prévoir deux actes : le contrat de prestation de services entre le médiateur et le prescripteur et l’engagement à la médiation des participants.
Impartialité – Le médiateur est impartial en ce sens qu’il agit sans prévention ni préférence pour l’une ou l’autre partie (Code de procédure civile, art. 1530). Cette impartialité est intimement dépendante de l’indépendance de médiateur. En effet, ce principe d’indépendance que le médiateur en entreprise annonce aux personnes impliquées dans le conflit mais aussi aux différentes parties prenantes (délégués du personnel, agent de prévention, DRH, hiérarchie non directement impliquée), est indispensable pour convaincre ces mêmes personnes de son impartialité. Cela est d’autant plus vrai lorsque la médiation réunit deux salariés unis par un lien hiérarchique.
Neutralité – Le médiateur est aussi tenu à la neutralité et s’abstient de donner son opinion ou de faire des propositions sur la façon de surmonter un différend (Code national de déontologie du médiateur). Cette neutralité est la condition de la responsabilisation des participants qui trouveront par eux-mêmes leur solution sans attendre du tiers qu’il la leur donne. En cela, la neutralité est indissociable de l’impartialité, laquelle pourrait être mise à mal si le médiateur devait faire une proposition pouvant être perçue comme plus favorable à l’un qu’à l’autre. On notera cependant l’originalité de la « procédure de médiation » proposée en cas de harcèlement moral par l’art. 1152-6 du Code du travail. Il est prévu que le médiateur qui ne parviendrait pas à concilier les parties peut soumettre des propositions en vue de mettre fin au harcèlement. Ce texte laisse les praticiens perplexes car il laisse entendre que le médiateur a pour mission de vérifier la réalité harcèlement, ce qui le place dans un rôle d’enquêteur incompatible avec l’esprit de la médiation.
B – Les principes d’intervention du médiateur en entreprise
Liberté – Comme dans toute médiation, le principe de liberté s’applique de manière différenciée pour le médiateur et pour les parties. Il signifie pour ces dernières qu’elles sont à la fois libres d’entrer dans la démarche et libres de la quitter à tout moment, sans avoir à se justifier (Code national de déontologie précité). Cette liberté reste présente alors même que la médiation a été voulue et est financée par la direction de l’entreprise. Dans le contrat conclu avec le médiateur, la direction s’engage à respecter ce principe de liberté et s’interdit de faire pression sur les salariés. Il faut cependant bien admettre que le seul fait que l’intervention d’un médiateur soit proposée par la direction est de nature à faire pression sur les salariés impliqués. Enfin, les salariés sont aussi libres dans la recherche de leurs solutions, dans la mesure bien entendu où ces solutions n’impliquent pas le pouvoir organisationnel. Le périmètre de leur négociation a pour limite leur pouvoir de décision. Comme bien souvent les solutions impliquent en partie la direction, celle-ci est associée à ce stade de la médiation. Il arrive aussi que les parties aboutissent non pas à des décisions mais à des propositions de solutions qu’elles décident de porter ensemble à la direction.
La liberté est un principe qui concerne aussi la personne du médiateur en entreprise (v. code national de déontologie). Celui-ci peut à tout moment cesser sa mission, et même d’ailleurs refuser de l’engager par exemple à la suite de la rencontre d’information avec qualiles participants. Il le fera lorsqu’il craint que la médiation ne fragilise davantage un participant. Il pourrait aussi décider d’y mettre fin s’il constatait que le processus de médiation était instrumentalisé par une des parties. Cependant, il n’a pas à préciser les raisons à la direction, sous peine de contrevenir à son engagement de confidentialité.
Confidentialité – La confidentialité lie bien évidemment le médiateur en entreprise. La confidentialité porte sur le contenu des échanges et signifie que le médiateur ne rend pas compte de ce que les parties ont échangé même s’il est sollicité par la direction ou par les délégués du personnel. Le contenu de l’accord issu de la médiation n’est cependant pas couvert par la confidentialité si sa divulgation est nécessaire pour sa mise en œuvre (art. 21-3 L. n° 95-125 du 8 févr. 95). En pratique, la direction est informée de cet accord – ou des propositions convenues entre les parties – par les salariés eux-mêmes. Parfois même, la direction a déjà été associée au stade de la recherche des solutions parce qu’elles impliquaient le pouvoir organisationnel.
La confidentialité est aussi un engagement que chaque partie prend à l’égard de l’autre lorsqu’elles adhèrent au processus de médiation. Elles s’interdisent de dévoiler le contenu de leurs échanges à d’autres. Cette confidentialité s’entend aussi comme une obligation de loyauté par laquelle les parties s’engagent à ne pas se servir des échanges contre l’autre, par exemple lors d’une évaluation ou d’une procédure contentieuse. En pratique, conscient que les parties seront interrogées par leurs collègues, le médiateur les invite à chaque fin de séance à préciser ensemble de ce qu’elles décident de garder confidentiel et de ce qu’elles peuvent partager avec leurs collègues.
Responsabilisation – La responsabilisation des parties est enfin un principe fondamental de la médiation (elle découle implicitement de l’art. 1530 CPC qui précise que ce sont les parties qui recherchent un accord). Elle implique pour chaque partie d’accepter la possibilité de reconnaître sa part de responsabilité dans la relation conflictuelle. Elle implique pour le médiateur de résister aux tentatives des parties, conscientes ou inconscientes, d’en faire un tiers qui leur donnerait raison en cherchant à le convaincre, en lui demandant son opinion, en lui soumettant des pièces pour qu’il les instruise, etc. Le principe de responsabilisation pousse ces dernières à trouver elles-mêmes l’issue à leurs différends et constitue le gage d’une exécution spontanée de leur accord.
Après avoir rendu compte de la médiation en entreprise et de ses singularités par rapport à d’autres médiations, il reste à préciser, du point de vue des entreprises, comment elle s’inscrit dans la politique de prévention des atteintes portées à la santé des salariés.
II – La médiation en entreprise dans le contexte de la santé au travail
La médiation est pour une entreprise un outil précieux pour prévenir certains risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail. Du point de vue de l’employeur, elle est une mesure de prévention qui lui permet de satisfaire à son obligation de protéger la santé mentale et physique de ses salariés[2].
A – La médiation en entreprise, un outil pour prévenir les risques psychosociaux et améliorer la qualité des relations de travail
Médiation et risques psychosociaux – Les travailleurs sont parfois exposés à des risques liés à leur environnement de travail qui, lorsqu’ils se réalisent, les affectent psychiquement et parfois aussi physiquement. Ils sont définis comme les « risques pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. »[3]
Les relations de travail sont au cœur de cette problématique. Des relations de travail tendues peuvent affecter de façon considérable des salariés. Lorsqu’ils n’y trouvent plus de soutien, de solidarité, de confiance et de respect, mais au contraire de la compétition, du contrôle excessif, de la méfiance, ils résistent difficilement aux contraintes et aux changements dans l’organisation du travail et développent du stress et/ou un profond mal-être.
Ces relations de travail tendues, conflictuelles, peuvent trouver leur source dans des facteurs de risques liés à l’organisation du travail. Par exemple, dans une situation de travail où le facteur de risque réside dans ce que l’on appelle les exigences du travail, comme une activité au rythme très soutenu, ce facteur va conduire les salariés à être tendus, inquiets, ce qui pourra avoir pour conséquence de créer des conflits dans une équipe et, au sein de cette équipe, certains développeront des TMS directement liés à cette situation.
On reconnait aujourd’hui que les relations entre collègues ont un impact sur la santé psychosociale des collaborateurs[4]. Lorsque la coopération n’est plus possible dans une équipe, lorsqu’une personne n’est pas intégrée dans un collectif, lorsque les collaborateurs disent souffrir d’un management trop contrôlant, chacune de ces situations est potentiellement source de stress et de mal-être pour les personnes concernées[5].
Allant plus loin, des relations conflictuelles vont avoir à leur tour un impact sur l’organisation du travail. Illustrons ce phénomène fréquent par l’exemple suivant : à la suite d’une fusion, un service est réorganisé. Cette réorganisation a nourri un conflit entre deux personnes contraintes désormais de partager les mêmes tâches. Ce conflit qui ne concernait directement que ces deux personnes a fini par créer deux clans dans l’équipe. Cette situation de nature relationnelle conduit les personnes à adopter de nouveaux comportements : les réunions hebdomadaires deviennent mensuelles, certains dossiers ne sont plus contrôlés par telle personne, etc. On voit ici comment des difficultés relationnelles modifient l’organisation du travail au sein d’une équipe qui s’adapte inconsciemment en suivant de nouvelles règles d’organisation.
C’est pourquoi, conscientes que les relations de travail sont souvent au cœur des situations qui mettent en jeu la santé psychosociale des salariés, les entreprises choisissent de recourir à la médiation. Elles offrent ainsi aux salariés la possibilité d’exprimer leurs difficultés et de discuter des voies de solution possibles, sachant que la discussion portera à la fois sur les difficultés relationnelles mais aussi de leur impact sur l’organisation du travail.
Médiation et qualité de vie au travail – Ces dernières années est apparue la notion de « qualité de vie au travail », laquelle traduit une approche plus positive que celle de la prévention des risques psychosociaux. Cette notion est associée à l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 « vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle »[6]. Elle marque l’engagement des entreprises de tenir compte de l’impact de l’environnement de travail sur le développement personnel et professionnel du salarié. Cet engagement va au-delà de la seule lutte contre les atteintes à la santé et implique de considérer les différentes composantes de la qualité de vie au travail que sont les relations de travail, l’information ou bien encore les relations sociales.
Si l’on s’en tient aux relations de travail, une multitude d’actions peuvent être imaginées pour contribuer à améliorer leur qualité[7]. L’ANI préconise certaines d’entre elles, parmi lesquelles la mise en place d’espaces de discussion pour favoriser l’expression des salariés sur leur travail (article 12). Ces espaces de discussion s’entendent comme des : « (…) espaces collectifs qui permettent une discussion centrée sur l’expérience de travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les ressources, les contraintes. (…)»[8]. Donner un temps et un lieu pour que les salariés puissent s’exprimer sur leur travail est une initiative salutaire. Mais un des dangers qui guette un tel espace de discussion est le découragement voire l’épuisement de leurs participants qui peuvent avoir le sentiment que les discussions tournent en rond et ne produisent rien.
Pour se prémunir de ce risque d’épuisement, les modalités de ces réunions doivent être soigneusement pensées. En particulier, ces discussions doivent être menées dans un cadre très précis tenu par un tiers facilitateur. Ce facilitateur, « chargé d’animer le groupe et d’en restituer l’expression » à la hiérarchie est spécialement visé dans l’ANI à l’article 12. Un médiateur, formé à tenir un cadre strict pour encadrer des discussions à l’occasion de relations conflictuelles, est à même de mener une telle mission. Il sait non seulement animer un groupe en réunissant les conditions pour libérer et canaliser la parole, mais il sait aussi accompagner les participants dans une co-construction de propositions ou de solutions.
L’espace de discussion peut ainsi avoir pour objet de discussion non seulement le travail et ses conditions d’exercice mais aussi les relations de travail elles-mêmes[9]. Dans ce cas, l’objectif sera de déployer des initiatives pour les enrichir afin qu’elles deviennent une ressource sur laquelle les salariés pourront s’appuyer pour faire face plus sereinement aux événements et bouleversements organisationnels.
On le constate, la médiation est aujourd’hui un outil incontournable, qu’il s’agisse de l’inscrire dans une démarche de prévention des risques psychosociaux ou bien d’amélioration de la qualité de vie au travail. Elle peut aider des salariés à retrouver du sens à leur travail et à leur collaboration. L’employeur quant à lui, outre l’avantage de retrouver des salariés motivés et performants, se plie à son obligation de protéger la santé de ses salariés.obligation
B – La médiation en entreprise, un moyen pour l’employeur d’accomplir son obligation de sécurité
En effet, du point de vue de l’employeur, la médiation est une des mesures de prévention qu’il peut prendre pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cependant, l’art. L. 4121-1 du Code du travail qui consacre cette obligation de sécurité ne détaille pas les mesures à prendre pour réaliser cette protection. L’art. L. 4121-1 du Code du travail vise de façon générale des « actions de prévention des risques professionnels», des « actions d’information et de formation » et des actions portant sur l’organisation du travail. Les principes de prévention énoncés à l’article suivant mettent l’accent sur les mesures collectives et sur celles qui relèvent de la prévention dite primaire, c’est-à-dire celle visant à l’élimination du risque psychosocial.
La médiation n’est citée que dans le cas spécifique du traitement d’une situation de harcèlement moral (L. 1152-6 du Code du travail et Accord National Interprofessionnel du 26 mars 2010 qui vise aussi la violence).
Mais en dehors de ces derniers textes spéciaux, on ne trouve pas de référence expresse à la médiation en tant que mesure de prévention.
Parce que les mesures individuelles ne sont pas jugées prioritaires, ainsi que les mesures dites de prévention secondaire (où le risque est présent) ou tertiaire (où le dommage est apparu ; on parle aussi de mesures curatives), on peut légitimement se demander si la médiation relève bien des mesures dites de prévention.
Médiation, mesure à la fois individuelle et collective – A y regarder de plus près cependant, la médiation est une mesure individuelle qui a un effet sur le collectif. Une difficulté vécue entre deux ou plusieurs salariés touche, par un effet systémique, l’entourage professionnel (et personnel aussi) que sont les autres collègues, la hiérarchie si elle n’est pas déjà directement impliquée, les autres services, les clients, les fournisseurs, etc. En agissant pour dépasser cette difficulté et amener les parties à trouver un mode de fonctionnement leur permettant de continuer à travailler ensemble ou au contraire à se séparer sereinement, la médiation agit indirectement sur l’ensemble des personnes impactées par le malaise que créait cette tension.
Médiation, mesure curative ou véritablement préventive – Il est aussi vrai que la médiation apparaît de prime abord comme une mesure curative plus que préventive. Dans la pratique pourtant, elle n’est pas cantonnée à une situation où le risque psychosocial est apparu. Elle est aussi déployée au titre de la prévention dite primaire, par exemple pour anticiper la fusion de deux services en donnant la possibilité aux salariés d’exprimer et partager leurs craintes et d’anticiper ce changement en concevant des solutions d’adaptation. On retrouve aussi la médiation au niveau de la prévention dite secondaire, pour réduire le risque présent, dans des actions de sensibilisation et de formation de managers et agents à la gestion des conflits en adoptant les outils du médiateur.
Médiation dans la jurisprudence récente – Si l’on examine maintenant la jurisprudence récente rendue sur le fondement de l’art. 4121-1 du Code du travail, on observe un changement majeur de perspective. Désormais, l’employeur peut, s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires, être exonéré de sa responsabilité. Ainsi, l’obligation de sécurité qui pèse sur lui n’a pas plus pour seul but « de faciliter la réparation du dommage subi par le salarié, mais d’assurer l’effectivité du principe de prévention »[10]. Ce principe de prévention retrouve ainsi son sens premier en incitant l’employeur à non seulement réagir immédiatement dès qu’il a connaissance de troubles, mais avant tout à prendre des mesures véritablement préventives. La Cour de cassation a consacré cette lecture dans un arrêt du 1er juin 2016[11]. Elle énonce que « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; ».
Mais si l’employeur est désormais admis à s’exonérer de sa responsabilité, les conditions sont néanmoins très sévères : il ne peut pas attendre passivement la production du dommage pour agir, il doit anticiper et, lorsque le pire n’a pu être évité, réagir immédiatement[12]. Dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de juin 2016, une procédure d’alerte en cas de harcèlement avait été prévue et une médiation avait eu lieu. Mais la Cour souligne qu’il aurait fallu en amont avoir également réalisé des actions d’information et de formation « propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral. » La Cour distingue clairement les mesures de prévention (information, formation) des mesures pour faire cesser les faits de harcèlement (alerte, enquête, médiation).
Cet assouplissement de l’obligation de sécurité a surpris, d’autant plus que l’arrêt a été rendu dans une situation de harcèlement où la sévérité était de mise. En effet, même si une telle évolution avait été amorcée dans l’arrêt Air France du 25 nov. 2015[13], on doutait de sa portée dans une telle situation. L’assouplissement est cependant confirmé dans le rapport publié par la Cour de cassation : « la solution adoptée le 25 novembre 2015 est étendue à la situation de harcèlement moral en ce sens que l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement moral, quand un tel harcèlement s’est produit dans l’entreprise, mais pas à n’importe quelles conditions. »[14]
Certains commentateurs voient dans cette décision la consécration d’une obligation de résultat désormais atténuée, d’autres d’une obligation de moyens renforcée[15]. D’autres encore relèvent au contraire l’abandon de cette distinction entre obligation de moyens et de résultat[16]. Ramenée à la médiation, cette évolution jurisprudentielle nous confirme que la médiation est une mesure parmi d’autres qui enrichit l’éventail des mesures propres à protéger la santé des salariés[17]
. Elle n’est cependant bien évidemment pas suffisante à elle seule. On a vu que cet éventail devait être déployé dès le stade de l’anticipation des risques et ne devait pas se cantonner à des mesures curatives. A ce sujet, on rappellera que la médiation, si elle a été menée dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt du 1er juin 2016 à titre curatif, peut aussi constituer une mesure véritablement préventive si elle intervient avant ou au moment de la naissance d’un conflit relationnel, c’est-à-dire au titre de la prévention primaire et secondaire. Il faut bien reconnaître que la médiation se présente alors ici davantage comme un outil de gestion que comme un mode alternatif de résolution des conflits. Mais c’est précisément dans cette optique que les entreprises y ont aujourd’hui de plus en plus souvent recours.
Article initialement publié in La lettre des médiations, n° 5, mai 2018.
[1] Il rédige une recommandation pour mettre fin au litige et un rapport sur le différend, art. L. 2523-5 et s. Code du travail.
[2] Sur l’ensemble de la question, OUDIN F., ROULET V. et OUDIN M., (dir.), L’essor de la médiation en entreprise, Médias & Médiations, 2014, 117p ; BRET J.M, La médiation : un mode innovant de gestion des risques psychosociaux, Médias & Médiations, 2016.
[3] Rapport dit Gollac sur le suivi statistique des risques psychosociaux, 2011, p. 31.
[4] Rapport dit Gollac précité.
[5] V. aussi le rapport de 2014 EUROFOUND qui vise les relations interpersonnelles, horizontales et verticales, p. 27, à télécharger sur http://www.eurofound.europa.eu.
[6] Un arrêté d’extension du 15 avril 2014 rend obligatoires, pour les employeurs et les salariés compris dans le champ d’application de l’Accord, ses dispositions. Sur cet accord, LANOUZIERE, H (2013), Un coup pour rien ou un tournant décisif ?, Sem. Soc. Lamy, 16 sept. 2013, n° 1597.
[7] Sur cette question v. BECARD A.C., OUDIN F. et OUDIN M. (2015), La qualité des relations de travail, IRES, 165p.
[8] JOURNAUD S., Discuter du travail pour mieux le transformer, Revue Travail & Changement n° 358, janv. févr. mars 2015, p. 2.
[9] La qualité des relations de travail, op. cit. p. 52.
[10] En ce sens, FANTONI-QUITON S., VERKINDT P-Y., Obligation de résultat en matière de santé au travail, à l’impossible, l’employeur est tenu?, rev. Droit social 2013.229.
[11] N° 14-19.702, FS P+B+R+I, MOULY J., L’assouplissement de l’obligation de sécurité en matière de harcèlement moral, JCP G 2016, note 822 ; RADE Ch., Feue la responsabilité de plein droit de l’employeur en matière de harcèlement : le mieux, ennemi du bien, Lexbase Hebdo, éd. soc. 16 juin 2016 n° 656 ; Loiseau G., Le renouveau de l’obligation de sécurité, sem. Jur. Social, n° 24, 21 juin 2016, 1220 ; CORRIGNA-CARSIN D., JCP G 2016, act. 683, p. 1180.
[12] V. déjà Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-69.444 et n° 09-70.902, Lexbase Hebdo éd. soc. n° 448, 14 juill. 2011, RADE Ch., Harcèlement dans l’entreprise : l’employeur doit réagir vite !.
[13] Cass. soc. n° 14-24.444 ; ANTONMATTEI P-H., Obligation de sécurité de résultat : virage jurisprudentiel sur l’aile !, Dr. Soc. 2016.457 ; ICARD J., L’incidence de la jurisprudence Air France dans le contentieux du harcèlement moral. Essai de prospective, Cah. Soc. 2016.214.
[14] https://www.courdecassation.fr/IMG///Commentaire_arret1068_version201605.pdf.
[15] Op. cit. MOULY J.
[16] En ce sens, LOISEAU G., op. cit.
[17] V. déjà Cass. soc. 3 déc. 2014, n° 13-18.743. Dans cet arrêt, la médiation est expressément citée parmi les mesures prises : « N’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat l’employeur qui justifie avoir tout mis en oeuvre pour que le conflit personnel entre deux salariées puisse se résoudre au mieux des intérêts de l’intéressée, en adoptant des mesures telles que la saisine du médecin du travail et du CHSCT et en prenant la décision, au cours d’une réunion de ce comité, de confier une médiation à un organisme extérieur. »