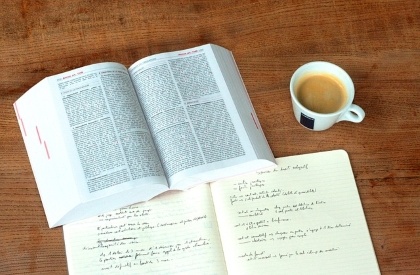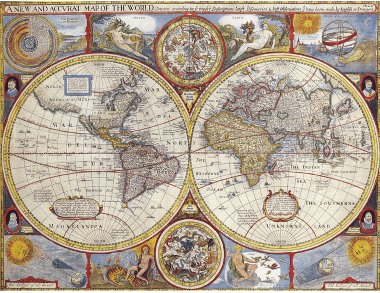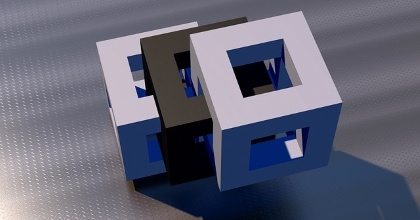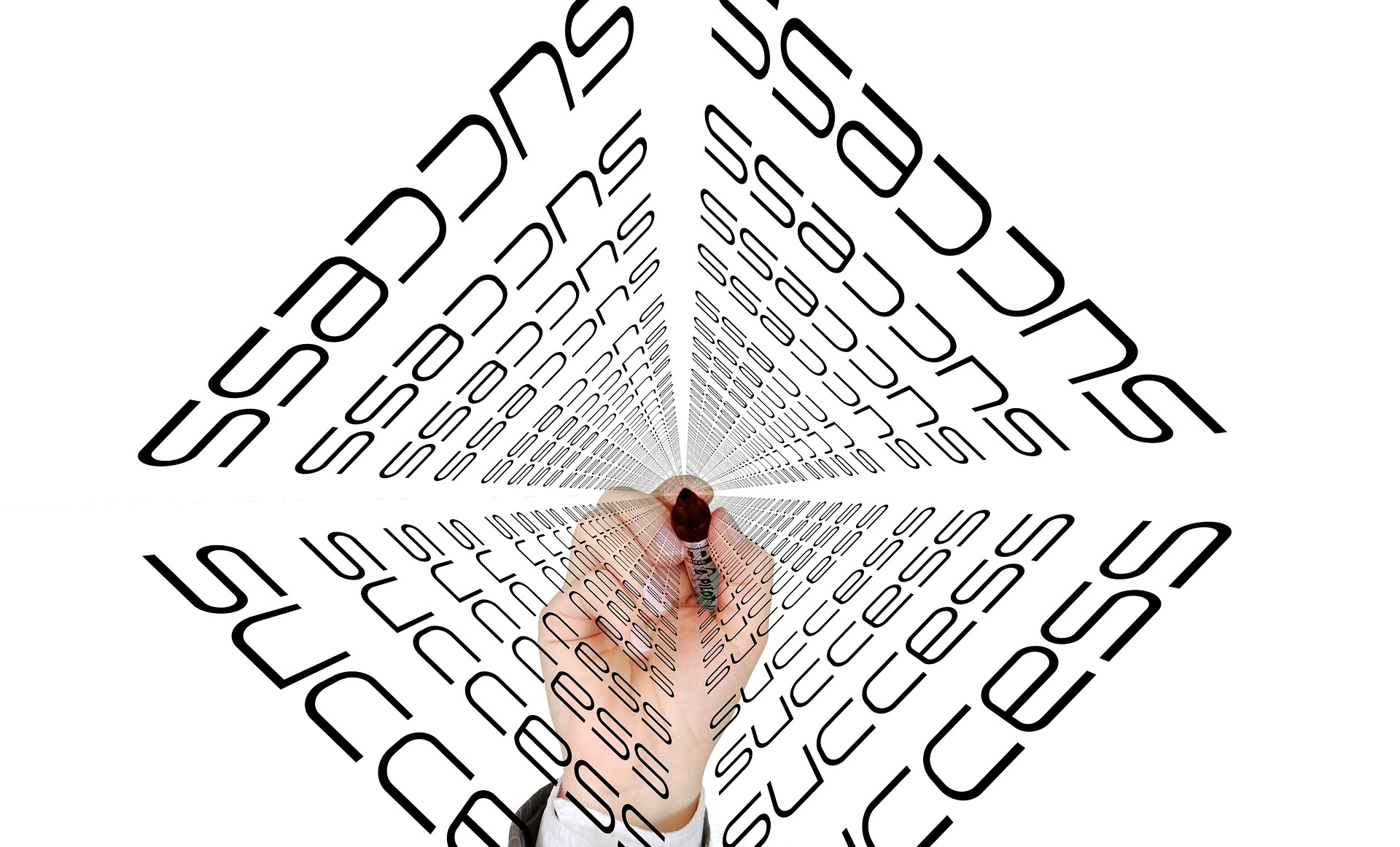S’intéresser à l’objet de la preuve suppose de déterminer ce que la partie à un procès doit prouver pour garantir le succès de ses prétentions.
De façon assez surprenante, l’objet de la preuve n’est abordé par aucun texte, alors même qu’il soulève de nombreuses difficultés.
La principale tient à la question de savoir si les justiciables doivent seulement prouver la situation qui est la cause du droit dont ils se prévalent ou s’ils doivent également prouver la règle de droit applicable.
À l’analyse, le principe est que seuls les faits doivent être prouvés. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Il est des cas où la preuve du droit devra être rapportée.
I) La preuve du fait
S’il revient aux justiciables de rapporter la preuve des faits, tous les faits n’ont pas à être prouvés.
Il s’agit, en effet, de ne pas contraindre les parties à devoir prouver tous les faits qui ont concouru à la situation présentée au juge. Cela pourrait revenir, en effet, à exiger d’elles qu’elles remontent la causalité de l’univers et donc à rendre la preuve impossible.
C’est la raison pour laquelle seuls les faits répondant à certains critères doivent être prouvés. Il doit s’agir :
- D’une part, de faits pertinents
- D’autre part, de faits contestés
A) Un fait
==> La preuve du fait et non du droit
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aussi, est-ce aux justiciables qu’il revient de supporter le fardeau de la preuve des faits à l’origine du litige porté devant le juge.
Comme souligné par François Terré « cette exigence naturelle est l’expression d’une nécessaire collaboration avec le juge, de la part de celui qui s’adresse à lui »[1].
La règle ainsi énoncée doit être lue en contemplation de l’article 12 du Code de procédure qui prévoit que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Il ressort de cette disposition que la règle de droit, contrairement aux faits qui dépendent des parties, est l’affaire du juge.
En effet, l’office du juge ne se limite pas à dire le droit, il lui appartient également de le « donner ».
Cette règle est exprimée par l’adage « da mihi factum, da tibi jus » qui signifie littéralement : « donne-moi les faits, je te donnerai le droit ».
Les parties n’ont ainsi nullement l’obligation de prouver la règle de droit dont elles entendent se prévaloir. C’est au juge qu’il incombe de trancher le litige qui lui est soumis au regard de la règle de droit applicable.
La raison en est que le Juge est présumé connaitre la règle de droit conformément à l’adage jura novit curia.
À cet égard, comme souligné par Aubry et Rau « les règles de droit ne sauraient en général faire l’objet d’une preuve proprement dite. Leur existence, leur teneur, et leur portée peuvent donner lieu à discussion, mais le juge est, par sa formation et son expérience, habile à en décider »[2].
N’étant pas tenues de prouver le droit, les parties doivent concentrer leurs efforts sur la preuve du fait. Plus précisément, selon Motulsky, il leur faut prouver « les éléments générateurs du droit par elle réclamé »[3].
A titre d’illustration, une victime qui saisit le Juge afin d’obtenir réparation d’un préjudice devra prouver non pas l’existence d’une règle qui « oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.), mais que les conditions d’application de cette règle sont réunies (préjudice, fait générateur et lien de causalité).
Dans un procès les rôles sont ainsi parfaitement répartis entre le juge et les parties :
- D’un côté, il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles allèguent au soutien de leurs prétentions
- D’un autre côté, il revient au juge d’une part, de recueillir les faits qui lui sont soumis, d’autre part, de leur donner ou restituer une exacte qualification et, enfin, de leur appliquer la règle de droit adéquate
==> La preuve du fait au sens large
Lorsque l’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe « à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », la question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « faits ».
Doit-on comprendre les faits au sens civiliste du terme, ou doit-on retenir une approche extensive ?
- L’approche civiliste
- Si l’on retient l’approche civiliste, il y a lieu d’opérer une distinction entre les faits juridiques et les actes juridiques :
- Les faits juridiques
- Ils sont définis à l’article 1100-2 du Code civil comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit».
- Exemple: un accident de voiture, la dissimulation d’un objet, une tornade, blessures infligées à autrui etc…
- Les actes juridiques
- Ils sont définis à l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »
- Exemple: un contrat, une démission, une déclaration de naissance, l’acceptation d’une succession etc.
- Il ressort de ces deux définitions que, le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets de droit qu’il est susceptible de produire n’ont pas été voulus.
- Si l’on s’en tient à l’approche strictement civiliste de la notion de « faits », elle devrait conduire à exclure les actes juridiques de l’objet de la preuve, tel que présenté par l’article 9 du Code de procédure civile.
- Est-ce à dire qu’il n’incomberait pas aux parties de prouver les actes juridiques qu’elles produisent au soutien de leurs prétentions ?
- L’admettre reviendrait à imposer au juge de tenir pour vrai des éléments dont l’existence et l’authenticité ne seraient pas établies, alors même que l’une ou l’autre serait douteuse, sinon improbable.
- Or cela serait contraire à la finalité du procès qui, pour mémoire, doit permettre notamment « la manifestation de la vérité» ( 10, al. 1er C. civ.)
- Pour cette raison, seule une approche extensive de la notion de « faits » peut être envisagée.
- L’approche extensive
- Cette approche consiste à appréhender la notion de « faits » comme comprenant, tant les faits juridiques, que les actes juridiques.
- Aussi, sont-ce de façon générale toutes « les situations juridiques»[4] qui doivent être prouvées par les parties, peu importe leur nature ou leur cause.
S’il n’est pas douteux que la notion de fait doit être comprise largement, cela ne signifie pas pour autant que tous les faits doivent être prouvés.
B) Un fait pertinent
Pour que pèse l’obligation sur une partie de prouver « les faits nécessaires au succès de sa prétention » (art. 9 CPC), encore faut-il que ces faits soient pertinents ou selon la terminologie processualiste « concluants » ou encore « relevants ».
Cette exigence est exprimée par l’adage frustra probatur quod probatum non relevat qui signifie : « il est vain de prouver les faits qui ne sont pas pertinents ».
Par pertinent, il faut comprendre que le fait qui doit être prouvé entretienne un rapport avec le litige porté devant le juge.
Plus précisément, il faut, selon Motulsky, que ce fait présente « une importance pour la solution du litige ».
Aubry et Rau abondent dans le même sens en écrivant que « le juge doit admettre ou ordonner la preuve que des faits relevants, pertinents, ou concluants, c’est-à-dire qui soient de nature à influer, d’une manière plus ou moins décisive, sur le jugement de la cause à l’occasion de laquelle ils sont allégués »[5].
À quoi bon, en effet, prouver un fait qui serait sans incidence sur la solution du litige à tout le moindre qui n’apporterait rien au débat judiciaire.
À cet égard, comme souligné par Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux « le plaideur alléguant un fait qui, à supposer établi, ne donnerait prise à aucune règle de droit apte à produire l’effet demandé, doit voir sa prétention rejetée, sans qu’il soit besoin de se préoccuper de l’existence de ce fait »[6].
L’exigence de pertinence des faits à prouver n’est formulée par aucune disposition générale relevant du droit commun de la preuve.
On la retrouve toutefois dans certaines dispositions du Code de procédure civile intéressant les mesures d’instruction susceptibles d’être prises par le Juge.
L’article 143 de ce code prévoit, par exemple, que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
Cette règle confère ainsi le droit à un justiciable de solliciter auprès du juge une mesure d’instruction, tant en cours d’instance, qu’en prévision d’un litige à naître, pourvu que le fait qui requiert cette mesure d’instruction soit susceptible d’influer sur la solution du litige.
La question qui alors se pose est de savoir comment identifier un tel fait.
Pour Motulsky les faits pertinents « sont ceux qui correspondent aux éléments générateurs du droit subjectif déduit en justice ». Il poursuit en rappelant « la nécessité pour toute partie faisant valoir un droit subjectif en justice d’alléguer, sous peine d’être déboutée de sa prétention, toutes les circonstances de fait répondant aux éléments générateurs de ce droit »[7].
Or c’est précisément sur la base de ces circonstances que le juge sera en capacité de se forger une conviction.
D’où la conclusion partagée par la plupart des auteurs consistant à admettre qu’un fait présente un caractère pertinent « lorsque, à supposer son existence établie, il est de nature à entraîner la conviction du juge en l’aidant à conclure définitivement le litige »[8].
Pour déterminer si un fait répond au critère de pertinence il y a donc lieu de se demander s’il est susceptible d’influer la conviction du juge et donc d’orienter le sens de sa décision.
S’agissant de l’appréciation par le juge de la pertinence, il y a lieu de distinguer deux hypothèses :
- Première hypothèse : l’appréciation de la pertinence du fait intéresse la conviction du juge
- Lorsque l’enjeu de la preuve du fait se limite à influer la conviction du juge alors l’appréciation de la pertinence de la preuve relève de son pouvoir souverain (V. par exemple 2e civ. 30 janv. 1980, n°79-12.470).
- Le juge est, en effet, seul à pouvoir déterminer si un fait est susceptible d’avoir une incidence sur sa décision
- Lorsqu’ainsi il estime qu’un fait est trop éloigné du fait qu’une partie cherche à établir, il pourra rejeter la preuve à rapporter, car inutile ( 1ère civ. 20 nov. 1973, n°72-13.508).
- Le juge pourra encore refuser d’ordonner une mesure d’instruction visant à établir un fait « quand sa conviction est formée» ( 2e civ. 12 mars 1970, n°69-12.291).
- Seconde hypothèse : l’appréciation de la pertinence du fait mobilise une règle de droit
- Lorsque l’enjeu de la preuve d’un fait intéresse la violation ou l’application d’une règle de droit, il est admis que la Cour de cassation exerce son contrôle sur l’appréciation par les juges du fond de la pertinence de la preuve rapportée.
- Dans un arrêt du 29 juin 1967, la Deuxième chambre civile a jugé en ce sens que « si les juges du fond ont, en principe, un pouvoir souverain d’appréciation, quant à la pertinence des faits offerts en preuve, il en est autrement quand les faits invoqués, dans le cas où l’existence en serait établie, justifieraient les prétentions de la partie qui les articule» ( 2e civ. 29 juin 1967).
C) Un fait contesté
==> Théorie du fait constant
Parce que « la preuve juridique est une preuve judiciaire »[9], elle ne doit être rapportée que si le fait dont se prévaut l’une des parties au procès est contesté.
Cette exigence est issue de la « théorie du fait constant » développée par Motulsky qui a soutenu que « pour que se pose la question de la preuve, il faut donc une contestation ; un fait reconnu ou simplement non contesté n’a pas besoin d’être prouvé »[10].
Cet auteur explique que pour que les parties à un procès puissent espérer voir prospérer leurs prétentions, il leur échoit d’accomplir deux tâches bien distinctes :
- Première tâche : l’allégation des faits
- La première tâche qui incombe à une partie qui se prévaut de l’application d’une règle de droit est d’alléguer les faits qui justifient son application
- Cette exigence est énoncée à l’article 6 du Code de procédure civile qui prévoit que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder».
- Il ne s’agit pas, à ce stade, de prouver les faits qui ont concouru à la situation présentée au juge, mais seulement de les lui exposer, pourvu qu’ils soient pertinents.
- Car rappelle Motulsky, avant de s’intéresser à la preuve du fait, le juge va d’abord chercher à déterminer s’il existe « une coïncidence totale entre les éléments générateurs du droit réclamé et les allégations du demandeur»[11].
- Dans l’affirmative, le juge devra tenir pour vrai le fait allégué et faire droit à la prétention du demandeur, sauf à ce que s’élève une contestation du défendeur.
- Seconde tâche : la preuve des faits
- Ce n’est que dans l’hypothèse où le défendeur oppose une résistance au demandeur que ce dernier sera tenu de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
- À cet égard, comme souligné par Motulsky « la position du défendeur n’intéresse […] le juge qu’à condition que le défendeur nie la réalité de l’une au moins des circonstances faisant écho aux éléments générateurs [du droit invoqué par le demandeur]»[12].
- Aussi l’objet de la preuve est-il circonscrit aux seuls faits qui sont contestés
La doctrine a tenté de justifier la théorie du fait constant soutenue par Motulsky en convoquant le principe dispositif et le dispositif de l’aveu judiciaire :
- Le principe dispositif
- Ce principe est énoncé à l’article 4, al. 1er du Code de procédure civile qui prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
- Parce que donc ce sont les parties qui déterminent le périmètre du procès, seuls les faits qu’elles entendraient soumettre à la discussion devraient être prouvés.
- Les faits qui ne feraient l’objet d’aucune contestation s’imposeraient donc au juge qui n’aurait d’autre choix que de les tenir pour vrai.
- D’ailleurs, l’article 7, al. 1er prévoit que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. »
- Bien que l’argument soit séduisant, il se heurte notamment au second alinéa de l’article 7 qui dispose que « parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
- L’article 8 confère, en outre, au juge le pouvoir d’« inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.»
- De toute évidence, le principe dispositif peine à justifier la théorie du fait constant.
- L’aveu judiciaire
- D’aucuns ont avancé que si un fait contesté n’a pas besoin d’être prouvé, c’est parce que l’absence de contestation par le défendeur s’analyse à un aveu tacite.
- Or l’aveu compte parmi les modes de preuve.
- À cet égard, l’article 1383-2 du Code civil prévoit, d’une part, que l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait», d’autre part, qu’« il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »
- Là encore, l’argument ne convainc pas.
- Compte tenu des conséquences attachées à l’aveu judiciaire, il serait dangereux d’admettre qu’il puisse s’induire du silence d’une partie.
- La définition qui en est donnée par le premier alinéa de l’article 1383-2 du Code civil semble d’ailleurs s’y opposer.
- Cette disposition prévoit que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. »
- Une déclaration consiste toujours en un acte positif et plus précisément en la manifestation d’une volonté.
- Dès lors, il y a une incompatibilité entre l’aveu et la reconnaissance tacite d’un fait.
Au bilan, aucun des deux arguments portés par la doctrine ne parvient à justifier la théorie du fait constant. Cela n’a toutefois pas empêché sa réception en droit positif.
==> Réception de la théorie du fait constant en droit positif
L’examen de la jurisprudence révèle que la théorie du fait constant a été reconnue dans de nombreuses décisions.
Dans un arrêt du 16 novembre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une Cour d’appel qui, pour refuser à des salariés le remboursement de frais de voyages a retenu que les états produits par chacun d’eux ne constituaient pas la preuve qu’il avait bien effectué les voyages.
La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu au motif qu’un salarié « n’est tenu de rapporter cette preuve que si la réalité du voyage est déniée par l’employeur débiteur des remboursements » (Cass. soc. 16 nov. 1972, n°72-40.080).
La Chambre commerciale a statué dans le même sens dans un arrêt du 2 mai 1989 à propos de créances tirées d’effets de commerce déclarées au passif d’une procédure collective.
Faute d’avoir été contestées par le débiteur, la Cour de cassation a estimé que les créances déclarées devaient être admises au passif de la procédure (Cass. com. 2 mai 1989, n°87-17.159).
Si les décisions admettant l’absence de nécessité de rapporter la preuve d’un fait non contesté soit nombreuses, certaines ont semé le trouble quant à l’assimilation en droit positif de la théorie du fait constant.
Dans un arrêt du 10 mai 1991, la Cour de cassation a notamment jugé qu’une Cour d’appel « n’était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu’ils n’avaient pas été expressément contestés par les autres parties » (Cass. 2e civ. 10 mai 1991, n°89-10.460).
Ainsi dans cette décision, la Deuxième chambre civile considère-t-elle que le juge n’est nullement obligé de tenir pour vrai un fait dès lors qu’il n’est pas contesté. Il S’agit là d’une simple faculté qu’il est libre d’exercer.
Cette approche a été partagée par la Chambre commerciale qui, dans un arrêt du 10 octobre 2000, a décidé que « le juge n’est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu’il n’est pas expressément contesté » (Cass. com. 10 oct. 2000, n°97-22.399).
Il s’infère de ces décisions que la théorie du fait constant est pour le moins fragile, sinon remise en cause. Le juge demeure, en effet, toujours libre de ne pas réputer comme établi un fait qui ne serait pas contesté.
Il semble donc falloir s’en tenir à la règle énoncée à l’article 9 du Code de procédure civile qui n’opère aucune distinction entre les faits à prouver. En application de cette disposition il incombe à chaque partie d’établir « les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
À cet égard, dans un arrêt du 18 avril 2000, la Cour de cassation a jugé que « le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait » (Cass. 1ère civ. 18 avr. 2000, n°97-22.421).
Autrement dit, le silence du défendeur ne saurait dispenser le demandeur de prouver les faits qu’il allègue.
II) La preuve du droit
S’il a toujours été admis qu’il n’incombait pas aux parties de prouver la règle de droit dont elles se prévalaient, ce principe n’en souffre pas moins de tempéraments qui tiennent, pour les premiers, à l’invocation du droit, pour les seconds, à la preuve du droit.
A) L’invocation du droit
Il n’échoit certes pas aux parties de rapporter la preuve du droit, les dernières réformes de la procédure civile ont néanmoins visé à leur faire jouer un rôle actif dans son invocation.
L’article 768 du Code de procédure prévoit ainsi s’agissant de la procédure par-devant le Tribunal judiciaire que « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. »
Les parties sont ainsi tenues d’invoquer les règles de droit qu’elles entendent voir appliquer par le juge.
À cet égard, dans un arrêt Cesareo du 7 juillet 2006 la Cour de cassation a jugé que « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci » (Cass. ass. Plén. 7 juill. 2006, n°04-10.672). C’est ce que l’on appelle le principe de concentration des moyens.
Ce principe vise en somme à interdire aux parties qui, dans le cadre d’un nouveau procès, formulent une demande ayant le même objet, de se prévaloir d’un moyen de droit qui n’aurait pas été invoqué en première instance. La violation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité de la nouvelle demande.
Deux ans plus tard, la Troisième chambre civile a été plus loin en étendant l’obligation de concentration des moyens aux parties en défense (Cass. 3e civ. 13 févr. 2008, 06-22.093)
Dans l’intervalle, l’assemblée plénière avait pris le soin de préciser dans un arrêt du 21 décembre 2007 que « si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes » (Cass. ass. plén. 21 déc. 2007, n°06-11.343).
Ce principe de concentration des moyens dégagé par la jurisprudence oblige donc les parties à jouer un rôle actif dans le processus de mobilisation de la règle de droit, à telle enseigne que l’on est légitimement en droit de se demander ce qu’il reste de l’office du juge.
En effet, tandis que les parties sont sommées de présenter au juge l’ensemble des moyens de droit qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions, le juge est quant à lui dispenser de leur en proposer s’il n’en voit pas l’utilité.
Ce retrait du juge dans la proposition de la règle de droit peut être accentué par l’exercice de la faculté que lui confère l’article 13 du Code de procédure civile d’« inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
B) La preuve du droit
Si a priori il n’incombe pas aux parties de prouver la règle de droit qu’elles entendent voir appliquer, il est dérogé au principe pour deux catégories de normes :
- La loi étrangère
- La coutume
1. La preuve de la loi étrangère
Lorsqu’une situation juridique comporte un élément d’extranéité, elle mobilise potentiellement plusieurs droits nationaux qui peuvent rentrer en conflit.
Ce conflit est appréhendé par ce que l’on appelle une règle de conflit lois, laquelle a pour fonction de désigner la loi applicable.
Par le jeu de ce dispositif, le juge français est ainsi susceptible de faire application d’une loi étrangère sur le territoire national.
Très tôt la question s’est posée de savoir quel traitement réserver à la loi étrangère s’agissant de la preuve. Deux approchent viennent à l’esprit en première intention :
- Première approche
- Elle consiste à appréhender la loi étrangère comme n’importe règle de droit français.
- Cette approche conduit alors à dispenser les parties de prouver la loi étrangère
- C’est donc au juge que reviendrait la tâche de trancher le litige qui lui est soumis en appliquant la loi étrangère adéquate
- Cette position revient toutefois à considérer que le juge connaît le contenu de la loi étrangère
- Or il s’agit là d’un vœu pieux, le juge étant déjà bien en peine de maîtriser le droit français compte tenu de sa complexité
- Seconde approche
- Elle consiste à appréhender la loi étrangère comme un fait, de sorte que c’est aux parties qu’il incomberait de prouver son existence et son contenu.
- Cette approche se veut pragmatique ; puisque intégrant l’impossibilité pour le juge français de connaître les droits de tous les États du monde.
- L’autre argument avancé par les auteurs est que la loi étrangère « apparaît au juge français dépouillée de son élément impératif, en lequel réside justement le caractère juridique»[13].
- Pour cette raison, elle ne se distinguerait pas d’un fait juridique et devrait, en conséquence, être traitée comme telle.
Dans un premier temps, la Cour de cassation a adopté la seconde approche. Dans un arrêt Lautour du 25 mai 1948, elle a, en effet, fait peser l’obligation sur les parties de rapporter la preuve de la loi étrangère applicable.
Au soutien de sa décision, la Haute juridiction a avancé qu’« il n’appartenait pas aux juges du fond de déplacer le fardeau de la preuve et de soustraire au contrôle de la Cour de cassation leur décision relative au règlement du conflit, en reprochant subsidiairement au défendeur à l’instance l’ignorance où ils les aurait laissés à des dispositions précises du droit espagnol capables de justifier ses allégations, alors que la victime, demanderesse en réparation, à laquelle incombait la charge de prouver que la loi applicable lui accordait les dommages-intérêts réclamés, ne contestait pas l’interprétation du droit espagnol affirmée par son adversaire » (Cass. Civ. 25mai 1948).
La Cour de cassation a, par suite, réaffirmé cette solution notamment dans un arrêt Sté Thinet rendu en date du 24 janvier 1984 (Cass. 1ère civ. 24 janv. 1984, n°82-16.767).
Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a infléchi sa position en opérant une distinction entre les demandes portant sur des droits disponibles et celles portant sur des droits indisponibles
- Première situation : les droits litigieux sont disponibles
- Dans cette hypothèse, la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur les parties.
- Dans un arrêt du 16 novembre 1993, la Chambre commerciale a jugé que « les matières où les parties ont la libre disposition de leurs droits, il incombe à la partie qui prétend que la mise en œuvre du droit étranger, désigné par la règle de conflit de lois, conduirait à un résultat différent de celui obtenu par l’application du droit français, de démontrer l’existence de cette différence par la preuve du contenu de la loi étrangère qu’elle invoque, à défaut de quoi le droit français s’applique en raison de sa vocation subsidiaire» ( com. 16 nov. 1993, n°91-16.116).
- Seconde situation : les droits litigieux sont indisponibles
- Dans cette hypothèse, c’est au juge qu’il appartient de rechercher d’office le contenu de la loi étrangère
- Dans un arrêt du 1er juillet 1997, la Première chambre civile a jugé en ce sens que « l’application de la loi étrangère désignée pour régir les droits dont les parties n’ont pas la libre disposition impose au juge français de rechercher la teneur de cette loi» ( 1ère civ. 1er juill. 1997, n°95-17.925)
Dans un troisième temps, la Cour de cassation a abandonné cette distinction en décidant dans un arrêt du 27 janvier 1998 « qu’il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de procéder à sa mise en œuvre, et, spécialement, d’en rechercher la teneur » (Cass. 1ère civ. 27 janv. 1998, n°95-20.600).
Elle a ensuite confirmé ce revirement de jurisprudence en précisant dans deux arrêts rendus, le même jour, par la Première chambre civile et la Chambre commerciale, « qu’il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger » (Cass. 1ère civ. 28 juin 2005, n°00-15.734 ; Cass. com. 28 juin 2005, n°02-14.686).
Par ces deux arrêts, la Cour de cassation renonce ainsi à l’idée que la preuve du contenu de la loi étrangère incombe exclusivement aux parties.
Dès lors que le conflit de lois a été résolu, le caractère disponible ou indisponible des droits subjectifs discutés devant le juge est sans incidence sur l’établissement du contenu de la loi étrangère.
La Cour de cassation a résumé cette idée dans un arrêt du 16 septembre 2015 aux termes duquel elle a jugé que « qu’il incombe au juge français, saisi d’une demande d’application d’un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l’aide des parties, et de l’appliquer » (Cass. 1ère civ. 16 sept. 2015, n°14-10.373)
S’agissant du contrôle exercé par la Cour de cassation sur l’interprétation de la loi étrangère par les juges du fond, il est le même que celui exercé en matière d’actes juridiques.
Dans un arrêt du 13 novembre 2003, la Première chambre civile a, en effet, affirmé « que s’il incombe au juge français, qui applique une loi étrangère, de rechercher et de justifier la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif de l’Etat concerné, l’application qu’il fait de ce droit étranger, quelle qu’en soit la source, légale ou jurisprudentielle, échappe, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour de Cassation » (Cass. 1ère civ. 3 juin 2003, n°01-00.859).
Par hypothèse, la Cour de cassation n’est investie d’aucun pouvoir juridictionnel ou disciplinaire sur le droit étranger. Dans ces conditions, elle ne peut appréhender la loi étrangère que comme un acte juridique ordinaire relevant du domaine des faits au sens large – par opposition au droit.
C’est la raison pour laquelle, lorsque la Cour de cassation est saisie pour se prononcer sur l’application d’une loi étrangère, son contrôle se limite à vérifier que les juges du fond n’ont pas dénaturé le sens de la règle discutée.
2. La preuve de la coutume
À l’instar de la loi étrangère, le juge n’est pas censé connaître tous les usages et coutumes auxquels les justiciables sont susceptibles de se soumettre.
Pour mémoire, la coutume se définit comme une « norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire (consensus utentium) qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant »[14].
Lorsqu’une partie à un procès se prévaut de l’application d’une coutume immédiatement se pose la question de la preuve de l’existence et du contenu de la règle invoquée.
Très tôt la jurisprudence a posé que la preuve de la coutume devait être rapportée par la partie qui en réclame l’application (V. par exemple Cass. soc. 11 juin 1987, n°84-43.059).
L’assemblée plénière a confirmé cette solution dans un arrêt du 26 février 1988 (Cass. ass. plén. 26 févr. 1988, n°85-40.034)
Parce que la coutume est traitée comme un fait, elle peut être prouvée par tous moyens.
Ainsi, les usages professionnels pourront, par exemple, être établis au moyen d’attestations délivrées par des Chambres de commerce, des Chambres des métiers ou encore des associations de professionnels (V. en ce sens Cass. com. 9 janv. 2001, n°97-22.668 ; Cass. com. 12 déc. 1973, n°72-12.979).
Dans un arrêt du 6 janvier 1987, la Cour de cassation a précisé « qu’il n’appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler l’existence et l’application des principes et usages du commerce international » (Cass. 1ère civ. 6 janv. 1987, n°84-17.274).
C’est donc aux seuls juges du fond qu’il revient d’apprécier souverainement l’existence et le contenu de la coutume invoquée par une partie.
[1] F. Terré, Introduction générale au droit, éd. Dalloz, 2000, n°487, p. 516.
[2] C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, 6e éd. 1958, T. 12, par P. Esmein, p. 52.
[3] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°115, p. 128
[4] F. Terré, Introduction générale au droit, éd. Dalloz, 2000, n°488, p. 516.
[5] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariea, éd. Hachette Livre – BNF, p. 153
[6] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil – Introduction générale, éd. LGDJ, 1977, n°576, p.452.
[7] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°85, p. 87.
[8] R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 9, Les contrats et les obligations, par G. Lagarde et R. Perrot, 1953, Rousseau, n°1170.
[9] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil – Introduction générale, éd. LGDJ, 1977, n°563, p.441.
[10] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°115, p. 128.
[11] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°107, p. 114.
[12] H. Motulsky, op. cit., n°109, p. 119.
[13] P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, éd. LGDJ, 2001, n°179
[14] G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. Puf, 2005, V. Coutume, p. 248