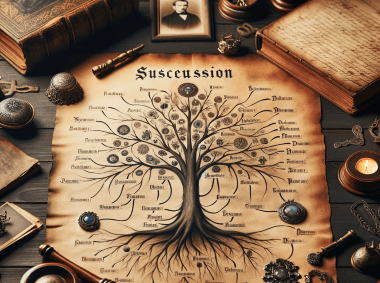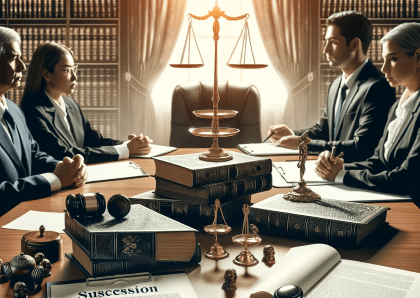En application de l’article 724 du Code civil le patrimoine du de cujus est transmis à ses héritiers immédiatement après sa mort.
S’il est héritier ab intestat, c’est-à-dire par l’effet de la loi, l’héritier entre en possession des biens qui lui sont transmis de plein droit, soit sans qu’il lui soit besoin d’accomplir une quelconque formalité préalable.
S’il est légataire ou donataire universel, c’est-à-dire par l’effet de la volonté du de cujus (testament ou donation), l’entrée en possession ne peut intervenir qu’après l’accomplissement des formalités requises.
Si, la plupart des temps, l’héritier pourra exercer les droits qui lui sont reconnus sans opposition, il est des cas en revanche où il se heurtera à la résistance d’un tiers.
Trois situations peuvent être distinguées :
- Première situation
- Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui n’entendra le lui remettre que s’il justifie de sa qualité d’héritier.
- Cette situation soulève la question de la preuve dite non-contentieuse, soit celle qui doit être rapportée en dehors des prétoires.
- Deuxième situation
- Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre car il se prévaut de la qualité de seul successeur du de cujus.
- Cette situation soulève la question de la preuve contentieuse.
- Afin de faire valoir ses droits sur le bien détenu par le tiers, l’héritier devra engager une action en pétition d’hérédité.
- C’est alors au juge qu’il reviendra de trancher le litige opposant l’héritier au tiers détenteur du bien disputé.
- Troisième situation
- Le bien transmis à l’héritier est détenu par un tiers qui refuse de le lui remettre, non pas parce qu’il se prévaut de la qualité de successeur, mais parce qu’il prétend avoir acquis le bien à un autre titre (contrat, prescription, accession etc.)
- Dans cette hypothèse, l’héritier devra, pour faire valoir ses droits, exercer l’action reconnue à n’importe quel propriétaire : l’action en revendication.
Parmi ces trois situations, seules les deux premières concernent la preuve de la qualité d’héritier.
La troisième situation intéresse la qualité de propriétaire et relève, à ce titre, non pas du droit des successions, mais du droit commun des biens.
§1 : La preuve non-contentieuse de la qualité d’héritier
🡺Vue générale
À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?
En première intention, comme souligné par Michel Grimaldi, la démarche peut interroger, sinon surprendre dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament[1].
Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil.
Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.
L’absence de détermination dans le Code napoléonien de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques.
Prouver sa qualité d’héritier est un exercice qui n’est, en effet, pas toujours aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaire à l’établissement de sa filiation.
Pour toutes ces raisons, et afin de contourner les difficultés rencontrées, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuves tels que notamment l’acte de notoriété ou l’intitulé d’inventaire.
🡺Consécration légale de la pratique
Conscient de la source de contentieux générée par l’absence de dispositions dans le Code civil réglant la question de la preuve de la qualité d’héritier, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001.
Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier. Cette preuve est désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.
Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.
S’agissant du système de preuve retenu par le législateur quant à l’établissement de la qualité d’héritier, l’article 730 du Code civil rappelle donc le principe de liberté de la preuve. Il prévoit en ce sens que « la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »
La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire pour faire la preuve de sa qualité d’héritier de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuves sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan.
Autrement dit, dans ce système, tous les modes de preuve se valent de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier.
S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique permettant d’établir la qualité d’héritier en dispensant les successeurs d’accomplir des formalités fastidieuses et complexes, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique.
Comme exprimé dans les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété qui constitue, encore aujourd’hui, le principal mode de preuve de la qualité d’héritier. D’importantes modifications ont toutefois été apportées au régime de ces actes pour les simplifier et pour accroître leur force probante.
Le législateur en a profité, dans le même temps, pour reconnaître d’autres modes de preuves non-contentieux permettant d’établir facilement la qualité d’héritier tels que l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité.
Plus tard, ont été créés le certificat successoral européen par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Parmi les modes de preuves utilisés par la pratique pour établir la qualité d’héritier, il faut aussi compter sur ce que l’on appelle l’attestation notariée immobilière qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.
I) L’acte de notoriété
🡺Origine
L’acte de notoriété est, à l’origine, issu de la pratique des notaires qui avaient trouvé là un moyen fort commode pour constater la dévolution des successions. Les seuls textes encadrant cette pratique n’étaient autres que ceux régissant le notariat, soit la loi du 25 ventôse an XI (anc. article 20), ainsi que le décret n°71-941 du 26 nov. 1971 (art. 26).
L’établissement de l’acte de notoriété reposait, sous l’empire du droit antérieur, sur les déclarations d’au moins deux témoins, lesquels devaient attester, au regard de leur connaissance personnelle, de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.
Sur la base de ces déclarations, le notaire pouvait alors dresser l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale.
Si cette pratique est apparue comme adaptée dans une société rurale où les membres d’une même famille vivaient le plus souvent au même endroit et où les relations entre les personnes étaient stables et connues notoirement de tous, l’urbanisation de la société a bouleversé cette configuration.
La multiplication des déplacements de populations a rendu la notoriété des relations entre les personnes beaucoup moins certaine, la vie urbaine se caractérisant notamment par l’anonymat des habitants de la ville.
Parce que l’adoption par les notaires de l’acte de notoriété reposait essentiellement sur cette connaissance qu’ont les personnes d’un même village des relations qu’elles entretiennent les unes aux autres, la raison d’être de ce mode de preuve a commencé à être discuté, sinon remis en cause.
Bien que deux nombreux arguments plaidassent pour l’abandon pur et simple de l’acte de notoriété, le législateur a finalement choisi de le conserver.
🡺Consécration légale
L’acte de notoriété comme mode de preuve de la qualité d’héritier a donc été consacré par la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.
Son régime est défini aux articles 730 à 730-5 du Code civil. La principale innovation apportée par le législateur est l’abandon de l’exigence au recours d’au moins deux témoins lors de l’établissement de l’acte.
Si la suppression de cette exigence se comprend aisément compte tenu de son caractère désuet, elle aurait dû être accompagnée d’un changement de terminologie.
L’acte dressé par le notaire était, en effet, dit de notoriété car il était établi sur la base de déclarations d’au moins deux témoins dont le rôle était d’attester de la notoriété de la qualité d’héritier de la personne se présentant comme le successeur du de cujus.
Désormais, l’acte de notoriété peut être dressé alors même que la qualité d’héritier de la personne qui s’en prévaut ne peut être attestée par personne.
Aussi, comme souligné par Michel Grimaldi « le nouvel acte de notoriété n’a […] plus rien d’un témoignage et contiendrait plutôt une sorte de serment : d’une part, on ne témoigne pas de ses propres qualités ; d’autre part, l’affirmation solennelle de la véracité de sa propre assertion évoque le serment »[2].
Malgré les critiques, le législateur a opté pour la conservation de la terminologie initiale.
Bien que n’ayant plus grand-chose à voir avec la notoriété de la qualité d’héritier de celui à la faveur de qui il est dressé, l’acte de notoriété demeure visé comme tel dans le Code civil.
A) Les conditions d’établissement de l’acte de notoriété
🡺Auteur de la demande
L’article 730-1, al. 1er du Code civil prévoit que l’acte de notoriété est dressé par un notaire « à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ».
Il ressort de cette disposition que l’établissement d’un acte de notoriété ne peut être sollicité que par un ayant droit.
Une telle sollicitation ne pourrait donc pas être faite par un tiers ; elle n’est admise que si elle émane de personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier ou de légataire.
🡺Rôle du notaire
Comme énoncé par l’article 730-1, al. 1er du Code civil, l’acte de notoriété ne peut être dressé que par un notaire.
Il peut être observé que cela n’a pas toujours été le cas. Sous l’empire du droit antérieur, l’alinéa 2 de l’article 730-1 prévoyait que l’acte de notoriété pouvait « également être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession. »
Cette disposition a été abrogée par la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
L’objectif affiché par le législateur était, à l’époque, de décharger les greffiers en chef des tribunaux de cette tâche.
Désormais, l’établissement d’un acte de notoriété relève donc de la compétence exclusive du notaire.
À cet égard, parce qu’il intervient à l’acte en sa qualité d’officier public, le notaire est responsable de sa validité.
Aussi, cela l’oblige-t-il à procéder à toutes les vérifications et recherches préalables permettant d’en assurer l’efficacité.
Pratiquement, le notaire devra dès lors accomplir toutes les démarches utiles aux fins de vérifier la parenté du de cujus avec la ou les personnes qui se prévalent de la qualité d’héritier. Ces recherches devront être plus ou moins approfondies selon le degré de parenté en jeu.
À cette fin, le notaire devra notamment réclamer tous les documents justificatifs (actes d’état civil, livret de famille, jugement d’adoption ou de divorce, actes constatant une possession d’état, etc.) qui lui permettront de vérifier l’existence des liens de parenté revendiqués par les héritiers avec le de cujus.
Il devra également demander la production de tous documents qui concernent l’existence de libéralités (testaments, contrats de mariage, etc.) pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
S’agissant des libéralités à cause de mort, le notaire devra systématiquement consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés qui recense tous les testaments reçus en France par les notaires.
🡺Personnes appelées à l’acte
Comme vu précédemment, l’établissement d’un acte de notoriété n’est plus subordonné à la présence d’au moins deux témoins.
Si cette exigence a été abolie par la loi du 3 décembre 2001, cela ne signifie pas pour autant que la sollicitation de témoins est désormais prohibée.
Le notaire dispose, en effet, toujours de la faculté de recueillir les déclarations de tiers aux fins de l’éclairer sur la dévolution successorale.
L’article 730-1, al. 4e du Code civil prévoit en ce sens que « toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte. »
Les déclarations formulées par les tiers ne sont toutefois plus aussi décisives qu’elles ne l’étaient lorsque le recours à au moins deux témoins était obligatoire.
Ce qui prime aujourd’hui et ce sur quoi repose l’établissement de l’acte de notoriété, ce ne sont autres que les déclarations des ayants droit.
B) Le contenu de l’acte de notoriété
L’acte de notoriété doit, pour être valable, contenir un certain nombre d’éléments :
- Déclarations des auteurs de la demande d’établissement de l’acte
- L’article 730-1, al. 3e du Code civil prévoit que l’acte de notoriété doit contenir « l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt ».
- Ainsi, l’ayant droit en demande de l’établissement de l’acte de notoriété doit déclarer au notaire sa vocation successorale.
- Il peut être observé que l’établissement de l’acte de notoriété ne requiert pas la réception par le notaire des déclarations de l’ensemble des héritiers ou légataires.
- Reste qu’il devra faire tout son possible pour que l’ensemble des successeurs déclarent dans l’acte leur vocation successorale.
- En tout état de cause, préalablement à l’établissement de l’acte, le notaire devra systématiquement informer les déclarants que, conformément à l’article 730-5 du Code civil, « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts. »
- Mention de l’acte de décès
- L’article 730-1, al. 2e du Code civil exige que l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte soit visé dans l’acte de notoriété.
- Cet acte de décès, dont le notaire doit demander une copie, permet de faire la preuve du décès du de cujus.
- Mention des pièces justificatives
- L’article 730-1, al. 2e du Code civil prévoit que, outre l’acte de décès, doivent être visées dans l’acte de notoriété toutes « les pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. »
- Il s’agit là pour le notaire de s’assurer de la qualité de successeurs des déclarants et plus précisément de vérifier qu’ils entretiennent bien avec le de cujus soit un lien de filiation (actes de naissance), soit un lien matrimonial (actes de mariage) ou bien qu’ils sont bénéficiaires d’un legs (testament) ou d’avantages matrimoniaux (contrat de mariage, actes de changement de régime matrimonial).
- Mention des démarches et recherches accomplies par le notaire
- À titre facultatif, le notaire peut faire mention des démarches et recherches complémentaires qu’il a effectuées aux fins d’établir la dévolution successorale.
- Cela permettra, en cas de litige, de renforcer la force probante de l’acte de notoriété.
C) Les effets de l’acte de notoriété
1. Les effets à l’égard des parties à l’acte
L’article 730-2 du Code civil prévoit que « l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. »
Cela signifie que, nonobstant l’établissement de l’acte de notoriété, les héritiers conservent leur droit d’option. Ils pourront donc tout autant accepter la succession que la refuser. L’établissement de l’acte de notoriété ne les oblige pas.
2. Les effets à l’égard des tiers
a. Publicité de l’acte
L’article 730-1, al. 5e du Code civil prévoit qu’il doit être « fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès. »
La publicité de l’acte vise à informer les tiers de l’établissement de la dévolution successorale et leur permettre de se manifester afin de faire éventuellement valoir leurs droits sur la succession.
b. Force probante de l’acte
🡺Présomption de la qualité de successeur
L’article 730-3 du Code civil prévoit que « l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire. »
Plus précisément c’est la véracité des déclarations formulées par les parties à l’acte de notoriété qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
S’agissant du contenu de ces déclarations, il fait foi jusqu’à inscription en faux dans la mesure où les déclarations mentionnées dans l’acte ont été personnellement constatées par le notaire en sa qualité d’officier public.
Le contenu des déclarations ne pourra dès lors être combattu que par la mise en œuvre de la procédure d’inscription en faux définie aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.
Pour ce qui est de la véracité des déclarations elle peut donc, quant à elle, être combattue par la seule preuve contraire laquelle se rapporte par tous moyens, conformément à l’article 730, al. 1er du Code civil.
Pratiquement, cela signifie que la dévolution successorale constatée dans l’acte de notoriété est présumée établie.
L’article 730-3, al. 2e du Code civil dispose en ce sens que « celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée. »
Les tiers qui, dans ces conditions, détiendraient un bien revenant aux successeurs ne sauraient exiger la production d’éléments probatoires, sauf à contester leur qualité d’héritier auquel cas il leur faudra rapporter la preuve contraire.
🡺Présomption de pouvoirs
Afin de favoriser la confiance que les tiers doivent avoir dans la force probante de l’acte de notoriété, le législateur a introduit dans le Code civil l’article 730-4 qui prévoit que « les héritiers désignés dans l’acte de notoriété ou leur mandataire commun sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte. »
Cette disposition institue une présomption de pouvoirs à la faveur des successeurs visées dans l’acte de notoriété. Ces derniers sont réputés avoir le pouvoir d’accomplir tout acte d’administration et de disposition sur les biens relevant de la succession.
En cas de remise d’un bien à une personne dont la qualité de successeur serait remise en cause ultérieurement, la responsabilité du tiers à l’origine de cette remise (le banquier par exemple) ne saurait être engagée dès lors que celui-ci a agi en se fondant sur l’acte de notoriété qui lu a été présenté.
II) L’intitulé d’inventaire
🡺Établissement de l’intitulé d’inventaire
L’article 1328 du Code de procédure civile prévoit que « l’inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante. »
Il ressort de cette disposition, qui relève d’un chapitre du Code de procédure civile consacré aux successions et libéralités, que lors de l’ouverture d’une succession, il est un certain nombre de personnes qui peuvent réclamer l’établissement d’un inventaire des biens du de cujus, lequel pourra être réalisé par un notaire ou un commissaire de justice.
Parmi les personnes autorisées à solliciter cet inventaire, il y a lieu de compter, outre les créanciers poursuivant de la personne décédée, ses successeurs et plus généralement les personnes chargées d’administrer la succession.
Lorsque l’inventaire est sollicité par des personnes se déclarant comme successeurs du de cujus auprès d’un notaire, il peut être demandé à ce dernier de mentionner en préambule – d’où le nom d’intitulé d’inventaire – notamment leur qualité d’héritier ou de légataire ainsi que l’étendue de leur vocation successorale.
Préalablement à la rédaction de l’intitulé d’inventeur, le notaire devra procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins de vérifier la qualité de successeurs des personnes requérantes et leur réclamer toutes les pièces justificatives qu’il jugera utile.
La raison en est que l’intitulé d’inventaire confère aux personnes visées la qualité successeur apparent. À cet égard, ils pourront demander au notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits aux fins de faire la preuve de leur qualité d’héritier ou de légataire auprès des tiers.
🡺Force probante de l’intitulé d’inventaire
À titre de remarque liminaire, l’établissement d’un intitulé d’inventaire dispense les successeurs de solliciter la délivrance d’un acte de notoriété.
Cela s’explique par le fait que l’intitulé d’inventaire est pourvu de la même force probante que l’acte de notoriété.
En effet, il fait foi jusqu’à preuve contraire laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Aussi, toutes les personnes désignées dans l’intitulé d’inventaire sont présumées avoir la qualité d’héritier.
Un tiers ne pourrait dès lors pas exiger la production d’une preuve complémentaire, sauf à contester la qualité d’héritier des personnes visées dans l’acte auquel cas il lui faudra rapporter la preuve contraire
III) Les certificats de propriété ou d’hérédité
🡺Établissement de certificats de propriété ou d’hérédité
L’article 730, al. 2e du Code civil énonce qu’« il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives. »
Cette disposition traduit la volonté du législateur de consacrer la pratique qui, sous l’empire du droit antérieur, consistait pour les maires, les notaires ou encore les juges à délivrer des certificats attestant de la propriété d’un bien ou de la qualité de successeur du requérant.
Ces certificats sont souvent nécessaires pour accomplir différentes démarches administratives, comme le déblocage de comptes bancaires du de cujus et plus généralement la remise de biens ayant appartenu à ce dernier mais détenus par des tiers.
- S’agissant du certificat de propriété
- Il s’agit d’un acte établi, le plus souvent par un notaire, parfois par un juge, attestant du droit de propriété exercé par une ou plusieurs personnes sur des biens déterminés.
- Il peut être observé que les certificats de propriété ne peuvent être établis que pour attester de la propriété d’un bien meuble. Ils ne permettent donc pas de faire la preuve d’un bien immobilier.
- Pour faire cette preuve, le successeur devra demander l’établissement d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou d’une attestation notariée immobilière.
- S’agissant du certificat d’hérédité
- Il s’agit d’un acte établi par un maire permettant au requérant d’obtenir le paiement d’une créance détenu par le de cujus à l’encontre d’organismes publics dans la limite de 5 335 euros.
- S’agissant du plafond de 5 335 euros il ne trouve son fondement dans aucun texte ; il s’agit d’une pratique administrative Il sert de seuil en dessous duquel le certificat d’hérédité délivré par le maire peut être suffisant pour régler des petites successions, notamment en matière de créances détenues auprès d’organismes publics (V. en ce sens Circ. min. Budget, 30 mars 1989).
Qu’il s’agisse du certificat de propriété ou du certificat d’hérédité, leur délivrance est presque systématiquement subordonnée à la production de documents justificatifs, tels que l’acte de décès, l’acte de naissance, le livret de famille, la pièce d’identité, etc.
L’autorité qui délivre l’un de ces certificats doit s’assurer, sur la base d’un minimum d’éléments probants, que le requérant est fondé dans sa demande, soit qu’il présente toute apparence du successeur du de cujus.
Un notaire qui établirait un certificat de propriété sans entreprendre toutes les investigations requises sur la qualité d’héritier ou de légataire de la personne qui se présente à lui engagerait assurément sa responsabilité.
Quant au maire, bien qu’il demeure libre d’apprécier l’opportunité de délivrer un certificat d’hérédité en considération des éléments de preuve qui lui sont soumis, il engagerait la responsabilité de l’État en cas d’investigations insuffisantes.
🡺Force probante des certificats de propriété ou d’hérédité
Le certificat de propriété ou d’hérédité confère à leur titulaire la qualité de successeur apparent.
Il en résulte que les tiers ne sauraient conditionner la remise d’un bien ou le paiement d’une créance à la production d’éléments de preuve supplémentaires.
IV) L’attestation notariée immobilière
🡺Établissement de l’attestation notariée immobilière
Dès lors qu’un bien immobilier fait l’objet d’un transfert de propriété, ce transfert doit donner lieu à l’accomplissement de formalités de publicité.
L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit en ce sens que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles […] tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs […] mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au Code civil ».
L’article 29 de ce même décret précise que « toute transmission ou constitution par décès de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté et précisant, éventuellement, les modalités de cette acceptation. »
Ainsi, lorsque le transfert de propriété d’un bien immobilier résulte d’un décès, l’accomplissement des formalités de publicité foncière consiste en la publication de ce que l’on appelle une « attestation notariée immobilière » auprès du service de la publicité foncière (ancien bureau des hypothèques) du ressort dans lequel est situé l’immeuble concerné.
Par exception, lorsque la totalité des biens immobiliers relevant de la succession a fait l’objet d’un acte de partage dans le délai de 10 mois après le décès, il n’est pas nécessaire d’établir une attestation notariée immobilière.
Comme suggéré par son nom, cette attestation ne peut être délivrée que par un notaire.
Quant à son contenu, l’attestation notariée immobilière doit :
- D’une part, identifier le bien immobilier faisant l’objet d’un transfert de propriété en le décrivant avec précision
- D’autre part, certifier le droit de propriété des successeurs désignés sur le bien immobilier visé dans l’acte
Parce que l’attestation notariée immobilière permet d’établir la dévolution successorale, elle doit obligatoirement viser les pièces justificatives sur lesquelles elle repose, ce qui suppose que le notaire ait, au préalable, accompli toutes les investigations utiles.
Il peut être observé que, conformément à l’article 33 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, l’attestation notariée immobilière doit être établie et publiée dans certains délais :
- En premier lieu, le notaire doit être requis pour l’établissement de l’attestation notariée immobilière dans les six mois après le décès.
- En second lieu, l’attestation doit être publiée dans les quatre mois à compter du jour où le notaire a été requis
L’inobservation de ces délais n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité aux tiers du transfert de propriété à cause de mort non publié.
En revanche, elle fait obstacle à la publication de tout acte ultérieur qui constaterait un transfert de propriété ou la constitution de droits réels sur l’immeuble.
À cet égard, la responsabilité des successeurs pourrait être recherchée dans l’hypothèse où l’impossibilité pour des personnes de constituer leurs droits sur l’immeuble leur causerait un préjudice.
🡺Force probante de l’attestation notariée immobilière
L’attestation notariée immobilière est pourvue de la même force probante que le certificat de propriété.
Aussi, confère-t-elle aux personnes désignées dans l’acte la qualité de successeur apparent du de cujus.
V) Le certificat bancaire
🡺Ratio legis
Le certificat bancaire est issu de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
Il a été créé afin de permettre aux successeurs, dans le cadre d’une succession de faible montant, d’établir leur qualité d’héritier auprès des établissements bancaires au moyen d’un mode de preuve simplifié.
Plus précisément, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs, sans qu’il leur soit besoin de produire un acte de notoriété, un certificat d’hérédité ou un certificat de propriété, d’accomplir un certain nombre d’opérations bancaires limitativement énumérées par la loi.
🡺Domaine
Le domaine d’application du certificat bancaire est pour le moins restreint dans la mesure où :
- D’une part, il ne peut servir à faire la preuve de la qualité d’héritier que dans le cadre de l’accomplissement d’opérations bancaires ; d’où son intégration dans le Code monétaire et financier (art. L. 312-1-4 CMF) ;
- D’autre part, il ne peut être délivré qu’à un successeur en ligne directe (ascendants ou descendants), ce qui signifie que les successeurs en ligne collatérale, n’auront d’autre choix que de recourir à un mode de preuve de droit commun s’ils entendent se faire remettre les avoirs bancaires du défunt.
🡺Les pouvoirs conférés aux successeurs
En application de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, le certificat bancaire confère la faculté aux successeurs en ligne directe, d’accomplir deux catégories d’actes :
- Première catégorie d’actes
- Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent « obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d’imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l’article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
- Les actes conservatoires visés ici ne sont autres, si donc l’on se reporte à l’article 784 du Code civil, que « le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent »
- Ce paiement ne peut intervenir que dans la limite d’un montant de 5.000 euros conformément à l’arrêté du 14 mai 2015.
- Seconde catégorie d’actes
- Les successeurs détenteurs d’un certificat bancaire peuvent également « obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
- Ici aussi, le plafond a été fixé à 5000 euros.
- Lorsqu’ainsi le montant de la succession est modeste, les successeurs en ligne directe peuvent directement se faire remettre par l’établissement bancaire au sein duquel sont domiciliés les comptes du défunt ses avoirs.
- Il peut être observé que le montant maximum de 5000 euros doit s’entendre du montant cumulé des prélèvements ou des fonds disponibles sur l’ensemble des comptes du défunt.
- Enfin, pour être autorisé à réclamer la clôture du compte du défunt et le versement des sommes y figurant, la succession ne doit comporter aucun bien immobilier.
- Dans le cas contraire, la remise des fonds ne pourra s’opérer que par l’entremise d’un notaire chargé d’assurer le règlement de la succession.
🡺Conditions d’établissement du certificat bancaire
En premier lieu, pour que le certificat bancaire puisse être utilisé par un successeur pour faire la preuve de sa qualité d’héritier il doit être signé par l’ensemble des héritiers.
En deuxième lieu, il doit comporter un certain nombre de mentions aux termes desquels les héritiers attestent :
- Qu’il n’existe pas de testament ni d’autres héritiers du défunt ;
- Qu’il n’existe pas de contrat de mariage ;
- Qu’ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
- Qu’il n’y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d’héritier ou la composition de la succession.
Dans l’hypothèse où le certificat bancaire est produit par un héritier aux fins d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, il doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
En dernier lieu, pour que le certificat bancaire puisse produire ses effets, l’héritier qui s’en prévaut doit remettre à l’établissement de crédit teneur des comptes :
- Son extrait d’acte de naissance ;
- Un extrait d’acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
- Le cas échéant, un extrait d’acte de mariage du défunt ;
- Les extraits d’actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l’attestation susmentionnée ;
- Un certificat d’absence d’inscription de dispositions de dernières volontés.
🡺Force probante
À l’instar du certificat d’hérédité ou de propriété, le certificat bancaire foi jusqu’à preuve contraire laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Aussi, toutes les personnes mentionnées dans le certificat sont présumées avoir la qualité d’héritier apparent.
Dès lors que les conditions d’établissement du certificat bancaire sont satisfaites, l’établissement bancaire auquel il est présenté ne saurait exiger de l’héritier qui s’en prévaut la production d’éléments probatoires complémentaires.
§2 : La preuve contentieuse de la qualité d’héritier
🡺Définition
Classiquement, l’action en pétition d’hérédité est définie comme la « demande par laquelle un héritier entend faire reconnaître en justice sa vocation héréditaire contre ceux qui se prétendent seuls héritiers des biens qu’ils détiennent et obtenir d’eux les avantages qui en découlent »[3].
Cette action intervient donc lorsqu’un héritier, un légataire ou un institué contractuel se heurte à la résistance d’un tiers détendeur d’un bien relevant de la succession, qui refuse de le lui remettre au motif qu’il serait le seul successeur du de cujus.
L’action en pétition d’hérédité a, en somme, vocation à faire trancher un litige opposant deux personnes qui se disputent la qualité de successeur du de cujus.
Plus précisément, elle poursuit deux objectifs :
- Premier objectif
- L’action en pétition d’hérédité vise à faire reconnaître judiciairement la qualité de véritable successeur du de cujus du demandeur
- Seconde fonction
- L’action en pétition d’hérédité vise à obtenir le délaissement des biens détenus par le tiers qui se prévaut de la qualité de successeur au profit du demandeur
🡺Distinctions
Il peut être observé que l’action en pétition d’hérédité se distingue, d’une part, de l’action en partage et, d’autre part, de l’action en revendication.
- S’agissant de l’action en partage
- Elle consiste seulement pour un héritier ou un légataire à réclamer sa part dans la succession.
- Ce n’est que si sa qualité de successeur est contestée par les autres ayants cause du de cujus qu’il devra la faire reconnaître préalablement à sa demande de partage.
- S’agissant de l’action en revendication
- Elle a vocation à être exercée lorsque le tiers détenteur d’un bien relevant de la succession refuse de le remettre au successeur non pas parce qu’il se prétendrait être le seul successeur du de cujus, mais parce qu’il aurait acquis le bien disputé au titre d’un autre mode d’acquisition de la propriété (contrat conclu avec le défunt, prescription acquisitive, accession etc.).
🡺Nature
La nature de l’action en pétition d’hérédité est discutée en doctrine en raison de sa double finalité.
Pour certains, il s’agit d’une action personnelle dans la mesure où elle vise à obtenir la reconnaissance judiciaire d’une qualité – personnelle – du demandeur, celle de successeur.
Pour d’autres, il s’agit d’une action réelle dans la mesure où elle vise à faire trancher la question de la propriété du bien disputé par le tiers détenteur de ce bien et le demandeur.
D’autres enfin avancent, qu’il s’agit d’une action mixte, en ce sens que sa nature varierait selon la prétention invoquée.
L’enjeu de la nature de l’action en pétition d’hérédité réside notamment dans le délai de prescription lequel diffère selon que l’on est en présence d’une action réelle ou d’une action personnelle.
I) Le régime l’action en pétition d’hérédité
A) Juridiction compétence
L’article 45 du Code de procédure civil prévoit que, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort.
Il ressort de cette disposition que la juridiction compétente pour connaître d’une action en pétition d’hérédité n’est autre que celle du lieu d’ouverture de la succession.
Bien que claire en apparence, la règle énoncée par l’article 45 du CPC soulève deux difficultés :
- Première difficulté
- Le texte précise que l’attribution de compétence à la juridiction du lieu d’ouverture de la succession ne joue que « jusqu’au partage inclusivement ».
- Est-ce à dire lorsqu’une action en pétition d’hérédité est exercée postérieurement au partage, elle obéirait à la règle d’attribution de compétence de droit commun ?
- Il est admis unanimement par la doctrine que, quand bien même l’action en pétition d’hérédité aurait été introduite en justice postérieurement au partage, l’article 45 du CPC demeure applicable.
- La raison en est que si l’action en pétition d’hérédité aboutit elle est susceptible de remettre en cause rétroactivement le partage.
- Il y aurait dès lors lieu de faire comme si aucune opération de partage n’était intervenue.
- L’action en pétition d’hérédité pourra ainsi être réputée avoir été exercée par le demandeur avant le partage.
- Seconde difficulté
- Si l’on s’en tient à une lecture littérale de l’article 45 du CPC, il apparaît que la règle d’attribution de compétence à la juridiction du lieu d’ouverture de la succession ne joue que dans trois cas au nombre desquels figurent notamment « les demandes entre héritiers ».
- Autrement dit, selon ce texte, ce n’est que si la qualité de successeur d’un héritier est contestée par l’un de ses cohéritiers que l’article 45 du CPC aurait vocation à s’appliquer.
- Doit-on en déduire que la règle d’attribution de compétence énoncée par cette disposition ne joue plus lorsque l’action en pétition d’hérédité est dirigée contre un tiers détenteur d’un bien du de cujus ?
- À l’analyse, lorsque c’est un tiers qui, sans se prévaloir de la qualité de successeur, détient un bien du de cujus, refuse de remettre ce bien à un héritier ou au légataire, cette situation doit se régler sur le terrain de la preuve non-contentieuse.
- Si malgré la production d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire, d’un certificat d’hérédité ou encore d’un certificat bancaire, le tiers ne défère pas à la demande du successeur, l’action qui devra être engagée n’est autre que l’action en revendication et non l’action en pétition d’hérédité.
B) Prescription de l’action
Sous l’empire du droit antérieur, la question du délai de prescription de l’action en pétition d’hérédité ne soulevait aucune difficulté particulière, dans la mesure où les actions en justice se prescrivaient toutes par 30 ans, sauf disposition contraire.
Or aucun texte ne prévoyant un délai de prescription spécifique pour l’action en pétition d’hérédité ; elle était donc soumise au délai de prescription de droit commun.
La réforme du droit de la prescription opérée par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a quelque peu bouleversé la situation.
En effet, le législateur a introduit des délais de prescription différents selon que l’action en justice exercée est une action réelle ou une action personnelle.
Tandis que dans le premier cas elle se prescrit par 30 ans, dans le second cas elle se prescrit par 5 ans.
Compte tenu de ce que, comme vu précédemment, il existe une véritable incertitude quant à la nature de l’action en pétition d’hérédité, la détermination du délai de prescription applicable à cette action pose question.
L’interrogation est d’autant plus grande que l’option héréditaire se prescrit quant à elle par 10 ans.
Quel délai de prescription dès lors retenir pour l’action en pétition d’hérédité ? Les auteurs sont très partagés sur cette question, à telle enseigne qu’aucune solution doctrinale ne se dégage.
Afin de s’extraire du débat portant sur la nature de l’action en pétition d’hérédité, d’aucuns suggèrent de faire application du délai de 10 ans applicable à l’option héréditaire[4].
Cette solution présenterait notamment l’avantage d’éviter qu’un successeur ne se retrouve prescrit pour faire reconnaître sa qualité d’héritier, alors qu’il est toujours recevable à exercer l’option attachée à cette qualité.
Pour l’heure la question de Cassation ne s’est pas encore prononcée, de sorte que le débat reste ouvert.
C) Parties à l’action
L’action en pétition d’hérédité suppose que deux personnes se disputent la qualité d’héritier et que plus précisément qu’elles s’opposent sur la titularité des droits qu’elles entendent exercer sur la totalité ou sur une quote-part de la succession.
Cette spécificité de l’action en pétition d’hérédité a une incidence directe sur la qualité exigée pour être partie à l’action.
1. Les demandeurs à l’action
Pour être demandeur à l’action en pétition d’hérédité, trois conditions cumulatives doivent être remplies :
🡺Première condition
L’action en pétition d’hérédité ne peut être exercée que par un successeur universel ou à titre universel.
Aussi, est-il indifférent que le demandeur tienne sa qualité de successeur de la loi (héritier ordinaire ou anomal) ou de la volonté du de cujus (légataire).
Ce qui importe c’est qu’il justifie d’une vocation successorale universelle ou à titre universel.
🡺Deuxième condition
Pour être admis à exercer l’action en pétition d’hérédité, le successeur doit avoir préalablement été saisi ou, à défaut, s’être vu délivrer son legs.
Aussi, les conditions d’exercice de l’action en pétition d’hérédité diffèrent selon que l’on est en présence d’un successeur universel ou d’un successeur à titre universel.
- L’exercice de l’action par le successeur universel
- En présence d’un successeur universel, l’action en pétition d’hérédité peut être exercée par ce dernier sans qu’il lui soit besoin d’accomplir des formalités particulières, dans la mesure où, conformément à l’article 724, al. 1er du Code civil il est saisi de plein droit.
- Tel n’est en revanche pas le cas pour le successeur à titre universel.
- L’exercice de l’action par le successeur à titre universel
- Deux situations doivent être distinguées ici :
- La succession ne compte pas d’héritier réservataire
- Dans cette hypothèse, le légataire à titre universel pourra être saisi.
- Il lui faudra toutefois accomplir un certain nombre de formalités.
- Aussi, ce n’est qu’après avoir accompli ces formalités qu’il pourra exercer une action en pétition d’hérédité.
- La succession compte un héritier réservataire
- Dans cette hypothèse, le successeur à titre universel ne pourra pas être saisi.
- Dans ces conditions, il n’aura d’autre choix que d’attendre la délivrance de son legs pour être recevable à agir en pétition d’hérédité.
- La succession ne compte pas d’héritier réservataire
- Deux situations doivent être distinguées ici :
🡺Troisième condition
Il peut être observé que, sous l’empire du droit antérieur, les successeurs de second rang, soit ceux venant aux droits des successeurs universels ou à titre universels étaient admis à exercer l’action en pétition d’hérédité en cas d’inaction du successeur de premier rang (V. en ce sens Cass. civ., 15 déc. 1913).
Selon la doctrine majoritaire, cette faculté semble avoir été remise en cause par la dernière réforme du droit des successions opérée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Ce texte a, en effet, introduit dans le Code civil une disposition conférant aux héritiers subséquents la faculté de sommer l’héritier de premier rang, par acte extrajudiciaire (un exploit de commissaire de justice), de prendre parti, soit de se décider à exercer son droit d’option, ce qui peut notamment impliquer d’exercer une action en pétition d’hérédité.
Compte tenu de ce que les héritiers de second rang disposent désormais de cette faculté, la possibilité d’exercer l’action en pétition d’hérédité en lieu de place de l’héritier de premier rang semble leur être fermée.
Aussi, l’action en pétition d’hérédité est-elle désormais ouverte aux seuls successeurs de premier rang.
2. Les défendeurs à l’action
L’action en pétition d’hérédité ne peut être exercée que contre une personne qui détient un bien relevant de la succession en se prévalant de la qualité de successeur universel ou à titre universel.
Dans le cas contraire, et notamment lorsque le bien est détenu par un ayant cause à titre particulier, seule la voie de l’action en revendication est ouverte au demandeur.
II) Les effets de l’action en pétition d’hérédité
L’action en pétition d’hérédité peut donner lieu à trois issues différentes :
- Première issue : le demandeur à l’action en pétition d’hérédité est totalement débouté de ses prétentions
- Dans cette hypothèse, le défendeur à l’action est confirmé dans sa qualité d’héritier et la dévolution successorale établie demeure.
- Le demandeur ne peut dès lors plus faire valoir aucune vocation successorale.
- Deuxième issue : il est fait droit à la demande de l’auteur de l’action en pétition d’hérédité
- Dans cette hypothèse, le demandeur se voit reconnaître sa qualité d’héritier.
- Le défendeur perd quant à lui toute vocation successorale, de sorte qu’il devient étranger à la succession.
- Troisième issue : il est partiellement fait droit à la demande de l’auteur de l’action en pétition d’hérédité
- Dans cette hypothèse, si le demandeur se voir reconnaître sa qualité d’héritier ; le défendeur est reconnu comme cohéritier ou colégataire.
- Il en résulte une redéfinition du périmètre des droits de l’un et l’autre sur la succession.
Nous nous focaliserons ici sur la deuxième et la troisième issue de l’action en pétition d’hérédité qui sont les seules à affecter la situation existante, tant entre les parties, qu’à l’égard des tiers.
A) Les effets entre les parties
Lorsqu’il est fait droit à la demande formulée par le demandeur à l’action en pétition d’hérédité celui-ci se voit reconnaître la qualité de successeur légal ou testamentaire.
De son côté, le défendeur devra restituer au demandeur, selon que sa qualité d’héritier est totalement ou partiellement remise cause (s’il est déclaré cohéritier), tout ou partie des biens qui se trouvaient en sa possession.
S’agissant des opérations de restitution, elles obéissent aux règles de droit commun énoncées aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
Aussi, les modalités des restitutions dépendent de la nature de la chose à restituer :
- S’il s’agit d’une chose autre qu’une somme d’argent, elle devra être restituée en nature, sauf à ce que cette restitution soit impossible auquel cas elle se fera en valeur (art. 1352 C. civ.)
- Si la chose à restituer consiste en une somme d’argent, alors elle sa restitution sera augmentée des intérêts au taux légal et éventuellement des taxes afférentes.
Concernant l’étendue des restitutions, il y a lieu de distinguer selon que le défendeur qui a succombé à l’action en pétition d’hérédité est de bonne ou de mauvaise foi.
- Le défendeur à l’action est de bonne foi
- D’une part, il sera dispensé de restituer les fruits qu’il a perçus jusqu’au jour de la demande (art. 1352-7 art. C. civ.)
- D’autre part, il ne répondra pas des dégradations et détériorations subies par la chose à restituer (art. 1352-1 art. C. civ.)
- Enfin, s’il a vendu la chose il n’est tenu que de restituer le prix de la vente (art. 1352-2 al. 1er art. C. Civ.)
- Le défendeur à l’action est de mauvaise foi
- D’une part, il devra restituer tous les fruits qu’il a perçus ou, s’il les a consommés, leur valeur estimée à la date du remboursement (art. 1352-7 art. C. civ.)
- D’autre part, il devra répondre des dégradations et détériorations subies par la chose à restituer (art. 1352-1 art. C. civ.)
- Enfin, s’il a vendu la chose il en devra la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix (art. 1352-2 al. 2e art. C. Civ.)
Par ailleurs, l’article 1352-5 du Code civil prévoit que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. »
Ainsi, toutes les dépenses qui ont été exposées par le défendeur à l’action en pétition d’hérédité pour conserver ou pour améliorer à la chose, ce que l’on appelle les impenses, donnent lieu à restitution.
L’évaluation de ces impenses diffère toutefois selon que les dépenses exposées concernent la conservation de la chose ou l’amélioration de la chose.
- Si les dépenses exposées concernent la conservation de la chose, alors elles devront être intégralement supportées par le demandeur à l’action en pétition d’hérédité.
- Si, en revanche, les dépenses exposées concernent l’amélioration de la chose, alors elles ne devront être supportées que dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution
B) Les effets à l’égard des tiers
La question qui ici se pose est de savoir quel sort réserver aux actes accomplis par le défendeur à l’action en pétition d’hérédité.
En application du principe nemo plus juris (nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a), tous les actes accomplis par ce dernier devraient être anéantis rétroactivement.
Reste que cette règle n’est pas sans porter atteinte à la sécurité juridique puisque l’annulation d’un acte est susceptible de remettre en cause nombre de situations juridiques constituées dans le lignage de cet acte.
Cette situation est d’autant plus injuste lorsque le tiers est de bonne foi, soit lorsqu’il ignorait la cause de nullité qui affectait l’acte initial.
C’est la raison pour laquelle, de nombreux correctifs ont été institués pour atténuer l’effet de la nullité d’un acte à l’égard des tiers :
- La possession mobilière de bonne foi
- Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
- Lorsqu’il est de bonne foi, le possesseur d’un bien meuble est considéré comme le propriétaire de la chose par le simple effet de la possession.
- Dans notre exemple, C est présumé être le propriétaire du bien qui lui a été vendu par B, quand bien même le contrat conclu entre ce dernier et A est nul.
- La prescription acquisitive immobilière
- Après l’écoulement d’un certain temps, le possesseur d’un immeuble est considéré comme son propriétaire
- Son droit de propriété est alors insusceptible d’être atteinte par la nullité du contrat
- Le délai de prescription est de 10 pour le possesseur de bonne foi et de trente ans lorsqu’il est de mauvaise foi (art. 2272 C. civ.)
- Il peut être observé que l’article 2274 prévoit que, en matière de prescription acquisitive, « la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. »
- La théorie de l’apparence
- Très tôt, il a été admis en jurisprudence que les actes accomplis par une personne qui, aux yeux des tiers revêtait l’apparence du successeur du de cujus, devaient être regardés comme valables.
- Dans un arrêt du 26 janvier 1897, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « dès que l’erreur commune et invincible ainsi que la bonne foi des tiers sont établies, les aliénations consenties par l’héritier apparent échappent à toute action en résolution dirigée par l’héritier véritable » (Cass. civ. 26 janv. 1897).
- La haute juridiction faisait ainsi application ici de ce que l’on appelle la théorie de l’apparence.
- Cette théorie vise à protéger les tiers de bonne foi qui ont agi en se fiant à l’apparence de la réalité, même si cette apparence est ultérieurement remise en cause.
- Appliquée au cas où l’action en pétition d’hérédité prospérerait, la théorie de l’apparence a pour effet d’obliger le demandeur à l’action d’être tenu par les actes accomplis par le successeur apparent.
- Pour qu’un tiers puisse se prévaloir de la théorie de l’apparence, encore faut-il qu’un certain nombre de conditions soient réunies :
- Première condition
- Le tiers doit être de bonne foi, soit doit avoir cru contracter avec le véritable successeur.
- Deuxième condition
- La méprise commise par le tiers sur la qualité du successeur apparent doit être « commune et invincible », c’est-à-dire être très difficile à éviter.
- À l’analyse, la jurisprudence se livre à une application stricte de cette exigence.
- Aussi, refusera-t-elle de faire application de la théorie de l’apparence si l’erreur commise par le tiers, qui peut être de fait ou de droit, est seulement légitime.
- Pour être admise, l’erreur doit donc être impossible à éviter et être partagée par tous (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 9 janv. 1996, n°93-20.460).
- Tel sera notamment le cas, lorsqu’elle aura été commise sur la foi d’un acte de notoriété, d’un intitulé d’inventaire ou encore d’une attestation notariée immobilière.
- Troisième condition
- L’acte en cause, s’il peut indifféremment s’agir d’un acte d’administration ou de disposition, doit, en toute hypothèse, avoir été accompli à titre onéreux.
- Aucune protection particulière n’est, en effet, reconnue pour les actes à titre gratuit.
- Première condition
- Lorsque ces trois conditions sont remplies, le tiers sera fondé à faire rejeter par voie d’exception les prétentions de l’héritier véritable, de sorte que ses droits sont inattaquables.
- L’héritier véritable quant à lui, s’il est privé du droit d’agir contre le tiers de bonne foi, pourra toujours se retourner contre l’héritier apparent auquel il peut réclamer la restitution en valeur de la chose aliénée.
- M. Grimaldi, Droit des successions, éd. Lexisnexis, 2017, n°554, p. 435. ↑
M. Grimaldi, Droit des successions, éd. Lexisnexis, 2017, n°555, p. 436. ↑
- G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. Puf, 2005 ↑
V. en ce sens F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Les successions, les libéralités, éd. Dalloz, 2014, n° 805, p. 725. ↑