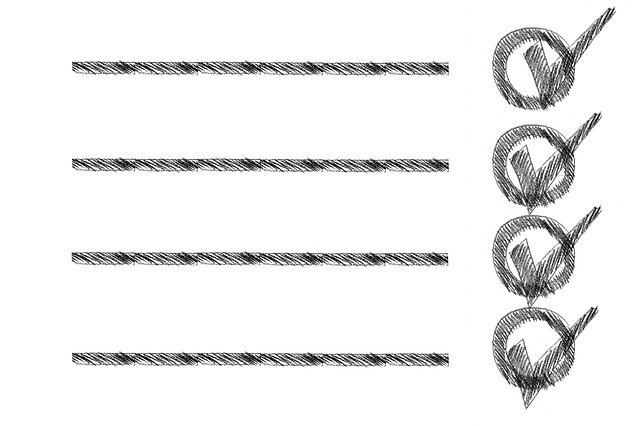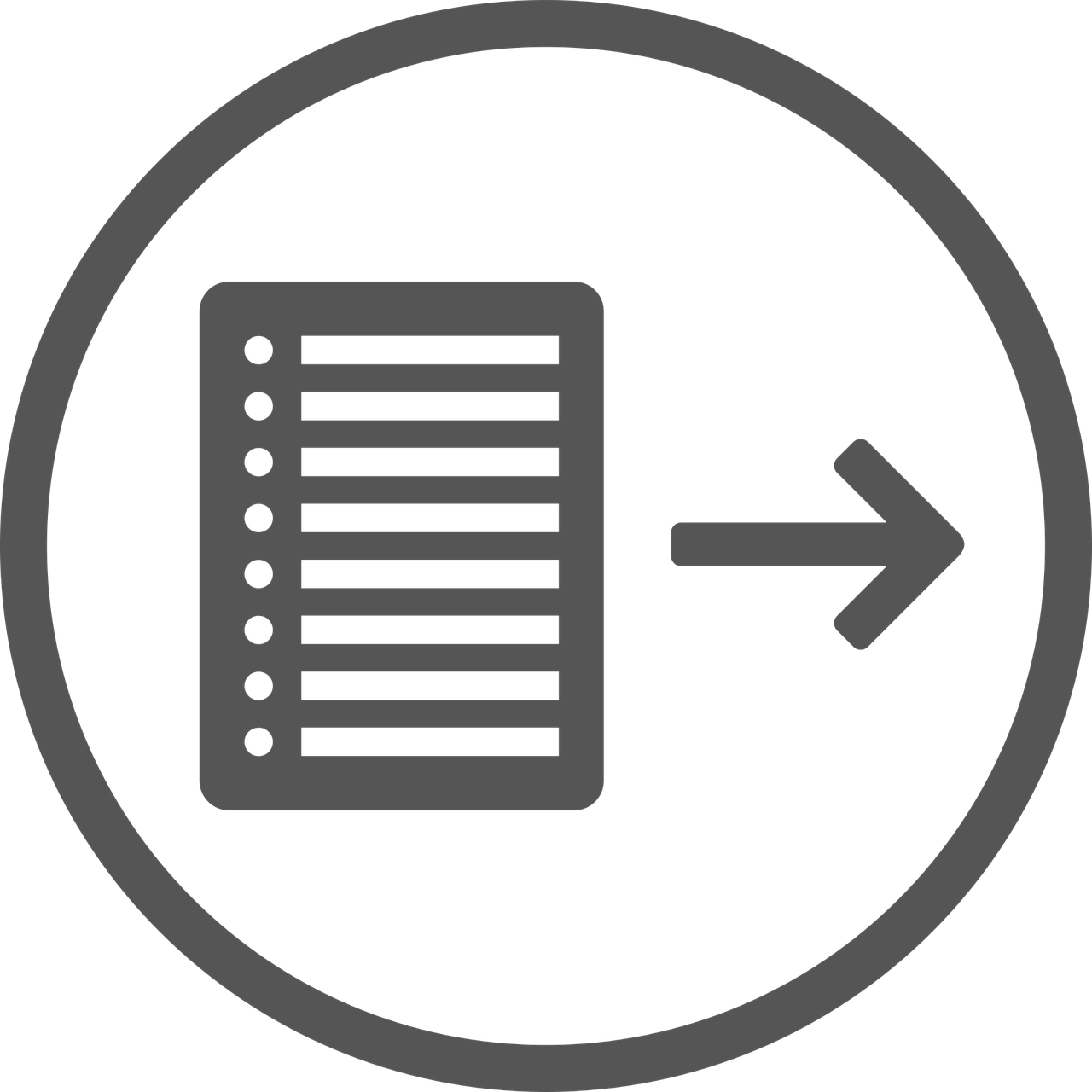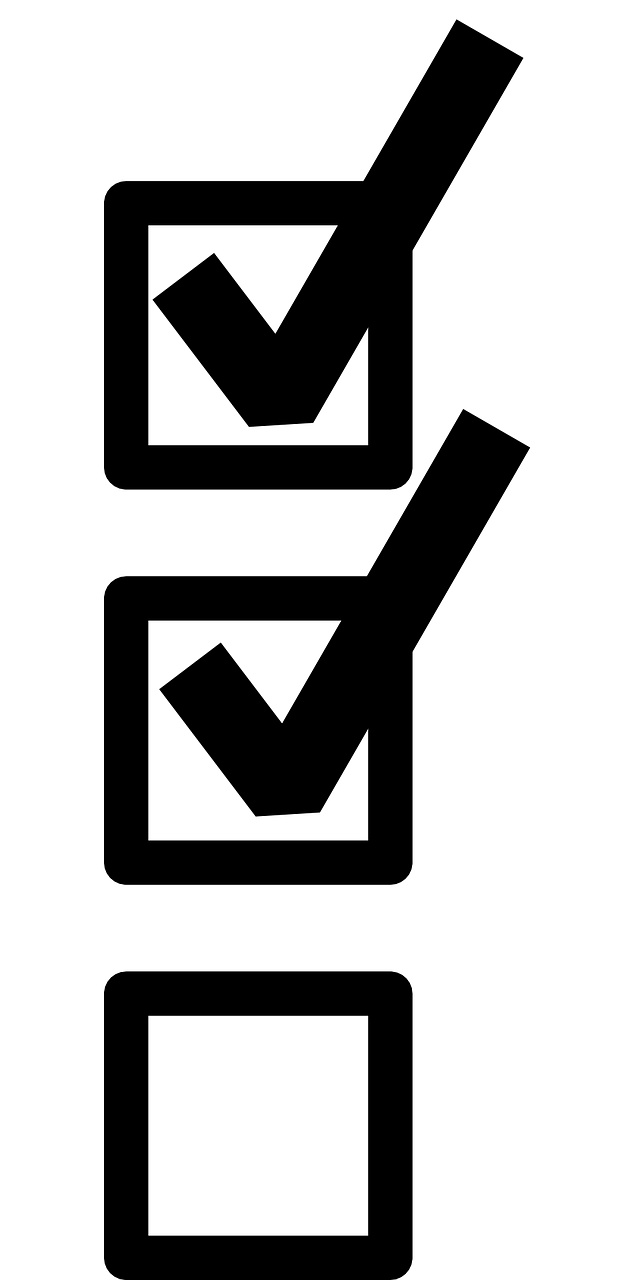En raison notamment de l’activité de l’Union européenne, les dispositions « classiques » du Code civil protégeant l’acheteur (obligation de délivrance et garantie des vices cachés) ont été complétées par deux dispositifs principaux ayant pour objet d’assurer, au sein du marché unique, une protection minimale des personnes en même temps qu’une uniformisation du droit applicable aux opérateurs : la responsabilité du fait des produits défectueux et la garantie de conformité (voy. sur cette 2nde garantie l’article “La vente : La garantie de conformité du vendeur”).
La responsabilité du fait des produits défectueux est née de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, laquelle n’a été transposée en droit français – aux articles 1386-1 et suivants anc. du Code civil (L. n° 98-389, 19 mai 1998) (voy. à présent les articles 1245 à 1245-17 nouv. c.civ.) – qu’après que la France a été condamnée (une première fois) par la Cour de justice des communautés européennes du fait de sa non-transposition (CJCE, 13 févr. 1993, aff. C-293/91).
1.- Le domaine de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux
La responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à tous les biens mis en circulation ou importés à compter du 21 mai 1998. Pour les biens mis en circulation avant cette date, la Cour de cassation (interprétant le droit interne en vigueur à l’époque à la lumière de la directive) retient la responsabilité du fabricant sur le fondement d’une obligation de sécurité.
L’application de la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive d’autres régimes de responsabilité. Pour obtenir la réparation des préjudices couverts par la responsabilité du fait des produits défectueux, la victime ne saurait emprunter une autre voie, telle la garantie des vices cachés (CJCE, 25 avr. 2002, aff. C-52/00, C-154/00 et C-183/00), à moins que le dommage trouve sa source ailleurs que dans la défectuosité du produit.
Il pourrait s’agir par exemple d’un défaut de vigilance du fabriquant. Le contentieux du médicament est typique à cet égard. Un médicament renferme intrinsèquement une certaine dangerosité. Il faut bien voir que sans effet secondaire, on considère volontiers que le médicament est dépourvu d’effet princeps. C’est dire combien les articles 1245 et s. c.civ. sont bien souvent mal calibrés pour garantir la réparation des victimes qui ont fait usage de ces dernières substances. Raison pour laquelle il se pourrait fort que le législateur moderne fasse échapper le contentieux du médicament aux articles précités… L’idée est la suivante : On doit pouvoir soutenir plus justement et utilement qu’un fabricant, qui commercialise un tel produit, se doit d’être des plus vigilants (principe de précaution en santé publique oblige). La vigilance consiste dans le cas particulier à veiller sur ledit produit via des études prospectives sur son effets et/ou des études rétrospectives sur son usage. En bref, on ne saurait faire échapper les laboratoires à une responsabilité alors qu’ont été mis sur le marché des produits susceptibles de se révéler autrement plus dommageables (voire mortifère) que la recherche et le développement ne le laissaient à penser.. Dit autrement, un pareil comportement, qui aura consisté une fois le produit fabriqué et commercialisé à ne pas se préoccuper de ses effets secondaires in futurum, peut valablement être qualifié de fautif).
2.- Les conditions de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux
Le jeu de la responsabilité du fait des produits défectueux est suspendu à la réalisation de conditions tenant aux qualités du bien, à la nature du dommage, au lien de causalité entre la défectuosité du bien et le dommage, et à la personne de la victime. À cette dernière d’établir que ces différentes conditions sont réunies.
La faute du responsable n’est donc pas une condition de la responsabilité : « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative » (art. 1245-9 nouv. c.civ. / art. 1386-10 anc.).
Les qualités du bien
Le bien en cause – le produit – doit, d’abord, être un bien meuble, même incorporé dans un immeuble, « y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche » (art. 1245-2 nouv. c.civ. / art. 1386-3).
Il doit ensuite avoir été destiné à la vente ou à toute forme de distribution (art. 1245-10, 3° in contrario / art. 1386-11 anc.), et avoir fait l’objet d’une mise en circulation (art. 1245-4 ensemble 1245-10, 1° in contrario / art. 1386-5 anc.).
Le produit doit enfin être défectueux. La défectuosité est établie dès lors que le produit « n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » (art. 1245-3, al. 1, nouv. c.civ. / art. 1386-4 anc.). Il s’agit ici :
- soit d’un vice affectant le produit susceptible de causer un dommage aux personnes ;
- soit du défaut d’information ou d’une mauvaise présentation du produit à l’égard de l’utilisateur du bien (voy. par ex. Civ. 1, 4 févr. 2015, n° 12-19.781. A noter que le contentieux de la Dépakine – valproate de sodium plus généralement – est typique).
La nature du dommage
Les biens ayant causé un « dommage qui résulte d’une atteinte à la personne […] ou d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » tombent dans le champ de la responsabilité du fait des produits défectueux pourvu, dans ce dernier cas, que le dommage soit supérieur à 500 euros (art. 1245-1, al. 2 nouv. c.civ. / art. 1386-2). Sont donc exclus du champ de la réparation les dommages causés à la chose elle-même (Civ. 1, 9 juill. 2003, n° 00-21.163, Bull. civ. I, 173), ainsi que les dommages économiques ou moraux procédant de l’impossibilité d’user de la chose.
La personne de la victime
Toute personne qui en est la victime peut se prévaloir de la responsabilité du fait des produits défectueux, peu importe qu’elle soit liée ou non par un contrat au responsable (art. 1245 nouv. c.civ. / 1386-1 anc). Si la responsabilité des produits défectueux s’applique à l’occasion de la vente, celle-ci n’est pas son seul domaine d’application.
La preuve
« Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ». Cette règle de l’article 1245-8 nouv. c.civ. (art. 1386-9 anc.) connaît cependant certains tempéraments lorsque le lien de causalité ne peut, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, être établi avec certitude. Les nombreuses affaires auxquelles a donné naissance la vaccination contre l’hépatite B illustrent cette difficulté, qui relève du droit de la responsabilité.
3.- Les effets de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux
Il convient d’identifier le responsable, de mesurer la portée de l’obligation de réparation qui lui incombe et de définir les conditions d’exercice de l’action.
Le responsable
L’article 1245 nouv. c.civ. (art. 1386-1 anc.) désigne comme premier responsable le « producteur », entendu comme celui qui, agissant à titre professionnel, est « le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première [ou] le fabriquant d’une partie composante » (art. 1245-5 nouv. c.civ. / 1386-6 anc.). Est notamment assimilé au producteur, l’importateur d’un produit en vue de sa distribution. Il faut comprendre de ces dispositions que, sauf tempérament, le distributeur (par ex. le vendeur) n’est pas tenu au titre de la responsabilité des produits défectueux.
En revanche, « si le producteur ne peut pas être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou loueur assimilable au crédit-bailleur (art. 1245-6 nouv. c.civ.), est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur » (art. préc. / art. 1386-7 anc.).
Enfin, « en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables » (art. 1245-7 nouv. c.civ. / art. 1386-8 anc.).
La portée de la responsabilité
Le responsable est tenu des dommages causés aux personnes et, sous réserve du seuil de 500 euros, des dommages causés aux autres choses.
Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il n’a pas commis de faute (art. 1245-9 nouv. c.civ. / art. 1386-10 anc.).
Cependant, il peut valablement invoquer :
- soit le fait que les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies (absence de mise en circulation, absence de défaut au moment de la mise en circulation, absence de défaut lorsque le défaut allégué est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire) ;
- soit le fait que le dommage est le fruit d’un risque de développement, c’est-à-dire que « l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où [le produit] a été mis en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut » (art. 1245-10, al. 4° / art. 1386-11 anc.). Cette cause d’exonération est cependant exclue lorsque la chose qui a causé le dommage est un élément ou un produit du corps humain (art. 1245-11 nouv. c.civ. / art. 1386-12, C. civ.).
Quant au montant de la réparation, il varie selon les circonstances :
- d’abord, si le dommage est survenu à raison simultanément du défaut affectant la chose et de la faute de la victime, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée (art. 1245-12 nouv. c.civ. / art. 1386-13 anc.). Il n’en va pas de même si c’est le fait d’un tiers qui a concouru à la réalisation du dommage (art. 1245-13 nouv. c.civ. / art. 1386-14 anc.) ;
- ensuite, les clauses limitatives de responsabilité sont en principe réputées non écrites (art. 1245-14, al. 1, nouv. c.civ. / art. 1386-15 anc.), bien qu’elles soient tolérées, entre professionnels uniquement, lorsqu’elles ne visent que les « dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée» (art. 1245-14, al. 2, nouv. c.civ. / art. 1386-15).
Les conditions d’exercice de l’action
L’exercice de l’action est encadré par deux délais distincts :
- d’abord, l’action est soumise à un délai de prescription de 3 années courant à compter du jour où la victime a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du dommage, du défaut et de l’identité du producteur (art. 1245-16 nouv. c.civ. / art. 1386-17 anc.) ;
- ensuite, et en tout état de cause, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci […] est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit» (art. 1245-15 nouv. c.civ. / art. 1386-16 anc.).