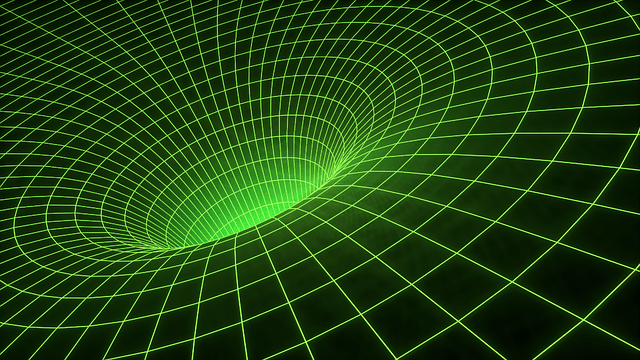Chapitre III – Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité
(articles 1253 à 1257-1)
Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours
Section 1 – Les causes d’exonération de responsabilité
1. Cause d’exonération totale. En prévoyant que, pour être dispensé totalement de la responsabilité qui lui incombe, le défendeur doit apporter la preuve que le cas fortuit, le fait, sous-entendu fautif ou non, d’un tiers ou de la victime revêt les caractères de la force majeure, le projet de réforme, à l’article 1253, alinéa 1er, confirme globalement le droit positif et mérite d’être approuvé sur le fond. La force majeure est, en effet, la seule circonstance permettant de démontrer que le défendeur n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. Sur la forme, on notera toutefois qu’aucune référence n’est faite à la cause étrangère dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations alors que cette notion est utile non seulement pour donner une conception unitaire de la force majeure et de l’exonération totale en évitant l’énumération à laquelle procède l’article 1253, alinéa 1er, mais aussi pour mettre en évidence la justification profonde de l’exonération totale de responsabilité, la négation de la causalité. L’absence de la cause étrangère pourrait laisser penser que le fondement de la libération du défendeur a changé. Pour ces raisons, nous proposons d’introduire la notion de cause étrangère dans le texte.
De surcroît, la référence au cas fortuit prête à confusion dans la mesure où en droit privé, il est synonyme de la force majeure. Il serait souhaitable de la supprimer et de viser plutôt le fait de la nature et le fait humain anonyme. Ce retrait a d’ailleurs été opéré par la proposition de loi.
2. Définition de la force majeure. L’article 1253, alinéa 2, du projet de réforme et de la proposition de loi renonce, pour définir la force majeure, au triptyque classique extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité pour lui préférer celui d’incontrôlabilité, inévitabilité et insurmontabilité. Ainsi, la force majeure extracontractuelle coexiste avec la force majeure contractuelle, qui fait l’objet d’une définition autonome (nouvel article 1218, al. 1er), reposant, elle aussi, sur les caractères d’inévitabilité et d’insurmontabilité mais ajoutant, de manière attendue, la condition d’imprévisibilité, qui est de l’essence de la force majeure en matière contractuelle.
L’extériorité disparaît à juste titre des caractères de la force majeure. Elle n’est pas inhérente à celle-ci. En dépit de son absence, on continuera, quoi qu’il en soit, à considérer que le défendeur ne peut pas invoquer, pour s’exonérer, la circonstance que le dommage trouve son origine dans le fait des choses ou des personnes dont il répond.
L’imprévisibilité est chassée en matière extracontractuelle, sans doute parce qu’elle n’est pas une condition autonome de la force majeure mais au mieux un indice de l’inévitabilité. En effet, chaque fois qu’un événement aurait pu être évité par des mesures appropriées, il n’est pas en soi constitutif de la force majeure. De surcroît, il est inique de maintenir la condition d’imprévisibilité lorsque même prévisible, un événement ne peut pas être empêché.
L’irrésistibilité, quant à elle, disparaît seulement d’un point de vue formel puisqu’elle subsiste à travers l’incontrôlabilité, l’inévitabilité (irrésistibilité d’un événement dans sa survenance) et l’insurmontabilité (irrésistibilité de celui-ci dans ses effets). Un événement est qualifié de force majeure lorsqu’il échappe au contrôle du défendeur et qu’il n’aurait pu, lui ou ses conséquences, être empêché. Soit la réalisation d’un événement aurait pu être évitée, et ce n’est pas un événement de force majeure, soit celui-ci était inévitable mais ses effets auraient pu être écartés, et ce n’est pas non plus un événement de force majeure. Il est dès lors tout à fait opportun de recentrer la force majeure sur l’inévitabilité et l’insurmontabilité. Ces deux caractères permettent de vérifier que le comportement du défendeur n’est aucunement à l’origine du dommage et qu’une quelconque responsabilité ne peut subsister. Toutefois, il faudrait prendre garde que l’on ne déduise pas de cette nouvelle définition de la force majeure une évolution quant au fondement de son effet exonératoire. Celui-ci doit rester attaché à l’absence de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage et ne pas être substitué à l’absence de faute du défendeur. La force majeure doit conserver son effet libératoire général, que la responsabilité soit fondée sur la faute ou pas.
Par ailleurs, il nous semble étrange de préciser à l’article 1253, alinéa 2 que lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement du fait d’autrui, la force majeure doit être appréciée par rapport à l’auteur du dommage. Étant donné qu’il s’agit de savoir si la responsabilité du défendeur doit être en définitive engagée, la force majeure doit être exclusivement appréciée par rapport à lui. Il faut ainsi se demander si l’événement susceptible de recevoir la qualification de force majeure a été inévitable et insurmontable pour le civilement responsable. Si l’événement en question est constitutif de la force majeure pour l’auteur du dommage, cela revient simplement à rompre le lien de causalité entre son fait et le dommage de sorte que les conditions de la responsabilité du défendeur ne sont même pas réunies en amont. Pour mémoire, il n’y a lieu de parler d’exonération que lorsque les conditions de la responsabilité du défendeur sont en apparence réunies.
3. Causes d’exonération partielle. Il résulte de l’article 1253 du projet que le cas fortuit et le fait du tiers qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure ne sont pas des causes d’exonération partielle. Même si ces circonstances ont concouru à la survenance du dommage, la responsabilité du défendeur est entière, celui-ci sera condamné au tout (V. pour confirmation pour le fait du tiers, l’article 1265 du projet et l’article 1267 de la proposition de loi). Les solutions actuelles sont en conséquence maintenues sur ce point et s’imposent dans un souci de protection de la victime afin de ne pas lui faire courir le risque d’obtenir moins que l’équivalent monétaire de son dommage lorsqu’elle n’a pas, par son fait, contribué à la réalisation du dommage. Un certain nombre de modifications concernent, en revanche, la faute de la victime.
La nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle oblige à définir autrement la faute de la victime. La réparation du dommage corporel résultant de l’inexécution d’un contrat entrant dans le giron de la responsabilité extracontractuelle, les rédacteurs du projet ont cru bon d’énoncer que le manquement de la victime à ses obligations contractuelles emporte exonération partielle du défendeur (article 1254) et qu’il est opposable aux victimes par ricochet (article 1256). Bien que, dans la logique du projet, cette précision est utile dans la mesure où le manquement contractuel n’est pas toujours constitutif d’une faute (lorsque l’obligation méconnue est de résultat), elle doit, dans notre logique, être supprimée puisque nous ne sommes pas favorables à l’éviction automatique de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel (V. supra nos observations sur l’article 1233 du projet).
L’article 1254 du projet prend également soin de préciser qu’emporte exonération partielle du défendeur la faute commise par une personne dont la victime répond. Cette solution trouve écho dans quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont permis au défendeur d’obtenir une réduction de sa dette de réparation lorsque l’enfant mineur ou le préposé de la victime a concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage. Si l’on estime que l’effet libératoire de la faute de la victime n’est pas une peine privée, on peut, en effet, admettre la solution et la justifier par l’idée que la part de responsabilité incombant à la victime en sa qualité de parent ou de commettant d’un des coauteurs vient en diminution de sa créance de dommages-intérêts. Toutefois, ce n’est pas a priori la conception retenue par le projet. En privant d’effet exonératoire partiel la faute de la victime privée de raison, partant en subordonnant l’exonération à l’exigence de discernement de la victime, l’idée de peine privée est sous-jacente. En conséquence, il n’est pas logique d’opposer à la victime la faute d’une personne dont elle répond. Cette règle est d’ailleurs écartée par la proposition de loi.
Surtout, le projet de réforme contient deux innovations majeures, confortées par la proposition sénatoriale.
D’une part, à l’article 1254, il prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime a un effet exonératoire partiel. Jusqu’à présent, toute faute, même la plus légère, libère pour partie le défendeur. Ce n’est que par exception qu’une faute qualifiée est nécessaire pour produire un tel effet (faute de la victime d’un accident de la circulation non-conductrice, d’un dommage causé par un navire nucléaire). Le projet modifie profondément le droit positif en exigeant une faute lourde lorsque le dommage est corporel.
Plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, il est étrange que la faute qualifiée qui a été choisie soit une faute lourde, celle-ci n’étant pas familière à la responsabilité extracontractuelle. Certes, les manquements contractuels ayant donné naissance à un dommage corporel seront dans le champ de la responsabilité extracontractuelle mais on ne saurait pour autant faire abstraction de la faute extracontractuelle pure. Il serait préférable, comme le proposait l’avant-projet Catala (article 1351), de faire référence à la faute grave, moins connotée responsabilité contractuelle. Ensuite, le principe même de subordonner l’exonération partielle à une faute d’une certaine gravité, quelle que soit la qualification choisie, est gênant si la jurisprudence administrative continue à retenir qu’une faute simple de la victime suffit à exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité. Pour l’heure, les solutions retenues par les juridictions judiciaires et administratives sont similaires s’agissant de la faute de la victime. Il serait regrettable de rompre cette harmonie : il en dépend d’une bonne administration de la justice et d’une égalité de traitement entre les victimes, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la réparation. Il y a peu de chances pour que le juge administratif, soucieux de préserver les deniers publics, fasse évoluer sa position. En conséquence, la solution actuelle doit être maintenue en droit privé.
D’autre part, l’article 1255 du projet dispose que la faute des victimes privées de discernement n’a pas d’effet exonératoire. Cette modification importante doit largement être approuvée à la fois sur la forme et sur le fond. Premièrement, la rédaction est habile, car elle permet de sauvegarder la conception objective de la faute appliquée à l’auteur du dommage. Sans sacrifier la protection des victimes qui pourront toujours rechercher la responsabilité personnelle de l’infans et du dément à l’origine de leur dommage, la réforme met enfin un terme au piège engendré par la logique juridique. La victime privée de raison ne peut pas se voir opposer sa propre faute pour diminuer sa créance de réparation. Secondement, la solution qui règne actuellement, consistant à prononcer un partage de responsabilité en raison de la faute commise par une personne qui n’est pas douée de discernement est non seulement profondément injuste mais aussi infondée dans la mesure où ce partage, opéré le plus souvent en fonction de la gravité de la faute de la victime, est conçu aujourd’hui comme une peine privée. Or, il ne peut y avoir de peine sans conscience du sujet. Il est fortement souhaitable d’y renoncer.
Il est toutefois nécessaire de supprimer le rétablissement du caractère exonératoire de la faute de la victime privée de discernement lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, une telle précision étant superfétatoire dans la mesure où l’article 1253 du projet prévoit déjà l’effet exonératoire total de la force majeure.
Pour finir, il est regrettable que le projet de loi reste silencieux à propos du critère qui doit présider au partage de responsabilité lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage alors qu’il est loin d’être toujours facile aujourd’hui de savoir quels éléments retiennent les juges du fond pour apprécier souverainement la part qui doit être laissée à la charge de la victime. Afin de combler une telle incertitude et surtout, de mettre fin à la grande disparité des solutions (« autant de tribunaux, autant de fractions » comme l’écrivait déjà Savatier au début du XXème siècle), il serait opportun de préciser que le partage de responsabilité doit être déterminé à l’aune de la gravité de la faute de la victime dans la mesure où l’avant-projet conçoit, semble-t-il, l’effet libératoire partiel de la faute de la victime comme une peine privée (V. supra nos observations sur l’article 1255).
Section 2 – Les causes d’exclusion de responsabilité
1. Faits justificatifs. À l’article 1257 du projet, sont énoncés ce qu’on appelle communément les faits justificatifs, à savoir des circonstances qui sont de nature à effacer la faute commise.
Plusieurs remarques peuvent être faites. Tout d’abord, il aurait été plus pertinent de placer ce texte après l’article 1242 qui définit la faute, car les circonstances visées n’ont lieu de jouer que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Ensuite, il est opportun que le projet ait renoncé à dresser une liste, au demeurant incomplète dans la version précédente, des faits justificatifs et qu’il ait choisi de renvoyer aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal. Il faudrait préciser que ces circonstances sont appréciées dans les conditions posées par le Code pénal qui en fixe très précisément le régime. La proposition de loi a renoncé à ce choix en préférant donner une liste des faits justificatifs.
2. Consentement de la victime. L’article 1257-1 consacre des dispositions au consentement de la victime et reprend à l’identique la proposition contenue dans le projet Terré. Il laisse au juge une assez grande latitude puisqu’il ne cherche pas à identifier les droits ou les intérêts dont les titulaires ont la libre disposition et ceux auxquels ils ne peuvent renoncer. Il serait opportun, malgré tout, de préciser que le consentement de la victime est sans effet en cas de dommage corporel dans la mesure où l’avant-projet, dans son ensemble, met en évidence le sort particulier réservé au dommage corporel. La proposition de loi, quant à elle, ne fait plus référence au consentement de la victime.
Propositions de modifications :
Article 1253
Alinéa 1 :
Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. Le défendeur peut s’exonérer totalement uniquement s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers, fait de la victime) présentant les caractères de la force majeure.
Alinéa 2 :
En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées.
Alinéa 3 [sans changement]
Article 1254
Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, La faute de la victime ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont est partiellement exonératoires lorsqu’ils ont elle a contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.
La diminution de l’indemnisation doit être spécialement motivée par référence à la gravité de la faute de la victime.
Article 1255
Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.
Article 1256
La faute de ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est opposable également aux victimes d’un préjudice par ricochet.
Article 1257 Article 1242-1 (à condition de décaler tous les articles)
Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, autorisé par la loi ou la coutume, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur dans les conditions prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.
Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. Le consentement de la victime est sans effet lorsque celle-ci a subi un dommage corporel.
Article 1257-1
A supprimer
Chapitre III – Les causes d’exonération ou d’exclusion de la responsabilité
(articles 1253 à 1257-1)
Observations d’Olivia Robin-Sabard, professeur à l’Université de Tours
Section 1 – Les causes d’exonération de responsabilité
1. Cause d’exonération totale. En prévoyant que, pour être dispensé totalement de la responsabilité qui lui incombe, le défendeur doit apporter la preuve que le cas fortuit, le fait, sous-entendu fautif ou non, d’un tiers ou de la victime revêt les caractères de la force majeure, le projet de réforme, à l’article 1253, alinéa 1er, confirme globalement le droit positif et mérite d’être approuvé sur le fond. La force majeure est, en effet, la seule circonstance permettant de démontrer que le défendeur n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation du dommage. Sur la forme, on notera toutefois qu’aucune référence n’est faite à la cause étrangère dans le prolongement de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations alors que cette notion est utile non seulement pour donner une conception unitaire de la force majeure et de l’exonération totale en évitant l’énumération à laquelle procède l’article 1253, alinéa 1er, mais aussi pour mettre en évidence la justification profonde de l’exonération totale de responsabilité, la négation de la causalité. L’absence de la cause étrangère pourrait laisser penser que le fondement de la libération du défendeur a changé. Pour ces raisons, nous proposons d’introduire la notion de cause étrangère dans le texte.
De surcroît, la référence au cas fortuit prête à confusion dans la mesure où en droit privé, il est synonyme de la force majeure. Il serait souhaitable de la supprimer et de viser plutôt le fait de la nature et le fait humain anonyme. Ce retrait a d’ailleurs été opéré par la proposition de loi.
2. Définition de la force majeure. L’article 1253, alinéa 2, du projet de réforme et de la proposition de loi renonce, pour définir la force majeure, au triptyque classique extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité pour lui préférer celui d’incontrôlabilité, inévitabilité et insurmontabilité. Ainsi, la force majeure extracontractuelle coexiste avec la force majeure contractuelle, qui fait l’objet d’une définition autonome (nouvel article 1218, al. 1er), reposant, elle aussi, sur les caractères d’inévitabilité et d’insurmontabilité mais ajoutant, de manière attendue, la condition d’imprévisibilité, qui est de l’essence de la force majeure en matière contractuelle.
L’extériorité disparaît à juste titre des caractères de la force majeure. Elle n’est pas inhérente à celle-ci. En dépit de son absence, on continuera, quoi qu’il en soit, à considérer que le défendeur ne peut pas invoquer, pour s’exonérer, la circonstance que le dommage trouve son origine dans le fait des choses ou des personnes dont il répond.
L’imprévisibilité est chassée en matière extracontractuelle, sans doute parce qu’elle n’est pas une condition autonome de la force majeure mais au mieux un indice de l’inévitabilité. En effet, chaque fois qu’un événement aurait pu être évité par des mesures appropriées, il n’est pas en soi constitutif de la force majeure. De surcroît, il est inique de maintenir la condition d’imprévisibilité lorsque même prévisible, un événement ne peut pas être empêché.
L’irrésistibilité, quant à elle, disparaît seulement d’un point de vue formel puisqu’elle subsiste à travers l’incontrôlabilité, l’inévitabilité (irrésistibilité d’un événement dans sa survenance) et l’insurmontabilité (irrésistibilité de celui-ci dans ses effets). Un événement est qualifié de force majeure lorsqu’il échappe au contrôle du défendeur et qu’il n’aurait pu, lui ou ses conséquences, être empêché. Soit la réalisation d’un événement aurait pu être évitée, et ce n’est pas un événement de force majeure, soit celui-ci était inévitable mais ses effets auraient pu être écartés, et ce n’est pas non plus un événement de force majeure. Il est dès lors tout à fait opportun de recentrer la force majeure sur l’inévitabilité et l’insurmontabilité. Ces deux caractères permettent de vérifier que le comportement du défendeur n’est aucunement à l’origine du dommage et qu’une quelconque responsabilité ne peut subsister. Toutefois, il faudrait prendre garde que l’on ne déduise pas de cette nouvelle définition de la force majeure une évolution quant au fondement de son effet exonératoire. Celui-ci doit rester attaché à l’absence de causalité entre le comportement du défendeur et le dommage et ne pas être substitué à l’absence de faute du défendeur. La force majeure doit conserver son effet libératoire général, que la responsabilité soit fondée sur la faute ou pas.
Par ailleurs, il nous semble étrange de préciser à l’article 1253, alinéa 2 que lorsque la responsabilité est engagée sur le fondement du fait d’autrui, la force majeure doit être appréciée par rapport à l’auteur du dommage. Étant donné qu’il s’agit de savoir si la responsabilité du défendeur doit être en définitive engagée, la force majeure doit être exclusivement appréciée par rapport à lui. Il faut ainsi se demander si l’événement susceptible de recevoir la qualification de force majeure a été inévitable et insurmontable pour le civilement responsable. Si l’événement en question est constitutif de la force majeure pour l’auteur du dommage, cela revient simplement à rompre le lien de causalité entre son fait et le dommage de sorte que les conditions de la responsabilité du défendeur ne sont même pas réunies en amont. Pour mémoire, il n’y a lieu de parler d’exonération que lorsque les conditions de la responsabilité du défendeur sont en apparence réunies.
3. Causes d’exonération partielle. Il résulte de l’article 1253 du projet que le cas fortuit et le fait du tiers qui ne revêtent pas les caractères de la force majeure ne sont pas des causes d’exonération partielle. Même si ces circonstances ont concouru à la survenance du dommage, la responsabilité du défendeur est entière, celui-ci sera condamné au tout (V. pour confirmation pour le fait du tiers, l’article 1265 du projet et l’article 1267 de la proposition de loi). Les solutions actuelles sont en conséquence maintenues sur ce point et s’imposent dans un souci de protection de la victime afin de ne pas lui faire courir le risque d’obtenir moins que l’équivalent monétaire de son dommage lorsqu’elle n’a pas, par son fait, contribué à la réalisation du dommage. Un certain nombre de modifications concernent, en revanche, la faute de la victime.
La nouvelle délimitation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle oblige à définir autrement la faute de la victime. La réparation du dommage corporel résultant de l’inexécution d’un contrat entrant dans le giron de la responsabilité extracontractuelle, les rédacteurs du projet ont cru bon d’énoncer que le manquement de la victime à ses obligations contractuelles emporte exonération partielle du défendeur (article 1254) et qu’il est opposable aux victimes par ricochet (article 1256). Bien que, dans la logique du projet, cette précision est utile dans la mesure où le manquement contractuel n’est pas toujours constitutif d’une faute (lorsque l’obligation méconnue est de résultat), elle doit, dans notre logique, être supprimée puisque nous ne sommes pas favorables à l’éviction automatique de la responsabilité contractuelle en matière de dommage corporel (V. supra nos observations sur l’article 1233 du projet).
L’article 1254 du projet prend également soin de préciser qu’emporte exonération partielle du défendeur la faute commise par une personne dont la victime répond. Cette solution trouve écho dans quelques arrêts rendus par la Cour de cassation qui ont permis au défendeur d’obtenir une réduction de sa dette de réparation lorsque l’enfant mineur ou le préposé de la victime a concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage. Si l’on estime que l’effet libératoire de la faute de la victime n’est pas une peine privée, on peut, en effet, admettre la solution et la justifier par l’idée que la part de responsabilité incombant à la victime en sa qualité de parent ou de commettant d’un des coauteurs vient en diminution de sa créance de dommages-intérêts. Toutefois, ce n’est pas a priori la conception retenue par le projet. En privant d’effet exonératoire partiel la faute de la victime privée de raison, partant en subordonnant l’exonération à l’exigence de discernement de la victime, l’idée de peine privée est sous-jacente. En conséquence, il n’est pas logique d’opposer à la victime la faute d’une personne dont elle répond. Cette règle est d’ailleurs écartée par la proposition de loi.
Surtout, le projet de réforme contient deux innovations majeures, confortées par la proposition sénatoriale.
D’une part, à l’article 1254, il prévoit qu’en cas de dommage corporel, seule la faute lourde de la victime a un effet exonératoire partiel. Jusqu’à présent, toute faute, même la plus légère, libère pour partie le défendeur. Ce n’est que par exception qu’une faute qualifiée est nécessaire pour produire un tel effet (faute de la victime d’un accident de la circulation non-conductrice, d’un dommage causé par un navire nucléaire). Le projet modifie profondément le droit positif en exigeant une faute lourde lorsque le dommage est corporel.
Plusieurs observations peuvent être faites. Tout d’abord, il est étrange que la faute qualifiée qui a été choisie soit une faute lourde, celle-ci n’étant pas familière à la responsabilité extracontractuelle. Certes, les manquements contractuels ayant donné naissance à un dommage corporel seront dans le champ de la responsabilité extracontractuelle mais on ne saurait pour autant faire abstraction de la faute extracontractuelle pure. Il serait préférable, comme le proposait l’avant-projet Catala (article 1351), de faire référence à la faute grave, moins connotée responsabilité contractuelle. Ensuite, le principe même de subordonner l’exonération partielle à une faute d’une certaine gravité, quelle que soit la qualification choisie, est gênant si la jurisprudence administrative continue à retenir qu’une faute simple de la victime suffit à exonérer partiellement l’administration de sa responsabilité. Pour l’heure, les solutions retenues par les juridictions judiciaires et administratives sont similaires s’agissant de la faute de la victime. Il serait regrettable de rompre cette harmonie : il en dépend d’une bonne administration de la justice et d’une égalité de traitement entre les victimes, quel que soit l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la réparation. Il y a peu de chances pour que le juge administratif, soucieux de préserver les deniers publics, fasse évoluer sa position. En conséquence, la solution actuelle doit être maintenue en droit privé.
D’autre part, l’article 1255 du projet dispose que la faute des victimes privées de discernement n’a pas d’effet exonératoire. Cette modification importante doit largement être approuvée à la fois sur la forme et sur le fond. Premièrement, la rédaction est habile, car elle permet de sauvegarder la conception objective de la faute appliquée à l’auteur du dommage. Sans sacrifier la protection des victimes qui pourront toujours rechercher la responsabilité personnelle de l’infans et du dément à l’origine de leur dommage, la réforme met enfin un terme au piège engendré par la logique juridique. La victime privée de raison ne peut pas se voir opposer sa propre faute pour diminuer sa créance de réparation. Secondement, la solution qui règne actuellement, consistant à prononcer un partage de responsabilité en raison de la faute commise par une personne qui n’est pas douée de discernement est non seulement profondément injuste mais aussi infondée dans la mesure où ce partage, opéré le plus souvent en fonction de la gravité de la faute de la victime, est conçu aujourd’hui comme une peine privée. Or, il ne peut y avoir de peine sans conscience du sujet. Il est fortement souhaitable d’y renoncer.
Il est toutefois nécessaire de supprimer le rétablissement du caractère exonératoire de la faute de la victime privée de discernement lorsqu’elle revêt les caractères de la force majeure, une telle précision étant superfétatoire dans la mesure où l’article 1253 du projet prévoit déjà l’effet exonératoire total de la force majeure.
Pour finir, il est regrettable que le projet de loi reste silencieux à propos du critère qui doit présider au partage de responsabilité lorsque la faute de la victime a concouru à la production du dommage alors qu’il est loin d’être toujours facile aujourd’hui de savoir quels éléments retiennent les juges du fond pour apprécier souverainement la part qui doit être laissée à la charge de la victime. Afin de combler une telle incertitude et surtout, de mettre fin à la grande disparité des solutions (« autant de tribunaux, autant de fractions » comme l’écrivait déjà Savatier au début du XXème siècle), il serait opportun de préciser que le partage de responsabilité doit être déterminé à l’aune de la gravité de la faute de la victime dans la mesure où l’avant-projet conçoit, semble-t-il, l’effet libératoire partiel de la faute de la victime comme une peine privée (V. supra nos observations sur l’article 1255).
Section 2 – Les causes d’exclusion de responsabilité
1. Faits justificatifs. À l’article 1257 du projet, sont énoncés ce qu’on appelle communément les faits justificatifs, à savoir des circonstances qui sont de nature à effacer la faute commise.
Plusieurs remarques peuvent être faites. Tout d’abord, il aurait été plus pertinent de placer ce texte après l’article 1242 qui définit la faute, car les circonstances visées n’ont lieu de jouer que dans le cadre d’une responsabilité pour faute. Ensuite, il est opportun que le projet ait renoncé à dresser une liste, au demeurant incomplète dans la version précédente, des faits justificatifs et qu’il ait choisi de renvoyer aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal. Il faudrait préciser que ces circonstances sont appréciées dans les conditions posées par le Code pénal qui en fixe très précisément le régime. La proposition de loi a renoncé à ce choix en préférant donner une liste des faits justificatifs.
2. Consentement de la victime. L’article 1257-1 consacre des dispositions au consentement de la victime et reprend à l’identique la proposition contenue dans le projet Terré. Il laisse au juge une assez grande latitude puisqu’il ne cherche pas à identifier les droits ou les intérêts dont les titulaires ont la libre disposition et ceux auxquels ils ne peuvent renoncer. Il serait opportun, malgré tout, de préciser que le consentement de la victime est sans effet en cas de dommage corporel dans la mesure où l’avant-projet, dans son ensemble, met en évidence le sort particulier réservé au dommage corporel. La proposition de loi, quant à elle, ne fait plus référence au consentement de la victime.
èPropositions de modifications :
Article 1253
Alinéa 1 :
Le cas fortuit, le fait du tiers ou de la victime sont totalement exonératoires s’ils revêtent les caractères de la force majeure. Le défendeur peut s’exonérer totalement uniquement s’il apporte la preuve d’une cause étrangère (fait de la nature, fait humain anonyme, fait du tiers, fait de la victime) présentant les caractères de la force majeure.
Alinéa 2 :
En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement dont le défendeur ou la personne dont il doit répondre ne pouvait éviter la réalisation ou les conséquences par des mesures appropriées.
Alinéa 3 [sans changement]
Article 1254
Le manquement de la victime à ses obligations contractuelles, La faute de la victime ou celle d’une personne dont elle doit répondre sont est partiellement exonératoires lorsqu’ils ont elle a contribué à la réalisation du dommage. En cas de dommage corporel, seule une faute lourde peut entraîner l’exonération partielle.
La diminution de l’indemnisation doit être spécialement motivée par référence à la gravité de la faute de la victime.
Article 1255
Sauf si elle revêt les caractères de la force majeure La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire.
Article 1256
La faute de ou l’inexécution contractuelle opposable à la victime directe l’est opposable également aux victimes d’un préjudice par ricochet.
Article 1257 Article 1242-1 (à condition de décaler tous les articles)
Le fait dommageable ne donne pas lieu à responsabilité pour faute lorsqu’il était prescrit par des dispositions législatives ou réglementaires, autorisé par la loi ou la coutume, imposé par l’autorité légitime ou commandé par la nécessité de la légitime défense ou de la sauvegarde d’un intérêt supérieur dans les conditions prévues aux articles 122-4 à 122-7 du Code pénal.
Ne donne pas non plus lieu à responsabilité le fait dommageable portant atteinte à un droit ou à un intérêt dont la victime pouvait disposer, si celle-ci y a consenti. Le consentement de la victime est sans effet lorsque celle-ci a subi un dommage corporel.
Article 1257-1
A supprimer