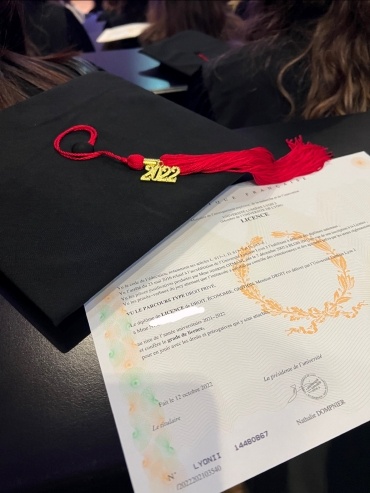Très tôt, l’écriture est apparue comme un formidable moyen pour l’Homme de fixer sur des supports les plus divers (tablettes de pierre, papyrus, parchemins etc.) les récits de son vécu.
Assez paradoxalement, ce n’est à partir du XVIe siècle que les juristes lui ont accordé une place prépondérante dans le système probatoire.
Si une hiérarchie des modes de preuve relativement sophistiquée avait été établie dans l’ancien droit, la preuve par écrit a occupé pendant longtemps un rang bien inférieur à celui conféré aux preuves irrationnelles telles que les ordalies, le duel judiciaire ou encore le serment.
Ce n’est qu’à partir de l’ordonnance de Villers-Cotterêts édictée en août 1539 par François 1er que l’écrit a commencé à supplanter les autres modes de preuve.
Domat justifiait la primauté de la preuve littérale en avançant que « la force des preuves par écrit consiste en ce que les hommes sont convenus de conserver par l’écriture le souvenir des choses qui se sont passées et dont ils ont voulu faire subsister la mémoire, pour s’en faire des règles, ou avoir la preuve perpétuelle de la vérité de ce que l’on a écrit ».
Ainsi poursuit-il « on écrit les conventions pour conserver la mémoire de ce qu’on s’est prescrit en contractant et pour se faire une loi fixe et immuable de ce qui a été convenu ».
==> L’absence de définition de l’écrit dans le Code civil de 1804
Cette place réservée à la preuve par écrit à compter du XVIe siècle a été reconduite par les rédacteurs du Code civil en 1804.
Curieusement, ces derniers n’avaient toutefois pas jugé utile de définir ce que l’on devait entendre par écrit.
Tout au plus, l’ancien article 1359 du Code civil prévoyait que « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre ».
Cette disposition définissait donc le domaine de la preuve littérale sans pour autant préciser le sens de la notion.
Pour certains auteurs, ce silence trahit l’état d’esprit dans lequel se trouvait le législateur en 1804 qui ne concevait pas que l’on puisse dissocier l’écrit de son support.
La preuve littérale ou preuve par écrit n’a pas été définie tant il était évident, à l’époque, que l’adjectif littéral désignait « une écriture apposée en signes lisibles sur un support tangible ».
Pour les promoteurs du Code napoléonien, l’écrit faisait nécessairement qu’un avec le support destiné à le recevoir, en l’occurrence pour les actes juridiques, le papier. Or le papier est une notion qui ne requiert pas qu’on la définisse ; sa signification relève de l’évidence.
L’absence de définition de la preuve littérale dans le Code civil ne soulevait aucune difficulté tant que les actes juridiques étaient dressés sur des supports papiers.
L’apparition des nouvelles technologies de l’information et de la communication a toutefois complètement bouleversé la conception que l’on se faisait de l’écrit.
La possibilité offerte aux opérateurs économiques de conclure et d’exécuter des opérations par voie dématérialisée a contraint les juristes et les pouvoirs publics à réfléchir à l’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information.
Dès la fin du XXe siècle une partie de la doctrine a plaidé pour interprétation souple des textes alors en vigueur.
Ces derniers n’en demeuraient pas moins inadaptés aux actes conclus par voie électronique.
Comme relevé par le Conseil d’État, dans son rapport intitulé « Internet et les réseaux » publié le 2 juillet 1998, « la notion d’original n’a pas de sens s’agissant d’un message numérique et il serait dangereux de considérer comme satisfaisant à l’obligation d’une signature un procédé dont la loi n’aurait pas fixé les conditions de validité ».
Cela n’a toutefois pas empêché la Chambre commerciale de la Cour de cassation de construire une jurisprudence tendant vers une assimilation des documents électroniques offrant certaines garanties à un écrit.
Dans un arrêt remarqué du 2 décembre 1997, elle a ainsi jugé que « l’écrit constituant, aux termes de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1981, l’acte d’acceptation de la cession ou de nantissement d’une créance professionnelle, peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées » (Cass. com. 2 déc. 1997, n°95-251).
Pour la Chambre commerciale, c’est donc aux juges du fond qu’il revenait d’analyser les circonstances dans lesquelles avait été émis l’écrit pour établir s’il pouvait ou non être retenu comme établissant la preuve d’un acte.
Cette position n’a pas été partagée par toutes les chambres de la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 14 février 1995, la Première chambre civile a, par exemple, estimé qu’une photocopie ne pouvait pas être assimilée à un écrit et ne pouvait dès lors valoir que commencement de preuve par écrit (Cass. 1ère civ. 14 févr. 1995, n°92-17.061).
Si le droit en vigueur autorisait à prendre en compte les documents électroniques au titre des exceptions prévues par la loi à l’exigence de preuve littérale, la doctrine s’accordait à dire qu’il ne permettait pas, en revanche, de leur reconnaître la même valeur probatoire qu’un écrit.
D’où l’appel du Conseil d’État émis dans son rapport de 1998 à procéder à « une reconnaissance rapide de la valeur juridique du document électronique [qui] s’impose et rend nécessaire une adaptation du Code civil ».
==> L’impulsion du droit communautaire
La première autorité à s’être saisie du sujet n’est autre que la Commission européenne qui, dès 1994, a émis une recommandation relative aux aspects juridiques de l’échange de données informatisées.
L’échange de données informatisées (EDI) est le transfert électronique, d’un ordinateur à un autre, de données commerciales et administratives sous la forme d’un message EDI structuré conformément à une norme agréée.
La recommandation adoptée par la Commission européenne visait à généraliser l’usage de l’« accord type européen pour l’EDI » dans les relations commerciales entre acteurs économiques et organisations de l’Union européenne.
En application de l’article 4 de cette recommandation, dans la mesure où les lois nationales le permettent, les parties s’engagent à accepter, en cas de litige, que les enregistrements des messages EDI qui ont été conservés conformément aux dispositions de cet accord soient admissibles devant les tribunaux et fassent preuve des faits qu’ils contiennent, à moins qu’une preuve contraire ne soit présentée.
Manifestement, cet accord type européen sur les EDI préfigurait l’adoption notamment de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.
Cette directive prévoit notamment à son article 9 que « les États membres veillent à ce que leur système juridique rende possible la conclusion des contrats par voie électronique. »
Le texte poursuit en disposant que « les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l’utilisation des contrats électroniques ni ne conduise à priver d’effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu’ils sont passés par voie électronique. »
L’un des éléments marquants de cette directive est qu’elle ne limitait pas à prescrire aux États membres de reconnaître les contrats électroniques selon les modalités qu’ils jugeraient utile d’adopter. Bien au contraire, elle leur imposait de garantir aux contrats électroniques « effet et validité juridique ».
À cet égard, un an plus tôt, soit le 13 décembre 1999, le Parlement européen et le Conseil avaient adopté la directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.
L’objectif de cette directive était de faciliter l’utilisation des signatures électroniques et de contribuer à leur reconnaissance juridique.
À cette fin, l’article 5 du texte prévoyait notamment que les États membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées fondées sur un ” certificat qualifié ” et créées par un dispositif sécurisé de création de signature :
- D’une part, répondent aux exigences légales d’une signature à l’égard de données électroniques de la même manière qu’une signature manuscrite répond à ces exigences à l’égard de données manuscrites ou imprimées sur papier ; c’est le principe de non-discrimination
- D’autre part, soient recevables comme preuves en justice
L’adoption des directives relatives au commerce électronique et à la signature électroniques par les instances européennes a eu pour effet de contraindre les États membres de l’Union européenne à faire évoluer leur droit interne.
==> Les travaux conduits en France
C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a rendu le 2 juillet 1998 un rapport intitulé « Internet et les réseaux ».
L’un des chapitres de ce rapport est consacré à « la reconnaissance de la valeur juridique du document et de la signature électroniques ».
Le Conseil d’État relève d’abord que, sans assimiler de manière générale un message électronique à un écrit, le législateur a déjà admis qu’un tel message tienne lieu d’écrit dans des domaines particuliers afin de simplifier et d’accélérer les formalités administratives et notamment fiscales.
Il souligne ensuite que, en 1998, de nombreux pays, tels que le Québec, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore l’Italie ont d’ores et déjà reconnu la valeur probante des écrits électroniques.
Cette reconnaissance de la validité de l’écrit électronique a par ailleurs été affirmée à la même époque par plusieurs organismes internationaux :
- La Commission des Nations unies pour le droit commercial international incitait les États à « lever les obstacles à l’admissibilité des messages électroniques comme mode de preuve, dont témoigne l’adoption d’une loi type sur le commerce électronique en 1996. »
- La Commission européenne qui, dans sa communication du 8 octobre 1997 intitulée « assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique», s’est exprimée sur la nécessité d’une adaptation des législations nationales visant la reconnaissance de la valeur juridique d’un document électronique signé.
Pour le Conseil d’État, il ressort de ces différentes initiatives, « qu’une reconnaissance rapide de la valeur juridique du document électronique s’impose et rend nécessaire une adaptation du Code civil ».
À cette fin, il formule dans son rapport cinq propositions de modification du droit en vigueur en 1998 :
- Admettre qu’une signature électronique remplisse les fonctions d’une signature dès lors qu’elle est fiable
- Lorsqu’un document électronique assorti d’une signature électronique est présenté pour établir la preuve d’un acte, il ne saurait être contesté au seul motif qu’il se présente sous forme électronique
- Un document électronique devrait pouvoir tenir lieu d’acte sous signature privée dès lors qu’il est assorti d’une signature fiable et qu’il est conservé avec celle-ci de façon durable
- Dès lors qu’un document électronique est accompagné d’un certificat répondant à certaines exigences, délivré par une autorité de certification accréditée, la fiabilité de la signature et la conservation durable du document signé (si le certificat a aussi cet objet) devraient être présumées.
- Dans le cas inverse, il doit appartenir à celui qui entend se prévaloir d’un document électronique signé mais non certifié de démontrer que les conditions de fiabilité et de conservation sont remplies.
En parallèle de ces travaux menés par le Conseil d’État, la mission de recherche « Droit et Justice », constituée sous forme de groupement d’intérêt public (GIP), a constitué un comité d’experts sur le thème de « L’écrit et les nouveaux moyens technologiques au regard du droit ».
Les réflexions menées par ce comité d’experts ont donné lieu à la publication d’un projet de texte de loi en septembre 1997.
Trois propositions figurant dans ce projet de texte retiennent particulièrement l’attention :
- Première proposition
- Le comité d’experts a souligné que la préconstitution de preuve devait être conservée parce qu’elle garantit l’égalité des parties devant le risque de la preuve et parce que c’est le système dont la légitimité s’impose le plus facilement au juge
- Deuxième proposition
- Le rapport proposait une définition de la preuve par écrit qui ne dépendait ni du support utilisé, ni des modalités du transfert.
- Troisième proposition
- Le comité d’expert a proposé de reconnaître explicitement le statut des écrits électroniques comme mode de preuve, à condition que soit dûment identifiée la personne dont émane le document électronique et que celui-ci ait été établi et soit conservé de manière fiable.
Des auteurs ont dit de ce projet de texte qu’il était parvenu à concilier « une indispensable modernité avec la nécessité d’une intégration harmonieuse dans le Code Napoléon »[1].
Approuvé par la Chancellerie, il est devenu, en octobre 1998, un avant-projet de loi « relatif à l’adaptation du droit de la preuve aux nouvelles technologies ».
Après avoir été soumis à des consultations publiques, puis à l’examen du Conseil d’État, l’avant-projet de loi élaboré sous l’impulsion du Ministère de la justice a été présenté, comme projet de loi, en Conseil des ministres le 1er septembre 1999 puis déposé au bureau du Sénat pour examen mise en œuvre de la procédure législative.
Cette procédure donnera lieu à l’adoption de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
==> Assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier
Il faut donc attendre la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 pour que soit enfin consacrée l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier.
Cette loi a introduit un article 1316-1 dans le Code civil qui prévoyait que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’écrit électronique se voyait ainsi reconnaître la même valeur probatoire que l’écrit papier.
La France est le premier pays d’Europe à avoir introduit cette innovation dans son droit. Hors d’Europe, il n’est guère que le Québec pour avoir admis, dès 1991, l’écrit électronique au rang des preuves littérales, tout en autorisant sa contestation par tous moyens.
Bien qu’il s’agisse là d’une avancée majeure en droit français, l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier n’était pas totale.
Elle ne jouait en effet que sur le terrain de la preuve et non pour la validité des actes juridiques.
Pour mémoire, il est certains actes dont la validité est subordonnée à l’établissement d’un écrit à peine de nullité.
Tel est le cas, par exemple, des actes portant donation entre vifs, dont le code civil (art. 931 C. civ.) exige qu’ils soient passés devant notaire et qu’il en reste « minute, sous peine de nullité ». Dans cette hypothèse, l’exigence de l’écrit comme condition de la validité de l’acte découle de l’obligation d’en dresser et d’en conserver une minute.
Citons par ailleurs le chèque (loi du 14 juin 1865), les conventions collectives de travail (art. L. 132-2 C. trav.), le contrat de construction d’une maison individuelle (art. L. 231-1 C. constr.) ou encore la licence de brevet d’invention (loi n° 68-1 du 2 janvier 1968).
Dans tous les cas, il s’agit de protéger la volonté de l’une des parties ou, à tout le moins, de ralentir et alourdir la procédure pour prévenir la précipitation et favoriser la réflexion.
On dit alors pour ces actes que l’écrit est exigé ad validitatem ou ad solemnitatem.
Lorsqu’elle est instituée par le législateur, cette exigence vise le plus souvent à assurer la protection des contractants et notamment de la partie la plus faible.
À cet égard, lorsqu’un écrit est exigé ad validitatem, la violation de cette exigence est sanctionnée par la nullité de l’acte.
C’est là une différence majeure avec le cas où l’écrit est exigé à titre de preuve, soit ad probationem. En cas de non-respect de cette exigence, l’acte n’est pas nul ; il est seulement présumé n’avoir pas existé.
Consécutivement à l’adoption de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000, un débat est né en doctrine intéressant la portée qu’il y avait lieu de reconnaître à l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier.
Certains auteurs ont effet interprété ce texte comme autorisant les parties à recourir au support électronique, non seulement pour se préconstituer une preuve pour les cas où l’écrit est exigé ad probationem, mais également pour constater un acte pour les cas où l’écrit est exigé ad validitatem.
Les défendeurs de cette thèse voyaient ainsi dans les dispositions de la loi du 13 mars 2000 une assimilation totale de l’écrit électronique à l’écrit papier.
Pour eux, ce texte visait à les mettre sur le même plan, l’écrit électronique valant ainsi, non seulement à titre de preuve, mais également comme condition de validité des actes juridiques.
Tel n’était pourtant pas l’objectif de la loi du 13 mars 2000, comme l’atteste d’ailleurs l’emplacement des articles introduits par cette réforme dans le Code civil, qui complètent les dispositions du chapitre VI du titre III relatif au droit de la preuve.
Toujours est-il que pour mettre un terme au débat et clarifier cet état du droit qui avait soulevé de nombreuses interrogations, le législateur a fait le choix d’intervenir une nouvelle fois aux fins de parachever la réforme entreprise quatre ans plus tôt.
Cette intervention a donné lieu à l’adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ce texte a notamment introduit dans le Code civil des dispositions relatives au contrat électronique précisant ses conditions de validité.
Le nouvel article 1174 prévoit en ce sens que « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369 ».
Désormais, le doute n’est plus permis quant à l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier.
Non, seulement il peut être recouru au support électronique pour se préconstituer une preuve par écrit, mais également pour établir et conserver un acte juridique.
Comme souligné par Michèle Tabarot, rapporteur du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique « l’évolution majeure amorcée avec la reconnaissance de l’écrit électronique au titre de preuve est menée à son terme : l’écrit cesse, dans notre droit, d’être systématiquement associé au support papier. »
L’équivalence entre l’écrit électronique et l’écrit papier est ainsi dorénavant totale. L’écrit électronique peut valoir tant ad probationem qu’ad validitatem.
Nous nous focaliserons dans cette étude sur la seule question du recours électronique à titre de preuve.
==> Droit positif
À l’occasion de l’adoption de l‘ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme de la preuve, le législateur s’est notamment donné pour ambition de clarifier « les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ».
À cette fin, il a tout d’abord repris la définition de la notion de preuve littérale énoncée à l’ancien article 1316 du Code civil en supprimant toute référence aux modalités de transmission, inutiles car étrangères à la substance de l’écrit ainsi défini.
Aussi, le nouvel article 1365 du Code civil ne subordonne l’écrit à aucune condition qui tiendrait à son support ou à ses modalités de transmission.
Désormais, la preuve littérale ne s’identifie plus au papier et peut résulter d’une communication à distance (e-mail, disquette, disque dur, clé USB).
Au fond, comme souligné par des auteurs, l’insertion dans le Code civil d’une définition de l’écrit par la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 « n’a eu d’autre but que de permettre de reconnaître valeur juridique à l’écrit électronique »[2].
À cet égard, la disposition qui suit l’article 1365 du Code civil n’est autre que celle qui place sur un pied d’égalité l’écrit papier et l’écrit électronique.
Cette disposition opère une fusion entre les anciens articles 1316-1 et 1316-3 du Code civil qui reconnaissaient à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier.
Pour mémoire ces articles étaient formulés comme suit :
- L’article 1316-1 prévoyait que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
- L’écrit 1316-3 prévoyait quant à lui que « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »
Compte tenu de ce que ces dispositions exprimaient sensiblement la même chose, il a été décidé de les fusionner en un seul et même texte : l’article 1366.
Cette nouvelle disposition prévoit que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité »
Ce texte proclame ainsi l’équivalence entre l’écrit électronique et l’écrit papier. L’admission de l’écrit électronique à titre de preuve est toutefois subordonnée à l’observation de conditions.
Ce n’est que si ces conditions sont réunies que l’écrit électronique produira les mêmes effets que l’écrit papier.
I) Les conditions d’admission de l’écrit électronique
A) Les conditions tenant à l’établissement de l’écrit
L’article 1366 du Code civil subordonne l’admission de l’écrit électronique à une double condition :
- D’une part, la personne dont il émane doit pouvoir « être dûment identifiée»
- D’autre part, il doit être « établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité»
À l’analyse, il s’agit là d’une consécration d’une décision adoptée par la Cour de cassation le 2 décembre 1997 aux termes de laquelle elle avait énoncé les conditions d’admission d’une télécopie à titre de preuve.
Dans cette décision elle avait notamment jugé que « l’écrit […] peut être établi et conservé sur tout support, y compris par télécopies, dès lors que son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées, ou ne sont pas contestées » (Cass. com. 2 déc. 1997, n°95-14.251).
Jérôme Huet justifie ces exigences en écrivant que « si la valeur probante des documents électronique doit être reconnue, encore faut-il que les risques tenant à leur caractère immatériel, et au fait qu’il est le plus souvent possible de les modifier, soient contrebalancés par des garanties techniques d’où l’on tire la conviction, à propos de tel ou tel acte particulier, qu’il émane bien de celui auquel on l’oppose et qu’il a été conservé dans son contenu original. »[3]
Mais alors, si ces restrictions à l’admissibilité de l’écrit électronique se justifient pour des raisons de sécurité juridique, elles interrogent cependant sur l’existence d’une égalité réelle entre l’écrit papier et l’écrit électronique. Ne serait-ce pas là un mirage ?
En effet, l’écrit papier n’est nullement à l’abri de faire l’objet d’une falsification. Or aucun texte ne conditionne son admissibilité à sa fiabilité.
Si l’écrit électronique possède la même force probante que l’écrit papier, pourquoi le soumettre à des exigences tenant à l’identification de son auteur et à son intégrité ?
À la vérité, l’égale admissibilité de l’écrit électronique et de l’écrit papier est somme toute discutable, sinon fictive.
Les conditions techniques qui doivent être remplies par l’écrit électronique pour être doté de la valeur juridique d’un écrit vont bien au-delà de ce qui est exigé pour l’écrit papier dont l’admissibilité est seulement subordonnée, en simplifiant à l’extrême, à l’apposition d’une signature et à son établissement en autant d’originaux qu’il y a de parties s’il constate une convention synallagmatique.
Aussi, parce que l’écrit électronique est soumis à des conditions de fiabilité qui ne sont pas requises pour l’écrit papier, il y a lieu de considérablement tempérer le principe d’égalité entre ces deux formes d’écrit qui, au fond, s’analyse moins une réalité, qu’en une déclaration d’intention qui confine à la méthode Coué.
Examinons désormais dans le détail les deux conditions énoncées par l’article 1366 du Code civil tenant, d’une part, à l’imputabilité de l’écrit et, d’autre part, à son intégrité.
1. La condition tenant à l’imputabilité de l’écrit
Pour que l’écrit électronique ait la même force probante que l’écrit papier, l’article 1366 du Code civil exige que « puisse être dûment identifiée la personne dont il émane »
Autrement dit, l’écrit doit avoir été établi dans des conditions techniques permettant d’imputer l’opération qu’il constate aux parties qui ont voulu cette opération.
À cet égard cette condition d’imputabilité ne pourra être satisfaite que si l’écrit comporte une signature électronique répondant à l’exigence de fiabilité définie à l’article 1367 du Code civil.
==> Reconnaissance d’une équivalence entre signature électronique et signature manuscrite
Si, conformément à l’article 1367 du Code civil, la signature doit, pour être valable, permettre, d’une part, d’identifier le signataire et, d’autre part, de manifester le consentement de ce dernier à l’acte, il n’est, en revanche, plus exigé qu’elle soit manuscrite, c’est-à-dire qu’elle soit tracée à la main.
L’abandon de cette exigence a d’abord été limité aux effets de commerce. La loi n° 66-380 du 16 juin 1966 a admis en ce sens que la signature devant figurer sur une lettre de change puisse être apposée « soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit » (art. L. 511-1, 8° C. com.). Cette règle vaut également pour l’endossement des effets de commerce (art. L. 511-8, al. 7e C. com.)
Puis, le législateur a généralisé la règle à tous les actes en admettant que la signature puisse être « apposée » sur l’instrumentum par voie dématérialisée : c’est la signature électronique.
La reconnaissance d’une équivalence entre la signature électronique et la signature manuscrite résulte de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique.
Cette loi a introduit un article 1316-4, al.2e dans le Code civil, devenu l’article 1367, al. 2e consécutivement à l’adoption de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve, qui prévoit que « lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. »
Il ressort de cette disposition que pour être dotée de la même valeur juridique que la signature manuscrite, la signature électronique doit répondre à une exigence de fiabilité.
Plus précisément, cette fiabilité doit garantir :
- D’une part, l’identification du signataire
- D’autre part, l’imputabilité de l’acte au signataire
==> Fonctionnement de la signature électronique
Pour que la signature électronique réponde à l’exigence de fiabilité, condition pour être reconnue comme valant signature manuscrite, cela implique qu’elle repose sur un dispositif de cryptographie, soit une technique de chiffrement consistant à rendre le texte d’un message illisible pour qui ne détient pas la clé de déchiffrement.
Classiquement, on distingue deux systèmes de chiffrement :
- Le système de chiffrement symétrique ou à clé secrète
- Dans ce système de chiffrement, déjà connu à l’Égypte ancienne, une seule clé sert à la fois à chiffrer et à déchiffrer les données.
- Il est donc impératif qu’elle soit gardée secrète par les parties intéressées pour que la sécurité de l’information soit assurée.
- L’inconvénient principal de ce système réside dans le fait que l’expéditeur et le destinataire doivent convenir à l’avance de la clé et doivent disposer d’un canal sûr pour l’échanger.
- Le système de chiffrement asymétrique ou à clé publique
- Afin de contourner l’inconvénient du système de chiffrement symétrique, il s’est développé depuis plusieurs années un dispositif de cryptographie reposant sur des algorithmes de chiffrement dits « asymétriques ».
- Dans ce système, chaque utilisateur dispose de deux clés, une clé publique et une clé privée.
- Ces deux clés sont elles-mêmes créées à l’aide d’algorithmes mathématiques.
- Elles sont associées l’une à l’autre de façon unique et sont propres à un utilisateur donné.
- Un message chiffré à l’aide d’un algorithme asymétrique et d’une clé privée, qui constitue l’un des paramètres de l’algorithme, ne peut être déchiffré qu’avec la clé publique correspondante, et inversement.
- La clé publique doit donc être connue de tous, tandis que la clé privée reste secrète.
Les dispositifs de signature électronique qui remplissent la condition de fiabilité posée par l’article 1367, al. 2e du Code civil, reposent sur le système de chiffrement asymétrique.
Comme souligné par Hubert Bitan, tous fonctionnent sensiblement de la même manière[4] :
- Première étape
- L’émetteur du document à signer se munit d’une paire de clés générées par un algorithme mathématique :
- Une clé publique qui est connue de tous et notamment du destinataire du document
- Une clé privée qui est seulement connue par l’émetteur du document
- Deuxième étape
- Une fois les clés publique et privée créées, l’émetteur du document à signer communique à un tiers certificateur :
- Sa clé publique
- Son identité et si nécessaire sa qualité, le tout assorti de pièces justificatives
- La fonction de « hachage » qu’il entend utiliser qui agit comme une empreinte numérique unique sur un document, ce qui permet de garantir son intégrité et son authenticité
- Le tiers certificateur doit nécessairement avoir obtenu le statut de prestataire de services de confiance qualifiés délivré par un organisme d’évaluation de la conformité dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juillet 2004
- Leurs obligations sont définies à l’article 19 du règlement du 23 juillet 2014 (eIDAS)
- Troisième étape
- Le tiers certificateur délivre à l’émetteur du document à signer un « certificat électronique » ou « certificat de clé publique » qui contient les informations suivantes :
- La clé publique de l’émetteur
- Son identité
- La fonction de « hachage » utilisée
- Le certificat électronique s’apparente en une sorte de carte d’identité numérique ; il permettra au destinataire du document de vérifier l’identité de l’émetteur
- C’est ce certificat qui a vocation à faire le lien de façon certaine entre l’identité du signataire et la signature attachée au document électronique
- Quatrième étape
- À réception du certificat électronique, l’émetteur peut procéder à la phase de signature du document qui consiste à :
- D’une part, insérer dans le message à envoyer au destinataire :
- Le certificat électronique remis par le tiers certificateur
- L’empreinte du document généré par la fonction de « hachage » visée dans le certificat électronique
- D’autre part, chiffrer l’empreinte du document avec la clé privée qu’il est le seul à détenir : c’est cette opération de chiffrement qui constitue l’acte de signature électronique proprement dit
- Cinquième étape
- Le destinataire du document signé par l’émetteur doit utiliser la clé publique du tiers certificateur afin de décrypter le certificat électronique contenu dans le message qui lui est envoyé.
- Le déchiffrement du certificat électronique permet au destinataire d’obtenir deux éléments :
- La clé publique de l’émetteur au moyen de laquelle il pourra :
- Vérifier l’identité de l’émetteur du document
- Décrypter l’empreinte du message reçu
- La fonction de hachage utilisée pour générer l’empreinte du document reçu
- En appliquant cette fonction au document reçu, le destinataire pourra comparer si l’empreinte obtenue est identique à celle envoyée par l’émetteur.
- Dans l’affirmative, le destinataire peut être assuré de l’intégrité du document reçu
Au bilan, la signature électronique, telle qu’envisagée par le législateur, constitue un bloc de données créé à l’aide d’une clé privée; la clé publique correspondante et le certificat permettent de vérifier que la signature provient réellement de la clé privée associée, qu’elle est bien celle de l’expéditeur et que le message n’a pas été altéré.
==> Présomption de fiabilité
Afin de prévenir toute remise en cause systématique de la validité de la signature électronique par la partie à laquelle elle est opposée et favoriser ainsi la dématérialisation des actes juridiques, le législateur a institué une présomption dispensant l’utilisateur d’une signature électronique d’avoir à prouver sa fiabilité.
L’article 1367, al. 2e du Code civil prévoit que « la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Pour être présumé fiable, la signature électronique doit ainsi répondre à un certain nombre d’exigences techniques fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 qui a abrogé l’ancien décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’ancien article 1316-4 du Code civil.
Ce décret est complété par deux textes que sont :
- Le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l’information
- Ce texte régit les critères techniques que doivent remplir les dispositifs de création de signatures électronique (logiciels installés sur l’ordinateur, la tablette ou le téléphone mobile du signataire) aux fins d’être certifiés conformes, ce qui implique que ces dispositifs soient en capacité de générer des signatures électroniques répondant aux exigences fixées par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017
- L’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation
- Ce texte fixe les conditions d’obtention de la qualité de tiers certificateur, soit de prestataire habilité à fournir des services de certification électronique (PSCE)
Ces textes doivent être lus à la lumière du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Ce règlement, plus couramment appelé règlement eIDAS, pose notamment, en son article 25, 1, le principe de non-discrimination à l’égard des signatures électroniques dont la validité est soumise au juge.
Selon ce principe, « l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée ».
À l’analyse, il ressort de la combinaison de ces différents textes qu’il y a lieu de distinguer deux sortes de signatures électroniques :
- Les signatures électroniques qui, en raison de leur niveau élevé de sécurité, bénéficient de la présomption de fiabilité
- Les signatures électroniques qui, parce qu’elles ne répondent pas aux exigences techniques fixées par les textes, ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité
a. Les signatures électroniques qui bénéficient de la présomption de fiabilité
Pour qu’une signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité et que, par voie de conséquence, elle produise, de plein droit, tous les effets juridiques attachés à une signature manuscrite, elle doit remplir un certain nombre de conditions.
i. Conditions
Les exigences auxquelles doit répondre une signature électronique pour être présumée fiable sont énoncées par le décret du 28 septembre 2017.
L’article 1er de ce décret prévoit que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. »
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « signature électronique qualifiée ».
Pour le déterminer, il convient de poursuivre la lecture du texte qui dispose que « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour qu’une signature électronique soit reconnue comme qualifiée et que, à ce titre, elle puisse bénéficier de la présomption de fiabilité.
==> Première condition : une signature qualifiée
La première exigence qui doit être remplie par une signature électronique pour qu’elle soit présumée fiable tient à son niveau de sécurité.
Plus précisément, elle doit consister en « une signature électronique avancée », au sens de l’article 26 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
C’est donc vers l’article 26 de ce règlement, plus couramment appelé règlement eIDAS qu’il convient de se tourner.
Cette disposition prévoit que pour qu’une signature électronique soit reconnue comme étant avancée, elle doit satisfaire aux exigences cumulatives suivantes :
- être liée au signataire de manière univoque
- permettre d’identifier le signataire
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable
Lorsqu’une signature électronique répond à ces exigences, elle accède donc à la qualification d’avancée.
Bien que ce type de signature repose nécessairement sur un dispositif de cryptographie, le niveau de sécurité proposé n’est toutefois pas suffisant pour lui faire bénéficier de la présomption de fiabilité.
Pour être élevée au rang de signature qualifiée, la signature avancée doit avoir été créée à l’aide d’un dispositif présentant un niveau de sécurité plus élevé.
==> Deuxième condition : un dispositif de création de signature qualifiée
La deuxième exigence qui doit être remplie par une signature électronique pour qu’elle soit présumée fiable tient à ses modalités de création.
Plus précisément, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 prévoit que la signature électronique – avancée – doit avoir été « créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement ».
La première question qui immédiatement se pose est de savoir ce qu’est un dispositif de création de signature électronique.
Selon le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, aujourd’hui abrogé, un dispositif de création de signature électronique est « un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ».
Concrètement, ce dispositif prend la forme de logiciels ou d’applications installés sur l’ordinateur, le téléphone mobile ou la tablette du signataire.
Aujourd’hui, il est de nombreux acteurs sur le marché des nouvelles technologies de l’information qui développent et distribuent des dispositifs de création de signature électronique.
Tous les dispositifs proposés n’offrent pas néanmoins le même niveau de sécurité aux utilisateurs.
Or si l’utilisation d’un dispositif de signature électronique est absolument nécessaire pour signer des actes par voie dématérialisée, cela n’est pas suffisant pour conférer à la signature électronique générée par ce type de dispositif la même valeur qu’une signature manuscrite.
Pour ce faire, l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 exige que le dispositif utilisé réponde « aux exigences de l’article 29 dudit règlement ».
C’est donc vers l’article 29 du règlement eIDAS qu’il convient de se reporter afin de connaître les exigences qui doivent être satisfaites par les dispositifs de création de signatures électroniques qualifiées. Il est alors renvoyé à l’annexe II dudit règlement.
Tout d’abord, cette annexe prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que :
- La confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée ;
- Les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois ;
- L’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ;
- Les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Ensuite, l’annexe précise que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne doivent en aucune manière modifier les données à signer et empêcher la présentation de ces données au signataire avant la signature.
En outre, la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, soit à un tiers certificateur.
À cet égard, les conditions d’obtention de ce statut sont fixées par l’arrêté du 26 juillet 2004.
La procédure de reconnaissance de la qualification de prestataire de services de certification électronique comporte plusieurs étapes :
- Première étape
- Le prestataire de services de certification électronique qui souhaite être reconnu comme qualifié doit formuler une demande auprès d’un ou plusieurs organismes accrédités afin qu’il soit procédé à l’évaluation des services qu’il propose.
- Le prestataire est alors tenu de fournir aux organismes qu’il a choisis tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d’évaluation.
- Deuxième étape
- Le ou les organismes choisis procèdent à l’évaluation des services proposés par le prestataire à ses frais.
- Cette évaluation a pour objet notamment de vérifier que les services offerts par le prestataire respectent en tout point les exigences fixées par l’article 6 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 ainsi que les normes, prescriptions techniques et règles de bonne pratique applicables en matière de certification électronique.
- Troisième étape
- À l’issue de la procédure d’évaluation, l’organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.
- Les rapports d’évaluation sont communiqués par les organismes accrédités à la direction centrale de la sécurité des systèmes d’information si celle-ci le demande.
- Quatrième étape
- L’organisme accrédité reconnaît ou non la qualification du prestataire de services de certification électronique au vu du rapport d’évaluation et des éventuelles observations du prestataire.
- Lorsqu’il reconnaît la qualification d’un prestataire, l’organisme accrédité délivre une attestation qui décrit les prestations de services couvertes par la qualification ainsi que la durée, qui ne peut excéder un an, pendant laquelle l’attestation est valable.
- Les prestataires dont la qualification est reconnue communiquent à toute personne qui en fait la demande une copie de l’attestation délivrée par l’organisme accrédité.
Enfin, un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes :
- Le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine ;
- Le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.
==> Troisième condition : un certificat qualifié de signature électronique
Contrairement à la signature manuscrite, la signature électronique, composée de chiffres, de lettres et d’autres signes, ne comporte aucun élément permettant de l’attribuer à une personne donnée.
Chaque utilisateur doit donc établir avec certitude l’identité de ses correspondants.
C’est pourquoi on recourt à des services de certification fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés, souvent désignés comme des « tiers de certification », qui disposent de la confiance de chacun et qui garantissent l’appartenance d’une signature à une personne.
Comme le destinataire utilise la clé publique de l’expéditeur pour vérifier la signature électronique de ce dernier, la vérification suppose que le tiers certifie au destinataire que la clé publique qu’il utilise correspond bien à la clé privée de l’expéditeur signataire et que ce dernier est bien celui qu’il prétend être.
Pour ce faire, les tiers de certification délivrent ce que l’on appelle des certificats « électroniques », qualifiés aussi de « numériques ».
Selon l’article 1, 9 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 un certificat électronique est « un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire »
Ce certificat joue un rôle prépondérant dans l’opération de signature électronique puisqu’il contient :
- D’une part, divers renseignements sur la personne dont on souhaite vérifier l’identité (nom, prénom, date de naissance…)
- D’autre part, la clé publique de cette dernière
Le certificat électronique s’apparente, en quelque sorte, en une carte d’identité numérique qui permettra au destinataire du document à signer de vérifier l’identité de l’émetteur.
À cet égard, seul un prestataire de services de confiance qualifié est habilité à délivrer des certificats électroniques qualifiés.
Surtout, conformément à l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pour qu’une signature électronique puisse être présumée fiable, son dispositif de création doit nécessairement reposer sur « un certificat qualifié de signature électronique »
La question qui alors se pose est de savoir ce qu’est un certificat électronique qualifié. Le texte indique qu’il s’agit d’un certificat « répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
C’est donc à l’article 28 du règlement eIDAS qu’il y a lieu de se reporter afin de connaître les exigences devant être remplies pour qu’un certificat soit qualifié.
Cette disposition renvoie alors à l’annexe I du règlement qui prévoit que les certificats de signature électronique doivent, pour être qualifiés, contenir :
- une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;
- un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :
- pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels
- pour une personne physique: le nom de la personne ;
- au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ;
- des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ;
- des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;
- le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;
- la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ;
- l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
- l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ;
- lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
L’article 28 du règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires.
Ces attributs ne doivent toutefois affecter l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.
Par ailleurs, si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.
ii. Effets
Lorsqu’une signature électronique répond aux exigences fixées par le décret du 28 septembre 2017, en application de l’article 1367, al. 2e du Code civil elle est présumée fiable.
Cela signifie que la partie qui s’en prévaut est dispensée d’avoir à prouver sa fiabilité. Tout au plus, il lui faudra seulement établir que le dispositif utilisé met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens de l’article 26 du règlement eIDAS.
La signature qualifiée, soit celle qui est présumée fiable, présente ainsi un véritable intérêt : elle est pourvue, de plein droit, de la même valeur juridique qu’une signature manuscrite.
L’article 25, 2 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 prévoit en ce sens que « l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite. »
La présomption de fiabilité instituée par l’article 1367, al. 2e est toutefois simple, de sorte qu’elle souffre de la preuve contraire.
En cas de litige, cela signifie que la partie à laquelle la signature électronique est opposée est autorisée à contester sa fiabilité. Si elle est y parvient, la signature litigieuse ne pourra pas se voir attacher les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.
Il appartiendra alors au juge de déterminer si les conditions de l’écrit qui lui est soumis sont réunies.
b. Les signatures électroniques qui ne bénéficient pas de la présomption de fiabilité
La seule condition exigée pour qu’une signature électronique produise les mêmes effets qu’une signature manuscrite c’est qu’« elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » dit l’article 1367, al. 2e du Code civil.
Ce texte ne pose aucune autre condition à la reconnaissance d’une équivalence entre les deux formes de signatures.
Il n’est donc pas nécessaire qu’une signature électronique bénéficie de la présomption de fiabilité pour valoir signature manuscrite.
Il y a lieu, en effet, de ne pas confondre l’exigence de fiabilité avec la présomption de fiabilité.
- S’agissant de l’exigence de fiabilité, elle doit nécessairement être remplie pour que la signature électronique puisse produire les mêmes effets qu’une signature manuscrite : c’est la reconnaissance d’une équivalence entre les deux formes de signature qui se joue ici. Une signature électronique qui n’est pas fiable fait obstacle à la perfection de l’écrit sur lequel elle est apposée.
- S’agissant de la présomption de fiabilité, il n’est pas nécessaire que la signature électronique utilisée en bénéficie pour que celle-ci produise les mêmes effets qu’une signature manuscrite. Une signature électronique qui ne répondrait pas aux exigences fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, lequel exige pour mémoire l’utilisation d’un procédé mettant en œuvre une signature électronique qualifiée, pourrait dès lors parfaitement valoir signature manuscrite s’il est établi qu’elle est fiable. Seulement, c’est à celui se prévaut de la fiabilité de cette signature qu’il appartiendra de démontrer que le dispositif utilisé garantit, d’une part, l’identification du signataire et, d’autre part, le lien entre la signature et l’acte auquel elle s’attache. Ce qui donc se joue ici c’est la charge de la preuve.
Comme souligné par un auteur, au fond « toutes les signatures électroniques peuvent être recevables devant les tribunaux, leur distinction n’a d’intérêt qu’au regard de leur niveau de fiabilité qu’il convient d’établir soit ex-ante (bénéficie de la présomption de fiabilité), soit ex-post (fiabilité à établir devant le juge) »[5].
Aussi, toute forme de signature électronique doit, a priori, pouvoir être valablement apposée sur un écrit électronique.
À cet égard, conformément au principe de non-discrimination énoncé par l’article 25 du règlement eIDAS, il est fait interdiction au juge de dénier à une signature électronique tout effet juridique ou de refuser sa recevabilité « au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée. »
Dans un arrêt du 20 octobre 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé en ce sens que « l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul, lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de celui-ci, à condition que la nullité de cet acte ne soit pas constatée au seul motif que la signature de celui-ci se présente sous une forme électronique. »
Le juge a donc l’obligation, quelle que soit la forme de la signature électronique qui lui est soumise, d’examiner les preuves visant à établir sa fiabilité.
C’est à la seule condition que la fiabilité de la signature électronique litigieuse ne soit pas démontrée que le juge pourra la priver d’effet juridique.
Si désormais l’on se focalise spécifiquement sur les signatures électroniques dont la fiabilité doit être établie par la partie qui s’en prévaut, car ne bénéficiant pas de la présomption de fiabilité, on peut les classer en deux catégories :
- Les signatures électroniques avancées
- Les signatures électroniques simples
i. Les signatures électroniques avancées
==> Spécificité
Ce n’est pas parce qu’une signature électronique ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité qu’elle n’est pas pour autant fiable et que donc elle ne produirait pas les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite.
Cette fiabilité, exigée pour mémoire par l’article 1367, al. 2e du Code civil, ne jouera toutefois pas de plein droit ; elle devra être démontrée par celui qui s’en prévaut.
Pour ce faire, conformément à l’article 26 du règlement eIDAS, il conviendra de prouver que la signature électronique utilisée peut être qualifiée d’avancée (SEA) ou, de sécurisée (SES) ; ce qui implique de satisfaire aux exigences suivantes :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
À l’analyse la signature électronique avancée (appelée également de niveau 2) se distingue de la signature électronique qualifiée (de niveau 3) essentiellement sur deux points :
- Premier point
- La fourniture d’un dispositif de création de signature électronique avancée peut ne pas être assurée par un prestataire de services de confiance qualifié, soit par tiers certificateur.
- Pour rappel, ces prestataires présentent la spécificité de relever du contrôle d’organismes habilités par des textes réglementaires à délivrer des accréditations, lesquels sont eux-mêmes accrédités par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
- Second point
- Les garanties apportées par le prestataire fournissant un dispositif de signature électronique avancée sont purement déclaratives.
- Aucun contrôle de conformité aux exigences posées par le règlement eIDAS n’est réalisé par un organe de contrôle, bien que, en pratique, il ne soit pas rare que les prestataires fassent certifier leurs services par un tiers indépendant au regard des exigences reconnus.
- Reste qu’il conviendra néanmoins, pour celui qui se prévaut d’une signature électronique avancée, de démontrer au juge que
- Les procédures de collecte et de vérification d’identité mises en place par le prestataire garantissent l’identification du signataire
- Le dispositif utilisé garanti l’intégrité du document signé
==> Effets
Comme énoncé par l’article 25 du règlement eIDAS, l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique avancée comme preuve en justice ne saurait être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
En revanche, il appartiendra à celui qui s’en prévaut de démontrer sa fiabilité ce qui implique qu’elle satisfasse aux exigences posées par l’article 26 du Règlement.
S’il y parvient, alors la signature électronique avancée produit les mêmes effets qu’une signature manuscrite : elle vient parfaire l’écrit sur lequel elle est apposée.
ii. Les signatures électroniques simples
==> Spécificités
Il est des signatures électroniques qui ne répondent :
- Ni aux exigences de la signature électronique avancée (niveau 2) posées par l’article 26 du règlement eIDAS
- Ni aux exigences de la signature électronique qualifiée (niveau 3) posées par l’article 29 du règlement eIDAS
Ces signatures électroniques sont dites simples ou de niveau 1. Au nombre des dispositifs techniques les plus fréquemment utilisés on compte :
- La signature scannée
- Ce procédé consiste à numériser, au moyen d’un scanner, une signature manuscrite. L’image obtenue est ensuite enregistrée sur un support durable (disque dur, clé usb etc.)
- Cette signature peut alors être très facilement pour être apposée sur n’importe quel document.
- Aussi, ne permet-elle pas de faire le lien entre le signataire et le document signé, ni de garantir l’intégrité du document sur lequel elle est apposée.
- À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée n’est pas assimilable à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil (V. en ce sens 2e civ. 17 mars 2011, n°10-30.501; Cass. soc. 14 déc. 2022, n°21-19.841).
- Il en résulte qu’une signature scannée, faute de pouvoir être qualifiée d’électronique, ne saurait produire les mêmes effets qu’une signature manuscrite.
- Dans un arrêt du 14 décembre 2012, la Cour d’appel de Fort-de-France avait précisé, dans un arrêt remarqué, que « si la mention écrite par la partie qui s’engage n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois résulter des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ; or, la seule signature scannée de Maxime X. est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire» (CA Fort-de-France, ch. civ., 14 déc. 2012, n° 12/00311).
- La signature réalisée sur tablette
- Ce procédé consiste à apposer une signature sur une tablette numérique à l’aide d’un stylet.
- La différence avec la signature manuscrite, c’est que le support de fixation de la signature est ici digital et non physique.
- Ce dispositif de signature se rencontre de plus en plus dans le domaine de la banque ou des assurances
- Est-ce à dire cette forme de signature vaut signature électronique et que, par voie de conséquence, elle est susceptible de produire les mêmes effets juridiques qu’une signature manuscrite ?
- Dans un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.
- Elle a estimé que le procédé n’était assimilable, ni à une signature manuscrite, ni à une signature électronique.
- La Deuxième chambre civile l’a qualifié de « réplique informatique» ( 2e civ. 17 mars 2011, n°10-14.850).
- Dans le sens inverse, la Cour d’appel d’Amiens n’a pas hésité à assimiler la signature sur tablette à une signature manuscrite (CA Amiens, 1ère ch. civ., 24 mai 2022, n° 20/04601).
- Cette position doit cependant être rejetée dans la mesure où ce procédé de signature ne répond pas aux exigences de fiabilité énoncées par l’article 1367 du Code civil.
- Par ailleurs, comme souligné par un auteur « comparer une signature manuscrite avec une signature électronique même apposée à l’aide d’un stylet sur une tablette est une fausse bonne idée puisque celles-ci relèvent de procédés différents et ne peuvent donc pas avoir les mêmes caractéristiques graphiques. Confronter l’une et l’autre lors d’une procédure est par conséquent vide de sens et revient à les assimiler alors qu’il est substantiel de distinguer les deux formes de signatures»[6].
- Pour cette raison, on ne saurait reconnaître à la signature réalisée sur une tablette les effets juridiques d’une signature manuscrite.
- Signature par confirmation de code reçue par SMS ou par courriel
- Il s’agit d’une méthode consistant à adresser le document à signer par voie électronique, lequel sera accessible à partir d’un lien reçu par mail ou par SMS.
- Après avoir consulté le document, le signataire le valide en cliquant sur un boutant, cette opération faisant office de signature.
- Compte tenu de l’absence de procédure sérieuse de vérification de l’identité du signataire, ce type de signature est, a priori, dépourvu d’effet juridique.
- Certains prestataires proposent néanmoins de renforcer la sécurité de cette forme de signature en ajoutant une étape d’authentification.
- Le signataire devra en effet s’authentifier au moyen d’un code OTP (One-Time-Password), soit d’un code unique et éphémère qui lui est envoyé par SMS sur le numéro de téléphone déclaré.
- La saisie de ce code déclenche alors la création d’un certificat électronique « éphémère » dit également « à la volée » délivré par un prestataire de signature électronique, qui présente la particularité de n’être valable que pour la signature de l’acte pour lequel il a été généré.
- Pour certains auteurs, ce dispositif qui comporte une étape d’authentification du signataire, répondrait aux exigences de la signature électronique avancée.
- Cette analyse semble être confirmée par la jurisprudence. Plusieurs juridictions ont reconnu la validité de cette forme de signature (CA Douai, 2 mai 2013, n°12/05299 ; CA Nancy, ch. 2e, 14 févr. 2013, n°12/01383).
- La partie qui s’en prévaut devra néanmoins prouver la fiabilité du dispositif de signature utilisé (V. en ce sens CA Rouen, 4 mars 2021, n° 20/01275).
==> Effets
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 25 du règlement eIDAS, la recevabilité de la signature électronique dite « simple » comme preuve en justice ne saurait être refusée par le juge au seul motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
Reste qu’elle n’en demeure pas moins soumise à l’exigence de fiabilité fixée par l’article 1367, al. 2e du Code civil.
Aussi, appartient-il à la partie qui se prévaut d’une signature électronique simple de démontrer qu’elle satisfait à cette exigence.
Compte tenu toutefois du faible niveau de sécurité que cette forme de signature offre à ses utilisateurs, elle présente précisément la particularité de n’être pas fiable, soit de ne garantir, ni l’identification du signataire, ni son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Pour cette raison, elle est dépourvue de tout effet juridique, à tout le moins, l’écrit sur lequel elle est apposée ne peut valoir tout au plus que commencement de preuve par écrit.
2. La condition tenant à l’intégrité de l’écrit
Il ne suffit pas pour être recevable à titre de preuve que l’écrit électronique permette l’identification de la personne dont il émane, il faut encore dit l’article 1366 du Code civil « qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Cela signifie que le dispositif de l’écrit électronique utilisé doit garantir que son contenu exprimant les parties à l’opération qu’il constate n’est pas été altéré.
Là encore, cette condition sera réunie lorsque la signature apposée l’écrit répondra aux exigences de fiabilité fixées par l’article 1367 du Code civil.
En effet, la signature électronique ne se limite pas à assurer l’identité du signataire, il a également à garantir l’intégrité de l’écrit sur lequel elle est apposée (art. 1367, al. 2e C. civ.).
B) Les conditions tenant à la forme de l’écrit
À l’instar de l’écrit papier, il est admis que l’écrit électronique puisse être établi :
- Soit sous signature privée
- Soit sous forme authentique
Pour être valable, il lui faudra néanmoins satisfaire aux conditions applicables à l’une ou l’autre forme d’écrit.
1. Conditions propres à l’écrit authentique
L’article 1369 du Code civil prévoit expressément que l’acte authentique « peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Ainsi, l’exigence d’intervention d’un officier public pour l’établissement d’un acte authentique ne fait nullement obstacle à ce qu’il soit dressé sur support électronique.
Cette possibilité offerte aux officiers publics procède d’une volonté du législateur de ne pas laisser l’acte authentique « en dehors de la révolution numérique ».
La poursuite de cet objectif ne doit pas néanmoins se faire au détriment de la sécurité juridique.
C’est la raison pour laquelle, lorsqu’il est établi sur support électronique, l’acte authentique doit satisfaire aux mêmes formalités que celles requises pour son établissement sur support papier.
À cette exigence s’ajoutent celles tenant :
- En premier lieu, à sa signature qui doit reposer sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ( 1367, al. 2e C. civ.)
- En second lieu, à sa conservation, laquelle doit assurer la préservation de l’intégrité et la lisibilité de l’acte
S’agissant de la seconde exigence elle a été précisée notamment par deux décrets au nombre desquels figurent :
- Le décret n°2005-973 du 10 août 2005 relatif aux actes établis par les notaires
- Le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice
==> S’agissant des écrits électroniques établis par des notaires
- Établissement de l’acte
- Le décret n°2005-973 du 10 août 2005 prévoit que le notaire qui établit un acte sur support électronique utilise un système de traitement et de transmission de l’information agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’intégrité et la confidentialité du contenu de l’acte.
- Les systèmes de communication d’informations mis en œuvre par les notaires doivent être interopérables avec ceux des autres notaires et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
- L’acte doit être signé par le notaire au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée conforme aux exigences du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique.
- Cette signature est apposée par le notaire dès l’acte établi, si besoin après réunion des annexes à l’acte.
- Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l’apposition sur l’acte notarié, visible à l’écran, de l’image de leur signature manuscrite.
- Lorsque l’acte doit contenir une mention manuscrite émanant d’une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l’article 1108-1 du Code civil.
- L’image du sceau figure sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques.
- Toute surcharge, interligne, ou addition contenus dans le corps de l’acte sont nuls.
- Les renvois sont portés en fin d’acte et précèdent la signature.
- Lorsqu’une partie ou toute autre personne concourant à un acte n’est ni présente ni représentée devant le notaire instrumentaire, son consentement ou sa déclaration est recueilli par un autre notaire devant lequel elle comparaît et qui participe à l’établissement de l’acte. Cet acte porte la mention de ce qu’il a été ainsi établi.
- L’échange des informations nécessaires à l’établissement de l’acte s’effectue au moyen du système de transmission de l’information mentionné à l’article 16.
- Chacun des notaires recueille le consentement et la signature de la partie ou de la personne concourant à l’acte puis y appose sa propre signature.
- L’acte est parfait lorsque le notaire instrumentaire y appose sa signature électronique sécurisée.
- Conservation de l’acte
- Le décret n°2005-973 du 10 août 2005 précise que l’acte établi sur support électronique doit être conservé dans des conditions de nature à en préserver l’intégrité et la lisibilité.
- L’ensemble des informations concernant l’acte dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
- L’acte notarié dressé sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier central dès son établissement par le notaire instrumentaire. Ce dernier, ou le notaire qui le détient, en conserve l’accès exclusif.
- Le minutier central est établi et contrôlé par le Conseil supérieur du notariat sans préjudice de l’application de l’article 2 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d’archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
- Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l’objet, ne retirent pas à l’acte sa nature d’original.
- Le procédé de conservation doit permettre l’apposition par le notaire de mentions postérieures à l’établissement de l’acte sans qu’il en résulte une altération des données précédentes.
==> S’agissant des écrits authentiques établis par les huissiers de justice
- Établissement de l’acte
- Le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 prévoit que les originaux établis sur support électronique doivent l’être au moyen d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l’intégrité et la confidentialité de leur contenu.
- Les systèmes de communication d’informations, mis en œuvre par les commissaires de justice, doivent être interopérables avec ceux des autres commissaires de justice et des organismes auxquels ils doivent transmettre des données.
- Lorsqu’un commissaire de justice signe un document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d’un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l’identique, il y appose sa signature électronique qualifiée au moyen d’un procédé de signature conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.
- Les actes visés à l’article 11 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée sont contresignés par le commissaire de justice civilement responsable du fait de son clerc dans les mêmes conditions.
- Avant de le signer, celui qui dresse l’acte y mentionne la date en lettres, ses nom, prénoms et qualité.
- Tout document, soit constitué originairement sur support électronique, soit transféré sur ce support au moyen d’un procédé de numérisation garantissant sa reproduction à l’identique, peut être annexé aux actes et aux procès-verbaux de vente. Lorsqu’un document est annexé, il doit être indissociablement lié à l’acte auquel il se rapporte.
- Transmission de l’acte
- Lorsqu’elle est dressée sur support électronique, l’expédition est transmise par voie électronique.
- La transmission par voie électronique est faite dans des conditions garantissant sa confidentialité, son intégrité, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire à moins que la partie ou son représentant n’en demande une édition sur support papier.
- Lorsque l’acte a été dressé sur support électronique, une copie, ainsi que celle des pièces qui y sont annexées, sont éditées sur support papier, afin d’être remises au destinataire, selon les modalités prescrites par les textes en vigueur, à moins que celui-ci ait consenti à la signification par voie électronique de l’acte.
- Copie de l’acte
- Une expédition de l’acte peut être établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l’acte.
- Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée.
- Signification de l’acte
- La personne destinataire d’un acte établi par un commissaire de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice selon un modèle établi par celle-ci.
- La déclaration précise :
- L’identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
- La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
- La durée pour laquelle le consentement est donné ;
- Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
- Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653, 662-1, 663 et 664-1 du code de procédure civile.
- La chambre nationale des commissaires de justice dresse et tient à jour, conformément au 12° de l’article 16 de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d’un acte de commissaire de justice.
- Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
- Ces données sont détruites à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation ou de l’expiration du consentement à la signification par voie électronique.
- Conservation
- Les actes et les procès-verbaux de vente établis sur support électronique doivent être conservés, dès leur établissement par le commissaire de justice, qui en conserve l’accès exclusif, dans des conditions de nature à en préserver l’intégrité et la lisibilité et permettant d’en faire des copies. Ils sont enregistrés pour leur conservation dans un minutier central établi et contrôlé par la chambre nationale des commissaires de justice.
- L’ensemble des informations concernant l’acte ou le procès-verbal dès son établissement, telles que les données permettant de l’identifier, de déterminer ses propriétés et d’en assurer la traçabilité, doit être également conservé.
- Les originaux des actes mentionnés à l’article 14, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
- Dans l’attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation est assurée par ce commissaire de justice au moyen du système prévu à l’article 15.
- Cette conservation est assurée dans le minutier central sans préjudice du contrôle scientifique et technique prévu par l’article R. 212-2 du code du patrimoine.
- Les procès-verbaux de vente, établis sur support électronique, sont adressés au minutier central par le commissaire de justice dès leur établissement.
- Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l’objet, ne retirent pas à l’acte ou au procès-verbal sa nature d’original.
2. Conditions propres à l’écrit sous signature privée
Pour mémoire, l’acte sous signature privée ne fait preuve que s’il satisfait aux exigences énoncées par les articles 1375 et 1376 du Code civil.
À cet égard, les exigences applicables diffèrent selon que l’écrit constate un contrat synallagmatique ou un engagement unilatéral.
==> L’écrit électronique sous signature privée constate un contrat synallagmatique
Dans cette hypothèse, l’écrit électronique est soumis à l’exigence énoncée par l’article 1375 du Code civil.
Cette disposition prévoit en son premier alinéa que « l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct »
Le dernier alinéa du texte précise que « l’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès. »
Ainsi, lorsque l’acte sous signature privée est établi au moyen d’un support électronique pour que l’exigence du double original soit remplie, deux conditions doivent être satisfaites :
- Première condition
- L’acte doit être conservé et établi selon les modalités énoncées par les articles 1366 et 1367 du Code civil.
- Cela implique :
- D’une part, que puisse être dûment identifiée la personne dont l’acte émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ( 1366 C. civ.).
- D’autre part, que la signature électronique utilisée repose sur un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ( 1367, al. 2e C. civ.).
- Seconde condition
- Le procédé utilisé pour établir l’acte doit permettre à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès à tout moment.
- Par support durable, il faut entendre, selon l’article liminaire du Code de la consommation « tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées».
- Le considérant 23 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs précise que « le support durable devrait permettre au consommateur de stocker les informations aussi longtemps que cela lui est nécessaire pour protéger ses intérêts découlant de sa relation avec le professionnel. Au nombre des supports durables devraient figurer, en particulier, le papier, les clés USB, les CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire ou les disques durs d’ordinateur ainsi que les courriels. »
==> L’écrit électronique sous signature privée constate un engagement unilatéral
Dans cette hypothèse, l’écrit électronique est soumis à l’exigence énoncée par l’article 1376 du Code civil.
Cette disposition prévoit que « l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ».
Il ressort de cette disposition que lorsqu’un acte sous signature privée constate un engagement unilatéral de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, le débiteur doit reproduire sur l’acte une mention exprimant le montant ou la quantité de l’engagement souscrit.
Il peut être observé que sous l’empire du droit antérieur, l’ancien article 1326 du Code civil exigeait que la mention manuscrite devant figurer sur l’acte soit écrite de la main du débiteur de l’obligation.
Cette précision excluait, en conséquence, que cette mention puisse être dactylographiée, quand bien même il serait établi qu’elle a été reproduite par celui qui s’engage.
Afin de conférer à l’écrit électronique la même valeur que l’écrit papier, il est apparu nécessaire d’aménager l’exigence posée par le texte.
Il fallait en effet autoriser que la mention puisse être reproduite sur l’acte, tant au moyen d’un stylo que d’un procédé numérique.
C’est la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la signature électronique qui a levé l’obstacle parfaitement identifié par le législateur en substituant la formule « écrite de la main » par « écrite par lui-même ».
Par cette substitution, il était désormais admis que la mention exigée par l’ancien article 1326 du Code civil soit reproduite au moyen d’un outil de dactylographie.
La Cour de cassation a toutefois précisé dans un arrêt du 13 mars 2008 « que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s’engage, n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention ».
Autrement dit, pour conférer à l’acte sous signature privée la force probante d’un écrit, la preuve doit être rapportée que la mention a bien été reproduite par le signataire, faute de quoi cet acte ne peut tout au plus constituer qu’un simple commencement de preuve par écrit devant être corroboré par une preuve extrinsèque (Cass. 1ère civ. 13 mars 2008, n°06-17.534).
À cet égard, en cas de dénégation de son écriture par le débiteur, il appartiendra au juge de procéder, en application des articles 1373 du Code civil et 287 du Code de procédure civile à une vérification d’écriture.
II) Les effets de l’établissement d’un écrit électronique
==> Sur la force probante de l’écrit électronique
L’article 1366 du Code civil prévoit que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier ».
Pratiquement cela signifie que :
- S’il est établi sous signature privée il fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause, dès lors qu’il a été reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard ( 1372 C. civ.)
- S’il est établi sous forme authentique, il fait foi jusqu’à inscription en faux, à tout le moins pour les énonciations relatives à des faits qui ont été personnellement accomplis ou constatés par l’officier public ( 1371 C. civ.)
==> Le règlement des conflits d’écrits
À l’occasion de l’adoption de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 la question s’est posée de savoir comment régler un conflit susceptible d’intervenir entre un écrit électronique et un écrit établi sur support papier.
Plus précisément on s’est demandé s’il n’y avait pas lieu d’instaurer dans la loi d’une hiérarchie des preuves en cas de contradiction entre un écrit sur support papier et un écrit électronique.
Pour certains auteurs, il eût été prématuré de faire prévaloir un écrit électronique, même authentifié, sur un acte sur support papier assorti de la signature manuscrite des parties et ayant le même objet. Pour eux, cette hiérarchie serait conforme à l’état des mœurs.
Le professeur Xavier Linant de Bellefonds écrivait par exemple en ce sens que « la logique juridique de l’autonomie de la volonté consisterait à dire que l’expression la plus récente de cette dernière oblitère la plus ancienne. Or ceci nous paraît fondamentalement imprudent. Dans tous les cas, l’écrit devrait prévaloir car il s’agit d’un acte investi d’une force de démonstration particulière ».
La mission de recherche « Droit et Justice », constituée sous forme de groupement d’intérêt public (GIP) est parvenu à la même conclusion et suggéra de prévoir dans la loi qu’« il ne peut être prouvé par un écrit électronique outre et contre un acte rédigé sur des registres ou papiers quelconques et signé des parties ».
Bien que les arguments avancés au soutien de l’instauration d’une hiérarchie entre l’écrit électronique et l’écrit sur support papier soient séduisants, ils sont loin d’être décisifs.
Comme relevé par le Conseil d’État dans son rapport Internet et les Réseaux Numériques « dès lors que de strictes exigences relatives à la fiabilité de la signature et à la conservation du message de façon durable sont imposées, il paraît difficile de maintenir longtemps la prééminence de l’écrit sur support papier, entouré finalement de moindres garanties ».
À cet égard, des personnes de mauvaise foi pourraient archiver d’avance des écrits manuscrits contraires à leurs engagements électroniques, ou négocier des avenants électroniques à des contrats écrits dont elles savent par avance qu’elles ne les respecteront pas.
Aussi, afin de limiter les risques de répudiation unilatérale est-il sans doute préférable de s’en remettre à la sagesse du juge et de lui laisser le soin de trancher les conflits de preuve en fonction des circonstances de l’espèce.
C’est finalement cette dernière approche qui a emporté la conviction du législateur, celui-ci ayant refusé de faire primer l’écrit papier sur l’écrit électronique.
Cela s’est traduit par l’insertion dans le Code civil d’un article 1316-2 qui prévoyait, sous l’empire de la loi du 13 mars 2002, que « lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support ».
Cette disposition a par suite été reformulée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit de la preuve.
Le nouvel article 1368 du Code civil prévoit désormais que « à défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable. »
En cas de conflit entre un écrit électronique et un écrit établi sur support papier, c’est donc au juge qu’il revient de trancher selon son intime conviction. Toute hiérarchie entre preuves littérales est ainsi écartée.
[1] P. Catala et P.-Y. Gautier, « L’introduction de la preuve électronique dans le Code civil », JCP G, nov. 1999, n°47, I, 182.
[2] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, éd. Dalloz, 2019, n°1834, p. 1910
[3] J. Huet, « Preuve et sécurité juridique en cause dans l’immatériel », in Arch. Philo Droit, tome 43, Le droit et l’immatériel, 1999, Sirey, p. 163.
[4] V. en ce sens H. Bitan, « Un décret fixe les conditions de fiabilité de la signature électronique », CCE, juill. 2001, n°7-8, chon. 19.
[5] E. Caprioli, « Éléments devant constituer le dossier relatif à la signature électronique », CCE, mai 2021, n°41
[6] E. Caprioli, « Validation d’une signature apposée sur une tablette comparée à une signature manuscrite », CCE sept. 2022, n°63