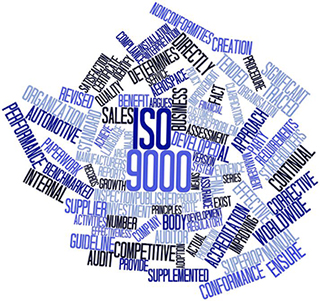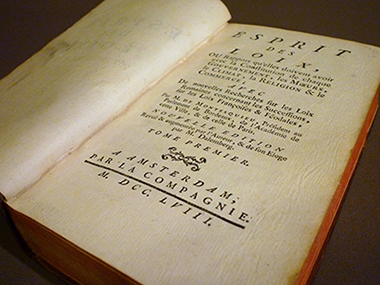Schématiquement, les auteurs s’accordent à dire que les normes peuvent être regroupées en deux familles. Doivent être distinguées les normes à fonction descriptives, des normes à fonction prescriptive. Cette division[1] a, de tout temps, été envisagée par les grands penseurs[2]. Kelsen y fait référence lorsqu’il oppose le sein au sollen[3]. En différenciant le droit et la science du droit, Michel Troper s’y reporte également[4]. De la même manière, Paul Amselek s’appuie sur elle quand il distingue les normes directives, des normes scientifiques[5]. Celle-ci apparaît encore, lorsqu’est évoquée la dichotomie entre le fait et le droit[6] ou les sciences de la nature et les sciences sociales[7]. Malgré la différence de vocable et de formulation, toutes ces divisions renvoient à la même idée : les normes doivent être appréhendées différemment selon qu’elles relèvent de l’« être » ou du « devoir-être ». Il y a, selon le doyen Carbonnier, un « abîme infranchissable entre ces deux univers »[8]. Alors que les règles qui appartiennent à la famille de l’« être » se conjuguent à l’indicatif, celles qui font partie de la famille du « devoir-être » se conjuguent à l’impératif[9]. Et comme a pu le souligner le mathématicien Henri Poincaré : « un million d’indicatifs ne feront jamais un impératif »[10]. Les normes techniques ne peuvent, en toute logique, appartenir qu’à l’une des deux familles de normes. Afin de savoir, comment, ces règles se conjuguent, il convient, dès lors, d’analyser plus en détail cette distinction qui oppose le monde du devoir-être au monde de l’être.
Le monde du « devoir être ». S’agissant du premier, les règles qui le peuplent consistent dans le fait que quelque chose doit être (sollen). Selon Kelsen, « si A est, B doit être »[11]. A priori, les normes qui empruntent cette forme sont marquées du sceau de l’obligation. Par leur édiction est décrit un devoir – si infime soit-il – qui s’impose à son destinataire. Ces normes répondent à une structure bien particulière. Cette structure est gouvernée par un principe que Kelsen nomme l’imputation[12]. Les normes qui appartiennent au monde du devoir-être se décomposent nécessairement en deux éléments : le présupposé et la conséquence[13]. Plus précisément, ces règles consistent en l’énoncé d’une hypothèse (le présupposé) à laquelle sont attachés certains effets (la conséquence). L’imputation est le lien logique unissant les deux, de sorte que, si les conditions décrites dans le présupposé se réalisent, les conséquences définies par l’auteur de la norme doivent avoir lieu. Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple du vol. Cet acte est unanimement réprouvé par les peuples, du moins, par ceux attachés au droit de propriété. En soi, aucune règle ne peut empêcher les agents de voler. L’adoption de cette conduite dépend, pour une large part, de la volonté du voleur[14]. La règle ne saurait agir sur lui, semblablement au marionnettiste qui, par l’action des fils de son fantoche, contrôle ses moindres faits et gestes. Ce que, en revanche, peut faire une norme, c’est adjoindre à ce présupposé, que constitue l’acte de voler, une conséquence comme la condamnation du délinquant, laquelle exprimera tout à la fois la désapprobation et la réponse sociale à cet acte malveillant[15]. Dans le cadre du devoir-être, la relation instituée par la norme entre le présupposé et la conséquence peut se traduire par la formule utilisée par Kelsen selon laquelle : « si A est, B doit être [ce qui] n’implique nullement que B sera réellement chaque fois que A sera »[16]. Il s’ensuit que, les règles qui relèvent du devoir-être, peuvent être, soit respectées, soit violées. Plus exactement, « pour qu’il s’agisse véritablement d’une norme [relevant du devoir-être], il faut qu’existe la possibilité d’une conduite non conforme »[17]. La réalisation des conditions posées par le présupposé n’entraîne pas nécessairement que l’auteur de la transgression soit frappé par les conséquences que prévoit la règle, à savoir, dans le cas du vol, d’une condamnation pénale. Il n’y a pas de relation de causalité entre le présupposé et la conséquence. C’est là, toute la différence avec les normes qui appartiennent au monde de l’être.
Le monde de l’« être ». Contrairement aux règles qui relèvent du devoir-être, ces dernières consistent dans le fait que quelque chose est. En d’autres termes, « si A est, B est »[18]. Cette forme, qu’endossent les normes de l’être, fait d’elles l’exact opposé des normes qui se conjuguent à l’impératif. Elles ne véhiculent aucune forme d’obligation. Ces normes ne font que décrire un « état certain, possible ou probable, dans lequel seront une chose, une situation ou un évènement si telles conditions sont remplies »[19]. Éclairons-nous d’un exemple. Lorsque la pomme se décroche de l’arbre, elle tombe. Bien qu’elle soit mûre ou qu’une bourrasque ait secoué la branche sur laquelle elle était accrochée, la pomme n’avait aucune obligation de tomber. Elle est venue heurter le sol sans qu’elle ait fait l’objet d’un quelconque ordre. Si la pomme est tombée, c’est parce que plus aucune force contraire – celle de la branche de l’arbre – ne s’opposait à ce que s’exerce sur elle la loi de la gravitation. Cette norme, qu’est la loi de Newton, ne commande pas à la pomme de tomber, elle décrit simplement le pourquoi de sa chute, soit le phénomène d’attraction de la terre sur tout corps positionné jusqu’à une certaine distance de sa surface. Comme l’a démontré Kelsen, au même titre que les normes qui relèvent du devoir-être, les normes qui appartiennent au monde de l’être, sont structurées de telle façon qu’elles « lient l’un à l’autre deux éléments »[20]. Ce lien dont il est question a, cependant, nous dit-il, « une signification radicalement différente »[21], selon que la norme qui l’énonce se conjugue à l’impératif, ou selon qu’elle se conjugue à l’indicatif. Dans le premier cas, il s’agira, nous l’avons vu, d’un lien d’imputation entre un présupposé et une conséquence. Dans le second, ce lien sera de nature causale, c’est-à-dire, qu’il unit une cause à son effet. Telle est la finalité des normes de l’« être » : décrire la causalité du mouvement des choses, leur survenance, l’ordre de leur déroulement. Si la pomme se décroche de l’arbre, elle tombe nécessairement. Ce phénomène est systématique et se répètera autant de fois que la branche de l’arbre ne sera plus en mesure supporter le poids de la pomme.
Lois de la nature et lois humaines. Il en résulte que les règles qui appartiennent au monde de l’être sont vraies ou fausses, mais, en aucune manière, ne peuvent être transgressées[22]. La pomme ne saurait violer la loi de la gravitation[23]. S’il s’avérait qu’elle ne tombait pas, cela signifierait simplement que le principe posé par Newton est faux. Il faudrait, par conséquent, que les scientifiques s’attellent à en élaborer un nouveau « à partir de l’observation du réel »[24]. C’est là, la marque des normes de l’être. Leur édiction ne procède jamais d’un acte de volonté ; elle repose toujours sur l’observation du cours des choses. D’aucuns en déduisent, qu’elles ne peuvent être que des lois de la nature[25]. Pour Kelsen, « la différence essentielle entre le principe de causalité et le principe d’imputation normative réside en ceci que la relation des évènements, dans le cas de la causalité, est indépendante d’un acte humain ou d’une volonté surhumaine tandis que le lien, dans les cas d’imputation, est issu d’un acte de volonté humaine […] »[26]. Autrement dit, si les normes sous-tendues par le couple cause-effet doivent être rangées parmi les lois naturelles, celles qui empruntent la structure présupposé-conséquence, sont des lois humaines. Alors que « la Nature […] sait seulement fabriquer de l’être »[27], l’Homme ne peut, quant à lui, produire que du « devoir-être »[28]. Qu’en est-il de la norme technique ?
La conjugaison de la norme technique. Qu’est-ce qu’une norme technique ? Il s’agit, selon Paul Amselek, d’une norme « élaborée directement en fonction de données (même purement intuitives) de la connaissance, en fonction d’un savoir acquis dont on s’efforce de tirer les applications pratiques auxquelles il peut se prêter »[29]. Peuvent, dans ces conditions, être considérées comme des normes techniques les règles de sécurité, d’hygiène, de fabrication industrielle, soit toutes celles qui visent « à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné »[30]. La norme technique prend la forme suivante : pour obtenir le résultat A, les conditions B et C doivent être réalisées. Que peut-on en déduire s’agissant de la conjugaison de la nome technique ? Le premier argument qui tend à réfuter la thèse selon laquelle les normes techniques se conjugueraient à l’impératif, consiste à dire que, derrière le verbe déontique, auquel il peut être recouru pour les énoncer, se cache une norme qui, en réalité, se conjugue à l’indicatif. Lorsque, de la sorte, il est avancé que, pour forger une lame, l’acier dont elle est constituée doit être porté à une certaine température, il s’agit là non pas d’une prescription indiquant un modèle de conduite, mais d’une description de la relation de cause à effet entre la dilatation de l’acier et son exposition à une forte chaleur. Malgré la tournure déontique de la proposition qui énonce la norme, il n’est nullement question ici d’une relation d’imputation entre un présupposé et sa conséquence. C’est pourquoi, les normes techniques se confondraient avec les lois scientifiques, en conséquence de quoi, elles devraient être rangées à côté d’elles dans le monde de l’être. Ô combien pertinente est cette thèse. Elle est pourtant loin de rendre compte de la réalité des choses. Son défaut ? Elle procède d’une vision trop restreinte de la norme technique. Cette espèce de norme possède, certes, une vocation descriptive, de sorte que si l’on s’arrête à cette vocation première, elle se conjugue, sans équivoque, à l’indicatif. Pour autant, il existe de plus en plus de cas où la norme technique se voit conférer une vocation supplémentaire : lorsqu’on la transforme en une règle prescriptive. Comment pareille opération est-elle possible ? Si l’on se réfère à la célèbre loi de Hume, « il n’est pas possible de dégager des conséquences prescriptives à partir de prémices seulement descriptives »[31]. Prenons un exemple : de l’observation que les femmes sont, à situation égale, moins bien payées que les hommes, il ne peut être déduit la règle selon laquelle, les personnes de sexe féminin, doivent toucher un salaire inférieur à celui dont bénéficient les membres de la gent masculine. L’adoption d’un tel raisonnement relèverait du pur sophisme. C’est la raison pour laquelle, il est absolument impossible, nous dit Hume, de faire dériver un « devoir-être » de l’« être ». Est-ce le cas d’une norme technique que l’on changerait en norme prescriptive ? La réponse est, sans hésiter, négative.
L’ambivalence de la conjugaison de la norme technique. Il ne s’agit pas, pour ce qui est des normes techniques qui se conjuguent à l’impératif, de les faire dériver, mécaniquement, sans discernement, de propositions descriptives, mais plutôt, comme le souligne Paul Amselek de les créer « par transformation de modèles recognitifs en modèles directifs »[32]. Rien n’empêche de décider qu’un modèle de conduite dicté par la nature, tel l’échauffement de l’acier à une température précise, devienne un modèle de conduite dicté par l’Homme qui, délibérément, peut faire le choix d’imposer que toutes les lames de tronçonneuses soient pourvues, pour des raisons de sécurité, d’un degré de solidité donné. Il n’y a là, rien de contraire à la loi de Hume. La norme technique est simplement érigée, par un acte de volonté, comme un modèle de conduite auquel les agents doivent se conformer. Dans ces conditions, elle perd sa vocation purement descriptive pour gagner le statut de proposition prescriptive. Cela lui permet, dès lors, de faire son entrée dans le monde du devoir-être, tout en gardant une étroite proximité avec les normes scientifiques. S’agissant, précisément, de cette proximité que la norme technique entretient avec les lois de la nature, certains auteurs y voient un argument qui plaide en faveur de leur appartenance au monde de l’être. Franck Gambelli abonde en ce sens, lorsqu’il affirme qu’« il faut mettre au premier rang des normes techniques les lois naturelles objectives »[33]. Pareillement, pour Denis Voinot, parce que « les normes techniques contiendraient une vérité extérieure à celle énoncée par la norme elle-même »[34], elles pourraient être vraies ou fausses. Si, en apparence, cet argument ne souffre d’aucune contestation, le soutenir revient, pourtant, à confondre la forme descriptive de la norme technique laquelle est, dans cette dimension, soit vraie, soit fausse avec sa forme prescriptive qui, prise dans cette autre dimension, ne peut être que violée ou respectée.
[1] Vincenzo Ferrari parle de « Grande division » (V. Ferrari, « Réflexions relativistes sur le Droit », in Regards sur la complexité sociale et l’ordre légal à la fin du XXe siècle, Bruylant, 1997, p. 36).
[2] On pense notamment à Kant, Saint-Thomas d’Aquin, Aristote ou bien encore, parmi les juristes, à Kelsen, Roubier, ou Josserand.
[3] Pour Kelsen, « la différence entre Sein et Sollen, « être » et « devoir être » […] est donnée à notre conscience immédiate. Personne ne peut nier que l’assertion que ceci ou cela « est » – c’est l’assertion qui décrit un fait positif – est essentiellement différente de la proposition que quelque chose « doit être » – c’est l’assertion qui décrit une norme ; et personne ne peut nier que, du fait que quelque chose est, il ne peut suivre que quelque chose doive être, non plus qu’inversement de ce quelque chose doit être, il ne peut pas suivre que quelque chose est » (H. Kelsen, Théorie pure du droit, op. cit. note 203, p. 14).
[4] M. Troper, La philosophie du droit, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2003, p. 27.
[5] P. Amselek, art. cit. note 201, p. 96. Pour Paul Amselek « toutes les règles ou normes […] ne sont pas exclusivement des règles de conduite ou normes éthiques : il suffit de penser aux « lois » scientifiques » (P. Amselek, « Le droit, technique de direction publique des conduites humaines », Droits, 1989-10, pp. 7-10).
[6]V. en ce sens J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, coll. « Quadrige Manuels, 2004, p. 286. V. également D. de Béchillon op. cit. note 114, pp. 232-233.
[7] Cette distinction est évoquée notamment par Kelsen qui avance qu’« en posant que le droit est norme […] et en limitant la science du droit à la connaissance et description de normes juridiques et des relations fondées par ces normes entre des faits qu’elles règlent, on trace la frontière qui sépare le droit de la nature, et la science du droit, en tant que science normative, de toutes les autres sciences qui visent à la connaissance de relations causales entre processus réels, ou, de fait. Ainsi, et ainsi seulement obtient-on un critérium sûr permettant de séparer sans équivoque société et nature, sciences sociales et de sciences de la nature » (H. Kelsen, op. cit. note 203., p. 83).
[8]Cet auteur parle également d’« antithèse absolue entre l’être et le devoir-être ». J. Carbonnier, op. cit. note 225, p. 286.
[9] Kelsen exprime cette idée en affirmant qu’un sein ne peut pas être confondu avec un sollen et inversement. H. Kelsen, op. cit. note 203, p. 14.
[10]Cité in N. Ar Poulantzas, Nature des choses et droit : essai sur la dialectique du fait et de la valeur, LGDJ, 1965, p. 294.
[11] H. Kelsen, op. cit. note 203, p. 85.
[12] Ibid.
[13] Ph. Jestaz, Le droit, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2011, p. 18.
[14] Encore faut-il que cette volonté ne soit pas altérée, et que l’infraction puisse matériellement être commise. V. par ailleurs en ce sens Laurence Boy pour qui « dans la mesure où [les hommes] sont doués de volonté, les normes sont naturellement transgressables » (L. Boy, « Normes », RIDE, 1998, 115).
[15] On peut noter que la sanction à laquelle risque d’être condamnée le voleur ne constitue en aucune manière la conséquence que l’on impute au présupposé. Cette sanction a seulement pour finalité d’inciter les agents à observation de la règle.
[16] H. Kelsen, op. cit. 203, p. 85.
[17] Ibid., p. 17
[18] Ibid., pp. 14 et s.
[19] D. de Béchillon, op. cit. note 114, p. 189.
[20] H. Kelsen, op. cit. note 203, p. 85.
[21] Ibid.
[22] Pour Dénys de Béchillon, il convient cependant de nuancer cette affirmation. Selon cet auteur « la possibilité d’une conduite non conforme existe aussi dans le monde des sciences – toutes choses égales par ailleurs. Elle prend simplement une autre forme, et porte surtout des effets différents. Grosso modo, la violation d’une norme juridique s’opère sur le mode de la transgression, alors qu’une loi scientifique s’expose, lorsqu’elle n’est pas respectée à une réfutation, totale ou partielle. Violée, une norme juridique conserve normalement sa validité (c’est-à-dire son plein caractère de norme juridique), alors que la loi scientifique perd en principe la sienne (c’est-à-dire sa qualité descriptive, explicative ou prédictive). » (D. de Béchillon, op. cit. note 114, p. 188).
[23] Ainsi pour Franck Violet « le plus puissant des hommes ne peut aller à l’encontre de la plus simple des règles naturelles » (F. Violet, Articulation entre la norme technique et la règle de droit, PU Aix-Marseille, 2003, p. 32).
[24] P. Amselek, art. cit. note 201, p. 98.
[25] Les auteurs assimilent en ce sens les normes qui relèvent de l’être aux lois de la nature. Ainsi, pour Paul Amselek, en dehors des normes du devoir-être « toutes les autres sont les […] lois de la nature ». P. Amselek, art. cit. note 201, p. 97. V. également, P. Amselek, « Lois juridiques et lois scientifiques », Droits, 1987, n° 6, p. 131. Dans le droit fil de cette pensée, Kelsen oppose les « lois naturelles » aux normes qui relèvent du devoir-être (H. Kelsen, op. cit. note 203, p. 85).
[26] H. Kelsen, « Qu’est-ce que la théorie pure du droit ? », Droit & Société, 1992, p. 553.
[27] D. de Béchillon, op. cit. note n° 114, p. 196. Cet auteur poursuit en avançant que « ces prétendues lois de la Nature sont des constructions purement humaines et largement fantasmatiques au travers desquelles nous prêtons des aptitudes normatives à une Nature qui n’en possède pas » (D. de Béchillon, op. cit. note n° 114, p. 198).
[28] Soutenir le contraire reviendrait à assimiler l’homme à un dieu, ce qu’il n’est pas, bien évidemment. Au mieux, l’homme a le pouvoir d’interférer dans le déroulement du cours des choses. Il peut chercher à déjouer les effets de la loi de la causalité. Il ne peut cependant, ni la neutraliser, ni la modifier. La gravitation exercera toujours une force sur la pomme. Il s’ensuit qu’elle tombera, arrivée à maturité, inéluctablement de l’arbre, sans que la plus grande volonté humaine ne puisse rien y changer.
[29] P. Amselek, art. cit. note 201, p. 99 ; Franck, Violet définit quant à lui la norme technique comme « une solution d’application répétitive apportée à des questions relevant essentiellement des sphères de la science, de la technique et de l’économie et visant à l’obtention du degré optimal d’ordre dans un contexte donné » (F. Violet, op. cit. note 272, p. 19). V. également pour une définition de la norme technique M. Lanord, « La norme technique : une source du droit légitime ? », RFDA, juil. 2005, n° 4, pp. 738-751 ; « norme technique et le droit : à la recherche de critères objectifs », Revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 2005/2, pp. 619-649 ; D. Voinot, La norme technique en droit comparé et en droit communautaire, Thèse : Grenoble, 1993 ; A. Peneau, Règles de l’art et normes techniques, LGDJ, 1989.
[30] F. Violet, op. cit. note 272, p. 19.
[31] Cité in C. Grzegorczyk, M. Troper, F. Michaut (dir.), Le positivisme juridique, LGDJ, 1992, pp. 244-245.
[32] P. Amselek, art. cit. note 201, p. 100.
[33] F. Gambelli, « Définitions et typologies des normes techniques », LPA, n° 18, 11 février 1998, p. 5.
[34] D. Voinot, op. cit. note 278, p. 35.