Deux fondements président à la production de l’ordre dans les sociétés étatiques. L’un tient à sa qualité de système. Il s’agit de la lutter contre l’entropie (I). L’autre se rapporte à sa qualité d’ordre normatif. Il lui faut engager une lutte contre une déclinaison du phénomène d’entropie : l’anomie (II).
I) La lutte contre l’entropie
Le paradigme de l’ordre. L’ordre et le chaos : jusqu’il y a peu, ces deux phénomènes étaient considérés par les scientifiques comme complètement indépendants l’un de l’autre. Aucune osmose, ni aucun dialogue ne pouvaient être envisagés entre eux. Pour Edgar Morin, il faut remonter à la Grèce antique pour trouver l’origine de cette pensée. À cette époque, était « dissocié chronologiquement le chaos originaire, sorte de pré-univers monstrueux où Ouranos le furieux copule avec sa mère Gaia et détruit ses enfants, du Cosmos, univers organisé où règne la règle de l’ordre »[1]. Selon cette vision, décrite par Hésiode au VIIIe siècle avant J.-C., le chaos précèderait, non seulement la genèse du monde, mais également l’apparition des dieux[2]. À l’inverse du chaos, l’univers était vu par les Grecs comme un monde clos et ordonné. Assez curieusement, cette conception, qui tend à voir de l’ordre partout dans l’univers, a perduré jusqu’au début du XXe siècle. Elle s’est même accentuée à partir du XIXe siècle, les scientifiques enorgueillis par les immenses prouesses techniques réalisées à cette période, n’hésitant pas à dire de la science qu’elle serait infaillible et parviendrait, un jour, à répondre à toutes les questions, y compris celles de nature philosophique que l’Homme se pose depuis qu’il est doué de la faculté de penser : d’où venons-nous ? que sommes-nous ? où allons-nous ? Les savants avaient la certitude que l’humanité tout entière était à l’aube d’une nouvelle ère ; une ère où le nombre des réponses croîtrait pendant que celui des questions diminuerait. Le discours proféré par Mercadier, président de la section de Physique de l’association française pour l’avancement des sciences, lors de l’assemblée générale annuelle de cette association le 19 août 1880 à Reims est tout à fait symptomatique de cet état d’esprit. Ce scientifique déclara, à cette occasion, que « nous avons une foi sincère dans le progrès continu de l’humanité et jugeant de l’avenir d’après le passé et d’après les conquêtes que le siècle actuel a faites sur la nature nous n’admettons pas qu’on vienne nous dire a priori en quelque branche que ce soit de la science positive : tu t’arrêteras là ! ».
La conception déterministe. La raison de cet optimisme, à la limite de l’arrogance, se comprend aisément si l’on se remémore le paradigme dans lequel s’inscrivent les scientifiques de l’époque : le paradigme de l’ordre. À partir du moment où l’on adhère au postulat selon lequel l’univers est régi par l’ordre, le chaos ne constituant qu’une entité complexe pouvant, elle aussi, être ramenée à des éléments ordonnés, il n’apparaît pas illogique de penser que tout phénomène est explicable et prédictible. Cette idée a parfaitement été résumée par l’astronome Laplace qui, se situant du point de vue du « Démon », a écrit : « une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux »[3]. Autrement dit, comme l’explique Pierre Berger, selon la conception laplacienne « tout le futur est […] entièrement contenu, déterminé par le présent : connaissant les lois du mouvement et les conditions initiales, nous déterminons avec certitude le mouvement futur pour un avenir aussi lointain que nous le souhaitons »[4]. Cette idée de l’univers porte le nom de déterminisme. Qu’est-ce que le déterminisme ? Il s’agit de la thèse consistant à soutenir que chaque événement serait déterminé par le principe de causalité. Pour Laplace « nous devons […] envisager l’état présent de l’univers comme l’effet de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre »[5]. Ainsi, l’univers regardé sous le prisme de la conception déterministe, évoque-t-il « la plus parfaite des horloges »[6]. Les théories qui décrivent la rotation des astres et des planètes, la propagation des ondes, les éléments constitutifs de la matière, le code génétique des êtres vivants ou encore la trajectoire d’un boulet de canon, nous offrent un certain ordre, une linéarité, un modèle reproductible à l’infini que l’on a fini par qualifier de lois de la nature. Est-ce pour se rassurer que la thèse du déterminisme a été développée ? Cela n’est pas exclu. À bien y réfléchir, l’Homme n’est jamais autant satisfait et apaisé, que lorsqu’il sait les phénomènes qui l’entourent traduits en équations mathématiques ou du moins susceptibles de l’être.
La remise en cause de la conception déterministe. En tout état de cause, ce sentiment de quiétude par lequel ce dernier a pu être envahi, à la fin du XIXe siècle, a été de courte durée. À peine a-t-il eu le temps de se gargariser des avancées de la science, que sa peur la plus profonde, celle qui pendant tant de siècles l’a poussé à voir tantôt Dieu tantôt le Diable partout où l’inexplicable a pu prospérer, allait resurgir de plus belle. Quelle est cette peur ? Il s’agit de la peur du chaos, dont on a pu dire qu’il est ténèbres, porteur de désolation et de tous les maux dont souffrirait l’Humanité. L’idée que le chaos pourrait ne pas être lié au phénomène de la complexité, mais faire partie intégrante de l’univers aux côtés de l’ordre, a commencé à germer lorsque certains scientifiques ont pointé du doigt des questions auxquelles aucune réponse ne pouvait être apportée par les grandes lois de la physique, pourtant censées s’appliquer universellement. Si, par exemple, l’on se représente une boule de billard en mouvement qui vient percuter une autre boule immobile, grâce aux lois de Newton il sera, a priori, possible de déterminer avec certitude la trajectoire précise de l’une et l’autre de ces boules. Si, en revanche, l’on prend ces mêmes boules de billard, mais cette fois-ci percutées de face et simultanément par une troisième boule, dans cette hypothèse, aussi incroyable que cela puisse paraître, les lois de Newton ne permettent plus de prévoir le mouvement respectif des trois boules après la collision. Leur comportement est ici déterminé par ce que l’on qualifie communément de hasard. Lorsqu’Henri Poincaré a mis en exergue les failles des lois de Newton, on n’y prêta guère attention. Le paradigme laplacien de l’ordre était encore solidement ancré dans les esprits de l’époque. Toutefois, une première fissure s’était formée sur la digue que constituait ce paradigme. Cette digue n’allait pas tarder à céder sous l’impulsion de l’une des plus grandes découvertes du XIXe siècle : l’établissement de la relation entre la chaleur et le mouvement, phénomène étudié dans le cadre d’une discipline que l’on nomme thermodynamique.
Les principes de thermodynamique. Une première étape majeure a été franchie lorsque, grâce aux travaux, entre autres, de James Joule et Hermann von Helmholtz, a été formulé le premier principe de la thermodynamique, à savoir que dans un système fermé – c’est-à-dire sans aucune interaction avec l’extérieur – l’énergie contenue dans ledit système reste constante. Selon cette loi, l’énergie serait « une entité indestructible, dotée d’un pouvoir polymorphe de transformation »[7]. Cette idée se retrouve dans la fameuse formule selon laquelle « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Attribuée à tort à Antoine de Lavoisier, cette formule a, en réalité, pour auteur Anaxagore de Clazomènes, contemporain de Zénon qui déjà au Ve siècle avant J.-C. avait écrit que « rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau »[8]. Le premier principe de la thermodynamique trouve application, par exemple, lors de la construction de machines thermiques dont la fonction est de transformer la chaleur en travail (machine à vapeur, moteur à explosion) ou inversement de transformer le travail en chaleur (réfrigérateur, climatiseur, etc.). Dans ces machines, l’énergie renfermée ne diminue, ni n’augmente : par le jeu d’une transformation, elle se conserve. Que doit-on entendre par là ? Pour se saisir de la notion de conservation, c’est vers le deuxième principe de la thermodynamique qu’il convient de se tourner. La découverte de ce principe constitue la seconde étape du processus qui a conduit à la remise en cause du paradigme de l’ordre. Esquissé par Sadi Carnot puis formulé, pour la première fois, par Rudolf Clausius, au milieu du XIXe siècle, ce principe va au-delà de la précédente loi. Il énonce que, si l’énergie ne se perd pas, elle se disperse néanmoins dans l’univers ; d’où il s’ensuit une élévation infime de sa température. Conformément au premier principe de la thermodynamique, la quantité d’énergie totale de l’univers serait alors toujours constante. La quantité d’énergie utile ne cesserait, cependant, pas de décroître. Le deuxième principe de la thermodynamique introduit cette idée d’une dégradation irréversible de l’énergie qui, une fois dégradée, serait certes toujours présente dans l’univers, mais perdrait toute faculté à se transformer et à effectuer un quelconque travail. Cette dégradation de l’énergie est qualifiée par Clausius d’entropie[9]. Signifiant « transformation » en grec, l’entropie est définie par Rémy Lestienne comme « ce qui change réellement quand en apparence tout redevient pareil »[10].
Le concept d’entropie. Très vite, le concept d’entropie est repris par d’autres physiciens dont Boltzmann, lesquels s’en vont s’en servir pour désigner, non pas la dégradation d’énergie dans un système, mais plus généralement la déperdition d’ordre dont il fait l’objet. Pour comprendre ce qu’est véritablement l’entropie, le mieux, c’est de s’appuyer sur l’exemple, exposé dans de nombreux manuels : la boîte divisée en deux compartiments par une cloison amovible. Le premier compartiment est rempli d’eau douce, le second d’eau de mer. Ce système se caractérise, de toute évidence, par un certain niveau d’ordre, les contenus qui se trouvent dans chacun des compartiments étant bien distincts l’un de l’autre. Imaginons maintenant que l’on ouvre la cloison qui sépare les deux compartiments. Il est aisé de se représenter ce qui va se produire. L’eau douce va se mélanger à l’eau de mer, l’eau de mer à l’eau douce, de sorte que la boîte ne contiendra plus qu’un liquide homogène. Il peut en être déduit qu’il y a, désormais, moins d’ordre dans le système qu’est la boîte ou, si l’on préfère, plus de désordre. Cette expérience, peut également être réalisée avec un château de sable qui, une fois achevé, aura atteint son niveau d’ordre maximal, mais qui immédiatement après, s’acheminera plus ou moins rapidement vers un retour à son état initial, soit un amas uniforme de sable. Ainsi, l’entropie mesure-t-elle la quantité d’ordre dans un système. Cet ordre tend, irrémédiablement, à décroître dans quelque système que ce soit. Dans un système clos, toute transformation s’accompagne donc, inéluctablement, d’un accroissement d’entropie. Cette dégradation irréversible ne peut que s’accroître jusqu’à un maximum qui correspond à un état d’homogénéisation et d’équilibre thermique pour le système. À cet état, toute aptitude au travail et toute possibilité de transformation disparaissent. Le froid, le chaud se transforment en tiède, l’hétérogène devient homogène, l’ordre tend vers le désordre. Clausius a prévenu : le second principe de la thermodynamique peut être appliqué à l’univers tout entier pris en tant que système fermé : cela signifie qu’il se dirigerait tout droit vers une mort thermique. Cette idée que l’univers serait, progressivement, gagné par le chaos n’a, évidemment, pas laissé indifférents les scientifiques qui, pour certains, voyaient déjà le ciel leur tomber sur la tête[11]. Le constat est pourtant là : l’univers est condamné à l’uniformité comme n’importe quel autre système qui contient un tant soit peu d’ordre.
La particularité des systèmes ouverts. Est-ce là le sort qui attend les sociétés étatiques ? Dans l’absolu c’est certain, leur destinée étant nécessairement liée à celle de l’univers physique. Quand est-ce que cela se produira ? Rien ne permet de le dire. Pour le savoir, encore faut-il connaître la vitesse à laquelle croît l’entropie en leur sein si tant est qu’elle y progresse. Une société étatique peut, en quelque sorte, être comparée à une cathédrale qui, à mesure que le temps passe, voit ses pierres, sa charpente, ses voûtes ou encore ses fondations s’abîmer jusqu’à ce qu’elle finisse un jour par s’écrouler sur elle-même. Conformément au deuxième principe de la thermodynamique, l’entropie fera inexorablement son œuvre. Il est, cependant, un détail que l’on ne saurait négliger ici. L’édifice qu’est la cathédrale n’est pas un système complètement fermé. C’est, d’ailleurs, le cas de tous les systèmes qui composent l’univers. Un système totalement fermé n’existe pas dans la nature. Il est une pure abstraction utilisée par commodité par les physiciens. Pareil système est celui qui n’échange ni énergie, ni matière, ni information avec son environnement. C’est un système totalement coupé de l’extérieur. À l’opposé, un système ouvert est un système en relation constante avec son environnement. Il est traversé, en continu, par des flux d’énergie, de matière ou d’information. Alors que dans un système fermé, il n’est rien qui puisse stopper la marche en avant de l’entropie, dans un système ouvert c’est tout le contraire. Parce qu’un système est fermé, il ne dispose d’aucune source par le biais de laquelle il peut lui être insufflé de l’ordre – structurant – afin de compenser l’accroissement de désordre provoqué par l’entropie. Dans un système ouvert en revanche, selon son degré d’ouverture, l’environnement sera susceptible de lui fournir la dose d’ordre nécessaire quant à ralentir, voire neutraliser l’entropie qui s’exerce sur lui. S’agissant d’une cathédrale, celle-ci sera tout ce qu’il y a de plus ouverte sur l’environnement dans lequel elle s’insère. Les agents vont donc, très probablement, se donner pour tâche de la restaurer et s’employer à ce qu’elle retrouve son niveau d’ordre le plus élevé. Cela revient, en somme, à lutter contre l’entropie.
La lutte contre l’entropie. Pour que les sociétés étatiques restent debout, une lutte similaire contre l’entropie devra, être engagée par ses membres. Mener à bien cette lutte suppose que soit, en permanence, insufflé de l’ordre structurant. Comment cela se traduit-il ? Pour une cathédrale, il s’agira de remettre en état ses composantes. Afin d’y parvenir, ses restaurateurs n’auront qu’à suivre les traces laissées par le temps sur l’ouvrage et panser ses plaies pour que l’entropie soit freinée momentanément. Pour ce qui est des sociétés étatiques, comme n’importe quel autre système, elles sont, tout autant qu’une pierre, un organisme vivant, ou un gaz, sujettes à l’entropie. Seulement, dans le cas de ces dernières, le désordre ne se mêlera pas à l’agencement de particules de matière, mais viendra semer le trouble dans l’organisation des agents qui se sont réunis autour d’un intérêt commun. Ce désordre se traduira par une désagrégation de ce par quoi l’ordre social est assuré. Autrement dit, c’est par une action sur les normes qui règlent la conduite des membres de la société que s’exercera l’entropie. Ce phénomène porte le nom d’anomie.
II) La lutte contre l’anomie
Anomie et anarchie. Il faut remonter à l’époque présocratique pour trouver, paraît-il, les premières traces de débats relatifs à l’anomie. Concept qui a vivement intéressé tout particulièrement les sophistes dans la Grèce du Ve siècle avant J.-C., et qui a été redécouvert à l’époque contemporaine, notamment par Durkheim, dont on dit qu’il est le premier auteur moderne à avoir écrit sur ce sujet. Ce qui est très frappant, lorsque l’on se penche sur le concept d’anomie, c’est que, selon les époques et selon les auteurs vivant à une même époque, il lui a été conféré une multitude de sens, lesquels renvoient à des théories toutes plus différentes les unes que les autres. Cela n’a pas empêché ce concept de traverser près de vingt-cinq siècles d’histoire et de continuer à faire encore parler de lui. Aussi, afin de prendre la mesure précise de ce qu’est véritablement l’anomie, il faut s’essayer à délimiter l’étendue de sa signification. Au préalable, commençons par prévenir toute confusion entre ce concept et une autre notion : l’anarchie. Contrairement à une idée fausse et malheureusement extrêmement répandue, l’anarchie n’est pas un état dans lequel se trouverait une société sans lois, ni règles ; autrement dit une société où l’entropie aurait atteint son niveau maximal, l’ordre structurant y ayant complètement disparu[12]. Bien loin de cette représentation fallacieuse réside l’idée d’anarchie. Le mot « anarchie », tel qu’on le connaît aujourd’hui, se compose du préfixe privatif an « absence de » et arkhê « commandement », ce qui mis bout à bout signifie « absence de commandement ». Plus précisément, le terme anarchie renvoie à l’idée d’une société dans laquelle il n’y aurait ni chef, ni gouvernement, ni quelque autre forme d’autorité que ce soit. Une société où règne l’anarchie n’est donc pas caractérisée par l’inexistence d’ordre. Il est seulement question de l’absence de hiérarchie entre les agents. En témoigne cette formule de Proudhon : « la plus haute perfection de la société se trouve dans l’union de l’ordre et de l’anarchie »[13]. Selon lui l’ordre et l’anarchie ne seraient pas deux concepts antagonistes. Ils pourraient très bien cohabiter l’un dans l’autre. C’est du moins ce que suggère Proudhon de manière encore plus explicite lorsqu’il écrit que « l’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir »[14]. Une société dans laquelle s’épanouit le désordre se trouve donc dans un état, non pas d’anarchie, mais d’anomie.
La naissance du concept d’anomie. Puisant ses racines dans le nom grec anomia, qui dérive lui-même de l’adjectif anomos « sans lois », le terme anomie désigne littéralement l’état d’une société déstructurée, car la conduite de ses membres n’est régie par aucune norme. L’anomie renverrait, aussi surprenant que cela puisse paraître, à la conception erronée que l’on se fait généralement de l’anarchie. Cependant, comme le montre de façon extrêmement bien documentée Marco Orrù, dans les textes grecs les plus anciens, « le terme anomia revêt un sens plus large que celui d’une simple absence de lois »[15]. Il viserait, grosso modo, le comportement déviant d’un individu faisant fi des normes sociales, ciment de la société dans laquelle il évolue. Toujours selon Marco Orrù, avec la métamorphose connue par la Grèce du Ve siècle avant J.-C. sur les plans politique, économique, et social, le sens du mot anomia dérive, progressivement, vers une connotation qui signifie moins l’état d’un individu isolé que l’état du groupe social pris dans son entier. L’anomia ne désignera plus un écart de conduite individuel. Il renverra plutôt à l’idée de non-respect généralisé des lois et coutumes. Dans son Histoire de la guerre du Péloponèse Thucydide raconte que c’est, précisément, ce qui se serait passé à Athènes, après que la peste l’eut dévastée. La raison de cet état d’anomie dans lequel la fameuse cité grecque aurait été plongée devrait, toutefois, aux dires de certains, être recherchée dans des causes bien plus profondes[16]. Durant cette période, Athènes n’est pas la seule cité grecque à voir ses normes sociales se consumer. D’autres sont également touchées par ce phénomène, notamment Sparte. D’aucuns tentent d’expliquer cette situation en avançant que ce serait là, le résultat « d’un manque de respect pour les lois et pour les accords conclus entre les cités grecques »[17]. Ce serait, dans ces conditions, une grossière erreur de croire que le concept d’anomia est exclusivement perçu par les Grecs de manière péjorative. Il s’avère justement que les penseurs de cette période s’opposaient sur la question de la dimension bénéfique de l’anomia pour les membres de la Cité.
L’évolution du concept d’anomie. Pour les sophistes, qui prônent la relativité des valeurs morales, la réponse n’est pas si évidente qu’il y paraît. Ils vont s’emparer de cette question essentiellement à travers le débat sur les concepts de physis et nomos. Tandis que la physis renvoie aux lois immuables et universelles de la nature humaine, le nomos désigne, quant à lui, les normes sociales changeantes d’une époque et d’une cité à l’autre, car fixées conventionnellement. Comme le souligne Marco Orrù, « la controverse sur nomos et physis apparaît en partie comme un effort pour trouver un équilibre entre la sphère publique et la sphère privée, entre la liberté naturelle de l’individu et les contraintes artificielles imposées par le groupe social. D’un côté, les apologistes de la physis voient les normes sociales comme une perversion morale supérieure de la nature […]. De l’autre côté, pour les défenseurs du nomos la nature humaine est corrompue et imparfaite […] »[18]. Pour les défenseurs de la physis, les normes sociales ne doivent pas créer d’obstacles au développement de l’individu auquel cas l’anomia ne saurait être une mauvaise chose. Au contraire, pour les partisans du nomos, les lois sont prises pour assurer une coexistence paisible entre les membres de la cité, de sorte que les effets de l’anomia sont en tous points indésirables. Pour Platon qui, certes, se montre beaucoup moins virulent que Socrate à l’égard de la pensée sophiste, mais virulent tout de même, aucun doute n’est permis quant à la nature de l’anomia : l’obéissance aux lois étant un impératif moral, l’état d’anomia doit ipso facto être considéré comme un mal qui menace grandement les fondements de toute société humaine. Conséquemment, il doit être combattu, coûte que coûte, sans quoi il est de forts risques que s’installe subrepticement le chaos. Assez curieusement, ces débats sur l’anomia ne sont pas restés l’apanage de la Grèce du Ve siècle avant J.-C. Ils vont reprendre leur cours à l’époque moderne, notamment à travers la querelle doctrinale qui oppose Durkheim à Guyau.
Un concept disputé. Pour Durkheim, comme pour Platon d’ailleurs, la source des codes de conduite et des valeurs est extérieure à l’individu. Pour eux, la morale réside dans la sphère sociale. Elle aurait un fondement transcendantal[19]. À l’inverse, pour Guyau qui, sur ce point, rejoint les sophistes, le fondement des normes sociales ne saurait être recherché ailleurs que dans les individus qui portent tous en eux-mêmes des principes de bonne conduite. La source de la morale ne serait donc pas transcendantale, mais immanente[20]. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est que, dans les deux cas, la vision que Guyau et Durkheim se font de l’anomie se rapporte à leurs conceptions respectives de la morale. S’agissant de Guyau, sa conception immanente des codes sociaux le mène à voir dans le phénomène d’anomie qui s’amplifie à mesure que la religion décline et qu’une nouvelle ère industrielle s’affirme, une sorte de défi lancé aux individus pour trouver en eux leurs propres valeurs morales et les substituer à celles qui, trop longtemps, leur ont été imposées. Pour Durkheim, en revanche, étant donné que « les normes qui règlent le fonctionnement de la société ne définissent pas seulement les limites aux initiatives des acteurs, mais fournissent à ces derniers leurs propres fins et leurs propres objectifs »[21], l’anomie est le pire ennemi qui soit de la société. Elle priverait ses membres de toute possibilité de se réaliser en tant qu’individus, ce qui serait susceptible de les conduire au suicide. Les thèses de Guyau et de Durkheim ont eu une incidence considérable sur la sociologie contemporaine, à tel point que la question de l’anomie a traversé l’Atlantique pour être discutée par les auteurs américains. Nous citerons, entre autres, Robert Merton qui, après s’être imprégné de la pensée durkheimienne pour mieux s’en écarter, a élaboré sa propre thèse de l’anomie. Pour lui, l’anomie, qu’il considère tout autant que Durkheim comme hautement nocive pour la société, est le résultat d’un déséquilibre entre les objectifs culturels des individus et les moyens institutionnels qu’ils ont à leur disposition pour réaliser ces objectifs. Il s’ensuit que ce déséquilibre favoriserait la violation par ces derniers des normes sociales[22].
Anomie et entropie. Au total, le constat est là : le débat sur l’anomie semble, aujourd’hui, resté grand ouvert. Tantôt assimilé à une absence de lois, tantôt assimilé au comportement déviant d’individus, voire du groupe tout entier, le phénomène d’anomie s’est vu conférer, au fil des siècles, pléthore de significations, dont une immense partie manque encore à notre liste. Si, cependant, le terme d’anomie recèle d’une multitude de sens, il n’en reste pas moins employé pour désigner, finalement, une seule et même chose : les conditions idoines dans lesquelles prospère le chaos. N’est-ce pas lorsqu’une société voit la déliquescence de ses normes sociales que le désordre la gagne ? Par le concept d’anomie est toujours visé l’état d’une société dont les portes sont grandes ouvertes pour que s’y engouffre l’entropie. Il faut être lucide, les systèmes humains que sont les sociétés, ne sont, en aucun cas, à l’abri de l’entropie. Sans que l’on ne puisse rien, elles y sont exposées et succomberont toutes nécessairement, à terme, sous ses coups. Comme n’importe quel autre système, les sociétés humaines sont condamnées à subir les assauts incessants de l’entropie dont le succès dépend du niveau d’anomie qu’elles présentent.
[1] E. Morin, La Méthode. La Nature de la Nature, Seuil, coll. « Points essais », 1977, p. 57.
[2] Hésiode poète grec du VIIIe siècle avant J.-C. écrit de la sorte qu’« au commencement, fut Chaos, et puis la Terre au vaste sein, siège inébranlable de tous les immortels qui habitent les sommets du neigeux Olympe, et le Tartare sombre dans les profondeurs de la vaste terre, et puis Amour, le plus beau des immortels, qui baigne de sa langueur et les dieux et les hommes, dompte les cœurs et triomphe des plus sages vouloirs. De Chaos naquirent l’Érèbe et la sombre Nuit. De la Nuit, l’Éther et le Jour naquirent, fruits des amours avec l’Érèbe. À son tour, Gaïa engendra d’abord son égal en grandeur, le Ciel étoilé qui devait la couvrir de sa voûte étoilée et servir de demeure éternelle aux Dieux bienheureux. Puis elle engendra les hautes Montagnes, retraites des divines nymphes cachées dans leurs vallées heureuses. Sans l’aide d’Amour, elle produisit la Mer au sein stérile, aux flots furieux qui s’agitent » (Hésiode, Théogonie. Les Travaux et les Jours, Folio, coll. « Folio classique », 2001, V. § 116 et § 123-132).
[3] P.-S. Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris, Christian Bourgeois, 1986, pp. 32-33.
[4] P. Berger, « Chaos, hasard et prédictibilité », Revue Études, octobre 1994.
[5] P.-S. Laplace, op. préc., pp 32_33.
[6] E. Morin, op. préc., p. 33.
[7] Ibid., p. 34
[8] Cité in R. Taton, Histoire générale des sciences, Paris : P.U.F., 1957, T. I, p. 217.
[9] Sur la notion d’entropie, V. J. Gribbin, Le chaos, la complexité et l’émergence de la vie, éd. Flammarion, 2006. ; Ch. Brunold, L’entropie : son rôle dans le développement historique de la thermodynamique, Masson, 1930, 221 p. ; H. Atlan, Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation du vivant, Seuil, coll. « Points sciences », 1979.
[10] R. Lestienne, Les fils du temps, Presses du C.N.R.S., Paris, 1990, p. 171.
[11] V. en ce sens C. Flammarion, La Fin du monde, Ernest Flammarion, 1894.
[12] Ainsi, Bossuet se méprend-il sur la signification du concept d’anarchie lorsqu’il écrit qu’« il n’y a rien de pire que l’anarchie, c’est-à-dire de vivre sans gouvernement et sans lois » (J.-B. Bossuet, De la connaissance de Dieu et de soi-même, Hachette Livre BNF, coll. « Philosophie », 2013. I, 13).
[13] P.-J. Proudhon, Qu’est-ce que la propriété ?, Paris, 2e éd., 1848, p. 251.
[14] P.-J. Proudhon, Les Confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de la révolution de février, 1849, cité in B. Gourmelen et J. Le Goff, À la Découverte des Organisations pour une Approche Méthodologique Sociologique et Economique, L’Harmattan, 2012, p. 154.
[15] M. Orrù, L’anomie : histoire et sens d’un concept, L’Harmattan, 1998, p. 30.
[16] V. en ce sens Marco Orrù faisant référence à Karl Popper (Ibid., p. 42).
[17] Ibid.
[18] Ibid., p. 50.
[19] V. en ce sens E. Durkheim, De la division du travail social, PUF, coll. « Quadrige », 2007, 416 p.
[20] J.-M. Guyau, L’irreligion de l’avenir : études sociologiques, BiblioBazaar, 2008, 516 p.
[21] P., Talcott, Éléments d’une sociologie de l’action, trad. de F. Bourricaud, Paris, Plon, 1955, pp. I-VI.
[22] V. en ce sens R. Merton, On social structure and Science, University of Chicago Press, 1996.

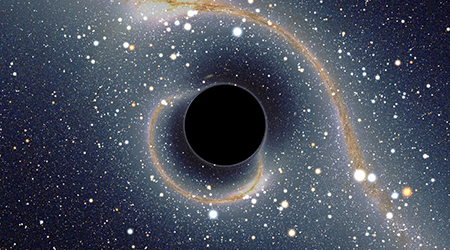


No comment yet, add your voice below!