En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.
Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :
- D’une part, à l’assiette de l’usufruit
- D’autre part, à l’exercice de l’usufruit
Nous nous focaliserons ici sur la détermination de l’assiette de l’usufruit
L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».
Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?
1. Les biens compris dans la catégorie des biens existants
==>Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt
Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.
Dans le détail, il s’agit :
- D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
- D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt
À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.
Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant.
Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs.
En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires.
==>L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien
En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant.
Pourtant, il n’en est rien. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants.
Aussi, il y a bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants, les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel.
2. Les biens exclus de la catégorie des biens existants
==>Les biens donnés
En application de l’article 757 du Code civil les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.
La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant.
À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires.
==>Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel
Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.
Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.
Aussi, le droit de retour légal s’analyse, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire.
Or une condition résolution produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour légal est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur.
Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants.
3. Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine
Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués.
Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.
Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.
Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil qui suggère la solution inverse.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse, tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ».
Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants.
Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.
S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doit être réintégré dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.
L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.
Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint.
S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.
Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant.
Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit.
Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.
Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.
Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs.
4. L’imputation des libéralités entre époux
Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.
On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer d’une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus.
Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable.
Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
- Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
- Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
- En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
- Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
- En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
- Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde »[4].
- Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
- La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
- Plus précisément, il y aura lieu d’imputer à l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
- Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
- Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.

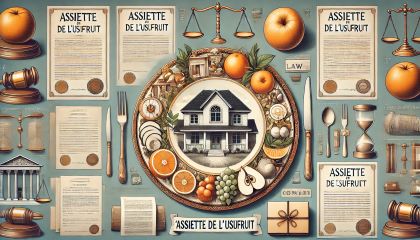


No comment yet, add your voice below!