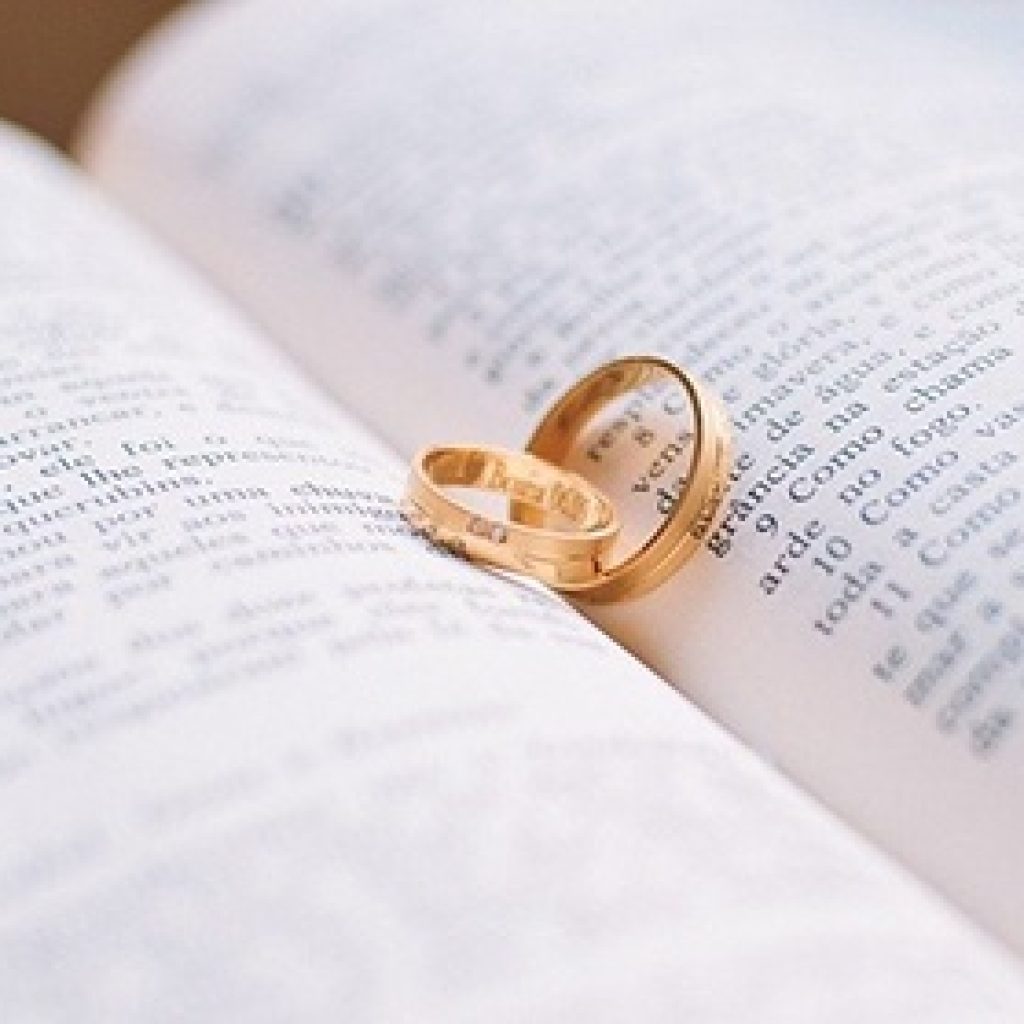Au cours de leur mariage les époux sont donc soumis au droit des régimes matrimoniaux s’agissant des rapports pécuniaires qu’ils entretiennent entre eux.
Ce droit des régimes matrimoniaux fait l’objet d’un traitement dans deux parties bien distinctes du Code civil, puisque envisagé, d’abord dans un chapitre consacré aux devoirs et aux droits respectifs des époux (art. 212 à 226 C. civ.), puis dans un titre dédié spécifiquement au contrat de mariage et aux régimes matrimoniaux (art. 1384 à 1581 C. civ.).
Cet éclatement du droit des régimes matrimoniaux à deux endroits du Code civil, révèle que les époux sont soumis à deux corps de règles bien distinctes :
- Premier corps de règles : le régime primaire impératif
- Les époux sont d’abord soumis à ce que l’on appelle un régime primaire impératif, également qualifié de statut matrimonial de base ou statut fondamental, qui se compose de règles d’ordre public applicables à tous les couples mariés.
- Il s’agit, en quelque sorte, d’un socle normatif de base qui réunit les principes fondamentaux régissant la situation patrimoniale du couple marié.
- À l’examen, ce sont, pour l’essentiel, des règles qui constituent l’essence même du mariage et qui intéressent le fonctionnement du ménage dans son quotidien : contributions aux charges du mariage, dettes ménagères, logement familial, présomptions de pouvoirs etc.
- Le régime primaire impératif est envisagé aux articles 212 à 226 du Code civil.
- Second corps de règles : le régime matrimonial
- Au régime primaire impératif qui constitue « le statut fondamental des gens mariés»[1], se superpose un régime matrimonial dont la fonction est :
- D’une part, de déterminer la composition des patrimoines des époux
- D’autre part, de préciser les pouvoirs dont les époux sont titulaires sur chaque masse de biens
- Nous nous focaliserons ici sur ce second corps de règles qui gouverne les différents régimes matrimoniaux.
- Au régime primaire impératif qui constitue « le statut fondamental des gens mariés»[1], se superpose un régime matrimonial dont la fonction est :
Au régime primaire impératif se superpose donc un régime matrimonial dont le choix est laissé à la discrétion des époux en application du principe de liberté des conventions matrimoniales.
L’article 1387 du Code civil dispose en ce sens que « la loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent. »
Il ressort de cette disposition que, non seulement les époux sont libres de choisir le régime matrimonial qui leur convient parmi ceux proposés par la loi, mais encore ils disposent de la faculté d’aménager le régime pour lequel ils ont opté en y stipulant des clauses particulières sous réserve de ne pas contrevenir aux bonnes mœurs et de ne pas déroger aux règles impératives instituées par le régime primaire.
Faute de choix par les époux d’un régime matrimonial, c’est le régime légal qui leur sera appliqué, étant précisé que le couple marié peut toujours, au cours du mariage, revenir sur sa décision en sollicitant un changement de régime matrimonial.
Classiquement, il est d’usage de présenter les différents régimes matrimoniaux susceptibles d’être appliqués aux époux en distinguant :
- D’une part, le régime légal qui a vocation à s’appliquer en l’absence de contrat de mariage
- D’autre part, les régimes dits conventionnels dont l’application suppose que les époux aient opté pour un dispositif spécifique.
I) Le régime légal
Le régime légal, qui s’applique aux couples mariés faute d’établissement d’un contrat de mariage, est le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Ce régime a été institué par la loi du 13 juillet 1965 qui l’a substitué à l’ancien régime légal de communauté de meubles et d’acquêts, lequel est désormais relégué au rang de régime conventionnel.
Dans les grandes lignes, la spécificité du régime légal tient à trois éléments qui diffèrent d’un régime matrimonial à l’autre :
==> La répartition des biens
Principale caractéristique du régime légal, il s’agit d’un régime communautaire. Cette spécificité implique la création d’une masse commune de biens aux côtés des biens propres dont les époux demeurent seuls propriétaires.
La réparation des biens entre la masse commune et la masse de chaque époux s’opère comme suit :
- Les biens communs
- La masse commune est alimentée par les tous les biens acquis à titre onéreux par les époux au cours du mariage.
- C’est ce que l’on appelle des acquêts ; d’où le qualificatif attribué au régime légal de « communauté réduite aux acquêts».
- Pour être précis les acquêts qui composent la masse commune comprennent deux catégories de biens :
- Tout d’abord, il y a les biens faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant de leur industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ( 1401 C. civ.)
- Ensuite, il y a tous les biens meubles, ou immeubles dont on ne peut prouver qu’ils sont propres à l’un des époux ( 1402 C. civ.).
- Ainsi la masse commune est-elle alimentée de deux manières : soit par le jeu d’une règle de fond, soit par le jeu d’une règle de preuve.
- Les biens propres
- Les biens propres sont, par hypothèse, tous ceux qui n’endossent pas la qualification d’acquêts.
- Plus précisément, cette catégorie de biens comporte notamment :
- Les biens acquis par les époux avant la conclusion du mariage
- Les biens acquis par les époux à titre gratuit
- Les biens dont la propriété est étroitement attachée à la personne d’un époux (vêtements et linges à usage personnel, actions en réparation d’un dommage corporel, créances et pensions incessibles etc.)
- Les biens de nature professionnelle
- Tous les biens acquis à titre accessoire d’un bien propre
==> La gestion des biens
Les époux sont investis de pouvoirs de gestion de leurs biens propres et des biens qui relèvent de la masse commune.
- S’agissant de la gestion des biens propres des époux
- Le principe posé par l’article 1428 du Code civil est celui de la gestion exclusive des biens propres.
- Ce principe est renforcé par l’article 225 du Code civil qui dispose que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels».
- Ainsi chaque époux dispose de pouvoirs d’administration, de disposition et de jouissance exclusifs sur ses propres.
- Ce pouvoir n’est contrarié que lorsque le logement familial est un bien propre.
- Dans cette hypothèse, conformément à l’article 215, al. 3e du Code civil l’époux auquel il appartient en propre devra obtenir le consentement de son conjoint pour en disposer.
- S’agissant de la gestion des biens communs
- L’article 1421 du Code civil pose un principe de gestion concurrence.
- Cela signifie que chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer sans avoir à obtenir le consentement de l’autre.
- Par exception, certains biens communs font l’objet d’une gestion exclusive, tels que les revenus des biens propres, les gains et salaires ou encore les biens nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle séparée, tandis que d’autres sont soumis à une cogestion, soit dont la disposition exige le commun accord des époux.
==> La répartition du passif
Les règles de répartition du passif permettent de déterminer l’étendue du gage des créanciers et plus précisément les masses de biens qui devront supporter les dettes contractées par les époux.
À cet égard, il y a lieu de distinguer, l’obligation à la dette qui intéresse les rapports des époux avec les tiers, de la contribution à la dette qui intéresse les rapports des époux entre eux.
Autrement dit, l’obligation à la dette permet de déterminer sur quelle masse de biens (commune ou propre) la dette contractée auprès des créanciers est exécutoire.
Quant à la contribution à la dette, elle permet de déterminer laquelle de ces masses de biens va, à titre définitif, supporter le poids de la dette.
Cette dichotomie entre obligation à la dette et contribution à la dette doit être envisagée, tant pour les dettes personnelles des époux, que pour les dettes communes.
- S’agissant des dettes personnelles d’un époux
- Au stade de l’obligation à la dette
- La règle posée par l’article 1411, al. 1er du Code civil est que la dette contractée à titre personnelle par un époux est exécutoire sur ses biens propres, mais encore sur ses gains et salaires qui sont des biens communs
- Il en résulte, a contrario, qu’une dette personnelle n’est pas exécutoire sur la masse commune et les biens propres de l’autre époux
- Au stade de la contribution à la dette
- La règle est ici que les dettes contractées à titre personnel par un époux doivent demeurer personnelles.
- Dès lors, en cas de règlement d’une dette personnelle par un époux avec ses gains et salaires, il devra récompense à la communauté, celle-ci n’ayant pas vocation à supporter le poids définitif d’une dette propre.
- Au stade de l’obligation à la dette
- S’agissant des dettes communes
- Au stade de l’obligation à la dette
- Le principe posé par l’article 1413 du Code civil est que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs.
- Autrement dit, les dettes contractées par chaque époux sont exécutoires sur les biens communs.
- À cet égard, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
- Au stade de la contribution à la dette
- La communauté n’a vocation à supporter, à titre définitif, que les dettes contractées dans son intérêt.
- Lorsque tel n’est pas le cas, elle aura droit à récompense, ce qui sera notamment le cas lorsque la dette réglée avec des biens communs aura été souscrite en vue d’acquérir, de conserver ou d’améliorer un bien propre.
- Au stade de l’obligation à la dette
II) Les régimes conventionnels
Pour être soumis à un régime conventionnel les époux doivent avoir effectué un choix qui se traduira par l’établissement d’un contrat de mariage.
À cet égard, les régimes conventionnels se divisent en deux catégories : les régimes communautaires et les régimes séparatistes.
==> S’agissant des régimes communautaires
Leur spécificité est, comme leur énoncé l’indique, de reposer sur la création d’une masse commune de biens qui s’interpose entre les masses de chaque époux composées de biens propres appartenant à chacun d’eux.
Parmi les différents régimes conventionnels proposés par la loi, deux endossent la qualification de communautaire
- Le régime de la communauté de meubles et d’acquêts
- Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, le régime de la communauté de meubles et d’acquêts n’était autre que le régime légal.
- Depuis lors, il a néanmoins été remplacé par le régime de la communauté réduite aux acquêts, à tout le moins il a été rétrogradé au rang de simple régime conventionnel.
- La spécificité de ce régime matrimonial tient aux règles qui gouvernent l’actif et le passif de la communauté
- S’agissant de l’actif
- Lorsque les époux optent pour la communauté de meubles et d’acquêts, l’actif de la communauté est augmenté par rapport au régime légal.
- En effet, il comprend, outre les biens qui relèvent de la masse commune sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les bens meubles qui seraient qualifiés de propres sous ce régime.
- Sont donc inclus dans la masse commune, lorsque les époux sont soumis au régime de communauté de meubles et d’acquêts, tous les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n’ait stipulé le contraire.
- S’agissant du passif
- Par symétrie avec la composition de l’actif, lorsque les époux ont opté pour le régime de la communauté de meubles et d’acquêts, le passif de la communauté est plus étendu que sous le régime légal.
- En effet, entrent dans le passif commun, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage.
- À cet égard, la fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d’actif qu’elle recueille, soit dans le patrimoine de l’époux au jour du mariage, soit dans l’ensemble des biens qui font l’objet de la succession ou libéralité.
- Il s’agit ici d’instaurer une corrélation entre l’actif et le passif : dès lors que l’actif augmenté, le passif doit s’en trouver élargi dans les mêmes proportions.
- S’agissant de l’actif
- Le régime de la communauté universelle
- Le régime de la communauté universelle, qualifié de « régime de l’amour» par le doyen Cornu présente cette particularité de réaliser une fusion entre les patrimoines des époux pour ne former qu’une seule masse de biens.
- Cette fusion des patrimoines se traduit, tant sur le plan de l’actif, que sur le plan du passif.
- Sur le plan de l’actif
- La communauté comprend les biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir des époux.
- Par exception et sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.
- Sont donc exclus de la masse commune
- D’une part, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
- D’autre part, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
- En dehors de ces biens visés par l’article 1404 du Code civil, tous les biens acquis par les époux avant et pendant le mariage ont vocation à alimenter la masse commune
- Sur le plan de l’actif
- L’article 1526 du Code civil prévoit que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
- L’universalité de la communauté ne touche ainsi pas seulement son acte, elle intéresse également son passif.
- Sur le plan de l’actif
==> S’agissant des régimes séparatistes
Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux.
Cette séparation des patrimoines demeure néanmoins plus ou moins prononcée, selon que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple ou selon qu’ils ont opté pour le régime de la participation aux acquêts.
- Le régime de la séparation de biens
- Sur le plan de l’actif
- Tous les biens acquis par les époux au cours du mariage leur appartiennent en propre.
- Aucune masse commune de biens n’est créée, de sorte qu’est instaurée une séparation stricte des patrimoines.
- À cet égard, l’article 1536 du Code civil prévoit que lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
- Il est donc indifférent que le bien ait acquis avant ou pendant le mariage ou encore qu’il ait été acquis à titre onéreux ou à titre gratuit.
- Seules exceptions au principe de séparations :
- Les biens acquis en indivision
- L’affectation de certains biens à une société d’acquêts
- Sur le plan du passif
- L’article 1536 du Code civil dispose que chaque époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220.
- La séparation des patrimoines opère ainsi, tant pour l’actif, que pour le passif qui demeure propre à l’époux qui a contracté la dette.
- Le gage des créanciers se limite ainsi aux seuls biens propres de l’époux qui s’est engagé, sauf à ce que la dette relève de la catégorie des dépenses ménagères.
- Sur le plan de l’actif
- Le régime de la participation aux acquêts
- Le régime de la participation aux acquêts a été institué par la loi du 13 juillet 1965, le législateur s’étant inspiré de ce qui était pratiqué en Allemagne.
- La particularité de ce régime est qu’il présente une nature hybride, en ce sens qu’il présente une nature séparatiste ou communautaire selon que l’on se place pendant la durée du mariage ou au jour de sa dissolution.
- Pendant la durée du mariage
- En application de l’article 1569 du Code civil, quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu’il a acquis pendant le mariage à titre onéreux.
- Aussi, pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
- Aucune masse commune de biens n’est donc créée : tous les biens acquis par les époux avant ou pendant le mariage, à titre gratuit ou onéreux, leur appartiennent en propre, soit à titre exclusif.
- Réciproquement, toutes les dettes qu’ils contractent leur demeurent également personnelles.
- Au jour de la dissolution du mariage
- L’article 1569 du Code civil prévoit que, à la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.
- Autrement dit, au jour de la liquidation du régime de participation aux acquêts, l’époux dont le patrimoine s’est enrichi pendant le mariage doit en valeur à l’autre une créance de participation.
- Cette créance est déterminée en comparant le patrimoine originaire et le patrimoine final.
- L’article 1575 du Code civil dispose en ce sens que si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux.
- Si, en revanche, il lui est supérieur, l’accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
- S’il y a des acquêts nets de part et d’autre, ils doivent d’abord être compensés.
- Seul l’excédent se partage : l’époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
- Au moment de la dissolution le régime de la participation aux acquêts est ainsi parcouru par un esprit communautaire.
- Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre.
- Pendant la durée du mariage