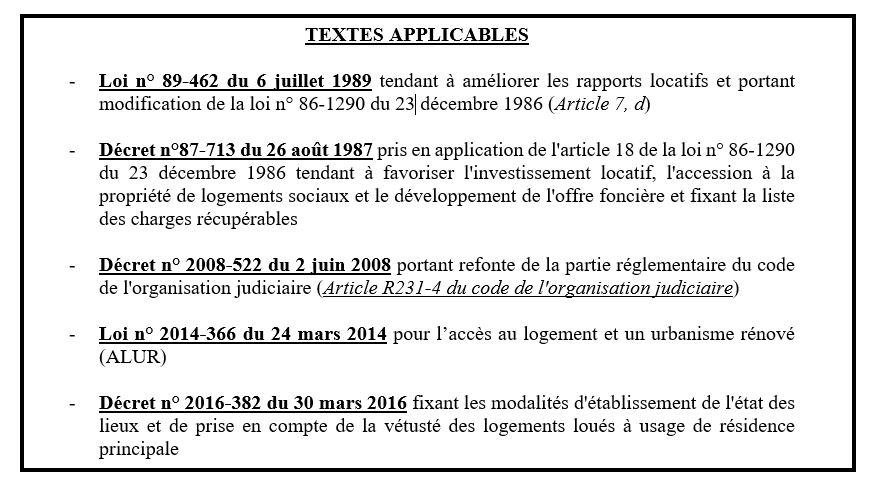
I) Le contenu de l’obligation de réparation et d’entretien du logement loué
Parmi les diverses obligations qui échoient au titulaire d’un bail d’habitation, la loi du 6 juillet 1989 (article 7, d), prévoit qu’il appartient au locataire :
« De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure»
Deux obligations distinctes ressortent de ce texte :
- L’obligation d’entretien courant du logement et de ses équipements
- L’obligation d’assurer les menues réparations et réparations locatives
A) L’obligation d’entretien courant du logement et de ses équipements
Trois questions ici se posent :
- Que doit-on entendre par « entretien courant » ?
La loi ne définit pas la notion d’entretien courant.
On peut néanmoins conjecturer que la notion d’entretien courant renvoie aux mesures que doit prendre le locataire au quotidien, tout au long de la durée du bail, afin d’éviter que le logement et ses équipements ne se dégradent.
À charge pour le bailleur d’intervenir ponctuellement pour assurer la réalisation des gros travaux d’entretien (toiture, ravalement etc.)
- Quelle est l’étendue de l’obligation d’entretien courant ?
Le locataire n’est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de ses équipements que dans la limite de ce qui figure au contrat.
Ainsi, seuls les équipements mentionnés dans le contrat de bail doivent être entretenus par le locataire.
S’ils n’y figurent pas, aucune obligation ne pèse sur le locataire. Qui plus est, ils ne sont pas censés être loués.
- L’obligation d’entretien courant persiste-t-elle en cas de vétusté du logement et de ses équipements ?
Dans un arrêt du 23 février 1994, la Cour de cassation a apporté une réponse positive à cette question (Cass. 3e civ., 23 févr. 1994, n° 92-11.238).
Ainsi a-t-elle estimé que la vétusté des lieux ne fait pas obstacle à l’exécution de l’obligation d’entretien du logement et de ses équipements.
B) L’obligation d’assurer les menues réparations et réparations locatives
L’article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit qu’il appartient au locataire d’assurer :
« les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure »
Deux éléments ressortent de ce texte :
- Un principe: le locataire doit assurer les menues réparations et les réparations locatives
- Une exception : en cas de « vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure » le locataire est dispensé d’exécuter l’obligation de réparation qui, en principe, lui échoit
==> Le principe
Il échoit donc au locataire d’assurer les menues réparations et autres réparations locatives.
La question qui se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « réparations locatives ».
Pour le savoir, il convient de se référer au décret n°87-713 du 26 août 1987 comme l’y invite la loi.
À l’examen, ce décret nous renseigne principalement sur deux choses :
- La définition des réparations locatives
- La liste des réparations locatives
- La définition des réparations locatives
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en son article 1er définit les réparations locatives comme :
« les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. »
2. Liste des réparations locatives
Le décret du 26 août 1987 établit une liste des réparations locatives qui répondent à la définition qu’il en donne.
a) Caractère non-limitatif de la liste
Il peut être observé que cette liste ne revêt aucun caractère limitatif.
Cela a été rappelé par la Cour de cassation notamment dans un arrêt du 7 avril 1994 (Civ. 3e, 7 avr. 1994, no 92-16.432)
b) Contenu de la liste
Parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif
- Jardins privatifs
- Entretien courant, notamment des
- Allées
- Pelouses
- Massifs
- Bassins
- Piscines
- Taille, élagage, échenillage des
- arbres
- arbustes
- haies
- Remplacement des arbustes
- réparation et remplacement des installations mobiles d’arrosage.
- Entretien courant, notamment des
- Auvents, terrasses et marquises
- Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
- Descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières
- Dégorgement des conduits.
Ouvertures intérieures et extérieures
- Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres
- Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
- Menues réparations
- des boutons et poignées de portes
- des gonds
- crémones
- espagnolettes
- Remplacement notamment de
- boulons
- clavettes
- targettes
- Vitrages
- Réfection des mastics
- Remplacement des vitres détériorées
- Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies
- Graissage
- Remplacement notamment de
- Cordes
- Poulies
- de quelques lames.
- Serrures et verrous de sécurité
- Graissage
- Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
- Grilles
- Nettoyage
- Graissage
- Remplacement notamment de
- Boulons
- Clavettes
- targettes
Parties intérieures
- Plafonds, murs intérieurs et cloisons
- Maintien en état de propreté
- Menus raccords de peintures et tapisseries
- remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que
- faïence
- mosaïque
- matière plastique
- Rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci
- La Cour d’appel de Versailles a estimé que le bailleur était fondé à réclamer au locataire le paiement du coût de réfection du plafond d’une pièce du logement loué présentant 23 trous de cheville (CA Versailles, 1re ch. B, 18 sept. 1998).
- Parquets, moquettes et autres revêtements de sol
- Encaustiquage et entretien courant de la vitrification
- Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état
- Pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
- Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures
- Remplacement des tablettes et tasseaux de placard
- Réparation de leur dispositif de fermeture
- Fixation de raccords
- Remplacement de pointes de menuiseries.
Installations de plomberie
- Canalisations d’eau
- Dégorgement
- Remplacement notamment de joints et de colliers.
- Canalisations de gaz
- Entretien courant des
- Robinets
- Siphons
- ouvertures d’aération
- Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
- Entretien courant des
- Fosses septiques, puisards et fosses d’aisance
- Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie
- Remplacement des
- Bilames
- Pistons
- Membranes
- boîtes à eau
- allumage piézo-électrique
- clapets
- joints des appareils à gaz
- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
- Remplacement des
- Éviers et appareils sanitaires
- Nettoyage des dépôts de calcaire
- remplacement des tuyaux flexibles de douches.
Equipements d’installations d’électricité
- Remplacement des
- Interrupteurs
- Prises de courant
- Coupe-circuits et fusibles
- Ampoules
- Tubes lumineux
- Réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection
Autres équipements mentionnés au contrat de location
- Entretien courant et menues réparations des appareils tels que
- Réfrigérateurs
- machines à laver le linge et la vaisselle
- sèche-linge
- hottes aspirantes
- adoucisseurs
- capteurs solaires
- pompes à chaleur
- appareils de conditionnement d’air,
- antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision
- meubles scellés
- cheminées
- glaces et miroirs
- Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets
- Graissage et remplacement des joints des vidoirs
- Ramonage
- des conduits d’évacuation des fumées et des gaz
- des conduits de ventilation
==> L’exception
En vertu de l’article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire n’est pas tenu de satisfaire à son obligation de prendre en charge les réparations locatives en cas de :
« vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure »
Dans ces trois hypothèses, les réparations locatives doivent être assurées par le bailleur. Deux conditions doivent être remplies :
- Il appartient au locataire de prouver l’existence d’un désordre ou d’un cas de force majeure ( 3e civ., 20 déc. 1995, n° 93-20.288)
- L’état de vétusté ne doit pas être le fait de la négligence du locataire quant à l’entretien du logement ( 3e civ., 25 mai 1976).
Deux questions alors se posent :
- que doit-on entendre par « vétusté » ?
- Que doit-on entendre par « force majeure » ?
- Notion de vétusté
Le décret n°2016-382 du 30 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juin 2016, précise les modalités de prise en compte de l’état de vétusté des logements vides ou meublés, loués à usage de résidence principale.
La vétusté y est définie (article 4) comme :
« l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement »
Afin d’évaluer la vétusté du logement, les parties au contrat de location peuvent :
- Soit convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif de location conclu conformément à l’article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 susvisée, même si le logement en cause ne relève pas du secteur locatif régi par l’accord.
- Soit convenir de l’application d’une grille de vétusté choisie parmi celles ayant fait l’objet d’un accord collectif local conclu en application de l’article 42 de la même loi, même si le logement en cause ne relève pas du patrimoine régi par l’accord.
Dans tous les cas, cette grille définit au minimum, pour les principaux matériaux et équipements du bien loué, une durée de vie théorique et des coefficients d’abattement forfaitaire annuels affectant le prix des réparations locatives auxquelles serait tenu le locataire.
2. La notion de force majeure
L’article 1218, al. 1 du Code civil définit la force majeure comme
L’« événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »
L’alinéa 2 de cette même disposition précise que :
« Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
II) La sanction de l’inexécution de l’obligation de réparation et d’entretien du logement loué
Dans l’hypothèse où le locataire ne satisferait pas à ses obligations, le bailleur dispose de deux actions :
- Soit, il peut réclamer l’exécution forcée en nature de l’obligation d’assurer les réparations locatives (article 1217 du Code civil)
- L’article 1222 précise que :
- « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
- Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.»
- L’article 1222 précise que :
- Soit, il peut provoquer la résiliation du bail (article 1217 du Code civil)
- En sollicitant cette résiliation auprès du juge
- Ou en se passant du juge, mais à ses risques et périls, car si la résiliation n’est pas fondée, il s’expose au paiement de dommages et intérêts
- L’article 1226 prévoit en ce sens que :
- « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
- La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
- Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
- Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
- L’article 1226 prévoit en ce sens que :