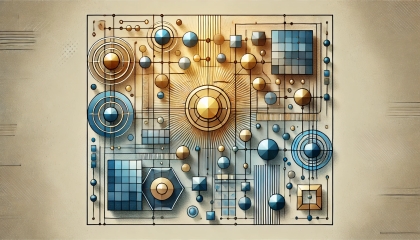Le droit de provoquer le partage incarne le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans une indivision contre son gré. Toutefois, l’exercice de cette prérogative n’est pas absolu. Il est encadré par des conditions précises, destinées à concilier les intérêts parfois divergents des indivisaires et des tiers, tout en préservant l’équilibre patrimonial. Au nombre des conditions devant être réunies figurent la préexistence d’une indivision juridiquement constituée, l’existence de biens partageables, ainsi que l’absence de toute prescription extinctive affectant ce droit. À ces exigences générales s’ajoutent des conditions spécifiques lorsqu’un bien indivis fait l’objet d’un démembrement de propriété, imposant une articulation subtile entre les droits concurrents d’usufruit et de nue-propriété. C’est dans le respect de ces exigences que le partage pourra pleinement produire ses effets, tout en préservant l’équité entre les copartageants.
A) Préexistence d’une indivision
1. Les éléments constitutifs de l’indivision
Bien que la notion d’indivision constitue une pierre angulaire du droit des biens, elle n’est définie par aucun texte.
Aussi, s’est-elle principalement construite à travers la doctrine et la jurisprudence, lesquelles se sont appuyés sur les articles 815 et suivants du Code civil.
De nombreuses approches de la notion d’indivision ont été proposées par les auteurs. Nous nous limiterons à en proposer trois :
- L’approche classique
- Selon cette approche, l’indivision désigne la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coïndivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
- Chaque coïndivisaire est réputé propriétaire de l’ensemble du bien, mais uniquement pour sa part et portion, soit sans pouvoir revendiquer un droit exclusif sur une partie déterminée du bien.
- Cette approche repose sur une dissociation entre la chose, qui reste matériellement indivise, et le droit de propriété, qui a pour objet une quote-part abstraite attribuée à chaque propriétaire.
- Ce droit n’est pas lié à une portion physique du bien, mais à une fraction arithmétique de la propriété totale, chaque indivisaire ayant un droit qui s’exerce sur chaque élément de la chose, sans qu’il soit possible d’identifier matériellement cette part.
- L’approche fonctionnelle
- Certains auteurs envisagent l’indivision en contemplation de sa fonction.
- Pour eux, l’indivision est intrinsèquement provisoire, en ce sens qu’elle n’est pas une fin en soi mais un moyen temporaire de gérer un bien en attendant une résolution plus définitive de la situation à laquelle il est mis fin par l’opération de partage.
- Cette conception s’appuie sur l’idée que les situations d’indivision naissent souvent de circonstances qui requièrent un dénouement futur.
- Tel est notamment le cas lorsque l’indivision résulte d’une succession, d’un divorce ou de la dissolution d’une personne morale.
- Dans le cadre d’une succession, par exemple, l’indivision survient lorsque les héritiers héritent d’un patrimoine commun sans qu’une répartition immédiate des biens soit possible ou souhaitée.
- Le temps nécessaire à l’évaluation des actifs, au paiement des dettes du défunt, et à l’accord entre les parties sur la répartition des biens rend l’indivision inévitable.
- De la même façon, lors d’un divorce, les ex-conjoints peuvent se retrouver en situation d’indivision pour la résidence familiale ou d’autres biens, jusqu’à ce que des arrangements financiers et personnels plus permanents puissent être mis en place.
- Ces situations constituent, par nature, des terrains fertiles aux conflits entre coïndivisaires, car chaque partie peut avoir des attentes, des besoins financiers et des projets de vie divergents.
- Les tensions peuvent surgir autour de la gestion des biens, leur utilisation, leur éventuelle valorisation ou leur vente.
- L’indivision apparaît alors comme une solution permettant :
- D’une part, d’assurer une transition vers la liquidation définitive des droits dont sont investies les parties sur un ou plusieurs biens
- D’autre part, de prévenir les risques de mésententes, la loi offrant des mécanismes permettant aux coïndivisaires de demander à tout moment le partage, mais également des possibilités de gestion du bien par un ou plusieurs indivisaires voire, en cas de conflits, par un administrateur provisoire
- L’approche économique
- Il est des auteurs qui appréhendent l’indivision au regard de sa fonction économique.
- Plus précisément, selon les tenants de cette approche, l’indivision offre une structure permettant une gestion collective des biens qui peut être plus efficace que la gestion individuelle, surtout dans des contextes où les ressources et compétences sont partagées.
- Tel est notamment le cas s’agissant de la gestion d’un patrimoine ou d’une entreprise familiale.
- Par ailleurs, l’indivision peut se révéler être un formidable outil permettant de réaliser des économies d’échelle en mutualisant les coûts liés à la gestion, l’entretien, et la valorisation des biens.
- Par exemple, dans le cas d’une grande propriété agricole ou d’un immeuble, la gestion collective peut réduire les coûts unitaires et améliorer la rentabilité globale du patrimoine.
- De plus, elle évite la fragmentation des biens qui pourrait en réduire la valeur économique et compliquer leur gestion.
- Des auteurs voient également l’indivision comme une étape préparatoire au partage définitif des biens.
- La période d’indivision peut servir à évaluer la meilleure manière de diviser les biens sans compromettre leur valeur économique ou leur utilité.
- Cette phase peut être cruciale pour les entreprises familiales où un partage prématuré ou mal planifié pourrait nuire à l’entreprise elle-même.
- Enfin, l’indivision peut être une forme d’organisation économique et sociale bénéfique, surtout lorsque les biens sont destinés à rester dans un cadre familial ou communautaire.
- Elle permet non seulement une gestion efficace mais aussi un moyen de préserver le patrimoine pour les générations futures.
Malgré les différences qui distinguent ces approches, elles ont pour point commun d’admettre que l’existence d’une situation d’indivision est toujours subordonnée à la réunion de trois éléments constitutifs :
- Une pluralité de personnes exerçant des droits concurrents
- Les droits dont sont titulaires ces personnes doivent être de même nature
- Ces droits doivent porter sur un même bien
a. Pluralité de personnes
Parce que l’indivision constitue une forme de propriété collective, elle ne se conçoit qu’en présence d’une pluralité de personnes qui exercent des droits concurrents sur un ou plusieurs biens.
Cette exigence conduit à exclure du domaine de l’indivision deux situations juridiques résultant des opérations que sont :
- D’une part, la clause d’accroissement
- D’autre part, le compte joint
==>La clause d’accroissement
La clause d’accroissement, qualifiée également de tontine ou de pacte tontinier, désigne le dispositif contractuel aux termes duquel plusieurs personnes stipulent dans l’acte d’acquisition d’un bien que, à la mort de l’un des acquéreurs, ses droits sur le bien accroissent ceux des survivants, jusqu’à ce que le dernier vivant devienne l’unique propriétaire.
Ce contrat vise ainsi, à chaque décès successif, à concentrer la propriété du bien sur la tête des survivants, le dernier survivant étant réputé avoir été le seul propriétaire dès l’origine de l’acquisition du bien.
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait prohibé les clauses d’accroissement, considérant qu’elles s’analysaient en des pactes sur succession future (Cass. req. 24 janv. 1928).
Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la stipulation de telles clauses.
Pour échapper à la qualification de pacte sur succession future, la clause d’accroissement doit toutefois présenter un caractère aléatoire et être stipulée à titre onéreux (Cass. 3e civ. 3 févr. 1959).
Une fois le principe de validité des clauses d’accroissement acquis, la question se pose de savoir si la conclusion d’un pacte de tontine ne créerait pas une situation d’indivision entre les tontiniers.
À cette question, la Haute juridiction répond par la négative. Elle a effet jugé dans un arrêt du 27 mai 1986 que la clause d’accroissement rend « jusqu’au décès du prémourant incompatibles entre eux les droits des parties à la propriété de l’immeuble litigieux puisque seul le survivant en était titulaire depuis la date d’acquisition de ce bien » (Cass. 1ère civ. 27 mai 1986, n°85-10.031).
Il ressort de cette décision que la clause d’accroissement n’a nullement pour effet de conférer la qualité de propriétaire aux parties de telle sorte qu’ils se retrouveraient dans une situation d’indivision.
En application de cette clause, ce n’est que celui qui survit à tous les autres qui est réputé avoir été le seul propriétaire du bien. Quant à ceux prédécédés, ils sont réputés n’avoir jamais rien acquis.
À l’analyse, le pacte de tontine repose sur une technique juridique qui combine :
- D’une part, une condition suspensive de la survie : elle confère au dernier survivant la propriété du bien acquis en tontine
- D’autre part, une condition résolutoire du décès : elle dénie aux prémourants la qualité de propriétaire du bien acquis en tontine
Parce que la réalisation de ces deux conditions opère rétroactivement, les tontiniers ne peuvent jamais être titulaires, en même temps, d’un droit de propriété sur le bien.
D’où la position de la Cour de cassation qui n’admet pas la création d’une situation d’indivision par l’effet d’une clause d’accroissement.
Dans un arrêt du 17 décembre 2013, la Troisième chambre civile a ainsi expressément affirmé que « l’achat en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement est exclusif de l’indivision » (Cass. 3e civ. 17 déc. 2013, n°12-15.453).
La conséquence en est l’impossibilité pour les tontiniers de solliciter le partage du bien à l’instar de la faculté reconnue aux coïndivisaires.
Compte tenu de l’absence d’indivision, est-ce à dire que les parties au pacte de tontine ne seraient investies d’aucuns droits concurrents sur le bien ? Il n’en est rien.
Dans un arrêt du 9 février 1994, la Cour de cassation a jugé que si la clause d’accroissement est exclusive de toute indivision « puisqu’il n’y aura jamais eu qu’un seul titulaire du droit de propriété », en revanche, tant que la condition suspensive – de survie – ne s’est pas réalisée, « les parties ont des droits concurrents qui emportent le droit pour chacune d’entre elles de jouir indivisément du bien » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 1994, n°92-11.111).
Autrement dit, la clause d’accroissement a pour effet de créer une situation d’indivision, non pas en propriété, mais en jouissance à tout le moins tant qu’au moins deux tontiniers sont encore en vie
Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation en a déduit la faculté pour une partie de réclamer à l’autre une indemnité de jouissance au titre de l’occupation exclusive du bien acquis en tontine (Cass. 1ère civ. 9 nov. 2011, n°10-21.710).
==>Le compte joint
L’ouverture d’un compte joint est le fait, le plus souvent, des personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage qui l’utilisent aux fins d’accomplir les opérations relatives à l’entretien du ménage.
Il se caractérise par la situation de ses cotitulaires qui exercent les mêmes droits sur l’intégralité des fonds inscrits en compte.
Compte tenu de l’existence d’une situation de concours entre les droits des cotitulaires d’un compte joint, la question se pose de savoir si l’ouverture d’un tel compte ne créerait pas une situation d’indivision.
Une brève analyse du régime juridique applicable au compte joint conduit à répondre par la négative.
En effet, le compte joint est régi par les principes de solidarité active et passive. Or il s’agit là de deux principes qui sont incompatibles avec le mécanisme de l’indivision.
- S’agissant de la solidarité active
- Elle confère une grande autonomie de gestion aux cotitulaires d’un compte joint.
- Chacun peut accomplir seul des opérations susceptibles d’affecter la totalité du compte sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’approbation des autres titulaires.
- Cette autonomie contraste fortement avec le régime de l’indivision où chaque acte de gestion nécessite, par principe, l’accord de tous les coïndivisaires, à tout le moins de la majorité d’entre eux pour l’accomplissement de certains actes.
- S’agissant de la solidarité passive
- Elle implique que chaque titulaire du compte est tenu solidairement par les engagements souscrits par tous les autres.
- Ainsi, en cas de solde débiteur, le banquier peut se retourner contre n’importe quel titulaire du compte et lui réclamer le paiement de l’intégralité des sommes dues.
- Cette solidarité passive qui lie les cotitulaires d’un compte joint ne se retrouve pas dans une indivision.
- En effet, les coïndivisaires ne sont tenus qu’à une obligation conjointe envers les créanciers de l’indivision, ce qui signifie qu’ils ne peuvent être actionnés en paiement qu’à concurrence de la quote-part qu’ils détiennent.
b. Identité des droits
==>Principe
Pour que plusieurs propriétaires soient regardés comme se trouvant en situation d’indivision, ils doivent être titulaires de droits concurrents qui sont de même nature.
Par même nature, il faut comprendre que les droits réels qui sont en concours portent sur un ou plusieurs démembrements du droit de propriété qui correspondent.
Ainsi, par exemple, il ne saurait y avoir d’indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire.
La raison en est que les droits de nue-propriété et d’usufruit ne confèrent pas à leurs titulaires les mêmes prérogatives de sorte qu’ils peuvent être exercés séparément.
Or cette séparation quant à l’exercice de droits réels est incompatible avec le fonctionnement unitaire d’une indivision dont la gestion est gouvernée par le principe de codécision.
Au fond, tandis que les coïndivisaires se tiennent côte à côte, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont placés dans des situations qui se superposent.
À cet égard, la jurisprudence est constante sur cette question. Dans un arrêt du 31 octobre 2000 la Cour de cassation a expressément affirmé qu’« il est de principe qu’il n’y a pas indivision entre usufruitier et nu-propriétaire » (Cass. 3e civ. 31 oct. 2000, n°97-20.732).
Dans un arrêt du 12 février 2020, elle a encore jugé « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1ère civ. 12 févr. 2020, n°18-22.537).
L’enjeu ici réside dans la faculté des titulaires de droits réels de solliciter le partage du bien et plus précisément pour un usufruitier et un nu-propriétaire de mettre fin prématurément au démembrement du droit de propriété.
La fin de ce démembrement ne peut toutefois intervenir qu’à la mort de l’usufruitier. Aussi, ne saurait-on contourner cette règle en convoquant des droits – au cas particulier le droit au partage – qui ne sont reconnus qu’aux seuls titulaires de droits indivis.
Il peut être observé que le même raisonnement peut être tenu s’agissant du tréfonds (la propriété du sous-sol) et de la superficie (la propriété de la surface).
En effet, l’un et l’autre font l’objet de droits de propriétés distincts, de sorte que le tréfoncier et le superficiaire ne sauraient être regardés comme se trouvant en situation d’indivision.
À l’instar de l’usufruitier et du nu-propriétaire, ils sont titulaires de droits, non pas qui se tiennent côte à côte, mais qui se superposent.
==>Mise en œuvre
Si l’exigence d’identité des droits conduit à dénier au nu-propriétaire et à l’usufruitier la qualité de coïndivisaire, il est en revanche admis que puisse exister une situation d’indivision entre titulaires de démembrements du droit de propriété, pourvu que ces démembrements soient de même nature.
Dans un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « l’indivision s’entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien [de sorte] qu’elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).
Aussi, l’indivision est-elle susceptible d’intervenir dans plusieurs configurations :
- Concours entre droits de nue-propriété
- Il est des cas où la nue-propriété d’un bien appartient à plusieurs personnes.
- Dans cette configuration, elles se trouveront alors en situation d’indivision.
- Il en résulte que chaque nue-propriétaire pourra se prévaloir de son droit au partage de la nue-propriété.
- Concours entre droits d’usufruit
- Lorsque l’usufruit appartient à plusieurs usufruitiers il est également admis qu’existe entre eux une situation d’indivision.
- Là encore, chaque usufruitier pourra faire valoir son droit à provoquer un partage de l’usufruit.
- Concours entre droits d’usage et d’habitation
- Pour mémoire, les droits d’usage et d’usufruit ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
- S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
- S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
- Parce qu’ils s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit, les droits d’usage et d’habitation s’analysent en des droits réels.
- La question qui alors se pose est de savoir s’il se crée, lorsqu’ils sont en concours, une situation d’indivision.
- À cette question, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative dans son arrêt rendu le 7 juillet 2016.
- Aux termes de cette décision, elle a jugé, en effet, que « le propriétaire d’un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant conjointement sur le bien et qu’il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d’usage et d’habitation » (Cass. 3e civ. 7 juill. 2016, n°15-10.278).
- Pour mémoire, les droits d’usage et d’usufruit ne sont autres que des diminutifs de l’usufruit en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose :
- Concours entre l’usufruit et la pleine propriété
- Il peut arriver qu’un droit d’usufruit soit en concours avec un droit de pleine propriété.
- Ce cas correspond à l’hypothèse où l’usufruit n’est que partiel, et que le surplus appartienne à une ou plusieurs personnes qui sont également nus-propriétaires.
- La question qui alors se pose est de savoir s’il existe une situation d’indivision entre l’usufruitier et le plein propriétaire.
- Une première approche consisterait à répondre négativement, compte tenu de ce que l’usufruit et la nue-propriété sont des droits réels de nature différente.
- Or l’existence d’une indivision est subordonnée à l’existence d’un concours entre droits réels de même nature.
- Une deuxième approche pourrait consister à envisager qu’une indivision se crée en usufruit.
- Reste que l’article 578 prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété », de sorte que l’on ne peut pas jamais être regardé comme usufruitier de sa propre chose.
- Selon une dernière approche, le concours entre un droit d’usufruit et un droit de pleine propriété ferait naître une indivision, non pas en usufruit, mais en jouissance.
- C’est dans ce sens que la jurisprudence s’est positionnée.
- Dans un arrêt du 25 juin 1974, la Cour de cassation a ainsi expressément affirmé que « lorsque le droit de l’usufruitier porte sur une quote-part d’un bien, il y a une indivision entre lui et le plein-propriétaire du surplus quant à la jouissance » (Cass. 1ère civ. 25 juin 1974, n°72-12.451).
c. Identité d’objet
Pour que plusieurs personnes se trouvent en situation d’indivision, les droits réels concurrents dont elles sont titulaires doivent avoir le même objet.
À cet égard, l’indivision peut porter, tant sur un bien unique, que sur plusieurs biens.
Il est également admis qu’une indivision puisse porter sur une universalité, tel que, par exemple, un fonds de commerce.
S’agissant de la nature des biens objets de l’indivision, il est indifférent qu’il s’agisse d’un meuble ou d’un immeuble. Il importe peu également que l’on soit en présence d’une chose corporelle ou incorporelle.
2. Les sources de l’indivision
Il est plusieurs circonstances susceptibles de conduire à une situation d’indivision. Ces circonstances peuvent être voulues ou subies.
Nous nous limiterons, dans les développements qui suivent, à aborder les principales sources de l’indivision.
2.1. L’indivision résultant de l’ouverture d’une succession
Lorsqu’une personne décède et laisse derrière elle plusieurs héritiers, ces derniers sont immédiatement investis de droits concurrents, de même nature, sur un ou plusieurs bien ayant appartenu au défunt.
C’est alors que se crée entre eux, dès l’ouverture de la succession, une situation d’indivision.
Il peut être observé que l’indivision successorale peut résulter :
- D’une part, de la loi qui, en l’absence de disposition testamentaire, désigne les personnes ayant vocation à hériter du de cujus et détermine leurs droits dans la succession
- D’autre part, d’une disposition testamentaire qui peut instituer plusieurs personnes comme légataires d’un même bien ou d’un même ensemble de biens
- Enfin, d’une donation qui serait consentie à plusieurs personnes et qui porterait là encore sur un même bien ou sur un même ensemble de biens
Dans ces trois cas, il est nécessaire de régir les rapports entre successeurs lesquels sont titulaires de droits concurrents ayant un objet identique, alors même qu’ils sont susceptibles d’avoir des intérêts divergents, voire opposés.
C’est là tout l’enjeu, sinon la raison d’être de l’indivision : assurer la coexistence des droits et intérêts de chacun.
2.2. L’indivision résultant de la dissolution d’une communauté matrimoniale
Lorsque deux personnes se marient et optent pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal), les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – et certains biens qu’elles apportent, viennent abonder ce que l’on appelle une communauté.
Cette communauté présente la particularité de consister en une masse de biens distincte de celles composées de biens appartenant en propre aux époux.
D’aucuns se sont demandé si, compte tenu de cette particularité, la communauté ne s’analyserait pas, au fond, en une forme d’indivision. Bien que séduisante, cette thèse n’est toutefois pas sans faille.
Tout d’abord, l’indivision se caractérise par sa nature temporaire ; elle n’a pas vocation à durer dans le temps. Tel n’est pas le cas de la communauté qui ne prend fin que dans les cas limitativement énumérés par la loi.
Ensuite, l’indivision constitue un ensemble de biens inorganisé, en ce sens qu’il n’est ni de répartition, ni d’aménagement des pouvoirs entre les indivisaires, puisque, pour la très grande majorité des actes de gestion du bien indivis, c’est la règle de l’unanimité qui préside à la prise de décision.
S’agissant, tout au contraire, des biens composant la communauté conjugale, les pouvoirs d’administration et de gestion des époux sont définis avec précision par la loi.
Selon la nature du bien concerné et la gravité de l’opération en cause, les pouvoirs dont sont investis les époux sur les biens communs diffèrent. Tantôt la loi admet une gestion concurrente, tantôt elle exige une gestion conjointe. Il est encore des cas où elle instaure un principe de gestion exclusive.
S’il est indéniable que la communauté conjugale et l’indivision sont deux institutions qui, en raison de leurs caractéristiques, sont proches, elles ne se confondent pas.
C’est ainsi que la Cour de cassation a refusé d’appliquer les règles relatives aux récompenses pour un bien acquis en indivision avant le mariage des époux, puisque n’ayant pas le caractère de bien commun (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173).
Par cette décision, la Première chambre civile refuse d’assimiler un bien indivis à un bien commun. C’est là la preuve qu’ils obéissent à des régimes juridiques distincts, à tout le moins aussi longtemps que la communauté perdure. Car lorsque celle-ci prend fin, les biens communs tombent en indivision.
Pour mémoire, il est plusieurs événements susceptibles de mettre fin à l’existence de la communauté. L’article 1441 du Code civil prévoit en ce sens que La communauté se dissout :
- par la mort de l’un des époux ;
- par l’absence déclarée ;
- par le divorce ;
- par la séparation de corps ;
- par la séparation de biens ;
- par le changement du régime matrimonial.
Aussi, lorsque la communauté prend fin, indépendamment de la répartition des biens qui la composent, se pose la question des règles organisant la gestion de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.
Spontanément, il apparaît que l’institution qui serait la plus à même de fournir des règles de gestion temporaire des biens issus d’une communauté conjugale dissoute n’est autre que l’indivision.
Ce mécanisme juridique a, en effet, été précisément pensé pour encadrer la situation de biens se trouvant dans un état transitoire. Sans grande surprise, c’est cette solution qui a été retenue par le législateur.
Ainsi, résulte-t-il de la dissolution d’une communauté conjugale, pour quelle que cause que ce soit, la constitution d’une indivision post-communautaire.
Les biens qui, dès lors, composaient la masse commune se transforment, sous l’effet de la dissolution de la communauté, en biens indivis. La conséquence en est un changement des règles applicables.
Tandis que les biens communs sont soumis au droit des régimes matrimoniaux, et plus précisément aux règles qui régissent la communauté conjugale, les biens indivis obéissent quant à eux au droit commun de l’indivision.
À compter du jour de la dissolution de la communauté, ce sont donc les articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent aux biens relevant de l’indivision post-communautaire.
2.3. L’indivision résultant de l’adoption d’un régime matrimonial séparatiste
Lorsque deux personnes se marient, elles peuvent choisir d’opter pour un régime matrimonial séparatiste plutôt que pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Les régimes séparatistes se caractérisent par l’absence de création d’une masse commune de biens qui serait alimentée par les biens présents et futurs acquis par les époux.
Aussi, ces derniers conservent-ils, en principe, la propriété en propre de tous les biens qu’ils ont apportés ou qu’ils acquièrent au cours du mariage.
La vie conjugale implique toutefois que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.
a. Présomption d’indivision
Issu de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, l’article 1538 du Code civil prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.
Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.
Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.
À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.
Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »
D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses »[5].
S’agissant des effets de cette présomption, elle conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
Il peut être observé que la présomption d’indivision instituée à l’article 1538 du Code civil n’est pas sans limite. Elle peut être combattue par la preuve contraire.
b. Preuve de la propriété
==>La charge de la preuve
En l’absence de présomption conventionnelle de propriété, la charge de la preuve pèse sur l’époux qui revendique la propriété d’un bien.
L’article 1538, al. 1er du Code civil prévoit en ce sens que « tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. »
Il peut être observé que si la règle énoncée par cette disposition ne vise que le cas où celui qui se prévaut de la propriété d’un bien est un époux, elle s’applique également à l’hypothèse où c’est un tiers qui cherchera à attribuer la propriété d’un bien à l’un ou l’autre époux.
Il y aura notamment intérêt lorsqu’il voudra exercer des poursuites sur ce bien, au titre d’une créance qu’il détient contre son débiteur.
==>Objet de la preuve
La preuve de la propriété n’est pas des plus aisée à rapporter. Pour y parvenir, il convient, en effet, d’établir irréfutablement la légitimité du rapport d’appropriation d’un bien. Or cela suppose d’être en mesure de remonter la chaîne des transferts successifs de propriété jusqu’au premier propriétaire, ce qui, a priori, est impossible.
D’où la présentation de la preuve de la propriété comme la « probatio diabolica », car seul le diable serait en capacité de la rapporter.
Quoi qu’il en soit, cette preuve doit être rapportée par l’époux qui revendique la propriété d’un bien, faute de quoi, conformément au troisième alinéa de l’article 1538 du Code civil, le bien revendiqué sera réputé appartenir indivisément à chacun des époux pour moitié.
Cette preuve de la propriété est-elle insurmontable ? Il n’en est rien. Comme observé par le Professeur Revêt « la propriété se prouve par sa cause : l’acquisition ».
Aussi, la propriété d’un bien se prouvera différemment selon le mode d’acquisition de ce bien. Il convient, en particulier, de distinguer les modes d’acquisition originaires, des modes d’acquisition dérivés.
- L’acquisition originaire
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété qu’il ne tient pas d’autrui
- Le droit dont il est titulaire n’a été exercé par personne et résulte d’un fait juridique.
- Tel est le cas de l’occupation, de la prescription, de la présomption de propriété ou encore de l’accession
- Dans cette configuration, l’acquisition de la propriété n’exige pas que l’acquéreur noue un rapport juridique avec une autre personne.
- L’acquisition n’intéresse que lui et la chose
- La preuve de la propriété consistera donc ici à établir les circonstances de création de ce lien entre le propriétaire et la chose
- En cas d’acquisition d’un bien par occupation, il s’agira de démontrer l’entrée en possession de la chose et la volonté d’en être le propriétaire
- En cas d’acquisition par prescription, il s’agira de démontrer que la possession est caractérisée, tant dans ses éléments constitutifs, que dans ses caractères.
- En cas d’acquisition par accession, il conviendra de rapporter la preuve du fait d’accroissement ou de production.
- L’acquisition dérivée
- Il s’agit du mode d’acquisition qui confère à l’acquéreur un droit de propriété par voie de transfert du droit
- Autrement dit, le bien appartenait, avant le transfert de sa propriété, à une autre personne, de sorte que l’acquéreur détient son droit d’autrui.
- Ce mode d’acquisition de la propriété procède toujours de l’accomplissement d’un acte juridique, tels qu’un contrat, un échange, un testament, une donation etc.
- Dans cette configuration, un rapport juridique doit nécessairement se créer pour que l’acquisition emporte transfert de la propriété
- La preuve de la propriété consistera ici à établir l’existence d’un transfert de propriété et plus précisément à remonter le fil des transmissions, ce qui ne sera pas sans soulever des difficultés en matière mobilière.
==>Les modes de preuve
S’agissant des modes de preuves admis quant à établir la propriété d’un bien, l’article 1538 du Code civil prévoit que la preuve peut être rapportée « par tous moyens ».
Cela signifie que tous les modes de preuves sont admis. Est-ce à dire qu’ils se valent tous ? Il n’en est rien.
Le titre de propriété est, sans aucun doute, le mode de preuve qui est pourvu de la plus grande force probante.
Reste qu’il ne sera établi, en général, que pour les immeubles étant précisé que la jurisprudence considère que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).
Autrement dit, il est indifférent que le bien ait été financé par un époux en particulier : le titre prime en tout état de cause sur la finance. C’est donc l’époux titulaire du titre qui endosse la qualité de propriétaire du bien.
S’agissant des meubles, cette question ne se posera pas, à tout le moins qu’à titre exceptionnel, dans la mesure il est rare qu’un titre de propriété soit établi lors de l’acquisition de cette catégorie de biens.
Parfois, les meubles acquis avant le mariage feront l’objet d’une énumération dans le contrat de mariage, ce qui permettra d’éviter que les époux se disputent la propriété de ces biens lors de la liquidation de leur régime matrimoniale.
Pour les meubles acquis au cours du mariage, sauf à ce qu’ils aient été expressément visés dans une donation ou un testament, la possession devrait constituer le mode normal de preuve de la propriété.
Reste que pour produire ses effets, elle doit présenter les caractères requis par l’article 2261 du Code civil qui prévoit que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il ressort de cette disposition que pour être efficace, la possession ne doit être affectée d’aucun vice. Elle doit, autrement dit, être utile.
Par utile, il faut entendre susceptible de fonder une prescription acquisitive. On dit alors que la possession est utile ad usucapionem, soit par l’usucapion.
Si la situation des époux séparés de biens ne fait pas obstacle à la réunion des trois premiers caractères de la possession utile (continue, paisible et publique), il en va différemment de l’exigence tenant à l’absence d’équivoque.
Par hypothèse, les époux, quel que soit le régime matrimonial auquel ils sont soumis, partagent une communauté de vie, ce qui implique qu’ils mettent en commun leurs biens meubles.
Aussi, s’avérera-t-il délicat de déterminer si le possesseur détient la chose à titre exclusif ou si la possession est partagée.
Cette situation conduit, en pratique, à une confusion des biens meubles, ce qui est de nature à rendre la possession équivoque.
Compte tenu de la difficulté à établir l’absence d’équivoque de la possession pour les biens meules, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 7 novembre 1995, que « les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens, édictées par l’article 1538 du Code civil, excluent l’application de l’article 2279 [nouvellement 2276] du même Code » (Cass. 1ère civ. 7 nov. 1995, n°92-10.051).
Ainsi, pour la Première chambre civile, la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil qui confère un titre de propriété à celui qui possède – de bonne foi – un meuble, est paralysée sous l’effet du régime de la séparation de biens.
Bien que vivement critiquée par les auteurs, cette position a été confirmée dans un arrêt du 27 novembre 2001 (Cass. 1ère civ. 27 nov. 2001, n°99-10.633).
Dans ces conditions, la preuve de la propriété devra se faire selon d’autres moyens, ce qui pourra consister à produire des témoignages et plus généralement toutes sortes d’indices.
Ces indices pourront notamment résulter de factures, bien qu’il ne s’agisse pas d’un écrit au sens du droit de la preuve.
Dans un arrêt du 10 mars 1993, la Cour de cassation a jugé en ce sens, au visa de l’article 1538 du Code civil, « qu’une facture, même non acquittée, est de nature à établir, sauf preuve contraire, l’acquisition d’un bien par celui au nom duquel elle est établie » (Cass. 1ère civ. 10 mars 1993, n°91-13.923).
Elle ajoute, dans cette même décision, « que la propriété d’un bien appartient à celui qui l’a acquis sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont l’acquisition a été financée ».
Les factures ne sont pas les seuls indices susceptibles de prouver la propriété d’un bien acquis par un époux séparé de biens. La jurisprudence a également admis que la preuve puisse être rapportée au moyen de certificats de garantie ou d’origine (CA Versailles 12 déc. 1988).
Pour les véhicules immatriculés, la preuve de leur propriété pourra résulter de la carte grise qui a été établie au nom d’un époux (CA Paris, 4 févr. 1982).
Si, en droit commun de la preuve, on n’accorde aux documents qui ne remplissent pas les conditions d’un écrit qu’une faible valeur probante, car ne prouvant, tout au plus, que le paiement par celui au nom duquel ils sont établis, à l’analyse, il en va différemment lorsque la preuve est rapportée dans le cadre matrimonial.
La jurisprudence reconnaît, en effet, aux indices que sont les factures, les certificats et autres documents contractuels, la valeur d’une présomption simple, en ce sens qu’ils permettent d’établir la propriété du bien jusqu’à la preuve contraire.
C’est là une certaine faveur qui est consentie aux époux séparés de bien pour lesquels le fardeau de la preuve se trouve ainsi allégé.
2.4. L’indivision résultant de la dissolution d’une société
Tout comme les personnes physiques dont la vie prend fin par la mort, les sociétés ont également vocation à disparaître. Ce qui met fin à l’existence de ces dernières, c’est la dissolution.
Classiquement, on définit la dissolution comme l’acte juridique qui anéantit l’existence de la personne morale. Autrement dit, c’est le processus qui marque la cessation de l’activité de la société et la disparition de sa personnalité juridique. La dissolution peut en quelque sorte être regardée comme la « mort » juridique de la société.
À la différence toutefois de la mort qui frappe une personne physique, la dissolution ne produit pas d’effet instantané, en ce sens qu’elle n’emporte pas extinction immédiate de tous les droits et obligations de la personne morale.
Avant que le pacte social conclu par les associés ne cesse définitivement de produire des effets, il doit être procédé à la conduite de deux catégories d’opérations qui se succèdent :
- Les opérations de liquidation
- Les opérations de partage
==>Les opérations de liquidation
La dissolution d’une société donne lieu à ce que l’on appelle la phase de liquidation.
Classiquement on définit la liquidation comme l’ensemble des opérations qui, consécutivement à la dissolution de la société, visent à :
- D’une part, exécuter les engagements souscrits, désintéresser les créanciers, et recouvrer les créances sociales.
- D’autre part, procéder à la répartition de l’actif net entre tous les associés, soit l’actif subsistant après le règlement du passif social
Il peut être observé que pendant cette phase transitoire qu’est la liquidation, conformément à l’article 1844-8, al. 3e du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Il en résulte que, aussi longtemps que perdurent les opérations de liquidation, la société conserve la propriété de son patrimoine, les associés n’étant titulaires que de droits sociaux.
Aussi, ce n’est qu’à compter de la clôture de la liquidation de la société que ces derniers se voient reconnaître des droits sur l’actif social, à tout le moins si le règlement du passif laisse subsister des éléments d’actif.
S’ouvre alors une seconde phase : le partage.
==>Les opérations de partage
La clôture de la liquidation de la société, qui emporte disparition définitive de la personne morale, donne lieu à ce que l’on appelle la phase de partage.
Cette phase recouvre l’ensemble des opérations qui vise à répartir entre les ex-associés les biens issus des opérations de liquidation.
La personne morale ayant disparu, se pose alors la question du statut de ces biens dans l’attente du dénouement des opérations de partage.
Pour le déterminer, il convient de se tourner vers l’article 1844-9 du Code civil d’où il s’évince que, consécutivement à la clôture de la liquidation, l’actif social tombe en indivision.
Ce sont donc les règles de l’indivision qui ont vocation à régir les rapports entre ex-associés quant à la gestion des biens qu’ils ont vocation à se répartir.
À cet égard, si le partage de l’actif social entre ex-associés est présenté comme la suite naturelle de la liquidation de la société, il n’y a là rien d’obligatoire.
L’article 1844-9 du Code civil prévoit, en effet, que « tous les associés, ou certains d’entre eux seulement, peuvent aussi demeurer dans l’indivision pour tout ou partie des biens sociaux. »
3. L’indivision résultant de l’acquisition d’un bien en commun
Si la plupart du temps l’indivision est une situation qui est subie par les coïndivisaires, il est des cas où elle peut être choisie.
Il en va notamment ainsi lorsque plusieurs personnes décident d’acquérir un bien en commun.
L’acquisition en commun d’un bien ne donne toutefois pas systématiquement lieu à une situation d’indivision. Le statut du bien dépend de la nature des relations entretenues par les acquéreurs.
Le régime applicable diffère notamment selon que l’achat est ou non réalisé par des personnes qui vivent en couple.
3.1. L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un couple
a. Les couples mariés
a.1. L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime communautaire
Lorsque deux personnes se marient, elles sont libres d’opter pour un régime dit communautaire (par exemple le régime légal).
La conséquence en est que, par principe, tous les biens qu’elles acquièrent – ensemble ou séparément – pendant le mariage viennent abonder une masse commune de biens que l’on appelle communauté.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir quel statut reconnaître à ces biens – qualifiés également d’acquêts – qui forment la communauté conjugale ?
Pour certains auteurs, les acquêts endossent la qualification de biens indivis. D’autres soutiennent qu’ils répondent à un statut qui leur est propre et que, par voie de conséquence, ils ne sont pas soumis aux règles de l’indivision.
À l’analyse, c’est la seconde thèse qui emporte l’adhésion de la doctrine majoritaire, laquelle est corroborée par la jurisprudence qui systématiquement refuse d’appliquer aux biens communs les règles de l’indivision et inversement d’appliquer des règles issues du régime matrimonial à des biens acquis par un époux en indivision (Cass. 1ère civ. 22 juill. 1985, n°84-14.173, n°84-14.173).
Aussi, faut-il considérer que, par principe, les biens acquis par des époux mariés sous un régime de communauté échappent à la qualification de biens indivis. Ils appartiennent à une masse de biens – la communauté – qui, si elle comporte des similitudes avec une indivision, ne se confond pas avec cette institution.
a.2. L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un régime séparatiste
i. Principe général
Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le principe de séparation des patrimoines implique que chacun conserve la propriété de ses biens présents et futurs.
Faute d’instauration d’une communauté, les éléments d’actif que les époux acquièrent séparément, à commencer par leurs revenus, n’ont donc pas vocation à alimenter une troisième masse de biens.
C’est la raison pour laquelle, sous le régime de la séparation de biens, les époux en conservent nécessairement la propriété à titre individuel, sans que l’enrichissement que leur procure l’acquisition faite ne puisse, par un transfert de valeur, profiter au patrimoine du conjoint.
ii. Tempéraments
Le Code civil prévoit une exception au principe de séparation des patrimoines lorsque le bien appartient aux époux en indivision.
Cette indivision peut résulter :
- Soit de l’acquisition conjointe d’un bien
- Soit de présomptions d’indivision
?: L’acquisition conjointe d’un bien par les époux
Il n’est pas rare que les époux séparés de biens réalisent des acquisitions conjointement, en particulier lorsqu’il s’agit d’acquérir un bien pourvu d’une valeur patrimoniale importante, tel que le logement de famille ou une résidence secondaire.
Lorsqu’ils acquièrent un bien ensemble, il leur appartient en indivision, étant précisé que les quotes-parts attribuées à l’un et l’autre peuvent être déterminées dans l’acte constatant l’acquisition. À défaut, les époux sont réputés être propriétaires du bien indivis à parts égales.
Quoi qu’il en soit, les biens acquis conjointement par les époux séparés de biens ne composent, en aucune façon, une troisième masse de biens à l’instar de la communauté instaurée sous le régime légal.
Il s’agit de biens soumis au seul droit de l’indivision qui se compose de deux corps de règles :
- Les règles générales énoncées aux articles 815 et suivants du Code civil qui s’appliquent en l’absence de convention contraire
- Les règles spéciales énoncées aux articles 1873-1 et suivants du Code civil lorsqu’une convention relative à l’exercice des droits indivis a été conclue entre les époux.
Il peut être observé que, dès lors que l’acte d’acquisition constate que le bien a été acquis conjointement par les époux, il est réputé leur appartenir en copropriété, peu importe qu’il ait été financé par un seul des époux.
Dans un arrêt du 14 novembre 2007, la Cour de cassation validé en ce sens une décision de Cour d’appel qui, après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, le terrain avait été acquis indivisément chacun pour moitié par les époux séparés de biens, avait décidé que l’épouse, propriétaire pour moitié du terrain, « devait être présumée propriétaire pour moitié de l’immeuble qui y avait été édifié, les modalités de financement de la construction de cet immeuble n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la preuve contraire » (Cass. 1ère civ. 14 nov. 2007, n°06-18.395).
?: Les présomptions d’indivision
Les présomptions d’indivision peuvent avoir deux sources différentes :
- La loi
- La volonté des époux
==>La présomption d’indivision légale
La vie conjugale implique que les époux mettent en commun les biens qu’ils acquièrent séparément.
Sous l’effet du temps, les biens, en particulier les meubles, qui leur appartiennent en propre sont alors susceptibles de se confondre avec ceux qui appartiennent au conjoint et réciproquement.
Cette situation est, par hypothèse, de nature à rendre pour le moins difficile l’attribution à l’un et l’autre époux de la propriété des biens qui ont été confondus.
Aussi, afin de faciliter la preuve de la propriété de ces biens, le législateur a institué une règle qui, lorsqu’existe une incertitude sur la propriété d’un bien, fait présumer ce bien appartenir aux époux en indivision.
Cette règle, qui est issue de la loi n°65-570 du 13 juillet 1965, est énoncée à l’article 1538 du Code civil qui prévoit que « les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié ».
Par le jeu de cette présomption est ainsi instituée une masse indivise de biens qui, à certains égards, se rapproche de la masse commune instituée sous les régimes communautaires.
Elle s’en distingue néanmoins en ce que les biens qui la composent sont soumis au seul droit de l’indivision.
Il en résulte que le sort de cette masse indivise n’est pas lié à la durée du mariage. Plus précisément, cette masse peut cesser d’exister avant la dissolution du mariage, ce qui n’est pas le cas de la communauté qui est instituée pour toute la durée de l’union matrimoniale.
En effet, l’article 815 du Code civil prévoit que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. ». La situation d’indivision peut donc cesser à tout instant du mariage.
À l’analyse, la présomption d’indivision est un dispositif qui permet d’atténuer le principe de séparation des patrimoines qui préside au régime de la séparation de biens.
Comme observé par Gulsen Yildirimn elle « permet d’introduire un facteur d’équité dans l’établissement de la composition des patrimoines des époux. »
D’autres auteurs soulignent qu’« il est significatif de voir ainsi s’établir une union des intérêts pécuniaires, subrepticement en quelque sorte, et à la faveur d’une absence de preuve. Cela autorise à penser qu’une certaine communauté de meubles est peut-être, elle aussi, dans la nature des choses »[6].
S’agissant des effets de cette présomption, elle opère, tant dans les rapports entre époux, que dans les rapports avec les tiers.
- Dans les rapports entre époux
- La présomption d’indivision conduira les époux à se partager le bien lors de la dissolution du mariage.
- Le partage donnera lieu à réparation du bien en deux parts égales, celui-ci étant présumé appartenir conjointement aux époux pour moitié.
- Dans les rapports avec les tiers
- La présomption d’indivision leur est opposable, de sorte que s’applique l’article 817 du Code civil aux termes duquel il leur est fait interdiction de saisir la quote-part indivise de l’époux débiteur.
- Ils n’ont d’autre choix que de provoquer le partage de l’indivision.
==>Les présomptions d’indivision conventionnelles
En application du principe de liberté des conventions matrimoniales, les époux peuvent insérer dans leur contrat de mariage une clause qui institue une présomption d’indivision qui aura vocation s’appliquer à une ou plusieurs catégories de biens.
Depuis que la loi a institué une présomption d’indivision pourvue d’une portée générale, la stipulation d’une telle clause a grandement perdu de son intérêt.
Reste qu’il pourra être recouru à ce dispositif contractuel pour les meubles meublants qui garnissent le logement familial et plus généralement tous les lieux où les époux résident.
Sous l’empire du droit antérieur à la loi du 13 juillet 1965, on s’était demandé si les présomptions d’indivision conventionnelles étaient opposables aux tiers.
L’article 1538, al. 2e du Code civil tranche désormais cette question en prévoyant que « les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. »
La conséquence de l’opposabilité des présomptions d’indivision conventionnelles aux tiers est le renversement de la charge de la preuve.
Autrement dit, c’est au créancier saisissant d’établir que le bien sur lequel il exerce ses poursuites appartient exclusivement à l’époux débiteur.
Dans un arrêt du 29 janvier 1974, la Cour de cassation a jugé en ce sens que la clause de présomption d’indivision figurant dans le contrat de mariage des époux séparés de biens est opposable au créancier, de sorte qu’il appartient à ce dernier d’administrer la preuve du droit de propriété exclusif de son débiteur sur les biens litigieux (Cass. 1ère civ. 29 janv. 1974, n°72-12.670).
iii. Cas particuliers : l’acquisition d’un bien par un époux financé par le conjoint
La plupart du temps, lorsqu’un époux se porte acquéreur d’un bien, il le fera au moyen de ses deniers personnels, de sorte que ce bien lui appartiendra en propre, sans qu’il lui soit besoin d’accomplir les formalités d’emploi ou de remploi requises sous le régime légal.
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste propriétaire, par principe, des biens qu’ils acquièrent au moyen de leurs deniers personnels.
Il est des cas néanmoins où l’époux qui réalisera l’acquisition ne sera pas nécessairement celui qui l’aura financée. Il peut, en effet, arriver que cette acquisition soit financée par le conjoint.
Lorsque cette situation se présente, la question alors se pose de la propriété du bien. Revient-elle à l’époux qui s’est porté acquéreur ou à celui qui a financé l’acquisition ?
Il ressort de la jurisprudence qu’une distinction se dessine quant aux règles applicables selon que le bien acquis est affecté à l’usage personnel de l’époux acquéreur ou selon qu’il est affecté à un usage familial.
?: Acquisition d’un bien affecté à un usage personnel
==>L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint en dehors de tout contrat
Le principe est que lorsqu’un bien est acquis par l’un ou l’autre époux, il appartient, non pas à l’époux qui a financé l’acquisition, mais, à celui au nom duquel cette acquisition a été faite.
Aussi, c’est le titre qui confère la qualité de propriétaire et non le financement qui ne confère aucun droit de propriété sur le bien.
Dans un arrêt du 9 octobre 1991, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « sous le régime de la séparation de biens, l’époux qui acquiert un bien pour son compte à l’aide de deniers provenant de son conjoint, devient seul propriétaire de ce bien » (Cass. 1ère civ. 9 oct. 1991, n°90-15.073).
Dans un arrêt du 31 mai 2005, la première chambre civile a encore jugé que « sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété sans égard à son financement » (Cass. 1ère civ. 31 mai 2005, n°02-20.553).
Tout au plus, l’époux qui a financé le bien pourra « obtenir le règlement d’une créance lors de la liquidation du régime matrimonial, s’il prouve avoir financé en tout ou partie l’acquisition » (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2007, n°05-14.311).
==>L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de mandat
Dans cette hypothèse, l’époux qui se porte acquéreur endosse la qualité de mandataire ou, le cas échéant, de gérant d’affaires.
Pour déterminer à qui revient la propriété du bien objet de l’acquisition il y a lieu de faire application des règles du mandat.
Or ces règles désignent le mandant comme étant seul propriétaire du bien acquis.
L’époux qui a réalisé l’opération est, en effet, réputé avoir agi en représentation de son conjoint.
==>L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’un contrat de prêt
Dans cette hypothèse, quand bien même les deniers ont été fournis par le conjoint, le bien acquis demeure la propriété exclusive de l’époux qui s’est porté acquéreur.
La raison en est que la remise de fonds en exécution d’un contrat de prêt opère un transfert de propriété.
Aussi, parce que les fonds prêtés appartiennent en propre à l’époux emprunteur, le bien qu’il acquiert avec ces fonds subit le même sort, charge à lui de rembourser son conjoint selon les règles qui régissent les créances entre époux.
==>L’époux acquiert le bien au moyen de deniers fournis par le conjoint dans le cadre d’une donation
- Droit antérieur
- Lorsqu’un époux reçoit de son conjoint des fonds à titre gratuit et qu’il remploie ces fonds à l’acquisition d’un bien, ce bien devrait, par le jeu de la subrogation réelle, lui appartenir en propre.
- Telle n’est pourtant pas la solution qui avait été retenue par la jurisprudence sous l’empire du droit antérieur.
- Les juridictions regardaient plutôt cette opération comme une donation déguisée, le déguisement se caractérisant par le fait que la libéralité se dissimule sous les apparences d’un autre acte, notamment d’un acte à titre onéreux.
- Il en était tiré conséquence que la donation portait non pas sur les fonds donnés, mais sur le bien acquis au moyen de ces fonds.
- Il en résultait que, en cas d’annulation de la libéralité, ce qui, en application de l’ancien article 1099, al. 2e du Code civil, était le sort de toute donation déguisée, la propriété du bien retournait dans le patrimoine du conjoint qui en avait financé l’acquisition (le donateur) et non à l’époux acquéreur (le donataire).
- Là n’était pas la seule conséquence de l’anéantissement de la donation.
- Il en était une autre qui était particulièrement fâcheuse lorsque le donataire avait réalisé avec les fonds provenant de la donation irrégulière une opération immobilière à laquelle intervenaient des tiers.
- Exemple[7] :
- Un époux achète, avec les deniers donnés par l’autre, un immeuble, puis le revend à un tiers ou lui consent des droits sur cet immeuble.
- Dans cette hypothèse, comme vu précédemment, la jurisprudence considérait que l’époux donateur était réputé « avoir toujours été le seul propriétaire de l’immeuble acquis de ses deniers » au motif qu’il s’agirait là d’une donation déguisée.
- L’annulation de cette donation entraînait alors l’anéantissement de toutes les mutations intervenues subséquemment à l’acquisition de l’immeuble par le donataire, ce qui, par voie de conséquence, était de nature à léser gravement les droits des tiers de bonne foi qui donc voyaient l’opération qu’ils avaient conclue remise en cause.
- Afin d’assurer la sécurité juridique des tiers, en prévenant notamment la survenance de nullités en cascade, le législateur est intervenu pour briser la jurisprudence de la Cour de cassation en introduisant, par la loi du 28 décembre 1967, un article 1099-1 dans le Code civil.
- Cette disposition prévoit que « quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés. »
- Ainsi, désormais, la donation est réputée avoir pour objet les fonds donnés par l’époux donateur et non le bien acquis au moyen de ces deniers.
- En cas d’annulation d’une donation déguisée ou de simple révocation d’une donation ostensible, obligation était donc faite au donataire de restituer les fonds donnés.
- En application du second alinéa de l’article 1099-1 du Code civil, la somme restituée devait toutefois correspondre, non pas à la valeur nominale des deniers remis, mais à la valeur actuelle du bien acquis avec ces deniers.
- Quoi qu’il en soit, par l’instauration de ce système, le droit de propriété constitué par le donataire sur le bien s’en trouvait préservé, sauf à ce qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes pour régler la somme d’argent due à son conjoint au titre de l’obligation de restitution.
- Dans cette hypothèse, il serait alors contraint, soit de céder le bien à un tiers et de remettre au donateur le produit de la vente, soit de s’’acquitter de sa dette en cédant directement à ce dernier la propriété de son bien.
- Afin d’éviter que l’une ou l’autre situation ne se produise et ainsi préserver le droit de propriété du donateur sur son bien conformément à l’objectif recherché par le législateur lors de l’introduction de l’article 1099-1 dans le Code civil, la jurisprudence a cherché à cantonner le domaine des libéralités entre époux.
- Plus précisément, les juridictions ont progressivement considéré que, en cas de collaboration d’un époux à l’activité professionnelle de son conjoint au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, la remise d’une somme d’argent par le second au premier devait s’analyser, non pas en une libéralité, mais en une rémunération due au titre du travail fourni (Cass. 1ère civ. 19 mai 1976, n°75-10.558).
- La conséquence en était la requalification de l’opération en acte à titre onéreux ce qui dès lors faisait obstacle à tout anéantissement sur le fondement, soit du principe de révocabilité des libéralités, soit du principe de nullité des donations déguisées.
- À cet égard, la Cour de cassation est allée plus loin en jugeant que la qualification de libéralité devait également être écartée lorsqu’il était établi que l’activité de l’époux bénéficiaire de la remise de fonds dans la gestion du ménage et la direction du foyer avait, de par son importance, été source d’économies pour le conjoint.
- Cela lui permettait ainsi de refuser l’annulation ou la révocation de l’acte de remise de fonds, puisque s’analysant en une rétribution due en contrepartie de la fourniture d’un travail au foyer (Cass. 1ère civ. 20 mai 1981, n°79-17.171).
- Seule solution pour le demandeur à l’action en nullité ou en révocation de l’acte litigieux : rapporter la preuve de l’origine des deniers et de l’intention libérale du donateur.
- À défaut, ni l’acquisition du bien, ni la fourniture des deniers ayant servi à son financement ne pouvaient être remises en cause.
- Droit positif
- Depuis l’adoption de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les solutions dégagées par la jurisprudence s’agissant de l’anéantissement des donations entre époux n’opèrent plus.
- En effet, cette loi a aboli :
- D’une part, le principe de révocabilité des donations entre époux
- D’autre part, le principe de nullité des donations déguisées
- Ainsi, aujourd’hui, dans la mesure où les donations entre époux de biens présents ne peuvent plus être anéanties, sauf motifs graves[8], il est indifférent que l’époux qui a remis une somme d’argent à son conjoint ait été ou non animé d’une intention libérale.
- Il importe peu également que le bénéficiaire de cette remise de fonds ait collaboré à l’activité professionnelle du conjoint ou qu’il ait assuré la gestion du ménage au-delà de ce qui était exigé au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage.
- Dans les deux cas, la donation, qu’elle soit ostensible, indirecte ou déguisée, ne peut plus être remise en cause, de sorte que non seulement le donataire est consolidé dans ses droits de propriété du bien acquis au moyen des fonds remis en application de l’article 1099-1 du Code civil, mais encore le risque de devoir restituer ces fonds au donateur est écarté.
- Ainsi que le relèvent les auteurs « cette modification revêt une importance considérable pour le régime de la séparation de biens »[9].
- Le contentieux des donations indirectes et déguisées ne s’en trouve pas totalement épuisé pour autant : l’administration demeure en effet toujours intéressée au premier chef des libéralités qui n’ont fait l’objet d’aucune formalité de déclaration.
?: Acquisition d’un bien affecté à l’usage de la famille
Lorsqu’un époux séparé de biens finance un bien indivis au-delà de la quote-part dont il est titulaire et que le bien financé est affecté à un usage familial la question s’est posée de la nature du financement réalisé.
Plus précisément, on s’est demandé si le financement supporté par l’époux solvens ne relevait pas de la contribution aux charges du mariage.
Pour mémoire, l’article 214 du Code civil prévoit que les époux doivent contribuer à ce que l’on appelle les charges du mariage, contribution qui, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Il s’agit là d’une obligation légale qui vise à assurer le bon fonctionnement du ménage et qui a pour seul fait générateur le mariage.
Aussi, dès lors que deux personnes sont mariées elles sont assujetties à l’obligation de contribution aux charges du mariage, peu importe le régime matrimonial auquel elles ont choisi de se soumettre.
Cette obligation a ainsi vocation à s’appliquer à tous les couples mariés, y compris à ceux séparés de biens, ce qui, dans le cas de ces derniers, n’est pas sans apporter un sérieux tempérament au principe de séparation des patrimoines.
Une application stricte de ce principe devrait, en effet, conduire à écarter toute mise en commun forcée des ressources perçues par les époux séparés de biens. En instituant une obligation de contribuer aux charges du mariage, le législateur a entendu déroger à ce principe.
Pour les dépenses en lien avec le train de vie du ménage et ayant pour objet l’entretien de la famille et l’éducation des enfants l’époux solvens ne saurait attendre en retour aucune contrepartie de la part de son conjoint, sinon que celui-ci exécute pareillement son obligation de contribution aux charges du mariage.
La qualification de charges du mariage n’est ainsi pas sans enjeu :
- Lorsqu’une dépense s’analyse en une charge du mariage, elle ne peut jamais donner naissance à une créance entre époux, sauf à ce que cette dépense excède la part de l’époux solvens au titre de son obligation contributive
- Lorsqu’une dépense ne s’analyse pas en une charge du mariage, elle donnera naissance à une créance entre époux toutes les fois qu’elle se rapporte à une dette supportée par l’époux solvens alors qu’elle relève du passif définitif du conjoint
S’il ne fait aucun doute que la qualification de charges du mariage est exclue lorsque le paiement réalisé par l’époux solvens se rapporte à une dette contractée aux fins d’acquisition d’un bien affecté à l’usage exclusif du conjoint, cette qualification est bien moins évidente en présence d’une dépense ayant financé un bien affecté à l’usage familial.
Il ressort de la jurisprudence que deux situations doivent être distinguées :
- Première situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen d’un prêt remboursé par l’époux solvens
- Dans un arrêt du 15 mai 2013 la Cour de cassation a jugé que le remboursement par un époux d’un emprunt ayant servi à l’acquisition en indivision du domicile conjugal « participait de l’exécution [par ce dernier] de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 15 mai 2013, n°11-26.933).
- Il ressort de cette décision que lorsqu’un époux finance un bien indivis affecté à l’usage familial au-delà de la quote-part qui lui revient, il ne peut se prévaloir d’aucun droit de créance à l’encontre de son conjoint, sauf à ce que le contrat de mariage stipule le contraire.
- Tel serait notamment le cas si celui-ci comporte la clause de style énonçant, par exemple, que « chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive aux charges du mariage, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature »
- Il peut être observé que la première chambre civile a retenu la même solution pour l’acquisition d’une résidence secondaire, après avoir relevé que ce bien était « destiné à l’usage de la famille » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2018, n°17-25.858).
- Dans un arrêt du 5 octobre 2016, elle a jugé, en revanche, que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ».
- Il en résulte que la dépense supportée par l’époux solvens lui confère un droit de créance contre son conjoint pour la partie du bien indivis financé qui excède sa quote-part (Cass. 1ère civ. 5 oct. 2016, n°15-25.944).
- Seconde situation : le bien affecté à l’usage familial a été financé au moyen de l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels
- Dans un arrêt du 3 octobre 2019, la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 214 du Code civil, que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage » (Cass. 1ère civ. 3 oct. 2019, n°18-20.828).
- Dans cette hypothèse, le financement du bien par l’époux solvens ouvre droit à créance à l’encontre de son conjoint.
- La Première chambre civile a confirmé par la suite sa position à plusieurs reprises ; notamment dans un arrêt du 9 juin 2022 (Cass. 1ère civ. 9 juin 2022, n°20-21.277).
b. Les couples non mariés
b.1. L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un pacs
Issu de la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le pacte civil de solidarité (pacs) est défini à l’article 515-1 du Code civil comme « contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».
Le pacs vise à proposer aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage » diront certains[10], qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires.
En 1999, le régime patrimonial du PACS reposait sur deux présomptions d’indivision différentes selon le type de biens :
- les meubles meublants dont les partenaires feraient l’acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale. Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie ;
- les autres biens dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.
Par ailleurs, le champ de l’indivision était pour le moins incertain puisque la formulation du texte ne permettait pas de savoir avec certitude s’il comprenait les revenus, les deniers, et les biens créés après la signature du pacs.
Afin de remédier à ces difficultés, le législateur a décidé, à l’occasion de l’adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, d’abandonner le principe d’indivision des biens acquis par les partenaires au cours du pacs, à la faveur d’un régime de séparation de biens.
Si, aujourd’hui, les partenaires sont soumis à un régime de séparation de biens, ils disposent toujours du choix d’opter pour un régime d’indivision organisé.
i. Principe
Aux termes de l’article 515-5 du Code civil « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ».
Il ressort de ce principe que le législateur a souhaité instituer un régime de séparation de biens entre les partenaires.
Cette volonté a été exprimée, lors de l’adoption de la loi du 23 juin 2006, dans un souci de protection des partenaires qui ignorent souvent que les biens acquis au cours du pacs sont soumis à l’indivision et a jugé préférable de prévoir la séparation des biens, sauf quand les partenaires optent pour l’indivision.
Sous l’empire du droit antérieur à cette réforme, le législateur avait instauré le régime inverse, soit une indivision entre les partenaires.
La loi du 15 novembre 1999 posait, en ce sens, l’existence d’une sorte de communauté de biens réduite aux acquêts.
En simplifiant à l’extrême, il convenait d’opérer une distinction entre les biens acquis avant et après l’enregistrement du pacs.
- S’agissant des biens acquis avant l’enregistrement du pacs
- Ils avaient vocation à rester dans le patrimoine personnel des partenaires, à charge pour eux de rapporter la preuve que le bien revendiqué leur appartenait en propre.
- S’agissant des biens acquis après l’enregistrement du pacs
- Ils étaient réputés indivis, de sorte qu’à la dissolution du pacs, une répartition égalitaire était effectuée entre les concubins
La loi du 23 juin 2006 a abandonné ce régime patrimonial applicable aux partenaires. Désormais, c’est un régime de séparation de biens qui régit leurs rapports patrimoniaux.
Cela signifie que tous les biens acquis par les partenaires avant et après l’enregistrement du pacs leur appartiennent un propre.
Une lecture affinée de l’article 515-4 révèle toutefois qu’il convient de distinguer les meubles dont la propriété est établie de ceux pour lesquels aucun des partenaires ne peut prouver sa qualité de propriétaire
- S’agissant des biens dont la propriété est établie
- C’est l’alinéa 1er de l’article 515-4 qui s’applique en pareille hypothèse
- Ils restent dans le patrimoine personnel du partenaire qui les a acquis
- Il est indifférent que l’acquisition soit intervenue avant ou après l’enregistrement du pacs.
- S’agissant des biens dont la propriété n’est pas établie
- L’article 515-5 du Code civil pris en son deuxième alinéa prévoit que :
- D’une part, chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
- D’autre part, les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
- Il s’évince de cette disposition que, lorsque les biens sont acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du PACS, ils sont présumés indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale.
- Il en est de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être établie
- L’article 515-5 du Code civil pris en son deuxième alinéa prévoit que :
ii. Exception
Si le législateur a institué le régime de la séparation de biens en principe, il a offert la possibilité aux partenaires d’y déroger en concluant une convention d’indivision.
L’article 515-5-1 du Code civil prévoit en ce sens que :
- D’une part, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions.
- D’autre part, ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
Ce régime d’indivision auquel les partenaires ont la faculté d’adhérer par convention s’articule autour de deux principes :
- Premier principe
- L’indivision s’applique aux seuls acquêts, c’est-à-dire aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après l’enregistrement de leur convention.
- S’agissant des biens acquis l’enregistrement de la convention d’indivision qui n’est pas nécessairement concomitant à l’enregistrement du pacs, ils demeurent appartenir en propre aux partenaires
- Second principe
- Les biens visés par la convention conclue par les partenaires sont réputés indivis pour moitié.
- Cela signifie qu’en cas de liquidation du pacs la répartition s’opérera à parts égales, sauf à ce qu’une fraction du bien ait été financée par des fonds propres d’un partenaire.
- Dans cette hypothèse, seule la portion du bien qui constitue un acquêt fera d’un partage par moitié.
- Exemple :
- un immeuble est acquis pour 50 % avec les fonds propres d’un partenaire, pour l’autre moitié avec des fonds indivis.
- Dans cette hypothèse, en cas de partage, le partenaire qui aura financé le bien avec ses fonds propres sera fondé à revendiquer 75% du bien, tandis que l’autre ne percevra que 25% de sa valeur.
L’article 515-5-3 du Code civil précise que la convention d’indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité.
Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu’elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil.
iii. Exception à l’exception
En cas de conclusion par les partenaires d’une convention d’indivision, le législateur a prévu qu’un certain nombre de biens échappaient à son champ d’application.
L’article 515-5-2 prévoit que demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
- Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien ;
- Les biens créés et leurs accessoires ;
- Les biens à caractère personnel ;
- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
- Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
- Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.
Le dernier alinéa de cette disposition précise que l’emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l’objet d’une mention dans l’acte d’acquisition.
L’emploi est un acte qui stipule la provenance des deniers et la volonté de leur propriétaire de les employer pour l’acquisition d’un bien propre.
À défaut d’accomplissement des formalités d’emploi, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance entre partenaires.
b.2. L’acquisition d’un bien en commun dans le cadre d’un concubinage
En théorie, la cessation du concubinage ne devrait emportait aucune conséquence juridique.
Spécialement, comme rappelé régulièrement par la jurisprudence, le statut juridique dont jouissent les époux n’est pas applicable aux concubins.
La conséquence en est que ces derniers ne sauraient se prévaloir des règles qui gouvernent la liquidation du régime matrimonial.
En pratique, toutefois, la rupture du concubinage soulève de nombreuses difficultés, d’ordre juridique, face auxquelles les juridictions ne peuvent pas rester indifférentes.
Par hypothèse, l’existence d’une vie commune va conduire les concubins à acquérir des biens, tantôt séparément, tantôt en commun.
Au moment de cessation du concubinage, il conviendra donc de démêler leurs intérêts et leurs biens qui, parce que s’est instituée entre eux une communauté de vie, se sont entrelacés, voire parfois confondus.
Aussi, la question se posera de la liquidation de leurs intérêts pécuniaires. En l’absence de régime matrimonial, cette liquidation ne pourra s’opérer que selon les règles du droit commun.
Concrètement, la liquidation du concubinage suppose de surmonter une importante difficulté et non des moindres : la preuve de la propriété des biens.
À titre de remarque liminaire, il convient d’observer que, lors de la cessation du concubinage, la preuve de la propriété d’un bien ne soulèvera de difficulté qu’en cas de dispute, par les concubins, de la qualité de propriétaire.
Dans cette perspective, il est parfaitement envisageable que les concubins se répartissent les biens sans tenir compte des règles qui gouvernent la propriété et notamment faire fi de la question de savoir qui a financé l’acquisition de tel ou tel bien.
C’est donc seulement en cas de désaccord sur la propriété d’un bien que la preuve de la qualité de propriétaire devra être rapportée.
Deux hypothèses doivent être distinguées :
==>Le bien revendiqué est assorti d’un titre de propriété
Deux situations doivent alors être distinguées :
- Le bien a été financé par le titulaire du titre de propriété
- Le titre de propriété est un acte qui constate un droit de propriété
- Il permet à celui désigné dans l’acte de justifier de sa qualité de propriétaire
- Le titre de propriété est dressé en cas de vente immobilière, de cession de fonds de commerce et plus généralement en cas d’acquisition d’un droit de propriété ou de créance qui fait l’objet de formalités de publicité
- Aussi la propriété du bien reviendra à celui qui est désigné dans l’acte
- Dans l’hypothèse où les deux concubins sont désignés dans l’acte, le bien sera soumis au régime de l’indivision.
- Le bien n’a pas été financé ou seulement partiellement par le titulaire du titre de propriété
- Dans cette hypothèse, la jurisprudence considère que le titre prime sur la finance.
- Dans un arrêt du 19 mars 2004, la Cour de cassation a estimé que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n°13-14.989).
- Ainsi, peu importe que le bien ait été entièrement financé par le concubin qui en revendique la propriété.
- La qualité de propriétaire est, en toutes circonstances, endossée par le titulaire du titre de propriété.
- Dans un arrêt du 2 avril 2014, la Cour de cassation a précisé que le concubin qui avait financé en intégralité l’acquisition d’un bien en indivision n’était pas fondé à se prévaloir d’une créance de remboursement à l’encontre de sa concubine dès lors qu’il avait été établi que celui-ci était animé d’une intention libérale.
- Toute la difficulté sera alors de prouver l’intention libérale qui, selon la première chambre civile, peut se déduire « des circonstances de la cause » (Cass. 1ère civ., 2 avr. 2014, n°13-11.025).
- Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Première chambre civile a encore rejeté la demande de remboursement formulé par le concubin qui avait supporté l’intégralité de l’acquisition d’un bien indivis au motif que ce financement s’analysait en une dépense de la vie courant (Cass. 1ère civ. 13 janv. 2016, n°14-29.746).
- La solution retenue par la Cour de cassation ici est éminemment contestable dans la mesure où les concubins ne sont assujettis à aucune obligation de contribuer aux dépenses de la vie courante à l’instar des époux sur lesquels pèse une obligation de contribution aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil.
- Bien que critiquable, cette solution a été reconduite par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2018 (Cass. 1ère civ. 7 févr. 2018, n°17-13.979).
==>Le bien revendiqué n’est assorti d’aucun titre de propriété
En l’absence de titre, rien n’est perdu pour le concubin revendiquant qui pourra toujours rapporter la preuve de la propriété du bien.
Toutefois, il ne pourra, ni compter sur la présomption de possession s’il souhaite établir la propriété exclusive d’un bien, ni ne pourra se prévaloir d’une présomption d’indivision s’il souhaite prouver la propriété indivise du bien.
- L’inopérance de la présomption de possession
- Aux termes de l’article 2276 du Code civil « en fait de meubles, la possession vaut titre »
- Cela signifie que celui qui exerce la possession sur un bien est réputé en être le propriétaire.
- Cette présomption est, de toute évidence, très pratique pour établir la propriété d’un bien lorsque l’on est muni d’aucun titre ce qui sera presque toujours le cas pour les biens meubles
- La mise en œuvre de cette présomption est toutefois subordonnée à l’établissement d’une possession non équivoque sur le bien.
- En cas de concubinage, il sera, par hypothèse, extrêmement difficile de satisfaire cette condition, dans la mesure où l’existence d’une communauté de vie entre les concubins confère précisément à la possession du bien revendiqué un caractère équivoque.
- D’où la position de la Cour de cassation qui, systématique, refuse de faire jouer la présomption de l’article 2276 à la faveur du concubin revendiquant.
- Aussi, lui appartiendra-t-il de rapporter la preuve de la propriété du bien par tous moyens.
- Pour établir sa qualité de propriétaire, il pourra, notamment, se rapporter aux circonstances qui ont entouré l’acquisition du bien
- Le plus souvent, le juge déterminera la titularité de la propriété du bien disputé en recourant à la méthode du faisceau d’indices.
- Il tiendra notamment compte de l’auteur du financement du bien ou encore de l’existence d’une intention libérale
- Il pourra encore se référer au nom du signataire de l’acte d’acquisition du bien.
- L’absence de présomption d’indivision
- Principe
- Il est de jurisprudence constante qu’il n’existe pas de présomption d’indivision entre concubins.
- Dans un arrêt du 25 juin 2014, la Cour de cassation a considéré, par exemple, s’agissant de la propriété de fonds déposés sur un compte bancaire que « le titulaire d’un compte bancaire est présumé seul propriétaire des fonds déposés sur ce compte et qu’il appartient à son adversaire d’établir l’origine indivise des fonds employés pour financer l’acquisition de l’immeuble indivis » (Cass. 1ère civ. 25 juin 2014, n°13-18.891).
- Dans le même sens la Cour d’appel d’Amiens a jugé dans un arrêt du 8 janvier 2009 qu’il s’infère de l’article 515-8 du Code civil qu’il « n’existe ni indivision, ni présomption d’indivision entre deux personnes vivant en concubinage » (CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128).
- Il en résulte qu’il appartient à celui qui revendique la propriété indivise d’un bien de le prouver.
- La Cour d’appel de Riom a de la sorte considérer « qu’en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. » (CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253)
- Exception
- L’absence de présomption d’indivision entre concubins est assortie d’une exception.
- Dans l’hypothèse où aucun des concubins ne parvient à établir qu’il est le propriétaire exclusif du bien revendiqué, celui-ci sera réputé indivis pour moitié (V. en cens CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463).
- La présomption d’indivision n’intervient ainsi, qu’à titre subsidiaire.
- Principe
3.2. L’acquisition d’un bien en commun en dehors du couple
Pour qu’un bien puisse être reconnu comme appartenant à plusieurs personnes, il doit être mentionné dans le titre de propriété que ce bien a été acquis en indivision.
Dans un arrêt du 5 octobre 1994, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée » (Cass. 1ère civ. 5 oct. 1994, n°92-19.169).
Il ressort de cette disposition que le titre prime toujours sur la finance. Autrement dit, il est indifférent que l’acquisition du bien n’ait pas été financée par la personne désignée dans le titre de propriété ; seule cette dernière est considérée comme la seule et unique propriétaire du bien. En somme, le propriétaire est toujours celui qui achète le bien et non celui finance.
Il peut être observé que si le titre constate que le bien a été acquis en indivision, mais qu’il ne précise pas le montant de la quote-part détenue par chaque indivisaire, le bien est réputé appartenir pour moitié à chacun (V en ce sens Cass. 1ère civ. 4 mars 2015, n°14-11.278).
Lorsque plusieurs personnes acquièrent ainsi un bien en indivision, il est préconisé de préciser dans l’acte d’acquisition les proportions des droits détenus par chacune d’elles.
B) Existence de biens partageables
L’exercice du droit de tout indivisaire de solliciter le partage, consacré par l’article 815 du Code civil, suppose nécessairement que les biens composant l’indivision soient susceptibles de partage. Cependant, cette faculté trouve des limites importantes, posées par la loi ou la nature même de certains biens. Ainsi, tous les biens indivis ne peuvent être soumis à une demande en partage, en raison soit de leur inclusion dans des régimes d’indivision forcée ou perpétuelle, soit de leur affectation à des finalités spécifiques.
Cette réflexion appelle une double approche : d’une part, il convient de définir les biens qui composent l’indivision et, d’autre part, d’examiner ceux qui, bien que potentiellement indivis, échappent à toute procédure de partage.
Dans cette perspective, nous aborderons d’abord les catégories de biens qui constituent le patrimoine indivis, avant d’explorer les exclusions qui s’imposent, qu’il s’agisse des biens soumis à un régime d’indivision forcée ou perpétuelle, ou des biens spécifiques comme ceux affectés au culte, ceux à caractère familial, ou encore ceux attachés à l’exercice d’une fonction. Ces restrictions, loin d’être anecdotiques, traduisent des considérations juridiques et sociales majeures qui encadrent le droit au partage.
1. Les biens faisant l’objet du partage
1.1. Principe général
Le partage constitue l’aboutissement naturel de l’indivision, un état temporaire où les biens, matériels ou immatériels, sont détenus collectivement par les indivisaires. Ce processus repose sur un principe fondamental : tous les biens appartenant à l’indivision au moment du partage, qu’il s’agisse de biens existants, de biens subrogés ou des fruits et revenus générés pendant l’indivision, doivent être inclus dans la répartition patrimoniale.
Les biens existants, qu’ils soient immobiliers, mobiliers ou incorporels, forment le socle initial du partage. À ces biens s’ajoutent ceux issus du mécanisme de subrogation réelle, comme le prix de vente, les indemnités d’assurance ou d’expropriation, qui remplacent les biens aliénés ou détruits. Ces éléments préservent l’intégrité de la masse à partager et garantissent que les droits des indivisaires ne soient ni altérés ni amoindris par les évolutions survenues durant l’indivision.
Le partage ne se limite pas à une répartition statique des biens. Il tient également compte des variations de leur valeur, qu’il s’agisse de plus-values réalisées ou de pertes subies en cours d’indivision, souvent liées à des fluctuations économiques ou à une gestion active des biens. Ces évolutions influent directement sur l’équilibre des droits entre indivisaires, et leur prise en compte lors du partage est essentielle pour assurer une répartition équitable.
Ainsi, le partage ne représente pas seulement la sortie de l’indivision, mais aussi l’aboutissement d’un processus visant à rétablir les droits individuels de chacun, dans le respect des apports et de l’évolution des biens indivis. Il consacre une répartition équilibrée, tenant compte à la fois de la nature, de la valeur et de la dynamique des éléments composant la masse indivise.
1.2. Mise en œuvre
a. Les biens existants
Les biens existants forment la base essentielle de toute masse partageable, qu’elle résulte d’une indivision successorale, conventionnelle ou légale.
Dans le cadre d’une indivision successorale, ces biens comprennent l’intégralité des éléments patrimoniaux ayant appartenu au de cujus et demeurant dans la succession au jour du partage.
i. Notion et délimitation des biens existants
==>Les biens ordinaires
Les biens existants sont ceux qui appartiennent à l’indivision au moment de l’ouverture de celle-ci et qui n’ont pas été cédés, consommés ou aliénés avant la clôture des opérations de partage.
Ces biens peuvent revêtir différentes formes, au nombre desquels figurent :
- Les biens immobiliers : terrains, maisons, appartements, immeubles de rapport, qui constituent souvent une partie substantielle de la masse indivise.
- Les biens mobiliers : meubles corporels tels que les objets d’art, les véhicules, les meubles d’ameublement, ainsi que les biens mobiliers incorporels comme les valeurs mobilières, les comptes bancaires ou les titres de créances.
- Les parts sociales et actions : dans les sociétés civiles ou commerciales, les parts détenues par le défunt, tant qu’elles n’ont pas été transmises par cession, restent dans la masse indivise.
- Les droits patrimoniaux : droits de créance, droits d’exploitation d’une entreprise individuelle ou droits attachés à des propriétés intellectuelles.
Le partage de ces biens dépend de leur existence au jour du partage. Dans un arrêt du 9 mai 9178, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date du partage » (Cass. 1ère civ., 9 mai 1978, n°76-12.646), soulignant ainsi la nécessité d’exclure les biens qui ont disparu de la masse successorale avant cette date, que ce soit par aliénation, consommation ou destruction.
==>Les libéralités rapportées ou réduites
En sus des biens existants au sens strict, les libéralités consenties à certains héritiers peuvent également entrer dans la masse à partager sous réserve de certaines conditions.
En effet, ces libéralités sont susceptibles d’être rapportées à la masse indivise ou réduites si elles excèdent la quotité disponible et portent atteinte à la réserve héréditaire.
L’article 843 du Code civil prévoit en ce sens que les héritiers réservataires sont tenus de rapporter à la masse successorale les biens dont ils ont pu bénéficier à titre de donation ou d’avantage indirect.
Deux situations sont à envisager :
- Le rapport des libéralités
- Il s’agit de remettre fictivement dans la masse successorale les biens reçus par un héritier en avance sur sa part d’héritage.
- Ces biens peuvent être rapportés en nature (si le bien est resté dans le patrimoine de l’héritier) ou en valeur.
- Le but est ici de préserver l’égalité entre les héritiers.
- La réduction des libéralités
- Si les donations ou legs consentis par le défunt dépassent la quotité disponible, ils peuvent être réduits pour protéger les droits des héritiers réservataires.
- La réduction s’effectue en valeur ou en nature selon les modalités prévues par les articles 924 et suivants du Code civil.
Dans ces cas, même si les biens en question ont été donnés avant l’ouverture de la succession, leur valeur est réintégrée dans la masse à partager pour préserver l’égalité entre les cohéritiers.
ii. L’évolution de la masse indivise jusqu’au partage
Il convient de souligner que la masse indivise n’est pas figée. Elle peut évoluer entre l’ouverture de l’indivision et le partage définitif.
Pendant cette période, les biens peuvent être vendus, dégradés ou augmenter de valeur.
Par exemple, les immeubles indivis peuvent prendre de la valeur sur le marché immobilier ou au contraire subir une dépréciation en fonction des conditions économiques.
L’article 822 du Code civil précise que l’évaluation des biens indivis se fait à la date la plus proche du partage afin de tenir compte de ces fluctuations.
En cas d’augmentation de la valeur des biens, celle-ci bénéficie à l’ensemble des indivisaires.
De la même manière, toute dépréciation impacte collectivement les indivisaires. Les plus-values réalisées, par exemple en cas de gestion ou d’améliorations apportées aux biens indivis par un des cohéritiers, sont elles aussi réparties au prorata des droits indivisaires, sauf demande de remboursement pour les investissements réalisés (Cass. 1ère civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).
iii. L’importance d’une évaluation exhaustive des biens existants
Il est essentiel de procéder à une évaluation complète et précise de l’ensemble des biens existants au jour du partage.
L’omission d’un bien dans la masse indivise peut entraîner un partage complémentaire, quand bien même la valeur du bien omis est minime.
Dans d’une décision du 15 mai 2008, la Cour de cassation a rappelé en ce sens que « lorsqu’un bien est omis lors du partage, cela impose la réalisation d’un partage complémentaire, quelle que soit la valeur du bien omis » (Cass. 1ère civ., 15 mai 2008, n°06-19.416).
Cette règle vise à garantir que tous les biens constituant la masse successorale soient effectivement répartis entre les cohéritiers, protégeant ainsi les droits de chacun.
Aussi, sauf renonciation expresse d’un indivisaire à ses droits, l’omission d’un bien ne saurait priver un indivisaire de sa part dans ce bien. Le fait de ne pas avoir mentionné un bien dans le partage initial n’éteint donc pas les droits des indivisaires sur ce bien.
b. Les créances
Les créances indivises peuvent constituer une composante importante de l’actif de l’indivision, car elles représentent des droits que l’indivision détient envers des tiers.
Elles peuvent prendre différentes formes : créances de nature contractuelle, créances liées à des droits de propriété, ou encore créances issues de la gestion des biens indivis.
Leur gestion au sein de l’indivision est encadrée par des principes stricts de répartition entre les indivisaires.
i. Le principe de division des créances
==>Énoncé du principe
En application de l’article 1309, al. 1er du Code civil, dès l’ouverture de l’indivision, les créances se divisent de plein droit entre les indivisaires, au prorata de leurs parts dans la succession.
Ce principe est applicable aussi bien en cas d’indivision successorale qu’en cas d’indivision conventionnelle. Cela signifie que chaque indivisaire devient titulaire de la fraction de la créance correspondant à sa quote-part dans l’indivision.
En pratique, cela permet à chaque indivisaire de réclamer directement sa part de la créance à un tiers débiteur. Cette règle vise à simplifier le recouvrement des créances tout en respectant les droits proportionnels de chacun des indivisaires.
==>Mise en œuvre du principe
Lorsqu’une créance indivise est recouvrée par un indivisaire, ce dernier doit s’assurer de ne percevoir que sa part proportionnelle.
Si un indivisaire reçoit un montant supérieur à sa quote-part dans la créance, il est tenu de rembourser l’excédent à ses coindivisaires. Cette obligation découle du principe d’équité qui régit l’indivision.
L’effet déclaratif du partage, prévu par l’article 883 du Code civil, joue un rôle important ici.
Lors du partage de l’indivision, chaque indivisaire est considéré comme ayant toujours été propriétaire exclusif des biens qui lui sont attribués depuis l’origine de l’indivision.
Cela signifie qu’une créance qui est partagée ne fait l’objet d’un transfert qu’au moment du partage, ce qui peut avoir des conséquences sur les paiements effectués avant le partage.
Si, par exemple, une créance successorale est cédée par un indivisaire avant le partage, cette cession pourrait être annulée si, au moment du partage, la créance est attribuée à un autre indivisaire.
Cela a été confirmé par la jurisprudence dans un arrêt ancien, mais encore souvent cité : Cass. req., 13 janv. 1909, qui rappelle que la cession d’une créance par un indivisaire avant partage est nulle si celui-ci n’en est pas attributaire lors du partage.
Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage de la succession.
Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier. La Cour de cassation a jugé que cette cession était nulle, car l’indivisaire cédant n’avait pas été attributaire de la créance au moment du partage.
Il ressort de cette jurisprudence que, jusqu’au partage, l’indivisaire ne saurait valablement céder une créance indivise, car l’effet déclaratif du partage signifie qu’il n’est considéré comme ayant eu un droit exclusif sur cette créance qu’à partir du moment où elle lui est attribuée définitivement lors du partage.
En effet, l’effet déclaratif du partage, consacré par l’article 883 du Code civil, signifie que le partage ne fait que constater et déclarer des droits qui existaient depuis l’ouverture de la succession, mais que chaque héritier est censé avoir eu de manière exclusive sur les biens qui lui sont attribués.
Avant le partage, les biens de la succession sont indivis, et chaque indivisaire est copropriétaire de la totalité des biens à hauteur de sa quote-part. Un indivisaire ne peut donc céder un bien ou une créance tant que celui-ci n’a pas été précisément attribué à lui lors du partage.
Cette règle vise à préserver l’intégrité de la masse successorale jusqu’au partage et d’éviter des complications liées à des cessions de biens indivis avant leur attribution définitive.
ii. Exception : les créances indivisibles
Toutes les créances ne sont pas divisibles entre les indivisaires. Certaines créances, en raison de leur nature, sont considérées comme indivisibles et doivent être recouvrées et partagées dans leur totalité par l’ensemble des indivisaires.
Un exemple typique est celui des indemnités d’expropriation, que la jurisprudence a qualifiées de créances indivisibles.
Dans une décision importante, la Cour de cassation a jugé que ces indemnités ne pouvaient pas être divisées entre les indivisaires, et devaient donc être partagées dans leur ensemble (Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n°94-86.191).
Dans cette affaire, une indemnité d’expropriation avait été accordée pour un bien appartenant à une indivision.
Le problème portait sur la manière dont cette indemnité devait être traitée et répartie entre les indivisaires, certains d’entre eux contestant les modalités de la répartition.
Plus précisément, la question soulevée était de savoir si une indemnité d’expropriation, touchant un bien indivis, pouvait être divisée entre les indivisaires ou si elle devait être considérée comme indivisible.
La Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est indivisible, confirmant ainsi que cette indemnité devait être partagée entre tous les indivisaires de manière globale.
Elle ne pouvait donc pas, en d’autres termes, être divisée et recouvrée séparément par chaque indivisaire en fonction de sa quote-part dans l’indivision.
Il s’en déduit qu’une créance liée à l’indemnité d’expropriation d’un bien indivis est insusceptible de faire l’objet d’une division proportionnelle comme les autres créances ordinaires de l’indivision.
La raison en est que l’indivisibilité de l’indemnité d’expropriation repose sur la nature même de cette indemnité, qui est censée compenser la perte d’un bien indivis dans son ensemble.
Le bien étant indivis, l’indemnité qui le remplace doit également être considérée comme indivise et répartie globalement entre les co-indivisaires au moment du partage.
La jurisprudence justifie cette position par la nécessité de maintenir la cohérence de l’indemnisation en cas d’expropriation d’un bien indivis.
Puisque le bien appartient en commun à tous les indivisaires, l’indemnité accordée par les autorités expropriantes est considérée comme une créance unique et indivisible, à répartir seulement après avoir été reçue globalement par l’indivision.
Il peut être observé que le caractère indivisible d’une créance peut également se retrouver dans d’autres situations, notamment lorsque la nature même de l’obligation le rend impossible. Cela peut notamment concerner des créances liées à des préjudices moraux, ou des obligations contractuelles spécifiques.
c. Les biens subrogés
La subrogation réelle consiste à substituer dans un patrimoine une chose par une autre.
Il en va ainsi lorsqu’un bien mobilier ou immobilier dont est propriétaire une personne est remplacé par une somme d’argent correspondant à la valeur du bien remplacé.
Cette somme d’argent peut consister en un prix de vente, à une indemnité d’assurance ou encore à une indemnité d’expropriation.
La particularité de la subrogation réelle est donc qu’elle opère le remplacement dans un bien par un autre, sans pour autant modifier le rapport de propriété préexistant liant le propriétaire à la chose.
C’est là le sens de l’adage subrogatum capit naturam subrogi, soit ce qui est subrogé prend la nature de ce à quoi il est subrogé.
La conséquence en est que la subrogation n’affecte pas le droit réel exercé par le propriétaire ; elle substitue seulement son objet.
A cet égard, le mécanisme de la subrogation réelle trouve une application dans le régime des indivisions, particulièrement lorsque des biens sont vendus, détruits ou remplacés.
La subrogation permet ainsi d’assurer la continuité de la masse indivise, en substituant à un bien disparu un équivalent en nature ou en valeur (prix de vente, indemnité, créance, etc.). L’objectif est de préserver les droits des indivisaires et de maintenir la cohérence de l’actif indivis jusqu’au partage.
En pratique, cela signifie que le bien subrogé, bien qu’il diffère dans sa forme ou sa valeur, continue à appartenir à la masse indivise et reste soumis aux règles qui gouvernent le partage.
Le principe de la subrogation réelle est issu de l’arrêt Chollet-Dumoulin rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 5 décembre 1907 (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
Dans cette affaire, les indivisaires avaient vendu un bien immobilier indivis et une contestation était née quant à la répartition du prix de vente.
La question portait sur le fait de savoir si le prix de vente devait être considéré comme faisant partie de la succession et partagé entre les indivisaires, ou s’il pouvait être exclu de la masse indivise.
La Cour de cassation a tranché en faveur de l’intégration du prix de vente à la masse indivise, affirmant que le produit de la vente d’un bien indivis devait être considéré comme un « effet de succession ».
Le prix de vente remplace donc le bien vendu et devient un bien subrogé à répartir entre les indivisaires de la même manière que le bien lui-même aurait été partagé. Cet arrêt a posé le fondement de la subrogation réelle, garantissant ainsi que la vente d’un bien indivis n’entraîne pas la perte de valeur pour les indivisaires mais simplement son transfert sur une somme d’argent.
Dès lors, la subrogation réelle peut intervenir selon deux modalités principales :
- La subrogation automatique
- Lorsqu’elle est automatique, la subrogation réelle joue de plein droit.
- Ce mécanisme est mise en oeuvre dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit, sans nécessiter l’accord des indivisaires.
- Par exemple, le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité d’assurance en cas de destruction entre automatiquement dans la masse indivise.
- Ce principe de subrogation automatique assure que les droits des indivisaires sur les biens aliénés sont préservés et reportés sur la somme obtenue en contrepartie.
- La subrogation volontaire
- Il est des cas où pour produire ses effets, la subrogation requiert le consentement des indivisaires, notamment en matière d’emploi ou de remploi de biens indivis.
- Ici, le produit de la vente d’un bien indivis peut être réinvesti dans l’acquisition d’un nouveau bien, à condition que tous les indivisaires y consentent.
- Ce nouveau bien deviendra alors lui-même indivis, mais seulement si les cohéritiers acceptent explicitement cette opération.
i. La subrogation automatique : un principe général
La subrogation réelle est, en principe, automatique et s’applique de plein droit dès lors qu’un bien indivis est aliéné ou détruit.
Ce principe est consacré par l’article 815-10 du Code civil, qui prévoit que les créances et indemnités venant remplacer des biens indivis entrent automatiquement dans la masse indivise.
Ainsi, les indivisaires conservent-ils leurs droits, non plus sur le bien initial, mais sur la somme ou l’indemnité qui le remplace.
La subrogation automatique est susceptible de jouer dans plusieurs situations :
- Vente d’un bien indivis : le prix de vente comme bien subrogé
- Lorsqu’un bien indivis est vendu, le prix de vente se substitue automatiquement au bien vendu et intègre la masse indivise.
- Cette subrogation a pour effet de remplacer le bien physique par une créance pécuniaire, qui est alors partagée entre les indivisaires selon leurs droits dans l’indivision.
- Ainsi, les indivisaires conservent une quote-part dans le produit de la vente.
- C’est ce principe que l’arrêt Chollet-Dumoulin est venu consacrer (Cass. ch. Réunies, 5 déc. 1907).
- Ce principe garantit que la vente d’un bien indivis ne prive pas les indivisaires de leurs droits, mais simplement les reporte sur une somme d’argent.
- Indemnité d’assurance : subrogation en cas de destruction d’un bien
- En cas de destruction d’un bien indivis, par exemple à la suite d’un sinistre, l’indemnité d’assurance versée en réparation du dommage se substitue automatiquement au bien détruit.
- Cette indemnité est intégrée dans la masse indivise et se partage entre les indivisaires selon leurs parts respectives.
- Ce principe a été confirmé par l’arrêt Cass. 1re civ., 19 mars 2014, dans lequel la Cour de cassation a jugé que l’indemnité d’assurance subrogée à un bien indivis détruit doit être intégrée à l’indivision, même si son montant dépasse la valeur initiale du bien détruit.
- Le juge du partage n’a aucun pouvoir pour discuter le montant de l’indemnité ; il doit l’intégrer intégralement à l’actif indivis (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014, n° 13-12.578).
- Créances successorales : annulation des cessions avant partage
- Un autre exemple de subrogation réelle se retrouve dans le cas des créances successorales.
- Si un indivisaire cède une créance avant le partage et que cette créance n’est finalement pas attribuée à cet indivisaire au moment du partage, la cession est annulée.
- C’est le principe de l’effet déclaratif du partage qui est à l’œuvre ici, comme l’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 1909 (Cass. req., 13 janvier 1909).
- Dans cette affaire, un indivisaire avait cédé une créance successorale avant le partage.
- Toutefois, au moment du partage, cette créance n’avait pas été attribuée au cédant, mais à un autre héritier.
- La Cour de cassation a jugé que la cession de cette créance était nulle, car l’indivisaire cédant n’était pas devenu propriétaire exclusif de la créance avant le partage.
- Cet arrêt confirme que, tant que le partage n’a pas eu lieu, les droits des indivisaires sur les biens de la succession sont indivis et ne peuvent pas faire l’objet d’une cession indépendante par un seul co-indivisaire.
- Ce principe s’infère de l’article 883 du Code civil, selon lequel le partage a un effet déclaratif : il ne crée pas de nouveaux droits mais attribue à chaque indivisaire la portion de biens à laquelle il avait déjà droit depuis l’ouverture de la succession.
- Ainsi, la cession d’un bien indivis avant le partage n’est valable que si le bien est effectivement attribué à l’indivisaire cédant au moment du partage.
ii. La subrogation volontaire : emploi et remploi des biens indivis
Par exception, certaines situations de subrogation réelle ne sont pas automatiques et requièrent le consentement des indivisaires.
Cela concerne principalement les cas d’emploi et de remploi, où le prix de vente d’un bien indivis ou une indemnité est réinvesti dans un nouveau bien. Cette forme de subrogation est dite volontaire, car elle requiert l’accord unanime des indivisaires.
En effet, l’emploi et le remploi sont des mécanismes qui permettent de réinvestir les sommes issues de la vente d’un bien indivis dans l’acquisition d’un nouveau bien.
Ce nouveau bien devient alors indivis, à condition que tous les indivisaires aient donné leur consentement.
L’article 815-10 du Code civil précise en ce sens que les biens acquis en emploi ou en remploi de biens indivis ne peuvent être eux-mêmes indivis que si tous les indivisaires ont consenti à cette opération.
Ce consentement est indispensable pour éviter que l’un des indivisaires ne soit contraint d’accepter l’acquisition d’un nouveau bien en indivision contre son gré. En l’absence d’accord unanime, seul le prix de vente ou l’indemnité d’assurance reste dans la masse indivise, mais aucun nouveau bien ne peut être intégré à l’indivision.
La jurisprudence a confirmé à plusieurs reprises le caractère volontaire de l’emploi et du remploi, notamment à travers d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 février 1996 (Cass. 1ère civ., 20 févr. 1996, 93-21.141)
Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si les opérations de gestion effectuées par le gérant d’une indivision, en utilisant des fonds indivis pour acquérir de nouveaux biens, pouvaient être considérées comme ayant été réalisées au profit de l’indivision.
L’époux, qui était le gérant de l’indivision post-communautaire, avait effectué des achats avec les deniers indivis. Le litige portait sur la question de savoir si ces biens nouvellement acquis devaient être considérés comme des biens indivis, au titre de la subrogation réelle.
La Cour de cassation a confirmé que les opérations de remploi effectuées par le gérant d’une indivision post-communautaire étaient valables, sous réserve que ces opérations aient été réalisées avec le consentement des indivisaires ou, à défaut, dans l’intérêt de l’indivision.
En l’espèce, la Cour a jugé que toutes les acquisitions réalisées par le gérant avec des deniers indivis l’avaient été volontairement pour le compte de l’indivision, car il avait agi dans l’intérêt de celle-ci et avec l’accord implicite des autres indivisaires.
Ainsi, la simple utilisation de deniers indivis ne suffit donc pas à opérer une subrogation ; il faut également une intention manifeste d’acquérir pour le compte de l’indivision.
En revanche, si l’emploi ou le remploi a lieu sans le consentement de tous les indivisaires, la subrogation ne pourra pas être imposée. Dans ce cas, seule la somme d’argent, comme le prix de vente ou l’indemnité, restera dans la masse indivise.
En cas de désaccord entre les indivisaires sur la question du remploi, il est possible de demander l’intervention du juge.
L’article 815-6 du Code civil permet au tribunal judiciaire de prendre des mesures urgentes pour protéger les intérêts de l’indivision, notamment en autorisant une opération de remploi en l’absence d’accord unanime.
De même, l’article 815-5 du Code civil permet à un indivisaire d’agir seul en cas de gestion d’affaires, à condition que cela soit dans l’intérêt commun et justifié par l’urgence ou la conservation du bien.
d. Les biens à caractère personnel
Certains biens, bien qu’ayant un caractère personnel, peuvent être inclus dans la masse partageable de l’indivision, mais sous certaines conditions particulières.
La jurisprudence a établi une distinction essentielle entre la titularité (ou le titre) de ces biens, qui reste personnelle et intransmissible, et leur valeur économique, qui, elle, peut être intégrée à la masse indivise et partagée entre les coindivisaires.
Ce principe de distinction entre le titre et la valeur permet de concilier le caractère personnel de certains biens avec la nécessité de partager leur valeur économique dans une indivision. Il trouve son origine dans la gestion des offices ministériels et a ensuite été transposé à d’autres types de biens présentant des caractéristiques similaires, comme les parts sociales ou les clientèles professionnelles.
i. Origine de la distinction entre le titre et la finance
Les offices ministériels (notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, etc.) illustrent bien la distinction entre le titre et la finance car ils se caractérisent par deux aspects distincts :
- Le titre, qui confère à son titulaire l’autorisation d’exercer une mission de service public. Ce titre, octroyé par l’État, est strictement personnel, car il repose sur des qualifications spécifiques et des agréments particuliers liés à la personne du titulaire. En raison de ce caractère personnel, la titularité d’un office ne peut être cédée ou partagée dans le cadre d’une indivision.
- La finance, ou la valeur économique de l’office, est en revanche patrimoniale. Cette valeur correspond au prix de marché de l’office et peut être partagée, notamment lors d’une succession ou d’un partage. Ainsi, même si le titre reste propre au titulaire, la valeur patrimoniale de l’office (appelée finance) peut être incluse dans la masse indivise et partagée entre les indivisaires.
Cette distinction a été consacré par la jurisprudence, notamment pour éviter que les coindivisaires ou le conjoint d’un titulaire d’office ne puissent revendiquer la titularité de l’office, tout en leur permettant de bénéficier de la valeur économique qu’il représente.
ii. Extension de la distinction à d’autres biens à caractère personnel
Au fil du temps, cette distinction entre le titre et la valeur a été transposée à d’autres biens à caractère personnel, tels que les parts sociales dans des sociétés de personnes, les clientèles professionnelles, ou encore certaines concessions administratives.
==>Les parts dans des sociétés de personnes
Dans les sociétés de personnes, comme les sociétés civiles ou les SNC (Société en Nom Collectif), la qualité d’associé repose sur une relation de confiance (intuitu personae) entre les associés.
La titularité des parts sociales est donc strictement personnelle et intransmissible sans l’accord des autres associés.
Cependant, la valeur patrimoniale de ces parts peut entrer dans la masse indivise et être partagée entre les indivisaires au moment du partage.
==>Les clientèles professionnelles
La clientèle d’un professionnel (médecin, avocat, notaire) repose sur une relation de confiance personnelle avec les clients, ce qui la rend intransmissible.
Toutefois, la valeur économique de cette clientèle peut être incluse dans l’actif indivis.
Par exemple, lors de la liquidation d’une indivision post-communautaire, la valeur patrimoniale de la clientèle peut être évaluée et partagée entre les indivisaires, bien que la titularité de la clientèle reste propre au professionnel.
==>Les concessions administratives
Un autre exemple de cette distinction peut être trouvé dans les concessions administratives, telles que les concessions de parcs à huîtres.
Dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a jugé que la concession, en tant que droit personnel, était intransmissible. Toutefois, la valeur patrimoniale de cette concession pouvait entrer dans la masse commune ou indivise, permettant ainsi de protéger l’intérêt économique des indivisaires ou du conjoint (Cass. 1ère civ. 8 déc. 1987, n°86-12426).
iii. Application de la distinction dans le cadre de l’indivision
La distinction entre le titre et la finance s’applique donc dans plusieurs cas où le bien est personnel, mais présente une valeur patrimoniale importante. Elle permet de protéger l’aspect personnel du bien, tout en offrant aux indivisaires la possibilité de partager la valeur économique de ce bien.
La jurisprudence est claire : la titularité de certains biens à caractère personnel (parts sociales, offices ministériels, clientèles professionnelles) reste strictement attachée à la personne du titulaire.
Cette intransmissibilité s’explique par les qualités spécifiques requises pour exercer certains droits ou fonctions, ou encore par la relation de confiance personnelle qui caractérise certains types de biens.
En revanche, même si la titularité ne peut être partagée, la valeur économique du bien peut entrer dans la masse indivise. Cela permet d’assurer une équité entre les indivisaires, notamment lorsque le bien représente une part significative du patrimoine indivis. Lors du partage, la valeur de marché du bien est évaluée et incluse dans la masse à partager.
L’évaluation des biens à caractère personnel pour leur intégration dans la masse indivise se fait généralement au moment du partage. Leur valeur marchande est déterminée lors des opérations de liquidation et de partage de l’indivision, et cette valeur est répartie entre les indivisaires proportionnellement à leurs parts.
e. Les fruits et revenus
Les fruits et revenus générés par les biens indivis, tels que les loyers, les dividendes, les intérêts ou d’autres produits, sont des éléments essentiels susceptibles de faire l’objet d’un partage entre les indivisaires. Ces derniers, en s’ajoutant à la masse indivise, augmentent l’actif partageable et garantissent une répartition équitable entre les coindivisaires.
Ce principe est énoncé par l’article 815-10 du Code civil qui prévoit que « les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision ». Selon cette règle, les fruits et revenus bénéficient donc à l’ensemble des indivisaires, évitant qu’un seul ne tire un avantage exclusif des fruits générés par les biens communs.
i. Le principe d’accroissement de la masse indivise
L’objectif de cette règle est d’éviter qu’un indivisaire ne tire un bénéfice personnel des fruits produits par un bien indivis avant le partage, au détriment des autres indivisaires.
Ainsi, les fruits et revenus produits par les biens indivis ne reviennent pas directement à celui qui en a la gestion ou la jouissance temporaire, mais sont intégrés dans la masse indivise pour être partagés lors de la liquidation ou du partage de l’indivision.
Cet équilibre est particulièrement important dans le cadre des successions, où certains héritiers pourraient autrement profiter d’un bien frugifère (comme un immeuble locatif) avant le partage, alors que d’autres ne recevraient qu’un bien non frugifère.
Le fait que les fruits soient inclus dans la masse indivise permet de garantir une égalité entre les héritiers et de compenser les écarts liés à la nature des biens attribués lors du partage.
Ce principe a été consacré depuis longtemps par la jurisprudence, notamment par un arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1858, qui reprend l’adage latin « fructus augent hereditatem », soit les fruits augmentent l’héritage (Cass. civ. 20 juill. 1858).
Ce principe veut que tous les fruits et revenus générés par les biens indivis bénéficient à l’ensemble des indivisaires et non à un seul.
ii. Typologie des fruits et revenus
Les fruits et revenus des biens indivis peuvent prendre plusieurs formes :
- Les fruits naturels
- Les fruits naturels sont les produits qui proviennent des biens immobiliers sans intervention humaine excessive.
- On compte dans cette catégorie notamment :
- Les récoltes agricoles issues de terrains indivis utilisés pour l’agriculture.
- Les produits forestiers comme le bois provenant de forêts indivises, ou encore la résine et autres produits naturels exploitables.
- Les fruits naturels se distinguent par le fait qu’ils sont directement générés par la nature et peuvent être récoltés régulièrement sans affecter la substance du bien d’origine (par exemple, couper du bois dans une forêt sans détruire le terrain). Ces revenus doivent être répartis entre les coindivisaires au moment du partage, sauf si une convention ou un accord a prévu une répartition antérieure.
- Les fruits civils
- Les fruits civils représentent les produits réguliers résultant de l’exploitation de biens indivis, souvent en vertu de contrats conclus avec des tiers. Contrairement aux fruits naturels, les fruits civils nécessitent une gestion active du bien pour en percevoir les revenus.
- Ils incluent notamment :
- Les loyers perçus d’un bien immobilier indivis mis en location. Les revenus locatifs sont considérés comme des fruits civils qui s’ajoutent à la masse indivise.
- Les dividendes provenant de parts sociales ou d’actions détenues en indivision. Si les indivisaires détiennent des titres financiers indivis, les dividendes versés par la société émettrice sont également intégrés à l’actif indivis.
- Les redevances issues de contrats de concession ou d’exploitation, comme la gestion d’un fonds de commerce indivis ou la mise en valeur de propriétés intellectuelles détenues en indivision.
- Les fruits civils sont souvent générés sur une base contractuelle et impliquent une perception périodique (mensuelle, trimestrielle, annuelle, etc.).
- Ces revenus, comme les loyers ou dividendes, doivent être partagés entre les indivisaires en fonction de leurs parts dans l’indivision.
- Si un indivisaire a géré seul un bien et perçu des loyers ou des dividendes, il est tenu de les partager avec les autres, sous peine de devoir indemniser l’indivision.
- Les intérêts
- Les intérêts perçus dans le cadre d’une indivision résultent de placements financiers ou de créances indivises.
- Ces revenus peuvent provenir de différentes sources, telles que :
- Les créances indivises qui génèrent des intérêts, comme un prêt consenti par l’indivision à un tiers. Dans ce cas, les intérêts perçus doivent être répartis entre les indivisaires.
- Les placements financiers, comme des comptes bancaires, des livrets d’épargne ou des obligations détenues par l’indivision. Les intérêts générés par ces placements viennent également augmenter la masse indivise.
- Les intérêts, qu’ils soient issus de créances ou de placements financiers, sont des revenus passifs, ne nécessitant pas une gestion active mais dépendant du temps et des conditions contractuelles.
- Ils sont perçus à échéances régulières et augmentent la masse à partager au moment de la liquidation de l’indivision.
Tous ces revenus, qu’ils proviennent de fruits naturels, de fruits civils ou encore d’intérêts, augmentent donc systématiquement la masse indivise et doivent être partagés entre les indivisaires lors de la liquidation de l’indivision.
Leur répartition se fait en fonction des parts respectives de chaque indivisaire dans l’indivision.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’un indivisaire ne bénéficie exclusivement des produits générés par le bien indivis avant le partage, ce qui pourrait entraîner des situations inéquitables.
En pratique, les revenus sont généralement conservés ou placés sur un compte commun au nom de l’indivision jusqu’au partage.
Si un indivisaire a perçu des fruits ou revenus sans les partager, il est tenu de restituer l’excédent aux autres indivisaires. Ce mécanisme vise à garantir l’équité entre les coindivisaires et à préserver les intérêts de chacun.
f. Les plus-values et moins-values
Dans le cadre d’une indivision, les plus-values et les moins-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments susceptibles d’être intégrés au partage. Ces variations de valeur, qu’elles résultent d’évolutions économiques, d’investissements ou encore de la gestion active des biens par l’un des indivisaires, influencent directement l’équilibre patrimonial au sein de l’indivision.
Le partage de ces fluctuations vise à garantir que chaque indivisaire bénéficie ou supporte les effets des changements affectant la valeur des biens indivis, conformément à ses droits dans l’indivision. Ce mécanisme assure une répartition équitable, tenant compte des enrichissements ou des diminutions de valeur intervenus pendant la période indivise.
Lors de la liquidation de l’indivision, les plus-values et moins-values sont évaluées au moment du partage, permettant une prise en compte actualisée des biens indivis. Ainsi, ces variations s’intègrent dans la répartition, traduisant une juste répartition des bénéfices ou pertes accumulés au cours de la gestion collective.
i. Les plus-values dans l’indivision
Les plus-values réalisées sur les biens indivis constituent des éléments importants pouvant faire l’objet d’un partage. Ces plus-values peuvent résulter de plusieurs facteurs :
- L’évolution naturelle des prix du marché immobilier ou financier. Par exemple, une augmentation du prix de l’immobilier peut générer une plus-value sur un immeuble détenu en indivision.
- Les investissements réalisés sur les biens indivis, tels que des travaux d’amélioration ou de rénovation, qui augmentent la valeur des biens. Ces investissements peuvent être réalisés soit par l’ensemble des indivisaires, soit par un seul indivisaire.
Lorsqu’une plus-value est constatée, elle bénéficie à l’ensemble des indivisaires, indépendamment de celui qui aurait initié les travaux ou géré le bien. Conformément au principe d’équité, toute augmentation de la valeur des biens indivis est répartie proportionnellement entre les indivisaires, chacun percevant une part en fonction de ses droits dans l’indivision.
Cependant, lorsqu’une plus-value est le résultat direct de la gestion active d’un bien indivis par un indivisaire (par exemple, dans le cadre de la gestion d’un fonds de commerce indivis), cet indivisaire a la possibilité de réclamer une rémunération pour sa gestion.
Cette règle a été consacrée par la jurisprudence, notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 1996 aux termes duquel elle a reconnu que la plus-value résultant de la gestion par un indivisaire accroît l’actif indivis, mais que cet indivisaire peut être indemnisé pour son activité de gestion (Cass. 1re civ., 29 mai 1996, n°94-14.632).
Dans cette affaire, un époux avait continué à gérer un fonds de commerce après la dissolution de la communauté post-communautaire, mais alors que les biens étaient encore en indivision.
Sa gestion avait permis une augmentation de la valeur du fonds de commerce, générant ainsi une plus-value.
Le litige portait sur la question de savoir si cette plus-value devait revenir uniquement à l’époux ayant géré le fonds, ou si elle devait être partagée entre les autres indivisaires.
La Cour de cassation a jugé que la plus-value résultant de la gestion d’un indivisaire sur un bien indivis accrue à l’indivision, c’est-à-dire qu’elle devait bénéficier à tous les indivisaires.
Cependant, la Cour a également précisé que l’indivisaire ayant géré le fonds pouvait demander une rémunération pour sa gestion, sous réserve que cette gestion ait été dans l’intérêt commun de l’indivision.
L’octroi de cette rémunération permet de compenser l’effort de gestion tout en préservant le principe que les fruits de l’indivision doivent être partagés.
La rémunération accordée à l’indivisaire peut prendre plusieurs formes, comme une indemnité de gestion ou une participation aux bénéfices générés par le bien. Cette indemnisation est soumise à l’approbation des autres indivisaires ou, à défaut, à une décision judiciaire en cas de désaccord.
ii. Les pertes dans l’indivision
Les pertes subies par les biens indivis peuvent également faire l’objet d’un partage entre les indivisaires, conformément au principe de proportionnalité des droits dans l’indivision.
Ces pertes, qu’elles soient liées à des circonstances économiques, des incidents ou une gestion déficiente, impactent collectivement la masse partageable au moment de la liquidation de l’indivision.
Ces pertes peuvent être dues à plusieurs facteurs, tels que :
- Des dépréciations économiques : une baisse du marché immobilier, par exemple, peut entraîner une diminution de la valeur des biens indivis, affectant ainsi la masse partageable lors de la liquidation.
- Des incidents ou sinistres : un bien indivis endommagé par un sinistre (incendie, inondation, etc.) peut entraîner des pertes financières, à moins qu’une indemnité d’assurance ne compense cette perte.
- La mauvaise gestion des biens indivis : si les biens indivis sont mal entretenus ou sous-exploités, leur valeur peut diminuer, entraînant une perte pour l’ensemble des indivisaires.
Cependant, la jurisprudence prévoit une exception importante : si les pertes sont imputables à la faute ou à la négligence d’un indivisaire, celui-ci peut être tenu pour responsable personnellement de ces pertes.
Par exemple, si un indivisaire, en tant que gérant des biens indivis, a pris des décisions qui ont causé une dégradation importante de la valeur des biens ou des pertes financières injustifiées, il pourrait être tenu de compenser ces pertes au bénéfice des autres indivisaires.
Cette responsabilité est souvent invoquée dans les cas où un indivisaire gère un bien indivis de manière négligente ou en ne tenant pas compte de l’intérêt commun de tous les coindivisaires.
2. Les biens exclus du partage
Le partage constitue le mécanisme naturel de dissolution de l’indivision. Toutefois, certains biens, en raison de leur nature ou de leur affectation particulière, échappent à cette issue. Leur exclusion du partage repose sur des considérations spécifiques, qu’elles soient d’ordre juridique, familial ou liées à l’intérêt collectif.
Cette exclusion s’appuie principalement sur deux logiques :
- La perpétuation de leur affectation : certains biens, tels que les biens cultuels ou familiaux, ne peuvent être soumis au partage sans compromettre leur usage ou leur valeur symbolique. Ils incarnent des fonctions ou des attaches particulières qui justifient leur maintien dans une indivision protégée.
- L’indisponibilité juridique : d’autres biens, comme les copropriétés forcées ou les titres communs à l’hérédité, sont soustraits au partage pour des raisons de nécessité ou d’intérêt collectif. Leur affectation spéciale ou leur caractère essentiel à un ensemble plus vaste impose une organisation juridique dérogatoire.
Ainsi, bien que le droit de provoquer le partage constitue une règle cardinale en matière d’indivision, il cède dans ces hypothèses au profit d’impératifs supérieurs. Ces exclusions, loin d’être arbitraires, traduisent une volonté de préserver des intérêts spécifiques qui transcendent la seule logique patrimoniale.
a. Les biens affectés à un usage cultuel
Les biens cultuels, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sépultures familiales, bénéficient d’un régime dérogatoire qui les soustrait au partage, en raison de leur affectation particulière. Cette exclusion repose sur le respect de leur vocation symbolique, religieuse ou familiale, et sur la préservation de leur usage.
Ainsi, les objets liturgiques, tels que les vases sacrés, les ornements religieux ou encore les livres destinés au culte, ne peuvent faire l’objet d’une licitation lorsqu’ils appartiennent à une indivision.
Cette interdiction vise à éviter que leur destination ne soit compromise par un transfert de propriété qui pourrait ignorer leur caractère sacré.
La jurisprudence a reconnu à ces biens une nature particulière les rendant indisponibles s’agissant d’un partage. Par exemple, un acheteur d’un tel bien lors d’une vente judiciaire pourrait être contraint de respecter son usage religieux, notamment via des stipulations figurant dans le cahier des charges.
De manière similaire, les chapelles privées affectées au culte public, bien qu’appartenant à plusieurs indivisaires, ne peuvent être aliénées sans conditions.
Si la jurisprudence récente tend à adopter une approche protectrice, en refusant d’exclure ces biens de principe du partage, elle impose toutefois à l’acquéreur de respecter leur destination initiale. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 septembre 2002 illustre cette volonté d’équilibre en réaffirmant que le droit au partage, consacré par l’article 815 du Code civil, demeure applicable, même pour des biens d’utilité religieuse, dès lors qu’aucun texte spécifique n’y déroge (Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n°99-20.765).
Dans cette affaire, des biens immobiliers avaient été acquis par des paroissiens pour être consacrés au culte protestant et étaient inscrits aux noms des paroisses correspondantes. La cour d’appel de Papeete avait jugé que ces biens relevaient d’une indivision forcée et perpétuelle, excluant tout partage tant qu’ils demeuraient affectés à leur usage religieux. En censurant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que, par leur nature ou leur destination, les biens d’utilité religieuse ne sont pas automatiquement soustraits à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision.
Cependant, la Haute juridiction ne méconnaît pas la particularité des biens cultuels. Elle souligne que leur affectation initiale constitue une stipulation tacite, opposable à tout nouvel acquéreur. En l’espèce, elle a reconnu que l’usage cultuel des biens, tel qu’établi par les paroissiens à l’origine des acquisitions, devait être respecté, même en cas de partage ou de transfert de propriété. Ainsi, l’Église évangélique, en sa qualité de bénéficiaire de cette stipulation, était en droit de solliciter la cessation des troubles causés par les associations cultuelles en place.
Cette décision marque une étape importante dans la conciliation entre le droit des indivisaires au partage et la protection des affectations spécifiques. Elle consacre un principe de responsabilité pour les acquéreurs, qui ne peuvent s’écarter de l’usage cultuel des biens sans méconnaître la volonté initiale des parties. Cette approche témoigne d’un effort pour préserver l’équilibre entre le droit individuel à l’indivision et les impératifs collectifs, notamment religieux, attachés à ces biens.
b. Les sépultures familiales
Les sépultures et tombeaux de famille, qu’ils soient établis sous forme de concessions dans les cimetières ou de caveaux sur des terrains privés, bénéficient d’un statut juridique particulier qui reflète leur nature symbolique et leur vocation à rassembler les générations d’une même lignée.
Ces biens, assimilés à des biens hors commerce, sont soumis à des règles dérogatoires qui en interdisent le partage ou la licitation, en raison de leur affectation familiale exclusive (Cass. 1re civ., 25 mars 1958).
Ces sépultures relèvent d’un régime d’indivision perpétuelle, dans lequel chaque héritier en ligne directe, conjoint ou collatéral, dispose d’un droit d’usage et de jouissance indivis. Ce droit, reconnu comme non susceptible de prescription, permet à chaque indivisaire de s’y faire inhumer et d’y faire inhumer ses proches, sous réserve de respecter les droits équivalents des autres membres de la famille (CA Amiens, 28 oct. 1992).
Toute tentative d’appropriation exclusive ou de transfert à un tiers étranger à la famille, même par voie testamentaire, est strictement prohibée (CA Paris, 28 janv. 1954). Cette interdiction garantit que les sépultures demeurent un lieu collectif et inviolable, consacré à la mémoire familiale. En conséquence, ces biens ne peuvent être inclus dans la masse successorale et restent en dehors de tout acte de partage ou de licitation (CA Toulouse, 25 avr. 1904).
L’attribution et l’utilisation des sépultures familiales reposent, avant tout, sur la volonté du fondateur de la concession. En l’absence de dispositions explicites, les juridictions s’attachent à interpréter cette volonté à travers des indices contextuels, notamment l’usage qui a été fait du tombeau ou les intentions présumées du fondateur.
Lorsqu’un différend survient entre les indivisaires, le juge intervient pour préserver l’équilibre familial et empêcher toute atteinte à la destination collective des sépultures. À ce titre, l’affectation familiale interdit qu’un étranger à la famille y soit inhumé, sauf accord unanime des ayants droit (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n°99-12.363).
Lorsque le défunt a choisi la crémation, la question de l’attribution des cendres peut susciter des différends au sein de sa famille ou avec ses proches. La jurisprudence s’attache alors à privilégier une solution qui reflète fidèlement la volonté du défunt, considérée comme le critère essentiel pour résoudre les conflits.
Ainsi, lorsqu’une opposition survient, le juge se prononce en fonction de la position traduisant le mieux les intentions exprimées ou présumées du défunt (CA Paris, 6 déc. 1997).
L’urne funéraire, en raison de sa charge mémorielle et symbolique, échappe au régime de l’indivision classique. Les cendres ne peuvent faire l’objet d’un partage matériel, mais une décision judiciaire peut exceptionnellement conduire à une répartition équitable entre les parties, si cela reflète la volonté du défunt.
Par exemple, lorsque le défunt avait exprimé le souhait d’être inhumé dans plusieurs lieux distincts, le juge peut ordonner une division symbolique des cendres (CA Paris, 27 mars 1998).
La jurisprudence met également en lumière des cas où les relations personnelles et affectives influent sur l’attribution de l’urne. Ainsi, une concubine ayant entretenu une relation stable et solide avec le défunt peut se voir accorder le droit de conserver l’urne à son domicile, malgré les oppositions familiales (CA Agen, 20 janv. 1999).
La demande de partage des cendres est généralement déclarée irrecevable, car une telle démarche contredirait la vocation mémorielle de l’urne. La jurisprudence considère que, bien qu’un partage en nature soit envisageable dans des cas spécifiques, les cendres doivent rester inséparables pour préserver leur symbolique collective et individuelle (CA Bordeaux, 14 janv. 2003).
Le décret n° 2007-328 du 12 mars 2007, relatif à la protection des cendres funéraires, consacre ce principe en disposant que l’urne est remise à une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (CGCT, art. R. 2213-39). Cette disposition vient renforcer la jurisprudence en excluant toute forme d’appropriation exclusive et en affirmant la nécessité de respecter les volontés du défunt.
c. Les titres communs à toute l’hérédité
Les titres communs à toute l’hérédité, tels que les documents d’état civil, les titres de noblesse ou encore les rapports d’expertise relatifs à la succession, occupent une place singulière au sein du patrimoine successoral. Leur nature spécifique et leur affectation justifient leur exclusion du partage, en dépit de l’absence de dispositions explicites dans le Code civil. Cette singularité découle de leur rôle dans la préservation de la mémoire familiale et de leur vocation à bénéficier à l’ensemble des héritiers.
Historiquement, l’article 842, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, disposait que ces titres devaient être « remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les copartageants, à toute réquisition ». À défaut d’accord unanime, le juge intervenait pour désigner le dépositaire, dans un souci d’équité et de respect de l’intérêt commun (CA Paris, 11 juin 1956). Bien que cette disposition ait été abrogée, les principes qu’elle consacrait continuent d’être appliqués par les juridictions.
Les documents visés par ce dispositif sont :
- Les titres de noblesse, qui attestent de la qualité nobiliaire d’une lignée et sont souvent perçus comme des symboles identitaires.
- Les documents d’état civil, tels que les passeports ou actes relatifs aux ancêtres du défunt, qui contribuent à la transmission de l’histoire familiale.
- Les rapports d’expertise relatifs à la succession, établissant la consistance des biens et leur répartition éventuelle en lots.
Ces biens, par leur nature ou leur destination, sont assimilés à des éléments hors commerce, ne pouvant être appropriés de manière exclusive par l’un des héritiers (CA Paris, 11 juin 1956).
La désignation d’un dépositaire vise à préserver l’intégrité et la disponibilité des titres communs pour l’ensemble des cohéritiers. Ce dépositaire peut être un héritier ou un tiers, choisi par accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge. Une fois confiés, les titres doivent rester accessibles à tous les héritiers, qui conservent le droit d’en obtenir des reproductions par tout procédé (CA Bourges, 12 mai 1942).
Bien que le législateur ait omis de réintroduire explicitement ce régime dans la réforme de 2006, la doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le maintien de cette exclusion. La nature particulière de ces titres, au même titre que celle des souvenirs de famille, justifie leur imperméabilité au droit commun du partage. Ils incarnent des valeurs familiales et patrimoniales qui transcendent la simple indivision matérielle.
d. Les souvenirs de famille
Les souvenirs de famille regroupent des objets variés tels que des décorations, armes d’honneur, brevets, portraits de famille, archives ou correspondances, qui témoignent de l’histoire et des traditions familiales (Cass. 2e civ., 29 mars 1995, n°95-18.769). Ces objets, bien qu’ils puissent parfois avoir une valeur marchande notable, se distinguent par leur affectation morale, considérée comme prépondérante.
La qualification de « souvenir de famille » relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui évaluent leur caractère affectif et mémoriel au regard des circonstances et des usages familiaux (Cass. 1re civ., 12 nov. 1998, n°96-20.236).
Par nature, les souvenirs de famille échappent aux règles ordinaires de dévolution successorale et de partage prévues par le Code civil (Cass. 1re civ., 21 févr. 1978, n°76-10.561). Ils ne sont pas intégrés à la masse successorale et ne peuvent faire l’objet d’une licitation ou d’une division matérielle sans risquer de compromettre leur vocation mémorielle.
Ces biens sont attribués à un héritier ou à un membre de la famille jugé le plus apte à en assurer la garde et la préservation. Cette désignation, qui relève de l’appréciation des juges, repose sur des critères tels que la capacité de l’attributaire à maintenir la mémoire familiale ou son lien particulier avec les objets concernés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°92-21.993). En pratique, il peut s’agir de l’aîné des descendants, d’un membre renonçant à la succession ou même d’un tiers séquestre en cas de contestation (CA Paris, 11 juin 1956).
L’attributaire ne reçoit pas ces biens en pleine propriété mais à titre de dépôt, avec l’obligation morale de les conserver et de les tenir à disposition des autres membres de la famille (CA Paris, 25 nov. 1975). Ce régime protège leur affectation tout en limitant leur aliénabilité, notamment envers des tiers étrangers à la famille (Cass. 2e civ., 29 mars 1995).
Les souvenirs de famille sont marqués par une indisponibilité particulière, qui leur confère une forme de propriété collective propre à la famille, parfois assimilée à une variété de copropriété de mainmorte. Cette indisponibilité, qui exclut tout transfert hors du cercle familial, garantit leur transmission aux générations futures et leur pérennité en tant que symboles identitaires.
Ainsi, au décès de l’attributaire, les souvenirs doivent rester au sein de la famille et ne peuvent être transmis par libéralité ou succession à des tiers non apparentés (Cass. 1re civ., 29 nov. 1994, n°92-21.993). Toute tentative de sortie du patrimoine familial est susceptible d’être contestée par les autres membres de la famille.
Le caractère exceptionnel des souvenirs de famille implique une interprétation stricte de leur définition. Les juges excluent de cette qualification les objets de nature purement utilitaire ou les œuvres d’art de grande valeur (exception faites des portraits de famille), qui restent soumis au droit commun du partage. De même, des manuscrits ou meubles portant des armoiries familiales ne sont pas systématiquement considérés comme des souvenirs de famille s’ils ne remplissent pas les critères de symbolisme et de mémoire collective.
e. Les copropriétés forcées
Certaines copropriétés dites “forcées” sont exclues du partage en raison de leur fonction particulière et de leur nécessité pour l’usage ou la jouissance des propriétés qu’elles desservent. Ces situations, qui relèvent d’une indivision perpétuelle, se rencontrent notamment dans les contextes suivants :
==>La mitoyenneté
Les murs, fossés, haies et autres clôtures mitoyennes, bien que juridiquement classés parmi les servitudes, constituent des exemples typiques de copropriétés forcées. Ces biens appartiennent en commun aux propriétaires des fonds contigus qu’ils séparent et ne peuvent faire l’objet d’un partage que dans deux hypothèses : la cession intégrale de la propriété ou l’abandon des droits de mitoyenneté par l’un des copropriétaires (art. 653 s. C. civ.).
La jurisprudence confirme que le caractère attaché à la mitoyenneté empêche toute tentative de partage sans porter atteinte à sa fonction essentielle : la séparation et la protection des propriétés voisines.
==>Les indivisions forcées d’usage commun
En l’absence de texte spécifique, il a été admis que certains biens, affectés à l’usage commun de plusieurs fonds, peuvent faire l’objet d’une indivision forcée.
Cela s’applique par exemple à des cours, dépendances ou installations techniques nécessaires à l’exploitation de propriétés voisines (Cass. 1ère civ. 1er 3 juill. 1973). Tant que ces biens restent indispensables à l’usage commun, ils demeurent indivis, et le partage n’est pas envisageable.
Cette indivision, bien que perpétuelle par nature, peut être remise en cause si le caractère nécessaire du bien disparaît avec le temps. Toutefois, une telle décision requiert l’accord unanime des copropriétaires ou des indivisaires concernés (Cass. 3e civ., 12 mars 1969).
==>Les copropriétés immobilières bâties
Les parties communes des immeubles soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relèvent également d’une indivision forcée. Ces parties comprennent notamment les escaliers, couloirs, toitures, et parkings affectés à l’usage collectif des copropriétaires ou de certains d’entre eux. Conformément à l’article 3 de ce texte, ces biens ne peuvent être partagés séparément des parties privatives auxquelles ils sont attachés, formant ainsi une copropriété perpétuelle liée à la structure de l’immeuble.
Dans tous ces cas, le partage est exclu tant que les biens en question remplissent leur fonction d’utilité commune ou sont indispensables à la jouissance des fonds qu’ils desservent. Ce régime, bien qu’il déroge au principe posé par l’article 815 du Code civil, vise à garantir la pérennité de l’usage collectif tout en évitant les litiges qui pourraient découler d’une division matérielle inappropriée.
f. Autres catégories de biens exclus
==>Œuvres littéraires et artistiques
Les œuvres littéraires et artistiques créés conjointement par plusieurs auteurs relèvent d’une copropriété particulière, assimilée à une indivision forcée. Cette spécificité découle de l’exigence de préserver l’intégrité artistique et économique de l’œuvre.
Ainsi, le partage de ces biens est exclu, toute division matérielle ou juridique risquant de compromettre l’unité de l’œuvre et les droits des copropriétaires (art. L. 113-3 CPI).
Chaque copropriétaire conserve toutefois un droit moral inaliénable sur l’œuvre, un principe destiné à garantir son respect et sa valorisation. En pratique, cette indivision artistique vise à protéger les intérêts de l’ensemble des auteurs, favorisant une gestion collective cohérente.
==>Fonds communs de placement
Les fonds communs de placement (FCP), en tant que copropriétés de valeurs mobilières, sont régis par le Code monétaire et financier, qui exclut explicitement leur partage (art. L. 214-8 CMF). Cette exclusion repose sur une logique économique : assurer la liquidité et la stabilité de l’investissement collectif en permettant aux porteurs de parts de racheter ou céder leurs parts à tout moment, sans nécessiter de partage global des actifs du fonds.
Ce mécanisme préserve la finalité d’épargne collective des FCP, tout en garantissant la flexibilité et la simplicité de gestion. Cette solution, fondée sur la liquidité plutôt que sur la divisibilité, évite tout blocage ou conflit entre copropriétaires, en assurant une continuité économique fluide.
==>Biens affectés à un usage religieux
Historiquement, les juridictions ont parfois exclu du partage certains biens indivis affectés à une destination religieuse par convention.
Cette tendance a toutefois été remise en question par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 25 septembre 2002, la Troisième chambre civile a rappelé qu’aucun texte ne soustrayait les biens religieux à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester en indivision (Cass. 3e civ. 25 sept. 2002, n° 99-20.765).
Dans cette affaire, des associations cultuelles avaient revendiqué la propriété d’immeubles inscrits aux noms de paroisses locales. Ces biens, acquis à l’origine par des pasteurs pour le compte des paroissiens, avaient été utilisés exclusivement à des fins cultuelles depuis leur acquisition. Le Conseil d’administration des biens de l’Église évangélique de Polynésie française (CABEEPF) a alors formé une demande reconventionnelle visant à immatriculer ces biens en son nom.
Les juges du fond ont estimé que ces biens relevaient d’une indivision forcée et perpétuelle, incompatible avec un partage, tant qu’ils restaient affectés à leur destination cultuelle.
La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant un principe fondamental : nul ne peut être contraint de demeurer en indivision, sauf disposition législative expresse ou accord des parties.
Plus précisément, elle a jugé que :
- D’une part, aucune disposition législative spécifique ne soustrait les biens d’utilité religieuse au droit commun de l’indivision ;
- D’autre part, les juges du fond ne pouvaient, par une interprétation prétorienne, créer une exception au principe de droit au partage des biens indivis, même si ces derniers étaient affectés à une destination particulière.
La Cour de cassation a reconnu que les biens en question avaient été acquis pour des fins cultuelles et utilisés comme tels de manière continue. Elle a même admis l’existence d’une stipulation tacite des paroissiens permettant l’exercice continu du culte protestant dans ces lieux. Cependant, elle a jugé que cette affectation ne pouvait justifier une indivision perpétuelle.
La raison en est que :
- La destination religieuse des biens ne confère pas une autonomie juridique à ceux-ci ;
- Leur affectation particulière peut être prise en compte dans le cadre du partage, mais ne saurait empêcher ce dernier.
Cet arrêt met un terme à une certaine tendance des juridictions du fond à reconnaître des indivisions perpétuelles sur des biens à vocation spécifique, tels que les biens religieux. Il réaffirme que toute dérogation au principe de droit au partage doit être expressément prévue par le législateur.
Par ailleurs, il invite les parties concernées par des biens à affectation spéciale à envisager des solutions contractuelles, telles que des conventions d’indivision ou la constitution de structures juridiques adaptées (associations ou fondations), afin de sécuriser leur usage à long terme.
==>Logement familial
Le droit au bail du logement familial, réputé indivis entre époux en application de l’article 1751 du Code civil, constitue une forme d’indivision légale.
Cette indivision, conçue pour préserver l’affectation conjugale du logement, empêche tout partage tant que la communauté de vie perdure. Ce régime s’étend également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sous réserve qu’ils en aient conjointement formulé la demande.
==>Copropriété des navires
La copropriété des navires, régie par le Code des transports, constitue une typologie d’indivision spécifiquement conçu pour répondre à des finalités économiques (art. L. 5114-30 s. C. transp.).
Cette indivision peut être dissoute par une licitation volontaire, sous condition d’approbation par une majorité en valeur des copropriétaires (art. L. 5114-48 et L. 5114-49 C. transp.).
En revanche, lorsque la copropriété résulte d’une circonstance imposée, telle qu’une succession, le droit commun de l’indivision redevient applicable, autorisant le partage en l’absence de consensus collectif.
C) Absence de prescription acquisitive
si le droit au partage est imprescriptible, la prescription acquisitive constitue une exception à ce principe.
En effet, bien que la prescription extinctive ne puisse éteindre le droit de demander le partage, il est possible, sous certaines conditions, qu’un indivisaire ou un tiers acquière la propriété d’un bien indivis par possession prolongée.
L’article 816 du Code civil dispose en ce sens que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription ».
Cela signifie que si un bien indivis a été possédé de manière continue, paisible, publique et non équivoque pendant un délai de trente ans, l’usucapion permet à l’indivisaire ou au tiers possesseur de faire sortir ce bien de l’indivision, le privant ainsi de son caractère indivis.
L’usucapion, qui repose sur des conditions rigoureuses de possession, s’applique donc uniquement à des biens spécifiques au sein de l’indivision, et non à l’ensemble d’une succession ou d’un patrimoine indivis dans son intégralité.
Cela se justifie par la nature même de l’indivision, qui repose sur une co-titularité de droits de propriété, chacun des indivisaires jouissant de l’ensemble des biens indivis sans en détenir la propriété exclusive.
Certains auteurs soutiennent qu’une succession, en tant qu’universalité juridique, ne peut faire l’objet d’une possession prolongée dans son ensemble, car il serait difficile, voire impossible, de posséder une telle universalité de manière non équivoque et exclusive.
En raison de la diversité des biens qui la composent et de la nature collective des droits indivisaires, ils estiment que la possession, pour être effective et produire des effets juridiques, doit porter sur des biens déterminés, spécifiquement identifiés, plutôt que sur l’ensemble des biens formant l’indivision.
Les tenants de cette thèse considèrent que « l’usucapion ne peut jouer que relativement à des biens envisagés ut singuli », c’est-à-dire individuellement, et non sur l’intégralité d’une succession ou d’une indivision, laquelle est perçue comme une universalité juridique insusceptible de possession exclusive[11].
Cependant, d’autres auteurs adoptent une approche plus large et nuancée de l’usucapion.
Ils soutiennent qu’il serait possible, sous certaines conditions, d’acquérir par prescription acquisitive non seulement des biens spécifiques, mais également un ensemble de biens constituant l’actif successoral, dès lors que ces biens sont suffisamment identifiés au sein de l’universalité juridique de la succession.
Selon cette approche, l’usucapion ne porterait pas sur l’universalité en tant que telle, mais sur les éléments patrimoniaux qui la composent, ce qui permettrait à un indivisaire de prescrire l’intégralité de l’actif successoral ou de l’indivision.
Cette position a trouvé un certain écho dans la jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a admis, dans un arrêt du 4 juillet 1853, que la prescription acquisitive pouvait, dans certaines circonstances, s’appliquer à l’ensemble des biens dépendant d’une succession.
Cet arrêt confirme l’interprétation selon laquelle l’usucapion, bien qu’habituellement limitée à des biens déterminés, peut dans des cas particuliers s’étendre à un ensemble de biens indivis, lorsque les conditions de la possession sont réunies.
L’article 816 du Code civil, qui dispose que « le partage ne peut être demandé s’il y a eu possession suffisante pour acquérir la prescription », consacre ce mécanisme, en permettant qu’un bien indivis puisse être usucapé et sortir ainsi de l’indivision, rendant le partage inapplicable à ce bien.
Quoi qu’il en doit, l’application de l’usucapion, même sur des biens indivis, repose sur le respect strict des conditions de la prescription acquisitive, telles qu’énoncées dans l’article 2261 du Code civil.
Pour que la possession puisse conduire à l’acquisition d’un bien par usucapion, elle doit être paisible, continue, publique et non équivoque, et ce, pendant un délai de trente ans, si aucun titre translatif de propriété n’est invoqué.
La jurisprudence et la doctrine insistent sur le caractère exclusif de la possession, particulièrement en matière d’indivision, où les actes accomplis par un indivisaire tendent souvent à être interprétés comme des actes de gestion collective plutôt que comme des manifestations d’une volonté d’exclusivité.
A cet égard, la possession en situation d’indivision présente une difficulté particulière : les actes de gestion ou d’usage par un coïndivisaire sont généralement équivoques, car ils peuvent être perçus comme l’exercice normal des droits indivis, et non comme une appropriation exclusive.
Selon Planiol et Ripert, la possession d’un bien indivis par un coïndivisaire est souvent indéterminée, car elle reflète une jouissance commune plutôt qu’une propriété individuelle. Les actes de possession ne peuvent donc permettre l’usucapion que s’ils traduisent une intention manifeste de se comporter en propriétaire exclusif, incompatible avec la qualité d’indivisaire.
La jurisprudence est venue confirmer cette exigence. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation a rappelé que les juges du fond doivent rechercher si le possesseur indivis s’est comporté en propriétaire exclusif, c’est-à-dire s’il a accompli des actes montrant son intention de s’approprier le bien pour lui seul (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 27 oct. 1993, n° 91-13.286). En l’absence d’actes exclusifs et non équivoques, la prescription acquisitive ne peut prospérer, et le bien demeure dans l’indivision.
Il peut être observé que le vice d’équivoque est l’un des principaux obstacles à la mise en œuvre de l’usucapion dans le cadre de l’indivision.
Ce vice se manifeste lorsque la possession invoquée par l’indivisaire n’est pas clairement distincte de celle que pourrait exercer un autre indivisaire.
Par exemple, un indivisaire qui se contente d’occuper un bien indivis ou d’en tirer des revenus comme le ferait tout autre coïndivisaire ne pourra prétendre à l’usucapion, car ces actes ne montrent pas une volonté d’exclusivité (Cass. 3e civ., 27 nov. 1985, n°84-15.259). À l’inverse, des actes significatifs, tels que l’accomplissement de travaux importants sans en informer les autres indivisaires ou la perception exclusive des fruits du bien, peuvent constituer des indices d’une volonté d’exclusivité, susceptibles de permettre l’usucapion (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998, n° 96-15.045).
Pour que la prescription acquisitive puisse être opposée avec succès aux autres indivisaires, il est nécessaire que l’indivisaire prétendant à l’usucapion se soit comporté en véritable propriétaire exclusif. Cette exclusivité doit être démontrée par des actes incompatibles avec la qualité d’indivisaire, c’est-à-dire des actes qui ne relèvent pas simplement de la gestion ordinaire de l’indivision, mais qui traduisent une appropriation personnelle du bien.
Le délai de prescription requis pour l’usucapion en matière d’indivision est de trente ans. La prescription abrégée de dix ans, applicable dans certains cas lorsque le possesseur dispose d’un juste titre, ne trouve pas à s’appliquer dans ce contexte, en raison de l’absence de titre translatif au profit de l’indivisaire.
Ce principe a été établi par la jurisprudence, qui exclut la possibilité pour un indivisaire de prescrire en moins de trente ans en invoquant un partage irrégulier ou un acte de gestion comme titre translatif (V. en ce sens Cass. req., 4 août 1870).
Cependant, dans le cadre de la copropriété, il est possible pour l’ensemble des copropriétaires d’acquérir des parties communes par prescription abrégée, comme rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003 .
Aux termes de cet arrêt, elle a, en effet, jugé que « les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l’ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l’article 2265 du Code civil, sur les parties communes de la copropriété, les droits indivis de propriété qu’ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu’ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2003, n° 01-15.078).
Au total, l’usucapion, bien que potentiellement applicable à des biens indivis, reste un mécanisme d’exception nécessitant des conditions strictes. La possession doit être exclusive, continue, paisible, publique et non équivoque, et ce, pendant une période de trente ans.
Si ces conditions ne sont pas réunies, le bien demeurera dans l’indivision et restera éligible au partage, étant précisé que la jurisprudence exclut toute possibilité d’usucapion lorsque la possession invoquée par l’indivisaire se confond avec l’usage ordinaire d’un bien indivis, ce qui nécessité alors une véritable appropriation exclusive pour que la prescription acquisitive puisse produire ses effets.
D) Conditions spécifiques tenant à un bien indivis démembré
Le démembrement de propriété, qui consiste en la division du droit de propriété entre l’usufruit et la nue-propriété, soulève des questions spécifiques quant à la possibilité de partage des biens concernés.
1. Principe général
Le principe posé par l’article 815 du Code civil est clair : nul ne peut être contraint de demeurer en indivision. Cette règle, qui traduit la volonté de limiter les situations de blocage, s’applique de manière générale à tous les indivisaires, y compris lorsque les biens concernés font l’objet d’un démembrement de propriété.
En effet, le démembrement, qui scinde le droit de propriété en usufruit et nue-propriété, ne supprime pas le droit au partage mais impose certaines adaptations. Contrairement à une indivision ordinaire où les droits des coindivisaires sont identiques, le démembrement instaure des droits distincts. L’usufruitier jouit du bien et perçoit les fruits, tandis que le nu-propriétaire conserve le droit de disposer du bien. Cette dualité de droits, bien que spécifique, ne remet pas en cause le droit fondamental au partage, sauf lorsqu’il s’agit de droits de nature différente qui, par leur configuration, ne permettent pas une fusion immédiate en pleine propriété.
Ainsi, si le démembrement de propriété peut parfois compliquer les modalités du partage, il n’en constitue pas un obstacle absolu. Les règles spécifiques prévues par les articles 817 à 819 du Code civil traduisent cette souplesse en adaptant les mécanismes de sortie de l’indivision aux particularités des biens démembrés. Ces règles permettent de garantir que chaque titulaire de droit puisse, dans des conditions adaptées, provoquer le partage de l’indivision sans que la nature démembrée du bien ne serve de prétexte à perpétuer une situation de blocage.
Cependant, le respect de cette garantie trouve sa limite dans des situations où le droit exercé par les indivisaires n’est pas de même nature. Dans ces hypothèses, la coexistence d’un usufruit et d’une nue-propriété rend parfois impossible un partage immédiat, nécessitant une distinction plus approfondie entre les configurations où un partage est réalisable et celles où il est exclu en raison de l’absence d’indivision juridique entre les droits exercés.
2. Mise en œuvre
Le droit au partage, pierre angulaire du régime de l’indivision, trouve également à s’appliquer dans le cadre des biens démembrés. Toutefois, la coexistence de droits distincts, tels que l’usufruit et la nue-propriété, impose une adaptation des mécanismes classiques de partage pour tenir compte de la nature particulière de ces droits. Les articles 817 à 819 du Code civil offrent ainsi un cadre juridique spécifique, permettant de concilier la liberté des indivisaires de sortir de l’indivision avec les contraintes inhérentes au démembrement.
Dans ce contexte, il convient de distinguer deux catégories de configurations : celles où la mise en œuvre d’un partage est juridiquement et matériellement possible, et celles où, au contraire, les spécificités du démembrement excluent tout partage.
a. Les configurations admettant un partage
Certaines situations impliquant des biens démembrés permettent la mise en œuvre d’un partage, conformément aux articles 817 à 819 du Code civil.
i. Indivision en jouissance
Lorsqu’un droit de jouissance est partagé entre plusieurs personnes, une situation d’indivision en jouissance peut se former, notamment en présence d’un usufruit détenu indivisément.
Chaque usufruitier dispose alors, en vertu de l’article 815 du Code civil, d’un droit absolu de demander le partage à tout moment. Ce principe, reconnu de manière constante par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 25 juin 1974, 72-12.451), trouve un ancrage dans les dispositions de l’article 817 du Code civil, introduit par la réforme des successions de 2006.
L’article 817 du Code civil prévoit alors deux modalités principales permettant aux usufruitiers de sortir de l’indivision en jouissance :
- Le cantonnement sur un bien déterminé
- Cette option consiste à attribuer à chaque usufruitier un droit exclusif sur un bien particulier, évitant ainsi le maintien de l’indivision.
- Cette méthode, lorsqu’elle est praticable, offre une solution simple et respectueuse des prérogatives de chaque usufruitier.
- La licitation de l’usufruit
- En cas d’impossibilité de cantonnement, la licitation constitue une alternative permettant la vente du droit indivis et la répartition du produit entre les usufruitiers.
- Ce mécanisme peut toutefois s’avérer complexe, car l’acquéreur de l’usufruit doit composer avec la coexistence du droit du nu-propriétaire.
- Cette difficulté explique le faible recours à cette option dans la pratique.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’intérêt commun des parties le justifie, la licitation peut porter sur la pleine propriété du bien grevé d’usufruit.
Ce mécanisme, expressément prévu par l’article 817 du Code civil, vise à faciliter la sortie de l’indivision en cas de blocage insurmontable. La vente de la pleine propriété, plus attractive pour un acquéreur potentiel, permet ainsi de surmonter les obstacles pratiques liés au démembrement.
Bien que codifiée par la loi du 23 juin 2006, cette faculté demeure sous-exploitée, en partie en raison de la méconnaissance de ces dispositifs par les praticiens et de la complexité des situations qu’ils impliquent.
La jurisprudence continue néanmoins de rappeler l’importance et l’intérêt des mécanismes de partage, notamment dans des situations où les relations conflictuelles entre usufruitiers rendent toute autre solution impraticable. Un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mai 2016 illustre particulièrement cette problématique en posant des principes destinés à préserver l’unité et la stabilité des droits démembrés, tout en limitant les contentieux potentiels (Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n°14-28.321).
Dans cette affaire, des époux avaient procédé à une donation-partage au profit de leurs enfants, assortie d’une réserve d’usufruit sur des parts sociales. Ce droit d’usufruit était prévu pour s’éteindre progressivement : à concurrence d’une moitié au décès du premier des époux, puis pour l’autre moitié au décès du conjoint survivant. Cependant, à la suite du décès de l’un des donateurs, des tensions sont nées entre les usufruitiers et les nus-propriétaires, aggravées par une interprétation divergente des stipulations de la donation.
La Cour de cassation, dans une décision particulièrement rigoureuse, a confirmé que l’usufruit ainsi constitué restait un droit indivisible entre les deux époux tant qu’ils en étaient tous deux titulaires. Elle a jugé que le décès de l’un des usufruitiers n’avait pas pour effet de diviser l’usufruit, mais seulement de l’éteindre pour la part attachée au défunt, laissant subsister le droit du survivant sur l’intégralité des biens grevés. La Haute juridiction a également précisé que cette indivision devait être maintenue afin de préserver l’harmonie des relations juridiques entre les parties, notamment en évitant de multiplier les conflits liés à des droits démembrés.
Cette solution, bien que rigoureuse dans son application, vise à garantir une certaine sécurité juridique dans la gestion des biens en usufruit indivis. Elle rappelle également que, lorsque les relations entre usufruitiers ou entre usufruitiers et nus-propriétaires deviennent source de blocages, le recours à des mécanismes tels que le cantonnement ou la licitation de l’usufruit peut constituer une issue pragmatique, mais doit s’inscrire dans le strict respect des règles applicables aux démembrements de propriété. Cet arrêt illustre ainsi l’équilibre recherché par la jurisprudence entre le droit au partage et la préservation des intérêts économiques et patrimoniaux des parties, dans un cadre légal marqué par la complexité des droits démembrés.
ii. Indivision en nue-propriété
De manière similaire, les nus-propriétaires d’un bien indivis peuvent provoquer le partage en application de l’article 818 du Code civil. Ce texte consacre le droit pour les indivisaires en nue-propriété de sortir de l’indivision, tout en renvoyant aux modalités prévues par l’article 817 pour en organiser la mise en œuvre. Ainsi, lorsque le partage en nature est possible, il demeure la solution privilégiée, permettant une répartition des biens entre les nus-propriétaires en fonction de leurs droits respectifs.
Cependant, le partage en nature se révèle souvent impraticable en raison des caractéristiques des biens concernés, notamment lorsqu’ils ne peuvent être divisés matériellement sans porter atteinte à leur valeur ou à leur utilité. Dans ces situations, le recours à la licitation s’impose. Par ce mécanisme, le bien est vendu, et le produit de la vente est réparti entre les nus-propriétaires au prorata de leurs droits. Ce dispositif offre une solution pragmatique pour mettre fin à l’indivision tout en préservant les intérêts économiques des indivisaires.
L’article 818 ouvre également la possibilité de procéder à une licitation portant sur la pleine propriété du bien, et non seulement sur la nue-propriété, lorsque cela apparaît comme la seule solution protectrice des intérêts des parties. Cette option se justifie particulièrement lorsque la vente exclusive de la nue-propriété risque de réduire considérablement la valeur du bien ou de ne pas trouver preneur sur le marché.
Néanmoins, cette licitation en pleine propriété est soumise à des limites strictes. Conformément à l’article 815-5 du Code civil, le juge ne peut ordonner une telle vente contre la volonté de l’usufruitier lorsque celui-ci détient un usufruit universel, comme cela peut être le cas pour un conjoint survivant. Cette protection vise à garantir la jouissance patrimoniale et économique de l’usufruitier, à moins qu’il ne consente expressément à la vente.
La jurisprudence n’a cessé de souligner la pertinence et la nécessité de ces mécanismes dans la gestion des situations d’indivision en nue-propriété, en mettant en lumière leur rôle fondamental dans la résolution des conflits et la préservation des intérêts des parties concernées.
Dans un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation a rappelé que l’indivision en nue-propriété pouvait donner lieu à un partage, y compris par la voie d’une licitation en pleine propriété, lorsque cela s’avère nécessaire dans l’intérêt des parties.
En l’espèce, après avoir constaté que les droits des héritiers sur les biens de la succession étaient répartis entre une pleine propriété et une nue-propriété grevée d’usufruit, la Première chambre civile a jugé qu’une indivision existait bien sur certains biens, en dépit de la différence de nature juridique des droits exercés.
Aussi, elle a cassé la décision d’appel qui avait refusé d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, soulignant que le nu-propriétaire était en droit de provoquer le partage afin de faire déterminer les biens composant la part de la pleine propriété, conformément aux articles 815 et 815-17 du Code civil (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2011, n° 09-17.298).
iii. Indivision entre pleins propriétaires, usufruitiers et nus-propriétaires
L’article 819 du Code civil aborde les configurations complexes dans lesquelles coexistent des pleins propriétaires, des usufruitiers et des nus-propriétaires, situation où la pluralité de droits exercés sur un même bien génère une indivision particulière. Cette disposition reconnaît le droit pour l’un des titulaires de provoquer le partage, qu’il soit réalisé par voie de cantonnement ou, si cette option s’avère impossible, par une licitation.
Le cantonnement permet de circonscrire les droits de l’usufruitier ou du nu-propriétaire sur un bien déterminé, évitant ainsi le maintien d’une indivision générale. Cependant, lorsque le cantonnement ne peut être mis en œuvre ou qu’il s’avère inadapté aux circonstances, le législateur autorise le recours à une licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères du bien concerné. Cette licitation peut, dans certaines situations, porter sur la pleine propriété du bien si cela constitue la seule solution viable pour préserver les intérêts de toutes les parties impliquées. Dans un tel cas, le prix de vente est réparti entre les différents indivisaires, conformément aux dispositions de l’article 621 du Code civil, qui impose une ventilation des montants en fonction de la valeur respective de l’usufruit, de la nue-propriété et de la pleine propriété.
La doctrine souligne le caractère subtil de cette indivision. Comme l’a exprimé Josserand, la pleine propriété d’un bien contient en latence un usufruit et une nue-propriété. Ces éléments, bien que souvent inaperçus, émergent et deviennent juridiquement opérants lorsqu’ils se trouvent en interaction avec un usufruit effectif ou une nue-propriété active, justifiant ainsi le recours à un partage.
Il est important de préciser que, lorsque la licitation porte sur la pleine propriété, le consentement de l’usufruitier n’est pas toujours requis. Contrairement aux situations relevant du deuxième alinéa de l’article 815-5 du Code civil, qui protège spécifiquement l’usufruitier universel, l’article 819 offre une souplesse supplémentaire, notamment dans les cas où l’usufruit n’a pas une portée universelle. Cela permet de surmonter les éventuelles oppositions et d’éviter les blocages dans l’administration ou l’exploitation des biens.
En revanche, la logique inverse n’est pas vraie. Un plein propriétaire ne peut être contraint de subir un cantonnement ou une licitation de ses droits en usufruit ou en nue-propriété, car cela reviendrait à démembrer de force sa pleine propriété. Cette limite préserve l’intégrité du droit de propriété tel qu’il est garanti par le Code civil.
Ainsi, l’article 819 établit un équilibre subtil entre la nécessaire protection des droits de chaque indivisaire et la recherche d’une solution pragmatique pour sortir des situations d’indivision complexes.
b. Les configurations excluant tout partage
L’impossibilité de demander un partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire découle directement de la nature fondamentalement différente de leurs droits. L’usufruit confère à son titulaire un droit de jouissance et de perception des fruits, tandis que la nue-propriété préserve la substance du bien. Ces droits, bien que complémentaires, ne sont ni identiques ni concurrents et s’exercent de manière autonome. Cette séparation des prérogatives exclut toute indivision juridique entre eux, rendant impossible l’application du droit au partage tel qu’il est prévu pour des indivisaires classiques.
La jurisprudence a affirmé cette analyse de manière constante, notamment dans un arrêt de principe du 27 juillet 1869, selon lequel « il n’y a indivision qu’autant que les intéressés ont sur la chose des droits de même nature » (Cass. req., 27 juill. 1869, DP 1971, 1, p. 170). De même, dans un arrêt du 25 novembre 1986, la Cour de cassation a réitéré qu’aucune indivision ne pouvait exister entre usufruitier et nu-propriétaire, ces derniers étant titulaires de droits incompatibles avec le fonctionnement unitaire d’une indivision (Cass. 1re civ., 25 nov. 1986, n°85-10.548). Plus récemment, cette position a été confirmée dans un arrêt du 12 février 2020, qui rappelle que « qu’il n’existe pas d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire dont les droits sont de nature différente » (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n° 18-22.537).
Cette incompatibilité a pour conséquence directe l’impossibilité pour l’usufruitier et le nu-propriétaire de solliciter un partage visant à réunir leurs droits en une pleine propriété. La fin du démembrement ne peut intervenir que par l’extinction naturelle de l’usufruit, généralement au décès de l’usufruitier. Toute tentative de contourner cette règle en invoquant le droit au partage, réservé aux situations d’indivision, est donc juridiquement vouée à l’échec.
Cependant, avant l’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, la jurisprudence avait introduit un tempérament à cette règle dans des cas spécifiques où le partage en nature se révélait matériellement impossible. Lorsque des immeubles incommodément partageables en nature étaient compris dans l’assiette de la nue-propriété ou de l’usufruit, la vente séparée de ces droits était jugée difficile et désavantageuse. Dans de telles situations, les juridictions ont admis que la licitation de la pleine propriété pouvait être imposée par l’une des parties, à condition qu’elle soit nécessaire pour protéger les intérêts des titulaires. Cette solution, qualifiée de « vente par autorité de justice », a ainsi permis de surmonter les blocages pratiques liés à l’absence d’indivision (Cass. Req. 9 avr. 1877).
Dans ces situations, la vente séparée des droits de nue-propriété et d’usufruit était jugée économiquement désavantageuse et peu réaliste. Ainsi, les juges considéraient que la licitation de la pleine propriété devenait nécessaire pour garantir l’assiette des droits en présence et préserver l’équilibre patrimonial des titulaires. Par exemple, un nu-propriétaire pouvait imposer une telle licitation dès lors qu’elle apparaissait comme la seule solution pour valoriser ses droits, tout comme un usufruitier pouvait également solliciter une licitation dans des circonstances similaires (Cass. req. 20 juill. 1932).
Ce mécanisme était particulièrement utile lorsque les biens concernés, tels que des immeubles, étaient incommodément partageables en nature. Ces situations de blocage trouvaient ainsi une issue grâce à une vente ordonnée par le juge, permettant de répartir équitablement le produit de la vente entre les titulaires des droits démembrés. Ces solutions jurisprudentielles, bien qu’exceptionnelles, illustraient une approche pragmatique pour résoudre les litiges complexes liés au démembrement.
La loi du 31 décembre 1976 est toutefois venue remettre en cause la souplesse antérieure de la jurisprudence en encadrant plus strictement les possibilités de licitation dans le cadre de biens grevés d’usufruit. L’article 815-5 du Code civil, tel qu’introduit par cette réforme, dispose que « le juge ne peut, sinon aux fins de partage, autoriser la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit, contre la volonté de l’usufruitier ». En établissant ce principe, le législateur entendait consolider la protection de l’usufruitier, considéré comme la partie économiquement et juridiquement la plus vulnérable dans le cadre du démembrement de propriété. L’objectif était de garantir une stabilité accrue des relations patrimoniales et de prévenir les abus susceptibles de découler des demandes de licitation.
Toutefois, ce texte, bien qu’introduit aux fins de clarification, a suscité des interprétations divergentes en doctrine et en jurisprudence. Certains commentateurs ont estimé qu’il affranchissait le juge des conditions posées auparavant par la jurisprudence pour ordonner la licitation de la pleine propriété. D’autres ont vu dans cette disposition une simple continuité des solutions antérieures, avec un renforcement des garanties procédurales pour l’usufruitier. Cette ambivalence a conduit à des décisions contrastées, dont l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 1982 constitue une illustration majeure. Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé que « le partage peut toujours être ordonné et qu’à cette fin, selon l’article 815-5 du Code civil, la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit peut être judiciairement ordonnée contre la volonté de l’usufruitier » (Cass. 1ère civ., 11 mai 1982, n° 81-13.055).
Cette décision a néanmoins suscité de vives critiques, notamment en raison de ses répercussions sur la situation des usufruitiers universels, et en particulier des conjoints survivants gratifiés de l’usufruit de toute la succession. Ces critiques, alimentées par des considérations doctrinales, ont conduit le législateur à intervenir à nouveau avec la loi du 6 juillet 1987. Ce texte a modifié l’article 815-5 du Code civil, en précisant explicitement que « le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier ». Désormais, le consentement explicite de l’usufruitier est requis, renforçant ainsi la protection de ce dernier dans les situations de licitation.
Cette évolution législative a marqué un tournant dans la régulation des conflits entre nus-propriétaires et usufruitiers, en restreignant davantage les possibilités d’imposer une licitation judiciaire. Si l’objectif de sortir de l’indivision demeure légitime, il ne peut plus se faire au détriment des droits fondamentaux de l’usufruitier. La réforme a également confirmé que l’usufruitier pouvait imposer aux nus-propriétaires une licitation dans des hypothèses spécifiques, notamment lorsque cette solution apparaissait comme la seule protectrice des intérêts des parties.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1987, la jurisprudence avait déjà admis de telles possibilités dans des situations où l’assiette de l’usufruit ne pouvait être déterminée autrement. L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 1996 illustre parfaitement ce principe (Cass. 1ère civ. 19 nov. 1996, n° 94-22.052).
Dans cette affaire, il était question d’un immeuble hypothéqué dont un indivisaire détenait les deux tiers en pleine propriété et un tiers en nue-propriété, tandis qu’un autre indivisaire en possédait l’usufruit. La société créancière avait sollicité la liquidation-partage de l’indivision et la licitation de la pleine propriété de l’immeuble, invoquant l’insolvabilité du débiteur principal et l’insuffisance de la garantie hypothécaire en raison des fluctuations du marché immobilier. La Cour d’appel avait accueilli cette demande, considérant que la licitation était nécessaire à la protection des intérêts de toutes les parties.
La Cour de cassation a confirmé cette décision, en soulignant que la licitation préalable de l’immeuble était justifiée par l’impossibilité matérielle de mettre en œuvre le tiers en usufruit détenu par l’un des indivisaires sur cet immeuble. Elle a également précisé que cette solution était indispensable pour permettre la détermination de l’assiette de l’usufruit et pour préserver les intérêts patrimoniaux des parties. En statuant ainsi, la Haute juridiction a consolidé le principe selon lequel la licitation de la pleine propriété peut être imposée dans des situations où le partage en nature est matériellement impossible et où la licitation constitue la seule solution viable pour garantir les droits de chacun.
Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes établis par la jurisprudence antérieure, qui admettait la possibilité d’une vente par autorité de justice dans des configurations exceptionnelles. Elle illustre également l’équilibre délicat que la loi et la jurisprudence cherchent à maintenir entre les droits des usufruitiers et ceux des nus-propriétaires, en prenant en compte les réalités économiques et patrimoniales tout en respectant les principes fondamentaux du démembrement de propriété.
- F. Zenati-Castaing, Les biens, éd. PUF, 2008, p. 347. ?
- Ph. Malaurie, L. Aynès et M. Julienne, Les biens, éd. Lextenso, p. 819. ?
- M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. IV, par J. Maury et H. Vialleton, éd. LGDJ, 1956, n° 495, p. 693. ?
- F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, les libéralités,éd. Dalloz, 2014, n° 1013, p. 893. ?
- J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°743, p. 696 ?
- J. Flour et G. Champenois, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand Colin, 2001, n°743, p. 696 ?
- Cet exemple nous est donné par Michel Hoguet, rapporteur de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, dans le cadre des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 28 décembre 1967 ?
- V. en ce sens l’article 953 du Code civil ?
- F. terré et Ph. Simler, Droit civil – Les régimes matrimoniaux, éd. Dalloz, 2011, n°800, p. 647. ?
- P. Simler et P. Hilt, « Le nouveau visage du Pacs : un quasi -mariage », JCP G, 2006, 1, p. 161. ?
- F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil, Les successions, les libéralités,éd. Dalloz, 2014, n° 1013, p. 893. ?