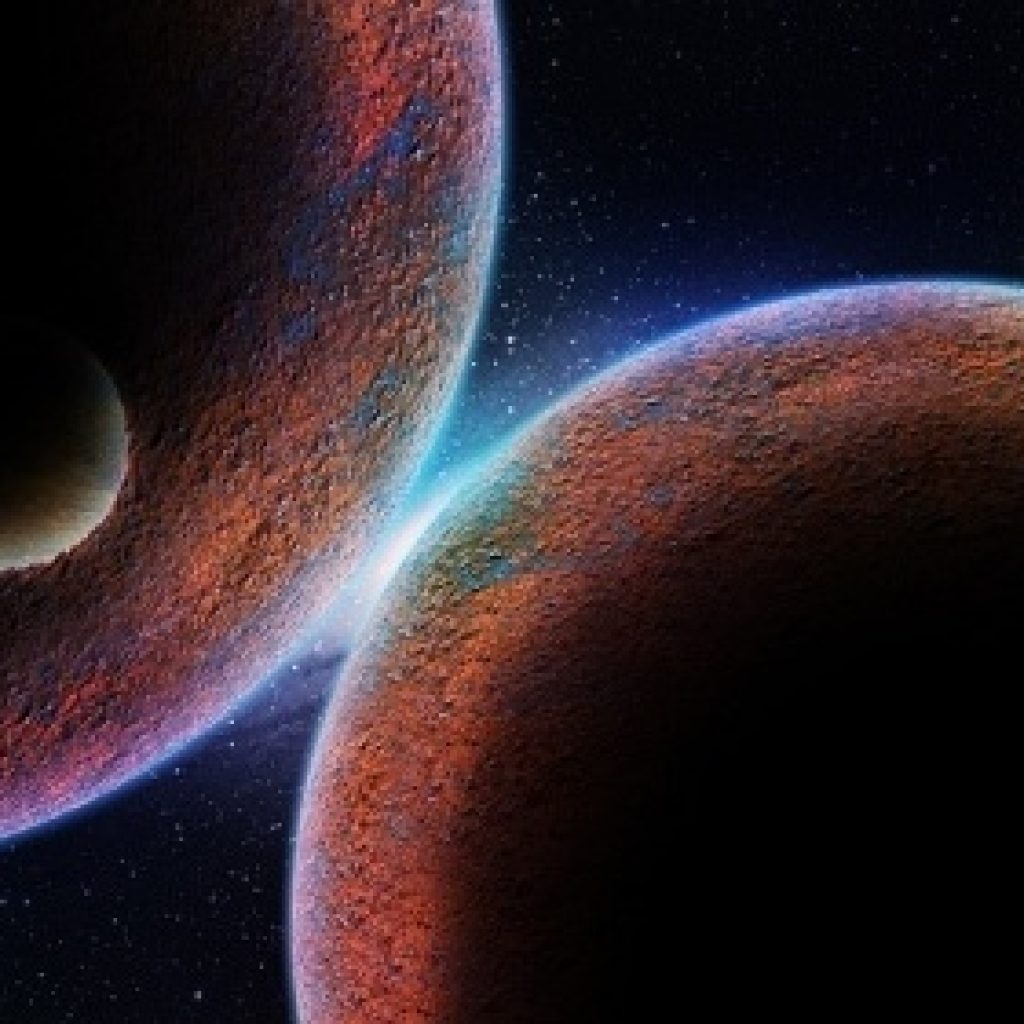Schématiquement, l’univers juridique se décompose en deux domaines bien distincts :
- Le domaine des actes juridiques
- Le domaine des faits juridiques
Sous l’empire du droit antérieur, le Code civil ne définissait aucune de ces deux notions. Reste que, comme souligné par le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les notions d’actes et de faits juridiques « sont bien connues en doctrine et en jurisprudence, et sont très usitées par les praticiens du droit, même s’il peut exister des controverses quant à leurs définitions et contours exacts, pour qualifier un comportement et lui appliquer le régime juridique adéquat. »
Aussi, afin de clarifier le sens de ces notions, le législateur leur a donné une définition qui est dorénavant énoncée aux articles 1100-1 et 1100-2 du Code civil.
L’intérêt de la distinction entre les actes et les faits juridiques est triple :
- L’étendue des effets des faits juridiques est strictement délimitée par la loi, alors que les effets des actes juridiques sont déterminés par les parties à l’acte, la seule limite étant la contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs ( 6 C. civ.)
- Tandis que la preuve des actes juridiques suppose la production d’un écrit ( 1359 C. civ.), la preuve des faits juridiques est libre (art. 1358 C. civ.)
- Le Code civil appréhende les différentes sources d’obligations autour de la distinction entre les faits et les actes juridiques, lesquels constituent précisément les deux grandes catégories de sources d’obligations avec la loi.
I) Les actes juridiques
Ils sont définis à l’article 1100-1 du Code civil comme « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. »
Il ressort de cette définition que les actes juridiques sont la conjonction de deux éléments : une manifestation de volonté et la production d’effets de droit voulus :
==> Des manifestations de volonté
L’acte juridique suppose l’extériorisation d’une intention en vue de générer des conséquences juridiques.
L’acte juridique repose donc sur la manifestation de volonté de son auteur, lequel recherche la production d’effets de droit
- Exemple: un contrat, une démission, une déclaration de naissance, l’acceptation d’une succession etc.
Comme souligné par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, « fondamentalement, tous les actes juridiques se caractérisent, comme actes volontaires, par la direction que prend la volonté (car les faits juridiques peuvent aussi être volontaires). »
Reste que dans l’acte juridique, « la volonté est toujours tendue vers l’effet de droit consciemment perçu et recherché par son auteur (ce que traduisent les mots-clé « destinés », « en vue »).»
À cet égard, l’acte juridique peut résulter de l’expression d’une pluralité de volontés ou d’une volonté unique.
Dans le premier cas l’acte sera conventionnel, tandis que dans le second cas il sera unilatéral.
L’article 1100-1 du Code civil précise en ce sens que les actes juridiques peuvent être « conventionnels ou unilatéraux».
- Les actes juridiques conventionnels
- Les actes juridiques conventionnels forment la catégorie des contrats.
- Par contrat, il faut entendre, selon l’article 1101 du Code civil, « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
- L’un des éléments essentiels qui caractérise le contrat est d’être le produit d’un accord d’au moins deux volontés.
- Quand bien même le contrat ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie, ce qui pourrait inciter à le classer dans la catégorie des actes unilatéraux, il requiert toujours la rencontre de plusieurs volontés.
- Aussi, on qualifie d’unilatéral un contrat, non pas parce qu’il est le produit d’une manifestation unilatérale de volonté, mais parce que, en pareil cas, une seule partie s’oblige sans qu’il y ait d’engagement réciproque de l’autre partie.
- L’article 1106 du Code civil pose en ce sens que :
- Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
- Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci.
- Les actes juridiques unilatéraux
- Contrairement à l’acte juridique conventionnel, l’acte juridique unilatéral n’est défini par aucune disposition du Code civil.
- L’avant-projet de réforme du droit des obligations avait pourtant proposé de le définir comme « un acte accompli par une seule ou plusieurs personnes unies dans la considération d’un même intérêt en vue de produire des effets de droit dans les cas admis par la loi ou par l’usage. »
- Il ressort de cette définition que l’acte unilatéral se distingue de l’acte conventionnel en deux points :
- En premier lieu, il n’est pas le produit d’une rencontre de plusieurs volontés, mais la manifestation d’une volonté unique.
- En second lieu, l’acte unilatéral est établi « dans la considération d’un même intérêt», alors que l’acte conventionnel est porteur d’une pluralité d’intérêts divergents ou opposés.
==> La production d’effets de droit voulus
Une manifestation de volonté ne suffit pas à créer un acte juridique, il faut encore que cette volonté soit exprimée en vue de produire des effets de droit.
Autrement dit, il faut que le ou les auteurs de l’acte aient intentionnellement recherché des conséquences juridiques.
Lorsque, par exemple, deux personnes décident de conclure un contrat, les obligations stipulées dans cet acte conventionnel sont toujours voulues.
La volonté de produire des effets de droit est également présente lorsqu’un salarié décide de démissionner de ses fonctions ou lorsqu’un héritier accepte une succession.
C’est là une différence fondamentale avec les faits juridiques dont les conséquences juridiques ne sont jamais voulues.
À cet égard, selon que l’acte juridique est conventionnel ou unilatéral, les effets produits sont différents.
Effectivement, ce qui fondamentalement distingue l’acte juridique unilatéral de l’acte juridique conventionnel, c’est qu’il n’est jamais générateur d’obligations.
Il ne produit que quatre sortes d’effets de droit :
- Un effet déclaratif: la reconnaissance de paternité
- Un effet translatif: le testament
- Un effet abdicatif: la renonciation, la démission
- Un effet extinctif: la résiliation
Il peut être relevé le cas particulier de l’engagement unilatéral de volonté :
- À la différence de l’acte juridique unilatéral, l’engagement unilatéral de volonté est générateur d’obligations
- À la différence du contrat unilatéral, la validité de l’engagement unilatéral de volonté n’est pas subordonnée à l’acceptation du créancier de l’obligation
Compte tenu des caractéristiques de l’engagement unilatéral de volonté, la question s’est posée de savoir s’il pouvait être classé parmi les actes juridiques.
Le rapport au Président de la République dont est assortie l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a répondu positivement à cette question en indiquant que « en précisant que l’acte juridique peut être conventionnel ou unilatéral, [cela] inclut l’engagement unilatéral de volonté, catégorie d’acte unilatéral créant, par la seule volonté de son auteur, une obligation à la charge de celui-ci. »
II) Les faits juridiques
Ils sont définis à l’article 1100-2 du Code civil comme « des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit».
Cette définition se rapproche très étroitement de celle qui avait été proposée par Gérard Cornu dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription.
Cet auteur avait en effet indiqué que « si, en eux-mêmes, les faits juridiques sont dans une grande diversité, comme agissements (individuels ou collectifs) ou comme événements (faits divers particuliers, économiques, politiques, naturels, etc) c’est toujours la loi qui leur attache l’effet de droit qu’elle détermine (lequel ne correspond évidemment pas s’il s’agit de faits volontaires, au propos délibéré de leur auteur)».
Ainsi, ce qui caractérise les faits juridiques c’est que, d’une part, ils consistent en des agissements ou des événements et que, d’autre part, les conséquences juridiques qu’ils produisent ne sont pas voulues.
==> Des agissements ou des événements
Les faits juridiques peuvent donc consister, soit en des événements, soit en des agissements.
- Des agissements
- Un agissement n’est autre qu’une conduite humaine, soit un fait de l’homme, lequel peut être volontaire ou involontaire, individuel ou collectif, licite ou illicite
- Il peut s’agir d’une fraude, d’une pratique sportive, de la manipulation d’un instrument ou d’un outil etc.
- Un événement
- Un événement est un fait qui survient indépendamment de la conduite humaine.
- Il peut notamment s’agir d’un fait naturel, d’un politique ou encore d’un fait économique
==> La production d’effets de droit non voulus
Le fait juridique se distingue de l’acte juridique en ce que les effets de droit qu’il est susceptible de produire n’ont pas été voulus.
- Exemple: un accident de voiture, la dissimulation d’un objet, une tornade, les blessures infligées à autrui etc…
Les conséquences attachées au fait juridique ne sont ainsi jamais recherchées, y compris lorsque le fait consiste en un agissement volontaire.
À titre d’illustration les coups portés à une personne dans le cadre d’une altercation : la conduite est volontaire, mais les conséquences juridiques (paiement de dommages et intérêts et/ou peine d’emprisonnement) ne sont pas voulues.
Aussi, les effets de droit attachés au fait juridique résultent, non pas d’une volonté humaine, mais de la loi.
Autrement dit, c’est la loi qui détermine les effets de droit attachés aux faits juridiques.
Pour qu’un fait produise des effets juridiques, il devra dès lors répondre aux conditions fixées par le législateur.
En cas de litige, c’est au juge qu’il reviendra de vérifier que ces conditions sont bien réunies.
Au nombre des effets susceptibles d’être produits par un fait juridique, on compte notamment :
- Les obligations délictuelles qui résultent de faits illicites intentionnels
- Les obligations quasi-délictuelles qui résultent de faits illicites non intentionnels
- Les obligations quasi-contractuelles qui résultent de faits licites purement volontaires
Il peut être observé que les obligations ne sont pas les seuls effets pouvant être produits par un fait juridique.
Il en est certains qui, à cet égard, produisent l’effet inverse : un événement climatique qui constitue un cas de force majeur est par exemple de nature à neutraliser une obligation ou à justifier le retard de son exécution.