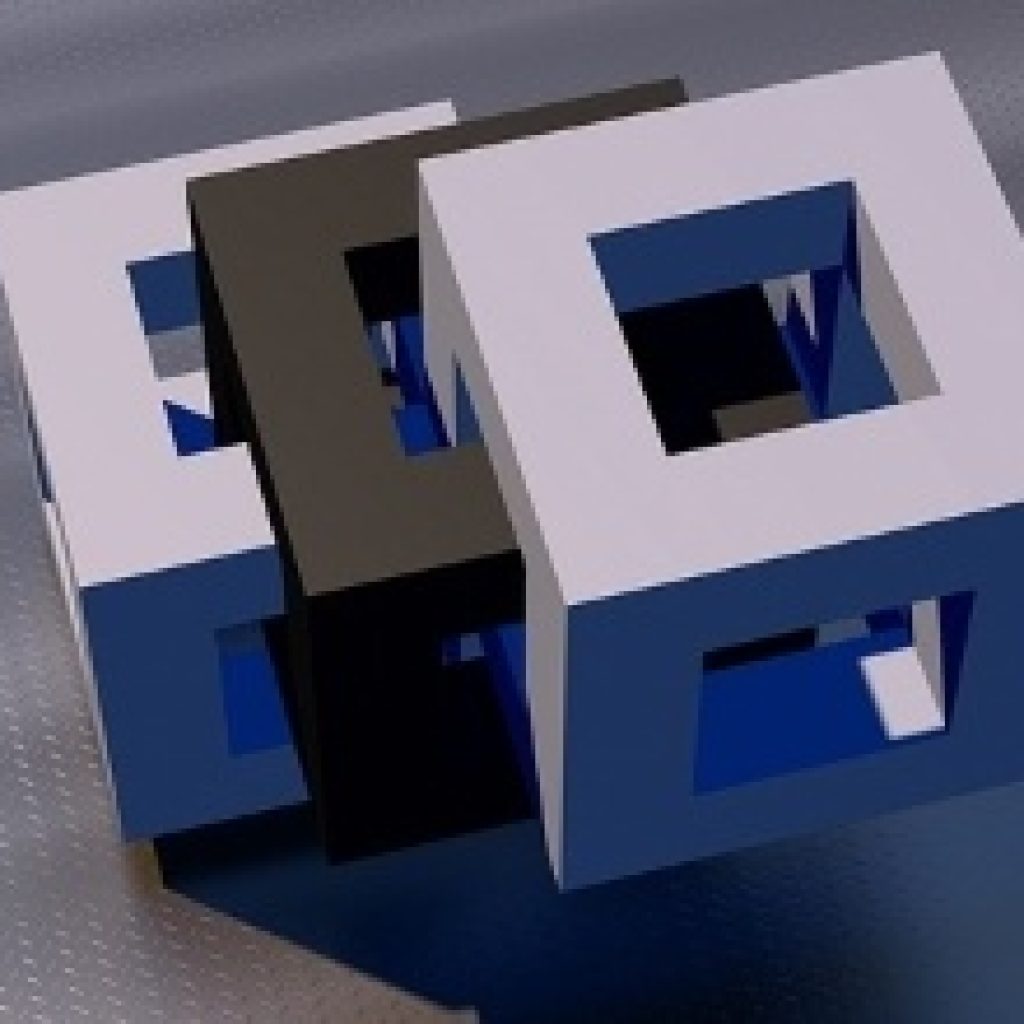==> Théorie du fait constant
Parce que « la preuve juridique est une preuve judiciaire »[9], elle ne doit être rapportée que si le fait dont se prévaut l’une des parties au procès est contesté.
Cette exigence est issue de la « théorie du fait constant » développée par Motulsky qui a soutenu que « pour que se pose la question de la preuve, il faut donc une contestation ; un fait reconnu ou simplement non contesté n’a pas besoin d’être prouvé »[10].
Cet auteur explique que pour que les parties à un procès puissent espérer voir prospérer leurs prétentions, il leur échoit d’accomplir deux tâches bien distinctes :
- Première tâche : l’allégation des faits
- La première tâche qui incombe à une partie qui se prévaut de l’application d’une règle de droit est d’alléguer les faits qui justifient son application
- Cette exigence est énoncée à l’article 6 du Code de procédure civile qui prévoit que « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder».
- Il ne s’agit pas, à ce stade, de prouver les faits qui ont concouru à la situation présentée au juge, mais seulement de les lui exposer, pourvu qu’ils soient pertinents.
- Car rappelle Motulsky, avant de s’intéresser à la preuve du fait, le juge va d’abord chercher à déterminer s’il existe « une coïncidence totale entre les éléments générateurs du droit réclamé et les allégations du demandeur»[11].
- Dans l’affirmative, le juge devra tenir pour vrai le fait allégué et faire droit à la prétention du demandeur, sauf à ce que s’élève une contestation du défendeur.
- Seconde tâche : la preuve des faits
- Ce n’est que dans l’hypothèse où le défendeur oppose une résistance au demandeur que ce dernier sera tenu de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
- À cet égard, comme souligné par Motulsky « la position du défendeur n’intéresse […] le juge qu’à condition que le défendeur nie la réalité de l’une au moins des circonstances faisant écho aux éléments générateurs [du droit invoqué par le demandeur]»[12].
- Aussi l’objet de la preuve est-il circonscrit aux seuls faits qui sont contestés
La doctrine a tenté de justifier la théorie du fait constant soutenue par Motulsky en convoquant le principe dispositif et le dispositif de l’aveu judiciaire :
- Le principe dispositif
- Ce principe est énoncé à l’article 4, al. 1er du Code de procédure civile qui prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
- Parce que donc ce sont les parties qui déterminent le périmètre du procès, seuls les faits qu’elles entendraient soumettre à la discussion devraient être prouvés.
- Les faits qui ne feraient l’objet d’aucune contestation s’imposeraient donc au juge qui n’aurait d’autre choix que de les tenir pour vrai.
- D’ailleurs, l’article 7, al. 1er prévoit que « le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. »
- Bien que l’argument soit séduisant, il se heurte notamment au second alinéa de l’article 7 qui dispose que « parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »
- L’article 8 confère, en outre, au juge le pouvoir d’« inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.»
- De toute évidence, le principe dispositif peine à justifier la théorie du fait constant.
- L’aveu judiciaire
- D’aucuns ont avancé que si un fait contesté n’a pas besoin d’être prouvé, c’est parce que l’absence de contestation par le défendeur s’analyse à un aveu tacite.
- Or l’aveu compte parmi les modes de preuve.
- À cet égard, l’article 1383-2 du Code civil prévoit, d’une part, que l’aveu judiciaire « fait foi contre celui qui l’a fait», d’autre part, qu’« il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. »
- Là encore, l’argument ne convainc pas.
- Compte tenu des conséquences attachées à l’aveu judiciaire, il serait dangereux d’admettre qu’il puisse s’induire du silence d’une partie.
- La définition qui en est donnée par le premier alinéa de l’article 1383-2 du Code civil semble d’ailleurs s’y opposer.
- Cette disposition prévoit que « l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. »
- Une déclaration consiste toujours en un acte positif et plus précisément en la manifestation d’une volonté.
- Dès lors, il y a une incompatibilité entre l’aveu et la reconnaissance tacite d’un fait.
Au bilan, aucun des deux arguments portés par la doctrine ne parvient à justifier la théorie du fait constant. Cela n’a toutefois pas empêché sa réception en droit positif.
==> Réception de la théorie du fait constant en droit positif
L’examen de la jurisprudence révèle que la théorie du fait constant a été reconnue dans de nombreuses décisions.
Dans un arrêt du 16 novembre 1972, la Cour de cassation a, par exemple, censuré une Cour d’appel qui, pour refuser à des salariés le remboursement de frais de voyages a retenu que les états produits par chacun d’eux ne constituaient pas la preuve qu’il avait bien effectué les voyages.
La Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu au motif qu’un salarié « n’est tenu de rapporter cette preuve que si la réalité du voyage est déniée par l’employeur débiteur des remboursements » (Cass. soc. 16 nov. 1972, n°72-40.080).
La Chambre commerciale a statué dans le même sens dans un arrêt du 2 mai 1989 à propos de créances tirées d’effets de commerce déclarées au passif d’une procédure collective.
Faute d’avoir été contestées par le débiteur, la Cour de cassation a estimé que les créances déclarées devaient être admises au passif de la procédure (Cass. com. 2 mai 1989, n°87-17.159).
Si les décisions admettant l’absence de nécessité de rapporter la preuve d’un fait non contesté soit nombreuses, certaines ont semé le trouble quant à l’assimilation en droit positif de la théorie du fait constant.
Dans un arrêt du 10 mai 1991, la Cour de cassation a notamment jugé qu’une Cour d’appel « n’était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu’ils n’avaient pas été expressément contestés par les autres parties » (Cass. 2e civ. 10 mai 1991, n°89-10.460).
Ainsi dans cette décision, la Deuxième chambre civile considère-t-elle que le juge n’est nullement obligé de tenir pour vrai un fait dès lors qu’il n’est pas contesté. Il S’agit là d’une simple faculté qu’il est libre d’exercer.
Cette approche a été partagée par la Chambre commerciale qui, dans un arrêt du 10 octobre 2000, a décidé que « le juge n’est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu’il n’est pas expressément contesté » (Cass. com. 10 oct. 2000, n°97-22.399).
Il s’infère de ces décisions que la théorie du fait constant est pour le moins fragile, sinon remise en cause. Le juge demeure, en effet, toujours libre de ne pas réputer comme établi un fait qui ne serait pas contesté.
Il semble donc falloir s’en tenir à la règle énoncée à l’article 9 du Code de procédure civile qui n’opère aucune distinction entre les faits à prouver. En application de cette disposition il incombe à chaque partie d’établir « les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
À cet égard, dans un arrêt du 18 avril 2000, la Cour de cassation a jugé que « le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait » (Cass. 1ère civ. 18 avr. 2000, n°97-22.421).
Autrement dit, le silence du défendeur ne saurait dispenser le demandeur de prouver les faits qu’il allègue.
[1] F. Terré, Introduction générale au droit, éd. Dalloz, 2000, n°487, p. 516.
[2] C. Aubry et C. Rau, Droit civil français, 6e éd. 1958, T. 12, par P. Esmein, p. 52.
[3] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°115, p. 128
[4] F. Terré, Introduction générale au droit, éd. Dalloz, 2000, n°488, p. 516.
[5] C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d’après la méthode de Zachariea, éd. Hachette Livre – BNF, p. 153
[6] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil – Introduction générale, éd. LGDJ, 1977, n°576, p.452.
[7] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°85, p. 87.
[8] R. Beudant et P. Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 9, Les contrats et les obligations, par G. Lagarde et R. Perrot, 1953, Rousseau, n°1170.
[9] J. Ghestin et G. Goubeaux, Droit civil – Introduction générale, éd. LGDJ, 1977, n°563, p.441.
[10] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°115, p. 128.
[11] H. Motulsky, Principes d’une réalisation méthodique du droit privé, thèse, Lyon, 1947, éd. Dalloz, 2002, n°107, p. 114.
[12] H. Motulsky, op. cit., n°109, p. 119.
[13] P. Mayer et V. Heuzé, Droit international privé, éd. LGDJ, 2001, n°179
[14] G. Cornu, Vocabulaire juridique, éd. Puf, 2005, V. Coutume, p. 248